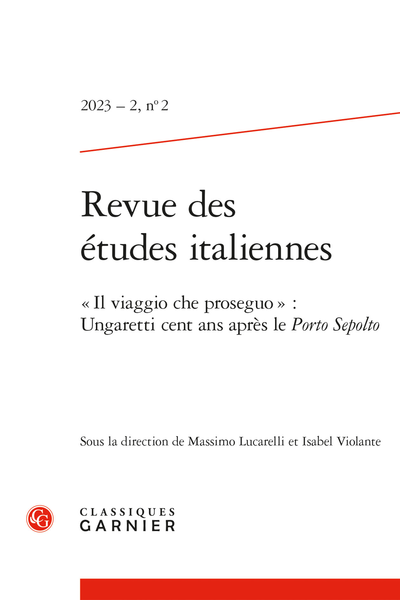
Comptes rendus
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Revue des études italiennes
2023 – 2. « Il viaggio che proseguo » : Ungaretti cent ans après le Porto Sepolto - Auteurs : Gendrat-Claudel (Aurélie), Chiquet (Olivier), Savoretti (Moreno), Maver Borges (Laura)
- Pages : 135 à 158
- Revue : Revue des Études Italiennes
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406159568
- ISBN : 978-2-406-15956-8
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15956-8.p.0135
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 20/12/2023
- Périodicité : Semestrielle
- Langues : Français, Italien
Niccolò Tommaseo, Canti corsi, a cura di Annalisa Nesi, Parma, Fondazione Pietro Bembo – Ugo Guanda Editore, 2020, p. 940, € 65.
Après les deux beaux volumes des Scintille (2008) et des Canti greci (2017), procurés respectivement par Francesco Bruni et Elena Maiolini, l’éditeur Ugo Guanda poursuit son entreprise, dirigée par Francesco Bruni, de publication des poésies populaires recueillies et commentées par Tommaseo (les Canti popolari toscani corsi illirici greci publiés à Venise en 1841) et propose au lecteur les Canti corsi, dans une remarquable édition d’Annalisa Nesi, linguiste et philologue, professeure à l’Université de Sienne et spécialiste des relations linguistiques et culturelles entre Toscane et Corse, ce qui lui vaut de s’intéresser de longue date à Tommaseo et à son séjour à Bastia en 1838-1839.
Tommaseo découvre la Corse après l’expérience de l’exil volontaire à Paris, suivi d’un passage à Nantes qui ne l’enchante guère, si ce n’est qu’il lui permet de découvrir la Bretagne. Quelles que soient les déconvenues dont Tommaseo fait part notamment dans ses mémoires (Diario intimo), la Corse se présente comme un asile ardemment désiré et une terre de traditions populaires, opposée à la « civilisation » incarnée par Paris, que Tommaseo abhorre. Recommandé notamment par Vieusseux, Tommaseo est accueilli à Bastia par l’élite intellectuelle de la ville (Salvatore Viale, Giuseppe Multedo…) : à travers certains des personnages d’envergure européenne fréquentés à Bastia, Tommaseo se retrouve, malgré la taille réduite de la ville, au cœur d’échanges internationaux lui permettant, entre autres, de publier la correspondance de Pascal Paoli. C’est aussi en Corse que Tommaseo achève la rédaction de ses mémoires politiques, pensés pour être posthumes (Un affetto. Memorie politiche, paru en 1974), et écrit, avec une rapidité remarquable, Fede e bellezza. La fertilité littéraire de cette expérience insulaire, marquée aussi par les ravages de la syphilis, le deuil et la réflexion nécessairement tourmentée que Tommaseo engage sur ses origines dalmates (en partie grâce à ses rapports avec Adolphus Petri-Palmedo), doit sans doute quelque chose 136à la « proximité distante » qui caractérise les rapports de la Corse et de l’Italie : avec un regard à la fois étranger et familier, Tommaseo observe les points de contact, mais aussi les différences, entre Corse et Italie, sans omettre de critiquer le rôle que les institutions et la culture françaises jouent dans le processus complexe de modernisation de l’île, au risque d’une uniformisation culturelle et linguistique que l’écrivain italien déplore. Le recueil des chants populaires corses correspond donc à la convergence de multiples intérêts, qui touchent à l’idée même de poésie populaire et orale, à la question de la langue, à l’identité méditerranéenne, aux us et coutumes, à la vie sociale (Tommaseo se passionne pour les procès aux Assises, auxquels il assiste très régulièrement, fasciné par la violence de cette île où « tout [se] fait à coups de fusil », comme le constatait un procureur français en 1840). La sélection des textes, où les chants funèbres (vóceri) occupent une place essentielle, la façon de les ordonner, les commentaires introductifs et les notes infrapaginales (de nature essentiellement linguistique) composent un document unique à la fois sur la culture corse et sur la personnalité de Tommaseo.
La très riche Introduzione (p. ix-lxxxiv) d’Annalisa Nesi éclaire parfaitement le contexte, historique et personnel, du recueil des textes (transmis par différents personnages) et de la rédaction des Canti corsi. Elle permet de comprendre comment la perception d’une parenté culturelle et linguistique profonde entre la Corse et l’Italie ne débouche pas, chez Tommaseo, sur une quelconque forme d’irrédentisme, mais bien plutôt sur la recherche d’une identité pan-méditerranéenne (qui inclut, entre autres, la Grèce), fondée sur un langage poétique et des valeurs communes, par-delà les différences régionales. Annalisa Nesi insiste également sur l’importance de considérer les Canti corsi non pas comme un simple recueil commenté de poésies populaires, mais comme un véritable prosimètre qui permet d’« insérer les textes dans un tissu interprétatif qui n’est pas tributaire de l’ordre thématique » (p. xxxvii) et qui révèle une « forte participation émotive » (p. xxxix), accentuée par un style particulier, au rythme souvent saccadé et à la syntaxe volontairement hachée. La présentation des discussions de Tommaseo avec Salvatore Viale permet de mettre en lumière deux conceptions différentes de la transcription de la poésie orale, Tommaseo étant conscient des risques que les coupes opérées et la régularisation 137formelle (qui n’exclut pas les oscillations graphiques, morphologiques et syntaxiques dans la restitution des dialectes corses) font courir à l’expressivité de textes dont certains relevaient de l’improvisation chantée. Parmi les concepts qui guident le travail linguistique et ethnographique de Tommaseo, ceux de puissance et d’efficacité paraissent avoir davantage de poids que celui de « pureté » : en ce sens, la pensée tommaséenne de la poésie populaire relève moins d’une quête des origines que d’un souci plus universel (et plus littéraire) d’expressivité, bien que la conservation des traditions, du sentiment religieux et de la langue soit une préoccupation constante. C’est aux Corses eux-mêmes que Tommaseo s’adresse pour amender au besoin son travail : « Che se in questi od in altro è sbagliato, certo gli sbagli non vengono da irriverenza o da disamore. I Corsi correggano, e le ricchezze nascoste ne’ lor monti nascoste cavino essi ed affinino. » (p. 134), écrit Tommaseo pour présenter la transcription d’un chant magnifique dans lequel une jeune femme pleure la mort de son frère bandit, « largu di spallera » et « minutu di vita » (p. 136).
Grâce aux très nombreuses notes d’Annalisa Nesi, qui portent aussi bien sur le discours de Tommaseo que sur les textes corses et qui croisent informations historiques et précisions linguistiques, le lecteur profite pleinement de cette œuvre rhapsodique et atypique, faite de nouvelles, de chants, de poésies, de récits, d’anecdotes et de « choses vues », de réflexions sur l’histoire, les passions et les mœurs, la vendetta et la justice, dessinant une image de la Corse à mettre en perspective et à déconstruire. Un exemple parmi tant d’autres de l’utilité du commentaire d’Annalisa Nesi : rapportant le cas d’un « poveretto » condamné pour le meurtre d’un médecin, amant de sa femme, Tommaseo estime que la peine a été particulièrement sévère en raison de la différence de statut social entre l’assassin et la victime, alors même que le délit d’honneur lui apparaît comme l’une des vengeances les moins inexcusables (p. 111). La note qui accompagne ce passage, citant les observations de Salvatore Viale sur la même affaire, révèle que la peine (quatre ans de prison) était au contraire plutôt légère pour un homicide. On a là un éclairage précieux sur les différents biais qui conditionnent les observations de Tommaseo, homme du xixe siècle prompt à trouver des circonstances atténuantes au « crime passionnel », mais aussi penseur politique obnubilé par la question des inégalités sociales. On ne peut donc que se réjouir de la 138publication de cette édition, qui permet une véritable approche critique de cette œuvre originale, dont l’intérêt dépasse le cercle des spécialistes de culture corse.
Aurélie Gendrat-Claudel
*
* *
Alejandro Patat, Costellazione Rovani. « Cento anni », un romanzo illustrato, Pisa, Pacini, 2021, p. 360, € 21.
Alejandro Patat, chercheur à l ’ Università per stranieri de Sienne et spécialiste de la littérature du xixe siècle (de Leopardi à Nievo) et des rapports entre culture italienne et culture ibérique et latino-américaine, propose ici au lecteur une monographie ambitieuse et tout à fait originale sur l ’ inclassable roman de Giuseppe Rovani, Cento anni, magistrale fresque qui raconte un siècle d ’ histoire italienne, et plus précisément milanaise, de 1750 à 1850, en faisant le choix d ’ insister sur certaines années particulières (au détriment de décennies entières passées sous silence), et sur l ’ histoire privée et intime de familles dont on suit l ’ évolution sur plusieurs générations. Là où Manzoni montrait dans Les Fiancés la violente intrusion de la grande histoire (famine, guerre, peste) dans la petite histoire de deux héros modestes, Rovani propose une immersion dans l ’ histoire intime et les menus faits privés, faisant l ’ hypothèse d ’ une sorte d ’ effet papillon : les grands événements historiques pouvent avoir des causes dérisoires qu ’ il faut aller chercher dans les alcôves, les coulisses des théâtres et les salons des aristocrates ou des parvenus (l ’ un des personnages les plus marquants est un laquais, surnommé « Il Galantino », qui deviendra fermier puis banquier, illustrant par son ambition la mobilité socio-économique caractéristique 139 de la modernité). Ambitieux, tentaculaire, « cyclique », comme le dit son sous-titre, Cento anni est bien considéré comme le chef d ’ œuvre de Rovani, mais il peine à trouver une place stable dans le canon littéraire et reste peu connu (et peu traduit) en dehors de l ’ Italie, bien que les récentes études universitaires sur la biographie de l ’ auteur, sur les vicissitudes éditoriales du texte, d ’ abord publié en feuilleton dans la Gazzetta di Milano de 1856 à 1863, et sur la représentation de l ’ histoire et de la société italiennes aient contribué, en même temps que l ’ édition de poche BUR de 2001, à tirer de l ’ oubli ce récit extraordinaire.
Faisant fond sur ces récents travaux (par Silvana Tamiozzo Goldmann, Monica Giachino, Valentino Scrima, Francesca Puliafito…), Alejandro Patat offre à Cento anni les honneurs d ’ une première monographie qui, reconstituant les problèmes littéraires, idéologiques, esthétiques du roman période historique par période historique, constitue également un formidable modèle méthodologique pour aborder des textes jugés « mineurs” », mais dont l ’ étude attentive permet de reconstituer un pan entier de l ’ histoire culturelle. Si l ’ ouvrage d ’ Alejandro Patat n ’ était qu ’ un long commentaire suivi du roman de Rovani, il serait probablement assez ennuyeux et, malgré les résumés de l ’ intrigue très pédagogiques qui ouvrent chaque chapitre, inaccessible à qui n ’ a pas lu le roman. Mais, comme le titre Costellazione Rovani l ’ indique clairement, le propos est bien plus large : il s ’ agit de faire émerger toutes les filiations, les dérivations, les influences directes et indirectes qui innervent le texte romanesque et font de Rovani un écrivain capable d ’ une réflexion très complexe sur le genre romanesque (comme le révèle le célèbre Preludio au roman) et un auteur profondément européen, qui dialogue certes avec Manzoni et les plus grandes figures italiennes du xviiie et du xixe siècle (Parini, Pietro Verri, Foscolo, Tommaseo…), mais aussi avec Balzac, Eugène Sue, Sterne et tant d ’ autres. Cette lecture rhizomique du roman, qui prend en compte la centralité des arts dans la pensée rovanienne de la culture (que son itinéraire de critique d ’ art et l ’ essai Le Tre Arti permettent de reconstituer), s ’ appuie surtout, de manière inédite, sur les nombreuses gravures (frontispices, illustrations en pleine page, fleurons, culs-de-lampe…) qui ornent l ’ édition Redaelli de 1868-1869. L ’ interprétation de ces images et de leur rapport avec le texte est délicate : contrairement à ce qui se passe pour l ’ édition définitive des Fiancés, pour laquelle les multiples interventions de Manzoni sont très 140 bien documentées, du choix des artistes à la disposition des illustrations sur la page, en passant par la composition de chaque image, on ne sait presque rien sur le rôle que Rovani a pu jouer dans la réalisation de cette édition illustrée de Cento anni, dont les images furent conçues par Luigi Borgomainerio et Giulio Gorra et gravées par Ambrogio Centenari, Francesco Canedi et Giosuè Gallieni (les uns et les autres ne se privant pas de laisser leur marque, bien visible, sur presque toutes les illustrations, flanquées de leurs noms complets ou d ’ une initiale massive). À vrai dire, l ’ opération d ’ Alejandro Patat n ’ en est que plus intéressante : puisqu ’ il est impossible de savoir si et comment Rovani est intervenu pour contrôler l ’ interaction du texte et de l ’ image, il reste à analyser ce que l ’ image fait au texte, en quoi les gravures réorientent de manière inattendue la lecture de telle ou telle scène, attirent notre attention sur un détail, dialoguent entre elles (on est frappé par le rapport spéculaire entre le frontispice, qui représente un ange de la mort planant au-dessus de symboles de l ’ Italie, notamment un drapeau affaissé, et la dernière lettrine, flottant au-dessus des signes de l ’ échec de la République de Venise en 1849, matérialisé par l ’ étendard de Saint-Marc, tout froissé à terre). Étudier ces images paraît d ’ autant plus pertinent que le roman se présente comme une réflexion sur une proto-« société du spectacle », où chaque personnage se donne à voir, se met en scène, observe, scrute, espionne et où le lecteur se fait souvent voyeur. En l ’ absence de certitude sur l ’ intervention de Rovani, l ’ hypothèse qui sous-tend le travail d ’ Alejandro Patat est que l ’ insertion des images crée une nouvelle œuvre, échappant peut-être à l ’ auteur du roman : il est donc possible de reconstituer non pas l ’ intentio auctoris, mais l ’ intentio operis, en posant à nouveaux frais la question des multiples potentialités sémantiques du roman de Rovani, caractérisé par une vision critique du Risorgimento et des transformations en cours de la société italienne. De nombreuses pistes restent bien sûr à explorer, et l ’ ouvrage d ’ Alejandro Patat laisse espérer, par exemple, des études à venir sur les liens que ces gravures entretiennent avec le monde du théâtre et de la pantomime, si important dans la création d ’ un répertoire de gestes et d ’ attitudes codifiés que le lecteur-spectateur pouvait déchiffrer immédiatement, ou encore sur les rapports des gravures de Cento anni avec d ’ autres éditions illustrées par les mêmes artistes. Il n ’ en reste pas moins que l ’ approche choisie montre, avec un enthousiasme communicatif, mais sans naïveté critique, 141 la complexité du travail romanesque de Rovani, la noirceur d ’ un roman qu ’ on aurait tort de prendre pour un simple divertissement en costumes et l ’ importance d ’ étayer les interprétations littéraires par une prise en compte globale du contexte culturel et éditorial.
Aurélie Gendrat-Claudel
*
* *
Camillo Boito, Senso et autres nouvelles vénitiennes, choix, édition et traduction de Marguerite Bordry, “Carnet italien – série Textes bilingues”, Paris, Sorbonne Université Presses, 2020, 382 p., 22 €.
Dans cette remarquable édition bilingue de cinq nouvelles de Camillo Boito, couronnée en 2021 du prix Jules Janin de l’Académie française, Marguerite Bordry entend mettre ou, plus précisément, remettre à l’honneur un écrivain encore « relativement méconnu » (p. 7), comme elle s’en explique dans son introduction. Camillo Boito est en effet aujourd’hui essentiellement connu comme le frère du compositeur et dramaturge Arrigo Boito, et comme l’auteur de « Senso », nouvelle magistrale rendue célèbre par le film de Ludovico Visconti en 1954. Or, que Camillo Boito soit ainsi devenu un écrivain mineur « n’est pas le moindre des paradoxes compte tenu de la place éminente qu’il a occupée dans les milieux culturels italiens de la fin du xixe siècle » (p. 7). Senso et autres nouvelles vénitiennes contribuera, pour sûr, à réparer pareille injustice. De surcroît, aux yeux du public français, l’œuvre littéraire de Camillo Boito paraît d’autant plus mineure que ses textes lui sont encore difficilement accessibles : « Si ‘Senso a fait l’objet de plusieurs traductions relativement récentes, ce n’est pas le cas de l’intégralité de l’œuvre de Boito, pour laquelle aucune édition critique n’est aujourd’hui 142accessible en France. Certaines nouvelles ont bien été traduites, mais il n’existe aujourd’hui aucun volume rassemblant, en français, Senso et les autres nouvelles de Boito » (p. 27). C’est dire l’importance du travail de traduction de Marguerite Bordry.
Outre Senso, donc, sur laquelle s’ouvre le volume, le lecteur français pourra y découvrir quatre autres nouvelles de Camillo Boito, présentées dans l’ordre chronologique de leur publication : La couleur à Venise (ces notes proviennent de l’album d’un artiste pédant), publiée dans la première édition des Storielle vane de 1876 ; Le collier de Bouddhaet Quatre heures au Lido, publiées dans Senso. Nuove storielle vane de 1883 ; enfin, Le maître du setticlave, intégrée à l’édition définitive des Storielle vane de 1899. Au-delà de leur évidente et jouissive variété, les écrits retenus par Marguerite Bordry se caractérisent par une double unité, temporelle et spatiale : les cinq intrigues se déroulent entre 1850 et 1870, et, surtout, ont pour cadre la ville de Venise et sa lagune. Camillo Boito, né à Rome en 1836 et mort à Milan en 1914, et que l’histoire littéraire rattache au mouvement milanais de la Scapigliaturai, dont Arrigo constituait l’un des chefs de file, passerait presque pour un auteur vénitien. C’est qu’il connaissait parfaitement la Sérénissime, pour y avoir étudié puis enseigné l’architecture italienne, dont il fut un spécialiste de renom. Par ailleurs, « en sa qualité de membre de plusieurs commissions d’experts dans le domaine des beaux-arts, il fut amené à participer à des décisions importantes pour Venise dans ce domaine » (p. 14). Les notes accompagnant le texte, ainsi qu’un plan de Venise de 1888, guident efficacement le lecteur dans sa promenade. Marguerite Bordry a d’ailleurs judicieusement fait suivre les cinq nouvelles de la traduction de deux articles de Camillo Boito, « Chronique artistique » et « Venise qui disparaît : Sant’Elena et Santa Marta », portant respectivement sur la restauration du patrimoine vénitien et sur le devenir des quartiers de Santa Marta et de Sant’Elena.
La Venise de Camillo Boito n’est pas seulement splendide ; elle est aussi crasseuse, nauséabonde, miséreuse, en un mot sordide, reflétant ainsi la turpitude de bien des personnages des nouvelles (c’est particulièrement le cas dans Senso, Le collier de Bouddha et Le maître du setticlave) : « la Venise dépeinte par Boito est à la fois éblouissante et écœurante. En livrant une vision amère de la société vénitienne, les Storielle vane mettent aussi l’accent sur la réalité d’un espace urbain démythifié » (p. 26). Ainsi, l’auteur rend également compte d’une Venise mineure. 143Maniant le clair-obscur, c’est en peintre qu’il évoque cette Venise bifrons : « l’art occupe (…) une place importante dans les nouvelles de Boito, à travers les références artistiques, mais aussi les images ou les descriptions, qui empruntent souvent au champ lexical de la peinture, comme si le regard esthétisant de l’écrivain filtrait sa perception du réel » (p. 16). L’ut pictura poësis de Camillo Boito repose tout particulièrement sur le rendu de la couleur, à l’image des artistes vénitiens de la Renaissance qui, contrairement à leurs collègues florentins et romains, privilégiaient la couleur et le naturalisme au dessin et à l’imitation de la statuaire antique. On suivra par exemple, tout au long du volume, les incessantes métamorphoses des tons verts de l’eau de Venise. Tout comme le peintre qu’il met au centre de sa nouvelle « La couleur à Venise », Camillo Boito cherche donc lui aussi à être « pittoresque » : « La couleur, dans son double sens, moral et matériel, est le grand tourment de l’artiste aujourd’hui. Couleur locale : sentir et représenter une Venise qui ne puisse être autre que Venise ; couleur : émuler avec sa palette ces fanfares de teintes, ces tons tout en nuances, qui proviennent du sel de l’eau et du sirocco, des exhalaisons nauséabondes des canaux lorsqu’ils restent à sec, du ciel vaporeux, pourtant limpide et enflammé à l’aurore et incandescent au coucher du soleil, des guenilles pouilleuses de la foule des mendiants et des grandeurs des fêtes du passé, des mosaïques pompeuses de la basilique Saint-Marc et des lourdes extrémités des cheminées en forme de cône renversé : de tout le reste, en somme, de splendeurs et d’abjections – abjections et splendeurs qui ont la principale vertu, l’unique vertu qui importe à l’artiste, celle d’être pittoresques » (p. 103). Ce passage n’est pas sans rappeler une notation de Giuseppe Ungaretti dans « Poesia e pittura » (1933) : « Non potremmo dunque dire che il tentativo del Romanticismo fu du rendere pittoresca l’attività umana ? ». Dans son article « Venise qui disparaît : Sant’Elena et Santa Marta », Boito évoque d’ailleurs lui aussi « le sentiment de ce qui est artistique, pittoresque, poétique et romantique » (p. 329).
On ne saurait par conséquent trop recommander la lecture de cette splendide traduction de Marguerite Bordry, qui s’inscrit parfaitement dans le prolongement de sa monographie parue en 2019 aux Éditions Classiques Garnier, Venises mineures. Quatre écrivains italiens entre mythe et modernité (1866-1915), dans laquelle l’œuvre de Camillo Boito se trouve mis en perspective avec celui de trois autres écrivains, Enrico 144Castelnuovo, Giacinto Gallina et Gerolamo Rovetta, auteurs mineurs, mais qui le sont déjà moins grâce au travail de cette brillante spécialiste de la littérature italienne du xixe siècle et de Venise.
Olivier Chiquet
*
* *
Edmondo De Amicis, Un carrosse démocratique, traduction et annotation de Mariella Colin et Emmanuelle Genevois, “Versions françaises”, Paris, Rue d’Ulm, 2020, 458 p., 25 €.
Mariella Colin, ici secondée par Emmanuelle Genevois, poursuit son remarquable travail de médiatrice de l’œuvre de De Amicis en France, en proposant au lecteur une traduction française inédite de La carrozza di tutti (1899), accompagnée de notes et d’une postface, qui tiennent compte des dernières recherches sur De Amicis et des deux éditions récentes du texte italien (Ferrari en 2008 et Aracne en 2011). Extraordinaire journal de bord de l’année 1896, mois par mois, vue depuis le poste d’observation privilégié que constitue le tramway à Turin, à la fois théâtre, carnaval et « institution éducative » (ce sont les images de De Amicis lui-même), La carrozza di tutti est une « étude » portant sur toutes les classes de la société, du prolétariat le plus misérable à la haute bourgeoisie, et sur toutes les catégories d’individus – du « tramophile » qui sait tout des itinéraires et des horaires, à dame Quichotte, la « socialistoïde », prête aux générosités les plus extravagantes –, ainsi que sur la perception de l’actualité, et notamment de la guerre en Ethiopie. Cette étude devient singulièrement vivante et émouvante, grâce aux qualités de descripteur et d’inventeur de De Amicis, qui saisit des attitudes, des mises, des mimiques, des tics de langage permettant de caractériser des 145personnages, fugitifs ou récurrents, et qui recrée des destinées humaines poignantes ou cocasses, des « vies minuscules » que le lecteur suit pendant une année entière, passant de la comédie (ou plutôt de « l’illusion éphémère que la vie n’est qu’une comédie plaisante », p. 56) à la tragédie (on pense notamment à l’histoire pathétique d’un couple déjà âgé, aux petits soins pour son unique enfant de deux ans, que l’on aperçoit en avril ravissante et pleine de vie, puis durement éprouvée par le croup en juin, puis convalescente en septembre, et dont l’absence est terrible lors de la dernière apparition du couple endeuillé, en novembre).
Saisissant le tumulte de la vie turinoise au tournant du xxe siècle, De Amicis exerce ses talents d’observation sur des phénomènes sociaux d’une actualité troublante : le harcèlement sexuel et les remarques sexistes dont sont victimes les femmes dans les transports en commun, les incivilités, le mépris de classe, la cruauté envers les animaux (le cocher Tempesta maltraite une jument, sauvée par l’intervention d’un membre de la Société protectrice des animaux, avec l’approbation d’un « ouvrier instruit » qui déclare fermement que « les bêtes sont les camarades de travail et non les esclaves de l’homme », p. 122, laissant entrevoir la possibilité d’une solidarité interspéciste). On est frappé aussi par la modernité de certains portraits, comme celui de la prostituée vieillissante, mal fardée, aux cheveux teints, qui attire sur elle les regards de tous les voyageurs et préfère fermer les yeux : on n’est pas très loin de la description, postérieure d’une dizaine d’années, que Pirandello propose, dans L’umorismo, d’une vieille femme mal maquillée, dont l’étude permet de comprendre la différence entre le comique (l’« avvertimento del contrario ») et l’humour (le « sentimento del contrario »). Il y a bien quelque chose de pirandellien dans l’humour de La carrozza di tutti : à la caricature De Amicis préfère toujours l’empathie, « cette participation sentimentale à la joie et à la douleur d’autrui qui est la marque caractéristique de sa rhétorique », comme le souligne très justement Mariella Colin (p. 433). Dans ce « roman en tramway » et « en lanterne magique », comme l’appelle De Amicis dans une lettre à son éditeur Treves, on sent partout la fibre sociale et l’humanisme de l’écrivain piémontais, dont l’un des plus ardents désirs politiques serait de réduire les inégalités et la fracture sociale, pour aboutir à une vie commune peut-être moins haute en couleurs, mais plus juste et plus apaisée.
146La belle traduction de Mariella Colin et Emmanuelle Genevois, fluide et rythmée, permet au lecteur français d’accéder aux subtilités, souvent métalittéraires et parfois presque expérimentales, de cette longue promenade en tramway dans le Turin fin-de-siècle. On regrette peut-être le choix – explicité dans la « Note sur l’édition » placée en début de volume – de renoncer à rendre les parties dialectales du texte de De Amicis : au cours des dernières années, plusieurs traductions (celle, par exemple, de Libera nos a Malo par Christophe Mileschi) ont montré qu’il est possible, en puisant dans des ressources régionales ou en acceptant des torsions morpho-syntaxiques inédites, de restituer en français de manière efficace le plurilinguisme, mais il faut respecter la décision des traductrices de privilégier la transitivité de la lecture pour un texte dont la postface, brève mais efficace, met en lumière avant tout l’intérêt historique.
Aurélie Gendrat-Claudel
*
* *
Luca Somigli ed Eleonora Conti (a cura di), Oltre il canone. Problemi, autori, opere del modernismo italiano, Perugia, Morlacchi Editore, 2018, p. 222, € 15.
Come tutte le categorie critiche anche il modernismo risente di un’indeterminatezza e di una mobilità che ne rendono difficoltosa una definizione dai contorni certi e definitivi o, peggio ancora, un’interpretazione che abbia il carattere dell’unanimità di consensi, di valutazioni e di punti di vista, tanto più se, come nel caso specifico della letteratura italiana, si tratta di etichetta relativamente recente. Nonostante quella del modernismo sia «categoria ormai definitivamente acquisita alla storiografia 147letteraria italiana», come opportunamente ricordano nell’introduzione al volume i curatori Luca Somigli ed Eleonora Conti – e lo dimostrano gli studi di Luperini, Donnarumma, Grazzini, Tortora, Pellini, dello stesso Somigli, per fare solo qualche nome – permangono tuttavia ancora ampi margini di intervento, soprattutto nell’allargamento degli ambiti di indagine per superare il ristretto canone fin qui considerato e limitato al genere del romanzo e alla «triade Pirandello-Tozzi-Svevo» (ed in tal senso va inteso il titolo del volume).
Quanto mai opportuno, e direi necessario, appare dunque in tale prospettiva il contributo offerto da questo volume miscellaneo, saporoso di spunti e aperture per nulla scontati verso orizzonti interpretativi nuovi, nella loro volontà di considerare e affrontare la categoria critica del modernismo, e dunque di testarne la validità, con un approccio libero da condizionamenti, sovrastrutture o impostazioni aprioristiche, attraverso quello che dovrebbe essere il reale banco di prova per la tenuta di qualsiasi opzione teorica, vale a dire la verifica concreta sui testi.
Il volume si apre con il saggio diPierluigi Pellini, che ritorna sui limiti cronologici del modernismo, postulando la necessità di considerare un’estensione dei confini temporali più ampia rispetto alla netta separazione tra i due secoli teorizzata da Renato Barilli, e prendendo in considerazione un arco temporale che parte da «Flaubert e Baudelaire e non si esaurisce prima dell’avvento del postmoderno». Sotto l’etichetta del modernismo, da intendersi come «atmosfera culturale» e non come una corrente poetica unitaria, possono allora coesistere – pur con le necessarie distinzioni e le ovvie differenze poetiche, tematiche e stilistiche – esperienze apparentemente inconciliabili come il realismo ottocentesco di Verga e i romanzi di Flaiano e Gadda, il tutto osservato e proiettato in una prospettiva di longue durée che dimostri la prevalenza di punti in comune rispetto alle molte e indubbie «divergenze».
A sostegno e dimostrazione del proprio «partito preso», Pellini sottopone al vaglio della prova pratica un romanzo come La terre di Zola, comunemente considerato «l’idealtipo del romanzo ottocentesco più arretrato», per illuminarne persuasivamente i tratti che già rimandano a certe peculiarità del romanzo modernista, a partire dall’eliminazione della consequenzialità delle azioni umane e dal ridimensionamento del peso narrativo dei personaggi e delle loro scelte, che si oggettivano in una sostanziale crisi dell’agency. In un universo ripetitivo e nel quale le 148loro azioni non hanno alcun valore causale, i personaggi di Zola «trovano paradossale riscatto nell’evocazione di un canovaccio mitico, o tragico», anticipando procedimenti e immagini tipici dell’high modernism, come nella rappresentazione del conflitto edipico – per certi versi analogo a quelli presenti nei romanzi modernisti (da Dostoevskij a Svevo) –, che qui diventa, attraverso il richiamo al shakespeariano Re Lear, esempio precoce e paradigmatico di quel «metodo mitico» che troverà piena espressione nelle opere maggiori.
Al De Roberto novelliere e alla costruzione di un suo profilo modernista è dedicato il saggio di Margherita Ganeri. Attraverso la puntuale ed efficace ricognizione di alcune novelle contenute nelle due raccolte Documenti umani e L’albero della scienza condotta seguendo il fil rouge del tema dell’adulterio, il saggio mette in evidenza alcuni tratti indubbiamente modernisti della narrativa derobertiana. Una narrativa spesso ingiustamente tacciata di provincialismo e che al contrario reca in sé i segni di una profonda conoscenza della cultura europea, opportunamente indicata da Ganeri nell’affinità tematica con i tre autori più rappresentativi del canone modernista, cioè Pirandello, Svevo e Tozzi, e riconducibile all’influenza del pensiero di Schopenhauer e Nietzsche. Da quest’ultimo, in particolare, tutti deriverebbero «il relativismo della coscienza e della verità, la logica della contraddizione, l’esplosione dell’ego e la pluralità dell’io». Un relativismo che, insieme al «superamento del positivismo e del verismo» e a una «poetica aperta e definibile solo in negativo», assume un ruolo fondamentale nell’interpretazione della produzione novellistica derobertiana. Il carattere modernista di queste raccolte si manifesta proprio in una visione relativistica matura ed estrema e pienamente espressa, così come nella «gnoseologia negativa della realtà» che accomuna molte novelle: «carattere sperimentale e, dunque, modernista» che paradossalmente si può ritrovare anche nella produzione dell’ultimo periodo, in quei racconti dedicati alla grande guerra ingiustamente ricondotti dalla critica a tardivo ripiegamento su giovanili moduli veristi e da considerare invece, secondo Ganeri, quale estremo esempio di sperimentalismo e «camaleontismo stilistico» al servizio di una visione negativa della realtà insensata e priva di certezze, dunque «modernamente intesa».
Ancora sulla forma breve del racconto, o meglio sulle raccolte novellistiche di tre “giganti” del modernismo quali Pirandello, Tozzi e Svevo, 149si sofferma Massimiliano Tortora, per evidenziarne le differenti «strategie compositive». Quanto mai opportuna appare in tal senso la precisazione sulla natura della novella modernista, che si differenzia dalla novella ottocentesca in virtù non tanto, o non solo, della sua frammentarietà e dell’«abdicazione a qualsiasi progetto di totalità creata o ritrovata» (aspetti caratteristici anche del realismo), quanto del suo essere forma letteraria privilegiata nella rappresentazione di uno scacco, dell’impossibilità dell’atto narrativo di rappresentare una realtà opaca se non riconducendola a verità parziali e imperfette e non quindi a «verità ultime, definitive e totalizzanti». Si tratta di aspetti che ben si colgono nel momento in cui si pongono a confronto, come efficacemente fa Tortora, non tanto i racconti in sé, quanto le raccolte di racconti dei tre autori, in modo da metterne in luce le differenze fondamentali. Nelle Novelle per un anno di Pirandello, che dei tre è il più “ottocentesco”, si assiste all’«esplosione multidirezionale» di una realtà «magmatica», impossibile da ricondurre a un centro se non per mezzo dell’«unità posticcia data dalla raccolta». Pirandello insomma «fa discendere i frammenti sparsi» dall’unità, laddove Tozzi «invece tenta il recupero dell’unità partendo dalla periferia». Nelle ventuno novelle della raccolta Giovani la «poliedricità del reale» si concretizza nella moltiplicazione dei punti di vista e delle angolazioni da cui ricercare la verità, in un movimento centripeto che postuli l’esistenza di un centro, e dunque della verità stessa, senza tuttavia la possibilità di poterlo raggiungere. Più estrema, infine, la riflessione sveviana che, pur mantenendosi a livello progettuale in quanto non si concretizza nella pubblicazione di alcuna raccolta, presuppone l’impossibilità di giungere a verità definitive o ancor più di «elaborare sistemi di comprensione del reale totalizzanti»: non riconoscendo più un centro da cui partire o a cui ricondurre i frammenti sparsi, insomma, a Svevo non resta che «ricreare un senso prettamente immanente e umano con i frammenti che ha a disposizione».
Al complesso e nodale rapporto con le avanguardie sono riservati ben tre contributi del volume, a cominciare da quello di Tullio Pagano che propone un’interessante lettura del «saggio-manifesto» di Giovani Papini Il giorno e la notte, nel quale è possibile ritrovare non poche tematiche moderniste, a partire dalla presenza di un denominatore comune tra categorie umane diverse ma «esemplari» come i selvaggi, i fanciulli, i pazzi, i geni, in virtù del loro saper essere espressione e rappresentazione 150del potenziale creativo del genere umano «che il razionalismo dominante nella società moderna» vorrebbe soffocare e reprimere. È in questa prospettiva, allora, che acquista valore determinate, in ottica modernista, l’elemento nuovo del discorso papiniano ravvisato da Pagano, cioè la presenza del tema onirico, in quanto «luogo privilegiato per evadere dalla prigione» della vita quotidiana e detonatore in grado di esaltare la libertà creativa di ogni individuo rivelandone la vera natura originaria. Il sogno dunque come «rivincita dell’uomo primo», una rivincita tesa a ristabilire «contro il regime attuale della ragione il regime eterno del sogno», come scrive lo stesso Papini.
Mimmo Cangiano nel suo saggio corposo e persuasivo mira invece alla definizione di una «personale linea del Moderno» di Ardengo Soffici, che si sviluppa a partire dalla sua attività di critico d’arte. Proprio la conoscenza e la valutazione dell’Impressionismo francese, secondo Cangiano, consentono a Soffici di abbandonare una visione estetizzante del ruolo orfico dell’artista e di entrare «sul piano di un’immanenza disposta a misurarsi col nuovo orizzonte epistemologico che il Modernismo sta portando in gioco».
Le novità artistiche d’Oltralpe mediate e introdotte in Italia dopo il soggiorno francese si delineano nelle loro potenzialità distruttive di strutture estetiche predefinite, così come nel rapporto con le espressioni artistiche italiane vecchie e nuove, consentendo al «genio» il legame «con ciò che la sua stirpe produce come “concreto”». Muovendosi tra i due poli di Cézanne e Rimbaud, Soffici ha dunque «la possibilità teoretica di ridefinire come Stile non solo il punto formalizzante dell’arte, ma la stessa capacità di questa di oltrepassare l’astrazione e, nella sua connessione con l’elemento sociale, reindirizzare l’esistenza».
Sul rapporto tra avanguardia e modernismo ritorna infine Luca Somigli con un’argomentata e suggestiva lettura del romanzo Gli Indomabili di Marinetti che, come tanta altra produzione avanguardista, sfugge ad una troppo rigida schematizzazione, a riprova della necessità di «un’interpretazione fluida e non schematica del rapporto tra le due categorie», da intendersi «come posizioni in movimento, spesso in uno stato di flusso relativo o di sovrapposizione».
Precisazione quanto mai necessaria se, a differenza della critica angloamericana – che considera le avanguardie come una delle componenti del modernismo – la critica italiana sembra ancora ferma ad un’interpretazione 151restrittiva e oppositiva delle due categorie: «distruttivo e nichilista» l’atteggiamento delle avanguardie, e dunque «negativo», improntato alla ricerca di una «mediazione dialettica rispetto al passato», e quindi «positivo», il modernismo. Somigli osserva, sulla scorta di Donnarumma, come il romanzo marinettiano non sia ascrivibile all’avanguardia nel momento in cui non soltanto ne mette a nudo i «potenziali vicoli ciechi» attraverso l’«estetizzazione della violenza», ma prende coscienza del fallimento della fiducia nella modernità e dunque di una riconquistata autonomia dell’arte di fronte all’impossibilità della fusione tra arte e vita; al tempo stesso, tuttavia, esso non può neanche dirsi completamente modernista per la persistenza di un «pesante allegorismo» che mal si concilia con il «registro realista che costituirebbe una caratteristica specifica del modernismo». È dunque necessaria, conclude Somigli, una profonda riflessione sulla complessità e sulla molteplicità delle forme della modernità italiana, che prenda le mosse anche dalla consapevolezza dell’esistenza di una «“zona grigia” non riducibile all’una o l’altra delle due categorie in questione».
Se interessanti e ricche di prospettive risultano queste analisi condotte sulla prosa (dal romanzo, alle novelle, alla critica d’arte), altrettanto fruttuoso e in linea con lo spirito che anima il volume – cioè la volontà di «verificare la proteicità del modernismo» sottoponendolo alla prova dei testi – appare lo sconfinamento nel terreno della poesia. Ben quattro saggi sono dedicati ai suoi molteplici aspetti e ai suoi protagonisti, a partire da Ungaretti, uno fra i primi ad essere inserito nel canone modernista nonostante le differenti posizioni che hanno fin da subito animato il dibattito critico attorno alla sua opera, con la contrapposizione tra la linea di Luperini – che, sulla scorta di Guglielmi, considera Sentimento del tempo opera modernista (opzione estesa da Fichera anche a L’Allegria) – e quella di Donnarumma che nega tale impostazione, riconoscendo invece i caratteri del modernismo a Il porto sepolto e Allegria di naufragi.
Lungo una linea interpretativa non restrittiva, che offra ulteriori elementi a favore di una lettura modernista di Sentimento del tempo e che cancelli una troppo netta distinzione tra questa raccolta e L’Allegria – distinzione che non tiene nel dovuto conto le «modalità di elaborazione delle raccolte ungarettiane dagli anni Dieci agli anni Trenta» – si pone Eleonora Conti conducendo una sapiente e attenta analisi di un «ciclo» di poesie pubblicate sulla rivista parigina «Commerce» e intitolate Notes pour une poésie / Appunti per una poesia.
152La valutazione dell’esperienza francese di Ungaretti presso la rivista «Commerce» in qualità di mediatore culturale, traduttore e poeta ha il pregio, secondo Conti, di offrirsi quale punto di vista privilegiato sull’«officina del poeta», sulla sua ispirazione, sul suo percorso poetico nel momento in cui tali Appunti rappresentano l’«incubatoio» di Sentimento del tempo (in cui confluiranno dopo numerose elaborazioni) e contengono in sé già molti “germi” del modernismo, riconoscibili nella continua ricerca di una sintesi, «per niente armonica», fra tradizione e innovazione, nella «drammatizzazione lirica ottenuta tramite la polifonia e la messa in scena di personaggi del mito» e nell’oscillazione tra «tendenza al frammento e ansia di totalità» (nella consapevolezza di una precarietà che conduce alla ricerca di una nuova tradizione dai valori duraturi).
Ancora alla poesia è consacrato il lavoro di Massimo Colella che si sofferma sulla prima fase della produzione di Eugenio Montale, e più specificamente sul componimento Fine dell’infanzia, per metterne in luce «la caratura “modernista” della specifica declinazione contenutistica e dei caratteri stilistico-formali». L’analisi di Colella si sviluppa persuasivamente, e con puntuali richiami al testo, a partire dal mito modernista dell’infanzia non più inteso come regressione o recupero di un’età felice perduta, ma come distacco che presupponga un «forte avvertimento del presente», rifiutando in tal modo i «sogni simbolisti di correspondances» (così come quelli di panismo, che consentono, secondo la formula montaliana riferita a Gozzano, l’“attraversamento” della «funzione-D’Annunzio»). Riconducibili a una istanza modernista sono inoltre, secondo Colella, anche il «paradigma temporale» – che appare già «pienamente segnato dal valore della memoria […] e dall’importanza del frammento temporale psichicamente rilevante» – e soprattutto la mediazione e la dialettica, non solo tematiche ma anche formali ed esperite nella capacità di attraversare e superare la tradizione letteraria per giungere a uno «stile affabile», derivante dall’«urgenza comunicativa» più che da «un ideale estetico di nitida perfezione puramente retorica».
La ricezione di Dante e del suo modello poetico da parte di tre poeti moderni quali Eliot, Mandelstam e Rebora è lo spunto da cui muove la riflessione di Anna Aresi per dimostrare, attraverso un interessante studio comparativo, come si possa, e si debba, «ripensare la figura e la produzione poetica di Rebora alla luce del modernismo europeo».
153Se una delle caratteristiche della scrittura modernista è la «continua e irrisolta tensione tra intero e frammento», Eliot e Mandelstam riconoscono in Dante il modello a cui dovrebbe tendere la poesia moderna europea, proprio in virtù della sua capacità di conciliare armoniosamente «unità e molteplicità»: entrambi inoltre ritrovano in Dante la somma capacità di «pensare per immagini», evidenza di un processo di scrittura poetica in grado di aggregare universale e particolare. Tuttavia, se è proprio nella crisi di un tale processo di scrittura poetica – così come nell’irragiungibilità di tale modello – che si nasconde «uno dei noccioli fondamentali del modernismo europeo», anche nella produzione reboriana è possibile ritrovare «dinamiche simili» ai maggiori poeti modernisti, in particolare in un testo del 1916 intitolato Viatico, dove l’«atmosfera psicologica dantesca”» mentre da un lato ne rafforza la potenza espressiva, dall’altro decreta l’«impossibilità di tradurre in poesia situazioni limite quali quelle della guerra in trincea», in tal modo acuendo «il contrasto tra vita ed espressione artistica».
Il compito di completare il blocco dei saggi dedicati alla poesia, e di chiudere il volume, spetta infine all’interessante saggio di Rossella Riccobono, che ha il merito di occuparsi di un autore come Cesare Pavese, la cui poesia, in un’ottica modernista, è difficilmente collocabile nei tre filoni proposti da Luperini e facenti capo a Ungaretti, Montale e Saba (e forse per questo completamente ignorata dalla critica nei vari studi sul modernismo). E invece, osserva Riccobono, la possibilità di riconoscere un carattere modernista all’opera pavesiana andrebbe riconsiderata proprio in rapporto alle modalità di recupero della classicità e della riscrittura del mito messi in opera nella sua poesia, intesa come metodo di conoscenza, o meglio, di una nuova conoscenza che consenta al lettore adulto, condannato ormai a «vedere le cose per la “seconda volta”», di vederle come se fosse la prima volta. La consapevolezza della frammentarietà della propria poesia – al netto dell’«apparente lavorìo di creazione» –, così come del filtro rappresentato dalla propria esperienza e dall’esperienza collettiva, è uno degli elementi di modernità di Pavese, insieme a quel linguaggio poetico in grado di «aggregare […] una realtà grezza, frammentaria e ammutolita attraverso uno sguardo e un ritmo che la possano unire e rendere narrabile», e questo nonostante il personaggio-narratore pavesiano appaia già come «sintomo e prodotto di una modernità che ha ammutolito e annientato il valore del racconto».
154Le suggestioni e gli spunti offerti dai vari saggi sono, come si vede, numerosi e diversificati, e tuttavia accomunati dall’idea di fondo che si debbano valutare le potenzialità interpretative del modernismo, così come i suoi limiti, non tanto ritornando su questioni di ordine cronologico o di definizioni teoriche – sulle quali tanto è già stato scritto –, quanto sottoponendo la categoria stessa al vaglio delle opere. Si tratta, insomma, di non considerare il modernismo come categoria rigida in cui incasellare o meno i vari autori, ma piuttosto di interpretarlo (secondo le parole conclusive dell’introduzione dei due curatori) come un «orizzonte di problemi all’interno del quale collocare i tentativi di risposta che sono le opere stesse».
Moreno Savoretti
*
* *
Valentina Sturli, Estremi Occidenti. Frontiere del contemporaneo in Walter Siti e Michel Houellebecq, Milano-Udine, Mimesis, 2020, p. 252, € 24.
Il faut d’emblée dire ce que le livre de Valentina Sturli, chercheuse associée à l’Université de Padoue, apporte aux chercheurs qui souhaitent se pencher à la fois sur la question des rapports entre Walter Siti et Michel Houellebecq, mais aussi sur la question de la représentation de l’Occident et de ses évolutions dans la littérature hyper-contemporaine européenne. Emanuele Zinato, dans sa préface à Estremi Occidenti, insiste d’emblée sur l’originalité et la force d’un ouvrage qui s’inscrit en faux contre trois tendances présentes dans le débat littéraire actuel : la posture anti-théorique, le mépris pour la littérature hyper-contemporaine et l’idée que la littérature est porteuse d’un message moral univoque. L’autrice de l’essai met à profit sa formation comparatiste pour explorer, à l’aide des outils critiques forgés par Francesco Orlando, la façon dont 155deux représentants de la littérature hyper-contemporaine parlent des mutations radicales qui affectent les formes de vie dans le capitalisme avancé et dans un contexte d’effondrement des idéologies du xxe siècle. Une rapide présentation du cadre théorique qui décrit et analyse ces évolutions des formes de vie (Lipovetski, Bauman, Baudrillard) est fournie dans l’introduction. L’ouvrage souhaite interroger la spécificité de la forme-roman, et sa capacité à fournir au lecteur un rapport à la réalité qui passe par l’identification à un « je » permettant au discours littéraire d’explorer une forme de la condition humaine. C’est la subjectivité mise en scène comme condition de l’identification du lecteur qui confère à la littérature une dimension d’« archive historique » au sens où l’entend Orlando. L’analyse proposée par l’autrice évite habilement l’écueil polémique d’une lecture idéologique pour examiner les stratégies narratives de deux auteurs que l’on peut rapprocher autour d’une commune visée : celle d’« articuler une vision originale et déstabilisante de l’Occident contemporain » (p. 24) pour répondre à la question de savoir comment le sujet évolue dans la période hyper-contemporaine et dans le cadre identitaire et culturel de l’Occident.
Le choix d’une division de l’ouvrage en deux parties distinctes comprenant quatre chapitres chacun, la première consacrée à Houellebecq et la seconde à Siti, sert la qualité de l’analyse. Elle rend possible deux dimensions de la recherche : des analyses d’ampleur de la totalité des œuvres de chacun des deux auteurs, et la mise en évidence de problématiques communes, qui apparaissent par jeux de miroirs et qui permettent une minutieuse comparaison de leurs stratégies narratives et rhétoriques, fournissant ainsi le premier ouvrage d’ampleur consacré aux deux auteurs.
La première moitié de l’ouvrage est consacrée à la production de Michel Houellebecq. Si ce dernier fait l’objet d’un grand nombre de travaux dans le champ académique et bénéficie également d’une exposition médiatique très large en France – ce qui contribue peut-être à une réception biaisée de son œuvre –, l’étude de Sturli a le mérite de proposer un survol complet et exhaustif de sa production, ainsi que de prendre en compte une grande partie de la bibliographie critique consacrée à Houellebecq, offrant un cadre critique extrêmement complet. Cette première partie, en s’intéressant à la manière dont l’écrivain envisage, représente et questionne la constitution du sujet dans la contemporanéité, permet d’identifier des récurrences des 156trajectoires des protagonistes, d’interroger les modalités du libre arbitre et du choix. Sturli identifie une stratégie centrale dans l’œuvre de son auteur : celle du renversement et de la polarité. Elle propose au lecteur une stratégie de lecture critique des textes de Houellebecq à travers l’analyse de deux tendances récurrentes dans sa production : la simplification et la complication, en leur apposant, en outre, les qualificatifs de positif ou négatif. Ainsi, après avoir consacré un chapitre complet à la question de la simplification entendue comme stratégie littéraire, Sturli met en évidence son caractère de code présenté à un lecteur qui a la tâche d’en déchiffrer les enjeux pour s’extraire des tons volontairement polémiques et provocateurs des narrateurs, afin de faire émerger une vision du monde plus complexe et fondée sur un questionnement constant des conditions de l’existence d’un sujet dans un contexte où la relation, qu’elle s’exerce sur un plan individuel ou collectif, n’est plus perçue par l’auteur comme étant en capacité de se fonder sur l’amour et la compassion. Ainsi, la simplification, selon le registre du renversement mis en évidence par Sturli, n’est-elle pas « simplement » – cet adverbe occupe une place centrale de l’analyse en close reading très réussie des romans de Houellebecq – un dévoilement mais bien plutôt une manière de forcer le lecteur à s’engager dans une réflexion sur le texte et à s’en distancier. La première partie de l’essai, en recueillant dans le lexique de Houellebecq, et notamment dans ses usages des adverbes, des indices de simplification ou de complexité, montre, en suivant un jeu de renversements, comment la simplification, entendue dans sa dimension négative, est synonyme de vide, tandis que la complexité négative est, elle, l’instrument d’une mystification qui va à l’encontre de l’émergence d’un système relationnel fondé sur l’amour et la compassion, tenants de ce que Sturli appelle la simplicité positive, et fondement d’une société utopique relevant de la complexité positive jamais atteinte, mais pourtant toujours présente dans les travaux de Houellebecq.
Au terme de la première partie de l’ouvrage, et à travers ce prisme à la fois très simple et très efficace, Sturli est parvenue à explorer ce qui constitue l’une des dimensions centrales du corpus de Houellebecq, la question relationnelle, qu’elle s’inscrive dans l’écriture polémique d’une sexualité toujours frustrée et décevante, dans la projection utopique et lyrique, ou dans le souvenir nostalgique d’un bonheur perdu et hors de portée.
157La seconde partie explore ce que l’autrice de l’essai appelle « la fonction Walter Siti ». Elle s’articule en quatre chapitres qui se penchent chacun sur une œuvre ou un groupement d’œuvres et se déroule chronologiquement. La Trilogia (Scuola di nudo, Il Contagio et Troppi Paradisi) fait l’objet d’un premier chapitre qui s’attache à analyser en profondeur la notion de paradoxe comme cœur d’une stratégie narrative et rhétorique de l’auteur qui sert un examen critique de trois dimensions de la contemporanéité : la définition du sujet, celle de son rapport à l’altérité (et à l’objet du désir) et celle du rapport entretenu entre le sujet et le monde. Sturli expose la mécanique de l’analyse approfondie de la notion de désir menée par Siti et mise en lien avec celle de subjectivité entendue comme transfuge et paradoxale. Le second chapitre est intégralement consacré au roman de Siti Il Canto del diavolo, et prolonge l’usage de la clé de lecture du paradoxe en s’attachant à montrer comment l’objet du désir crée une oscillation constante entre dégoût et fascination. Sturli analyse la façon dont le voyage vers un espace périphérique de l’Occident permet d’en mettre en évidence les caractéristiques majeures. Au centre de l’analyse se trouve le couple conceptuel paradoxal de nature et d’artifice, illustré par l’exploration d’une Dubaï double, qui dévoile les rouages d’un système désirant dont l’auteur souhaite montrer une « compresenza del vuoto e del pieno » (p. 156) à travers plusieurs mécanismes narratifs récurrents, qui comprennent notamment un jeu de tension entre participation et distanciation des narrateurs de Siti vis-à-vis de l’objet du désir. Le troisième chapitre de l’ouvrage pousse plus avant l’exploration de cette tension en s’arrêtant sur Il Contagio et tout particulièrement sur le personnage de Marcello. En questionnant les espaces périphériques de la société occidentale, Sturli montre comment tant Dubaï que l’espace de la borgata romaine, happés soudainement dans le consumérisme contemporain, constituent des lieux où le système désirant est exacerbé et où l’on assiste à des mutations radicales des formes de vie. Sturli pose la question de l’agentivité de ces espaces entendus comme lieux géographiques, sociaux, collectifs et politiques face à la modernité. C’est par cette notion de l’agentivité qu’arrive la figure de Marcello et l’un des mouvements comparatistes les plus intéressants de l’ouvrage, à savoir la recherche d’une affinité entre la Lolita de Nabokov et le Marcello de Siti. Par le biais de ce rapprochement, Sturli réintroduit une question centrale de son analyse de Houellebecq, celle des formes relationnelles 158proposées par l’auteur et de leur caractère de révélateur d’une certaine modernité occidentale. Ainsi, la relation entre un protagoniste et l’objet de son désir, tant dans le cas de Lolita que du Contagio, dissimule une « attrazione […] dell’intellettuale per le fenomenologie del consumismo » (p. 184). Du personnage de Marcello, Sturli fait émerger une notion-clé de la fin du livre et de son analyse générale de Siti et Houellebecq : celle de l’innocence. Avec une analyse croisée de Scuola di nudo et de bruciare tutto, le chapitre final interroge la tension permanente entre deux polarités : un absolu attirant et fascinant pour les narrateurs et les protagonistes de Siti, et une tendance des « autres », en réalité, de la contemporanéité occidentale, à circonscrire et à désacraliser l’absolu. Ce chapitre met en évidence les rapports entre les stratégies rhétoriques des deux auteurs. L’intellectuel, chez Siti, peut être face au monde, mais se trouve toujours empêché d’y participer par la nature absolue de son désir, de la même manière que, chez Houellebecq, il n’y a de vérité possible qu’à contre-courant de la marche de l’histoire.
Dans sa conclusion, Sturli propose une analyse croisée des romans Sérotonine et Bontà sortis à quelques mois d’intervalle, ce qui lui permet de mettre en œuvre à travers une lecture attentive de plusieurs passage les clés d’analyse et de lecture disséminées dans son essai. Si la mise en évidence d’une affinité profonde entre les deux titres sert de point de départ à Sturli, elle est en réalité une proposition interprétative qui couvre tout le corpus présenté dans l’essai, et montre comment deux trajectoires littéraires non pas parallèles, mais affines, se recoupent dans la recherche d’une forme émotionnelle et relationnelle authentique, qui permet aux deux auteurs de se saisir de la question du bien.
Laura Maver Borges