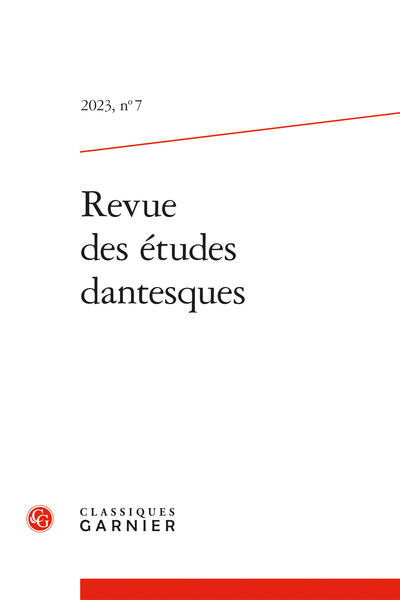
Comptes rendus
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Revue des études dantesques
2023, n° 7. varia - Auteurs : Sparviero (Valentina), Rousset (Anthony)
- Pages : 207 à 218
- Revue : Revue des études dantesques
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406165699
- ISBN : 978-2-406-16569-9
- ISSN : 2556-756X
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16569-9.p.0207
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 20/03/2024
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
Anne-Gaëlle Cuif, « In un atto soave ». La soavità come dolcezza e medicina dell’anima in Dante, Roma, Aracne editore, Dulces Musæ – Collana di Studi e testi di Letteratura Italiana, vol. 25, 2022, 328 p.
La douceur et la suavité sont deux mots qui ont connu un intérêt significatif dans la pensée médiévale, mais aussi dans la poésie et la littérature, étant liés à l’idée de bien-être dans le domaine des sens, de l’affectivité et de l’intellect. Néanmoins, la critique n’a pas évalué à ce jour l’importance du rôle salvifique joué par ces deux notions dans la poétique dantesque : pour cela, l’œuvre de Anne-Gaëlle Cuif se caractérise pour l’originalité de la question abordée, relativement à une présence importante dans la littérature et la langue italiennes.
L’essai analyse la signification de la dulcedo et de la suavitas dans les œuvres de Dante, afin d’expliquer l’évolution de la valeur sémantique de ces deux termes : en examinant le Convivio, la Vita Nova, le De Vulgari Eloquentia et la Commedia, Cuif étudie cette évolution, orientée par le poète toscan vers la rhétorique du salut ; une telle transformation, précise l’autrice, se réalise uniquement si l’âme est prête au changement. Suivant une méthode d’examen philologique et comparatiste, l’analyse de ces deux concepts aide à en comprendre le sens et à les rapprocher.
Ce qui caractérise l’étude de Anne-Gaëlle Cuif est la multiplicité des aspects examinés à propos des les notions de « douceur » et de « suavité » dans les œuvres dantesques, et dans la Commedia en particulier ; en effet, en s’arrêtant sur quelques chants de cet ouvrage, l’examen démontre que les deux qualités participent du procès salvifique de l’âme. La pluralité qui qualifie cet essai s’explique par les nombreux domaines abordés, à partir des œuvres de Dante, mentionnées et comparées, jusqu’aux différentes questions prises en compte. L’étude sur les textes dantesques, cités et reliés entre eux dans chaque chapitre du livre, est finalisée à présenter les phases du changement sémantique des deux notions ; en plus, pour examiner en profondeur cette évolution, Cuif signale des références aux textes contemporains du poète et à la Bible. De plus, la douceur et la suavité sont analysées par rapport à leurs nombreuses fonctions 208– esthétique, thérapeutique, sotériologique – destinées à l’âme et représentées par les acceptions acquises par les deux mots, en particulier dans les deux derniers cantiques de la Commedia. L’examen sur la définition des deux idées est étendu à la sphère sensorielle : l’ouïe, sollicitée par le langage et le son, est évoquée par la musicalité, dans laquelle l’autrice saisit avec beaucoup de finesse – elle est aussi musicienne – les diverses nuances, à savoir la polyphonie et la symphonie, à laquelle est consacré le chapitre final de son essai ; puis, la vue, stimulée par la description des paysages, la présence des personnages et la variété chromatique dans la Commedia ; ensuite, l’odorat et le toucher, abordés surtout dans le contexte du chant XXVIII du Purgatoire, et le goût, défini par la saveur des nourritures, sont analysés par opposition dans l’Enfer et le Paradis. D’ailleurs, la multiplicité est représentée aussi par les divers domaines examinés au regard de la douceur et de la suavité dans le langage, la poésie, le style et la musique par rapport aux œuvres de Dante, et dans la Commedia en particulier. Surtout, cette étude analyse l’aspect spirituel et poétique des deux concepts, qui offrent à l’âme du pèlerin de « stimolare il trasumanar come trasformazione intellettiva e spirituale, convocando tutti i sensi fisici e intellettivi, e coinvolgendo un tipo di esperienza tanto universale quanto individuale » (p. 123) ; comme l’autrice le dit, cette transformation est subordonnée à la propension de l’âme à accepter et à recevoir la dulcedo et la suavitas ; en effet, son essai démontre que les deux concepts varient leur propre sens, selon la disposition de l’âme.
L’étude de Cuif, attentive à évaluer l’utilisation des figures rhétoriques et la récurrence des mots objets de la recherche dans les œuvres dantesques, avec une comparaison entre tous les textes, expose « l’evoluzione del concetto di medicina dell’anima » (p. 295) ; cela se réalise à partir du Convivio, où Dante, explique l’autrice, « propone un percorso di cura dell’intelletto e dell’anima » (p. 37), un processus qui terminera dans le Paradis. Mais, avant d’aboutir au dernier cantique, l’essai analyse la présence de la douceur et de la suavité dans les ouvrages antécédents la Commedia : au poème sont consacrés les derniers trois chapitres, alors que les deux premiers sont dédiés au Convivio, à la Vita Nova et au De Vulgari Eloquentia (avec des renvois à la Commedia), pour un rapprochement entre les œuvres de Dante.
Le premier chapitre examine les notions antinomiques de douceur et de suavité dans le Convivio et surtout dans l’Enfer, où à l’harmonie 209de la dulcedo et de la suavitas s’opposent, dans les différents domaines sensoriels, respectivement, l’amer et l’aigre, responsables de la disharmonie et de l’affection de l’âme. Mais l’autrice relève aussi que ces mots antithétiques constituent une partie du processus salvifique pour l’âme, une transformation qui continue dans le Purgatoire, dans lequel la douceur et la suavité représentent un “analgésique pour l’âme”, comme condition de bien-être illusoire, éphémère et fictif. Mais, « suave » est aussi attribut de l’amour dans le Convivio : le deuxième chapitre se focalise donc sur l’importance de l’amour, dès la Vita Nova, car source du salut pour l’âme, ainsi que moteur de l’harmonie de l’univers. De plus, ce chapitre souligne que aussi la philosophie, la rhétorique et la poétique, présentes dans les œuvres dantesques, ont une fonction salvifique : l’analyse de la douceur et de la suavité dans le langage et, donc, dans la poésie, offre la possibilité d’examiner les deux mots dans la poétique du Dolce stil novo ; mais elle permet aussi de révéler la nouveauté de la poétique dantesque, pour l’importance éthique et spirituelle, par rapport aux contemporains du poète, et l’adoucissement de la langue, ayant une valeur pharmaceutique pour l’âme ; en effet, le langage métaphorique et poétique utilisé par Dante dans le Purgatoire, explique Cuif, devient encouragement pour l’intellect et pour les capacités sensorielles. Le chapitre suivant, le troisième, se focalise sur le deuxième cantique ; dans le Purgatoire, en s’arrêtant, particulièrement, sur le chant XXVIII, l’étude relève la relation entre les différents sens, dans une prospective de transformation de l’âme : dans cette partie du poème l’autrice constate une « conversione dell’anima » (p. 140-141), voire une conversion qui prépare au changement de l’âme pour des fins salvifiques. Le chapitre souligne que le Purgatoire se caractérise pour la pluralité sensorielle, qui favorise l’intellect et prépare l’âme à la purification nécessaire pour accéder au Paradis. Le dernier cantique est l’objet d’étude du chapitre suivant, le quatrième, consacré à l’examen de la multiplicité sensorielle des deux notions : la douceur et la suavité sont ici encore plus liées, par rapport à l’Enfer et au Purgatoire, et ce lien crée « un’esperienza sinestetica in cui si associano profumo, suono e luce » (p. 228) ; pour cela, les paragraphes du chapitre analysent les éléments contenus dans le Paradis, associés à chacun de cinq sens. Le chapitre offre aussi l’occasion d’évaluer les choix poétiques et métriques de Dante, visant à engager tous les sens, afin de continuer le processus de transformation, évoqué, principalement, 210par deux éléments : la clarté, « in quanto agente epifanico e psicacogico » (p. 221), et la musicalité, car « piacere sonoro » (p. 231, note 1), objet du cinquième et dernier chapitre de l’essai. Bien que l’attention à la sonorité et à la musicalité apparaît dans l’étude, un chapitre entier est consacré à cet aspect important dans la Comédie, surtout dans le Purgatoire et le Paradis, et aux autres œuvres de Dante, grâce à une comparaison entre ces textes. Une recherche sur les occurrences du mot musica révèle que l’expression est absente dans les trois cantiques ; Cuif observe néanmoins que le poète utilise un lexique parallèle pour évoquer l’idée musicale. Elle explique que la musique est abordée dans le Convivio et dans le De Vulgari Eloquentia, et cette observation l’amène à souligner le rôle considérable du langage musical dantesque, représenté par la suavité et la douceur, dans les deux derniers cantiques en particulier. Dans le Purgatoire, le son est une caractéristique significative : cela est évident dans le titre de l’essai, qui présente la citation du vers dantesque, tirée de Purgatoire X, 38, « in un atto soave ». La sonorité de ce cantique est identifiée par Cuif dans le lexique ainsi que dans la pluralité musicale : les variétés musicales présentées dans le Purgatoire, telles chants, hymnes, psaumes et symphonies de la nature (référée au chant XXVIII), sont examinées relativement à leurs diverses fonctions : thérapeutique, psychagogique et anagogique. Dans le Purgatoire, le son se transforme pour consentir à l’âme de recevoir la musique divine du Paradis dans une « catharsis musicale » (p. 245) : cette expression résume les fonctions de la sonorité uniforme, examinées dans le deuxième cantique ; dans le Purgatoire le son constitue donc la transformation de l’âme, pour « un’esperienza iniziatica » (p. 250), une expérience destinée au pèlerin pour le conduire à la transcendance conclusive du Paradis. Le dernier cantique, explique l’autrice, se caractérise pour l’harmonie en tant que « piacere trascendentale » (p. 260) et bien-être de l’âme : à travers « una serie di eventi epifanici e sonori » (p. 268), se produit dans le Paradis le “Trasumanar per musica”, titre d’un des paragraphes du dernier chapitre : ce plaisir musical, interprété comme douceur du son, est expliqué par Dante à travers les nombreuse “similitudes sensorielles”. Dans ce chapitre conclusif, chaque aspect musical est analysé : le silence aussi, car « espressione della musica » et « della dolcezza di Dio » (p. 271).
En utilisant un langage spécifique et clair, cette étude révèle la puissance transformatrice de la suavité et de la douceur, formulée par 211la nouvelle poétique dantesque à travers le pouvoir du langage et de la musique. Pour présenter cette nouveauté, Cuif retrace les sens et les recours à ces deux idées, pas seulement dans les œuvres de Dante mais aussi dans celles de ses prédécesseurs, avec une comparaison entre la pensée du poète et celle de ses contemporains – les sources et les textes interrogés sont classés dans la bibliographie, où on signale aussi les études récentes – ; le rapprochement entre dulcedo et suavitas est fait soit par rapport au sens des deux mots soit par rapport à la rhétorique, la poésie et le style, afin de permettre au lecteur de comprendre l’importance de la nouveauté de la pensée et de la poétique dantesques, concernant les deux mots objet de cet essai. L’originalité dantesque, expliquée surtout au début de l’étude, est exposée clairement dans la Conclusione, où une phrase résume ce que cette étude a analysé et décrit en profondeur : « la soavità musicale è la principale cura dell’anima, che si attua in particolare tramite la capacità di ascolto, grazie alla quale l’anima diventa medico di sé stessa » (Conclusione, p. 297).
Valentina Sparviero
*
* *
Claudia Jacobi, Mythopoétiques dantesques. Une intermédiale sur la France, l’Espagne et l’Italie (1766-1897), Strasbourg, ELIPHI – Éditions de Linguistique et Philologie, « Travaux de Littératures Romanes – Poétique et littérature moderne », 2021.
La recherche sur les conditions et les formes de la réception de l’œuvre de Dante est un aspect essentiel de la dantologie. L’ouvrage ambitieux et dense de Claudia Jacobi verse une pièce essentielle à ce dossier. L’auteure renonce à une recension exhaustive. Et elle préfère une 212approche thématique à une liste seulement chronologique. Elle assume des choix, par exemple l’exclusion des romans et des œuvres musicales de son champ d’analyse. Ce renoncement à des énumérations ou à des relevés seulement quantitatifs au profit d’une orientation qualitative témoigne d’une volonté de penser les conditions, les orientations et les surprises de la réception au xviiie et au xixe siècles en Italie, en France et en Espagne de la Divine Comédie. Jacobi montre qu’il ne faut plus se gausser d’une « dantomanie » que des commentateurs jugèrent superficielle. Certes des critiques ont pu recevoir avec ironie la manière dont les auteurs et les artistes s’emparèrent de Dante. Ceci conduirait à une critique sévère contre les erreurs et les rapidités alors accumulées. Or, Jacobi insiste : on ne peut pas distribuer les points entre bonnes et mauvaises lectures. L’auteure met en avant le sérieux et la volonté de faire un usage vivant de l’œuvre dantesque par ceux qui la redécouvrent entre la fin du xviiie siècle et le xixe.
Au sein de chacune de ces parties, les introductions annoncent, outre le plan de la sous-partie, l’idée générale défendue. Chaque sous-partie s’achève sur quelques lignes de conclusion. Une large introduction [I] et une véritable conclusion encadrent deux parties. La première – « II. Envols célestes et voyages infernaux. Dante dans les figurations de l’au-delà des xviiie et le xixe siècles » – se divise en huit sous-parties, chacune consacrée à un auteur ou à un artiste, souvent par le prisme d’une œuvre essentielle : les Visione sacre e morali Alfonso Varano, l’Appressamento della morte de Giacomo Leopardi, l’Inno alla morte de Caterina Franceschi Ferrucci, La Vision de Dante de Victor Hugo, Aurélia de Gérard de Nerval, Au lecteur de Charles Baudelaire, Creed en dios de Gustavo Adolfo Becquer, La nochebuena en el Inferno, en el Purgatorio, en el Limbo y en Cielo d’Emilia Pardo Bazán. La grande partie suivante – « III. Paolo et Francesca dans les mythopoétiques dantesques des xviiie et le xixe siècles » – commence par un tableau général de la réception du chant V de l’Enfer dans l’époque mentionnée. Ensuite, comme précédemment, Jacobi s’arrête sur des auteurs et artistes, à nouveau à partir d’une œuvre majeure : la Francesca di Arimino de Francesco Gianni, la Francesca da Rimini de Silvio Pellico, la François de Rimini de Gustave Drouineau, la Francisca di Rímini de Vicente Colorado, les œuvres de Julio Monreal et Gaetano Previati, La Rima XXIX de Gustavo Adolfo Bécquer, La Béatrice, puis Delphine et Hippolyte de Charles Baudelaire, et enfin La lecture d’Henri Cantel.
213La longue introduction détermine une méthode de lecture et une forme intellectuelle précise. Le comparatisme1 est le prodrome à la recherche mythopoétique. Cette dernière est « une méthode de lecture déconstructiviste qui part de la conviction que tout acte de réception est un acte d’appropriation et de transformation qui reformule inévitablement l’assise de départ » [p. 6]. Les analyses qui suivent, selon le plan rappelé, soulignent la manière dont la confrontation des textes et des œuvres avec la Divine Comédie éclairent cette dernière, en soulignant ses tensions intérieures. La réception du Grand Poème est donc un moyen de faire ressortir les différentes lectures de ce dernier. Dans cette perspective, Jacobi confronte aussi les différents types d’œuvres d’art. Cette mythopoétique est intermédiale en ce qu’elle propose des effets de sens et des éclaircissements réciproques par la confrontation entre des productions de l’esprit (des médias, donc) appartenant à des domaines différents, à commencer par la poésie, la peinture et la sculpture. La conclusion finale revient sur la méthode et sur ses acquis.
L’approche intermédiale entre le texte, la sculpture et l’image a permis […] d’approfondir la fonction des mythopoétiques dantesques, à savoir la valeur productive qui naît non seulement des convergences, mais précisément des divergences et des dissonances que les œuvres sélectionnées entretiennent avec la Divine Comédie. […] L’étude a démontré qu’il faut cesser de considérer leurs productions comme de « mauvaises copies » de « l’original », mais que Dante et ses successeurs s’éclairent réciproquement. En effet, la démarche comparatiste et intermédiale a permis non seulement de révéler de nouveaux aspects du corpus des xviiie et xixe siècles, mais aussi de mieux comprendre la Divine Comédie. [p. 363]
Chaque sous-partie est autonome tout autant qu’elle participe à une harmonie d’ensemble. Chacune est consacrée à un auteur ou un artiste en particulier. Il est présenté à partir d’une œuvre principale. Elle est remise en contexte dans la vie et dans la carrière de son auteur. Et Jacobi 214ouvre à des productions annexes et corrélatives – de l’auteur, voire d’autres qui l’éclairent. La mise en réseau de ces éléments particuliers concourt à une construction générale qui confère à l’ouvrage une réelle unité en même temps qu’une belle ouverture. Cette unité est renforcée par les retours des mêmes auteurs dans deux sous-parties différentes et les renvois proposés par Jacobi au sein de son livre. Ces réceptions et ces usages, plus ou moins fidèles, toujours créateurs, de Dante, développent une signification triple : sur l’auteur s’appropriant Dante, sur le xixe siècle en tant que tel notamment face au rapport entre classicisme et romantisme, et sur Dante. Même lorsqu’il s’agit d’une inversion des positions dantesques, ces mythopoétiques sont créatrices de sens.
Les lectures de Dante annoncent des débats de la dantologie savante de la fin du xxe siècle et du début du xxie siècle. Il ne s’agit pas de construire une philosophie possible. Mais la dantologie d’artistes, de créateurs, est riche d’intuitions, plus ou moins construites et précises, voire inconscientes. Ces mythopoétiques font écho à des principes herméneutiques centraux dans la dantologie contemporaine. Jacobi prend le temps de souligner, dans chacune des parties, comment les créations littéraires et artistiques, même si on peut les juger naïves, possèdent une réelle fécondité. De manière plus ou moins assumée, les dantologues contemporains, critiques, sont les héritiers de ces usages de la Divine Comédie, en totalité ou de l’un de ses épisodes, par leurs devanciers du xixe siècle. Par exemple, l’interprétation de la figure de Béatrice est au cœur des recherches actuelles. On distingue une Béatrice idéale, figure religieuse de la théologie ou de la grâce, d’une Béatrice plus sombre, plus inquiétante, plus cruelle. La première est une donna angelicata, celle qui se fait l’instructrice de Dante et lui permet de s’élever dans les cercles du paradis. La seconde est une figure beaucoup plus sévère, avec une puissance de destruction, par exemple celle qui se moque de Dante dans la scène du mariage (Vie nouvelle). Claudia Jacobi insiste notamment sur les travaux de Rossana Fenu Barbera dans ce sens. Or, ce débat central et parfois vif est annoncé, selon notre auteure, par la manière dont Baudelaire reconstruit la figure de Béatrice dans « La Béatrice » et dans « Franciscæ meæ laudes ». Le poète français crée une figure féminine dangereuse, cruelle, inquiétante. Ces deux textes ne sont pas, évidemment, explicitement destinés à commenter la figure de Béatrice chez Dante. Mais ils créent, que leur auteur en 215ait l’intention ou non, les conditions d’un nouveau débat sur la figure de la Dame du salut.
Les démonstrations sont étayées par la mobilisation des ressources propres à l’analyse littéraire. Jacobi propose parfois de véritables commentaires de textes presque scolaires. Elle s’appuie notamment sur l’étude des tropes et des temps de conjugaison. L’analyse des métadiscours est omniprésente. Jacobi revient constamment sur les conséquences métapoétiques. Les textes étudiés du xixe siècle ne permettent pas seulement d’anticiper les enjeux contemporains de la dantologie, ils sont aussi les conditions d’une analyse du fait poétique – de son essence, de ses puissances, de ses valeurs. Le comparatisme nourrit une telle réflexion sur ce qu’est la poésie. Par exemple, Dante est représenté comme un poetavates. Pour beaucoup de poètes du xixe siècle, il est un miroir idéal qui leur permet de prendre conscience de leur propre identité voire de leur génie et de leur mission. Se placer sous la tutelle de Dante leur permet, en se réclamant leurs successeurs, de s’autoglorifier ; jusqu’à élaborer le mythe d’un poète-prophète. Ceci culmine chez Hugo2. Inversement, il est possible, comme chez Nerval ou Baudelaire, que le poeta vates devienne un poète maudit ; voire qu’il faille minorer son importance. Ce double regard sur la poésie et sur le poète est un lieu commun de l’époque romantique, et on ne peut pas véritablement affirmer qu’il est thématisé en tant que tel chez l’Alighieri. Mais la manière dont les poètes se placent dans le sillage du génie italien leur permet, réflexivement, de s’interroger sur leur propre pratique, réelle ou idéale, et sur leur propre être. Claudia Jacobi insiste fréquemment sur cette réflexivité née de la confrontation entre un modèle idéal et ceux qui, fût-ce négativement, en assument l’héritage.
Prenons un premier exemple. La présence de Dante dans l’Aurélia de Nerval permet de mieux comprendre l’œuvre du poète et romancier français. La mythopoétique dantesque de Nerval est celle d’un « franc-maçon initié aux mystères de l’ancienne Égypte. […] En rapprochant constamment Béatrice et Isis, ainsi que le voyage dantesque et l’initiation 216au culte isiaque, Nerval invite le lecteur à considérer également l’œuvre de Dante comme une initiation aux mystères péribibliques, anticipant ainsi les hypothèses que Joseph Strelka présente au xxie siècle concernant l’appartenance de Dante au cercle secret des Illuminés. Nerval s’inscrit ainsi dans la grande lignée des détenteurs de secrets prébibliques du culte d’Isis aux côtés de Dante, Orphée et Moïse, bien que les symptômes de la folie contrecarrent constamment la crédibilité du narrateur » (p. 132-134).
Deuxième exemple : la construction d’une figure de Dante par les poètes italiens possède un sens politique. Le Sommo Poeta participe à la recherche de l’unité italienne par la culture et l’unification politique, y compris face au pouvoir du Vatican. Par exemple, le poème Francesca da Ariminio de Francesco Gianni comporte un grand enjeu politique. Les deux amants seraient des figures allégoriques pour exprimer le désir d’unification de l’Italie et sa libération à l’égard de la domination étrangère, notamment en face de la geste napoléonienne.
Troisième exemple : les mythopoétiques consacrées à l’épisode de Paolo et Francesca3, à côté de cet usage politique, font ressortir les grandes oppositions dans leur réception érudite depuis le Moyen Âge jusqu’à nous. Elles oscillent entre conception mariale de Francesca, son rapprochement avec Béatrice ou au contraire sa disqualification comme femme superficielle teintée de bovarisme voire pécheresse maudite. Jacobi synthétise les différentes interprétations de la figure de Francesca, à la fois chez les commentateurs et les critiques du chant V de l’Enfer, et chez les poètes et artistes du xixe siècle. Cette pluralité pourrait paraître désarmante. Elle risque de conduire à un certain scepticisme face à une nébuleuse d’interprétations parfois contradictoires, sans oublier leur grande évolution au gré de l’histoire de notre culture. Pensons aux jugements portés sur le romantisme ou le style troubadour dans les arts plastiques. Mais il en va tout autrement. Ces lectures si différentes témoignent de la richesse des figures de Paolo et Francesca, et même de Dante – une figure qui devient un mythe. Jacobi étudie le poème 217de Cantel « La lecture », en lien intermédial avec la gravure « Le midi » d’Emmanuel-Jean Népomucène De Gendt. La lecture d’un livre par une Francesca bovariste causant son lien extraconjugal devient la lecture d’un livre conduisant une jeune fille à la masturbation. Les dantologies récentes, par exemple en lien avec les genders studies, seront à nouveau les héritières plus ou moins conscientes de ces intuitions. Jacobi pense ici à Teodolinda Barolini.
Cet ouvrage revendique discrètement mais intelligemment le droit de cette dantologie multiple à être un parangon de la culture européenne. Les créateurs annoncent des débats beaucoup plus contemporains, à commencer par les formes variées du féminisme – par exemple l’émancipation, la lutte contre les violences conjugales et contre le mariage forcé, la défense de l’homosexualité féminine. Le choix des études romanes, conformément à l’esprit de l’éditeur, s’accompagnerait sans nul doute de l’apport de l’élément plus nordique ou alémanique. Mais la vie de l’esprit entre France, Italie et Espagne (avec de belles redécouvertes de poètes et artistes « un peu trop oubliés », comme dirait Saint-Exupéry, mais aussi des perspectives plus inattendues quoique de valeur4) est évidente à la lecture de l’ouvrage. Ce n’est pas encore la Weltlitteratur goethéenne, mais quelque chose comme une identité européenne émerge à partir de la circulation et du commentarisme du Sommo Poeta.
Les amoureux de la culture européenne autant que les dantologues trouveront dans les propos de Claudia Jacobi de quoi nourrir leur travail et leur méditation. La construction logique et une écriture agréable facilitent la lecture. L’ouvrage est augmenté d’illustrations, d’une annexe étonnante, d’un index nominal et d’une large bibliographie raisonnée. Cette recherche mythopoétique intermédiale est prometteuse ; même s’il reste certainement à approfondir la conception du mythe5. L’inclusion, dans ce comparatisme revendiqué, de savoirs qui dépassent la seule analyse littéraire serait bienvenue. Pensons à la philosophie de la mythologie qui se développe depuis la fin du xviiie siècle et durant le xixe siècle ; 218d’autant plus que, à l’instar du Plus ancien programme systématique de l’idéalisme allemand ou différemment de la réception de Vico par exemple chez Michelet, elle interroge concomitamment la valeur de la poésie. On encouragera Claudia Jacobi à poursuivre son enquête du côté des romans et de la musique ; et des œuvres de Dante qualifiées parfois de mineures (à grand tort). Il en va de l’amour savant de Dante, et d’un sens possible de l’Europe.
Anthony Rousset
1 « Le corpus, composé d’œuvres particulièrement représentatives, est traité dans une perspective comparatiste et intermédiale prenant en compte aussi bien le texte que l’image. La comparaison visera […] à éclairer les interprétations épistémologiques, sociologiques, culturelles ou politiques que ces œuvres proposent de la Divine Comédie. Cette approche se fonde sur la conviction que l’interprétation qualitative d’un texte est facilitée non seulement par la mise en relations avec d’autres textes, mais également par des convergences et divergences avec d’autres formes médiatiques qu’il faut cesser de considérer d’une manière isolée afin d’obtenir une vision plus complète d’un phénomène culturel à une époque déterminée. », p. 4.
2 Dans la Vision de Dante Hugo choisit Dante « comme porte-voix de sa propre conception du poète ainsi que de ses idées poétiques et spirituelles. […] Hugo évoque ainsi le rôle du poeta vates, voyant et prophète d’inspiration divine […]. Ainsi, la mythopoétique dantesque sert non seulement à illuminer les objectifs poétiques, théologiques et politiques de Victor Hugo, mais aussi à mieux comprendre le chant XIX de l’Enfer et le chant XXVIII du Paradis dantesque. », p. 110-113.
3 « Les close readings que ce chapitre [la partie III] présente des œuvres des xviiie et xixe siècles permettront d’approfondir les débats, les tensions et les apories du chant V de l’Enfer, ce qui souligne également leur propre polyvalence et complexité. En effet, la mythopoétique dantesque permet non seulement aux artistes de présenter leurs interprétations de la Divine Comédie – qui sont souvent en avance sur leur temps – mais aussi d’exprimer les préoccupations poétologiques, politiques et socio-culturelles de leur propre époque. », p. 224.
4 Par exemple, les formes de la Franc-Maçonnerie égyptienne ou isiaque. Sans lien aucun avec cette maçonnerie égyptienne chez Nerval, on pense aussi la pensée queer, les états de la psychanalyse et plus largement de l’hypothèse de l’inconscient et l’onanisme féminin déjà mentionné.
5 Il est seulement défini p. 6 comme « une projection qui naît de chaque reprise artistique du même motif ».