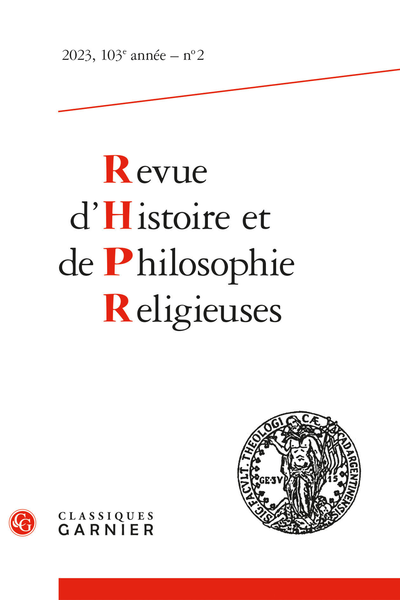
Book Reviews
- Publication type: Journal article
- Journal: Revue d'histoire et de philosophie religieuses
2023 – 2, 103e année, n° 2. varia - Authors: Monnot (Christophe), Arnold (Matthieu), Boniteau (Adrien), Rognon (Frédéric)
- Pages: 93 to 117
- Journal: Journal of Religious History and Philosophy
- CLIL theme: 4046 -- RELIGION -- Christianisme -- Théologie
- EAN: 9782406151340
- ISBN: 978-2-406-15134-0
- ISSN: 2269-479X
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-15134-0.p.0093
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 07-12-2023
- Periodicity: Quarterly
- Language: French
Revue des livres
SOCIOLOGIE
Alexandre Grandjean, Arborescence. Les voix de l’écologie spirituelle, Vevey, Hélice Hélas, coll. « Paon dans ton Q.I. ! », 2022, 160 pages, ISBN 978-2-940700-22-6, 16 €.
Cet ouvrage est le fruit d’un projet de médiation scientifique soutenu par le Fonds national Suisse (FNS) de la recherche scientifique. L’A. y fait état, d’une manière à la fois claire et élégante, des principales observations d’une recherche de cinq années menée à l’Université de Lausanne sur les liens que semblent entretenir religions, spiritualités et écologie.
Dans son introduction, il souligne combien, à partir du début du xxie siècle, les cloisons entre écologie et spiritualité se sont peu à peu effondrées. L’écospiritualité est devenue une « notion liane » qui connecte entre eux des univers sociaux voisins. Pour faire entrer les lecteurs dans ce fascinant entrelacement de motifs religieux, spirituels et écologiques, l’A. nous transporte sur le terrain ethnographique à travers six exemples.
Le premier chapitre montre les « affinités électives » (Weber) entre écologie et sensibilités religieuses. L’A. observe un double mouvement, celui d’une société qui se spiritualise et s’écologise tout à la fois. Ce double mouvement n’est pas à comprendre comme un retour du religieux, mais comme l’expression d’une métamorphose de la modernité. Dans ce contexte, deux types de rationalité s’opposent. L’une est fondée sur la gestion scientifique des risques, l’autre sur la gestion sociale « centrée sur l’existence même de l’idée qu’une catastrophe pourrait advenir à tout moment » (p. 71). Les mouvements écologiques ont été des critiques du tout technique en défendant des modèles alternatifs. C’est ainsi que, pour penser et dire l’écologie, mais aussi pour agir de manière écologique, les acteurs ont recours à 218des imaginaires sociaux qui circulent et se mêlent les uns aux autres. Au nombre de ceux-ci figurent bien évidemment des imaginaires spirituels, mais également les réflexions de philosophes et de théologiens.
Au chapitre suivant, l’A. nous emmène sur son terrain d’observation. Il montre que la dimension performative, celle qui « [fait] agir, dire et imaginer autrement » (p. 83) les acteurs, les poussent « à imaginer autrement, constituer des liens […] qu[’ils] n’auraient pas imaginés [eux]-mêmes » (ibid.). Il s’intéresse particulièrement aux « porte-parole de l’écologie » (ibid.) sur trois terrains : celui de la vigne, avec le réenchantement des pratiques biologiques par la biodynamie ; celui des espaces verts qui lient, au cœur des villes, des objectifs environnementaux avec des motifs spirituels ; celui des rituels contemporains tels qu’ils paraissent dans les écofestivals populaires (Aternatiba à Genève et le Festival de la Terre à Lausanne). L’A. constate que, sur ces terrains, les porte-parole de l’écologie déploient des « notions hybrides mêlant intériorité, spiritualité, psychologie, analyse sociale et culturelle et préservation du Vivant. [Ils] tentent de “lier” les univers sociaux entre eux » (p. 138). Le spirituel fait figure, dans ce contexte, d’une sorte de notion-valise bien plus que d’une disposition religieuse.
Le dernier chapitre constitue la partie la plus théorique de l’ouvrage. L’A. y soutient ses principales thèses. Premièrement, celle selon laquelle l’écospiritualité devient une notion constituée autant par des rapports sentimentaux et romantiques envers l’environnement que par des dispositions psychologiques et des ressources symboliques. L’A. la désigne comme une « notion-liane » que ses porte-parole utilisent pour « rendre présent à l’esprit des savoirs, des connaissances, des sensibilités » afin que leurs auditoires puissent saisir des enjeux écologiques pour la destinée humaine et outiller les reconfigurations des relations entre les êtres humains et leur environnement naturel. L’A. montre ensuite comment l’usage de cette notion-liane permet l’émergence d’un éthos écologique. La spiritualité, comme la transition intérieure, devient un outil opératoire pour participer au processus systémique engendré par la crise écologique. En somme, ces démarches rendent possible le changement et permettent aux personnes qui les adoptent d’entrer dans une démarche révolutionnaire à bas bruit, celle qui consiste à s’adapter à l’environnement changeant.
Il s’agit là d’une excellente entrée dans la thématique des liens entre écologie, spiritualité et religion, qui ne cède rien en matière 219de rigueur, de réflexion théorique et d’observation sociologique du terrain. On sort de la lecture de l’ouvrage avec une image parfaitement claire et toute en nuance d’une thématique on ne peut plus actuelle. Le livre est disponible en libre accès (https://podcast.unil.ch/podcast/ftsr/arborescence.epub).
Christophe Monnot
HISTOIRE
Généralités
Giuliano Ferretti, François Roudaut, Jean-Pierre Dupouy (dir.), La Vertu de tempérance entre Moyen Âge et âge classique, Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres » 106, 2020, 917 pages, ISBN 978-2-406-09664-1, 83 €.
Huit ans après l’ouvrage consacré à la prudence, Giuliano Ferretti, professeur à l’Université de Grenoble Alpes, et ses collègues François Roudaut (Université de Montpellier III) et Jean-Pierre Dupouy (Université de Brest) consacrent un fort volume à la deuxième des vertus cardinales, la tempérance. Dix-huit études fouillées (quatre portent sur le Moyen Âge, quatorze sur la Renaissance et l’Âge classique dont la dernière fait une incursion au xviiie siècle) sont suivies par une très importante anthologie (dictionnaires, textes de l’Antiquité grecque et romaine, textes du Moyen Âge, textes des xvie et xviie siècles, recueils d’emblèmes) dont la pièce maîtresse est constituée par les questions 141 à 170 de la Somme théologique (p. 538-797) ; pour Thomas d’Aquin, qui se lance dans une comparaison entre les vertus, « absolument parlant, la force est meilleure, quoique, par un certain côté, la tempérance puisse être dite préférable, non seulement à la force mais même à la justice » (qu. 141, art. 8 ; p. 552). Bernard de Clairvaux s’efforce, quant à lui, de montrer l’« heureuse liaison », l’« union étroite » de la tempérance avec la justice, mais aussi avec la force (De la considération, Livre Ier, § 10 ; p. 526 sq.).
Parmi ces dix-huit articles, dont trois ont été rédigés en italien, plusieurs intéresseront plus spécifiquement les historiens du 220christianisme. C’est le cas de l’article que Ch. Trottmann consacre à la place de la tempérance dans l’Éthique et les Conférences d’Abélard. Concernant également le Moyen Âge, la contribution de Th. Revol sur « Tempérance/Attrempence » s’intéresse à la manière dont les clercs et les auteurs de la grande rhétorique font l’éloge de la tempérance dans un but moral, pédagogique et littéraire, en recourant en particulier aux allégories.
Dans la mesure où, au Moyen Âge et à l’époque moderne, la tempérance est l’héritière des vertus de l’Antiquité tant païenne que chrétienne, il n’est pas étonnant que les philosophes païens (Aristote, Platon, Cicéron, Sénèque…) et les Pères (Ambroise, Augustin) soient les auteurs les plus cités. C’est le cas, au premier chef, d’Aristote ; ainsi, la contribution de T. Vigliano examine la réception de l’Éthique à Nicomaque entre 1494 et 1530, tant dans les textes marqués par la scolastique que dans ceux qui portent l’empreinte de l’humanisme.
Nulle étude n’est consacrée aux Réformateurs, alors qu’ils n’ont pas manqué de s’exprimer sur la tempérance. Ainsi, dans le grand écrit réformateur La liberté du chrétien (1520), Luther affirme que les œuvres accomplies librement par le chrétien visent en particulier à « réprimer l’intempérance et la convoitise du corps ». Luther et Calvin, il est vrai, ne sont pas entièrement absents de ce volume. Richelieu, qui n’accorde par ailleurs guère de place à la tempérance dans les vertus du ministre, « n’hésite pas à utiliser Calvin pour accuser Luther d’avoir mené une vie remplie de vices. L’intempérance du corps physique précéderait ainsi l’intempérance du corps spirituel » (G. Ferretti, p. 352 ; il est un peu dommage que F. donne seulement la référence au texte de Richelieu, sans le citer). En ce qui concerne Calvin, Th. Revol nous apprend (p. 115, n. 4) que, d’après la base FranText, 16 des 66 occurrences de « tempérance » pour les années 1550-1600 se trouvent dans l’Institution de la religion chrétienne (contre 24 dans les Essais de Montaigne). Quant au Dictionnaire de la langue française du xvie siècle d’Edmond Huguet, il cite (Anthologie, p. 452) le traité Contre l’astrologie judiciaire (« tempérance » y a le sens de « combinaison, proportion »), ainsi que l’Institution : « On appelle scandale prins, quand quelque chose qui n’estoit point intemperamment [= immodérément] ny indiscretement faite, neantmoins par la mauvaiseté et malice des autres est tirée occasion de scandale » (IRC III, xix, 11 ; p. 457) ; « Il est […] maintenant abusé par 221vaine espèce de bien, maintenant agité d’affections intempérées [= déréglées] » (IRC II, ii, 3 ; p. 460).
Ce n’est pas le moindre mérite de ce volume exemplaire que de montrer à la fois la variété des domaines (la religion, mais aussi l’économie, la politique et la rhétorique – contre l’« ivresse du bavardage » stigmatisée par Érasme, B. Méniel) dans lesquels la tempérance doit s’exercer et les significations variées et changeantes attachées à ce terme.
Un important index des noms (auteurs anciens, médiévaux et modernes, mais aussi contemporains) facilite la consultation de cet ouvrage de référence. Le lecteur attend avec impatience le volume qui sera dévolu à la force.
Matthieu Arnold
Patrick Cabanel, André Encrevé (dir.), Dictionnaire biographique des protestants français de 1787 à nos jours, tome 3 : H-L, Paris, Les Éditions de Paris Max Chaleil, 2022, xiv + 895 pages, ISBN 978-2-84621-333-2, 38 €.
Deux ans à peine après la sortie du tome 2, paraît le volumineux tome 3 du Dictionnaire biographique des protestants français…, qui devrait comporter au moins 5 tomes. Ce volume, qui renferme plus d’un millier de notices, est dédié à la mémoire de Bernard Vogler (1935-2020), « collaborateur décisif de ce dictionnaire » et signataire de nombreuses notices. Il commence par les frères Émile et Eugène Haag, auteurs de la France protestante dont le présent dictionnaire se veut le continuateur ; il se clôt sur la notice consacrée à Daniel Lys, qui professa l’Ancien Testament à la Faculté de Théologie de Montpellier.
Comme les tomes précédents, cet ouvrage illustre l’importance de la minorité protestante dans les domaines les plus divers : les professions intellectuelles, avec nombre d’universitaires (nous y reviendrons), tels que les historiens Jean-Noël Jeanneney, Lucien Jerphagnon et Élisabeth Labrousse, le philosophe Philippe Lacoue-Labarthe ou encore la pédagogue Pauline de Kergomard ; la science, avec le prix Nobel de physique Alfred Kastler ; l’industrie, avec les dynasties des Harth, des Hartmann, des Hatt, des Japy ou des Koechlin, ainsi que la famille Hermès ; la culture, avec l’éditeur René Julliard, 222les écrivains Ysabelle Lacamp, Robert Lafont et Pierre Loti, et les comédiens Frédérique Hébrard, Irène Jacob et Bernadette et Pauline Lafont, ou encore la chanteuse Patricia Kaas ; la politique, dont les représentants – Eva Joli, Lionel Jospin, Pierre Joxe, Jacques Lafleur, Catherine Lalumière et Gérard Larcher – se voient consacrer par les deux directeurs du Dictionnaire des notices développées. Les protestants qui ne sont issus ni du milieu réformé ni du luthéranisme ne sont nullement oubliés ; c’est ainsi que deux notices saluent la résistance pacifique au nazisme des mennonites Émile et Jean-Paul Krémer. On signalera, dans le même ordre d’idées, les notices consacrées à la résistante Adélaïde Hautval et au pacifiste Jean Lasserre.
Le fait que ce volume couvre notamment les lettres H, J et K explique la forte proportion de protestants alsaciens que l’on y trouve. Parmi les théologiens, on mentionnera – pour nous restreindre aux émérites et aux personnes décédées – Isaac Haffner, Gottfried Hammann, Charles Hauter, Jean-Georges Heintz, Jean Héring, Jean-Claude Ingelaere, Edmond Jacob, Bernard Kaempf, Bernard Keller, Marc Lienhard (qui fut également président d’Église) et Paul Lobstein. Plusieurs présidents d’Église ont droit de cité dans ce tome 3 : ainsi, dans l’ordre chronologique, les luthériens Robert Hoepffner et Étienne Jung, et les réformés Charles Albert Kuntz, Thérèse Klipfel et Christian Krieger (un peu curieusement, la notice tait ses origines luthériennes). Le facteur d’orgues Alfred Kern, le pasteur hymnologue Frédéric-Auguste Ihme et l’organiste Annemarie Lienhard figurent dans le présent volume, de même que Werner Jurgensen, qui fut secrétaire général du Directoire de l’ECAAL. Les gastronomes apprécieront les notices consacrées aux frères Jean-Pierre et Paul Haeberlin, et les amateurs de musique classique celles dévolues à Benoît et Salomé Haller. On trouve encore le juriste Christophe Guillaume Koch, le dessinateur et polémiste Hansi (Jean-Jacques Waltz), et les hommes politiques Patrick Hetzel, Jean Hoeffel et Daniel Hoeffel.
Deux éminentes collaboratrices d’Albert Schweitzer, Emma Haussknecht et Mathilde Kottmann, se voient consacrer chacune une notice assez brève. Il est à noter que d’autres protestants mentionnés dans ce tome 3 ont eu des liens étroits avec Schweitzer : ainsi, le professeur de médecine François Isch présida de longues années l’Association française des amis d’Albert Schweitzer, et Bernard Kaempf fut, durant une période plus brève en raison de sa disparition prématurée, à la tête de cette même association. Pour 223d’autres protestants, les rapports avec Schweitzer sont visiblement ignorés des auteurs des notices : ne sont pas mentionnés le fait qu’il étudia le piano chez Marie Jaëll et qu’il fut même le « cobaye » de la méthode qu’elle expose dans Le toucher (1899), ni que l’historien et publiciste Daniel Halévy se fit, à plusieurs reprises et dans les colonnes de grands journaux, le promoteur de sa pensée en France ; de même, l’auteur de la notice sur Valentine Lantz, qui fut missionnaire à la station de Talagouga, implantée sur le haut fleuve Ogooué, ne sait pas que c’est à elle que l’on doit le choix de Schweitzer pour Lambaréné. On complètera par ailleurs la notice consacrée au pasteur René Juteau, mort en avril 1945 en déportation, en signalant qu’il avait étudié à la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg.
Comme dans les volumes précédents, le centre de gravité du Dictionnaire… des protestants français de 1787 à nos jours porte sur l’époque présente. Ce choix explique la présence de quelques notices que d’aucuns, peut-être, jugeront prématurées. Par ailleurs, comme la longueur des notices (entre 1500 et 6500 signes) est laissée à l’appréciation des auteurs, elle n’est pas toujours en rapport avec l’importance de l’œuvre des personnes présentées.
Toutefois, ces observations n’enlèvent rien à l’importance de ce tome et, plus largement, du Dictionnaire biographique des protestants français. Les notices sont rédigées de manière soignée, et chacune d’entre elles est suivie de précieuses indications bibliographiques. Souhaitons que les deux directeurs et leurs collaborateurs trouvent l’énergie nécessaire pour mener à terme cette très belle entreprise.
Matthieu Arnold
XVI e -XVIII e siècle
Daniela Solfaroli Camillocci, Nicolas Fornerod, Karin Crousaz, Christian Grosse (dir.), La Construction internationale de la Réforme et l’espace romand à l’époque de Martin Luther, Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres » 495, 2021, 376 pages, ISBN 978-2-406-10811-5, 39 €.
Le présent volume est le fruit du colloque éponyme, organisé du 14 au 16 septembre 2017 à Genève par l’Institution d’histoire de la Réformation (Université de Genève), la section d’histoire 224de la Faculté des Lettres et la Faculté de théologie et de sciences des religions (Université de Lausanne), qui avait pour sous-titre : « Courants religieux, mutations sociales et circulation des idées à l’époque de Luther ». Partant du fait que, depuis les années 1960, une série d’études a mis en évidence le rôle des villes suisses dans la diffusion de la Réforme, cet ouvrage collectif se propose d’apporter à ces travaux « des approfondissements, voire des relectures […] en se penchant plus précisément sur les années du basculement, celles des conflits territoriaux et des premières constructions ecclésiastiques, tout en questionnant la pertinence des chronologies établies » (« Introduction », p. 9). Les quinze études qui composent cet ouvrage, et qui souvent se recoupent, voire se recouvrent partiellement, sont agencées en quatre parties.
La première partie, « Ruptures et édifications. Bâtisseurs de la Parole », traite du rôle déterminant de la parole dans ce basculement. Dans une communication fort suggestive, mais qui, de manière un peu surprenante, cite encore Luther par le biais de Félix Kuhn ou de Maurice Goguel, Denis Crouzet se pose la question, en lien avec ses propres thèses sur l’angoisse eschatologique, du type de rupture instauré par le Réformateur. L’étude de Michael Bruening s’attache aux relations entre Farel et les Réformateurs de langue allemande, à commencer par Œcolampade et Zwingli, mais aussi les Strasbourgeois Bucer et Capiton ; B. se fonde en particulier sur la correspondance des Réformateurs, mais jamais, sauf erreur de notre part, il ne se réfère à la correspondance de Bucer (voir pourtant BCor II, no 140 et 142) ; par ailleurs, les diagrammes représentant les réseaux épistolaires de Farel (p. 56-57) sont peu lisibles. C’est aussi à Farel que s’intéresse pour l’essentiel Geneviève Gross, dans un article portant sur la parole orale (prédication, dispute) au service de la Réforme de langue française. La Dispute de Lausanne (1536) se retrouve dans l’enquête de Fabrice Flückiger sur « Controverse oratoire et politique religieuse dans les possessions bernoises au début du xvie siècle » ; mais il y est question plus encore de la Dispute de Berne, les Réformateurs de cette cité faisant face, comme les Strasbourgeois à la même époque, au « défi anabaptiste ».
La deuxième partie est consacrée aux transitions institutionnelles, fruits de la confrontation et des négociations entre « les théologiens, les magistrats et les membres des communautés » (p. 16). Pour Matthieu Caesar, « Un monde incertain. Diffusion des idées évangéliques et réformes concurrentes en Savoie (vers 2251520-1530) », la victoire du « parti luthérien » n’a été un processus ni linéaire ni prévisible, et il vaudrait mieux écrire l’histoire de réformes concurrentes que celle de la diffusion (et de la répression) des idées évangéliques en Savoie. Dans sa communication synthétique, Andreas Würgler considère le rôle de Berne dans la diffusion de la Réforme en Suisse romande sous un angle non seulement politique et militaire, mais encore sous celui des médias utilisés pour la diffuser ; il est à noter que, dans la Suisse francophone des années 1520, les brochures imprimées n’ont pas joué un rôle aussi important que les Flugschriften dans l’espace germanophone. Le sort des biens ecclésiastiques en Suisse romande (1536-1542) fait l’objet de la contribution de Claire Moutengou Barats, Calvin et ses collègues étant attentifs à l’argumentaire développé par les Réformateurs allemands tout en défendant pour leur part un usage de ces biens dans le strict cadre des missions de l’Église. Grand connaisseur des Registres du Consistoire de Genève, dont il est l’éditeur scientifique, Jeffrey R. Watt, « La discipline des réformés », conclut au succès de la fonction disciplinaire et pédagogique des consistoires dans l’implantation de la Réforme en milieu urbain puis en milieu rural.
La troisième partie traite du rôle de l’imprimé dans la diffusion des idées protestantes, sans le détacher de l’action de la parole prêchée. Ainsi, Nathalie Szczech, « Un groupe en polémique », met en évidence les pratiques concertées d’écriture du « groupe de Neuchâtel » (Farel, Viret, Olivétan, Saunier, Marcourt, Malingre et Froment) dans les années 1530, et leur influence sur un réseau plus vaste de prédicateurs francophones. Dans une contribution qui souligne en plusieurs endroits l’influence exercée par les sermons et les catéchismes de Luther, Marianne Carbonnier-Burkard s’intéresse à un petit recueil de quatre ouvrages imprimés à Genève autour de 1540 qui témoigne de la circulation de la littérature de réconfort de l’espace germanophone à l’espace romand. Isabelle Garnier traite du rayonnement de Marguerite de Navarre dans l’espace romand par l’intermédiaire de l’imprimeur Jean Girard, qui édite en 1539 Le Miroir de treschrestienne Princesse Marguerite de France…, peu de temps avant de publier l’Epistre tresutile… de Marie Dentière. Dans un article qui attribue à F. Lestringant (p. 255, n. 19) l’édition de l’Institution de la Religion chrétienne réalisée par O. Millet, William Kemp présente la collaboration entre les imprimeurs Jean Girard et Michel Du Bois à Genève entre 1539 et 1543.
226La quatrième et dernière partie, « Trajectoires. Collaborations, confrontations, transferts », est un peu fourre-tout, mais chacune de ses contributions retient l’intérêt. Jade Sercomanens nous fait découvrir les « conversions littéraires et trajectoires religieuses » d’un personnage moins connu, Eustorg de Beaulieu, auteur en 1548 de L’Espinglier des filles, guide spirituel et comportemental destiné aux jeunes filles. L’article d’Ueli Zahnd sur la traduction française du catéchisme bernois de 1551 de Nicolas Zurkinden (1506-1587) aurait tout aussi bien pu trouver sa place dans la section III, après celui de M. Carbonnier-Burkard. Pour finir, dans une étude qui déborde la chronologie du présent volume puisqu’elle couvre le demi-siècle 1520-1570, Marion Deschamp se penche sur les mobilités étudiantes (il est question assez rapidement, p. 310, du Gymnase fondé par Jean Sturm) ; dans son Album amicorum, Claude Senarclens, parti à Wittenberg en 1545, parvint encore à recueillir des autographes et des citations de Luther, dont les « reliques graphiques » restaient alors les plus prisées.
Conformément à ses visées, ce volume, qui rassemble des études de première main et de qualité, ne bouleverse pas notre connaissance du rôle des territoires romands dans la diffusion – et, ajouterions-nous, l’établissement – de la Réforme, mais il l’enrichit et la nuance.
Les Éd. ont eu la bonne idée de pourvoir ce volume non seulement d’index (noms, lieux, p. 355-362), mais encore d’une substantielle bibliographie générale (p. 323-353).
Matthieu Arnold
Cédric Michon, Henri VIII. La démesure au pouvoir, Paris, Perrin, coll. « Perrin Biographie », 2022, 410 pages, ISBN 978-2-262-09724-0, 25 €.
Après une biographie érudite de François Ier (2018), qualifié de « roi entre deux mondes », il est heureux que l’A. ait également choisi d’aborder son rival anglais. L’on relèvera d’ailleurs la similarité des thèses : comme François Ier, Henri VIII est un monarque de transition entre le Moyen Âge et les temps modernes, « incarnation de la tradition » tout en étant « d’une parfaite modernité » (p. 367).
Outre un « prologue » (p. 9-16) et une conclusion (p. 359-369), l’œuvre est composée de vingt-six chapitres répartis en quatre grandes 227parties. La première (p. 17-84) aborde le règne d’Henri VII (le père du futur Henri VIII), l’éducation très féminine du jeune Henri, l’ascension du prince après le complot de Perkin Warbeck et plus encore la mort de son frère aîné Arthur, ainsi que ses « premiers pas » (p. 77-84) en tant que roi. La deuxième partie (p. 85-162), essentiellement chronologique, relate la première période du règne, de la campagne française de 1513 à la chute du cardinal et chancelier Thomas Wolsey (1529-1530). La troisième partie (p. 163-271) est tout entière consacrée à la mise en place de la suprématie d’Henri VIII sur l’Église d’Angleterre et à ses conséquences, jusqu’à la fin de la décennie 1530. L’on relèvera notamment une brillante synthèse consacrée à la « religion d’Henri VIII » (p. 238-247). Enfin, la dernière partie (p. 273-358) mêle de façon quelque peu désordonnée des chapitres chronologiques (chap. 22, 24-26) et des chapitres plus thématiques (chap. 21, 23) analysant la mise en scène de la majesté royale (p. 277-286) et les réalisations architecturales du règne (p. 300-318).
Henri VIII a laissé à l’historien de nombreuses annotations de sa main, ce qui permet de brosser le portrait psychologique du souverain beaucoup plus aisément que pour la majorité de ses contemporains (p. 14). L’A. offre ainsi plusieurs passages décrivant le complexe du roi vis-à-vis de son père (p. 11, 28-29, 58, 63, 83-84, 284) ou son besoin pathologique de se sentir aimé (p. 63, 100, 198, 224). Au-delà de la personnalité d’Henri VIII, l’A. propose un bilan complet de son règne. Sur le plan diplomatique, le monarque se présente comme un « troisième acteur » (p. 109) entre les deux « géants » (p. 124) que sont Charles Quint et François Ier, voire un « arbitre de la chrétienté » divisée (p. 215), même si, paradoxalement, c’est un « arbitre dont personne ne veut » (p. 216). L’A. propose de belles pages sur les transformations militaires du règne, faisant par exemple d’Henri VIII « d’une certaine manière le fondateur de la Royal Navy » (p. 331-332). Les mutations institutionnelles et les rouages de l’État en construction sont également présentés de manière simple mais érudite (p. 66-67, 75, 78, 117-119, 236, 289…). L’évolution du king and parliament en king-in-parliament au cours du règne mérite d’être relevée (p. 190). Mais c’est avant tout par son analyse de la symbolique royale que l’A., spécialiste de la Renaissance, époque où le « décorum et la mise en scène » sont primordiaux (p. 112), se distingue.
L’on saura gré à l’A. de donner une juste appréciation de la politique religieuse d’Henri VIII. Ce « roi théologien » (p. 123), grand 228adversaire de Martin Luther (p. 120-123), offre « un chemin entre les deux extrêmes du catholicisme romain et du protestantisme » (p. 243). Suivant probablement les intuitions de B. Cottret, l’A. caractérise la réforme henricienne comme un « “papisme” sans pape » (p. 252). L’antipapisme virulent et le biblicisme d’inspiration humaniste du roi d’Angleterre contrebalancent ainsi un antiprotestantisme évident, que traduit par exemple la valorisation des œuvres à côté de la grâce dans la théologie de la justification (p. 248). Véritable « nouveau pape en Angleterre » (p. 277), Henri VIII doit avant tout être vu comme le réformateur de son royaume (p. 239). L’on appréciera particulièrement les pages consacrées à la diffusion paradoxale de la Bible en anglais (p. 253-257, 296-299), aux figures bibliques mobilisées au service de la majesté royale (p. 277-279) ou encore au rôle religieux prépondérant de la dernière épouse d’Henri VIII, Catherine Parr (p. 324).
L’on pardonnera à l’A. l’usage, sans doute pédagogique, de plusieurs anachronismes : la vie d’Henri VIII assimilée à un « biopic américain » (p. 15) ; la présentation du monarque comme un « rappeur » ou un « nouveau riche » (p. 16) ; la description d’un « Henri VIII 2.0 » (p. 279) forgé par son « designer » Hans Holbein (p. 283) ; les références à la politique contemporaine (p. 226, 331) et à des séries télévisées (p. 220). Certains points pourraient être plus développés – la procédure si influente qu’est le praemunire mériterait sans doute une explication plus longue que la petite note de la p. 380. Mais l’ouvrage n’en constitue pas moins une excellente biographie, caractérisée par sa maîtrise des sources (p. 393-395) et de l’historiographie (p. 397-401), notamment anglo-saxonne, et appuyée par un utile index des noms de personnes (p. 403-408).
Adrien Boniteau
Valentin Krautwald, In evangelium Matthaei annotata. Vorlesung über das Matthäusevangelium (1530). Eingeleitet und herausgegeben von Martin Rothkegel, Baden-Baden – Bouxwiller, Valentin Koerner, coll. « Bibliotheca Dissidentium. Scripta et studia » 10 = coll. « Corpus schwenckfeldianorum. Supplement Volume » I, 391 pages, ISBN 978-3-87320-876-6, 112 €.
Dédié à la mémoire d’André Séguenny (1938-2019), le fondateur de la « Bibliotheca Dissidentium », le présent ouvrage paraît 37 ans 229après le volume de la « Bibliotheca » qui avait été consacré à Valentin Crautwald (vers 1490 ?-1545). R., qui édite depuis plusieurs années la « Bibliotheca », est un spécialiste de l’exégèse « dissidente » au xvie siècle ; c’est ainsi qu’il a publié, en 2017, le commentaire sur l’évangile de Jean (1597) de l’anabaptiste Hauprecht Zapff. En 2021, le manuscrit du présent volume a été accepté comme habilitation à diriger les recherches par la Faculté de Théologie de l’Université de Göttingen.
C’est durant la brève période où le duc Frédéric II de Liegnitz-Brieg-Wohlau a tenté de créer une université en Silésie (1526-1530) que Valentin Crautwald a donné des cours à Liegnitz. Dès 1997, l’Éd. avait trouvé, dans la bibliothèque du Musée national de Prague, un manuscrit révélant le contenu des cours donnés par Crautwald (outre Matthieu, il a commenté Jean, les Actes des Apôtres et les épîtres de Paul).
L’introduction, fort développée (p. 13-82), brosse tout d’abord, à l’aide de sources diverses, notamment des correspondances, l’histoire de la tentative de créer une université à Liegnitz, la biographie de Crautwald et son activité d’enseignant (p. 13-24). Elle traite ensuite en détail de la transmission de ses cours (p. 25-39) en décrivant les différents manuscrits qui les documentent. En ce qui concerne le commentaire de Matthieu, le manuscrit de Prague (P), sur lequel se fonde la présente édition, constitue pratiquement le seul témoin textuel : les manuscrits de Munich (M) et de Cambridge (C) contiennent tous deux l’explication de Mt 26,26-27. L’A. décrit ensuite (p. 41) une autre source importante qu’il édite dans le présent volume – même si cette édition n’apparaît pas sur la page de titre de son ouvrage –, la Vita beati Valentini Crautwaldi, Silesii theologi (1554) d’Adam Reißner. Ce témoignage (voir son éd., p. 105-111), qui présente maints traits quasi hagiographiques, constitue la principale source du xvie siècle relative aux cours de Crautwald à Liegnitz.
Les pages consacrées aux sources sur lesquelles Crautwald se fonde (p. 45-59) montrent tout d’abord qu’il a utilisé la quatrième édition bilingue (1527) du Nouveau Testament d’Érasme de Rotterdam, mais qu’il avait accès aussi à la Complutensis (1514), ce que confirme la consultation du commentaire : « adikias. Legit Complutensis pro akatharsias » (p. 316, à propos de Mt 23,27). Parmi les commentaires des Pères sur Matthieu, Crautwald connaissait en particulier ceux d’Hilaire de Poitiers et de Jérôme, ainsi que les 230homélies de Chrysostome. Il avait sans doute une connaissance directe de l’interprétation du Notre Père par Cyprien, tandis que celles de Jérôme et d’Origène lui étaient accessibles par les Annotationes d’Érasme (p. 50-51). L’Éd. livre encore de précieuses informations sur les sources médiévales de Crautwald et montre combien son rapport à la tradition était à la fois éclectique et critique (p. 54-55). Parmi les écrits de ses contemporains, Crautwald avait lu sans doute, outre ceux d’Érasme – le seul qu’il cite nommément –, les Annotationes in evangelium Matthaei (1523) de Melanchthon et les Enarrationes in evangelion Matthaei (1528) de Martin Bucer (p. 56 sq.) ; aussi l’Éd. renvoie-t-il fréquemment, dans les notes de son édition, à ces trois auteurs. L’introduction traite encore des cours et de l’herméneutique de Crautwald (p. 60-63), avant de présenter un résumé détaillé de son commentaire de Matthieu (p. 63-80). L’Éd. livre enfin ses principes éditoriaux (p. 81-82).
Le commentaire verset par verset de Crautwald, qui se caractérise par sa concision, est indiscutablement un commentaire biblique réformateur : en témoigne par exemple son interprétation de Mt 16,18-19 (p. 254-256). L’édition de M. Rothkegel montre d’une part la dette de cet exégète à l’endroit d’Érasme de Rotterdam et d’autre part l’originalité de l’interprétation de ce « non-conformiste religieux ».
L’édition des Annotata in evangelium Matthaeum (p. 115-321) est munie de notes infrapaginales fort utiles et complètes sans être pour autant envahissantes. Lorsque cela est nécessaire, l’Éd. établit des parallèles avec d’autres écrits de Crautwald : il renvoie par exemple, à propos de l’union hypostatique, au De cognitione Christi… de 1529 ; p. 121, n. 3). De même, tantôt R. se contente de brefs renvois à des commentaires de Matthieu de l’Antiquité, du Moyen Âge et de la Réforme, tantôt il cite plus longuement des passages pertinents : ainsi, les Enarrationes de Bucer sur Mt 3,14 (le refus, par Jean, de baptiser Jésus, voir p. 142, n. 39), la Paraphrasis d’Érasme (1524) sur Mt 4,20 (p. 149, n. 28) et le De sermone domini in monte d’Augustin à propos de Mt 5,22 (p. 156, n. 35). Dans son interprétation de Mt 6,11, Crautwald se situe dans la tradition qui comprend la quatrième demande du Notre Père comme se rapportant au « coelestis panis, verbum dei Ihesus Christus » (p. 168). D’autres notes infrapaginales se rapportent à l’exégèse typologique de Crautwald (p. 151, n. 2), à son interprétation de Mt 17,24 en lien avec le commandement d’obéissance aux autorités civiles, fussent-elles mauvaises (p. 266, 231n. 52), ou encore à sa compréhension des paroles d’institution de la Cène (p. 347, n. 39).
La bibliographie (imprimés avant 1600, p. 84-86 ; après 1600, p. 87-101 – y sont mêlées les éditions de textes et les études) est importante, mais elle ne vise nullement l’exhaustivité. Manquent ainsi les ouvrages de Jean-Pierre Delville, L’Europe de l’exégèse au xvie siècle. Interprétations de la parabole des ouvriers à la vigne (Matthieu 20,1-16), Leuven – Paris, 2004, et le tome 11 des « Études d’histoire de l’exégèse », Matthieu 5,48. Soyez parfaits !, Paris, 2017.
Des index fort détaillés (noms propres, p. 375-379 ; passages bibliques, p. 380-388 ; auteurs et œuvres, p. 389-391) facilitent la consultation de cette importante édition.
Matthieu Arnold
Hubert Bost, Bayle calviniste libertin, Paris, Honoré Champion, coll. « Vie des huguenots » 88, 2021, 456 pages, ISBN 978-2-7453-5497-6, 75 €.
Hubert Bost, interprète reconnu de Pierre Bayle, éditeur de sa Correspondance et de plusieurs de ses écrits, rassemble sous un titre oxymorique vingt-trois textes, publiés ou restés inédits, rédigés entre 2006 et 2017. Il donne lui-même, dans l’introduction à ce volume, la clé de son intitulé : « Le pôle calviniste, c’est l’affirmation de son maintien dans la foi réformée, vers laquelle il a choisi de revenir, et son fidéisme, quel qu’en soit le degré de sincérité. […] Le pôle libertin, c’est la critique de la religion dont on ne sait pas toujours jusqu’où elle mène, le scepticisme, l’athéisme au moins méthodologique. » (P. 13.)
Ces vingt-trois textes ont été rédigés pour des volumes collectifs ou pour des recueils d’actes de colloques (certains d’entre eux, comme « Sacra doctrina », organisé par la Mission historique française à Göttingen en 2007, ou « Marc Bloch : la figure de l’intellectuel en résistance de l’Antiquité à nos jours », réuni par l’Université de Strasbourg en 2009, n’avaient pas fait l’objet d’une publication), plus rarement pour des revues ; le bref texte final, « Bayle et la liberté de conscience » (chap. 23), est le fruit d’une allocution prononcée le 3 décembre 2006 au Musée du Désert. Toutes ces études ont été rédigées en français, à l’exception du long chapitre 12, « Bayle and 232Censorship ». Il n’est pas possible de signaler chacun des articles réunis par l’A. ; tous se caractérisent par leur rigueur historique.
L’A. se fonde sur la Correspondance, dont il donne un aperçu général (chap. 2), pour présenter un Pierre Bayle familier, les lettres échangées avec ses frères Jacob et Joseph apportant des indications précieuses sur le milieu où ils ont grandi (chap. 1). Ce sont encore les lettres qui nous renseignent sur Bayle élève et précepteur, et sur ses jugements à l’endroit des pédagogues, sa propre pédagogie étant marquée par l’importance assignée à une argumentation qui transcende les divisions confessionnelles ou religieuses (chap. 3).
Sans surprise, l’A. exploite en de nombreux endroits le Dictionnaire historique et critique : les articles « Adam » et « Ève » (chap. 5) ; la biographie de Calvin – notamment son mariage et l’exécution de Servet –, et le style du Réformateur, pour lequel Bayle professe une vive admiration : « La main de maître se fait tellement sentir dans cet ouvrage [l’Institution de la religion chrétienne], & avec telle supériorité de génie […] » (chap. 6, p. 101). Bayle traite aussi des reliques (chap. 7) dans son Dictionnaire, mais les réflexions les plus développées à leur sujet se trouvent dans ses Pensées diverses sur la comète. Le chap. 17 présente la manière dont, dans son Dictionnaire, Bayle « convoque les philosophes et les systèmes philosophiques dans sa propre pensée » (p. 323). Le présent ouvrage se fonde encore sur maints autres écrits de Bayle : parmi eux, son Commentaire philosophique, sa Critique générale de l’Histoire du calvinisme, ses Nouvelles de la République des Lettres, ses Nouvelles Lettres critiques ou ses Réponses aux questions d’un provincial sont les plus cités.
Les chapitres synthétiques 8 (« Un “protestant compliqué” ») et 9 (« Critique de la raison théologique : Bayle et le calvinisme ») traitent du rapport de Bayle aux systèmes théologiques protestants. Le chapitre 10, fondé en partie sur des traités d’homilétique (ils polémiquaient contre une pédagogie du rire), se lit avec délectation ; il met en évidence que Bayle, fils d’un pasteur qui avait tendance à endormir ses auditeurs, avait lui-même peu de goût pour l’éloquence de chaire : incapable de prêcher, il était de surcroît un auditeur peu enthousiaste…
Signalons encore, en lien avec le titre de l’ouvrage, le chap. 14, « La rétorsion du libertinage » : qu’il s’agisse de prendre la défense des Réformateurs contre les controversistes catholiques ou de se défendre lui-même face à Jurieu, Bayle retourne le procès en libertinage contre les accusateurs. Les chapitres 15 (« Contrainte 233théologico-politique et droits de l’âme »), 18 (« Bayle patriote ») et 21 (« Bayle pense-t-il la tyrannie en philosophe ? ») renferment des réflexions éclairantes sur les conceptions politiques de Bayle. Le chapitre 20 pose la question « Bayle, “précurseur de la laïcité” ? » en plaidant, contre Lucien Febvre, pour un « anachronisme contrôlé » : « à la différence du péché dont la gravité augmente avec la conscience de le commettre, l’anachronisme n’est-il pas d’autant plus irrémissible qu’il est commis par un ignorant ou un inconscient ? » (p. 377). Le chapitre 22 s’attache à la lecture que, dans les années 1930, Alexandre Kojève a faite de Bayle.
L’ouvrage ne comporte pas de bibliographie générale, mais un « Index des articles du Dictionnaire historique et critique » (p. 439-440) et un « Index des noms propres et des titres d’ouvrages » (p. 441-452) ; l’un et l’autre rendront de grands services.
Chacun des vingt-trois textes réunis dans ce livre a été rédigé dans des circonstances bien précises, souvent en lien avec le thème d’un colloque ou d’un volume collectif. Pourtant, on est frappé, en refermant cet ouvrage, par sa très grande cohérence. La pensée nuancée et suggestive de l’A. se déploie tout au long de ce volume, soutenue de bout en bout par une écriture limpide. En regroupant le fruit d’une décennie d’études autour de Pierre Bayle, l’A. offre à la collection « Vie des huguenots » une contribution de valeur.
Matthieu Arnold
XIX e -XXI e siècle
Dietrich Bonhoeffer, Sanctorum communio. Une recherche dogmatique sur la sociologie de l’Église. Texte critique traduit de l’allemand par Bernard Lauret sous la direction de Christophe Chalamet. Introduction de Christophe Chalamet, Genève, Labor et Fides, coll. « Œuvres de Dietrich Bonhoeffer » 1, 2022, 241 pages, ISBN 978-2-8309-1783-3, 27 €.
En 1930, trois ans après la soutenance de sa thèse de doctorat et un an après la parution de l’ouvrage de Paul Althaus, Communio sanctorum. Die Gemeinde im lutherischen Kirchengedanken, Dietrich Bonhoeffer publiait sa thèse sous une forme passablement abrégée : Sanctorum communio. Eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche. C’est sur cette version abrégée que se fonde la présente 234édition, mais, à la différence de l’édition de référence allemande sur laquelle elle se fonde (Dietrich Bonhoeffer, Werke), elle n’a pas cru bon devoir signaler en notes les passages qui ont été coupés « afin de ne pas alourdir le volume » (voir l’« Introduction à l’édition française », p. 7 sq.). Il est vrai que certaines des notes infrapaginales de B. sont déjà fort longues et courent sur plusieurs pages.
Il s’agit, pour B., de mettre la « philosophie sociale » et la sociologie au service de la dogmatique (« Avant-propos », p. 27). L’intérêt de B. pour la sociologie s’explique aisément par son souci d’examiner, dans l’Église, les rapports entre l’individu et la communauté. B. avance la thèse suivante : « Nous affirmons que la communauté comme personne collective doit être saisie selon la même structure que la personne individuelle. » (P. 63, souligné par B.) Les passages sociologiques alternent avec les exposés proprement théologiques, même si B. s’efforce d’articuler la sociologie et la dogmatique plutôt que de juxtaposer l’une et l’autre. B. s’intéresse ainsi à la typologie des communautés sociales (p. 70-76), aux formes et aux fonctions sociologiques de l’Église empirique (p. 169-187) ou encore à l’Église comme type sociologique autonome et à sa place dans la typologie sociologique (p. 188-203). Toutefois, le bref chapitre iv, « Le péché et la communion brisée », est de facture spécifiquement dogmatique.
Plusieurs années avant son cours sur Jésus-Christ (voir Bonhoeffer, Œuvres, 2b), B. souligne déjà l’importance du Christ pour la « communion/communauté des saints », et pas seulement dans les pages consacrées à « L’Église fondée dans et par le Christ » (p. 104-114) : « Cet être l’un avec l’autre de la communauté et des membres de la communauté, tel que cela a été établi pour le Christ, implique aussi l’être l’un pour l’autre » (p. 135). B. se réfère notamment à Luther, qui est d’ailleurs l’auteur qu’il cite le plus souvent, loin devant Max Scheler, Ernst Troeltsch ou Georg Simmel. Il se fonde en partie sur l’écrit de réconfort Tessaradecas consolatoria pro laborantibus et oneratis (1520) : « Dans les Tessaradecas, Luther expose avec une incomparable beauté ses pensées sur ce point. Mon fardeau, ce sont les autres qui le portent, leur force est ma force, la foi de l’Église vient à l’aide de mes tremblements et craintes. Et même quand vient le moment de la mort, je dois être sûr que ce n’est pas moi, ou plutôt pas moi tout seul qui meurt, mais que le Christ et la communauté des saints souffre (sic) et meurt (sic) avec moi. […] La communauté ne pourrait aucune chose si le Christ ne la portait ; c’est seulement au regard des mérites du Christ que Luther peut parler des mérites des 235autres qui m’aident » (p. 133 et 135). Du Réformateur, B. cite encore notamment le Sermon sur les bonnes œuvres (1520), qui rappelle que le diable a peur devant un toit de chaume sous lequel prie la communauté (p. 140, voir aussi p. 135), ou encore les propos selon lesquels tous sont un en Christ au point d’être « eyn kuche[une tourte de pain] » et « eyn ding[une seule chose] » (p. 149). La définition que B. donne de l’Église empirique combine quant à elle les « marques » de l’Église – la parole prêchée, les sacrements administrés – avec des éléments sociologiques : « L’Église empirique est l’“institution” du salut – une institution organisée – au milieu de laquelle se trouve le culte avec la prédication et le sacrement ou, pour le dire sociologiquement, l’“assemblée” de ses membres. » (P. 155 ; voir aussi p. 200, pour une définition plus sociologique, l’Église réunissant et dépassant, selon B., les types sociologiques fondamentaux de la société, de la communauté – Gemeinschaft – et de l’association de souveraineté – Herrschaftsverband.) Luther est convoqué enfin à propos de la dimension eschatologique de la communauté (p. 213).
L’intérêt de B. pour la pensée de Luther se confirmera jusque dans ses derniers écrits. Toutefois, il n’est sans doute pas interdit de voir aussi, dans ces références nombreuses au Réformateur, l’influence du directeur de thèse de B., Reinhold Seeberg, qui enseigna à Berlin de 1898 à 1927. Dans l’avant-propos de sa publication, B. remercie Seeberg non seulement pour avoir « aimablement suivi ce projet avec le plus grand intérêt depuis le début », mais encore parce qu’une contribution de la fondation Seeberg a rendu possible l’impression de son ouvrage (p. 27 sq.). Or, en raison de ses positions nationales-conservatrices (voir les travaux de G. Brakelmann), Reinhold Seeberg est tenu pour un théologien qui a nourri, chez ses élèves, des dispositions à accueillir avec sympathie les idées nazies… ce qui ne fut guère le cas pour Bonhoeffer. Il aurait été intéressant que la suggestive « Introduction à l’édition française » (p. 7-22) de Christophe Chalamet, qui vient de succéder à Henry Mottu pour la direction des Œuvres de Dietrich Bonhoeffer, abordât cette question, d’autant plus qu’elle signale chez B. le thème de la « faute de l’Allemagne » et le fait que le peuple (Volk) doive faire pénitence (p. 12, voir p. 88) : Seeberg a-t-il approuvé ces passages ? On aurait souhaité connaître par ailleurs la référence exacte des propos de Barth qualifiant l’ouvrage de B. de « surprise théologique (theologische Überraschung) », car ils sont donnés seulement par l’intermédiaire d’un ouvrage anglais portant sur la théologie de B. (p. 21).
236Malgré la présence, entre crochets, d’assez nombreux renvois aux termes allemands de l’édition originale, la traduction est fluide sans être une « belle infidèle ». Tout au plus B. Lauret aurait-il pu traduire par « parole de réconfort » le terme Trostwort qu’il rend par « mot de consolation » et que Bonhoeffer met en relation avec Luther (p. 176) ; le fait même qu’il ait jugé bon de donner l’original entre crochets montre que, sans doute, il n’était pas entièrement satisfait par sa traduction. Mais le problème majeur qui s’est posé à lui est celui de l’alternance continuelle, chez B., entre les termes « Gemeinde » et « Gemeinschaft », qui tous deux renvoient à communio ; Gemeinde est rendu le plus souvent par « communauté », Gemeinschaft peut signifier un groupement humain mais revêtir aussi un sens spirituel ou théologique. B. se demande ainsi « si la communauté [Gemeinde] dans laquelle l’amour de Dieu agit est réellement “communauté” [Gemeinschaft]. » (P. 129.) Tant l’« Introduction à l’édition française » (p. 13 sq.) que la « Note de traduction » (p. 23 sq.) ne manquent pas de souligner ce problème terminologique.
Les notes des éditeurs sont réduites à l’essentiel. La bibliographie des œuvres citées par B. (p. 218-227), le « choix bibliographique pour Sanctorum Communio » (p. 227-229) et les index (Bible, p. 231-233 ; noms de personnes, p. 235-237) rendront de grands services au lecteur.
Avec la parution en français de cette première œuvre de B., qui témoigne de la très grande maturité du jeune théologien, les Éd. du présent volume apportent une pierre importante au bel édifice des Œuvres de Dietrich Bonhoeffer. On attend avec impatience la parution des derniers ouvrages de la série.
Matthieu Arnold
Face au nazisme. Le cas alsacien. Catalogue réalisé sous la direction de Catherine Maurer et de Jérôme Schweitzer avec les collaborations de Pauline Belzève et de Théo Mertz, Strasbourg, Bibliothèque Nationale et Universitaire, 2022, 192 pages, ISBN 978-2-85923-094-4, 24 €.
Quatre-vingts ans après que les Mosellans puis les Alsaciens ont été incorporés de force, la BNU (Strasbourg) a eu l’excellente idée d’organiser une exposition sur l’Alsace annexée (de facto, non 237de iure). Catherine Maurer, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Strasbourg, et Jérôme Maurer, conservateur à la BNU, ont été les commissaires de cette exposition et les maîtres d’œuvre de son catalogue, assistés de Pauline Belzève et de Théo Mertz.
Préfacé par Alain Colas, directeur de la BNU, le catalogue s’ouvre tout d’abord sur une précieuse chronologie qui couvre les sombres années du « IIIe Reich ». De manière fort heureuse, les études et le catalogue proprement dit n’ont pas été séparés, puisque chacun des 20 textes synthétiques est accompagné des notices qui y sont liées. Ces articles sont regroupés dans trois parties d’inégale longueur : I. Une frontière contestée ? Les années 1920-1930 (p. 14-63) ; II. Une nouvelle Alsace dans une nouvelle Europe ? 1940-1945 (p. 64-155) ; III. De la mémoire à l’histoire. De 1945 à nos jours (p. 156-187).
Les cinquante pages dévolues à la première partie cherchent à mettre en évidence les continuités entre la période de l’annexion et les décennies qui la précèdent : « Placées dans une position politique inconfortable, quelques années seulement après leur retour à la France, l’Alsace et la Moselle connaissent une forte poussée de l’autonomisme. Il s’agit là d’une réponse au pouvoir français jugé trop brutal et peu soucieux des particularismes locaux » (p. 34), conclut Jérôme Schweitzer après avoir présenté de manière nuancée « les liens d’une partie des autonomistes avec le national-socialisme » (p. 26-40) ; on trouve parmi ces mouvements autonomistes celui de la Jungmannschaft, « qui se structure sur le modèle de la Jeunesse hitlérienne et est notamment présent dans l’Alsace protestante du Nord » (p. 34). « En 1938, poursuit l’auteur, des rapports de police estiment qu’il rassemble environ un millier de membres. » Mais peut-on se fonder seulement sur des rapports de police sans tenter de les croiser avec d’autres sources ? Par ailleurs, des documents tels que la brochure Der Jude… unser Gebieter (Le Juif… notre maître, 1938) ou l’illustration Die Wacht am Rhein (La garde du Rhin, 1935), caricaturant un tirailleur sénégalais, montrent que l’antisémitisme et le racisme s’exprimaient ouvertement bien avant l’annexion.
La deuxième partie commence par rappeler comment, à partir de juin 1940, l’Alsace a été « mise au pas » selon le processus qui avait été mis en œuvre en Allemagne sept ans plus tôt. On lira avec un intérêt tout particulier l’étude de Theresa Ehret, doctorante en histoire contemporaine aux Universités de Strasbourg et de Fribourg-en-Brisgau, « Victimes d’une politique antichrétienne radicale ? Prêtres, pasteurs et paroissiens alsaciens face au nazisme » (p. 84-90). Cet 238article bien informé rappelle que les nazis furent les derniers à avoir introduit, le 29 octobre 1940, la séparation de l’Église et de l’État en Alsace ; il montre toutefois, en s’appuyant plutôt sur des exemples catholiques (E. ignore ainsi les recherches récentes consacrées à Charles Maurer, président du Directoire de l’ECAAL), qu’en certaines occasions, les fidèles ont osé faire valoir leurs intérêts et même obtenu gain de cause, la politique religieuse menée sur le plan local étant « plus modérée que ce que prévoyaient les directives venues de Strasbourg, de Munich ou de Berlin » (p. 90). On relèvera encore, dans cette partie, les pages traitant de « la place des femmes » (p. 91-94) – mères au foyer, elles sont aussi encouragées à prendre des postes de responsabilité dans le Reichsarbeitsdienst – et celles qui portent sur la répression des tsiganes et des homosexuels (p. 106-115). Si, entre 1940 et 1942, nombre des uns et des autres furent expulsés en France non annexée – mesure « sans doute moins brutale que les mesures mises en œuvre en Allemagne » (p. 114) –, la répression a été bien plus radicale ensuite : déportation vers des camps d’extermination pour les premiers, internement au camp Vorbrück-Schirmeck et condamnations par la justice, voire déportation en camp de concentration pour les seconds, dont plusieurs furent assassinés (p. 111 et 114). Le traitement de « La résistance en Alsace » (p. 152-155) aurait mérité d’être bien plus développé, sur le modèle de l’étude que Catherine Maurer consacre à la Reichsuniversität de Strasbourg et à l’Université strasbourgeoise repliée à Clermont-Ferrand (p. 140-151).
Dans la troisième partie, consacrée à la mémoire et à l’histoire, on trouve notamment un autoportrait de l’artiste Camille Claus durant son incorporation de force à Dresde (p. 162, coll. BNU), ainsi que la veste de déporté que le résistant Eugène Wurtz portait à Mauthausen (p. 163). Signalons encore une émouvante maquette de bateau à voile : elle fut réalisée par un déporté au camp d’Obernai, qui l’offrit à un habitant du lieu qui lui avait donné clandestinement de la nourriture (p. 164). Cet objet témoigne, comme le relève l’auteur du cartel, « des relations qui pouvaient exister, en dépit de leur interdiction, entre des prisonniers du camp de concentration et la population locale ». C’est également dans la troisième partie qu’il est question de manière plus spécifique des Juifs : d’une part en lien avec les spoliations puis les restitutions, étudiées par Jean-Marc Dreyfus (p. 176-182), d’autre part avec les lieux de mémoire que sont les « Stolpersteine (pierres d’achoppement) », qui signalent le dernier domicile, choisi librement, de personnes déportées et assassinées (Nicolas Laugel, p. 184-189).
239Les documents présentés, issus pour un grand nombre des collections de la BNU (imprimés et manuscrits), mais aussi des Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, sont variés, même si les journaux, les brochures et les affiches se taillent la part du lion. En règle générale, les reproductions photographiques sont d’excellente qualité ; elles occupent souvent une pleine page et parfois même une double page : c’est le cas, p. 52-53, des soldats et officiers de la Wehrmacht posant place Kléber, à Strasbourg, pour une photo-souvenir à côté d’un drapeau français, et, p. 72-73, d’un plan de Strasbourg de 1941 où la place Broglie est devenue l’Adolf-Hitler-Platz. Toutefois, certaines affiches sont imprimées dans un format hélas trop réduit pour que l’on puisse en lire le contenu ; ainsi, l’Anklage des Elsass gegen Frankreich / Accusations contre la France présentées par l’Alsace, 1940 (p. 51). Quant aux caractères dans lesquels ont été rédigés les cartels, leur taille entrave la lecture, alors qu’il y aurait eu de la place pour choisir un corps plus grand. Le choix d’imprimer en rouge les notes, qui se trouvent dans les marges intérieures, permet certes de les distinguer nettement du reste du texte, mais ne contribue pas non plus à leur lisibilité ; il en va de même pour la pagination de l’ouvrage.
Une « bibliographie indicative » (p. 188-190), qui fait apparaître combien l’Alsace annexée a retenu l’attention de la recherche depuis deux décennies, conclut ce très beau volume, qui se caractérise par la sûreté de son information et la pondération de ses jugements.
Matthieu Arnold
VIENT DE PARAÎTRE
Matthieu Arnold, Oscar Cullmann. Ein Leben für Theologie, Kirche und Ökumene. Aus dem Französischen übersetzt von Gerhard Philipp Wolf. Herausgegeben von Michael R. Jost,Zurich, Theologischer Verlag Zürich, 2023, 148 pages, ISBN 978-3-290-18529-9, 29,80 €.
Le présent ouvrage constitue l’adaptation allemande de notre livre Oscar Cullmann. Un docteur de l’Église (Lyon, Olivétan, 2019). Adaptation, car il ne s’agit pas simplement d’une traduction. Certes, 240la structure de l’opuscule original a été conservée : cinq chapitres, consacrés respectivement à la biographie d’Oscar Cullmann (chap. 1), à son œuvre de néotestamentaire (écrits scientifiques, chap. 2 ; opuscules de vulgarisation, chap. 3, en lien avec des thèmes ecclésiaux), à ses engagements sociétaux (avec les conceptions qui y sont liées, chap. 4) et œcuméniques (chap. 5), suivis d’une conclusion sur la pertinence et l’actualité de sa pensée. Toutefois, une préface inédite s’adresse au lectorat germanophone, la bibliographie a été actualisée et adaptée au lectorat germanophone (O. Cullmann a publié presque tous ses ouvrages en français et en allemand), et les chapitres 2 et 5 ont été complétés. Le chapitre 2 fait son profit de l’édition de la correspondance entre Oscar Cullmann et Rudolf Bultmann publiée avec les actes du colloque qui a été consacré aux deux théologiens à Berne à l’automne de 2019 (Rudolf Bultmann, Oscar Cullmann, Briefwechsel 1926-1967. Studien zum theologischen und exegetischen Austausch, éd. Michael Jost, Martin Sallmann et Benjamin Schliesser, Tübingen, Mohr Siebeck, 2022). Quant au chapitre 5, il a été complété notamment par l’étude de la correspondance inédite entre Oscar Cullmann et Léon-Arthur Elchinger, ainsi que des Carnets du Concile d’Henri de Lubac.
La traduction est l’œuvre d’un traducteur expérimenté, Philipp Gerhard Wolf, docteur en théologie. Le travail de l’auteur, du traducteur et des éditions TVZ a été coordonné par Michaël Jost, spécialiste en Nouveau Testament et éditeur de la correspondance entre Cullmann et Bultmann ; c’est également M. Jost qui a réalisé les index (noms de personnes, index biblique).
Matthieu Arnold
Frédéric Rognon, Prier 15 jours avec Jacques Ellul. Théologien de l’espérance, Paris, Nouvelle Cité, 2023, 126 pages, ISBN 978-2-375-82341-5, 13,90 €.
Jacques Ellul (1912-1994) est connu comme juriste, historien des institutions, théologien protestant, précurseur de l’écologie… Ce petit livre aborde une facette moins familière de sa personnalité : l’intimité spirituelle d’un homme de prière. La célèbre collection « Prier quinze jours… » est aujourd’hui riche de plus de deux cent quarante titres, chacun d’entre eux étant consacré à l’une des grandes figures spirituelles de l’histoire, pour l’essentiel des Pères de l’Église ou des 241saints catholiques. Quelques protestants y sont représentés : Martin Luther, Jean Calvin, Jean-Sébastien Bach, William et Catherine Booth, Albert Schweitzer, Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King. L’introduction de Jacques Ellul dans cette liste sonne à l’évidence comme une certaine reconnaissance du professeur de Bordeaux dans le monde catholique. Chaque volume propose au lecteur un parcours en quinze étapes, chacune étant constituée d’un court texte de la plume de la personnalité spirituelle en question, suivi de quelques pages de commentaires. Ce sont comme quinze stations d’un cheminement intérieur, ordonnées selon une logique d’approfondissement. Elles sont précédées d’une esquisse biographique et suivies d’un exposé sur la spécificité de la vie spirituelle de l’auteur. Quelques repères bibliographiques permettent d’aller plus loin.
En ce qui concerne Jacques Ellul, le problème d’intégration dans ce format tient au fait qu’il n’a publié aucune prière. En revanche, il a consacré un ouvrage intitulé L’impossible prière à la difficulté de prier dans la société technicienne et aux raisons qui demeurent de cultiver cette pratique. Quatre étapes se nourrissent de ce livre. On trouve néanmoins d’autres textes qui abordent les thématiques du style de vie du chrétien, de la contemplation, de l’espérance et du combat contre Dieu qu’elle suscite, de la relation au texte biblique, ou de l’identité de Dieu. C’est sans doute dans la poésie ellulienne, moins connue, que se déploie le plus librement l’expression de sa vie spirituelle : deux extraits de ses poèmes sont proposés au lecteur. Enfin, les deux derniers textes concernent l’éthique de la non-puissance et le bilan d’une vie d’engagements qui oscille entre paroles prophétiques et action de grâces.
Ce livre s’adresse au grand public, plus particulièrement aux chercheurs de vérité en quête de sens. Il offre un biais singulier pour évoquer un homme qui ne parlait de sa vie spirituelle qu’avec une immense pudeur, mais qui écrivit en 1969, dans le sillage du mouvement de Mai 68 : « Si vous voulez être véritablement révolutionnaires dans cette société […], soyez des contemplatifs ».
Frédéric Rognon