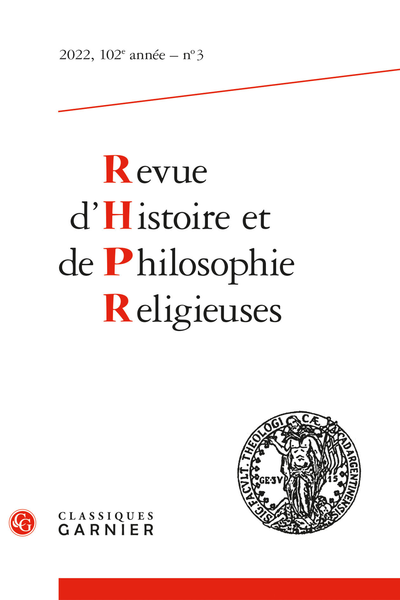
Revue des livres
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses
2022 – 3, 102e année, n° 3. varia - Auteurs : Noblesse-Rocher (Annie), Arnold (Matthieu), Monnot (Christophe), Frey (Daniel), Rognon (Frédéric), Siegwalt (Gérard)
- Pages : 343 à 393
- Revue : Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses
- Thème CLIL : 4046 -- RELIGION -- Christianisme -- Théologie
- EAN : 9782406141129
- ISBN : 978-2-406-14112-9
- ISSN : 2269-479X
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14112-9.p.0079
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 21/09/2022
- Périodicité : Trimestrielle
- Langue : Français
REVUE DES LIVRES
HISTOIRE
Moyen Âge (suite)
Olivier Marin, Ludovic Viallet (dir.), Pentecôtes médiévales. Fêter l’Esprit Saint dans l’Église latine (vie-xvie siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Hors-série », 2021, 244 pages, ISBN 978-2-7535-8086-2, 32 €.
Les Éd., Olivier Marin, maître de conférences à l’Université Paris XIII-Sorbonne et spécialiste du hussisme, et Ludovic Viallet, professeur d’Histoire médiévale à l’Université Clermont Auvergne et fin connaisseur de la vie religieuse à la fin du Moyen Âge, sont aussi les organisateurs du colloque, dont cet ouvrage renferme les actes, qui s’est tenu en 2017 à l’Université Paris-Nord et à l’École normale supérieure (Paris). Dans son introduction, O. Marin note le regain d’intérêt contemporain pour la troisième Personne de la Trinité, repérable notamment dans la mouvance pentecôtiste dont l’expansion mondiale est plus que notable. L’intérêt porté aujourd’hui à l’Esprit intéresse un médiéviste, dans la mesure où il entre en résonnance avec des phénomènes analogues au xiiie siècle, comme la Croisade dite des Enfants (1212), commencée précisément au jour de Pentecôte. Il ne s’agit pas, bien sûr, de comparer l’incomparable, mais d’étudier le rapport que le Moyen Âge, si christomoniste, a entretenu avec l’Esprit-Saint. L’effacement de l’Esprit à l’époque médiévale a donné lieu à la mise en place de cultes concurrents (marial, eucharistique). Le but du volume est d’examiner les raisons de cet effacement, alors que le culte de Pentecôte a pris son autonomie dès le ve siècle.
Le Moyen Âge a pourtant apporté sa part à l’enrichissement de la liturgie de Pentecôte : en témoignent les hymnes comme le Veni creator de Raban Maur ou le Veni sancte Spiritus, au début du 344xiiie siècle. La fête elle-même a bénéficié des progrès de la réflexion sur le septénaire spirituel, les sept dons de l’Esprit (És 11,2). La théologie s’est surtout attachée aux effets de l’Esprit, dons et vertus, que consacra, paradoxalement, la querelle entre thomistes et scotistes. Le développement de la prédication aux xie et xiiie siècles a permis à la Pentecôte de devenir le lieu privilégié de la réflexion sur le « genre » du sermon et ses effets sur un auditoire. Enfin, la Pentecôte lucanienne (Ac 2,42-47) a irrigué la réflexion sur la vita apostolica à partir du xie siècle. Jacques Le Goff n’évoquait-il pas déjà le Saint-Esprit comme un Dieu proche et quotidien, rapidement concurrencé, il est vrai, par le développement des cultes eucharistiques et mariaux, et celui des confréries du Corpus Christi ? Quoi qu’il en soit, le volume entend poser les jalons d’une histoire de la Pentecôte au Moyen Âge, et cela en trois parties : la première évoque les théologies médiévales de l’Esprit, orthodoxes et hétérodoxes ; la deuxième explore le vaste champ du culte et de la prédication ; la troisième traite des représentations de la Pentecôte à travers les images mentales ou matérielles.
Pour ce qui concerne la théologie, on mentionnera la belle contribution de Marc Vial (« Défenses et illustrations médiévales du Filioque »), qui montre les liens que la doctrine du Filioque a voulu établir entre la procession éternelle et la mission temporelle de l’Esprit, tant au Moyen Âge, chez Thomas d’Aquin, qu’à l’époque contemporaine dans la théologie de Karl Barth. Marc Bartoli évoque, quant à lui, la Pentecôte et l’Esprit Saint dans l’Histoire, à travers les écrits de Jean Olivi, disciple de Joachim de Flore, la Lectura super Apocalypsim en particulier. Deux contributions sont consacrées à la réception littéraire du phénomène pentecostal dans « quelques poèmes bibliques en français » (Marielle Lamy) et dans « les mystères français des xve et xvie siècles » (Véronique Dominguez).
Dans la deuxième partie, consacrée aux rites, Pascal Colomb étudie la liturgie de la Pentecôte dans la collégiale Saint-Paul de Lyon à la fin du Moyen Âge, notamment son aspect dramaturgique, puisque, comme dans les mystères médiévaux, l’apparition de la colombe ou des flammes de feu est strictement codifiée : il ne s’agit pas d’un ludus, d’un jeu liturgique, mais de la monstration d’une vérité vécue. Sophie Delmas s’attache ensuite aux sermons pour Pentecôte de Bonaventure, à ceux contenus dans les recueils de reportationes et aux sermons ad status. Trois thèmes y 345prédominent : l’utilisation du texte des Actes des apôtres permet d’affirmer l’action miraculeuse de l’Esprit Saint sur les apôtres, la consolidation de l’Église primitive à l’époque médiévale et, enfin, la rénovation de l’homme intérieur lors de cette liturgie pentecostale. Alexis Fontbonne s’attache, dans l’étude suivante, à la Pentecôte des laïcs et à l’appropriation dont la fête fait l’objet par les fidèles. Il rappelle la création très importante de confréries du Saint-Esprit au xiiie siècle, les distributions de nourriture aux pauvres lors de la fête, les prêts à taux non usuraire, l’assistance matérielle octroyée aux pauvres par les laïcs issus des classes moyennes. Il décrit ces actes de charité comme expression d’une théologie convenant par essence aux laïcs et qui consacrent une autonomie grandissante de ceux-ci, l’institution ecclésiastique faisant en la matière montre d’une neutralité bienveillante.
Dans la troisième partie, Sylvie Barnay propose une contribution sur le Liber specialis gratiae de Mechtilde de Hackeborn et le Legatus divinae pietatis de Gertrude d’Hefta : cette poésie spirituelle opère un acte de mémoire au travers duquel l’Esprit Saint joue un rôle médiateur, lors de la liturgie de Pentecôte. Cette école de théologie poétique des années 1300, conçue comme une machina memorialis, consacre le cœur divin comme le lieu d’une union entre l’âme et Dieu. Le récit de Pentecôte sert de cadre au défilé des images en mouvement qui viennent insérer la scène de la venue de l’Esprit dans le présent et le vécu de ces saintes femmes. Esther Dehoux étudie pour sa part 61 représentations de la Pentecôte entre le xie et le xiiie siècle : peintures murales, sculptures, vitraux, enluminures, provenant surtout de milieux monastiques. Représenter la Pentecôte, c’est représenter l’Église et donner à voir ce qu’elle est : une, sainte, universelle et apostolique, mais aussi romaine à partir du xiie siècle. Le volume se clôt avec une contribution de Matthieu Rajohnson portant sur les guides et récits de pèlerinage, depuis Le Pèlerin de Bordeaux en 333 jusqu’au récit de Felix Fabri au xve siècle, qui permettent de documenter la manière dont était célébrée la fête de Pentecôte à Jérusalem. Plutôt effacée devant les célébrations christiques et mariales, la Pentecôte hiérosolymite a sans doute pâti du culte des mystères de la Vie du Christ et d’une théologie occidentale christocentrée.
Ce volume, qui accorde toute sa place à la théologie, à la liturgie et à l’art dans une histoire de la Pentecôte au Moyen Âge comprise dans sa dimension humaine et spirituelle, se recommande par sa 346richesse et sa cohérence. Il est à proprement parler assez unique en son genre, et on saluera la volonté des Éd. de faire droit aux fondements théologiques des états de choses et des productions dont ce livre traite.
Annie Noblesse-Rocher
Theodor Dieter, Wolfgang Thönissen (éd.), Der Ablassstreit, Band I/1 : Vorgeschichte des Ablassstreits 1095-1517. Kirchliche Verlautbarungen, Recht, Theologie, Liturgie, Predigten, Ablassbriefe, Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt / Fribourg – Bâle – Vienne, Herder, 2021, xxix + 551 pages, ISBN
978-3-374-06349-9, 74 €.
Ce fort volume est le premier tome d’une vaste entreprise œcuménique dirigée par Theodor Dieter (Institut d’études œcuméniques, Strasbourg) et Wolfgang Thönissen (Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik, Paderborn) : elle comportera d’une part trois volumes de sources (« Dokumente zum Ablassstreit »), le présent concernant les textes antérieurs aux 95 thèses de 1517, le second – double ! – traitant les 95 thèses et le débat qui en a résulté de 1517 à 1520, et le troisième la période allant jusqu’à 1573 ; elle rassemblera d’autre part une série de commentaires des 95 thèses et des autres textes importants liés à la controverse sur les indulgences. Ce projet est œcuménique à la fois parce que ses directeurs et les contributeurs des futurs volumes sont des catholiques et des protestants, et parce qu’il donne la parole autant aux contradicteurs de Luther qu’à ce dernier.
Ce premier tome ne rassemble pas moins de 46 documents (ils sont numérotés de 1 à 25, mais un bon nombre d’entre eux, comme les séries de sermons ou de lettres d’indulgences, se subdivisent en plusieurs sources) agencés en trois sections. Ces textes sont présentés dans une édition bilingue pour la plupart d’entre eux (original latin, allemand contemporain), et les textes originaux en allemand du Moyen Âge ou du début de l’époque moderne sont rendus en allemand contemporain. L’intérêt du présent ouvrage est non seulement de rassembler des textes qui ont paru dans diverses éditions scientifiques (textes pontificaux, corpus de droit canon, etc.), mais encore de publier quelques inédits, comme le cycle de prédications que Hermann Rab a consacrées en 1509 aux indulgences.
347La première section comprend des textes conciliaires et des bulles papales. On y trouve ainsi la décision du Concile de Clermont (1095) d’accorder toute pénitence à quiconque se rendra à Jérusalem pour y « libérer l’Église de Dieu » (p. 4), celle du 4e Concile du Latran (1215), qui emploie la formule « plenam peccaminum veniam » (p. 10), la bulle Inter sanctorum de Célestin V (1294), qui, pour la première fois, accorde une indulgence plénière (« a culpa et a poena », p. 28) sans contrepartie guerrière, la bulle Unigenitus Dei filius de Clément VI (1343), qui parle du « trésor » que le Christ a « acquis pour l’Église militante » (p. 42), ou encore la bulle Salvator noster de Sixte IV (1476), qui accorde à l’église Saint-Pierre de Saintes une indulgence ad instar iubilaei (p. 62).
La deuxième section, « Aspects des indulgences au Moyen âge », présente, après quelques extraits de la tradition canoniste, les réflexions de plusieurs théologiens. À côté d’extraits des commentaires de Bonaventure sur les Sentences et de la Somme théologique de Thomas d’Aquin, on trouve des textes plus récents : une dispute de 1515 dans laquelle Johann Eck affirme que les indulgences peuvent être attribuées aux défunts directement par le pape, en raison de sa toute-puissance (p. 212) ; quant au long Tractatus de indulgentiis de Cajetan, qui définit avec précision l’indulgence et répond aux objections qui lui sont adressées, il a été retenu parce que, quoique paru le 8 décembre 1517, il a été rédigé vraisemblablement sans connaître les 95 thèses. Au sein de la sous-section « Prédications et écrits spirituels », on trouve notamment des textes de Jean Tauler et de Johann von Staupitz, qui tous deux insistent sur la pénitence intérieure et ont influencé Luther ; sans doute Jean Geiler de Kaysersberg aurait-il pu trouver sa place dans ces pages. Parmi les défenseurs des indulgences, Raymond Péraud vers 1487 et Johannes von Paltz en 1504 ont produit des textes liturgiques donnant les prières à prononcer par le pénitent à l’instant où il met l’argent dans le tronc (p. 378) et les consignes visant à introniser les indulgences dans les églises où elles sont prêchées (p. 382). Parmi les lettres d’indulgences proposées par les Éd., on trouve une curiosité : l’indulgence accordée le 18 avril 1508 aux ermites d’Augustin du couvent d’Erfurt pour soutenir la croisade contre les « hérétiques » et les « schismatiques » de Livonie (p. 406) ; en effet, « Martinus Luder » compte au nombre de ses bénéficiaires (p. 410) !
La troisième section renferme les documents qui sont, indirectement, à l’origine de la Réforme : la bulle Sacrosanctis salvatoris 348de Léon X (31 mars 1515), promulguée pour les fidèles des diocèses de Mayence et de Magdebourg (p. 424) ; les Instructions pour les confesseurs d’Albert de Brandebourg (1516) et plus encore son Instruction sommaire (1517), qui précise les « quatre principales grâces » (p. 502) accordées aux acquéreurs des indulgences, à commencer par la rémission plénière de tous les péchés.
Chaque document – ou série de textes plus brefs – fait l’objet d’une introduction courte mais précise, que suivent quelques indications bibliographiques. Les notes infrapaginales, peu nombreuses, se limitent à l’essentiel : l’identification des références bibliques, voire d’autres sources. Les traductions visent avant tout à être fidèles aux textes originaux (voir p. xxviii), mais elles se lisent agréablement.
Ce recueil de sources rendra les plus grands services. Les textes qu’il réunit montrent parfaitement la complexité, ainsi que l’évolution de la théorie et de la pratique des indulgences entre le xie siècle et le début du xvie. En ce qui concerne les volumes à suivre, on ne saurait trop recommander aux deux Éd. de renoncer à dissocier la publication des textes de 1517-1520 de celle de leurs commentaires : compte tenu de l’importance de cette matière, une parution, dans des délais raisonnables, des textes commentés nous paraît essentielle, dans l’intérêt des lecteurs comme des auteurs des commentaires.
Matthieu Arnold
xvie-xviiie siècle
Thomas Müntzer (1490-1525), Christianisme et révolution. Écrits théologiques et politiques. Édition et traduction de Joël Lefebvre. Préface de Johann Chapoutot et Éric Vuillard, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2021, 229 pages, ISBN
978-2-7297-1264-8, 15 €.
Près de quarante ans après la parution de l’anthologie réalisée par Joël Lefebvre, les Presses universitaires de Lyon ont eu la bonne idée de la rééditer, sous un titre légèrement différent puisque l’édition originale s’intitulait Christianisme et révolution dans l’Allemagne du xvie siècle. Pour le reste, à l’exception de la brève « Préface à la nouvelle édition » de J. Chapoutot et d’É. Vuillard (p. 5-10 ; on y corrigera la date du mariage de Luther, qui est 1525 349et non pas « 1526 », p. 7), le choix a été fait de reproduire le texte original sans modification (voir p. 11 note 1), si ce n’est que les notes ont été déplacées en bas de page. Même la chronologie et la bibliographie (elle s’arrête à la fin des années 1970) données par J. Lefebvre ont été reproduites à l’identique.
Ce choix est d’autant plus surprenant que nous disposons, depuis quelques années, d’une édition de référence des écrits de Müntzer et que, par ailleurs, bien des travaux ont paru, qui affinent notre connaissance tant de la biographie que de la pensée théologique de Müntzer. Le travail de pionnier réalisé par J. Lefebvre en 1982 et les lecteurs francophones intéressés par Th. Müntzer ne méritaient-ils pas mieux que cette réédition à l’économie ?
Matthieu Arnold
Patricia Eichel-Lojkine, Marguerite de Navarre. Perle de la Renaissance, Paris, Perrin, 2021, 395 pages, ISBN 978-2-262-08604-6, 24 €.
Dans un siècle pourtant riche en grands personnages, qu’il s’agisse de penseurs ou de figures politiques, Marguerite de Navarre (1492-1549) – née Marguerite d’Angoulême – occupe une place éminente. Humaniste, mécène et protectrice des dissidents religieux, non seulement elle composa une œuvre touchant aux genres littéraires les plus divers (nouvelles, contes, poésie religieuse et profane, théâtre…), mais encore elle exerça en certaines occasions une action diplomatique de premier plan : ainsi, après la défaite de Pavie, elle se rendit en avril 1525 pour réconforter son frère François Ier, prisonnier de Charles Quint, et négocier les conditions de sa libération. Dans un style alerte, P. Eichel-Lojkine retrace le destin de Marguerite, depuis sa « jeunesse dorée » jusqu’à son trépas le 21 décembre 1549, consécutif à un refroidissement lors d’une sortie nocturne dans le parc de son manoir d’Odos afin d’apercevoir une comète. Tout au long de cette biographie, qui se fonde sur de nombreuses sources inédites, l’A. analyse avec finesse l’œuvre écrite de Marguerite. Elle consacre même à cette œuvre une bonne partie du chapitre « En notre beau langage français » (chap. 6). Concernant le « choix du français » (p. 201-203) par Marguerite, à une époque où la langue vernaculaire devient la 350langue administrative et judiciaire du Royaume, sans doute aurait-il été intéressant d’effectuer quelques comparaisons avec les écrits français de Jean Calvin, qui ont été si bien étudiés au cours des dernières décennies par le regretté Francis Higman, par Olivier Millet et par Max Engammare.
L’A. ne manque pas de discuter la question, controversée, de la religion de Marguerite, en commençant par mettre en évidence ses relations épistolaires, de 1521-1524, avec l’« abbé reformateur » Guillaume Briçonnet, qui comptait sur elle pour promouvoir des changements à la Cour. Dans ses Icones ou Vrais Portraits (1580-1581), Théodore de Bèze avait exprimé le regret que Marguerite, dont le nom méritait un « los [hommage] perpétuel à cause de sa piété et de la sainte affection qu’elle a montrée à l’avancement et conservation de l’Église de Dieu » (p. 287), ne se fût jamais séparée de l’Église traditionnelle. « Sa piété, affirme l’A. après avoir mentionné l’Épître utile (1539) par laquelle Marie Dentière tentait de la rallier à la cause protestante, est incontestablement catholique. » (P. 167.) Quelques années auparavant, Marguerite, qui soutient les prélats, attaqués par la Faculté de Paris, qui croient en la gratuité du salut, a pensionné Clément Marot (1534-1536). La « Sorbonne » n’a-t-elle pas censuré comme hétérodoxe la deuxième édition de son Miroir de l’âme pécheresse (1533) ? L’A. montre aussi combien, au milieu des années trente, Marguerite a été accablée (« elle traverse une période sombre », p. 173) par l’accumulation des victimes des persécutions religieuses, et ce, en dépit de l’éclaircie que constitua l’édit libéral de Coucy (16 juillet 1535). Elle ne tait pas la réaction indignée de Calvin à l’accueil que Marguerite fit dans son château de Nérac, en 1543, aux prédicateurs Pocque et Quintin, « libertins spirituels » selon le Réformateur de Genève (voir p. 193). Elle rappelle aussi combien – en vain hélas ! – Marguerite a plaidé auprès de son frère la cause des paysans de Provence (voir p. 217-219). Elle montre enfin les liens puissants qui unissent Marguerite, dans ses dernières années, à sa fille Jeanne d’Albret-Bourbon, attirée par le protestantisme.
L’ouvrage comporte un indispensable glossaire (p. 295-299), des « repères chronologiques » détaillés (p. 301-314), de précieux résumés des principales œuvres de Marguerite de Navarre (p. 371-381) et une impressionnante bibliographie (p. 345-369).
S’il est permis d’exprimer un regret, il concerne la manière déconcertante de citer les sources, qui ne facilite pas leur identification : les citations sont nombreuses et bien choisies, mais il faut 351se reporter, à la fin de l’ouvrage, à la « Liste des principales sources citées » (p. 315-343), agencées, pour chaque chapitre, en « sources primaires » puis en « sources secondaires » ; or on ne trouve pas, dans le corps du texte, d’appels de note correspondant à ces sources. De plus, les sources secondaires sont citées de manière abrégée. Aussi, pour nous contenter de cet exemple, nous n’avons pas réussi à trouver la source fondant l’affirmation selon laquelle Bucer, en 1535, a écrit à Marguerite pour lui recommander Baduel pour une chaire de théologie (p. 153 ; l’édition de la Correspondance/Briefwechsel de Bucer s’arrête pour l’instant à l’année 1533). Par ailleurs, le magnifique portrait de couverture (réalisé par Jean Clouet en 1522, et que l’A. commente superbement dans le « prologue », p. 15-18) avive le regret que les Éditions Perrin n’aient pas muni ce volume d’un cahier d’illustrations.
Toutefois, ces observations n’enlèvent rien à la très grande qualité de cette biographie. À n’en pas douter, elle contribuera à susciter des recherches, en littérature, en histoire et en théologie, sur cette immense figure de la Renaissance, qui allia l’érudition et le talent littéraire à une foi fervente et à une profonde humanité.
Matthieu Arnold
Michael Basse, Marcel Nieden (éd.), Cajetan und Luther. Rekonstruktion einer Begegnung, Tübingen, Mohr Siebeck, coll. « Spätmittelalter, Humanismus, Reformation » 124, 2021, xiv + 336 pages, ISBN 978-3-16-160826-1, 114 €.
L’entrevue de Luther avec Cajetan, du 12 au 14 octobre 1518, a constitué l’une des étapes marquantes sur le chemin qui, de la publication des 95 thèses jusqu’à la bulle Decet romanum pontificem, a mené le « docteur Martin » à la rupture avec l’Église romaine. Ce dialogue de sourds a montré notamment qu’en dépit de son indiscutable enracinement dans la piété et dans la théologie de son temps, Luther avait développé une pensée qui, sur bien des points, n’était, sans doute, plus compatible avec l’ecclésiologie défendue par Cajetan. C’est aux questions liées à la pensée des deux théologiens, plus qu’aux aspects politiques et juridiques de leur rencontre, que s’attachent les quatorze contributions du présent volume, fruit d’un colloque qui s’est tenu les 28 et 29 septembre 2018 à Essen.
352Klaus Unterburger et Stefan Michel commencent par camper respectivement, de manière assez concise, le parcours biographique et théologique, jusqu’à leur rencontre, de Cajetan, commentateur d’Aristote et de Thomas, dont l’anthropologie comme la doctrine du péché et de la grâce étaient thomistes, et de Luther, qui avait publié quelques mois plus tôt ses Explications (Resolutiones) des 95 thèses. Elias Füllenbach traite de Cajetan comme « réformateur » de l’ordre des Dominicains (il en fut le magister generalis de 1508 à 1518), tandis que Hans Schneider examine de manière approfondie les témoignages de Luther sur le fait qu’après la rencontre d’Augsbourg, Staupitz l’aurait délié de ses vœux d’obéissance à son supérieur, mesure que Luther aurait perçue comme un abandon.
Marcel Nieden et Martin Ohst en viennent au cœur du débat. Le premier expose la conception des indulgences de Cajetan d’après son Tractatus de indulgentiis de décembre 1517 ; cet écrit reconnaît notamment qu’il « existe, parmi les professeurs du droit pontifical et de théologie, des opinions diverses au sujet des indulgences » (p. 81), insiste sur le remords authentique exigé du pénitent et soutient que le pape (et non l’Église) administre le « trésor de l’Église », y compris pour les défunts. L’étude de M. Ohst se fonde sur les 95 thèses, voire sur les Resolutiones, en lien avec des études récentes (B. Hamm, V. Leppin) pour exposer la critique que Luther adresse aux indulgences et pour égratigner – de manière un peu déplacée selon nous – le projet en cours de commentaire œcuménique des 95 thèses.
Dans des contributions qui auraient dû trouver leur place avant les deux études que nous venons de citer, Alfons Knoll et Jens Wolff s’attachent à la manière dont Cajetan et Luther ont compris la théologie : pour le premier, elle peut être appelée « science », car elle étudie de manière rationnelle ce qui est « pré-donné » dans la foi et elle s’éloigne de la doctrina christiana exposée par Augustin, qui se fondait exclusivement sur l’Écriture ; à l’inverse, la theologia crucis que Luther met en exergue en 1518, en particulier au début de son second cours sur les Psaumes, lutte contre la théologie scolastique en se réclamant de la Bible et entend se concentrer sur le Salut.
Selon Cajetan, la « certitude de la foi » telle que la comprenait Luther contredisait la doctrine de l’Église. Pour Michael Basse, le cardinal avait reconnu avec justesse que la conception luthérienne 353de la foi était incompatible avec la théologie scolastique. De son côté, Theodor Dieter, qui dédie son article à Oswald Bayer, traite de la certitude de la foi luthérienne en lien avec la promissio Christi, thème cher à Bayer, pour conclure que, si Cajetan et Luther se sont opposés, c’est parce qu’au fond, prisonnier chacun de son système de pensée, ils se seraient mécompris. Barbara Hallensleben entend « reconstruire » la rencontre entre Cajetan et Luther en partant des Opuscula omnia (1501-1504) du premier. Christian Volkmar Witt présente l’ecclésiologie de Luther dans les années 1517-1518 en se fondant étroitement sur la thèse d’habilitation de Kurt-Victor Selge, Normen der Christenheit im Streit um Ablaß und Kirchenautorität 1518-1521. Erster Teil : Das Jahr 1518 (1968) ; il conclut que la nouvelle compréhension, par Luther, de la religion chrétienne, « ne lui laissait plus sa place au sein des ordonnances et des traditions de l’Église papale » (p. 261).
En comparant avec finesse les Acta augustana, la célèbre préface autobiographique de 1545 et les Propos de table, Volker Leppin met notamment en évidence le fait que, dans les souvenirs tardifs de Luther, les événements d’Augsbourg et ceux de Worms (1521) ont interféré. La longue contribution synthétique de Berndt Hamm n’avait pas trouvé sa place dans le colloque ; dans cet article conclusif, comme il l’a fait dans plusieurs études analogues, Hamm campe avec brio la théologie et la religiosité du Moyen Âge tardif, avant de retracer l’évolution de Luther entre 1513 et 1518.
Il s’agit au total d’un volume très dense et exigeant, dont un index des personnes (p. 325-328) et plus encore un index des matières (p. 329-336) faciliteront la consultation. Ce n’est pas le moindre de ses intérêts que de rassembler des études qui témoignent de tensions dans l’historiographie : tension entre les auteurs pour lesquels l’incompréhension entre Luther et Cajetan atteste que, dès l’automne de 1518, tout ou presque était joué, et ceux qui, comme Theodor Dieter, Volker Leppin ou Berndt Hamm, s’attachent, chacun avec ses accents propres, à distinguer les « débuts de Luther (initia Lutheri) » et les « débuts de la Réformation (initia Reformationis) ».
Matthieu Arnold
354Ingo Klitzsch, Redaktion und Memoria. Die Lutherbilder der “Tischreden”, Tübingen, Mohr Siebeck, coll. « Spätmittelalter, Humanismus, Reformation » 114, 2020, xii + 635 pages, ISBN 978-3-16-159037-5, 119 €.
Fruit d’une thèse d’habilitation soutenue à l’Université de Tübingen sous la direction de Volker Leppin, cette étude monumentale entend traiter, à frais nouveaux, tout un pan de l’œuvre de Martin Luther, les fameux « propos de table ». La thèse défendue par l’A. est la suivante : les Tischreden nous en apprennent bien davantage sur ceux qui les ont transmis que sur Luther lui-même. Il estime ainsi, en reprenant les propos formulés par Joachim Schildt il y a plus d’un demi-siècle, que « rien ne justifie qu’on assimile aux paroles réellement prononcées par Luther la langue des transcriptions de ses propos de table » (p. 53).
Avant d’étayer cette thèse par l’examen de plusieurs grandes traditions de « propos de table », l’A. consacre tout un « chapitre » (par leur longueur, les quatre grands « chapitres » de cet ouvrage correspondent plutôt à autant de parties ou de sections) aux recherches récentes portant sur les « propos de table » et aux questions de méthode. Son ouvrage témoigne d’une connaissance quasi exhaustive des premières, y compris les études rédigées en français (voir aussi l’impressionnante bibliographie, p. 575-628) ; quant aux secondes, il les expose dans plus de 60 pages, après avoir traité des premiers « témoins », notamment Conrad Cordatus et Johannes Mathesius, puis avoir situé les Tischreden dans le genre des colloquia familiaria (les contemporains de Luther parlaient de colloquia, mais aussi de sermones in mensa). Pour justifier une approche plus critique des propos de table que celle d’Ernst Kroker, leur éditeur dans l’édition de Weimar, l’A. se fonde tant sur des travaux d’exégèse du Nouveau Testament que, plus largement, sur la littérature qui se rapporte à la mémoire collective et à la culture mémorielle. Il en déduit que les différentes traditions de propos de table doivent être comprises comme les reflets de diverses cultures mémorielles luthériennes (voir p. 64). Il s’agit pour lui d’examiner, comme l’indique le sous-titre de son ouvrage, quelles images de Luther les « Apophtegmata-Lutheri » ont transmises (p. 70).
La première tradition que K. examine (chap. 2, p. 84-305) est celle du cercle de Freiberg réuni autour de Jérôme Weller (1499-1572). Il s’agit de la première collection de propos regroupés de 355manière thématique, et elle est attestée par deux manuscrits, que l’A. décrit avec beaucoup de précision : l’un achevé en 1551, se trouvant à Gotha, et l’autre, légèrement postérieur, conservé à Hambourg. L’A. met en évidence, en comparant un certain nombre de propos de ces manuscrits avec l’édition de Weimar, les caractéristiques de cette tradition : elle interprète la mort de Luther dans des catégories relevant de l’histoire du salut, présente Luther comme « combattant la papauté » et se sert de lui pour lutter contre l’Intérim et la participation des protestants au concile de Trente ; la question de savoir si cette tradition transmet aussi l’image d’un Luther critique de Melanchthon reste ouverte, dans la mesure où « Philippe » y apparaît également sous des traits largement positifs. Dans une perspective didactique et pastorale, le milieu de Weller présente Luther comme l’exemple du croyant qui affronte quotidiennement croix et épreuves ; c’est un père de famille pieux et un homme vertueux, qui lutte notamment contre le diable pour défendre la vraie doctrine.
Tandis que la tradition autour de Weller avait réagi au choc de la mort de Luther puis de la défaite de la Ligue de Smalkalde et de l’instauration de l’Intérim, la tradition représentée notamment par Anton Lauterbach (1502-1569) et Jospeh Hänel (ca. 1521-1590), examinée au chap. 3 (p. 306-420) sur la base d’un codex de Halle daté de 1560, tire son origine d’une situation ultérieure : la crise a été surmontée et la confessionnalisation a pu se poursuivre. Luther est présenté principalement comme un prophète, et cette tradition accorde une grande importance aux débuts de la Réformation et au canon des œuvres de Luther ; Melanchthon y apparaît comme une autorité à côté de son collègue de Wittenberg. Sur le plan pastoral, la manière dont Luther a supporté ses maladies en fait un exemple pour les pasteurs en proie aux souffrances et aux épreuves ; autorité morale, il est également un économe modèle.
La dernière tradition étudiée (chap. 4, p. 420-466) est plus connue que les deux précédentes, dans la mesure où, d’emblée, elle est attestée par une impression qui a été largement diffusée et a connu de nombreuses rééditions : la publication en 1566, par Johannes Aurifaber (1519-1575), des Tischreden oder Colloquia Doct[or] Mart[in] Luthers…, dédiés aux autorités civiles de plusieurs villes d’Empire, parmi lesquelles Strasbourg. L’A. ne traite guère la manière dont, systématiquement, Aurifaber a interpolé les propos de table dont il disposait, mais comme pour les deux 356autres traditions, il s’intéresse à l’image – ou memoria – de Luther que cherche à transmettre Aurifaber, qu’il présente longuement. Aurifaber s’applique à distinguer Luther davantage de Müntzer ou des anabaptistes, voire d’Érasme, que du pape, même s’il met en évidence (ou en scène ?) les propos de Luther contre le diable et les « papistes » ; il accorde assez peu d’importance à la question du rapport entre Luther et Melanchthon, mais son édition recèle maintes armes contre tous les adversaires des gnésio-luthériens ; il insiste sur l’attitude pieuse de Luther, y compris au moment de la mort de sa fille Madeleine, et sur son rôle de catéchète et de prédicateur au sein même de sa famille ; par contre, il ne fait guère du Réformateur un prophète.
Au total, les trois grandes traditions analysées, qui s’étendent sur moins de vingt ans, témoignent des bouleversements qui, après la mort de Luther, ont affecté le luthéranisme durant cette courte période et de la manière dont, par la collation voire l’édition imprimée des « propos de table », on a tenté d’y répondre. Que les propos de table tels qu’ils nous sont parvenus en disent long sur ceux qui les ont collationnés (voire sur les « preneurs de notes », dont il est moins question dans le présent ouvrage), cela tombait déjà sous le sens. Il était toutefois nécessaire que l’étude fouillée de l’A. confirmât cette impression, et elle le fait de manière convaincante. Faut-il pour autant déduire des intérêts spécifiques des différents milieux qui les ont transmis que les propos de table sont sans valeur pour connaître la vie et la pensée de Luther ? Les comparaisons minutieuses établies par l’A. n’établissent pas seulement les différences entre les différentes traditions ; à la manière d’une synopse des évangiles, elles mettent aussi en évidence bien des points communs. Aussi le travail remarquable de l’A., que dessert seul un langage souvent inutilement compliqué voire jargonnant, constitue-t-il également, à notre sens, un plaidoyer pour une nouvelle édition des Propos de table ; cette édition devra tirer à la fois partie des sources que Kroker avait laissées de côté et des possibilités nouvelles des ressources numériques.
Matthieu Arnold
357Brian C. Brewer, David M. Whitford (éd.), Calvin and the Early Reformation, Leiden – Boston, Brill, coll. « Studies in Medieval and Reformation Traditions » 219, 2020, 231 pages, ISBN
978-90-04-35994-9, 99 €.
L’ouvrage propose une série de contributions présentées lors du colloque de la Calvin Studies Society, qui s’est tenu à l’Université Baylor (Waco, Texas), en 2017, et qui a porté sur le thème « Calvin et la réforme des premières décennies ». L’introduction de David M. Whitford (Université Baylor) dresse le parallèle entre les vies respectives de Martin Luther et de Jean Calvin, à l’heure de leur engagement initial pour la Réforme, puis définit les lignes directrices de la vie et de l’œuvre du Français, telles que les exposent les contributeurs du volume.
L’influence de l’humanisme sur Calvin est présentée par Greta Grace Kroeder (Waterloo University, Canada), qui pose la question de l’existence d’une théologie humaniste. L’A. dresse le bilan d’une historiographie qui a négligé cette question en s’attachant à classifier les humanistes comme des auteurs classiques, italiens ou européens du Nord, leur intérêt pour la théologie relevant non de la foi mais de la science. L’A. tente de prendre le contre-pied de cette position et de cerner ce que pourrait être l’essence d’une théologie humaniste. Elle conclut à un rejet de la scolastique reposant sur des certitudes métaphysiques et à un engagement selon un triple axe, conjuguant la recherche méthodologique en théologie, l’étude philologique du texte biblique (privilégiant les Pères de l’Église et leurs interprétations) et la prise en compte de la pratique pastorale.
L’étude de James K. Farge (Institute of Medieval Studies, Toronto) est consacrée au milieu politique et intellectuel qui fut celui de Calvin. L’A. retrace les principaux changements politiques intervenus à partir de 1534. Selon lui, le changement de position de François Ier ne date pas de l’Affaire des Placards, comme l’affirme l’historiographie classique, mais est fondé, en 1525, lors de la captivité du roi à Pavie, sur une expérience eucharistique, mystique, décisive. François Ier et le Parlement qualifiaient les hérétiques de « luthériens » ou de « sacramentaires » mais jamais, selon l’A., de « calvinistes ». Les persécutions se sont déroulées surtout dans les trois dernières années du règne de François Ier, puis furent facilitées par la liste des « Trente-six articles de la foi » (1543) qui réaffirmaient les points de doctrines contestés par les prédicateurs 358évangéliques. Enfin, quand François Ier décéda en 1547, c’est son successeur Henri II qui permit au Parlement d’accélérer l’exécution des hérétiques (la Chambre ardente) et de favoriser le développement des Guerres civiles.
Christoph Strohm (Universität Heidelberg) s’attache à la question de la formation juridique de Calvin et à son influence sur sa théologie. Après avoir rappelé les courants humanistes et leur relation au droit, en particulier l’évolution vers un mos gallicus dans les études juridiques en France, l’A. tente de cerner les effets de cette formation juridique sur le Réformateur : le concept d’« accommodation divine », central dans l’interprétation calvinienne de la Bible, qui se tire de l’écart entre la nature humaine et finie de l’homme et la majesté divine, provient de la doctrine de l’équité, mise au centre de leur recherche par les juristes humanistes. Enfin, la notion de renoncement à soi-même, qui fonde l’éthique de l’Institution de la religion chrétienne, est exprimée en termes juridiques et fait allusion aux droits légitimes de Dieu sur l’humanité : la loi est la méthode la plus adéquate pour ordonner la vie humaine.
Jonathan A. Reid (East Carolina University) étudie l’influence de l’évangélisme français sur le jeune Calvin, rappelant les acquis des travaux de ses prédécesseurs (Fraenkel, Roussel, Higman, van Stam), qui ont érigé l’anti-nicodémisme en clef de l’ecclésiologie de Calvin. L’A. montre que cet anti-nicodémisme a influencé durablement des protestants français et que les vagues d’émigration ne se sont pas constituées dans les années 1540, lors de la publication de ces écrits contre la dissimulation par Calvin, Farel et Viret, mais dans les années 1550, quand les Églises réformées se sont formées en France, permettant aux fidèles de rompre avec l’Église traditionnelle.
Outre ces contributions stimulantes, le volume propose une étude originale de Carrie F. Klaus (DePauw University, Indiana) sur la moniale genevoise Jeanne de Jussie, célèbre pour son engagement contre la Réforme. L’A. relate sa lutte contre la nouvelle esthétique, notamment contre le silence imposé aux sons du monastère, et dépeint, a contrario, les stratégies de déstabilisation mises en place par les partisans de Calvin, au moyen de bruits discordants, aboiements et nuisances sonores diverses, pour nuire aux déroulement des disputationes.
Brian C. Brewer (Baylor University) aborde la question des relations de Calvin avec les anabaptistes. Le Réformateur, selon 359l’A., n’a jamais démontré une connaissance précise du mouvement anabaptiste, même s’il le distinguait parfaitement d’autres nébuleuses radicales. Par ailleurs, même s’il ne l’a jamais admis publiquement, il fut façonné par la théologie anabaptiste ; en la combattant, il est comme formé par elle. L’A. s’appuie sur la Psychopannychia, bien sûr, sur l’édition de 1536, et les suivantes, de l’Institution de la religion chrétienne et sur les relations de Calvin avec la famille Stordeur.
Le volume se clôt sur une contribution de Barbara Pitkin (Standford University) qui montre comment Calvin a articulé plusieurs récits sur la « Réforme des premières décennies » dès son retour à Genève dans les années 1540, la peignant comme un mouvement porté par Dieu, centré sur Luther, souhaité par beaucoup pour restaurer l’authentique doctrine, purifiant les sacrements, protégeant de la tyrannie de l’Église traditionnelle, mais au détriment de l’histoire des protestants français.
Chacune des contributions du volume est dotée d’une bibliographie polyglotte. L’ensemble cohérent et bien articulé permet d’offrir quelques interprétations originales et fondées, dont nous venons de faire part, renouvelant un sujet et des domaines qu’on pouvait estimer très étudiés. Apparenté à un Companion par l’aspect synthétique des contributions, le volume ne s’enferme pas dans le genre « manuel » et apporte un portrait saillant de Calvin dans ses relations avec les acteurs, politiques et ecclésiaux, des premières années de la Réforme. Le lecteur averti y trouvera donc matière à réflexion.
Annie Noblesse-Rocher
Max Engammare, La Fabrique Calvin. L’ultime Institutio christianæ religionis et trois autres livres corrigés par Jean Calvin et ses secrétaires, Genève, Droz, coll. « Travaux d’Humanisme et Renaissance » 628, 2021, 224 pages, ISBN 978-2-600-06320-3, CHF 35.
On connaissait déjà, de longue date, Max Engammare le découvreur des sermons de Calvin. Le présent essai est le fruit d’autres découvertes, réalisées entre décembre 2019 et décembre 2020, qui portent sur quatre livres latins de Calvin : la dernière édition latine 360de l’Institution de la religion chrétienne (1559), le commentaire sur les Psaumes (1557), texte fameux notamment pour ses passages autobiographiques, la seconde version du commentaire sur Ésaïe (1559) et le commentaire des épîtres pauliniennes (1556).
C’est en examinant de près un exemplaire de l’Institution de 1559 dans la bibliothèque de la Société de lecture de Genève fondée en 1818 que l’A. s’est rendu compte que ce volume, riche de nombreuses corrections manuelles de la main du Réformateur, avait appartenu autrefois à la Bibliothèque de l’Académie de Genève. Dans une enquête passionnante, il dévoile le parcours de cet ouvrage depuis l’Académie de Genève jusqu’à la Société de lecture, puis le contenu des 104 annotations effectuées par Calvin (ces corrections sont livrées intégralement en annexe, p. 183-206), avant de s’attacher aux trois autres livres du Réformateur et à la « Fabrique Calvin », c’est-à-dire aux ateliers de rédaction mis en place par le Réformateur, qui s’aidait de plusieurs amanuenses proches pour relire et corriger ses ouvrages, soit à son domicile soit dans l’officine de l’imprimeur.
Le commentaire sur l’épître aux Romains fait l’objet d’une analyse minutieuse, et, photographies de grande qualité à l’appui, l’A. compare les corrections qui se trouvent dans l’exemplaire de l’Académie avec celles des exemplaires du Musée d’histoire de la Réformation (Genève), de Beaune, de Besançon ou encore de Lyon. Il apparaît notamment qu’en révisant, en 1556, son commentaire sur les Romains, Calvin a supprimé certaines phrases très favorables aux Juifs de son commentaire paru à Strasbourg en 1540. En ce qui concerne le commentaire des Psaumes, l’exemplaire étudié est passé entre les mains de son ami Jean Crespin et a appartenu à Aimé-Louis Herminjard ; les corrections portées sont de nature non seulement philologique, mais encore théologique, comme dans le cas du Psaume 118/119, où il s’agit de rapprocher David (et le croyant) de Dieu. Quant au commentaire d’Ésaïe, l’A. compare notamment des révisions de l’édition de 1559 avec la traduction française de 1572 (Commentaires sur le Prophete Isaïe), qui avait utilisé précisément l’exemplaire de 1559 corrigé par Calvin et ses secrétaires.
Après avoir traité de chacun des quatre ouvrages et exposé les relations entre Calvin et le maître-imprimeur Robert Estienne, l’A. revient, de manière plus synthétique, sur le système de correction de Calvin et sur ses « secrétaires collaborateurs » (ainsi, 361Denis Raguenier, Jean Budé, Charles de Jonviller et Nicolas des Gallars, mais aussi Antoine Calvin). S’il parle des « trois ateliers de la Fabrique Calvin », c’est parce que le premier, avec pour chef Raguenier, concernait la prise en notes de ses sermons, le second, actif dans l’Auditoire, ses cours de théologie biblique, tandis que le dernier rassemblait les disciples qui assistaient Calvin dans la réalisation et la révision d’ouvrages.
Ce livre à la fois érudit et rédigé dans un style élégant – c’est là une des marques de la « Fabrique Engammare » – met en évidence combien Calvin n’a eu de cesse de polir le style de ses ouvrages, qu’il s’agisse de l’Institution ou de ses commentaires bibliques. Le sous-titre des Commentaires sur… Isaïe (1572) en fait un argument de vente, mais son propos est exact : « Reveuz, corrigez et augmentez avec grand labeur et diligence, par l’Autheur mesmes avant sa mort » (voir p. 107). Ou, pour l’exprimer avec les mots de l’A. : « Il lui [Calvin] fallait toujours remettre l’ouvrage inspiré sur le métier de l’homme. » (P. 181.)
Matthieu Arnold
Paolo Sachet, Publishing for the Popes. The Roman Curia and the Use of Printing (1527-1555), Leiden – Boston, Brill, coll. « Library of the Written Word » 80, 2020, viii + 305 pages, ISBN
978-90-04-34864-6, 142 €.
L’A., docteur du Warburg Institute (2005), est actuellement chargé du cours d’histoire de la Suisse à l’époque moderne à l’Université de Milan. Cet ouvrage est issu de la thèse qu’il a consacrée précisément à l’imprimerie et aux enjeux que ce nouveau médium de communication a représentés pour la papauté dans la première moitié du xvie siècle. L’enquête commence en 1527 avec le sac de Rome et s’achève en 1555 avec l’avènement du pape Paul IV, qui renforça l’Inquisition et permit la promulgation du premier index des livres prohibés de 1558-1559. Si les travaux de Jean-François Gilmont ont montré l’importance de l’imprimerie dans le développement et l’instrumentalisation des idées réformées par les protestants, la place de ce médium dans les projets idéologiques de la papauté est encore sous-estimée.
L’A. se concentre sur les projets éditoriaux des membres de la Curie entre 1527 et 1555, examine l’attitude de l’Église romaine 362envers l’imprimerie, sa tactique d’utilisation et paradoxalement sa méfiance envers celle-ci. Prenant en compte les études récentes sur la multipolarité du catholicisme moderne, il parvient à dégager une relative cohérence dans l’action romaine en matière d’imprimerie. Trois aspects permettent de dresser le bilan de cette action : 1. les réseaux financiers qui ont permis cette politique éditoriale ; 2. le choix des publications ; 3. le contrôle doctrinal et l’éducation dans le contexte du combat contre le protestantisme.
L’étude est essentiellement consacrée à la personnalité et à l’action du Cardinal éditeur Marcello Cervini (1501-1555), devenu pape sous le nom de Marcel II, le 9 avril 1555 – son règne ne dura que 22 jours. Elle porte sur la politique éditoriale de Cervini dans le domaine des études grecques et patristiques (editiones principes ou correction de celles d’Œcolampade), son soutien aux publications de Cochlaeus en Allemagne et la mise en route de la Sixto-Clémentine. Des appendices donnent la liste des éditions savantes soutenues par Cervini, grecques (Sophianos, Eustache de Thessalonique, Euripide, Théodoret de Cyr), latines (Arnobe l’Ancien, Innocent III, Henri VIII, sur les sept sacrements). Citons aussi son soutien aux presses d’Alde Manuce et d’autres imprimeurs italiens, éditeurs notamment des premiers décrets du Concile de Trente (comme Gabriele Giolito), à celles de Nicolas Le Riche et de Martin Le Jeune (Paris) mais aussi de Christophe Plantin (Anvers).
Cet ouvrage très documenté présente ainsi la politique d’un cardinal-imprimeur ainsi que les enjeux que représenta, pour la Curie, la politique d’édition massive de sources anciennes et ecclésiastiques dans le contexte de la lutte contre l’érudition et l’expansion protestantes.
Annie Noblesse-Rocher
Chrystel Bernat, Frédéric Gabriel (dir.), Émotions de Dieu. Attributions et appropriations chrétiennes (xvie-xviiie siècle), Turnhout, Brepols, coll. « Bibliothèque de l’École des Hautes Études. Sciences religieuses » 184, 2019, 401 pages, ISBN
978-2-503-58367-9, 85 €.
Cet ouvrage collectif s’attache à traiter dans le domaine de l’histoire des idées théologiques le thème des émotions, sujet en vogue 363chez les historiens – du Moyen Âge principalement. En philosophie ou en théologie, il est vrai, on parle plus volontiers des « passions » de Dieu, terme d’ailleurs présent tout au long du présent volume. Un avant-propos suggestif de Chrystel Bernat et une introduction substantielle et très bien informée signée par Frédéric Gabriel (les p. 58-62, consacrées à Luther, sont de Ch. Bernat) campent parfaitement le sujet : l’exploration des discours (attributions) et des usages (appropriations) confessionnels des émotions de Dieu, ainsi que ses enjeux, notamment l’intelligibilité du divin ou le vocabulaire adéquat pour parler de Dieu. Dès l’introduction, F. Gabriel donne un aperçu des solutions par lesquelles les Pères et les théologiens chrétiens des époques ultérieures ont tenté de surmonter la tension entre les expressions bibliques qui appliquent à Dieu la tendresse, la jalousie, la colère, etc., et les attributs divins (impassibilité, l’immuabilité, etc.) avec lesquels elles entrent en dissonance.
Comme l’attestent la contribution « liminaire » de Piroska Nagy (« Émotions de Dieu au Moyen Âge »), attentive aux évolutions des émotions divines, et l’étude érudite de Gilbert Dahan (« Les émotions de Dieu dans l’exégèse médiévale »), qui expose en particulier la réflexion des commentaires du xiiie siècle sur le langage de l’Écriture (elle « parle de Dieu d’une manière humaine, comme une mère qui babille avec ses bébés », Pierre de Jean Olieu, p. 99), les articles rassemblés débordent largement le cadre chronologique délimité par le sous-titre. C’est aussi du Moyen Âge dont il est question en grande partie chez Alberto Frigo (« Affectiones Dei : les débats sur les passions de Dieu dans la scolastique médiévale et postmédiévale ») ; l’A. établit comment, après la fin de non recevoir de Thomas d’Aquin (« toute passion, de par sa définition même, est à exclure de Dieu », p. 129), les scolastiques ont été contraints de réinterpréter la notion d’affectio pour l’accorder avec la nature divine. Les réflexions du xviie siècle font l’objet des études de Brigitte Tambrun (« Le Dieu des Sociniens serait-il sujet à toutes les passions humaines ? ») et de Laurent Thiroin (« Quand il est parlé de Dieu à la manière des hommes : l’irritation de Dieu chez Pascal ») ; la première donne aussi la parole à Jean Calvin, qui reprend à son compte la figure de l’« anthropopathie » déjà exposée par les médiévaux (voir p. 154 et 102 sq.), tandis que pour Pascal, Dieu s’exprime « abondamment en figures » (p. 184).
Chez plusieurs auteurs, il s’agit moins de penser les conditions d’un discours théorique faisant droit aux émotions divines que 364d’utiliser ces émotions à des fins pastorales. C’est notamment le cas de la littérature réformée d’édification et de consolation (Véronique Ferrer, « “Jamais le soleil radieux ne se courrouce.” L’interprétation confessionnelle de la colère divine dans le contexte réformé des persécutions [xvie et xviie siècle] ») qui, tout en reprenant le motif vétérotestamentaire du courroux divin destiné à susciter la repentance des fidèles, insiste davantage sur la compassion de Dieu (ainsi, Agrippa d’Aubigné, p. 199). Pour la fin du xviie siècle et le xviiie siècle, marqués eux aussi par l’oppression religieuse, l’homilétique et la littérature consolatoire huguenotes (Ch. Bernat, « La dilection divine. Usages et enjeux dans la littérature pastorale huguenote […] ») présentent dans leur majorité des traits semblables, en lien avec les thèmes de l’épreuve et du châtiment. Pour autant, Pierre Jurieu n’est pas isolé, qui refuse ce Dieu sujet à l’émotion : « Voilà […] une […] divinité qui ne vaut guère mieux que nous » (p. 245). Dans un autre contexte, l’Angleterre du premier xviie siècle (Paula Barros, « De la “sobre intempérance” divine à la sanctification des passions humaines […] »), la catastrophe du 26 octobre 1693, lors de laquelle environ 90 paroissiens catholiques de Londres périrent au cours d’un office, est interprétée pareillement comme une expression paradoxale de la dilection de Dieu, qui châtie ses fidèles. À l’inverse, les aumôniers militaires jésuites étudiés par Silvia Mostaccio (« Dieu à la guerre. Les émotions de Dieu et la guerre de quatre-vingt ans aux Pays-Bas espagnols ») mettent les passions divines au service d’une piété belliqueuse ; à les lire, le courroux divin est dirigé ad extra, la vengeance de Dieu visant à châtier les hérétiques qui ont blessé son honneur (p. 208-212).
Colère et miséricorde alternent dans la « tragédie humaniste biblique » étudiée par Audrey Duru (« Le Jephté latin de Buchanan [1554] et ses traductions françaises [1566-1601] »), tandis que dans l’« oraison funèbre de la Renaissance française » (Claudie Martin-Ulrich), qui évoque les émotions divines avec sobriété, la consolation et le réconfort s’appuient sur un Dieu qui est non seulement amour et « compassion inconditionnelle » (p. 319), mais encore un juge « droit et équitable » (voir p. 317). Dans les sermons du prieur clunisien Jacques Biroat († vers 1666), la christologie joue un rôle central : « Homme-Dieu », Jésus « a eu tous les mouvemens des hommes, mais épurez de ces imperfections qui nous ont rendu odieux le nom mesme des passions » (p. 352) ; en retour, le chrétien « incorpore la figure du corps souffrant du Sauveur mû par la 365compassion » (F. Gabriel, « La passion comme mise en scène de l’émotion : rhétorique et christologie chez Jacques Biroat », p. 364). Francis Rapp, qui, étonnamment, n’est guère cité dans le présent volume, avait montré jadis combien, à la fin du Moyen Âge déjà, la compassion constituait la réponse attendue du croyant à l’amour et aux souffrances de Dieu.
La postface de Sébastien Drouin (« Divines émotions humaines ») se consacre à la littérature philosophique du xviiie siècle, qui moqua les passions divines et y réagit par le déisme ou le matérialisme athée. L’important index des noms (p. 379-401) mêle les auteurs anciens et modernes et les historiens contemporains. L’ouvrage ne comporte pas d’index biblique, alors même que les références scripturaires abondent dans plusieurs études.
Il s’agit au total d’un livre à la fois savant et qui se lit très agréablement. Ce volume collectif est d’autant plus cohérent que ses Éd. ont eu la sagesse de se limiter à la tradition chrétienne. Nul doute qu’il a ouvert une nouvelle voie dans le vaste champ de recherches sur l’histoire des émotions.
Matthieu Arnold
xixe-xxie siècle
Jean Frédéric Oberlin, Briefwechsel und zusätzliche Texte. Correspondance et textes complémentaires, tome 7 : 1820-1826. Textes établis et annotés par Gustave Koch, Herzberg, Verlag Traugott Bautz, coll. « Johann Friedrich Oberlin. Gesammelte Schriften » I/7, 2021, 246 pages, ISBN 978-3-95948-545-6, 35 €.
Par une heureuse coïncidence, le pasteur Gustave Koch vient d’achever la remarquable entreprise de l’édition de la correspondance de Jean Frédéric Oberlin au moment où lui-même est parvenu à l’âge atteint par le vénérable pasteur du Ban-de-la-Roche.
Ce tome 7, qui compte un peu plus de 80 lettres et textes divers, est le moins volumineux des tomes de la correspondance d’Oberlin : ce dernier, durant ses dernières années, reste certes actif – « je travaille depuis 6h du matin et jusque tard dans la nuit », écrit-il en avril 1820 (no 1076, p. 23 ; voir de même no 1086) – et prêche devant des centaines de paroissiens (no 1083), mais sa santé déclinante le 366contraint à moins écrire. Comme le relève l’Éd. dans sa préface (p. 8), les échanges épistolaires cèdent notamment la place aux récits, souvent développés, que des voyageurs font de leur visite à Waldersbach. Le portrait le plus irrévérencieux d’Oberlin brossé par l’un de ces voyageurs n’est pas le moins intéressant : dans ses Souvenirs, Édouard Reuss, futur professeur à la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg, narre l’excursion mouvementée qu’il a faite en septembre 1820 avec d’autres étudiants. Surpris par la tempête, ils arrivèrent trempés à Waldersbach ; tandis que ses camarades se réchauffaient à l’auberge, l’un des étudiants entreprit de rendre visite à Oberlin et il en revint en proclamant que désormais lui aussi croyait aux visions ; peu impressionné par les « histoires à la [Jung-]Stilling » rapportées par son ami, Reuss relève que l’adhésion de ce dernier aux esprits ne dura guère : « Il avait la tête trop claire pour ce genre d’histoires, et en 1820, à Strasbourg, rien ne surpassait la raison » (no 1093, p. 54). Par contraste, les témoignages d’une dame anglaise (no 1081), du secrétaire de la Société biblique de Londres (no 1083), du peintre et critique d’art Délécluse (no 1108), de John Henry Smithson, pasteur de l’Église de la Nouvelle Jérusalem (no 1123), ou encore du pasteur allemand Christian Gottlob Bart (no 1129) soulignent tant la piété d’Oberlin et l’estime générale dont il jouit que – sans les tourner en dérision – ses liens avec le monde des esprits.
Oberlin a des échanges réguliers avec le libraire strasbourgeois Heitz, auquel il commande des ouvrages pieux (no 1076, 1079, 1096, etc.) en insistant sur la qualité du papier de ces impressions, car il souhaite que l’on témoigne ainsi du « respect (Ehrfurcht) » dû à la Parole de Dieu (no 1074). Il continue de se soucier de l’existence matérielle comme de la vie spirituelle de ses ouailles. Il tente de soulager la misère locale grâce à la caisse des aumônes (no 1105), mais sa libéralité s’étend également à la jeune « Société des missions évangéliques chez les peuples non-chrétiens établie à Paris » (no 1111) ainsi que, en 1825, aux victimes du grave incendie de Salins-les-Bains, dans le Jura (no 1136).
Dès 1821, il se préoccupe du sort de Jean Georges Bernard, instituteur de Belmont depuis 46 ans, et de son épouse, conductrice, en demandant aux bourgeois de Belmont qu’ils puissent demeurer dans la maison d’école le reste de leur vie (no 1098). En avril 1824, il se soucie de la répartition, entre ses enfants, de ses livres de piété ; quant à ses sermons, Louise Scheppler ne devra pas être oubliée 367dans le partage (no 1119). À partir de 1824, il prie le Seigneur de « vouloir bientôt, bientôt [le] congédier » (no 1124, p. 127). L’année suivante et au début de 1826, il adresse au Consistoire des suppliques déchirantes pour qu’en raison de ses nombreuses infirmités, on pourvoie enfin à son remplacement (no 1138, 1139 et 1147) en nommant son gendre Philippe Louis Rauscher ; il n’obtient gain de cause que peu de temps avant sa mort, le 1er juin 1826.
Gustave Koch a eu la bonne idée de ne pas s’arrêter au décès d’Oberlin, mais de livrer un certain nombre d’hommages qui lui ont été rendus, à commencer par les strophes prononcées par Daniel Ehrenfried Stoeber sur sa tombe (no 1150) et par la lettre extrêmement touchante envoyée par Louise Scheppler à Louise Charité Witz, fille d’Oberlin (no 1154). Le présent volume ne renferme pas seulement un index des noms de lieux, un index des noms de personnes et un index biblique pour le t. 7 : en effet, l’Éd. a pris la peine d’y ajouter un index des noms de lieux pour les t. 5 et 6, ainsi qu’un remarquable index thématique pour l’ensemble de la correspondance (p. 216-242).
Ces outils faciliteront la consultation d’une source dont on peut affirmer dès à présent qu’elle présente un très grand intérêt historique. Nous espérons que cette édition poussera nombre de jeunes chercheurs à s’intéresser à Jean Frédéric Oberlin.
Matthieu Arnold
Jean-Pierre Bastian, Christian Grosse, Sarah Scholl (éd.), Les fractures protestantes en Suisse romande au xixe siècle, Genève, Labor et Fides, coll. « Histoire », 2021, 380 pages, ISBN
978-2-8309-1750-5, 24 €.
Pour ce volume, Jean-Pierre Bastian a fait appel à deux des grands spécialistes de l’histoire du christianisme en Suisse romande afin d’élargir le spectre du remarquable travail qu’il avait consacré aux fractures du protestantisme apparues dès le début du xixe siècle dans l’espace protestant romand (La fracture religieuse vaudoise 1847-1966, Labor et Fides, 2016). Le présent ouvrage, fruit d’un colloque qui s’est tenu les 7 et 8 mars 2019 à l’Université de Lausanne, réunit 17 auteurs pour autant de contributions. Il est divisé en cinq parties qui étayent la thèse selon laquelle la période de fragmentation du 368protestantisme en Suisse francophone doit être comprise comme un moment particulier de sécularisation (p. 17-18). Cette observation est d’autant plus intéressante qu’elle ne signifie nullement la disparition du religieux, mais plutôt sa reconfiguration sur au moins trois plans. L’un, sociopolitique, concerne la reconfiguration des rapports entre Églises et État ; un autre, socioreligieux, touche l’apparition des groupes religieux composés de membres volontaires ; le dernier a trait à l’émergence de la liberté de conscience qui est au cœur des fractures du protestantisme romand.
La première partie brosse le tableau historique de l’apparition des fractures protestantes. Le processus de sécularisation est amorcé, mais il implique, bien au-delà de la séparation entre religieux et non-religieux, une reconfiguration de la paire collectif-individuel (Hermann). Sur le plan politique, le libéralisme triomphant se replie face aux avancées du radicalisme politique dans les cantons romands (Meuwly). Trois moments peuvent ainsi être dégagés (Scholl). Le premier se situe au début de xixe siècle à Genève et oppose, sur le plan spirituel, la théologie rationaliste et les mouvements de réveil dont la théologie, plus orthodoxe, est empreinte de romantisme. Le deuxième, au milieu du siècle, se situe sur le plan des institutions et voit l’émergence de séparations entre des Églises nationales et des Églises libres, fracture particulièrement dramatique dans le Canton de Vaud. Le troisième, dans le dernier quart du siècle, est marqué par l’émergence de la théologie libérale et la revendication de la liberté de conviction pour le pasteur, singulièrement intense à Neuchâtel. Ce contexte permet de comprendre les reconfigurations religieuses en place, chacune renforçant à sa manière le processus de sécularisation.
La deuxième partie souligne combien ce siècle est celui de la mise en œuvre de l’individualisme. Tout d’abord par l’affirmation de subjectivité religieuse, en particulier au travers du concept de libre examen (Pitassi), et celle de la défense du droit à la liberté religieuse, illustrée par l’emblématique Alexandre Vinet (Reymond). Celle-ci conduit inexorablement à l’exigence de la séparation entre l’Église et l’État, reprise par les milieux du réveil (Grosse). Cette liberté de conviction et de défense du rationalisme, mise en exergue par le jeune théologien français en poste à Neuchâtel, Ferdinand Buisson, renforce l’individualisme et contribue à accélérer le processus de sécularisation (Cabanel).
La troisième partie s’attache tout d’abord à montrer combien ces premières fractures internes au protestantisme romand ont 369ouvert à un éclatement en petits groupes de certaines ailes issues du réveil (Mayer). Relevons l’activité de N. J. Darby qui a su profiter du réveil pour convertir les réveillés à un christianisme plus radical, mais aussi, quelques années plus tard, un mouvement de distanciation de ce rigorisme darbyste qui posera les premiers jalons de l’évangélisme proprement romand. Un autre enjeu est celui de l’éducation de la population. Derrière le discours philanthropique et politique qui accompagne le passage de l’éducation populaire des mains de l’Église à celles de l’État, on assiste à une déconfessionnalisation (sans déchristianisation) de l’éducation et au renforcement de la responsabilité individuelle (Dahn-Singh). Autre aspect de ces temps de bouleversement, les femmes jouèrent un rôle de premier plan dans le réveil. L’exemple de la petite ville de Payerne (Johner) souligne toute l’ambivalence des engagements, progressistes ou conservateurs, dans les deux Églises. À travers l’analyse de données nouvelles, la chercheuse observe que les femmes montrent une indépendance à l’endroit de l’engagement politique de leur mari (qui a le droit de vote) et que les progressistes ne sont pas toujours dans l’Église que l’on pense.
La quatrième partie s’intéresse à quelques figures emblématiques du réveil. L’histoire du sobriquet « momier », catégorisant les adhérents du réveil qui se l’approprieront et finiront par lui faire perdre ses connotations sociales et politiques péjoratives, est brossée par J.-P. Bastian. César Malan, tenu jusqu’ici pour un chantre genevois du réveil, est plutôt à considérer comme un « chantre à contretemps » selon Amsler. Le banquier Alexandre Lombard, ensuite, est connu pour avoir impulsé un mouvement associatif de lutte en faveur du dimanche chrétien. Ce projet évangélique a remporté un succès certain, mais au prix d’un élargissement du projet religieux à une perspective philanthropique et sociale (Lathion). Henry Dunant, enfin, qui baigne dans le milieu du réveil à Genève dès son plus jeune âge, a été mû par la foi. Cependant, ainsi que le constate Cottier, son œuvre majeure, comme en témoigne le rôle qu’il a joué aux côtés de Gustave Moynier dans la création du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, est résolument non confessionnelle, dans son intention comme dans sa réalisation.
La dernière partie du volume s’intéresse à deux figures culturelles issues du milieu du réveil. L’auteur populaire Urbain Olivier, qui a publié plus de trente-cinq romans et recueils de nouvelles, doit son succès, selon Auberson, à une « esthétique de conviction ». Dans ses 370romans populaires, il fait toujours triompher la piété et les vertus chrétiennes. Un autre artiste, plus connu, est le peintre Eugène Burnand. Kaenel s’attache à montrer, dans ce volume, combien Burnand cherche à établir une rencontre entre beaux-arts et religion, parlant à cet égard de théographie. Son art engagé cherchera à produire des images évoquant le Christ ou plus tard à traduire en images les grandes paraboles et le Sermon sur la montagne. Un dernier chapitre clôt le volume et reprend les jalons principaux posés par les contributeurs à l’aune du concept de sécularisation (Campiche).
Cet ouvrage collectif constitue une contribution majeure à la compréhension de l’histoire tumultueuse du protestantisme romand. Bien que le volume soit constitué de 17 chapitres dus à des auteurs différents, son unité est patente, les différentes contributions concourant toutes à démontrer que l’émergence de la liberté de conscience constitue, au cœur des fractures du protestantisme, le premier vecteur de sécularisation en Suisse romande. Deux contributions méritent une mention spéciale : celle, particulièrement éclairante, de Sarah Scholl consacrées aux trois vagues de réveil comprises comme autant d’étapes dans un processus vers la liberté de conscience et celle d’Aline Johner, qui présente des données tout à fait nouvelles et fascinantes sur la place des femmes dans les clivages religieux du canton de Vaud. On regrette cependant de ne pas avoir lu de contribution sur une femme comme Valérie de Gasparin dans la partie sur les figures marquantes du réveil. Une discussion avec les travaux de l’historien Hugh McLeod aurait peut-être permis d’ouvrir la perspective plus largement que ne le fait la conclusion, qui s’en tient au contexte exclusivement romand. Il n’en demeure pas moins que ce volume constitue un voyage passionnant et éclairant dans le protestantisme suisse : il était temps qu’une publication de cette envergure voie le jour.
Christophe Monnot
Christiane Tietz (éd.), Bonhoeffer Handbuch, Tübingen, Mohr Siebeck, 2021, xii + 538 pages, ISBN 978-3-16-150080-0, 59 €.
La parution, dans la série des « Theologen-Handbücher » des Éditions Mohr Siebeck, d’un manuel consacré à Dietrich Bonhoeffer est réjouissante. Elle s’imposait même, tant l’influence du théologien 371allemand a été voire reste importante, dépassant les clivages nationaux, confessionnels et théologiques. La direction de ce manuel, qui rassemble les contributions de plus d’une trentaine de théologiens (il est un peu dommage qu’aucun historien « profane » spécialiste des résistances au nazisme n’ait été sollicité), a été confiée à Christiane Tietz, professeur de théologie systématique à la Faculté de Théologie de Zurich ; elle est donc la lointaine successeur de Gerhard Ebeling, qui fut l’un des étudiants de Bonhoeffer. Les débuts de ce projet, nous apprend l’avant-propos, remontent à plus d’une dizaine d’années (p. v), et plusieurs des contributeurs (J. Henkys, éminent spécialiste des poèmes de B., H. Pfeifer, auteur de plusieurs chapitres, et K. Yamasaki) n’ont pu en voir l’aboutissement.
Trois grandes sections suivent les contributions introductives de Ch. Tietz et Ilse Tödt, qui portent sur les éditions d’œuvres de Bonhoeffer, les instruments de travail et les évolutions récentes de la recherche. Ces sections concernent respectivement la personne (les traditions, la biographie, les relations et les influences – la langue et la musique), l’œuvre (les textes et les thèmes) et la réception de Bonhoeffer. Que la rédaction du chapitre sur la biographie ait été confiée à un biographe de Bonhoeffer dont l’ouvrage, paru il y a une quinzaine d’années, tendait souvent à l’hagiographie peut surprendre, mais pourrait s’expliquer par son rôle de co-fondateur de la « Bonhoeffer-Gesellschaft » ; sans surprise, cet auteur met l’accent sur l’« entrée dans la résistance » puis sur « la résistance » de Bonhoeffer, thème que Christoph Strohm reprend de manière plus nuancée dans le chapitre « Politischer Widerstand » de la sous-section consacrée aux relations de Bonhoeffer. C’est également dans cette sous-section que Hans Pfeifer consacre des pages bien informées et parfois émouvantes à Jean Lasserre et à Maria von Wedemeyer.
La section qui se rapporte à l’œuvre examine tout d’abord les grands textes de Bonhoeffer, depuis Sanctorum communio jusqu’aux « Lettres de fiançailles ». Les quelques pages consacrées par Peter Zimmerling aux prédications (p. 299-304) sont assez décevantes, car elles ne nous renseignent guère sur le contenu de ces sermons. Les thèmes présentés combinent quelques lieux théologiques (l’Écriture sainte, C.-M. Bammel ; Jésus-Christ, K. Lehmkühler ; l’Église, K. Busch Nielsen), la question, chère au « dernier » Bonhoeffer, du christianisme a-religieux (E. Feil) et des sujets tels que le « caractère scientifique de la théologie » (J. Zimmermann), le « caractère 372public de la théologie » (H. Bedford-Strohm), la théologie pratique (P. Zimmerling), l’« œkumene » (W. Krötke), les fondements éthiques (B. Wannenwetsch), la résistance (à nouveau !, H.-R. Reuter) et la paix (C. J. Green). L’auteur de ce dernier chapitre, ainsi que d’autres contributeurs, mettent l’accent sur l’« éthique de la paix » de Bonhoeffer, le tyrannicide constituant, à les lire, la seule exception à ce pacifisme ; ces auteurs ne s’interrogent nullement, semble-t-il (l’index des thèmes comporte l’entrée « Tyrannenmord », mais non l’entrée « Mord »), sur les propos de l’Éthique (pages consacrées à « la vie naturelle ») dans lesquelles Bonhoeffer écrit que l’« homicide de personnes civiles pendant la guerre » n’est pas un acte arbitraire « pour autant qu’il n’est pas poursuivi de manière intentionnelle, mais seulement la conséquence malheureuse d’une mesure militaire nécessaire »…
La dernière section, qui traite de l’influence de Bonhoeffer et de sa réception, commence par examiner trois auteurs (K. Barth, par M. Beintker ; E. Bethge, par J. W. de Gruchy ; G. Ebeling, par A. Beutel) avant d’élargir son propos à plusieurs aires géographiques : outre les deux Allemagnes (RFA, J. Dinger ; RDA, W. Krötke), les États-Unis et le monde anglophone (C. J. Green), l’Afrique du Sud (R. K. Wustenberg) et l’Asie (K. Yamasaki avec la collaboration d’A. Okano). Cette section traite pour finir de la réception de Bonhoeffer dans la littérature, la musique (plusieurs poèmes de captivité sont devenus des cantiques) et les arts visuels (il s’agit principalement de statues ; J. Henkys), ainsi que de la « réception catholique » (E. Feil).
L’importante bibliographie (p. 477-519) n’ignore pas entièrement la littérature en français, mais il est significatif qu’à l’exception d’un article de l’Encyclopédie du protestantisme, la seule étude de Henry Mottu qui soit mentionnée a paru en anglais. Quant à la réception de Bonhoeffer en France et, plus largement, dans les pays latins, elle est superbement ignorée puisqu’elle ne se voit pas consacrer de chapitre (voir pourtant H. Mottu et J. Perrin, éd., Actualité de Dietrich Bonhoeffer en Europe latine, Genève, 2004) et que les seuls auteurs francophones traités dans la « réception catholique » sont ceux dont les livres ont été traduits en allemand.
Le Bonhoeffer Handbuch n’en reste pas moins un ouvrage important. Un index des noms de personnes et un index des thèmes (il comporte aussi les lieux) en facilitent la consultation. Un index des textes de Bonhoeffer aurait sans doute été encore plus utile, mais 373il est vrai que, même dans la sous-section « Texte » et y compris pour les poèmes, rarement ces textes font l’objet de citations qui dépassent quelques mots.
Matthieu Arnold
Cardinal Jean Daniélou, Cardinal Henri de Lubac, Correspondance 1939-1974. Présentation par le P. Dominique Bertrand, sj. Témoignage de Marie-Josèphe Rondeau. Annotation par Marie-Josèphe Rondeau et Étienne Fouilloux, Paris, Cerf, coll. « Cardinal Henri de Lubac, Œuvres complètes » 48, 2021, 515 pages, ISBN 978-2-204-14920-4, 40 €.
La correspondance entre Henri de Lubac (1896-1991) et Jean Daniélou (1905-1974), éditée dans la section « Posthumes » des Œuvres complètes d’Henri de Lubac, constitue un document de grande importance. Cette correspondance riche de 221 lettres (32 d’Henri de Lubac seulement, car son correspondant ne conservait guère ses lettres) s’échelonne du 16 septembre 1939 au 1er février 1974.
Les échanges épistolaires entre les deux jésuites, futurs cardinaux et membres de l’Institut, sont marqués toutefois, entre 1950 et 1956, par une interruption de six ans qu’explique une longue « Note » (p. 443-476) de M.-J. Rondeau. La crise entre les deux hommes résulta d’une part de divergences personnelles sur la direction de la collection des « Sources chrétiennes » : H. de Lubac jugeait que J. Daniélou n’y consacrait plus le temps ni la rigueur nécessaires. Elle fut occasionnée d’autre part, et plus fondamentalement, par les attaques menées en haut lieu contre la « Nouvelle théologie » (Pie XII) défendue par les deux membres de la Compagnie de Jésus depuis le manifeste publié en mai-juin 1946 par J. Daniélou dans la revue Études, « Les orientations présentes de la pensée religieuse ». H. de Lubac estimait en effet, non sans raison, que J. Daniélou s’agitait et criait « inconsidérément » tout en se désolidarisant de lui. Ce fut lui toutefois qui, en adressant à J. Daniélou une lettre de condoléances à l’occasion du décès de sa mère (voir la réaction de J. Daniélou, Lettre 194), permit à leurs échanges épistolaires de reprendre et de se poursuivre jusqu’à la mort de son correspondant – à un rythme certes moins soutenu que dans les années 1940-1950.
374Cette correspondance constitue une source importante non seulement pour la crise de la « Nouvelle théologie », que documentent par ailleurs plusieurs annexes des Éd., mais encore – et surtout – pour la naissance et le développement de la collection « Sources chrétiennes » (jusqu’en 1942, les deux jésuites l’appelèrent « Sources »). Cette collection constitue le fil rouge des années de guerre (J. Daniélou se trouvait à Paris, H. de Lubac à Lyon) ; la correspondance est riche de renseignements sur les volumes en préparation, mais aussi sur les difficultés liées à la censure (« Vous savez les mésaventures de la Vie de Moïse, victime de ces temps troublés » ; J. D., Lettre 47, p. 112 ; 11 août 1942) et sur les projets avortés, ainsi que, dès 1943, sur l’accueil favorable que reçoivent les premiers volumes.
Sur le plan exégétique et théologique, le fait que les deux jésuites ont en commun de préférer l’exégèse des Pères à celle des théologiens scolastiques ne masque pas certaines divergences : J. Daniélou juge également l’exégèse patristique supérieure à la méthode historico-critique, qui « fait de la parole vivante de Dieu un cimetière de civilisations disparues » (Lettre 59, p. 130 ; 29 avril 1943). De son côté, H. de Lubac ne partage pas son attrait pour l’exégèse christologique de Wilhelm Vischer, ni, plus largement, sa fréquentation des théologiens protestants auxquels Daniélou donne abondamment la parole dans la revue Dieu vivant : « Je crains que vous-même ne soyez quelquefois un peu trop séduit par eux » (Lettre 154, p. 313 ; 1er mars 1948). Le 27 octobre 1949, il s’indigne de ce que, dans Dieu vivant, J. Daniélou ait publié deux lettres « séniles » de Paul Claudel, qui voulait enfermer les critiques dans le dilemme « ou la Bible est humaine, ou elle est divine » : ces lettres peuvent être perçues, de même que l’article de J. Daniélou qui les accompagnait, comme « un encouragement au sabotage de la critique » (Lettre 185, p. 375 sq.).
Les deux théologiens ayant été nommés experts au Concile Vatican II, les six lettres des années 1962-1965 (voir p. 393-399) contiennent d’intéressants renseignements sur l’activité de J. Daniélou durant le Concile. À propos du Secrétariat pour l’Unité des chrétiens, H. de Lubac estimait qu’il y avait « peu de têtes doctrinales à l’intérieur » de cette institution (Lettre 203, p. 399 ; 11 juillet 1965). On relèvera enfin que cette correspondance atteste les contacts personnels entre J. Daniélou et Oscar Cullmann (tous deux assistèrent, le dimanche de Pâques 1948, à l’« Allocution au peuple romain » de Pie XII 375qui prenait position au sujet des élections prochaines en Italie) et l’estime mutuelle qui liait les deux hommes (voir Lettres 108, 111, 124, 158 et 176).
L’apparat critique est de grande qualité, et la « Présentation » (p. 11-29), les notes infrapaginales et plusieurs annexes développées (p. 419-490) contribuent à une meilleure compréhension des échanges intellectuels et humains entre ces deux grandes figures du catholicisme au xxe siècle. Un « index des auteurs anciens » (p. 491-495) et un « index des auteurs modernes » (à partir du xviie siècle, p. 497-514) facilitent la consultation de ce beau volume.
Matthieu Arnold
Jurjen Zeilstra, Willem Adolf Visser ’t Hooft. Ein Leben für Ökumene. Traduit du néerlandais par Katharina Kunter, Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt, 2020, 527 pages, ISBN
978-3-374-06376-5, 58 €.
Plusieurs ouvrages ont déjà été consacrés au pasteur néerlandais Willem Visser ’t Hooft (1900-1985), qui fut le premier secrétaire général du Conseil Œcuménique des Églises (COE). Toutefois, ces biographies se fondent très largement sur les écrits autobiographiques de l’intéressé. C’est pourquoi Jurjen Zeilstra, pasteur à Hilversum qui n’a pas connu personnellement Visser ’t Hooft, a entrepris de rédiger un ouvrage plus complet et plus distancié en se fondant également sur des documents d’archives (sélection d’archives du COE, archives de la famille de Visser ’t Hooft, etc.) et sur des témoignages oraux.
Comme son contemporain Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), Visser ’t Hooft est né dans une famille aisée et aristocrate, et ce milieu a favorisé son ouverture tant internationale qu’œcuménique. Mais la comparaison entre les deux théologiens s’arrête là, même si Visser ’t Hooft a tenté – hélas en vain – d’unir ses efforts à ceux de Bonhoeffer dans les années 1940 pour faire connaître aux Alliés l’existence d’une résistance allemande à Hitler (voir chap. 3, « L’œcumene en temps de guerre, 1939-1945 »). En effet, la lecture de l’ouvrage de l’A. fait apparaître que, bien que titulaire d’une quinzaine de doctorats honoris causa, Visser ’t Hooft (1900-1985) fut un homme d’appareil plus qu’un théologien : après avoir été 376secrétaire général des Unions chrétiennes de jeunes gens (1924-1932), puis de la Fédération universelle des associations chrétiennes d’étudiants (1932-1937), il fut secrétaire général du Comité provisoire (1938-1948) puis du Comité définitif du COE (1948-1968) ; ce poste de secrétaire général du COE lui avait été taillé sur mesure (voir chap. 2, p. 113-115). Il s’était par ailleurs voué à la théologie non par vocation, afin de devenir pasteur, mais pour approfondir des questionnements personnels (voir chap. 1, p. 42).
Cet ouvrage établit aussi que, tout en ayant eu une réputation de théologien barthien, Visser ’t Hooft avait commencé par trouver le commentaire des Romains de Barth trop difficile (p. 45). Quant à la théologie de Bultmann (le néotestamentaire de Marbourg est mentionné une seule fois, p. 280) et de ses disciples, elle lui sembla plus tard complètement inutilisable dans l’Église. En 1963, alors que Paul Tillich donnait une conférence devant des personnalités de la politique, du sport et du cinéma, Visser ’t Hooft jugea que ses propos passaient totalement à côté de son auditoire et il regretta, lui qui était un bon orateur, de ne pas être à la place du théologien germano-américain ; d’ailleurs, plus que la conférence de son coreligionnaire, il apprécia la présence à ses côtés de prélats et d’hommes politiques éminents, ainsi que celle de l’actrice italienne Gina Lollobrigida (chap. 6, « Secrétaire général du Conseil Œcuménique des Églises », p. 283 sq.).
Pour autant, le portrait que l’A. brosse de Visser ’t Hooft avec sympathie, mais sans complaisance, n’est pas celui d’un mondain, même si le secrétaire général du COE, qui fit la couverture du Time en 1961 avec la légende « World churchman Visser ’t Hooft » (voir p. 284), n’était pas insensible aux honneurs. Il rappelle le rôle de cet homme énergique dans l’accueil des réfugiés, juifs notamment, en Suisse dans les années 1942-1944 (chap. 4, « Du “contact spirituel” à l’engagement politique »). Il traite de son engagement au service de la « réconciliation » et de la « reconstruction » au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale (chap. 5), mais semble ignorer sa passe d’armes avec Oscar Cullmann au sujet de l’absence de réaction du COE à la « disparition » du théologien allemand Ernst Lohmeyer, capturé puis exécuté par les Soviétiques (voir RHPR 89, 2009, p. 19-20). Il rappelle ses qualités de diplomate, sa lutte contre l’apartheid et ses efforts pour intégrer au COE l’Église orthodoxe de Russie (chap. 7, « Guerre froide, œcumene et orthodoxie orientale »). Il traite longuement de ses contacts avec l’Église 377catholique romaine, qui s’intensifièrent avec le Concile de Vatican II et l’accueil d’observateurs protestants (chap. 8, « Nostra res agitur, 1948-1969 »).
L’A. ne cache pas que, dans les deux dernières décennies de sa vie, Visser ’t Hooft prit ses distances avec maintes évolutions de la théologie telle qu’elle s’exprimait désormais au sein du COE (chap. 9, « Au soir de sa vie, 1966-1985 »). Ayant toujours combattu le syncrétisme, y compris dans des publications qu’il dédia spécifiquement à cette question, Visser ’t Hooft se méfiait du dialogue interreligieux, estimant que les chrétiens devaient d’abord approfondir leur propre tradition spirituelle (voir p. 391). Par contre, il s’intéressait grandement au thème de la création, tout en soulignant, avec Karl Barth, que la Bible ne tenait nullement la nature pour sacrée (voir p. 388).
Au total, c’est un tableau assez complet et nuancé que J. Zeilstra brosse du « patron » du COE mais aussi de son épouse Jetty, laquelle n’hésitait pas, à l’occasion, à prendre la plume afin d’apaiser des tensions avec Karl Barth. En dépit de ses longueurs et de son caractère parfois scolaire (ainsi, les introductions un peu laborieuses aux différents chapitres), cet ouvrage se lit avec beaucoup d’intérêt.
Matthieu Arnold
Hines Mabika Ognandzi, Walter Munz. Dans la suite d’Albert Schweitzer à Lambaréné. Une biographie, Lausanne, Éditions Favre, coll. « Biographie », 2019, 316 pages, ISBN
978-2-8289-1755-5, 27 €.
Il y a quelques mois, Walter Munz s’éteignait paisiblement en Suède, dans sa 89e année. Bien connu des milieux qui cultivent la mémoire et l’œuvre d’Albert Schweitzer, W. Munz, qui succéda notamment à Schweitzer à Lambaréné (1965-1969), ne l’est pas nécessairement du grand public. Aussi la biographie rédigée par Hines Mabika, historien de la médecine qui a pu correspondre et s’entretenir avec W. Munz et son épouse Jo, est-elle particulièrement bienvenue ; W. Munz en a rédigé la « Note liminaire. Vivons dans le respect de la vie » (p. 13-15). Cet ouvrage a pu voir le jour grâce au projet, financé par le Fonds suisse de la recherche scientifique, Medical Practice and International Networks : Albert Schweitzer Hospital of Lambarene, 1913-1965.
378Cette biographie est agencée en quatre parties : 1. la vie de Munz jusqu’à l’« appel de Lambaréné » (1933-1959) ; 2. la préparation pour l’Afrique, puis les séjours à Lambaréné aux côtés et à la suite de Schweitzer (1959-1969) ; 3. le retour en Suisse et l’exercice de la chirurgie à l’hôpital de Wil (1970-1991) ; 4. la construction, en Suisse, de son « propre Lambaréné » en tant que directeur du « Sune-Egge (Coin du soleil) », centre socio-médical pour drogués et malades du sida à Zurich. À lui seul, ce plan montre que – même si la deuxième partie compte près d’une centaine de pages – le parcours professionnel et la vie de Munz ne se limitèrent pas à Lambaréné, et qu’il est donc réducteur de le qualifier de « successeur d’Albert Schweitzer ».
Fondée sur des sources nombreuses – y compris les archives privées de W. Munz –, la biographie rédigée par H. Mabika brosse le portrait attachant d’un homme qui, peu après la Deuxième Guerre mondiale, lut avec passion À l’orée de la forêt vierge, puis se sentit comme « appelé par Lambaréné » et dévora les ouvrages théologiques de Schweitzer (p. 43 sq.). Il hésita entre la théologie et la médecine avant d’opter dès 1951 pour la seconde, suivant ainsi la voie de son père et de bien des membres de sa famille. Assistant à l’hôpital de Rorschach (1959-1961) après une formation de treize semestres (et quatre mois de service militaire), il quitta ses fonctions après avoir trouvé sur son bureau, en janvier 1961, un numéro du Bulletin des médecins suisses comportant l’annonce d’une offre d’emploi comme chirurgien à Lambaréné (p. 63) ; intentionnel ou fortuit, le parallèle avec la vocation de Schweitzer – en tout cas telle qu’il la décrit dans Ma vie et ma pensée (1931) – est frappant, puisque le « grand docteur blanc » avait, quant à lui, réagi à l’automne 1904 à une annonce du Journal des Missions de Paris. Une fois sa candidature acceptée par les relais de Schweitzer en Suisse, Munz se prépara au voyage et partit en mai 1961.
Les pages consacrées à ses trois séjours en Afrique du vivant de Schweitzer témoignent à la fois de la grande influence que Schweitzer exerça sur son jeune collaborateur et de l’indépendance d’esprit de ce dernier, qui s’appliqua par exemple à apprendre les langues locales pour parler directement avec ses patients. Ces pages mettent aussi en évidence l’organisation rigoureuse de l’hôpital et la bonne collaboration entre les chirurgiens. Reparti, au grand regret de Schweitzer, à l’issue de son contrat de 26 mois, Munz revint à Lambaréné dès l’année suivante : Schweitzer était déterminé à ce que le jeune homme lui succédât de son vivant comme directeur médical, en 379grande partie à cause de son empathie pour les populations locales (p. 128). Après s’être spécialisé en gynécologie et en obstétrique à l’hôpital cantonal de Saint-Gall, Munz prit les rênes de l’hôpital tout d’abord sous la houlette de Schweitzer, qui s’attacha à le former à ses fonctions aux cours d’entretiens quotidiens, puis, après le décès de son mentor, en imprimant sa propre marque à l’hôpital. Les conflits avec Rhena Schweitzer – quoique directrice administrative de l’hôpital, la fille de Schweitzer « ne connaissait pas grand-chose de l’administration d’un hôpital [sic !] » (W. Munz, p. 155) –, puis les lenteurs de l’association de tutelle à répondre à ses demandes de modernisation et d’accroissement des effectifs du personnel, amenèrent Munz à quitter Lambaréné en 1969. Il y revint toutefois en 1980, le temps de régler avec succès un important conflit entre le directeur et le corps médical ; il repartit en Europe en mars 1981, deux mois après l’ouverture du nouvel hôpital Albert Schweitzer.
Entretemps, il avait continué, depuis la Suisse et avec son épouse Jo Boddingius, sage-femme hollandaise qu’il avait épousée en 1968 à Lambaréné, à soutenir l’œuvre créée par Schweitzer. Après dix-huit ans de travail en tant que chirurgien hospitalier en Suisse, Munz embrassa une nouvelle carrière à l’âge de 57 ans, se vouant notamment – toujours avec son épouse – aux soins des patients séropositifs à une époque où les traitements antirétroviraux efficaces n’existaient pas encore. Le temps de la retraite fut, pour le couple Munz, celui des grands voyages, d’innombrables conférences et de la rédaction de quelques ouvrages ; ce fut, surtout et à nouveau, le temps de l’engagement pour l’hôpital de Lambaréné, avec la création d’une fondation et la contribution à la rénovation de l’« hôpital historique » fondé par Schweitzer à la fin des années 1920.
Retracer l’existence d’une personne en vie, à partir notamment des sources livrées par elle, n’est pas chose évidente, et sans doute une biographie écrite avec plus de recul aurait-elle été un peu différente. Toutefois, en dépit de son admiration manifeste pour W. Munz, jamais l’A. ne verse dans l’hagiographie. Son ouvrage, agrémenté d’une soixantaine de photographies en noir et blanc, se lit avec le plus grand intérêt. La liste des « responsables des organisations Schweitzer » (p. 291-293 ; en sont hélas absents les présidents des associations française et allemande) et l’index des noms propres (p. 295-302) rendront d’utiles services.
Matthieu Arnold
380Hugh McLeod, Le déclin de la chrétienté en Occident. Autour de la crise religieuse des années 1960. Préface de Guillaume Cuchet et Géraldine Vaughan. Traduit de l’anglais par Élise Trogrlic, Genève, Labor et Fides, coll. « Histoire », 2021, 473 pages, ISBN 978-2-8309-1759-8, 24 €.
Selon l’historien britannique Hugh McLeod, professeur émérite à l’Université de Birmingham, la crise des années 1960 est, sur le plan religieux, un moment-charnière, révolutionnaire, et constitue une rupture presque aussi importante que la Réforme. Il est cependant impératif de s’intéresser au temps long et aux idées qui anticipent cette rupture religieuse. Voilà posée en quelques mots la thèse de ce passionnant volume, enfin traduit en français, 14 ans après sa parution.
Préfacé par Guillaume Cuchet et Géraldine Vaughan, l’ouvrage est structuré en onze chapitres, flanqués d’une introduction et d’une conclusion. L’A. traite de quatre thèmes majeurs. Il aborde tout d’abord la pluralisation des croyances, inaugurée dans les années 1950, avant de gagner en ampleur dans les années 1970, les années 1980-1990 ayant été le théâtre de l’interpénétration des croyances en question. Le deuxième thème est celui du passage des sociétés occidentales chrétiennes des années 1940-1950 à une société multiconfessionnelle, puis séculière dès la fin des années 1970. La baisse de socialisation religieuse des enfants constitue le troisième thème. Il est pour finir question du resserrement, dans le sillage de Vatican II, des relations entre Églises chrétiennes qu’accompagne l’intensification des tensions à l’intérieur même de ces Églises (entre conservateurs et progressistes).
L’A. montre que le terrain est de fait bien préparé par la crise des années 1960. L’écart se creuse entre les exigences morales de l’Église et le message délivré par les différentes productions culturelles. La prospérité sans précédent offre un climat économique affaiblissant les identités collectives et permet l’émancipation sociale (chap. 1). Dans les années 1940, il était encore possible de penser l’Europe occidentale en termes de chrétienté. « La période de la guerre, puis celle de la guerre froide ont renforcé les sentiments d’identité nationale chrétienne dans de nombreux pays occidentaux » (p. 102). Cependant, la baisse des vocations et d’engagement des fidèles sont des indicateurs de la tendance lourde de déclin du christianisme qui se met alors en place (chap. 2).
381La question que soulève ensuite l’A. est celle des leviers socio-historiques de cette période de bouleversement des années 1960 (chap. 3). Il remarque que les années 1950-1962 représentent une transition entre les années les plus tendues de la guerre froide et les espoirs de 1968. Durant cette période, le pouvoir et le prestige des Églises s’estompent. Des voix réformatrices s’y font aussi entendre. S’ensuivent de nombreux changements dans les Églises. Les perspectives de Vatican II ou les théologies protestantes mettant l’accent sur l’action dans le monde poussent les progressistes à « l’euphorie » (p. 172) et à la sous-estimation de la puissance des forces religieuses conservatrices (chap. 4).
La prospérité qui s’installe dès les années 1950 permettra à de nombreuses sous-cultures de se développer (chap. 5). Le mouvement de la contre-culture est frappant, car il est en même temps un éveil spirituel (à toutes sortes de mystiques) et un moment de sécularisation (chap. 6). Survient 1968 ou plutôt la période qui s’étend entre 1964 et 1970, laquelle suscite beaucoup d’espoir en dehors et dans les Églises. Cet espoir cédera le pas à un lot de déceptions chez les chrétiens aux idées les plus « radicales », mais alimentera aussi des valeurs durables qui perdureront dans les Églises, comme le soutien de certaines aux mouvements gay, féministes, tiers-mondistes, pacifiques et écologiques (chap. 7).
Le chapitre suivant est consacré à l’impact de la problématique de genre, de la sexualité et de la politique des familles sur la sécularisation. L’A. discute et conteste les thèses de Callum Brown et Patrick Pasture (chap. 8) qui placent la question de genre au cœur de l’explication de la désaffectation des fidèles. « À part dans le cas spécifique des catholiques et de la contraception, rien ne laisse véritablement penser que le rejet des préceptes chrétiens sur la sexualité constitue en soi un motif d’éloignement des fidèles » (p. 313).
L’A. observe qu’entre 1967 et 1972, un double mouvement de démissions en masse se met en place, celui des prêtres d’une part et celui des laïcs de l’autre (chap. 9). Dans le même temps, une proportion croissante de jeunes est socialisée en dehors du christianisme. Le chapitre suivant s’intéresse aux réformes législatives qui signent la transition d’une société chrétienne vers une société pluraliste, au sein de laquelle une grande variété de points de vue voit le jour (chap. 10). L’A. discute dans le dernier chapitre la fin de la chrétienté et revient sur les grandes périodes de déclin en Europe, qui culminent avec la « crise apparemment ultime » (p. 422) qui 382se déclare dans les années 1960-1970. Cependant, constate l’A., « les Églises chrétiennes continuent de jouer un rôle important » (p. 422), exerçant une influence sociale certaine et comptant encore un nombre conséquent de membres actifs.
En somme, un livre fascinant et argumenté de manière très pédagogique, qu’il est urgent de (re)découvrir !
Christophe Monnot
PHILOSOPHIE
Richard Popkin, Histoire du scepticisme de la fin du Moyen Âge à l’aube du xixe siècle. Traduit de l’anglais par Benoit Gaultier. Préface de Frédéric Brahami, Marseille, Agone, coll. « Banc d’essais », 2019, xxv + 883 pages, ISBN 978-2-7489-0413-0, 35 €.
Contrairement à ce qu’affiche la quatrième de couverture, le présent ouvrage – un fort volume de près de 900 pages – ne constitue que partiellement un inédit : une première traduction de la deuxième édition anglaise de 1979 était en effet parue dans l’excellente collection « Léviathan » des P.U.F. en 1995. L’édition présentée ici est toutefois partiellement inédite, puisque l’ouvrage de Popkin n’a cessé d’être repris et complété par son auteur : elle reprend ainsi la dernière édition anglaise (datée de 2003), qu’elle complète, qui plus est, par une sélection d’articles que l’A. avait fait paraître en 1976, 1992 et 1997. C’est en somme à un ouvrage refondu que le lecteur a affaire, même s’il ne l’a pas été par l’A. lui-même, mais par le traducteur et directeur de la très dynamique collection « Banc d’essais », moyennant bien sûr autorisation des ayants droit.
L’édition de 1979/1995 débutait l’histoire du scepticisme par la Réforme de Luther, à juste titre si l’on songe aux nombreuses conséquences intellectuelles que la critique de l’autorité spirituelle romaine a pu avoir. L’A., sans du tout remettre en cause l’importance qu’il avait accordée à la Réforme, est allé plus en amont dans les ultimes éditions, en remontant jusqu’à Savonarole, mais aussi plus en aval, jusqu’au xixe siècle.
À consulter cette somme, on ne peut louer les éditeurs d’avoir pris le risque de rééditer ce monument d’érudition, où le souci 383de l’A. de faire justice aux auteurs mêlés de près ou de loin aux questions sceptiques (de Montaigne à Jean de Sihon, de Pierre-Daniel Huet à Bayle, et bien d’autres encore) se remarque à chaque page. Bien plus qu’un courant philosophique contradictoire, assénant comme une vérité que la vérité n’existe pas, le scepticisme y apparaît comme une recherche de tous les instants, inquiète du tort que le dogmatisme fait aux intelligences, mais non incapable de se rendre elle-même à la vérité là où elle la discerne. Ce n’est pas sans à propos que l’ancien professeur américain a pu placer en exergue ce propos de Pierre Bayle, figure éminente du scepticisme européen : « J’en sais trop pour être Pyrrhonien & j’en sais trop peu pour être Dogmatique. »
Daniel Frey
Marc de Launay, Nietzsche et la race, Paris, Seuil, coll. « La librairie du xxie siècle », 2020, 171 pages, ISBN 978-2-02-101211-8, 20 €.
Un an après la parution dans la collection de la Pléiade du deuxième volume de l’excellente édition des œuvres de F. Nietzsche (Œuvres II. Humain, trop humain – Aurore – Le Gai Savoir, publié sous sa direction), Marc de Launay a livré avec cet essai un ouvrage indispensable pour éclairer la question – délicate entre toutes – de l’affinité présumée de la pensée nietzschéenne avec les théories racistes. Il ne s’agit pas selon lui de « “sauver” Nietzsche » (p. 14) de l’interprétation erronée donnée par les idéologues nazis à la suite d’Élisabeth Förster-Nietzsche, la sœur même de Nietzsche. Les manipulations de cette dernière sur les archives du philosophe et ses basses manœuvres sont documentées et bien connues de l’A. (voir les passionnants premiers chapitres intitulés « Nietzsche sous le nazisme », « Les Archives Nietzsche et le Reich »). Il s’agit plutôt de prendre la juste mesure de l’ironie dans l’écriture nietzschéenne, « que les interprètes ont eu du mal à situer » (p. 10). On a confirmation, en lisant cette étude, que cela était parfaitement conforme à l’intention de Nietzsche qui, derrière un élitisme réel, visait surtout à faire trébucher les lecteurs impatients pour mieux façonner – aphorisme après aphorisme, livre après livre – les « esprits libres », ces lecteurs à la mesure de son œuvre. Comme le note l’A., « Nietzsche multiplie les avertissements signalant à 384la fois qu’il se cherche des compagnons parmi les esprits libres et que ces esprits libres doivent satisfaire à un certain nombre de conditions, et d’abord celle de bien savoir lire, c’est-à-dire de franchir les barrières installées pour décourager les mauvais lecteurs ou les lecteurs trop pressés » (p. 56).
De Launay va plus loin, qui estime, d’une part, que La volonté de puissance (titre sous lequel la sœur de Nietzsche a fait paraître de façon arbitraire et orientée certains textes inachevés) constitue une « fiction éditoriale » : Nietzsche a en effet formé de plusieurs manières le projet d’un ouvrage sur ce sujet en 1886, mais il a fini par l’abandonner en 1888, de façon définitive semble-t-il (p. 50). D’autre part, et après d’autres (comme Michel Haar), l’A. estime que la « volonté de puissance » ne joue pas dans la philosophie de Nietzsche le rôle de principe métaphysique. Chez ce pourfendeur des « arrière-mondes », elle n’aurait pu sans contradiction désigner une essence même de la réalité (la vérité au sens traditionnel du terme, cf. p. 45 – encore que Nietzsche ait semblé parfois céder lui-même à la « l’ivresse de son intuition » (p. 62) ! La « volonté de puissance » n’est au fond qu’une autre définition de la vie – la vie comprise comme dépassement perpétuel de soi, au prix même de la vie. Bien plus : selon l’A., l’expression « volonté de puissance » n’a absolument pas « pour finalité la conservation d’une quelconque “race”, pas plus, d’ailleurs, que celle de l’espèce humaine » (p. 26). Il n’y a pas une seule, mais une multiplicité de volontés de puissance à l’œuvre dans chaque corps (organique ou non d’ailleurs, p. 67), comme une énergétique générale au sein de la vie. Pour l’érudit, elle relève essentiellement du discours exotérique. Les bons lecteurs sont, quant à eux, appelés par Nietzsche à apprécier la version ésotérique de ce thème, qui n’est autre que celle de l’éternel retour (cf. p. 56 sq.).
La question du Surhomme se situe elle aussi dans la perspective des « esprits libres » : Nietzsche appelle bien de ses vœux la venue du Surhomme, qui est forcément postérieure à la mort de Dieu (p. 75), mais c’est tout autre chose qu’une question de race. Certes, il est étrange que le Surhomme prophétisé par Zarathoustra ramène à l’immanence (le « sens de la terre »), tout en constituant en même temps un « espoir », un but à atteindre, une fin régulatrice (p. 77)… Mais ce surhomme n’a aucun rapport avec ce que l’idéologie nazie a pu en dire. Il n’est attendu par Nietzsche que comme une alliance entre esprits libres, ceux-là mêmes dont le philosophe a espéré faire 385de son vivant ses disciples (il reconnaît dans une lettre de 1884 qu’il a voulu en avoir et que ses derniers livres sont tous des hameçons à disciples ; s’il n’en a pas eu, ce n’est pas parce qu’il ne savait pas pécher, c’est parce que le poisson a manqué (p. 76) !
Ecce homo le confirme selon l’A. : « le surhomme est une projection de ce que serait le nietzschéisme réalisé : le surhomme serait ce type nouveau d’individus chez qui l’amor fati serait absolument spontané. […] Toutes les tentatives pour voir dans le surhomme une quelconque analogie avec les ambitions idéologiques du nazisme se heurteront au fait que Nietzsche n’envisage jamais une “race” comme support matériel de qualités spéciales : le “corps” est forgé par la discipline qui reconnaît des valeurs dont la première caractéristique est de ne pas être partagée par la masse » (p. 81-82). On ne saurait être plus clair ! Mais comment ne pas dire ici – dans le sillage du dernier ouvrage de Jacques Bouveresse (Les Foudres de Nietzsche et l’aveuglement des disciples, 2021) – que cet élitisme méprisant la plèbe constitue en soi un problème ? Non celui du darwinisme social ; car si Nietzsche s’est d’abord appuyé sur Darwin contre le christianisme, il a fini (comme le montre l’A.) par le critiquer ouvertement : la lutte pour la vie ne voit pas la victoire des forts, mais au contraire celle des faibles, qui sont plus rusés (p. 90 sq.) ! Là encore, c’est un aspect inquiétant de la pensée de Nietzsche, que De Launay ne commente pas particulièrement.
Les derniers chapitres (« Peuples et nations », « La race la plus pure en Europe », « La notion de “race” ») sont remarquables, tant l’érudition est au service de l’intelligence philologique et historique de l’œuvre (car « la philosophie de Nietzsche a sa propre histoire et une évolution spécifique qui doivent être prises en compte en identifiant ses tournants essentiels », p. 146). Grâce à eux, on comprend mieux la façon dont Nietzsche investit des notions qu’il tient souvent pour équivalentes (peuple, nation, race) pour faire saisir le jeu antagoniste des populations européennes. Le peuple juif s’y voit souvent évoqué, quelquefois avec des traits antisémites populaires ; mais une fois la rupture avec Wagner consommée et son influence judéophobe conjurée (p. 136), ce sera en affichant ouvertement son mépris pour l’antisémitisme, dans des termes qui, pour sembler philosémites (ce qui est déjà exceptionnel dans l’Allemagne de Bismarck, où Nietzsche lui-même s’étonne de n’avoir « encore jamais rencontré aucun Allemand qui soit favorable aux Juifs », cf. p. 140), n’en restent pas moins destinés à 386tout autre chose : incarner, si l’on peut dire, une réflexion sur la « gigantomachie des forces culturelles mobilisées par une histoire qui, devenant ainsi prédictive, cesse aussitôt d’être effectivement historique » (p. 140). On saura gré à l’A. de le reconnaître, mais cette réflexion même n’en reste pas moins, elle aussi, douteuse : si Nietzsche ne s’intéresse pas au judaïsme même, s’il évoque à loisir le génie grec ou français et renvoie au climat d’Athènes ou de Paris sans y avoir jamais mis les pieds (p. 141), n’est-ce pas qu’il s’agit au fond de constructions fantasmatiques ? Il ne suffit pas de reconnaître l’incapacité de Nietzsche à s’intéresser réellement à la réalité de la condition des Juifs pour rendre inoffensifs les clichés racistes que l’A., éditeur de Nietzsche, a bien entendu l’honnêteté de citer sans détour (p. 142 sq.). Il n’en demeure pas moins que le renversement nietzschéen des valeurs suppose – malheureusement – de définir le rôle négatif du judaïsme dans la déconsidération du « monde » (p. 145) ; reproche d’ailleurs totalement faux, s’il s’agit de désigner l’origine d’un ascétisme rejetant le monde au profit d’une idéalité. Tout se passe au fond comme si Nietzsche reprochait au judaïsme ce « platonisme pour le peuple » qu’il reproche (un peu moins injustement) au christianisme, tout comme il répugne à l’inversion des valeurs de force et de faiblesse. Oui, le Sermon sur la Montagne exalte l’opprimé : mais c’est moins une revanche des faibles qu’une création, celle de la dignité de chacun.
Demeure au fond de la pensée nietzschéenne, au-delà de ses subtilités innombrables, de ses traits d’esprit éblouissants, de son style foudroyant, un élitisme, un aristocratisme qui saute aux yeux dès lors qu’on le lit en tenant compte de ce que sont devenues finalement l’Europe et nos nations. Il ne s’agit pas d’accuser Nietzsche d’une responsabilité dans ce cours de l’histoire – le présent ouvrage fait définitivement justice de cette accusation – mais tout simplement de lire Nietzsche malgré les errements de ses vues presque « gnostiques » (p. 159) sur le sens de l’histoire : non coupable de nationalisme allemand (cf. Fichte !), Nietzsche n’en demeure pas moins un prophète peu inspiré lorsqu’il s’agit de la « gigantomachie des instincts » (p. 168) ; il l’est davantage lorsqu’il en appelle à l’admiration dionysiaque de ce qui est et de ce qui a été. Selon Nietzsche lui-même, la vraie générosité, la vraie affirmation tient à la volonté de revoir « la réalité telle qu’elle fut et telle qu’elle est, pour toute l’éternité, [celle] qui crie insatiablement da capo » (p. 107).
387Malgré ces réserves, il faut savoir gré à l’A. d’avoir, dans un style d’une précision et d’une élégance rares, donné les outils permettant de lire et de relire Nietzsche en toute connaissance des enjeux relatifs à la race ou aux peuples. On notera enfin que toutes les traductions de Nietzsche sont de l’A. (p. 21), et qu’elles font un très un large usage du Nachlass (les mentions FP en note désignent selon l’usage les Fragments posthumes, suivi du numéro indiquant la position du manuscrit dans l’édition incontournable de Colli et Montinari, désormais accessible en ligne).
Daniel Frey
Myriam Revault d’Allonnes, L’esprit du macronisme ou l’art de dévoyer les concepts, Paris, Seuil, coll. « La couleur des idées », 2021, 102 pages, ISBN 978-2-02-146507-5, 16 €.
Ce n’est pas la première fois que la philosophe Myriam Revault d’Allonnes, professeure émérite des universités à l’EHESS et chercheuse associée au CEVIPOF, se livre à un exercice d’interprétation de l’actualité de notre situation politique. Elle avait déjà abordé la notion de crise (La crise sans fin, Seuil, 2012) ou l’apparition de la notion de post-vérité (La Faiblesse du vrai. Ce que la post-vérité fait à notre monde commun, Seuil, 2018 ; cf. notre recension dans RHPR 99/3, 2019, p. 433-434). L’exercice qu’elle se propose ici est toutefois différent, et sans doute plus délicat, puisqu’il s’agit d’interpréter à chaud la notion de « macronisme ». L’ouvrage, rédigé durant la crise sanitaire de 2020, paru en 2021, se rapporte bien évidemment au premier mandat d’Emmanuel Macron. La philosophe y explique d’emblée : « j’ai voulu aborder cet objet insaisissable qu’est le “macronisme”, son discours, ses équivoques, son art de gouverner, son rapport à l’époque. Non pas tant sa doctrine que son adhérence à l’esprit du temps. Dans quel univers mental s’inscrit-il ? À quel style de vie (way of life) renvoie-t-il ? » (P. 7).
Malgré cette déclaration d’intention, malgré surtout le bandeau accrocheur de l’éditeur reproduit dans la fiche de presse, portant « Les mirages du président philosophe », le lecteur ne doit pas s’attendre à trouver dans ce petit ouvrage une analyse politique du « macronisme ». Certes, il est bien évidemment fait référence aux discours du Président de la République, tel celui du 15 juin 3882017, dans lequel Emmanuel Macron, devant des entrepreneurs du numérique, affiche son intention faire de la France une « start-up nation » – comprenez une « nation où chacun peut se dire qu’il pourra créer une start-up » (p. 49). De fait, les références directes à de tels discours sont finalement peu nombreuses, et leurs analyses sémantiques d’ailleurs à peine esquissées.
Ce qui constitue l’essentiel du propos, c’est plutôt la relecture des philosophes que Myriam Revault d’Allonnes fréquente de longue date, comme Rousseau, Kant, Arendt, Ricœur ou encore Foucault, ce dernier fournissant d’ailleurs à l’A. le cadre théorique lui permettant de situer le « macronisme », réalité plastique et multiforme, dans le cadre du néolibéralisme. Elle estime en effet que le néolibéralisme ne fait pas qu’appeler à moins d’État, mais qu’il enjoint surtout chacun à faire de lui-même « une sorte d’entreprise permanente d’entreprise multiple », comme Foucault l’écrivait déjà dans Naissance de la biopolitique. C’est là un dévoiement fâcheux de la notion d’autonomie chère aux Lumières ! L’A. appelle de ses vœux un retour aux promesses non tenues de ce concept décisif, dévoyé par la vision ultralibérale de la société depuis l’invention de l’idéologie décomplexée de Margaret Thatcher jusqu’au « macronisme », version trop séduisante du même libéralisme.
Daniel Frey
Yann Schmitt, Religions et vérité. De la pluralité au scepticisme, Paris, CNRS Éditions, coll. « CNRS Philosophie », 2021, 389 pages, ISBN 978-2-271-11977-3, 25 €.
Un certain nombre d’ouvrages de philosophie de la religion sont parus ces derniers temps. Plus original, celui-ci propose une recherche en philosophie des religions. Issu d’une monographie jointe au dossier présenté par l’A. en vue de l’habilitation à diriger des recherches, il interroge les raisons de croire en contexte de pluralité religieuse, c’est-à-dire en situation épistémique de concurrence entre plusieurs prétentions incompatibles à la vérité : lorsque les croyances en présence ne peuvent rigoureusement pas être tenues pour vraies ensemble.
L’A., professeur en classes préparatoires, fait donc le choix d’arrimer croyance religieuse et vérité. Il se donne pour règle 389méthodologique un « principe de charité interprétative » (p. 22), selon lequel une croyance ne pèche pas nécessairement par défaut aveugle de rationalité, de cohérence ou de recul critique. Il adopte une épistémologie qui récuse le diktat de la vérifiabilité, présupposé positiviste ou naturaliste n’acceptant l’étude de l’homme que selon les méthodes des sciences de la nature et exigeant que tout fait cru soit expérimentable et empiriquement accessible. Enfin, il prend au sérieux les régulations internes à chaque religion, avalisant la signification de sa foi pour le croyant lui-même et se refusant à sous-estimer la place du doute dans la croyance. L’A. fait donc l’apologie d’une approche « aléthique » (p. 32), qui table sur la rationalité de la prétention des croyances à la vérité et ne craint pas de discuter de la vérité et de la fausseté des croyances religieuses.
C’est fort de ces options de bienveillance méthodologique, rationnelles mais non rationalistes, que l’A. s’engage dans une enquête approfondie, faite d’examens circonstanciés des propositions de croyance et de leurs articulations, de développements argumentatifs serrés et d’illustrations parlantes (jouant en particulier d’analogies avec des situations courantes de croyances non-religieuses). Les positions classiques que sont l’exclusivisme, le pluralisme et le relativisme sont successivement exposées et critiquées. L’inclusivisme est simplement mentionné (p. 165, 203), mais non traité, après avoir été un peu rapidement identifié à une forme d’exclusivisme modéré. Au sujet de l’exclusivisme, l’A. distingue à raison une déclinaison épistémique et une version sotériologique (on sait que Karl Barth, non cité dans cet ouvrage, s’inscrivait dans la première tout en récusant la seconde). Le pluralisme et le relativisme sont discriminés selon un critère qui peut sembler aléatoire : plusieurs traditions religieuses sont vraies selon le premier, toutes le sont dans le second cas. Le pluralisme est lui-même dédoublé en un versant réduit aux croyances théistes et un autre aux croyances non-théistes. Pour ce qui concerne le relativisme, l’objection généralement avancée qui pointe la contradiction interne à la thèse se voit ici levée par une distinction entre relativisme des croyances religieuses et non-relativisme des positions épistémologiques dont relève la position relativiste. L’A. examine encore les raisons de croire non plus épistémiques mais pragmatiques, notamment celles qui relèvent d’un pari de type pascalien, selon ses deux versions : sotériologique et herméneutique, mais aussi celles défendues par la pragmatique de James.
390Au terme de l’enquête, l’A. conclut qu’en situation de pluralité religieuse, aucune raison ne permet de justifier le choix de telle ou telle croyance et que le scepticisme religieux s’impose comme la meilleure réponse rationnelle : nous sommes donc invités à suspendre notre jugement. Si cette conclusion peut décevoir, voire susciter un soupçon de raisonnement circulaire à partir d’une hypothèse conclusive, on ne peut qu’être impressionné par l’ampleur et la minutie de l’enquête, servie par une riche bibliographie (Michel Le Du, cité en note p. 25, n’est pas mentionné en bibliographie). Il est néanmoins permis d’adresser à l’A. un certain nombre de remarques critiques.
Au sujet de Kierkegaard, Yann Schmitt reconnaît que la compréhension des religions en général n’est pas son projet (p. 82), avant de lui reprocher sa non-prise en compte de la pluralité religieuse (p. 84). Par ailleurs, l’A. emploie à plusieurs reprises l’expression « saut de la foi » (p. 15, 66, 78, etc.), clairement référée à Kierkegaard même s’il n’est pas toujours nommé, en guise d’illustration indue du fidéisme, faisant ainsi l’économie des différents registres de la raison mobilisés par le penseur danois. En disant que la Trinité n’est qu’une croyance semi-propositionnelle parce que son contenu est inaccessible aux non-théologiens (p. 50-51), l’A. sous-estime le potentiel théologique des « simples » croyants, ainsi que l’effet didactique de la prédication. La fameuse expression « Je sais bien mais quand même » est convoquée pour illustrer la relativisation de l’adhésion religieuse en régime de sécularisation (p. 45), alors qu’à l’inverse Octave Mannoni en avait fait un emblème de la croyance qui se maintient malgré les démentis de l’expérience. L’insistance sur les raisons pragmatiques, plutôt qu’épistémologiques, de croire (p. 323-368) fait peu de cas du motif de la grâce ainsi que des croyances au salut universel. Enfin, on ne saisit pas réellement les justifications de l’intention affirmée par l’A. de « rompre » (p. 15) le cercle existentiel tracé par Paul Ricœur, qui fait du hasard un destin à travers un choix continu. Ne serait-ce pas là précisément la raison décisive d’embrasser et de conserver une tradition religieuse spécifique en contexte de pluralité ?
Ces quelques griefs ne retirent rien aux grandes vertus de ce volume, dont la moindre n’est pas de stimuler la réflexion, l’argumentation et la critique.
Frédéric Rognon
391John Baird Callicott, Genèse. Dieu nous a-t-il placés au-dessus de la nature ? Traduction de Dominique Bellec. Postface de Catherine Larrère, Marseille, Wildproject, coll. « Petite bibliothèque d’écologie populaire » 9, 2021, 109 pages, ISBN 978-2-381140-124, 8 €.
Trente ans après sa parution en anglais et douze ans après sa première traduction, il est heureux de voir la réédition de ce petit essai de l’une des principales figures de la philosophie et de l’éthique environnementales. John Baird Callicott (né en 1941) participe ainsi au bouillonnant débat initié par Lynn White et son fameux article de 1967 : la tradition judéo-chrétienne a-t-elle une part de responsabilité dans la crise écologique actuelle ? White et ses épigones répondaient affirmativement au nom d’une lecture « despotique » de Gn 1 (ce que l’on appelle l’interprétation « de la maîtrise »). Leurs opposants élaboraient une apologétique fondée sur une lecture « gestionnaire » (l’interprétation « de l’intendance »). L’A., s’appuyant sur les intuitions du naturaliste John Muir (1838-1914), défend une troisième interprétation, dite « de la citoyenneté » : les êtres humains ne sont appelés à devenir ni des maîtres tyranniques ni des gestionnaires bienveillants (du reste toujours dominateurs, dans une relation asymétrique de responsabilité), mais des « citoyens » de la nature à égalité avec les autres entités.
L’A. s’appuie, pour étayer sa thèse, sur la distinction entre les deux sources de la Genèse (sacerdotale et yahwiste) pour rattacher la première à la cosmologie présocratique de la philosophie grecque qui lui est contemporaine, et finalement décider d’« oublier » Gn 1 (p. 43) et ne retenir que Gn 2. Dans le récit yahwiste, l’A. relève que l’homme est défini par ce qu’il a en commun avec les animaux : une même origine. Gn 3 marque à ses yeux une rupture avec cette harmonie car la connaissance du Bien et du Mal signifie le pouvoir de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, c’est-à-dire la perception de soi comme centre et l’évaluation des autres en fonction de cette perspective. Selon l’A., le « péché originel » (p. 61) réside dans l’anthropocentrisme et la rupture de l’homme avec la nature dont il faisait jusqu’alors partie. L’idéologie sacerdotale ressurgit alors en Gn 9 pour faire de ce que le récit yahwiste condamnait comme péché originel une vertu anthropologique. Et les compilateurs de l’Ancien Testament ont placé le texte sacerdotal avant la narration yahwiste pour résister à l’anti-anthropocentrisme de cette dernière et justifier la civilisation agricole.
392En conséquence de cette lecture, une éthique environnementale judéo-chrétienne de la citoyenneté est possible car, dans le projet de Dieu, les êtres humains ont été créés pour faire partie de la nature et non pour en être séparés : citoyens de la communauté biotique, ils sont invités à coopérer avec la nature, en rendant compatibles leurs droits avec ceux des autres créatures.
Sans opposer bien entendu à l’A. les acquis de la recherche exégétique depuis trente ans, on peut tout de même pointer les présupposés qui orientent puissamment son interprétation. C’est ainsi qu’il néglige toute dimension dialectique à la juxtaposition de Gn 1 et Gn 2, et oublie d’interroger sérieusement les conditions de la constitution du canon. Projetant des considérations modernes sur les intentions des rédacteurs, il sous-estime l’écart entre le premier chapitre de la Genèse et les représentations contemporaines de la Grèce et du Proche-Orient ancien, et délaisse la signification que pourrait endosser la nomination des animaux dans le second chapitre.
Il n’empêche que l’on se doit de saluer l’effort mené par l’A. pour dessiner un sentier novateur dans le maquis des joutes théologiques et philosophiques inaugurées par la conférence fondatrice de Lynn White, et, comme le montre avec brio la postface de Catherine Larrère, pour tenter d’asseoir une éthique philosophique de l’environnement sur un socle susceptible de rassembler croyants et non-croyants.
Frédéric Rognon
VIENT DE PARAÎTRE
Gérard Siegwalt, Rétrospective d’un théologien, Paris, Cerf, coll. « Cerf-Patrimoines », 2022, ISBN 978-2-204-15132-0, 234 pages.
Cet écrit est une sorte de postscriptum, un éclairage après coup de ce qui était à l’œuvre avant. Un postscriptum comme introduction au chantier d’une vie.
Non une autobiographie, mais un essai de rendre compte de ce qui a été au cœur d’une vie de théologien placée sous le signe de la responsabilité théologique.
393Une sorte de boîte à outils, fournissant les clés principales pour la compréhension d’une pensée considérée parfois comme difficile, alors qu’elle consiste en 1. une exploration du réel, avec ses déterminismes et ses possibilités, 2. dans la force et avec le critère de discernement de la tradition de foi judéo-chrétienne, 3. à l’école du guide intérieur en qui le réel d’un côté, le message des Écritures bibliques de l’autre côté, se conjoignent.
Gérard Siegwalt