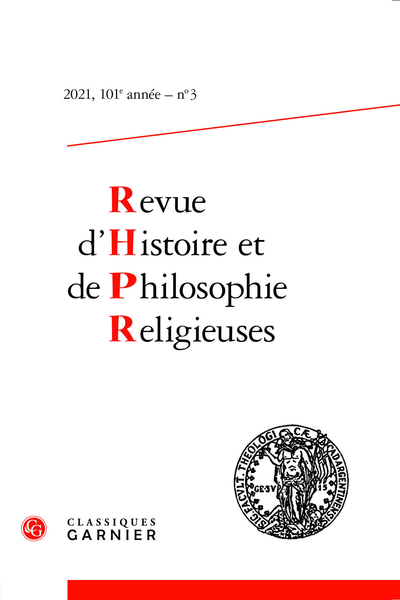
Revue des livres
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses
2021 – 3, 101e année, n° 3. varia - Auteurs : Rognon (Frédéric), Cottin (Jérôme), Vial (Marc), Gounelle (Rémi), Arnold (Matthieu), Heck (Christian), Noblesse-Rocher (Annie), François (Philippe), Dean (Jason), Frey (Daniel)
- Pages : 351 à 441
- Revue : Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses
- Thème CLIL : 4046 -- RELIGION -- Christianisme -- Théologie
- EAN : 9782406123385
- ISBN : 978-2-406-12338-5
- ISSN : 2269-479X
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12338-5.p.0071
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 08/09/2021
- Périodicité : Trimestrielle
- Langue : Français
REVUE DES LIVRES
THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE (SUITE)
Éthique
Stéphane Lavignotte, André Dumas. Habiter la vie. Préface d’Olivier Abel, Genève, Labor et Fides, 2020, 368 pages, ISBN 978-2-8309-1723-9, 24 €.
Éthicien protestant français de tout premier plan durant le dernier tiers du xxe siècle, André Dumas (1918-1996) est aujourd’hui passablement oublié. Serait-ce que la discipline qu’il enseigna à l’Institut protestant de théologie (Faculté de Paris) de 1961 à 1984 est trop étroitement liée aux questionnements de son temps ? C’est tout le mérite de l’A., par la publication de sa thèse de doctorat, de nous montrer qu’il n’en est rien et qu’il importe de revisiter les paroles et les textes d’André Dumas pour affronter les défis d’aujourd’hui avec la justesse de la posture éthique qu’il nous a léguée.
L’ouvrage, préfacé par Olivier Abel, s’ouvre sur une évocation de la trajectoire biographique d’André Dumas, se poursuit avec la présentation des auteurs et courants théologiques qui l’ont inspiré (Karl Barth et Dietrich Bonhoeffer principalement, mais aussi Nietzsche), avant de décliner différents lieux thématiques de réflexion et d’engagement (le dialogue avec le marxisme, l’écologie balbutiante, la libéralisation de la contraception et de l’avortement, les questions de la fin de vie et l’euthanasie, l’éthique sexuelle et familiale) ; il s’achève sur une analyse des spécificités de l’éthique d’André Dumas et du statut de l’intellectuel chrétien dans la cité.
La démarche éthique d’André Dumas est d’abord une prise en compte de la réalité : loin des principes abstraits (tels que la loi naturelle), elle part des dilemmes moraux tels qu’ils sont vécus 352par les personnes concrètes, notamment, pour ce qui concerne la bioéthique, par les femmes et par les couples. Ce qui conduit nécessairement à une éthique de type dialectique, chargée d’endurer les contradictions profondes propres à toute situation réelle ; l’exemple de l’avortement est à cet égard emblématique. Penser la morale dans la complexité de la réalité n’empêche cependant nullement de prendre courageusement position : il s’agit, dans une situation mauvaise, de discerner le préférable, sinon le meilleur, plutôt que le moindre mal, au sein du relatif. Ainsi le respect de la vie n’est-il qu’une valeur parmi d’autres, qui ne saurait être érigée en principe surplombant : s’il n’y a jamais de solution idéale, l’éthicien choisit d’assumer le conflit des valeurs sur le mode de la responsabilité. L’accès libre à la contraception est l’expression d’une parentalité responsable, qui dégage le couple de sa réduction à une fonction de reproduction. Mais le refus de sacraliser la vie conduit également André Dumas à défendre le droit d’habiter sa mort. L’éthique d’André Dumas est par conséquent, au regard de l’A., une éthique « embarquée, empathique, courageuse » (p. 237).
À partir de l’exemple d’André Dumas, l’A. dégage une « éthique de l’éthique » : « une éthique de la façon de construire l’éthique et la parole publique de l’éthicien » (p. 33). En régime de laïcité, l’intellectuel chrétien, libéré du pouvoir de tout argument d’autorité, met ses ressources théologiques à disposition de tout un chacun dans le débat public.
S’il n’émet guère de critique à l’encontre du penseur dont il rend compte (sauf lorsqu’il lui reproche de ne connaître que la version orthodoxe du marxisme, celle d’Althusser, et fort peu l’œuvre de Gramsci ou d’Ernst Bloch, p. 130-131), l’A. met en valeur la fécondité de l’œuvre d’André Dumas. On lui saura gré d’offrir ainsi au lecteur la première étude académique d’ampleur consacrée à celui dont le moindre paradoxe n’aura pas été de proposer, entre les voies classiques de l’ascétisme extra-mondain et intra-mondain, « un ascétisme pro-mondain » (p. 153).
Frédéric Rognon
353Théologie fondamentale
Denis Hétier, Éléments d’une théologie fondamentale de la création artistique. Les écrits théologiques sur l’art de Karl Rahner (1954-1983). Préface de Vincent Holzer, Leuven – Paris – Bristol (CT), Peeters, coll. « Bibliotheca ephemeridum theologicarum Lovaniensium » 307, 2020, xxv + 492 pages, ISBN 978-90-429-4162-5, 104 €.
L’importance de cette thèse pour l’élaboration d’une théologie des arts ainsi que son caractère novateur justifie la longueur de cette recension. L’A., qui est l’actuel Directeur de l’Institut supérieur de théologie des Arts du Theologicum de l’Institut catholique de Paris – par ailleurs lui-même artiste –, a choisi de s’intéresser, dans une démarche de théologie fondamentale, à Rahner plutôt qu’à Balthasar, beaucoup plus travaillé sous cet aspect. Il a en effet découvert – et c’est une nouveauté à souligner – que, malgré les apparences, on trouve bien dans son œuvre une théologie des arts – ou plus précisément de la création artistique –, que ni Rahner lui-même ni la théologie allemande n’ont mise en valeur. Quant à la théologie francophone, elle ignore d’autant plus cet aspect que la quasi-totalité des textes ici analysés ne sont pas traduits en français. Il serait à souhaiter qu’un autre tome paraisse, avec l’édition en français des textes rahnériens commentés dans le présent ouvrage.
Après avoir étudié, dans un précédent travail non publié, la manière dont l’anthropologie et la théologie transcendantale du jésuite allemand pouvaient rendre compte de la profondeur de l’acte de création artistique, l’A. fait un pas de plus en découvrant et en exploitant des textes du théologien natif de Fribourg, directement en lien avec les arts (la poésie et la littérature surtout, mais également – et plus tardivement – la musique et les arts visuels). Paradoxalement, l’intérêt de ces textes réside dans leur hétérogénéité et leur caractère circonstanciel, Rahner ayant privilégié une approche de théologie pratique même si, pour finir, il s’agit bien d’une réflexion de nature systématique. D’où cette évolution que l’A. met en évidence, qui part d’une théologie pratique de l’art pour poursuivre en direction d’une théologie fondamentale de l’art, avant d’aboutir à « des éléments » d’une théologie fondamentale de la création artistique. Cette modification de la terminologie veut rendre compte de l’évolution de la pensée de Rahner sur les arts : elle part d’une tension entre art et théologie, la première constituant 354la question et la seconde la réponse, pour arriver à une certaine osmose entre ces deux disciplines, la notion d’expérience, qu’elle soit artistique ou religieuse, pouvant convenir à l’une comme à l’autre.
Le corpus retenu, soigneusement commenté, consiste en une douzaine d’écrits s’étendant de 1954 à 1983, auxquels il faut rajouter un treizième datant de 1958, « Y a-t-il un art chrétien ? », conservés dans des notes d’étudiants. Ces articles sont présentés de manière à la fois chronologique et thématique, ce qui permet d’éviter les répétitions et de mieux faire apparaître les évolutions, autour des six thèmes suivants : 1) l’artiste dans sa relation à la Trinité économique ; 2) la parole poétique et la Parole de Dieu ; 3) l’écrivain dans son acte de création littéraire et son rapport anonyme au christianisme ; 4) les liens entre les arts et le discours théologique ; 5) l’image en tant que médiation effective de l’expérience religieuse dans le cadre d’une prise en compte de la sensibilité humaine ; 6) les liens entre les arts et la vie des communautés croyantes.
Pour tout théologien s’intéressant aux questions artistiques et plus précisément aux arts visuels, les trois textes centraux de Rahner sont « De l’ouïe à la vue. Réflexion théologique » (1969), « L’art dans l’horizon de la théologie et de la dévotion » (1982) et « La théologie de la signification religieuse de l’image » (1983). Sans pouvoir entrer dans l’ensemble des problématiques ouvertes par ces textes, on soulignera l’importance de la notion de « plénitude non vue du visible » (die ungeschaute Fülle des Schaubaren) qui libère l’image des limitations d’une relation analogique au réel et l’ouvre dans le même temps à un non-visible, présent dans sa matérialité même. L’art non figuratif (plutôt qu’« abstrait ») devient un médiateur possible – et peut-être plus sûr qu’une image religieuse – d’une transcendance. En revanche, on ne comprend pas très bien pourquoi le symbole ne pourrait fonctionner que sur la base de l’analogia entis (p. 178) et non sur celle – qui nous semble plus moderne et plus pertinente théologiquement – de l’analogia relationis.
La présentation de ces textes constitue la première et la plus importante partie de l’ouvrage (p. 23-344). Elle est suivie d’une seconde partie, plus brève (p. 345-468), dans laquelle, à partir des thèmes rahnériens, l’A. propose une esquisse, en cinq étapes, d’une théologie fondamentale de la création artistique : 1) le théologien possède une réelle compétence dans le domaine des arts, différente de celle des artistes et des spécialistes, pour autant qu’il articule sa réflexion à la question du sensible ; 2) l’expérience artistique est 355une manière de prendre au sérieux la dimension anthropologique autant que l’acte transcendantal de la foi ; 3) le rapport entre l’art et la notion de transcendance est ensuite exploré dans un sens autre que celui, traditionnel, de la métaphysique chrétienne ; sont ensuite détaillés 4) les rapports entre l’art et le christianisme, puis, pour finir, (5) ceux entre l’art et la théologie.
L’A., théologien mais aussi sculpteur, est particulièrement sensible aux ressources spirituelles et aux effets plastiques de l’art contemporain. Il n’hésite pas à actualiser son étude par des observations faites à partir d’artistes récents (Yves Klein, Marina Abramovic, Henri Cartier-Bresson) dont la démarche artistique peut être comprise – même s’ils ne sont pas chrétiens – comme une confirmation des fondamentaux théologiques de Rahner appliqués à l’art. Des philosophes et en particulier des phénoménologues comme Henry Maldiney, Michel Henry, Gaston Bachelard, Gilbert Durand et Georges Didi-Hubermann, permettent à l’A. de prolonger certaines pensées du théologien d’Innsbruck ; on s’étonnera toutefois de l’absence de Jean-Luc Marion ou de Jean-Luc Nancy. Parmi les thèmes finement étudiés, notons : l’acte de création artistique (à distinguer de celui de la contemplation ou de la réception) ; la dimension du sensible importante pour l’artiste comme pour le croyant ; l’autonomie de l’art ; les relations de rupture et de continuité entre art contemporain et art chrétien ; l’expérience religieuse à partir d’une image non religieuse ; l’imaginaire et le symbolique en deçà de la parole (valorisation d’une pensée pré-conceptuelle).
Le théologien protestant, qui a généralement tendance à se méfier des approches fondamentales sur l’art en théologie catholique, car celles-ci, en général inspirées par Romano Guardini, Hans Urs von Balthasar ou Jacques Maritain, font la part trop belle au thomisme ou au néo-thomisme, à l’ontothéologie, à la sacramentaire ou à la liturgique, sera reconnaissant de cette ouverture. La présente étude montre que Rahner explore d’autres voies que celle d’une esthétique théologique, plus compatibles avec une théologie du kérygme et de la Parole, et venant utilement compléter en les précisant les réflexions théologiques de Paul Tillich sur l’art. Une théologie de la Parole ouverte aux images (visions), une théologie inculturée, une exploration des capacités spirituelles de l’imaginaire, une approche herméneutique des textes bibliques ainsi que le pouvoir figuratif du langage poétique (Ricœur) rentreraient tout à fait dans le cadre d’une théologie protestante ouverte aux images. L’A. nous réconcilie 356également avec les notions de transcendantalité et de métaphysique, repensées à l’aide des concepts rahnériens et heideggériens. Les bases sont ainsi jetées pour une « théologie figurative » que l’A. appelle de ses vœux.
Jérôme Cottin
Dogmatique
Robert W. Jenson, Esquisse d’une théologie. Ces ossements peuvent-ils revivre ? Transcrit, édité et introduit par Adam Eitel. Traduit par John E. Jackson, Genève, Labor et Fides, coll. « Résonances théologiques », 2020, 185 pages, ISBN 978-2-8309-1716-1, 18 €.
Récemment fondée au sein des Éditions Labor et Fides, la collection « Résonances théologiques » vise à montrer la vitalité de la réflexion théologique contemporaine en mettant à la disposition du public des ouvrages qui coulent un propos consistant dans un langage accessible. À l’heure où ces lignes sont écrites, quatre volumes ont été publiés : un livre inédit (le dernier ouvrage en date de Gérard Siegwalt ; voir RHPR 101, 2021, p. ###-###) ainsi que trois ouvrages traduits : Tokens of Trust, publié en 2007 par l’ancien archevêque de Cantorbéry Rowan Williams et traduit sous le titre Une introduction à la foi chrétienne (2019) ; l’influent livre Tod d’Eberhard Jüngel, publié en 1971 et désormais disponible en langue française (La mort, 2021) ; le volume ici recensé.
Ce dernier est dû à l’important théologien américain Robert Jenson (1930-2017), dont la Systematic Theology a fait l’objet d’une traduction dans la langue de Molière aux Éditions L’Harmattan grâce aux bons soins de Serge Wüthrich (2016 et 2019 ; voir RHPR 98, 2018, p. 194-197). Fruit d’un cours donné en 2008 aux étudiants de premier cycle de l’Université de Princeton, ce volume aux dimensions modestes balaye les grands thèmes de la dogmatique en dix brefs chapitres.
Le sous-titre est emblématique du propos de l’A, ainsi qu’il l’indique lui-même dans le premier chapitre. La question posée à Ézéchiel (« Fils d’homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? ») est en effet celle qui fonde la théologie chrétienne et qui se pose à elle : 357dans quelle mesure peut-elle être pertinente sur le plan intellectuel et existentiel dans le contexte de l’Occident post-chrétien ? Les chapitres deuxième et troisième, consacrés respectivement à Israël et à la résurrection du Christ, montrent que cette dernière constitue la réponse à la question d’Éz 37,3. Le propos sur la résurrection culmine dans une interprétation stimulante du motif du « ciel » (où le Ressuscité se trouve), élaborée à la lumière de celui de la basileia tou theou : l’A. propose de concevoir ce motif d’ordre spatial en termes temporels : « Les cieux sont l’avenir que vise Dieu, le Royaume de Dieu. » (P. 66.)
Les chapitres suivants suivent l’ordre classique d’une brève présentation d’ensemble de la doctrine chrétienne, qui abordent successivement la Trinité (chap. 4), la création et le motif de l’imago Dei (chap. 5 et 6), le péché et le salut (chap. 7), puis l’Église (chap. 8). Le développement relatif à l’être trinitaire de Dieu, particulièrement suggestif, condense les réflexions menées dans la Systematic Theology au sujet des trois hypostases, conçues comme autant de dramatis personae : contrairement aux divinités grecques, mais aussi au Dieu des modalistes, le Dieu d’Israël et de Jésus Christ se compromet dans l’histoire, en étant tout à la fois l’auteur, un acteur et le « vent », si bien que chacune des personnes constitue « une identification parfaite et complète du Dieu unique » (p. 81). On appréciera également le traitement auquel l’A. soumet la notion d’imago Dei. Se fondant sur la thèse selon laquelle l’identité personnelle des Trois de la Trinité précède leur essence, il conçoit foncièrement l’être humain en tant qu’il est créé par Dieu à son image comme celui à qui un rôle spécifique est confié, rôle qui détermine sa nature. Ce rôle est celui d’un « partenaire de conversation avec Dieu » (p. 112), le Créateur qui appelle à l’être en adressant une parole, si bien que l’être humain peut théologiquement être défini comme un « animal qui prie » (p. 113). Un tel protocole, qui se refuse à donner à la notion de nature une importance première (évitant ainsi de définir la personne humaine à partir de « compétences », et donc d’exclure de la classe des « personnes » les individus qui en sont dépourvus), ne l’évacue pas pour autant, s’opposant ainsi d’emblée aux conséquences possibles des théories s’avançant comme « antispécistes » : « un aspect notable du récent nihilisme moderne, qu’on voit régulièrement affirmé (mais jamais démontré), est qu’un être humain n’est pas différent, disons, d’un être 358bovin. On avance cela d’habitude comme une raison de traiter les vaches selon les […] critères par lesquels nous réglons nos relations les uns avec les autres. Mais traiter les vaches comme nous nous traitons les uns les autres veut dire aussi que nous pouvons nous traiter les uns les autres comme nous traitons les vaches » (p. 107-108). Après avoir fait valoir que « le péché n’est rien de moins qu’une rébellion contre ce que nous sommes » (p. 122), l’A. expose les différents modèles classiques de la réconciliation (at-one-ment), avant d’esquisser son interprétation propre qui, puisant tant à la pensée de Balthasar qu’à celle de Luther, conçoit la libération de l’être humain en termes de participation (par la foi) au drame par lequel le péché et la mort sont transcendés en tant qu’ils sont assumés par le Crucifié ressuscité. Le chapitre consacré à l’Église, qui consiste essentiellement en un commentaire des quatre notae Ecclesiae, la conçoit comme le lieu dans lequel le Ressuscité se rend disponible pour le monde par la communion à son corps qui, comme tout corps, est ce par quoi une personne se rend disponible.
Le neuvième et dernier chapitre esquisse la réponse à la question d’Ézéchiel telle qu’elle se pose à la théologie chrétienne : cette dernière ne parviendra à montrer sa pertinence qu’en mettant en évidence la « plausibilité interne » de la foi (p. 181) et en prolongeant le geste de Pannenberg consistant à élaborer une métaphysique propre à l’Évangile, c’est-à-dire prenant son point de départ non dans ce qui a été mais dans ce qui sera – dans l’eschatologie, donc.
On le voit : la dimension modeste de cet ouvrage ne saurait offusquer son importance. On le recommandera donc non seulement aux étudiants en théologie mais également aux théologiens plus chevronnés. On le recommandera même à ceux d’entre eux qui enseignent. Car si Jenson est un auteur, il a surtout voulu être et il a surtout été un professeur : lui-même le dit, et ce livre le montre à chaque page. En le refermant, on se prend à rêver d’être un jour capable de donner un cours comme celui dont on vient de lire l’épure.
Marc Vial
359Karl Barth, Avent. Traduction de Pierre Maury et Edmond Jeanneret, Genève, Labor et Fides, coll. « Œuvres », 2019, 95 pages, ISBN 978-2-8309-1702-4, 12 €.
Karl Barth, Esquisse d’une dogmatique. Traduction de Fernand Ryser et Édouard Mauris. Introduction de Hans-Christoph Askani et Christophe Chalamet, Genève, Labor et Fides, coll. « Œuvres », 2019, 206 pages, ISBN 978-2-8309-1676-8, 19 €.
Les Éditions Labor et Fides poursuivent avec ces deux volumes leur campagne de réédition de traductions françaises d’ouvrages de Barth devenues introuvables en librairie, entamée avec la publication en 2016 de L’Épître aux Romains (voir RHPR 99, 2019, p. 437-438), à la différence près que ces deux ouvrages ne consistent pas en un reprint, le texte ayant, dans chaque cas, été recomposé.
L’Esquisse d’une dogmatique est trop célèbre pour qu’on la présente ici. Tout juste rappellera-t-on que cet ouvrage est le fruit d’un cours donné à Bonn en 1946, dont la trame est fournie par le Symbole des Apôtres et dont la section consacrée au deuxième article met déjà en œuvre le mouvement majestueusement orchestré dans le volume IV/1 de la Dogmatique (1953), le chemin descendant parcouru par le Christ (incarnation, souffrance, mort, descente aux enfers – via exinanitionis) étant de part et d’autre conçu comme l’abaissement de Dieu et le chemin ascendant (résurrection et ascension – via exaltationis) comme l’élévation de l’homme.
Le volume Avent est moins connu. Issu de quatre études bibliques portant sur Lc 1,5-80 et données en 1934, sa version originale a été publiée dans la revue Theologische Existenz heute l’année suivante et a fait l’objet d’une traduction française (Genève, Roulet, Collection du Centre protestant d’études) en 1948. C’est cette traduction qui est ici reprise. Il n’est pas déraisonnable de lire ces pages comme une méditation sur l’Église, tant le thème est récurrent. C’est ainsi que le mode de vie distinct de Jean le Baptiste, signe visible de sa mission, est lié à la visibilité de l’Église : « l’Église ne peut demeurer invisible dans le monde ; toujours une visibilité – peut-être très étrange, très choquante, très discutable – correspond à son invisibilité » (p. 21). De manière moins étonnante, le mystère de Marie est présenté comme celui de l’Église, à ceci près que la Vierge n’est « pleine de grâce » que dans l’exacte mesure où elle est « bienheureuse par la grâce ». Le Magnificat est, par suite, compris comme la réponse de l’Église à la promesse donnée. Et comment ne 360pas entendre, dans l’interprétation que donne Barth de l’étonnement ressenti par Zacharie devant le choix divin de faire de son fils un témoin, la voix de celui qui, la même année (1934), a été le principal rédacteur de la Confession théologique de Barmen et qui, un peu plus tard, allait refuser de prêter le serment d’allégeance au Führer : « Le témoin, c’est quelqu’un qui n’est plus dans le rang, qui a quitté la file où les hommes ont l’habitude de se tenir serrés les uns contre les autres, marchant tous ensemble d’un même pas ; c’est quelqu’un qui suit un autre chemin, peut-être même un chemin opposé […]. Tout à coup, devant lui, et grâce à un seul homme mis à part, ils en viennent à se poser la vraie question ! Au fond, où en sommes-nous nous-mêmes ? » (P. 86.) Cet ouvrage se ressent donc du contexte qui l’a vu naître, si bien que l’on ne s’étonnera pas de ce que la foi soit présentée à plusieurs reprises en lien avec la peur. Reste que bien des traits de ces études bibliques transcendent l’époque de leur composition. En un temps, comme le nôtre, où l’expression « recherche de Dieu » est surtout comprise au sens où « Dieu » a valeur de génitif objectif, il n’est sans doute pas inutile de lire, sous la plume de celui qui a précisément redonné à Dieu son rang de sujet (dans tous les sens du terme) : « La grâce, c’est justement que Dieu ait trouvé un être qui ne le cherchait pas » (p. 38).
Marc Vial
Paul Tillich, Quand les fondations vacillent. Textes traduits par André Gounelle et Mireille Hébert, Genève, Labor et Fides, coll. « Œuvres », 2019, 214 page, ISBN 978-2-8309-7, 22 €.
The Shaking of the Foundations constitue le premier des recueils de sermons prononcés par Paul Tillich dans le cadre de son enseignement aux États-Unis. Publié en 1948, il rassemble des prédications que l’A. a assurées au Union Theological Seminary de New York sur une période s’étendant des dernières années de la Seconde Guerre mondiale aux premiers lendemains de celle-ci. Une première traduction française avait vu le jour en 1967 sous le titre Les fondements sont ébranlés – elle est épuisée depuis lors. Aussi faut-il remercier André Gounelle et Mireille Hébert, traducteurs patentés de l’œuvre de Tillich, d’avoir remis ces textes à disposition des lecteurs francophones en en proposant une version nouvelle.
361Ainsi que les traducteurs le soulignent dans leur « Avant-propos », nombre d’éléments thématisés ultérieurement dans les ouvrages « académiques » de l’A. se rencontrent d’ores et déjà dans ce volume. Tel est le cas de la dimension apologétique de la pensée de Tillich : revendiquée comme une marque de la théologie dans la Théologie systématique, elle est ici mise en œuvre sur le plan de la prédication d’une manière d’autant plus assumée que les auditeurs de Tillich ne fréquentaient habituellement pas tous les bancs des églises. La caractérisation de la théologie comme discipline portant sur ce qui préoccupe l’être humain de manière ultime, magistralement traitée dans la Théologie systématique, est également de mise dans la série de trois prédications réunies sous le titre « Le théologien » (no 15). Le motif de l’Être nouveau (qui exprime l’être christique de Jésus selon l’A.) est lui aussi récurrent, implicitement ou explicitement (voir no 11, 15, etc.). Il n’est pas jusqu’au sermon prononcé sur la providence (no 12), que Tillich voit portée en langage en Rm 8,38-39, qui n’annonce les développements, certes plus nourris, qui figurent dans la Théologie systématique. On reconnaîtra pour finir sans peine l’épure du dernier chapitre du Courage d’être dans la magnifique prosopopée que constituent les lignes suivantes : « “Tu es accepté. Tu es accepté, accepté par ce qui est plus grand que toi et dont tu ne connais pas le nom. Ne cherche pas à connaître ce nom maintenant, peut-être le découvriras-tu plus tard. […] Ne cherche rien, n’accomplis rien, ne projette rien. Accepte simplement le fait que tu sois accepté.” Si cela nous arrive, nous faisons l’expérience de la grâce. » (No 19, p. 186-187.)
Il s’en faut cependant, et de beaucoup, que la lecture de ce volume permette uniquement aux personnes plus ou moins familières de l’œuvre de Tillich d’y retrouver, sous une forme simplifiée, ce qu’elles ont pu lire ailleurs. Ces prédications, précisément parce qu’elles ont par définition vocation à laisser sourdre la Parole de Dieu de la lettre biblique, mettent en évidence la sève scripturaire qui innerve la pensée de l’A., lors même que ses écrits plus techniques ne font que rarement référence, explicitement à tout le moins, au corpus biblique. Et, last but not least, elles donnent à vérifier, si besoin était, qu’un grand théologien est toujours doublé d’un maître spirituel. Deux exemples suffiront. Le premier touche au Notre Père. « Tout un chacun peut dire la prière du Seigneur ; chaque jour on la récite des millions et des millions de fois. Mais parmi ceux qui la disent, combien ont reçu le pouvoir de la prier ? […] Les chrétiens 362oublient que pour invoquer Dieu comme Père, on doit chaque fois surmonter l’hostilité envers lui, et que seul l’Esprit peut donner la certitude extatique d’être ses enfants. Ceux qui sont en dehors du christianisme le savent souvent mieux que ceux qui en font partie. Ils ont conscience du paradoxe et de l’impossibilité d’appeler Dieu “Père”. » (No 16, p. 158-159.) Le second exemple a trait au motif de l’attente de Dieu : « Pour nous, il est Dieu précisément parce que nous ne le possédons pas. Le psalmiste dit que son être tout entier attend le Seigneur ; il indique ainsi qu’attendre Dieu n’est pas simplement un aspect de notre relation avec lui, mais plutôt ce qui la conditionne tout entière. Nous avons Dieu en ne l’ayant pas. » (No 18, p. 174-175.)
Marc Vial
Bernard Hort, Gérard Siegwalt. Un protestantisme inclusif, Bruxelles, Academic and Scientific Publishers, 2017, 115 pages, ISBN 978-90-5718-656-1, 20 €.
Ce petit livre propose une introduction empathique à l’œuvre de Gérard Siegwalt. L’ouvrage est empathique : l’A. ne cache pas l’admiration qu’il voue au théologien strasbourgeois, ne lui adressant jamais aucune critique, allant même jusqu’à le remercier à deux reprises (p. 48, 77) et n’hésitant pas à dire de lui que, contrairement à nombre d’universitaires qui se sont penchés sur la mystique, il va, en la matière, à l’essentiel (p. 89). Il s’agit là d’une introduction qui, loin de s’atteler à la tâche, impossible, de résumer en une centaine de pages à la typographie aérée les dix volumes de la Dogmatique pour la catholicité évangélique et les cinq volumes d’Écrits théologiques, entend constituer une « mise en appétit » (p. 15), c’est-à-dire disposer à la lecture des textes de Siegwalt, en mettant en perspective les présupposés et les thèmes principaux de la théologie qui s’y trouve déployée. L’ouvrage procède en trois temps principaux, qui dégage les « axes thématiques » de la pensée du théologien alsacien, en montre la « portée civile et sociale », avant de s’interroger sur sa « pertinence actuelle ».
Tenant que l’œuvre de Siegwalt recèle un potentiel œcuménique incontestable, l’A. met très clairement en évidence la singularité de la voie tracée par le théologien de Strasbourg au sein du 363protestantisme contemporain : cependant que ce dernier, dans la lancée de la théologie barthienne, avait surtout mis l’accent sur le mouvement par lequel Dieu descend vers l’être humain, Siegwalt a voulu faire droit au mouvement inverse : celui, ascendant, que constitue « l’itinéraire de l’homme vers Dieu et en Dieu » (p. 99) – on aura noté la référence au traité de Bonaventure. D’où l’inclusion – Siegwalt parlerait sans doute plus volontiers de récapitulation – des réalités de l’existence humaine dans une théologie qui, tout en étant dogmatique, est également pastorale et spirituelle de bout en bout, orientée qu’elle est vers le « devenir humain ». L’A. insiste également, à très juste titre, sur les efforts déployés par Siegwalt pour contrecarrer les approches unilatérales auxquelles la pensée occidentale a, selon lui, succombé : le « rétrécissement “acosmique” de la culture occidentale » (p. 33), l’oubli de la « dimension invisible du réel » (cf. p. 41), la compréhension (plus particulièrement protestante) du péché comme dépravation de la nature humaine – cependant que Siegwalt voit surtout en lui une « fuite de soi » (cf. p. 45 sq.).
On s’étonne cependant du peu de place que cette introduction à l’œuvre d’un dogmaticien ménage à l’aspect proprement doctrinal de sa pensée. Quelques lignes seulement sont consacrées à la théologie trinitaire de Siegwalt (p. 55 sq.), dans lesquelles il est question de la portée d’une triadologie, non du contenu de celle que le théologien alsacien a élaborée. Il en va de même de la christologie, l’A. allant jusqu’à mobiliser des concepts tels que « christolâtrie » et « sophiologie christologique » sans les expliciter (p. 71 sq.). Quant à la pneumatologie, à l’ecclésiologie et à la théologie des sacrements, pièces maîtresses d’une théologie mystagogique, elles ne sont pas même effleurées – dans une perspective proprement doctrinale, s’entend. Sur ce point, le lecteur reste sur sa faim – situation sans doute normale suite à une « mise en appétit ». En tout état de cause, on conseillera à quiconque souhaiterait disposer d’un guide de lecture doctrinal de la Dogmatique pour la catholicité évangélique de puiser à un texte de Siegwalt lui-même : le recueil d’entretiens publié sous le titre Dieu est plus grand que Dieu (Cerf, 2012).
Marc Vial
364HISTOIRE
Généralités
Christine Helmer, Stephen L. McKenzie, Thomas Römeret al. (éd.), Encyclopedia of the Bible and Its Reception, 15 : Kalam – Lectio Divina, Berlin – Boston, De Gruyter, 2017, xxx pages + 1220 colonnes, ISBN 978-3-11-031332-1, 259 €.
Christine Helmer, Stephen L. McKenzie, Thomas Römeret al. (éd.), Encyclopedia of the Bible and Its Reception, 16 : Lectionary – Lots, Berlin – Boston, De Gruyter, 2018, xxviii pages + 1258 colonnes, ISBN 978-3-11-031333-8, 259 €.
Christine Helmer, Stephen L. McKenzie, Thomas Römeret al. (éd.), Encyclopedia of the Bible and Its Reception, 17 : Lotus – Masrekah, Berlin – Boston, De Gruyter, 2019, xxviii pages + 1282 colonnes, ISBN 978-3-11-031334-5, 259 €.
La publication de The Encyclopedia of the Bible and Its Reception se poursuit à un rythme réjouissant. Comme dans les volumes précédents, les articles touchent à la fois aux livres bibliques – bien présents dans ces volumes, avec les entrées « Kings (Books of) » et « Kings (Books) », « Lamentations (Book of) », « Leviticus (Books of) », « Luke-Acts », « Maccabees », « Malachi (Book and Person) », « Mark (Gospel of) », « Matthew (Gospel of) » –, aux personnages, lieux, realia, mots et expressions bibliques – par exemple « Logos », « Lilies of the Field » « Lossing and Biding » –, aux genres littéraires – ainsi, « Letter, letters », à des épisodes précis – comme « Lost Sheep » –, à des phénomènes linguistiques et termes relatifs à la Bible et à son contexte immédiat, sans oublier les éditions et traductions de la Bible – p. ex. « Luther Bible », « Manga Bible », – à de nombreux biblistes, théologiens et exégètes, tels Lactance, Pierre Lombard, Ernst Käsemann, John Knox et Martin Luther (« Luther, Martin », « Luther’s Hermeneutics »), Maïmonide, Robert Alexander Stewart – et à des institutions ou mouvements religieux – « Karaites », « Latter Rain Movement », « Lutheran Church », « Mani, Manicheans ».
Ces volumes contiennent de nombreux articles thématiques, qui proposent des lectures transversales du corpus biblique, des traditions juives, chrétiennes et musulmanes, souvent avec une ouverture sur 365le monde gréco-romain, sans oublier, bien entendu, la réception culturelle des thèmes étudiés. De nombreuses contributions portent sur des notions bien définies, comme la loi (« Law ») – dans un article où la réception chrétienne est centrée, pour l’Antiquité, sur le rapport à la Loi juive –, le rire (« Laugh, laughter ») ou « Light and Darkness ». D’autres sont consacrées à des concepts plus contemporains. Ainsi en est-il, par exemple, des articles « Labor (work) », « Leader, leadership », « Liberty », « Life », « Love » – qui couvre aussi bien l’amour entre humains que l’amour de Dieu. Ces articles thématiques abordent souvent, de façon plus ou moins approfondie, des questions épistémologiques, comme dans « Legend », « Magi », ou « Man/Men » (section « Christianity »), ce qui est à saluer.
Des articles comme « Kerygma Petrou » ou « Mark (Secret Gospel of) » attestent que, bien que centrée sur la Bible, cette encyclopédie prend en compte la littérature apocryphe, mais on peut regretter que cette dernière apparaisse parfois dans la section « Literature », au titre de l’« héritage culturel » – tel est le cas dans l’article « Mary (Mother of Jesus) » –, et non dans la section « Christianity », où elle aurait pleinement sa place, au même titre que les écrits des théologiens de l’Antiquité – sur ce point, l’article « Magi » est plus satisfaisant.
La littérature, la musique et les arts occupent une place importante dans ces volumes, aussi bien dans des articles consacrés à des auteurs que dans des articles thématiques. Un article « Literature, Bible in », propose d’ailleurs deux utiles guides bibliographiques sur un sujet complexe – les deux volumes de La Bible dans les littératures du monde,publiés en 2016 sous la direction de Sylvie Parizet, auraient d’ailleurs gagné à y être mentionnés. On notera toutefois quelques absents de marque comme Halldór Laxness ou Félicité de Lamennais – à qui on doit notamment une traduction annotée des évangiles. Peut-être d’autres témoins de la réception culturelle de la Bible, comme Laszlo Krasznahorkai ou György Ligeti, auraient-ils aussi pu faire l’objet d’une notice, fût-elle brève, même si l’on comprend aisément que les éditeurs aient dû procéder à des choix. La philosophie n’est pas négligée (« Kant, Immanuel », « Levinas, Emmanuel », « Marxism, The Bible and »), ni la réflexion politique (« Machiavelli, Niccolò », avec un utile tableau de l’utilisation de la Bible chez cet auteur), ou l’anthropologie, avec un bel article consacré à Claude Lévi-Strauss, où il est question à la fois du rapport de ce savant à la Bible et de l’impact de ses travaux sur ceux des 366biblistes. La dimension interculturelle de cette entreprise ressort notamment des articles consacrés à l’Amérique latine (« Latin America », « Latino/Latina Theology »), qui prend en compte les cultures indigènes, et aux Maoris (« Māori, Reception of the Bible among the »), ou de notices sur des artistes comme Kesus (ou Keshav) Das, peintre indien du xvie siècle.
Le périmètre de l’encyclopédie reste très large, au point d’ailleurs de poser question : était-il nécessaire de consacrer des articles à des lieux non bibliques comme Kamid el-Loz, Mar Saba, Lalibela ou « Mariamme (Place) » – dont la notice aurait simplement pu être intégrée à l’article « Mariamme » –, de s’intéresser aussi longuement au latin (« Latin Grammar », « Latin Langage ») ou au karsūhni, à des figures comme Lucien de Samosate ou le roi Louis IX, à des méthodes théologiques comme « Kataphatic Theology » – l’article est peu centré sur la Bible et s’intéresse aussi au cataphatisme dans l’islam –, ou encore à des traditions éloignées de la Bible comme « Legend of the True Cross » ou « Macumba, Quimbanba, and Umbanda » – dont la présence, dans cette encyclopédie, est rapidement justifiée par le fait que ces traditions sont critiquées au nom de la Bible par les néo-pentecôtistes – ou encore « Madonna » ? D’autres notices, comme celle consacrée à Gotthold Ephraïm Lessing, auraient pu être fortement abrégées pour rester centrées sur la question de la Bible et ne pas faire double emploi avec les informations que l’on peut trouver par ailleurs, et on peut se demander s’il était nécessaire de traiter autant de l’hindouisme et du bouddhisme à propos des limbes. Les notices relatives à l’islam – qui constituent une heureuse spécificité de cette encyclopédie – posent des problèmes similaires : des articles comme « al-Khidr » le sage vert, « Kalam » ou « Karim Allah » ne paraissent pas nécessaires ; l’essentiel de leur contenu aurait pu être simplement versé dans d’autres entrées (par exemple Moïse pour « Karim Allah »). Ces articles, malgré leur intérêt intrinsèque, reflètent la volonté des Éd. de couvrir tous les sujets que les biblistes pourraient croiser, mais au risque de faire de cette encyclopédie un nouveau recueil d’articles sur les religions, ce qui n’est pas son but premier.
La nature de cette encyclopédie pose quelques difficultés lorsque les réalités abordées ne sont pas fondées dans le texte biblique. Les notices « Lamentation of Jesus » et « Limbo » arrivent à bien gérer cette difficulté. D’autres n’ont pas réussi à y faire vraiment face. La 367notice « Last Words of Jesus » s’ouvre ainsi de façon surprenante par une analyse du Nouveau Testament, puis du judaïsme, avant d’arriver au christianisme ; il n’aurait pas été inutile de commencer par la rubrique « Christianity », dans laquelle il aurait été aussi pertinent de donner des éléments un peu précis sur la genèse de ce septénaire qui n’a, en tant que tel, rien d’évident. De même, la notice « Lectio divina » s’ouvre sur une section « Patristic and Orthodox Churches », qui évoque le sens de cette expression de façon générale, puis s’attarde à sa signification plus technique, faisant ainsi double emploi avec la section suivante, « Medieval Times and Reformation Era », plus précise et pertinente, et par laquelle l’article aurait gagné à débuter.
Les articles sont globalement de bonne facture et dotés de bibliographies, dans lesquelles les publications en français sont hélas ! peu présentes, même dans les notices consacrées à des personnalités comme le couple Maritain ou Marie de France. Inévitablement, certaines notices peuvent être critiquées. Ainsi, quelques articles reflètent des conceptions dépassées (ainsi, t. 15, col. 150-151 sur le canon) ; d’autres, par leur brièveté, sont frustrants – comme la section beaucoup trop brève consacrée au terme « kerygma » dans le christianisme avant le xixe siècle (t. 15, col. 137). Les articles consacrés à Marie négligent l’existence de textes nommés Nativité de Marie – c’était d’ailleurs le titre du Protévangile de Jacques ; l’article consacré à « Luke-Acts » affirme sans plus de nuances que les actes apocryphes des apôtres et les pseudo-clémentines dépendent des Actes,alors que le sujet est débattu ; l’absence des Actes de Philippe dans l’article consacré au léopard est regrettable ; dans l’article « Lamentation of Jesus », il aurait été utile de mentionner que ce motif n’est pas présent dans les Actes de Pilate du ive siècle mais dans ses réécritures byzantines et latines, et de renvoyer à des travaux plus récents que The Ante-Nicene Fathers.
Ces remarques montrent l’intérêt que l’on peut avoir à parcourir ces très beaux volumes, dont le contenu, d’une grande richesse, est relevé par de superbes cahiers iconographiques en couleurs et un nombre non négligeable d’illustrations en noir et blanc.
Rémi Gounelle
368Ulrich Köpf, Die Universität Tübingen und ihre Theologen. Gesammelte Aufsätze, Tübingen, Mohr Siebeck, 2020, x + 568 pages, ISBN 978-3-16-159124-2, 89 €.
Ulrich Köpf a professé l’histoire de l’Église à la Faculté de Théologie protestante de Tübingen de 1986 à 2007 et il a dirigé durant cette longue période le fameux « Institut pour le Moyen Âge et la Réforme (Institut für Spätmittelalter und Reformation) ». Outre ses travaux sur le Moyen Âge et la Réformation, il a rédigé, avec la même érudition et la même clarté, de nombreuses études sur l’histoire de son Université (fondée en 1477), et plus spécifiquement de sa Faculté de Théologie protestante. Aussi est-il particulièrement heureux que, dans le présent volume, il ait regroupé pas moins de vingt-cinq études consacrées à ce thème. Tous ces articles sont restés inchangés par rapport à leur première publication (voir p. vi), mais quelques compléments figurent dans les notes ; ils sont signalés par des crochets, ce qui permet de les repérer aisément.
La période couverte par ces études fouillées va des débuts de l’Université et de la Faculté de Théologie (ch. 1 et 2) jusqu’à la première moitié du xxe siècle (l’historien Karl Müller, 1852-1940, ch. 25), en passant notamment par les débuts de l’Université protestante en 1534 et la part qu’y prirent Philippe Melanchthon (ch. 3) et Johannes Brenz (ch. 4). Bâle étant alors la seule université protestante dans l’espace rhénan, on comprend sans peine que la reconquête du Wurtemberg par le duc Ulric ait aiguisé les appétits des Réformateurs ; ils conçurent aussitôt des projets pour la réforme non seulement de ses territoires, mais encore de son université. L’A. ne manque pas de signaler, en deux endroits (p. 42 et 54), que, dès le 18 mai 1534, Martin Bucer et les pasteurs strasbourgeois adressèrent au duc et à Philippe de Hesse une lettre dans laquelle ils recommandaient pour cette réforme des théologiens plus proches de leur point de vue que Johannes Brenz, à savoir Ambroise Blarer et Simon Grynaeus.
Le centre de gravité du présent ouvrage porte toutefois nettement sur la théologie protestante au xixe siècle et en particulier sur Ferdinand Christian Baur (1792-1860, ch. 14), fondateur de l’« école de Tübingen » (ch. 12, 15 et 16 ; la question de savoir si, autour de Johann Adam Möhler, il y eut aussi une « école catholique de Tübingen » reste controversée, ch. 12 et 13). L’A. montre qu’en dépit de la grande rigueur scientifique et de la prudence 369avec lesquelles il appliquait à l’Écriture comme aux dogmes sa « théologie historique conséquente », Baur fut en butte aux attaques des luthériens orthodoxes et des piétistes wurtembergeois, et resta même minoritaire au sein de la Faculté de Théologie protestante. C’est pourquoi il échoua à placer ses élèves Christian Märklin (1807-1849, ch. 17 et 18), Edouard Zeller et Friedrich Theodor Vischer (1807-1887, ch. 23) en théologie, voire à l’Université. Quant à David Friedrich Strauß (1808-1874, ch. 19 et 22), sa fameuse Vie de Jésus (1835-1836, ch. 21) le fit tenir pour un hérésiarque dans toute l’Allemagne. Dans l’important chapitre consacré aux relations entre Baur et son élève Strauß (ch. 20), l’A. explique, tout en le déplorant à plusieurs reprises, le manque de soutien que Baur a accordé à Strauß (Baur opposait sa « critique positive » à la « critique négative » de son élève) par la crainte d’affaiblir encore sa propre position à la Faculté de Théologie protestante ; il met par ailleurs en évidence que, à la différence de Baur, Strauß ne s’intéressait pas véritablement à l’histoire.
Pour l’A., mettre l’accent sur les apports de Baur et de ses élèves à la théologie protestante et sur les combats qu’il leur fallut mener ne relève pas seulement d’un intérêt historique. Les propos que Köpf a prononcés en 1992 à l’occasion du 200e anniversaire de la naissance de Baur gardent en effet toute leur actualité. Après avoir affirmé qu’il n’y avait, pour une théologie protestante académique fidèle à la Réformation, aucune possibilité de revenir en-deçà des principaux acquis de Baur et de son « école » (ch. 14, p. 312), il concluait : « Nombre de ses [= Baur] problèmes sont nos problèmes, et son exemple montre comment, en tant que théologien et chrétien protestant, on peut, avec sincérité intellectuelle, prendre publiquement position face à l’exigence de vérité et à la compréhension de la réalité de sa propre époque » (p. 313).
En dépit de son fort volume, cet ouvrage magistral se lit d’une traite. Un index des personnes (p. 557-565) et un index des thèmes (p. 567 sq.) en facilitent la consultation.
Matthieu Arnold
370Histoire ancienne
Claudio Zamagni, Recherches sur le Nouveau Testament et les apocryphes chrétiens, Rimini, GuaraldiLAB, 2017, 442 pages, ISBN 978-88-6927-352-0, 29,90 €.
Cet ouvrage regroupe 18 études publiées par l’A., spécialiste de critique textuelle, entre 1996 et 2018 – deux d’entre elles étaient sous presse au moment de la publication de ce recueil et elles ont été publiées entretemps – ainsi qu’un article, inédit, consacré à Dante et l’Apocalypse de Paul.
Neuf études portent sur le Nouveau Testament, entre critique textuelle, relecture des Écritures juives et réception dans les premiers siècles du christianisme. Les autres ont trait à la littérature apocryphe chrétienne et examinent le Kerygma Paulou – dont E. von Dobschütz avaitsupposé l’existence –,les Actes de Timothée –dont l’édition critique, publiée par l’A. en 2007, est ici rééditée – et surtoutl’Apocalypse de Paul, dont l’A. est l’un des spécialistes. Elles associent réflexions herméneutiques et analyses techniques.
C’est surtout le regard acéré du philologue aguerri qu’est l’A. qui fait l’intérêt de ce recueil d’études.
Rémi Gounelle
Les Actes de Pierre et des Douze Apôtres (NH VI, 1). Texte établi, traduit et présenté par Victor Ghica,Québec, Presses de l’Université Laval / Louvain et al., Peeters, coll. « Bibliothèque copte de Nag Hammadi. Section Textes » 37, 2017, lxiv + 420 pages, ISBN 978-90-429-3268-5, 115 €.
Issu d’une thèse de doctorat soutenue en 2006, ce volume est consacré à un texte apocryphe de tendance ascétique peu connu : les Actes de Pierre et des Douze Apôtres, dont l’A. avait déjà proposé une traduction annotée dans J.-P. Mahé et P.-H. Poirier (dir.), Écrits gnostiques, Paris, 2007. Ces deux publications se recoupent en grande partie.
La longue introduction (261 pages) est consacrée à l’histoire de la recherche, à la critique rédactionnelle et à des questions linguistiques. Comme dans le volume de 2007 susmentionné, l’A. y avance une théorie rédactionnelle complexe, distinguant dans ce 371texte quatre groupes de matériaux, deux sources et deux étapes rédactionnelles.
La méthode mise en œuvre part du principe qu’une œuvre antique a une forte cohérence, que les réviseurs ne font que perturber. Toute incohérence ou tension interne du récit – objective ou supposée – est dès lors considérée comme une preuve que le texte a été revu. Une telle méthodologie n’est pas sans poser question. Ainsi, alors que l’A. tenait en 2007 que le titre « pourrait être attribué au rédacteur du texte » (op. cit., p. 817), il estime que ce titre est vraisemblablement un ajout effectué par un copiste au cours de la transmission du texte. Il en veut pour preuve les contradictions qu’il décèle entre le titre et le contenu de l’œuvre. À cette occasion, il signale que la seconde partie du récitfait explicitement état de onze apôtres, alors que la première « présuppose douze apôtres » (p. 3). Mais rien, dans le récit, ne permet d’estimer le nombre des apôtres en scène dans la première partie ; ce n’est que parce qu’il le lit « en bonne logique néo-testamentaire » (ibid.) que l’A. y voit douze apôtres. Or une telle interprétation s’impose d’autant moins que, comme l’A. le signale plus loin (p. 185), le récit est avare en renvois au Nouveau Testament.
L’A. relève en outre très justement que le titre, qui mentionne Pierre aux côtés des douze apôtres – et laisse dès lors accroire qu’il y a treize apôtres – est surprenant, mais qu’il n’est pas unique. De fait, 1 Co 15,5 et une homélie d’Origène (cités p. 5, n. 27, avec d’autres exemples plus discutables) attestent que la mention conjointe de Pierre et des Douze n’est pas intrinsèquement incohérente ; ces parallèles, que l’A. ne discute pas, permettent d’expliquer qu’un tel titre ait pu germer et être ajouté par un copiste pour lequel il a dû faire sens – un point que l’A. n’explique pas, se contentant de voir dans le titre la trace d’une « composition agglutinante » (p. 6), manifestant son peu de considération pour l’intelligence des copistes et réviseurs.
L’A. s’est bien entendu attaché à décrypter les diverses énigmes de ce texte, dont le nom « Lithargoël » qui signifie, selon le récit lui-même, « la pierre légère de gazelle ». Après avoir critiqué de façon assez peu bienveillante les hypothèses antérieures (p. 62-68), l’A. avance la sienne : il distingue dans l’explication de ce nom « une étymologie populaire et deux métaphores étagées qui décomposent l’image de la perle en plusieurs notions spécifiques » (p. 69), mais il ne démontre pas cette hypothèse de lecture – soit dit en passant, les passages du Physiologos consacrés à la gazelle auraient pu être cités.
372On ne peut que se réjouir que ce court récit allégorique – qui serait d’origine égyptienne d’après l’A. –, soit introduit, nouvellement édité, traduit et commenté. Force est toutefois de constater qu’il est loin d’avoir livré tous ses secrets. Il serait certainement utile de s’intéresser davantage à la manière dont il pouvait être compris par ses lecteurs antiques.
Rémi Gounelle
Eusebius, Werke. Dritter Band. Erster Teil : Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen. Kritische Neuausgabe des griechischen Textes mit der lateinischen Fassung des Hieronymus. Herausgegeben von Stefan Timm, Berlin – Boston, De Gruyter, coll. « Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte » 24, 2017, clxxxix + 444 pages, ISBN 978-3-11-031565-3, 154,95 €.
Œuvre considérable par son ampleur (plus de 900 notices consacrées aux lieux mentionnés dans la Bible), l’Onomasticon d’Eusèbe de Césarée a constitué un instrument de travail qui, pendant longtemps, n’a guère été remplacé. La traduction latine qu’en a faite Jérôme lui a permis de nourrir l’exégèse occidentale de l’Ancien comme du Nouveau Testament.
L’Éd. avait déjà publié, en 2005, la version syriaque de ce texte. Le présent volume propose une nouvelle édition du texte grec avec, en regard, la version latine de Jérôme. L’introduction discute en détail le seul manuscrit original conservé, puis s’intéresse à la datation du texte – dont l’Éd. situe la composition en 313-314 et non vers 325-326 –, avant de justifier les choix éditoriaux effectués à la lumière des travaux de Kostermann. L’édition nouvelle du texte grec et du texte latin établi par Klostermann (faute d’une édition critique plus complète) sont suivis de copieux index (p. 243-370) et d’une bibliographie dans laquelle les éditions, traductions et études ont de manière regrettable été mêlées.
L’édition du texte grec se caractérise par un jeu de signes et de caractères qui permettent d’identifier rapidement les variantes incertaines et les notices reconstituées par la recherche antérieure sur la base de la version hiéronymienne. Des apparats nourris proposent, en plus des éléments critiques attendus, des parallèles avec 373divers textes, dont les traductions grecques de l’Ancien Testament, et des renvois internes.
L’ensemble constitue un magistral instrument de travail. Il renouvelle la recherche sur ce texte, qui constitue un témoin unique de l’interprétation biblique comme de la topographie du ive siècle – deux chantiers que l’Éd. n’aborde pas dans le cadre de cette édition.
Rémi Gounelle
Grégoire de Nysse, Trois oraisons funèbres (Mélèce, Flacilla, Pulchérie). Texte grec d’Andreas Spira (GNO IX) ; Sur les enfants morts prématurément. Texte grec de Hadwiga Hörner (GNO III.2). Introduction, traduction et notes de PierreMaraval,Paris, Cerf, coll. « Sources chrétiennes » 606, 2019, 211 pages, ISBN 978-2-204-13356-2, 29 €.
Les traités traduits et annotés dans le présent volume ont été élaborés par Grégoire de Nysse dans les années 381-386. Les oraisons funèbres ici traduites sont consacrées à la figure de Mélèce, évêque d’Antioche mort alors même qu’il présidait le concile de Constantinople (381), à Flacillia, épouse de l’empereur Théodose, morte durant un voyage, et à Pulchérie, fille de l’empereur, décédée à l’âge de 6 ou de 7 ans. Le traité Sur les enfants morts prématurément a, quant à lui, été écrit en réponse à la sollicitation d’un haut personnage nommé Hiéiros.
L’introduction, assez brève, présente les textes et souligne leur enracinement dans la rhétorique classique et la philosophie grecque aussi bien que dans les Écritures, sans pour autant entrer dans un commentaire détaillé de ces écrits ; les notes font de même, renfermant toutefois des parallèles précis. La datation exacte du traité Sur les enfants morts prématurément est discutée, mais le Trad. ne prend pas position sur le sujet (p. 18-19), laissant de ce fait ouverte la question des relations de ce traité avec l’ouvrage de Didyme d’Alexandrie sur le sujet et avec le Discours 40 de Grégoire de Nazianze, consacré au baptême des enfants ; il aurait aussi été intéressant de comparer certains aspects de ce traité avec l’éloge funèbre de Pulchérie, présent dans le même volume.
Sans surprise, la traduction est non seulement de qualité, mais aussi élégante. On notera toutefois que, probablement pour fluidifier 374le texte français, le Trad. s’est autorisé quelques libertés par rapport au texte grec, sans toutefois en trahir le sens. Il laisse notamment souvent de côté les adverbes, ce qui, en de rares cas, aboutit à une perte de sens ; il en est ainsi de l’omission de « ontôs » dans l’Éloge de Mélèce, 4, l. 30.
Ce volume, l’un des derniers publiés par Pierre Maraval, récemment décédé, fera certainement mieux connaître ces textes qui, pour ne pas faire partie des œuvres majeures de Grégoire, n’en sont pas moins passionnants.
Rémi Gounelle
Jean Chrysostome, Panégyriques de martyrs. Tome I. Introduction, texte critique, traduction et notes de Nathalie Rambaultavec la collaboration dePaulineAllen, Paris, Cerf, coll. « Sources chrétiennes » 595, 2018, 372 pages, ISBN 978-2-204-12647-2, 38 €.
Ce volume inaugure une série consacrée aux nombreux panégyriques prononcés par Jean Chrysostome durant sa carrière ecclésiastique. Les cinq textes réunis ici datent vraisemblablement de la période antiochienne de Chrysostome (386-397), mais l’un d’eux, l’Éloge des Égyptiens,ne semble avoir été conservé que sous une forme largement remodelée (p. 12, l’information aurait pu être redonnée p. 41-45). Deux des éloges, celui consacré à Juventin et Maximim, et celui dédié aux Égyptiens, semblent être liés à des cultes assez récemment établis ; ceux des autres saints honorés – Romain, Julien, Barlaam – le sont de plus longue date.
Ces cinq textes sont nouvellement édités, sur une base manuscrite partielle, présentée et analysée en introduction. Le principe ayant guidé l’édition est le suivant : « privilégier les leçons figurant dans les plus anciens manuscrits chaque fois qu’elles se révélaient satisfaisantes » (p. 145) – le sens de ce qualificatif n’est pas précisé. L’apparat critique est négatif et très concis, ce qui permet de gagner de la place mais ne facilite pas toujours sa lecture ; une série de manuscrits n’ont en outre pas été pris en compte (p. 128-129), ce qui empêche l’analyse de la tradition textuelle au-delà des exemples cités dans l’introduction. La traduction est de qualité, mais on peut regretter que la Trad. n’ait pas davantage rendu en français les effets rhétoriques de Jean Chrysostome. Ici ou là, les 375italiques dans les textes français et grecs ne coïncident pas (ainsi, p. 212-123, 248-249).
Les éditions et traductions sont accompagnées d’un bel apparat scientifique : chacun des textes est présenté et sa datation discutée (p. 33, il nous semble qu’il faut lire « en 396 ou 397 » et non « entre 386 et 397 ») ; le « genre de l’éloge » est ensuite analysé ; les notes à la traduction, auxquelles s’ajoutent quatre notes complémentaires (dont il aurait été utile de préciser à quel passage des éloges elles se rapportent), sont assez abondantes. Une bibliographie et un index scripturaire complètent ce volume.
Rémi Gounelle
Cyrille d ’ Alexandrie, Commentaire sur Jean. Tome I, Livre I. Texte grec, introduction, traduction, notes et index de Bernard Meunier, Paris, Cerf, coll. « Sources chrétiennes » 600, 2018, 634 pages, ISBN 978-2-204-13156-8, 59 €.
Œuvre majeure de Cyrille d’Alexandrie, ce volumineux Commentaire sur Jean n’avait jamais encore été traduit en français. Une équipe, coordonnée par l’A. et par Marie-Odile Boulnois, s’est attelée à ce vaste projet, dont ce volume, consacré au seul livre I, constitue la première étape.
La traduction, précise et brièvement annotée, repose sur un texte grec édité sur la base de nouvelles collations. La priorité a été donnée à la tradition directe et, en son sein, au plus ancien manuscrit, qui est hélas ! aussi le plus fautif, d’où la nécessité de recourir également aux leçons transmises par d’autres témoins. La tradition manuscrite étant dans l’ensemble stable, cette édition se distingue de celle de Pusey par trente variantes de détail seulement (énumérées p. 163-164) – elles auraient gagné à être systématiquement indiquées dans l’apparat, avec l’éventuel support manuscrit justifiant la leçon de Pusey : en l’état, il n’est par exemple pas possible de savoir d’où provient le texte édité par ce dernier à la p. 222, l. 83). L’apparat semi-négatif est dans l’ensemble clair, mais les notations du type « 70(ad lin) » suivies d’un ajout (cf. par exemple p. 456) ne sont pas suffisamment explicites ; on peut en outre regretter que les variantes issues des chaînes n’aient pas systématiquement été indiquées.
376Après une présentation du texte et de ses sources, difficiles à saisir étant donné la nature de ce commentaire, l’introduction s’attache utilement à la relation de Cyrille au texte biblique et aux aspects doctrinaux de ce texte, qui est explicitement dirigé contre les ariens, que l’auteur de l’évangile aurait déjà combattu selon Cyrille (cf. le prologue du livre I et la note complémentaire p. 605-606) ; ce chapitre fait droit à l’usage des syllogismes, qui est une de ses particularités, et au traitement accordé par Cyrille au judaïsme. Suivent une histoire du texte, les principes éditoriaux, les variations par rapport à l’édition de Pusey et une bibliographie. L’édition et la traduction sont suivies de quelques notes complémentaires, dont les titres auraient pu être mentionnés dans la table des matières, et d’un index scripturaire.
Ce volume, qui constitue le 600e de la collection et, de ce fait, a droit à une belle jaquette colorée, fait honneur aux « Sources chrétiennes » et inaugure de très belle manière la publication de ce majestueux commentaire.
Rémi Gounelle
Martin de Braga, Œuvres morales et pastorales. Introduction [de] Guy Sabbah. Texte latin révisé et traduction [par] Jean-François Bertheletet Guy Sabbah. Annotation [de] Laurent Angliviel de la Beaumelle, Jean-François Bertheletet Guy Sabbah, Paris, Cerf, coll. « Sources chrétiennes » 594, 2018, 370 pages, ISBN 978-2-204-12789-9, 42 €.
Auteur peu connu, Martin de Braga, né vers 510-520 en Pannonie, a fait un pèlerinage en Orient avant d’arriver à ce qui est aujourd’hui le nord du Portugal, probablement vers 552. Soucieux d’instruire des laïcs, il était, selon son contemporain Venance Fortunat, tout autant versé dans la théologie que dans la philosophie.
L’introduction présente les multiples aspects de la vie et de l’œuvre de Martin et prend position dans le débat qui porte sur eux. Dans des pages à la tonalité parfois un peu apologétique, G. Sabbah évoque la question – quelque peu secondaire – de savoir s’il était un théologien d’envergure ; soit dit en passant, à deux reprises (p. 15, n. 3 ; p. 31, n. 3) est évoquée l’importance de deux œuvres, les Sentences des Pères égyptiens et les Capitula Martini, 377laissées de côté par les Éd. au motif, semble-t-il, qu’elles ne sont pas « littéraires » (p. 9)…
Le présent volume regroupe onze textes de Martin, dont les titres montrent à la fois leur diversité et leur ancrage plus ou moins philosophique ou théologique selon les cas : Pour repousser la jactance, De l’orgueil, De la colère, Règle de la vie vertueuse, Exhortation de l’humilité, Réformer les paysans (un traité particulièrement truculent), De la triple immersion (dans lequel Martin se débat entre arianisme et sabellianisme), De la Pâque, à quoi s’ajoutent trois poèmes : Dans la basilique, Dans le réfectoire, Épitaphe. Le texte, dépourvu d’apparat critique, est repris à l’édition de Barlow, ici ou là légèrement modifiée (p. 51-53), sans que le support manuscrit de ces corrections soit toujours explicité (cf. ainsi Formula vita honesta 9, 9 ; p. 200, n. 2). Il est traduit et annoté.
Plusieurs index permettent de s’orienter dans ces textes : index scripturaire, index onomastique, index des notabilia – où n’ont pas été retenues les pratiques condamnées par Martin (à propos des souris, des mites, des éternuements, des chants d’oiseaux, des fontaines etc.) –, et des principaux auteurs anciens – cet index global ne détaille hélas ! pas les œuvres citées.
Il est réjouissant que ces textes, qui témoignent de la vie et de l’évangélisation de la Galicie, soient ainsi mis à la portée du public francophone.
Rémi Gounelle
Libératus de Carthage, Abrégé de l’histoire des nestoriens et des eutychiens. Texte latin d’E. Schwartz. Introduction et notes [de] Philippe Blandeau. Traduction [de] François Cassingena-Tréverdyet Philippe Blandeau, Paris, Cerf, coll. « Sources chrétiennes » 607, 2019, 445 pages, ISBN 978-2-204-13415-6, 35 €.
Le titre français de l’œuvre à laquelle est consacré ce volume pourrait laisser entendre qu’il s’agit du résumé d’une histoire antérieure. Il consiste en réalité en une histoire abrégée (breviarium), couvrant les années 428-544, due à Libérius, un diacre de Carthage. Ce dernier, chalcédonien, l’a probablement composée peu avant 566 afin de défendre la résistance de l’Afrique face à la condamnation de l’œuvre de Théodore de Mopsueste, des écrits anti-cyrilliens de 378Théodoret de Cyr et de la lettre adressée par Ibas d’Édesse à Mari (les Trois chapitres). L’introduction, qui rappelle le déroulement complexe de ces controverses avant de présenter l’Abrégé, défend, contre Meier, la thèse que Libératus est peu favorable à Justinien.
L’œuvre de Libératus est vraisemblablement conservée sous une forme remaniée. Les Trad. suivent l’édition de Schwartz en y introduisant « quelques corrections minimes »(p. 85), qui ne sont pas énumérées. Les ajouts et corrections de l’Éd. sont signalées sous le texte latin et, le cas échéant, discutées en notes. La traduction, précise et richement annotée, suit les choix de Schwartz, mais pas de façon systématique. On peut regretter que, à plusieurs reprises (par exemple en XXII, 97 ; XXIII, 45), les conjectures de Schwartz soient incorporées dans la traduction mais non dans le texte latin.
Un tableau des règnes impériaux et des successions épiscopales est commodément fourni. S’y ajoutent une bibliographie et de très utiles index : index scripturaire, index des sources citées in extenso dans le Brevarium,index des auteurs et textes cités en notes et index des noms propres (personnes et lieux).
L’œuvre de Libératus avait été traduite en italien en 1989, mais jamais en français, et n’était donc jusqu’ici accessible qu’aux spécialistes. Ce volume de belle facture est donc fort bienvenu.
Rémi Gounelle
Moyen Âge
Albertus Magnus , Super Iohannem (Ioh. 1, 1-18). Édité par Julie Casteigt, Leuven, Peeters, coll. « Eckhart : Texts and Studies » 10, 2019, ccxliv + 319 + dlxxxvi pages, ISBN 978-90-429-3609-6, 110 €.
Julie Casteigt, Métaphysique et connaissance testimoniale. Une lecture figurale du « Super Iohannem (Jn 1, 7) » d’Albert le Grand, Leuven, Peeters, coll. « Eckhart : Texts and Studies » 11, 2019, xviii + 666 pages, ISBN 978-90-429-3610-2, 115 €.
La somme que forment ces deux ouvrages constitue un apport majeur dans les domaines de l’histoire de la philosophie, de la théologie et de l’exégèse, mais nourrit aussi des questions essentielles tant sur la pensée médiévale que sur le rayonnement et la 379réception d’Aristote. Une approche rapide pourrait faire croire que l’étude de Julie Casteigt (C.), Métaphysique et connaissance testimoniale…, qui prend appui sur quelques lignes extraites du passage du Super Iohannem d’Albert le Grand, lequel analyse le verset 7 du Prologue de l’évangile de Jean, pourrait se suffire à elle-même, sans la présence parallèle de l’édition critique. Mais au-delà du contenu même, considérable, de la recherche publiée ici, une superbe leçon de méthode est offerte, avec une parfaite rigueur et une totale honnêteté intellectuelle. Car de la même manière que l’évocation directe de la phrase d’Aristote convoquée dans ce passage (« Ce que les yeux de la chauve-souris sont, en effet, à l’éclat du jour, l’intelligence de notre âme l’est aux choses qui sont de toutes les plus naturellement évidentes » ; Métaphysique, α, 1) est superbement éclairée par les références des multiples citations – dans toutes leurs variations – de cette phrase dans une série impressionnante d’autres œuvres d’Albert, C. ne présente jamais aucun point de son argumentation sans donner, avec une impeccable précision, le matériau textuel à partir duquel elle la construit, et dans lequel le lecteur trouvera toutes les données de la question. Et c’est de la même manière que ces quelques lignes du Super Iohannem sont, en toute clarté, parfaitement intégrées dans l’édition de l’ensemble du commentaire albertien du Prologue de Jean. La réflexion qui est offerte se développe dans un respect absolu de la relation permanente à un réseau – organisé et hiérarchisé – de références, de textes, d’analyses complémentaires… Pareil choix est certes attendu dans tout travail académique analogue, mais le voir porté à un tel niveau d’exigence ajoute encore au bonheur de la lecture de ces volumes.
L’édition critique et sa traduction française, limpide, sont accompagnées de quatre index : lieux bibliques ; auteurs allégués par Albert le Grand et auteurs allégués par l’éditeur ; lieux parallèles ; riche index thématique qui, indiquant chaque fois les phrases concernées, constitue un outil de travail de premier ordre. Une longue introduction fait le point sur le Super Iohannem et inclut, entre autres, une étude extrêmement fouillée des témoins et de tous les types de variantes, aboutissant à un stemma général tant pour la tradition manuscrite que pour les versions imprimées. Des appendices également imposants donnent un répertoire des leçons erronées, et un autre des variantes commentées, offrant toutes les clefs au lecteur qui voudra remonter les pistes suivies 380par C. Nous connaissons neuf manuscrits contenant l’intégralité du texte, parmi lesquels Toulouse (BM, 162) ne s’avère finalement pas supérieur aux autres. Le texte imprimé ne se trouvait essentiellement, jusque-là, que dans l’édition de Lyon (1651) et celle de Paris (1899). Le choix de limiter celle-ci au commentaire de Jn 1,1-18 est parfaitement justifié par le fait que ces versets constituent la partie doctrinale de cet évangile, avant la partie historique commençant au verset 19.
Dès les premiers mots du titre de l’étude de C. (métaphysique, connaissance testimoniale), plusieurs points fondamentaux sont posés. Le texte qui définit le territoire de cette recherche doit être cité : « Et il touche le mode du témoignage en particulier, en disant : pour rendre témoignage à la lumière. Et, bien qu’en elle-même elle soit très manifeste, cependant, notre intellect est, par rapport à elle, comme les yeux de la chauve-souris par rapport à la lumière du soleil. C’est pourquoi aussi, comme dit Denys, il faut qu’il soit conduit par la main au moyen d’une lumière qui lui soit proportionnée et, quant à cela, il a besoin d’un témoignage ». Ces extraits du commentaire albertien du verset 7 s’inscrivent en effet dans la dimension en très grande partie philosophique de cette œuvre exégétique. Car elle veut montrer que l’évangile de Jean constitue une réponse à l’aporie des philosophes : comment l’intellect, qui ne peut exister sans son union au corps, et qui est fondamentalement conjoint aux sens et à l’imagination, au continu et au temporel, pourrait-il connaître directement le principe ? Albert convoque ici le passage susmentionné de la Métaphysique d’Aristote (α, 1) dont il est impressionnant de constater à quel point il traverse l’œuvre du Colonais.
Quant à la situation centrale du témoignage, et à sa place dans le processus de médiation, ces éléments sont confirmés par le rôle d’intermédiaire occupé par Jean-Baptiste. À la différence de l’évangéliste, qui a une connaissance directe du principe divin – comme l’aigle fixe le soleil de son regard perçant –, le Baptiste dispose d’un mode de connaissance médiat. Mais si Albert reconnaît pleinement le caractère exceptionnel de celui qui « vint pour témoigner » (Jn 1,7), il déploie une intelligence des figures pour proposer que ce mode de connaissance médiat soit accessible à chacun, pour autant qu’il soit à l’écoute des diverses formes du témoignage, notion qui structure et traverse l’évangile de Jean jusqu’à son évocation puissante dans la fin du dernier chapitre (Jn 21,24).
381Pour évoquer ensuite les autres mots essentiels du titre de l’étude, si une lecture figurale peut être proposée, c’est en raison des modalités particulières d’un réseau de notions dans la pensée albertienne. Les trois images présentes dans les lignes citées – la chauve-souris, la conduite par la main (manuductio, empruntée à Denys), la lumière proportionnée – ne correspondent, dans les divers traités d’Albert, à aucun titre de chapitre, à aucune question qui soit traitée dans un espace spécifique. Mais les occurrences de ces motifs sont considérables, et on les trouve à travers tous les types de textes du dominicain. La lecture de ces occurrences montre une volonté claire de ne pas enfermer une analyse dans la narrativité linéaire d’un texte, mais de faire ressortir des structures implicites, de faire résonner des images mentales qui convoquent chaque fois d’autres séquences narratives. Cette analyse de l’œuvre du maître colonais fait ainsi apparaître comme un des points essentiels de sa pensée et de sa méthode une pratique non doctrinale, mais très concrète et incompréhensible dans une rationalité conceptuelle, d’usage de certaines figures analogue à ce qu’il reconnaît chez Augustin comme une « intelligence figurale ». Car ces figures vont au-delà des diverses images verbales que l’on peut repérer ; elles constituent de véritables chaînes textuelles, correspondant à la fois à un mode d’écriture et au mode de lecture qu’il appelle.
La place de ces figures dans une pensée du témoignage, et dans le principe fondamental d’un mode de connaissance médiat, se révèle être en accord avec ce que les études sur l’œuvre d’Albert ont bien décrit comme « une métaphysique du flux ou un système d’émanation et de conversion reposant sur la production de différents degrés » (p. 21). Le témoignage, tel que Jean le vit et l’exprime, apporte une connaissance du principe qui n’est pas séparée de la médiation par laquelle il transmet, à travers une hiérarchie de niveaux, la lumière reçue.
Le premier grand chapitre porte sur la figure de la chauve-souris, analysée principalement à partir de ses occurrences dans le corpus aristotélicien d’Albert, la Métaphysique, mais également dans d’autres parties de son œuvre. Le passage d’Aristote exprime une aporie, une rupture infranchissable entre le principe divin et l’intellect humain, mais l’argumentation du dominicain consiste précisément, à l’aide de plusieurs tripartitions hiérarchiques, à passer du chiasme de ce qui est le plus connaissable en soi et, néanmoins, le moins accessible à l’intellect humain, à l’affirmation d’un 382chemin en niveaux successifs (per gradus ascendens). La figure de la chauve-souris est par ailleurs évoquée, dès la Metaphysica, en trois termes, puisque le grec original y est rendu par trois animaux volants nocturnes, noctua (la chouette), nycticorax (plus ou moins « corbeau de nuit ») et verspertilio (chauve-souris). L’analyse des textes d’Albert montre qu’ils y sont globalement pris comme des synonymes et qu’ils correspondent à trois traductions différentes utilisées au xiiie siècle, – translatio respectivement vetus, media, nova –, ce qui permet à C. de se référer à très juste titre à cette figure sous l’expression générique « animaux volants nocturnes ». Cela nous amène à une remarque personnelle : il est très éclairant d’observer qu’une enluminure d’un commentaire de la Divine Comédie, dans un important manuscrit pisan remontant à 1330 environ, choisit de représenter précisément ces trois animaux sur la porte de l’Inferno, au début du chant III, pour exprimer l’entrée dans un monde de ténèbres, alors qu’ils ne sont cités ni dans ce passage de Dante, ni dans le texte du commentateur, Guido da Pisa (Chantilly, Musée Condé, ms 597, folio 48). Selon les textes d’Albert, de vraies nuances peuvent séparer ces trois animaux, la chauve-souris constituant alors l’extrême inférieur pour ce qui est de la capacité à recevoir et voir la lumière ; ce qui ajoute encore de la force au jeu d’opposition qui la situe dans un couple avec l’aigle qui, lui, voit le soleil en sa roue.
Cet éloignement suprême de la chauve-souris ne fait paradoxalement que renforcer la grande dimension d’espérance que porte cette figure, car elle est mise en parallèle avec l’intellect humain et sa capacité de voir la lumière. L’argumentation est au service d’un aspect central de la pensée d’Albert, « une complète confiance dans la possibilité pour l’intellect humain de connaître et de contempler ce qui est divin » (p. 113). On passe de l’aporie à la description de la traversée de plusieurs tripartitions hiérarchiques parallèles, citées ici à partir de leurs niveaux supérieurs ; celle de la lumière, lux en acte dans sa source, lucere dans l’acte d’émaner, lumen reçue dans un corps ainsi illuminé ; celle des intelligibles, de l’absence de mélange avec la matière jusqu’au continu et au temporel ; celle des intellects, respectivement divin, de l’intelligence séparée, de l’homme ; celle des sciences théoriques là aussi dans le sens décroissant, de la métaphysique (entendue comme theologia, connaissance de la cause première) à la mathématique puis à la physique. La figure de l’animal volant nocturne permet de proposer une continuité 383entre les niveaux d’intellects et de faire valoir qu’il est possible de vivre, par l’étude, une remontée progressive à travers la hiérarchie des sciences, jusqu’à la métaphysique comprise comme science du divin. La résolution du chiasme aboutit à la thèse hardie qu’une chauve-souris peut, d’une certaine manière, voir la lumière du soleil et devenir un aigle.
Le deuxième temps majeur de l’étude est consacré à la manuductio, qui est indispensable parce que, à l’instar de la chauve-souris qui ne peut regarder la lumière du soleil en face, l’intellect humain ne peut voir immédiatement le principe et a besoin d’un mode de connaissance médiat. À partir d’un passage du De caelesti hierarchia du Pseudo-Aréopagite, Albert convoque la nécessité de « conduire par la main » l’intellect qui, conjoint au corps, ne saurait en soi connaître ce qui est spirituel. Les questions soulevées sont multiples, comme l’étape de l’admiration, signe et connaissance de l’ignorance, l’enseignement en paraboles comme médiation sensible, le rôle particulier de la manuductio pour les commençants, l’usage de l’analogie, la place des images dans une théologie symbolique, le passage par les formes et leur nécessaire abandon, la relation de mélange puis de séparation progressive de la lumière et de l’obscurité… Le paradoxe est alors le fait que l’aboutissement de la manuductio, connaissance par médiation, aboutit à son inverse, l’immédiateté de la connaissance, la vision de ce qu’Albert nomme « la vérité nue ». De même qu’il y a continuité entre le fleuve et la source dont il émane, il s’agit, grâce au passage par un discours où le divin est exprimé par des symboles, d’atteindre un langage où il est restitué sans leur aide, de manière directe. L’intelligence figurale est à comprendre comme la perception simultanée des divers sens de la médiation – sans les opposer entre eux – et répond à la nature de l’intellect humain qui doit assumer sa double nature, contradictoire, d’intellect et d’humain.
Le troisième grand chapitre approfondit les questions complexes que pose, à travers l’intelligence figurale, le mode de connaissance propre à l’intellect humain qui, « conduit par la main » vers le principe, interprète les images à la fois dans leur singularité et dans les relations de ressemblance qu’il découvre entre elles. Dans ce travail d’imagination, d’interprétation de la manière dont le principe se met en figures, « s’imagine », l’intellect suit en sens inverse le chemin par lequel le principe se manifeste. Le repérage des ressemblances est un acte clé de ce processus, et on en trouve une analogie dans le 384travail que fait l’interprète face aux rêves, ce qui ouvre à des questions comme celle des similitudes métaphoriques et de la distinction entre sens figurés et sens propres. La connaissance des songes – à la condition de repérer ceux qui sont une révélation –, manifestant la manière dont des visions purement intellectives sont reçues sur le mode du particulier et du composé, permettant de comprendre la genèse des images, ouvre la voie à une intelligence figurale qui fait ce chemin à rebours, retrouvant peu à peu les réalités divines dans les intellects supérieurs, à partir de leurs manifestations dans les intellects inférieurs.
La figure du vase de lumière, citée à partir du Baptiste compris « comme un vase de lumière qui illumine et est à la fois illuminée » (sic, p. 402), s’inscrit dans une autre tripartition hiérarchique, 1) montant des corps opaques ou noirs, qui ne font que réfracter la lumière 2) vers des corps qui la reçoivent mais seulement en vue d’un éclat extérieur et 3) aboutissant à ceux qui la reçoivent en profondeur et qui sont comparés à des vases de lumière. Une riche typologie de comparaisons est déployée, incluant entre autres l’image de l’escarboucle, gemme qui peut emmagasiner la lumière puis la restituer un certain temps ; image qui permet aussi de ne pas confondre la réception d’une qualité avec la ressemblance parfaite avec celle-ci. Être un composé, fait de mélange, revient à être situé dans un lieu médian et non sur les sommets, et être témoin n’est pas être fils. Mais précisément parce qu’il est un composé, le témoin, dans le prologue de Jean, comprend aussi en lui l’éclat du principe, ce qui permet de « briller dans les ténèbres ».
Les travaux antérieurs de C. sur la pensée de Maître Eckhart (dont son livre de 2006, Seul le juste connaît la justice. Connaissance et vérité chez Maître Eckhart) lui donnaient des outils évidents pour la question légitime de la comparaison entre les interprétations respectives de Jn 1,6-8, données par les deux dominicains rhénans. C’est l’objet du quatrième grand chapitre, dans lequel la conception albertienne du témoin est vue dans toute sa différence avec celle du fils, centrale pour son successeur dans le temps. Pour ce dernier, c’est l’engendrement en tant que fils de Dieu qui est au cœur du prologue johannique, ce qui ouvre à la nécessité de la connaissance immédiate, sans la possibilité de laquelle la médiation perd tout sens. Eckhart et Albert insistent chacun, respectivement, sur un des aspects de la relation qu’entretiennent immédiateté et nécessité de la médiation. Mais ils placent tous deux, au cœur de 385la question, l’acte par lequel le principe est source d’une lumière qui illumine.
Au-delà de l’apport capital de ces travaux de C. pour une lecture d’Albert le Grand qui touche en particulier à la noétique, l’anthropologie, l’herméneutique et la métaphysique, le lecteur est nourri par l’intégration des textes et des séquences d’analyse qui montre comment l’exégèse peut être vivante, se déployant dans un mouvement d’interprétation ouvert, en une dynamique qui à la fois englobe et sait différencier. Remercions les Éditions Peeters d’avoir matérialisé une recherche qui fera date, dans le double apport de la parfaite clarté de l’argumentation et du foisonnement d’un très dense apparat critique qui lui permettra de susciter à son tour des pistes nouvelles et stimulantes.
Christian Heck
Franz Machilek, Jan Hus (um 1372-1415). Prediger, Theologe, Reformator, Münster, Aschendorff, coll. « Katholisches Leben und Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspaltung » 78/79, 2019, 271 pages, ISBN 978-3-402-11099-7, 29,90 €.
Né en 1934 en Tchécoslovaquie, Franz Machilek, qui a occupé d’importantes fonctions d’archiviste à Nuremberg puis à Bamberg, est décédé il y a quelques mois. Aussi sa biographie de Jan Hus constitue-t-elle son testamentaire littéraire. Il s’agit de la version, considérablement augmentée, d’une brochure parue en 2015 à l’occasion du 600e anniversaire de la mort de Hus. Il est à noter que c’est le regretté Anton Schindling, dont l’intérêt pour l’Europe centrale est bien connu, qui a donné à l’A. l’impulsion décisive pour remettre sur le métier son ouvrage.
Une proportion importante des études consacrées à Hus a paru en langue tchèque (voir la bibliographie, p. 217-271). Or l’A. connaît parfaitement ces travaux, de même que les écrits de Hus, ce qui lui permet de brosser un portrait bien informé et vivant du maître de Prague. Après une introduction qui fait l’état de la question et traite longuement de la récupération politique de Hus depuis le xixe siècle, l’A. campe le contexte politique, économique, social, intellectuel et religieux de la Bohème, et plus particulièrement de sa capitale, Prague, avant Hus. Le cœur de l’ouvrage est constitué 386par les 30 sous-chapitres consacrés à la vie et à l’œuvre de Hus (p. 61-202). L’A. accorde une place importante à la querelle qui a agité l’Université de Prague au sujet des écrits de Wyclif et joué un rôle important dans l’évolution spirituelle de Hus. Il traite de sa prédication en langue vernaculaire, des fondements de sa théologie et de ses différents écrits. Il passe rapidement sur le rectorat de Hus à Prague (1409-1410) ainsi que sur ses liens avec les Lollards (1410-1411), pour s’attarder sur les conflits des années 1411-1412 autour de la réforme de l’Église, puis sur la dispute du 17 juin 1412 contre les abus des indulgences. Il expose les interprétations que Hus a données, peu avant que l’Interdit sur Prague entre en vigueur (27 novembre 1412), du Credo, du Décalogue et du Notre Père. Il présente la polémique anti-hussite et le traité De Romana ecclesia, dont Hus a achevé la rédaction en mai 1413 à la Ziegenburg ; ce traité, qui non seulement définit l’Église comme la communauté des prédestinés, mais encore aborde de manière polémique les questions du pouvoir des clés, de l’autorité du pape et de la curie, allait constituer l’une des principales pièces à charge lors du Concile de Constance. L’A. étudie également les écrits pastoraux rédigés par Hus durant son exil, ainsi que ses conceptions politiques. Les préparatifs en vue du Concile, le voyage vers Constance et surtout la comparution de Hus sont documentés à l’aide de la correspondance de Hus et de la Relatio de P. de Mladionowitz. Quant à la condamnation prononcée sur Hus, l’A. estime, avec la recherche récente, que sa vision de l’Église était totalement inconciliable avec la conception « sacramentelle-hiérarchique » des pères conciliaires ; c’est pourquoi il était « conséquent » qu’un concile contraint de ne laisser aucun doute sur sa propre orthodoxie en vînt à contraindre le déviant à se rétracter puis le condamnât (p. 200). Dans deux brefs chapitres conclusifs, l’A. examine la question d’une réhabilitation de Hus (« hérétique ou réformateur » ?), en lien avec sa place dans les dialogues œcuméniques et les prises de position du pape depuis la visite de Jean-Paul II à Prague en 1990 jusqu’aux propos de François le 15 juin 2015.
On souhaite la plus large diffusion à cette biographie claire, à l’information sûre et aux jugements pondérés.
Matthieu Arnold
387Eric Marshall White, Editio princeps. A History of the Gutenberg Bible, Londres, Harvey Miller Publishers / Turnhout, Brepols, 2017, 465 pages, ISBN 978-1-909400-84-9, 120 €.
Cet ouvrage de grand format (30,5cm x 23cm), riche de plus de 110 illustrations en couleurs, ne relate pas seulement ni même principalement l’histoire des débuts de l’imprimerie en Europe et de l’impression de la fameuse Bible aux 42 lignes de Gutenberg (p. 17-61). Il se consacre pour l’essentiel à la postérité de cette Bible, après que, au xve siècle, Gutenberg a été unanimement célébré comme l’inventeur de l’imprimerie puis que, durant les deux siècles suivants, sa Bible, anonyme, a été complètement oubliée (p. 62-81) : on ne parlait alors de cette Bible que de manière abstraite, une Bible perdue qui aurait été imprimée à Mayence en 1450.
L’A. établit, grâce à des recherches minutieuses, comment le processus de réhabilitation et même de canonisation de la « Bible de Gutenberg » s’est déroulé du xviiie au xxe siècle (p. 83-299), avec la découverte progressive des exemplaires restants de la fameuse Bible aux 42 lignes et son attribution à l’imprimeur de Mayence. Le premier universitaire à associer cette Bible à Gutenberg et à l’invention de l’imprimerie fut Christoph Hendreich (1630-1702 ; voir son annotation manuscrite dans l’exemplaire de Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, vers 1700 ; p. 87) ; suivirent les attributions à Gutenberg des exemplaires de la Hofbibliothek de Aschaffenburg (1745), de l’abbaye bénédictine de Saint-Blaise (Forêt Noire, 1760) et de la fameuse « Bible Mazarine » (1763). En tout, ce sont 24 exemplaires qui apparaissent au xviiie siècle ; 11 d’entre eux se trouvent en Allemagne ou en Autriche, 7 en France ou en Flandre et 6 en Angleterre ou en Écosse. Le mouvement se poursuit tout au long du xixe siècle, durant lequel un tiers des exemplaires ayant subsisté sont tirés de leur long sommeil, le plus souvent dans des monastères. L’A. reconstitue l’histoire, souvent passionnante, de chaque exemplaire. Certaines découvertes eurent lieu dans des conditions rocambolesques. Ce fut le cas lors de l’inventaire effectué en 1889 à Hopetoun House, la résidence écossaise de John Adrian Hope qui souhaitait vendre sa bibliothèque avant de partir en Australie, où il venait d’être nommé gouverneur de Victoria : Tom Hodge, employé de la société Sotheby, découvrit par hasard les deux volumes de la Bible derrière des flacons de médicaments, quelques minutes avant de sauter dans le train qui devait le ramener à Londres (voir 388p. 258 sq.). La moisson est moindre au xxe siècle, mais on relèvera qu’en 1983, François Joseph Fuchs, alors directeur des Archives de la Ville de Strasbourg, signala la découverte, dans sa ville, de plusieurs folios d’une Bible de Gutenberg renfermant quelques chapitres du livre de Jérémie (voir p. 293).
Cette enquête historique approfondie est complétée par le catalogue détaillé des Bibles de Gutenberg, y compris les exemplaires « fantômes » (p. 307-353). Quelques 1 000 notes, rejetées en fin de volume (p. 355-402) et une importante bibliographie (p. 403-450) confirment le caractère érudit de cet ouvrage, qui est aussi un « beau livre ». Plusieurs index (p. 451-465) en facilitent la consultation.
Matthieu Arnold
xvi e -xviii e siècle
Erminia Ardissino, Élise Boillet (éd.), Lay Readings of the Bible in Early Modern Europe, Leyden – Boston, Brill, coll. « Intersections », 2020, xv + 312 pages, ISBN 978-90-04-41742-7, 107 €.
Cet ouvrage collectif est issu d’un programme de recherche soutenu par le Centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR) de l’Université de Tours. Les Éd. sont des spécialistes de Dante et de la littérature savante laïque en Italie pour la première et de l’Arétin pour la seconde, celle-ci préparant aussi l’édition de ses paraphrases bibliques, après un ouvrage remarqué, en 2007, L’Arétin et la Bible (Genève, Droz). L’introduction qu’elles co-signent s’attache à retracer le cadre général de la pratique de la lecture de la Bible par les laïcs à l’époque moderne. Dès le xiiie siècle, le fait est bien connu, les laïcs, soutenus par les ordres mendiants, sont les moteurs de la croissance continue de la lecture en langue vernaculaire, notamment dans le domaine biblique. Cette propagation de la Bible en langue vernaculaire ne concerne pas seulement les exercices de piété : l’Écriture sert aussi de modèle et devient source d’inspiration pour les idées politiques, pour les méthodes d’éducation, pour l’éthique sociale et familiale, domaines de souveraineté des laïcs.
Une première partie examine la Bible comme référence constante dans la société de la première modernité. Les premières contributions 389font le choix d’embrasser un vaste champ chronologique en sélectionnant des exemples significatifs. Sous le titre « Fides ex auditu », G. Campbell retrace la transmission de la foi sous couvert de la doctrine de la conceptio per aurem, depuis Éphrem le Syrien et le pseudo-Augustin jusqu’à Shakespeare (Cleopatra), Rabelais (Gargantua) et Milton (Paradise Lost). F. Dupuigrenet-Desrousilles évoque la Bible dans l’Europe moderne « sous le signe de Jonas », en décrivant l’importance accrue accordée à l’Ancien Testament à côté du Nouveau, les prophètes se partageant, avec les évangélistes, la vedette dans les représentations iconographiques et les commentaires. J.-P. Cavaillé s’attache aux usages « irreligieux » de la Bible, depuis Bonaventure Des Perriers jusqu’à Louis Machon, apologète de Machiavel.
La deuxième partie regroupe des contributions usant d’une méthode plus traditionnelle d’études de sources sur un laps de temps limité. Elles traitent des débats entrepris à propos de la lecture de la Bible par les laïcs en Espagne (I. J. García Pinilla) et à Genève (M. Engammare), ou en milieu catholique, sous la figure de Bellarmin (T. Ó hAnnracháin).
La troisième partie est consacrée à la diversité des livres en langue vernaculaire, à leurs usages et à leur interprétation. Une première étude traite de la place des évangiles dans les Vies ou Passions du Christ en français (M. Hoogvliet). La contribution d’É. Boillet évoque la littérature biblique en italien, sous l’angle des auteurs et des lecteurs. W. François aborde la production biblique à l’heure de la confessionnalisation et X. Bisaro la pratique des psaumes dans les « Petites Écoles » catholiques.
La dernière partie est consacrée au rôle de la lecture de la Bible dans la formation des identités sociales et professionnelles, avec, tout d’abord, une contribution de C. Pennuto sur le De sacra philosophia de F. Vallés et sa lecture médicale de l’Écriture. L’œuvre de Johannes Kepler, en lien avec la réforme de la théologie et l’astronomie nouvelle, est traitée par S. Gattei. Enfin, E. Ardissino donne une étude de genre sur les interprétations de la Genèse par des femmes, promouvant l’égalité des sexes. Ce beau volume se clôt par une postface qui envisage la lecture de la Bible par les laïcs sur un long terme.
Même si la méthode employée par certaines études pointillistes peut déconcerter, l’ensemble donne un volume bien documenté et solide, offrant de nouvelles pistes de recherches dans ce champ très 390labouré de la lecture de la Bible par les laïcs à l’époque moderne. Le tout est structuré intelligemment, et le travail éditorial très soigné.
Annie Noblesse-Rocher
Marie-France Monge-Strauss, Traduire le Livre de Jonas. De Lefèvre d’Étaples à la version révisée de Genève (1530-1588). Préface de Marie-Christine Gomez-Géraud, Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque de la Renaissance » 22, 2020, 688 pages, ISBN 978-2-406-07279-9, 68 €.
L’ouvrage est issu d’une thèse en doctorat de lettres préparée sous la direction de la préfacière et soutenue en 2014. Il s’agit d’une étude comparative de 13 traductions en français du livre de Jonas, depuis la version selon Lefèvre d’Étaples en 1530 jusqu’à la Bible révisée genevoise de 1588.
L’ouvrage s’ouvre sur une introduction qui met en évidence les enjeux de ces traductions du xvie siècle : le retour des humanistes aux sources, la place des langues vernaculaires dans le projet réformateur et l’importance des traductions en ce siècle qui voit fleurir aussi les paraphrases et les tragédies bibliques. Une première partie est consacrée au livre de Jonas lui-même, à son genre littéraire, à sa réception théologique et à sa fortune littéraire et artistique. L’A. présente ensuite le corpus de traductions retenu. La partie suivante est relative à la méthode d’analyse de ces traductions : comparaison des éditions entre elles puis avec le texte massorétique, selon les items – chaque verset du livre de Jonas est donné dans toutes les traductions retenues, offrant une vue synthétique –, la syntaxe, les structures narratives et les paratextes. La troisième partie commente les résultats obtenus pour caractériser les choix des traducteurs : diversité des traductions, traitement des récurrences et des hébraïsmes. La conclusion prend de la hauteur et propose une réflexion sur la philologie et l’exégèse en ce siècle décisif pour les traductions bibliques, présente les enjeux des choix lexicaux opérés par les traducteurs, avant de replacer cette entreprise de traductions dans le contexte sociologique de l’époque, notamment en regard de la place des juifs et de l’hébreu dans ce siècle de chrétienté bouleversée. Quatre annexes proposent le texte massorétique de Jonas, la traduction de Genève de 1588, l’Avertissement aux 391marchands, libraires et imprimeurs et la présentation groupée de quelques versions latines. Dans la bibliographie, bien documentée quoiqu’essentiellement francophone, des articles d’érudition, comme ceux de Gilbert Dahan, côtoient étonnamment des articles de vulgarisation, comme ceux produits par la revue Foi et Vie. Le lecteur se demandera aussi pourquoi sources et littérature secondaire sont mêlées dans la partie consacrée à l’hébreu (p. 673 sq.) alors qu’elles sont bien distinguées par ailleurs.
Ces quelques remarques n’enlèvent rien à l’intérêt que présente cet ouvrage, très bien présenté par ailleurs. Il s’agit d’une entreprise de grande qualité, menée selon les règles de l’analyse littéraire, et qui peut être considérée comme un modèle de protocole méthodologique pour ce genre d’étude comparative, offrant une vue synthétique des traductions au siècle des Réformes.
Annie Noblesse-Rocher
Paula Barros, Inès Kirschleger, Claudie Martin-Ulrich (dir.), Prêcher la mort à l’époque moderne. Regards croisés sur la France et l’Angleterre, Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres » 446, 2020, 376 pages, ISBN 978-2-406-10027-0, 46 €.
Stefano Simiz (dir.), Prêcher dans les espaces lotharingiens xiiie-xixe siècles, Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres » 474, 2020, 263 pages, ISBN 978-2-406-08975-9, 23 €.
Deux volumes parus la même année témoignent de la vitalité actuelle des recherches relatives à la prédication. Le premier est le fruit du colloque « Le sermon et la mort » qui a eu lieu en 2012 à Montpellier, le second publie les actes d’un colloque organisé en 2016 dans le cadre du projet ANR « LODOCAT » (Chrétientés lotharingiennes - Dorsale catholique, ixe-xviiie siècle, 2015-2018).
Le projet de Prêcher la mort à l’époque moderne se définit à la fois par une aire géographique et un cadre chronologique limités (principalement les xvie-xviie siècles), ainsi que par un thème précis (la rencontre entre le sermon et la mort), ce qui lui confère une grande cohérence. Il met en évidence la dimension non seulement pastorale et théologique, mais encore éminemment politique, lorsqu’il s’agit des funérailles d’un souverain, des prédications prononcées au début de l’époque moderne.
392Les dix-neuf études (quinze en français, quatre en anglais) sont distribuées de manière équilibrée dans les trois parties « revendiquer », « accompagner » et « commémorer », qui correspondent respectivement à la fonction didactique voire polémique de la prédication, à sa fonction pastorale et à la commémoration des défunts. Cette logique est convaincante, mais comme chaque sermon prêché aux endeuillés tout à la fois revendique, accompagne et commémore, nous ne la suivrons pas pour présenter ces articles de haut niveau. (Seule la traduction des citations allemandes pose quelques problèmes, mais on saluera le fait que la plupart des auteurs se sont donné la peine de traduire, dans le texte ou en note, les citations en langue étrangère.)
Ces études concernent pour près de la moitié l’Angleterre, pour l’autre moitié la France, avec une comparaison ponctuelle dans l’aire germanique (S. Gautier se penche sur les sermons funéraires luthériens au xviie siècle). Certaines d’entre elles ont trait au temps long : E. Tingle étudie les enseignements sur le purgatoire en France entre 1500 et 1700, et V. Ferrer le rôle du livre dans la préparation à la mort, genre qui, entre lexvie et le xviie siècle, évolue de l’exhortation à la consolation ; quant à J. Gœury, il présente le corpus des récits du « dernier prêche » et des publications de ces sermons dans les Églises réformées du xvie au xxe siècle. D’autres articles couvrent une période de quelques décennies : R. Houlbrooke présente les sermons rassemblés dans le recueil The House of Mourning (trois éd. entre 1640 et 1672), qui relèvent pour partie de la préparation à la mort, pour partie du réconfort au endeuillés ; C. Meli traite l’éloge des vertus féminines dans dix oraisons funèbres publiées au début du règne de Louis XIV, entre 1663 et 1684 ; P. Pritchard s’intéresse aux sermons funèbres des « dissidents » ou « non conformistes » anglais entre 1660 et 1700 ; les quelques sermons funèbres prononcés par Jacques Abbadie, pasteur au Refuge entre 1680 et 1727, font l’objet d’une étude de R. Whelan.
Plusieurs contributions portent sur un prédicateur ou un auteur : le chanoine de Notre-Dame Simon Vigor (1515-1575), étudié plus sous l’angle de sa polémique confessionnelle que sous celui de ses sermons sur la mort (A. Paschoud) ; Denys Peronnet, auteur en 1577 d’un Manuel general et instruction des curez qui insiste sur l’obligation de « satisfaire » après la mort (C. La Charité) ; C. Drelincourt (M. Carbonnier-Burkard), dont la consolation privée destinée aux pasteurs cherche à compenser l’absence de 393sermon funèbre dans l’espace réformé français. Certaines études se concentrent même sur une prédication : le sermon prononcé en 1511-1512 par Johan Colet devant l’assemblée du haut clergé de la province de Cantorbéry, qui présente une vision céleste de l’Église (J. Arnold) ; l’Exhortation agaynst the Feare of Death (1547) de Thomas Cranmer (M. Vénuat) ; l’hommage que John White, évêque de Winchester, rend à Marie Ire en décembre 1558, et qui tourne au réquisitoire contre les réformés (I. Fernandes) ; l’éloge par John Donne de Lady Danvers publié en 1627 avec des poèmes de George Herbert, fils de la défunte (A.-M. Miller-Blaise) ; la prédication que donne en 1678 Pierre Du Bosc, rescapé de la mort, sur sa propre maladie et sa guérison (H. Bost) ; le sermon de Richard Werge lors des funérailles d’un gentilhomme en 1683, qui fait le lien entre la mort et la repentance (N. Bourgès). Seul C. Jérémie propose une comparaison entre les sermons funèbres de deux auteurs, Edwyn Sandys et Edmond Gryndal, tous deux nés en 1519 et exilés sous le règne de Marie Tudor. Last but not least, C. Belin montre comment, dans ses oraisons funèbres, Bossuet subvertit le « modèle canonique » en faisant apparaître la vanité de l’éloge des défunts, voire de toute éloquence humaine face à la mort.
La cohérence de ce beau volume est renforcée par une introduction substantielle (p. 7-30) qui donne un aperçu historiographique des recherches portant sur le sermon ou la prédication (les Éd. s’attachent par ailleurs à en donner une définition générique) puis des travaux consacrés à la mort. L’index des notions, trilingue (français ; anglais ; latin pour les notions rhétoriques) et fort détaillé, l’index des noms et l’index biblique contribuent eux aussi à la cohésion de cette somme.
Si l’on s’en tient aux termes du débat posé il y a plusieurs décennies par Jean Delumeau, pastorale de la peur ou pastorale rassurante, les études rassemblées ici plaident incontestablement en faveur d’une pastorale qui réconforte les vivants, les rassure et leur propose des modèles de vie. Toutefois, chacune des confessions « prêche la mort » avec sa théologie propre et elle tient en conséquence les motifs de réconfort spécifiques à la confession rivale pour autant d’éléments inquiétants : il en va ainsi du purgatoire vu par les réformés, les luthériens et les anglicans, et de l’élection considérée par les catholiques, ou encore de la place respective de la foi et des œuvres.
La perspective du second volume, qui porte sur le temps long qui va du xiiie au xixe siècle, est plus historique que littéraire ou 394théologique. Ses dix études (deux sont en langue italienne) traitent moins du contenu des sermons prononcés que des occasions de la prédication, des rapports entre les sermons et les pouvoirs institués, voire du contrôle de la prédication. L’hypothèse que les organisateurs du colloque souhaitent vérifier concerne le lien entre une prédication singulière et une région spécifique, la « Lotharingie-dorsale catholique », avec ses caractéristiques confessionnelles, politiques et linguistiques.
Dans la première partie, « Contextes et autorités », L. Gaffuri traite de la prédication au Piémont durant le xve siècle ; l’étude de C. Borello est censée porter sur les prédications protestante et juive dans les années 1770-1815 mais, faute de sources, elle se fonde surtout sur des lettres pastorales, des discours et des recueils de prières pour établir combien juifs et protestants clament leur soumission aux autorités en place.
Forte de quatre contributions, la deuxième partie, « Mobilité et messages des prédicateurs », étudie successivement la prédication des observants italiens au xve siècle, en particulier sa diabolisation des hétérodoxes (L. Viallet), celle du frère minime François Humblot au début du xviie siècle, qui elle aussi mêle étroitement pastorale et controverse (F. Henryot, qui invite à dépasser la logique spatiale de la « dorsale catholique »), celle d’André Valladier à Metz, qui défend âprement la souveraineté des rois de France sur Metz (1608-1638 ; J. Léonard), et enfin les sermons du père Hyacinthe Loyson, « grand voyageur en christianisme », au xixe siècle (S. Scholl).
La dernière partie est dévolue aux « Espaces et sanctuaires » de la prédication : les espaces de la prédication mendiante en Auvergne (v. 1250-v. 1530), dans une contribution synthétique qui traite également des formes de cette prédication et des modalités de sa diffusion (C. Bourguignon) ; les célébrations ayant eu lieu dans l’église de la Visitation à Milan aux xviiie et xixe siècles (D. Sora) ; le thème de la croisade au xixe siècle, en lien avec les révolutions italiennes de 1848, qui montre de manière convaincante comment cette prédication guerrière a préparé le retour en force du thème de la croisade durant la Première Guerre mondiale (I. Veca) ; l’espace constitué par les « chaires de vérité “belges” » (planches p. 231-236), chaires baroques érigées principalement dans les années 1700-1720 et 1750, et qui caractérisent les Pays-Bas méridionaux (Ph. Martin).
Les index des noms et des thèmes (p. 249-251) ont été établis a minima, à la différence de l’index des lieux (p. 253-255). On saluera 395par contre les belles « conclusions » synthétiques de F. Meyer, qui répondent aux « introductions » de S. Simiz ; elles lient la gerbe, jugent prudemment qu’en Lotharingie, la prédication a probablement renforcé un lien entre religion et politique plus marqué qu’ailleurs, et signalent des thèmes quelque peu négligés, comme les questions économiques et financières, ou encore le rapport des prédicateurs avec leur hiérarchie.
L’un et l’autre ouvrages mentionnent, dans leur bilan historiographique, le colloque « Annoncer l’Évangile : permanences et mutations de la prédication (xve-xviie siècle) » organisé à Strasbourg en 2003 et publié trois ans plus tard. Nous nous réjouissons que cette manifestation ait contribué à ranimer l’intérêt pour un champ d’études dont ces deux volumes illustrent toute la fécondité.
Matthieu Arnold
Philippe Desan, Véronique Ferrer (dir.), Penser et agir à la Renaissance. Thought and Action in the Renaissance, Genève, Droz, coll. « Cahiers d’Humanisme et Renaissance » 161, 2020, 568 pages, ISBN 978-2-600-06007-3, 62,25 €.
Les 25 contributions de ce volume bilingue (17 en français, 8 en anglais) sont le fruit d’un colloque international franco-américain qui s’est tenu en deux temps, en 2017 à Paris puis en 2018 à Chicago. Elles examinent comment, en des temps troublés, les penseurs du xvie siècle ont articulé leurs idées et leurs actions, quitte à se contredire parfois. Ces penseurs, qui se distinguèrent des « intellectuels du Moyen Âge » en raison du rôle central que le livre imprimé joua dans la diffusion de leurs idées, furent confrontés, dans des proportions plus fortes qu’à d’autres époques, à des bouleversements dans les domaines tant religieux que culturel et politique.
Compte tenu du thème du présent volume, les titres des différentes sections (I. Penser en actes ; II. Agir en pensant ; III. Entre action et contemplation ; IV. Politique et action militante ; V. L’engagement des philosophes) et la répartition des contributions sont nécessairement quelque peu artificiels. Nous suivrons néanmoins l’ordre des contributions choisi par les Éd.
Marie Barral-Baron établit de manière très convaincante comment Érasme, adversaire de la censure dans les années 1510, est devenu 396censeur dans les années 1520-1536 en raison des attaques virulentes dont il fit l’objet ; Érasme – au même titre que Luther et en même temps que lui – traverse en 1525 une crise de confiance dans la puissance du langage (voir p. 39). Marina Mestre Zaragoza présente l’œuvre politique de Jean-Louis Vivès, en particulier son engagement par la plume pour la concorde, y compris l’amour des « Turcs parce qu’ils sont hommes » (p. 62). Pour Marie-Claire Phélippeau, Thomas More a été un « utopiste sans illusions », qui a traqué sans répit les luthériens et leurs écrits. Véronique Ferrer dresse le portrait du bouillant Guillaume Farel, exemple de « la Réforme en actes » par son souci constant d’appliquer ses idées en organisant la Réforme francophone ; il précipita les changements plutôt que de les subir (voir p. 99). Dans sa passionnante mise en parallèle des figures de Michel Servet (Restitutio) et de Jean Calvin (Institutio), Olivier Millet rappelle notamment la « lutte judiciaire à mort qui eut lieu […] entre les deux hommes » (p. 107). Dans la droite ligne de son ouvrage Prêcher au xvie siècle (voir RHPR 98, 2018, p. 486-488), Max Engammare traite de la suppression des fêtes chrétiennes à Genève (1538-1550), conséquence des idées théologiques de Calvin. Denis Crouzet se fonde sur les Commentairesde Charles-Quint pour portraiturer l’Empereur en historien et pédagogue, lequel présente à son fils son action prudente comme inspirée par la pensée d’Érasme. Marie-Christine Gomez-Géraud montre que, chez Sébastien Castellion dans les années 1550-1560, le pessimisme et l’attente eschatologique ne dispensent pas de l’action intellectuelle. Hugues Daussy étudie comment la pensée de François Hotman a influencé l’évolution de la pensée politique huguenote. Michel de l’Hospital, campé par Loris Petris, a lui aussi conjugué action pratique et réflexion théorique sur cette action ; il s’est attaché à la politique du juste milieu chère aux humanistes, « tenant la droicte voye, sans decliner ne a destre ne a senestre » (p. 333).
Il n’est pas possible de rendre compte de l’ensemble des contributions, qui toutes sont de haute tenue scientifique et se situent pleinement dans le thème du colloque. Les autres études traitent des penseurs suivants : François Guichardin (Concetta Cavallini), Rabelais (Mireille Huchon), Jacques Grévin (Rosanna Gorris Camos), La Boétie (Philippe Desan), Alessandro Piccolomini (Eugenio Refini), Jean Bodin (Sara Miglietti), Jacques Auguste de Thou (Ingrid A. de Smet ; cet article français aurait mérité une relecture plus soignée), Machiavel (John P. McCormick), 397Montaigne (George Hoffmann et Frank Lestringant), Charles, cardinal de Lorraine (Jean Balsamo), François de La Noue (Amy Graves Monroe), Girolamo Cardano et Giambattista della Porta (Armando Maggi), Francis Bacon (Thierry Gontier) et Andreas Frisius Modrevius (Steffen Huber).
De l’aveu même des Éd. (p. 17), Luther est, avec Martin Bucer, l’un des grands absents de ce volume. Toutefois, la substantielle introduction évoque, un peu rapidement il est vrai, sa réponse de 1525 aux paysans révoltés (voir p. 15). Par ailleurs, dans son article sur La Boétie, Ph. Desan affirme de manière assez surprenante que l’Exhortation à la paix… (1525) est l’« un des rares textes qui font de Luther un penseur social et non plus seulement un théologien » (p. 261).
Même privé de Luther, cet ensemble érudit, clair et cohérent remet en cause, y compris pour Érasme, « l’image du penseur ou du savant, distant du tumulte du monde » (p. 8). Il comporte des « éléments de bibliographie critique » (p. 551-554) et un index des noms (p. 555-564).
Matthieu Arnold
Andrew J. Niggemann, Martin Luther’s Hebrew in Mid-Career. The Minor Prophets Translation, Tübingen, Mohr Siebeck, coll. « Spätmittelalter, Humanismus, Reformation » 108, 2019, xiv + 411 pages, ISBN 978-3-16-157001-8, 129 €.
Publication d’une thèse soutenue en 2018 à l’Université de Cambridge, cet ouvrage s’intéresse à la manière dont, au « milieu de sa carrière académique », Martin Luther a traduit l’hébreu. En effet, les principaux travaux sur les compétences de Luther en hébreu, dus notamment à Siegfried Raeder, concernent la période qui va des années 1515 à 1521, soit les années entre la fin de son premier cours sur les Psaumes et l’arrêt de ses Operationes in Psalmos.
L’A. délaisse les psaumes pour se concentrer sur la traduction des « petits prophètes ». Il présente le contexte et l’histoire de cette traduction, ainsi que les ressources dont disposaient Luther et ses collègues à Wittenberg (ch. 1). Il s’attache au combat de Luther avec les « obscurités » du texte hébraïque (« Der text ist hie [= hier] finster, das ist seer Ebreisch », 1526, à propos de Ha 3,2) et aux différentes traductions du Réformateur, inconséquentes voire contradictoires à ses yeux (ch. 2). À l’aide de nombreux exemples précis, il étudie 398au ch. 3 la manière dont Luther s’applique à rendre l’« intensité sémantique » de l’hébreu, ainsi que les termes hébraïques qu’il rend par Anfechtung (tribulation ; ainsi ṣāra, Jon 2,3). En se fondant sur quatre cas (Za 2,13 et 12,2 ; Na 1,3 ; Am 8, 1-2), il examine comment Luther recourt à d’autres passages de l’Ancien Testament pour traduire les passages difficiles des petits prophètes (ch. 4). Enfin, il pense pouvoir établir un lien entre l’emploi, par Luther, d’un certain nombre de termes de la tradition mystique (le terme Anfechtung joue à nouveau un rôle important dans l’interprétation de l’A.) et sa traduction des petits prophètes (ch. 5).
La conclusion générale (ch. 6), un peu scolaire à l’instar des sommaires des différents chapitres, s’attache à rappeler à plusieurs reprises la « contribution fondamentale » que le présent ouvrage a voulu apporter (p. 217) voire qu’il est convaincu d’apporter (p. 220) aux études sur Luther. Il appartiendra, sans doute, à d’autres que l’A. d’en juger. En tout cas, son étude, qui repère maints changements intervenus dans la Deutsche Bibel entre 1532 et 1546, confirme, si besoin était, qu’en traduisant, Luther n’a pas seulement cherché à parler à l’« homme du peuple » (visée cibliste de la traduction) ; il a été également, comme l’établit le présent livre, particulièrement attentif aux langues sources du texte biblique. Plutôt que de voir, avec l’A., une véritable méthodologie de la traduction dans l’Épître sur l’art de traduire (1530) et d’en inférer par conséquent des contradictions entre la théorie et la pratique, on soulignera avec lui qu’un certain nombre des problèmes philologiques auxquels Luther a été confronté constituent, aujourd’hui encore, des « croix » pour les exégètes.
Appendices, bibliographie et index fort détaillés (Bible et sources anciennes et médiévales ; termes hébreux, allemands, latins et grecs ; notions) occupent près de la moitié de cet ouvrage (p. 226-411) et en font tout l’intérêt.
Matthieu Arnold
« Maudits livres ». La réception de Luther et les origines de la Réforme en France, [Paris], Bibliothèque Mazarine – Éditions des Cendres, 2018, 339 pages, ISBN 979-10-90853-12-6, 40 €.
À la différence de ce qui s’est passé en Allemagne, rares ont été, en France, les expositions de grande envergure qui ont commémoré le 500e anniversaire de la Réformation. Celle qui s’est tenue du 39914 novembre 2018 au 15 février 2019 à la Bibliothèque Mazarine, sous le haut patronage du Chancelier de l’Institut de France, revêt une importance d’autant plus grande. Le commissariat a été assuré par Florine Lévecque-Stankiewicz, conservateur à la Bibliothèque Mazarine. Outre le commissaire de l’exposition, le comité scientifique se composait de Yann Sordet, directeur de la Bibliothèque Mazarine, de Geneviève Guilleminot-Chrétien, conservateur en chef à la Bibliothèque nationale de France, et d’éminents connaisseurs de l’histoire du livre et de la Réforme en France : Frédéric Barbier, Marianne Carbonnier-Burkard, Yves Krumenacker et Olivier Millet. Les autres auteurs des notices de ce catalogue sont Thierry Amalou, Christine Bénévent, István Monok et Natanaël Valdmann. La majorité des ouvrages présentés proviennent de la Bibliothèque Mazarine, mais certains d’entre eux sont issus des fonds de la Bibliothèque nationale de France, de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, de la Bibliothèque de l’Arsenal ou encore de la Société d’Histoire du Protestantisme français.
Écrivons-le d’emblée, le présent catalogue est à la hauteur des attentes que pouvaient susciter le cadre prestigieux de cette exposition et son accompagnement scientifique. Les reproductions sont de grande qualité, et les 78 notices, chacune longue de une à trois voire quatre pages, sont généralement très complètes. Ces notices sont réparties en six sections qu’introduisent à chaque fois une ou deux synthèses d’une haute tenue scientifique. La préface rédigée par Yann Sordet (p. 7-10) exprime l’ambition de l’exposition (« examiner dans le détail la réception de Luther à travers les livres, et plus précisément à travers leur possession et leur lecture, leur traduction et réimpression, mais aussi à travers leur contestation, interdiction et destruction », p. 8) et présente les différences phases de la réception de Luther en France à partir de 1518. L’introduction signée par Hubert Bost (p. 11-14), qui fait son profit du numéro spécial de la Revue d’Histoire du protestantisme consacré au « Luther des Français » (no 2017/2), en replace le propos dans le cadre plus large des images de Luther et de la « réception de la Réforme, à court et à long terme ».
Les documents de la section I, « De nouvelles sensibilités, de nouveaux textes, de nouvelles lectures » (F. Barbier), nous renseignent sur la théologie, sur la piété et sur les mentalités de la fin du Moyen Âge. On y trouve notamment la traduction latine de la Nef des fous (no 1, Stultifera navis, Paris : [Johannes Philippi], 1498), qui avait paru quatre ans plus tôt, l’édition par Érasme des Adnotationes de Laurent Valla au Nouveau Testament (no 2, Paris : Jean Petit, Josse Bade, 1505), une 400version française du « best-seller » l’imitatio Christi (no 3, Le livre de imitatione Christi, Rouen : Jean Le Bourgeois, 1498), la Prognosticatio de Johann Lichtenberger (no 5, [Cologne : Peter Quentell], 1526) qui s’appuyait sur la conjonction de 1484, la Biblia cum postillis Nicolai de Lyra (no 7, Strasbourg : [Johannes Grüninger], 1492), la Bible historiale de Guyart des Moulins (no 9, Le Premier volume de la Bible en francoiz, Paris : Antoine Verard, [vers 1510]) ainsi qu’un exemplaire du Novum Instrumentum édité par Érasme (no 11, Bâle : Johann Froben, 1516) ayant appartenu au Landgrave Philippe de Hesse.
La section II, « 1518-1521. Luther à Paris » (F. Lévecque-Stankiewicz), s’ouvre sur le recueil d’œuvres de Luther imprimé par Froben en octobre 1518 ; six cents exemplaires furent envoyés en France et en Espagne (no 12). Ce volume comprenait non seulement des écrits de Luther tels que ses explications (Resolutiones) des 95 thèses, son Sermo de poenitentia et son Sermo de indulgentiis (version latine du fameux Sermon von Ablass und Gnade), mais encore le dialogue de Sylvestre Prieras et les cent neuf thèses d’Andreas Carlstadt contre Jean Eck.
Les écrits présentés dans cette section documentent les principales étapes qui balisent la rupture de Luther avec l’Église romaine : actes de l’entrevue d’Augsbourg avec Cajetan par lesquels Luther en appelle au jugement de l’Université de Paris (no 14, Acta F. Martini Lutheri…, [Leipzig : Valentin Schumann, 1518]) ; Dispute de Leipzig (no 16, Disputatio inter egregios et praeclaros viros…, [Paris : Josse Bade, janvier 1520]) ; bulle Exsurge Domine du 15 juin 1520 qui laisse à Luther soixante jours pour se rétracter (no 19, Bulla Decimi Leonis…, [Strasbourg : Johann Schott, 1520]) ; apologie du brûlement, le 10 décembre 1520, de la bulle et des décrétales (no 21, Quare Pape ac discipulorum ejus libri… combusti sint, Wittemberg [Paris : Pierre Vidoue], 1520) ; condamnation de la Faculté de Paris approuvée le 15 avril 1521 – soit trois jours avant le discours de Luther à Worms – et imprimée le même mois (no 22, Determinatio theologicae Facultatis Parisiensis…, Paris : Josse Bade, 1521) ; Édit de Worms, qui met Luther au ban de l’Empire (no 24, Edit et mandement de Charles cinquiesme… [Paris : Pierre Gromors, 1521 ?]).
La section III, « Défenses et ruptures » (G. Guilleminot-Chrétien, Y. Krumenacker), dont le premier livre exposé est le De captivitate babylonica (no 25, [Paris : Michel Lesclancher, après 1521]), est consacrée principalement aux réactions hostiles à Luther : les premiers procès et la polémique des théologiens « anti-Luther » (Josse 401Clichtove fut l’auteur d’un Antilutherus, no 31, Paris : Simon de Colines, 1525), à commencer par celle de Henri VIII (no 26, Assertio septem sacramentorum…, Paris Claude Chevallon, [1523]). Figurent également dans cette section les Loci communes et les Annotationes… in Epistolam Pauli ad Romanos… de Philippe Melanchthon (no 28 et 30, tous deux imprimés en 1523 à Strasbourg par Johann Herwagen), dont la Faculté de Théologie de Paris jugeait les écrits plus séduisants et donc encore plus dangereux que ceux de Luther (voir p. 156).
Sous l’intitulé « Luther en français avant Calvin » (M. Carbonnier-Burkard et O. Millet), la section IV regroupe des écrits de divers auteurs, à commencer par des ouvrages du « groupe de Meaux » (voir no 32 à 35) et l’Apologia de Noël Beda contre ces « Luthériens clandestins » (no 37, Paris : Josse Bade, 1529). De Luther, on trouve, éditées à Anvers (Martin Lempereur) dans les années 1527-1529, des traductions françaises d’écrits allemands parus en 1519-1520, le Brief racueil [sic !] des dix commendements… (no 39) et le Sermon sur la manière de prier Dieu… (no 40). Le Dialogue en forme de vision nocturne… et Le miroir de l’ame pecherresse… de Marguerite de Navarre, qui font partie d’un recueil de poèmes imprimé entre janvier et Pâques 1534 (no 47, Alençon : Simon Du Bois), présentent maintes « touches » luthériennes (O. Millet). Les idées de Luther sur le salut par la foi et la grâce se retrouvent chez Clément Marot (no 48, Epistre familière de prier Dieu…, Paris [Antoine Augereau], 1533), et à la même époque paraît, produit par un milieu évangélique zwinglien, le fameux Passional Christi und Antichristi qui opposait, en 1521, la passion du Christ à celle du pape-Antichrist (no 50, Les Faicts de Jésus-Christ et du Pape…, [Neuchâtel : Pierre de Vingle, vers 1533]). C’est de ce même milieu que sont issus les fameux placards d’Antoine Marcourt contre la messe (no 53, Articles veritables sur les… abuz de la Messe papalle…, [Neuchâtel : Pierre de Vingle, 1534]), lesquels ont provoqué, entre autres, la rupture de Guillaume Budé avec la Réforme (no 54, De transitu hellenismi…, Paris : Robert Estienne, 1535). La section IV se clôt sur une notice consacrée à la « Bible d’Olivétan » (no 56, La Bible qui est toute la Saincte escriture…, Neuchâtel : Pierre de Vingle, 1535).
La section V, « Entre Luther et Calvin : les années 1540 », introduite comme la section précédente par M. Carbonnier-Burkard et O. Millet, commence par présenter deux éditions de l’Institution de la religion chrétienne : la première édition, latine, de 1536 (no 57, Bâle : Thomas Platter et Balthasar Lasius) et la version française 402de 1545 (no 58, Genève : Jehan Girard). Quant au Catalogue des livres censurez par la faculté de theologie de Paris (no 60, Paris : Benoît Prevost pour Jean André, 1544, 26 août), sa parution marque un tournant dans la lutte contre les ouvrages de Luther (23 titres indexés) et de ses disciples. Les écrits publiés en France dans les années 1540 témoignent de la variété des genres littéraires dans lesquels Luther s’est illustré. Ainsi, la Consolation en adversité faite par M. Claude d’Espence (no 66, Lyon : Jean de Tournes, 1547) traduit discrètement l’écrit pastoral de 1520, Tesseradecas consolatoria pro laborantibus et oneratis, tandis que l’Antithese de la vraye et faulse Église… (no 67, [Genève : Jean Girard], 1545) est un traité polémique ; il rend en français la traduction latine partielle du Wider Hans Worst (1541), qui oppose l’Église évangélique, fidèle à la Parole de Dieu, à la « synagogue de Satan ».
L ’ Histoire de la vie et faitz de venerable homme m. Martin Luther, … fidelement redigée par escrit par M. Philippe Melancthon (no 69, Genève : Jean Girard, 1549) assure par contraste la transition avec la section VI, « La légende noire de Luther » (Y. Krumenacker). À côté de portraits polémiques célèbres de l’hérétique (no 77, Johannes Cochlaeus, Septiceps Lutherus…, Paris : Nicolas Chesneau, 1564), cette section présente des écrits plus modestes : La Balade des Leutheriens avec la chanson (no 71, [Lyon : Jacques Moderne, v. 1526 ?]), in-octavo anonyme de quatre feuillets, et Le grant miracle… A la confusion de l’heresie de Martin Luther (no 74, [Paris : Adrian Lotrian, vers 1530]), qui, à l’instar des publications évangéliques, interprète les naissances monstrueuses pour polémiquer contre la confession adverse.
Une chronologie des années 1470-1549 (p. 307-311), une « bibliographie sommaire » des travaux cités dans les notices (p. 313-320), un index des noms et des lieux (p. 323-329) et une précieuse « liste des œuvres de Martin Luther citées dans l’ouvrage » (p. 331-332) contribuent à faire de ce catalogue un livre de référence. Les travaux de William G. Moore en 1930, puis ceux de Francis Higman à partir des années 1970, avaient contribué à faire mieux connaître la diffusion des idées de Luther en France. Le présent catalogue affine grandement cette connaissance, et nul travail sur la Réforme en France ne pourra faire l’économie de sa lecture.
Matthieu Arnold
403Jacques Blandenier, Martin Bucer. Une contribution originale à la Réforme, Saint-Prex (Suisse), Éditions Je Sème / Charols, Éditions Excelsis, coll. « Dossier Vivre » 43, 2019, 209 pages, ISBN 978-2-9701342-1-3, 12 €.
Les ouvrages en langue française relatifs au Réformateur Martin Bucer (1491-1551) sont trop rares pour qu’on boude cet opuscule. En quinze chapitres, il présente les principales étapes de la vie de Bucer et les points essentiels de sa théologie. Il met en évidence le fait que le Réformateur de Strasbourg et de l’Allemagne du Sud, tout en ayant tout d’abord été influencé par Luther, a développé sa propre conception de la Cène, de l’Église (lien entre la « grande Église » et les ecclésioles ; rapports avec la société…) et des ministères. Dans de belles pages conclusives, l’A. à la fois dit son estime, voire son affection pour Bucer, et énumère – un peu pêle-mêle – ses nombreux apports originaux, y compris ceux qui, selon lui, pourraient encore être promus « à la simple échelle de nos communautés locales » (p. 203).
On rectifiera quelques erreurs. Sélestat ne se situe pas « au nord de l’Alsace » (p. 13) – à la différence de Wissembourg, où Bucer fut pasteur avant de se rendre à Strasbourg. Si Luther a défendu une autre conception de la Cène que Zwingli, ce n’est pas parce qu’il aurait été « élevé dans un monde rural éloigné des nouveaux courants de pensée » (sic !), par opposition à Zwingli qui, lui, aurait « parcouru tout un cheminement humaniste » (p. 74). H. Junghans a bien montré que, dans la grande ville d’Erfurt, Luther, qui n’était pas un ignare, a été lui aussi en contact avec l’humanisme ; toutefois, il en a retenu d’autres éléments que Zwingli, étant marqué également par la « théologie de la piété » (B. Hamm). (Le ch. 7, « Le douloureux conflit intraprotestant au sujet de la sainte cène », comprend par ailleurs un certain nombre d’autres imprécisions.) Ce n’est pas Luther qui a qualifié Bucer de « fanatique de l’unité » (p. 199), mais un de ses récents interprètes.
On a apprécié le fait que l’A., qui reconnaît ne pas avoir « eu accès à des documents inédits de Martin Bucer, ni à ses publications non traduites en français » (p. 205), se soit fondé non seulement sur les travaux de Marc Lienhard, de Martin Greschat et de Gottfried Hammann, mais encore sur ceux, plus anciens, de Jaques Courvoisier, de Henri Strohl et de Pierre Scherding. Par contre, il est dommage qu’il ait négligé maintes études récentes parues dans 404la RHPR et dans la Revue d’histoire du protestantisme / Bulletin de la SHPF, ainsi que les travaux portant sur le séjour strasbourgeois de Calvin (1538-1541).En outre, la consultation des résumés en français qui sont donnés pour chaque lettre dans l’édition de la correspondance de Bucer lui aurait permis de camper aussi un Bucer familier et familial.
Pour toutes ces raisons, son livre, marqué de bout en bout par la sympathie pour Martin Bucer en dépit du parcours « trop sinueux » (p. 199) qu’il lui reproche, constitue une introduction utile, mais perfectible, à la vie et à la pensée du Réformateur de l’Allemagne du Sud.
Matthieu Arnold
Frank Muller, Images polémiques, images dissidentes. Art et Réforme à Strasbourg (1520-vers 1550), Baden-Baden – Bouxwiller, Valentin Koerner, coll. « Studien zur deutschen Kunstgeschichte » 366, 2017, 364 pages, ISBN 978-3-87320-366-2, 48 €.
Depuis la création, en 1975, par Marc Lienhard, Jean Rott et André Séguenny, du Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des xvie et xviie siècles et l’histoire des protestantismes (GRENEP), puis la fondation de la collection « Bibliotheca dissidentium » aux éditions V. Koerner, les « dissidents » sont bien mieux connus, notamment ceux qui ont passé par Strasbourg voire s’y sont établis. L’A., membre du GRENEP, a contribué à cette connaissance par de nombreuses études ; en 2001, il avait publié, dans la « Bibliotheca dissidentium », un volume consacré à plusieurs artistes dissidents dans l’Allemagne du xvie siècle, parmi lesquels Heinrich Vogtherr l’Ancien, dont il est le meilleur connaisseur, et Hans Weiditz. Il était donc naturel que, l’année du 500e anniversaire de la Réforme, il nouât la gerbe de décennies de recherches par un ouvrage consacré plus particulièrement aux images dissidentes et approfondissant maints thèmes qu’il avait déjà traités. Ainsi, Vogtherr et Weiditz comptent à nouveau, dans le présent volume, parmi les principaux artistes étudiés par l’A., mais ils s’y trouvent en compagnie de beaucoup d’autres.
405L’étude se déploie en six chapitres, agencés en grande partie de manière chronologique, depuis les premiers portraits de Luther et de Hutten jusqu’aux gravures des années 1540. Cet ouvrage n’est pas seulement le livre d’un historien de l’art ; c’est la somme d’un historien et d’un théologien, attentif tant aux questions politiques et au rôle du Magistrat qu’à la théologie des Réformateurs strasbourgeois et à leur projet ecclésial contrecarré par les dissidents. Il s’intéresse tant aux graveurs qu’aux imprimeurs (Johann Schott, Johann Prüss, Johann Knobloch…), tant aux artistes dissidents qu’aux penseurs tels que Clément Ziegler, Melchior Hoffman, Caspar von Schwenckfeld ou encore Hans Denck, et aux rapports entre les uns et les autres. Les femmes ne sont pas absentes de cette investigation : on y trouve notamment la prophétesse Ursula Jost.
Traitant de l’image à Strasbourg, l’A. ne pouvait pas taire le phénomène iconoclaste qui, alimenté par des initiatives de la base autant que par des traités programmatiques de Martin Bucer, fut particulièrement important dans la ville libre d’Empire. Mais ce sont, plus encore, les études de cas qui retiennent l’attention : la destruction des idoles par Moïse selon Vogtherr, le duel entre Élie et les prêtres de Baal (1 R 18) réalisé par Hans Weiditz ou encore l’illustration d’un écrit de Hoffman sur l’Apocalypse. Par ailleurs, cet ouvrage s’inscrit de manière très heureuse dans la tendance qui consiste à s’intéresser non plus simplement aux individus dissidents, mais aux réseaux dans lesquels ils s’inscrivent. À ce titre, sans doute l’utilisation des correspondances épistolaires, lorsqu’elles existent, aurait-elle pu être développée.
Contrairement à ce que pourrait donner à penser le titre de l’ouvrage, toutes ces images dissidentes ne sont pas des images polémiques, loin s’en faut. En outre, il est dommage que l’A. n’ait pas réalisé de table de ces 124 illustrations, données souvent en pleine page mais inégales par leur qualité. On regrettera enfin que son ouvrage soit dépourvu d’index des noms propres, des œuvres citées voire des thèmes, en espérant que ce manque sera comblé lors d’une réédition. En effet, ce livre est appelé à devenir un ouvrage de référence : n’a-t-il pas, dès à présent, sa place dans la somme que Thomas Kaufmann a consacrée à la Réformation et à ses imprimeurs (Die Mitte der Reformation, 2019) ?
Matthieu Arnold
406Heinrich Bullinger, Theologische Schriften, t. 9 : Kommentare zu den neutestamentlichen Briefen. Hebräerbrief – Katholische Briefe. Herausgegeben von Luca Baschera, Zurich, Theologischer Verlag, 2019, xxx + 494 pages, ISBN 978-3-290-18198-7, 145 €.
En cinq ans, entre mars 1532 et mars 1537, Heinrich Bullinger, qui est l’un des grands théologiens et exégètes de la Réforme, a commenté l’ensemble des épîtres du Nouveau Testament. L’ordre suivi par le présent volume, qui présente les commentaires de l’épître aux Hébreux et des épîtres catholiques, ne suit pas l’ordre des livres bibliques, mais celui adopté par Bullinger dans son édition complète de 1537 : Hébreux, 1 et 2 Pierre, 1 Jean, Jacques, 2 et 3 Jean et Jude. La préséance accordée à 1 et 2 Pierre et à 1 Jean explique ce changement : ces épîtres traitent, explique Bullinger, de la « manière la plus pure les principaux articles de notre religion : la foi en Christ, qui purifie ; l’amour, unique précepte du Christ ; la sainte innocence et la patience qui triomphe des maux » (p. 175, introduction aux épîtres catholiques).
Le commentaire de ces épîtres montre combien durablement Bullinger est resté marqué par Érasme, auquel il se réfère très fréquemment. Ainsi, il cite le jugement de l’humaniste, qui juge 1 Pierre « digne du chef des apôtres » (p. 181). Il précise toutefois, en se fondant sur Rufin, que les « anciens (veteres) » qualifiaient Pierre de « princeps apostolorum » sans entendre par là un « primat » sur les apôtres comme le comprennent les « modernes (neoterici) » qui s’opposent à l’Écriture (ibid.). Quant à Luther, auquel il emprunte à l’occasion une traduction en allemand (ainsi, il rend « euplanchnoi/misericordes », 1 P 3,8, par « härtzlich[= herzlich] », p. 239), il le critique indirectement pour avoir contesté l’apostolicité de Jacques (voir p. 373). Là encore, il s’en remet explicitement au jugement d’Érasme, en affirmant qu’il est inutile de se disputer sur l’identité de l’auteur (p. 374), et rappelle, dans l’argument de la lettre, que l’auteur de l’épître visait à corriger les « hommes vains et impies » qui se vantaient de leur foi sans accomplir d’œuvres (p. 375). La foi qu’ils allèguent, précise-t-il à propos de Jc 2,14, n’est nullement celle « à laquelle les Écritures attribuent la justification », mais Jacques l’appelle foi par mimésis (p. 395). La leçon morale de l’épître est obvie : « Veillons chacun, conclut Bullinger, à être […] des personnes qui accomplissent la doctrine de l’Évangile plutôt qu’elles ne l’écoutent » (p. 429).
407L’apparat critique rendra de grands services. Il se compose d’une importante introduction (p. ix-xxx) et d’une annotation qui identifie principalement les sources (elles sont surtout bibliques, Bullinger citant rarement les auteurs anciens ou médiévaux). Les notes infrapaginales signalent également des comparaisons avec des contemporains de B. et expliquent les choix philologiques du théologien zurichois. Une bibliographie (p. 453-466) et plusieurs index – références bibliques (p. 467-481), autres sources (p. 483-486), personnes (p. 487-491) et lieux (p. 493-494) – complètent cette passionnante édition.
Matthieu Arnold
Heinrich Bullinger, Briefwechsel, t. 19 : Briefe von Januar bis März 1547. Bearbeitet von Reinhard Bodenmann, Alexandra Kess, Judith Steiniger. Unter Benützung der Abschriften von Emil Egli und Traugott Schieß. Philologische Beratung durch Ruth Jörg, Zurich, Theologischer Verlag Zürich, 2019, 496 pages, ISBN 978-3-290-18186-4, 145 €.
Le 19e tome de la volumineuse correspondance du Réformateur de Zurich Heinrich Bullinger couvre à peine trois mois. Il n’en renferme pas moins 137 lettres – près de la moitié ont été rédigées entièrement ou partiellement en allemand –, chiffre important qui s’explique par l’effervescence provoquée par les succès militaires de Charles Quint en Allemagne du Sud et la menace qui pèse en conséquence sur les cantons protestants suisses. Alors que seules 24 lettres de Bullinger pour cette courte période sont conservées, il en reçoit quatre à cinq fois plus (certains correspondants, tels que Johannes Haller, no 2759, p. 148, se plaignent d’ailleurs qu’il ne leur réponde pas) ; ainsi, le 12 février, Ambroise Blarer lui écrit de Constance, Bernhard von Cham de Kyburg, Francisco de Enzinas (Dryander) de Saint-Gall, Johannes Gast de Bâle et Gabriel Kröttlin de Ravensburg. De son côté, lorsqu’il dispose de nouvelles qui lui paraissent dignes d’intérêt, Bullinger n’hésite pas à les transmettre à plusieurs correspondants : ainsi, le 14 janvier, il se fait l’écho d’informations de Georg Frölich (Augsbourg) à la fois dans une lettre à A. Blarer (no 2751, p. 121) et dans une missive au Bernois Johannes Haller (no 2752, p. 123). Blarer et Haller comptent 408d’ailleurs parmi les théologiens avec lesquels la correspondance de Bullinger est la plus dense ; on mentionnera aussi, parmi de nombreux destinataires et/ou expéditeurs originaires principalement de la Suisse, l’Italien Celio Secondo Curione, qui a quitté Lausanne pour Bâle et que Josias Simler loue comme un remarquable rhéteur et orateur (no 2766, p. 177).
Dans cette correspondance qui renferme un certain nombre de pièces autographes inédites, il est question notamment de Martin Bucer, que l’étudiant zurichois Ludwig Lavater juge sévèrement (no 2829, p. 374), et de Strasbourg. Avant même que, le 21 mars, Jacques Sturm et les autres légats de la ville ne s’inclinent devant Charles Quint, plusieurs correspondants donnent à Bullinger des nouvelles alarmantes au sujet de la ville libre d’Empire (voir ainsi no 2751, p. 119, Ambroise Blarer ; no 2753, p. 127, Johannes Gast…). Le 21 février, Johannes Haller lui livre des informations détaillées sur les conditions de la paix accordée à Augsbourg (no 2821, p. 339-343), mais l’intransigeant Bullinger ne croit nullement en la parole de l’Empereur. Ce ne sont, écrit-il à Oswald Myconius toujours à propos d’Augsbourg, que pièges et mensonges (no 2788, p. 243 ; cf. au même, no 2738, p. 78, à propos d’Ulm, et no 2835, p. 383, au sujet de Strasbourg). À Johannes Gast, il exprime sa crainte que Strasbourg ait cédé aux « paroles flatteuses » de l’Empereur (no 2850, p. 427). À la mi-mars, Blarer (no 2847, p. 418) redoute également que c’en soit fini de Strasbourg, et Gast reproche amèrement aux villes d’Allemagne du Sud d’adorer l’« idole putride de César » (no 2848, p. 422).
Le 10 janvier 1547, Bullinger adresse, au nom des pasteurs de Zurich, une longue lettre à Bucer et aux scolarques de Strasbourg (no 2745). Cette lettre n’est malheureusement donnée que sous la forme d’un résumé – fort détaillé il est vrai –, puisqu’elle a été publiée auparavant au t. XII du Corpus Reformatorum (CR, et non pas CO comme l’abrègent les Éd., puisqu’il ne s’agit nullement d’un texte relevant des œuvres de Calvin !). La publication sous la seule forme d’un résumé concerne, plus largement, les lettres qui ont fait ailleurs l’objet d’une édition complète (ainsi, une importante lettre de Calvin du 25 février 1547, qui traite longuement de la Cène et qui montre ses divergences d’alors avec le Zurichois ; no 2825), y compris les lettres qui ont Bullinger pour auteur. Les Éd. ont souhaité publier le plus rapidement possible les textes encore inédits, on le comprendra sans peine, mais l’inconvénient de ce procédé, que 409d’autres éditions récentes n’ont pas adopté, n’est pas mince pour l’acquéreur de ces volumes : outre l’édition ancienne du Corpus Reformatorum, il lui faudra consulter la correspondance du libraire Thomas Knight et de son compatriote Richard Hilles (no 2765, 2772, 2826…), ou encore celle de Francisco Enzinas (no 2736, 2783…).
L’apparat critique est, comme pour les tomes précédents, de grande qualité, même si la longue introduction (p. 13-57) se perd parfois dans les questions de détail. Les résumés des lettres sont fidèles et complets, et les notes donnent les renseignements philologiques, historiques voire théologiques que l’on attend d’une édition de cette qualité. Un unique index (p. 473-496) mêle les toponymes et les noms de personnes (avec, le cas échéant, la liste de leurs écrits cités dans le volume).
On saluera l’avancée régulière de cette grande édition, qui existe désormais également sous forme électronique.
Matthieu Arnold
Philipp Melanchthon, Briefwechsel. Band T 21 : Texte 5970-6291 (1551). Bearbeitet von Matthias Dall’Asta, Heidi Hein und Christine Mundhenk, Stuttgart – Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 2020, 484 pages, ISBN 978-3-7728-2663-4, 298 €.
Après le T. 20, qui couvrait plus d’une année de correspondance (voir RHPR 100, 2020, p. 421-424), le T. 21 revient à une périodicité normale puisqu’il couvre à nouveau une année civile. Parmi les 345 pièces de ce volume, on dénombre 58 lettres entièrement ou partiellement inédites. On peut se demander si certaines de ces lettres, qui n’ont été ni rédigées par Melanchthon ni adressées à lui, n’auraient pas dû figurer simplement en annexe ; c’est le cas d’une lettre, datée du début de mars 1551, dans laquelle Dryander (Francisco de Enzinas), écrivant à Calvin, mentionne une lettre qu’il a reçue de Melanchthon avec un libelle d’Osiander (no 6008a).
Il est à noter que les 4/5 de ces lettres ont été rédigées par Melanchthon, sa correspondance « passive » se limitant à 70 lettres environ. Si l’édition de ces 345 textes, rédigés en allemand ou en latin, occupe à peine plus de 430 pages (p. 25-458), c’est parce que nombre de lettres de Melanchthon à des amis proches (souvent des lettres de recommandation) sont de simples billets.
410Durant l’année 1551, Melanchthon continue d’écrire à des correspondants nombreux (plus de 120 destinataires individuels ou collectifs) et variés : amis, tels que Jérôme Baumgartner (Nuremberg), Joachim Camerarius (Leipzig) et Jean Mathesius (Joachimsthal) ; autorités civiles (villes et princes, parmi lesquels le roi Christian III du Danemark, auquel Melanchthon envoie des nouvelles politiques, le prince Georges d’Anhalt ou encore la duchesse Catherine de Saxe) ; théologiens, pasteurs, mais aussi imprimeurs (ainsi, le Bâlois Jean Oporin) et destinataires les plus divers.
Notable est aussi la variété des thèmes traités. Comme Christine Mundhenk, directrice de cette édition, le souligne dans son bref avant-propos (p. 7-8), la polémique avec Andreas Osiander sur la justification (et sur l’habitation du Christ en l’homme) occupe Melanchthon l’année durant (voir ainsi no 6075, 6253, 6268 – « Osiander […] accable nos Églises, comme si elles ne disaient rien de la présence de Dieu en nous », etc.). L’année précédente, Osiander, qui professe désormais à Königsberg, a publié en effet plusieurs disputes latines sur la justification. Plus encore les lettres de Melanchthon et de ses correspondants (notamment les princes) expriment-elles, comme le souligne également C. Mundhenk, leurs soucis à l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle session du Concile de Trente. Avec ses collègues de Wittenberg, Melanchthon rédige à cette occasion des mémoires pour les comtes de Mansfeld, le margrave de Brandebourg ou encore l’Électeur de Saxe (no 6103, 6112, 6127, 6164, 6185, etc.). Il y insiste sur la nécessité d’une unité dans la doctrine chez les protestants allemands – indépendamment de ce qu’ils pensent du Concile.
À côté des questions spécifiques à l’année 1551, on retrouve dans ce volume les thèmes et les genres littéraires propres à l’ensemble de la correspondance de Melanchthon : lettres familières ; suppliques et recommandations pour des bourses ou pour des postes ; lettres destinées à apaiser les conflits entre des pasteurs d’une même paroisse ; préfaces dédicatoires ; conseils… Dans le domaine de la grande politique, Melanchthon s’alarme de la situation en Valachie, où le prince, « ayant rejeté de manière scélérate le nom de chrétien, a embrassé l’impiété mahométane » (no 6176). Écrivant le 1er novembre à l’Électeur de Saxe, il lui déconseille de s’allier à la France contre l’Empereur, qui est « l’autorité légitime (ordenliche obrikeit) » : Dieu n’a-t-il pas offert à l’Empereur des victoires miraculeuses lorsque l’Europe tout entière s’est liguée contre lui (no 6250) ?
411Quiconque s’intéresse, comme nous, à l’histoire de la Réformation à Strasbourg trouvera dans ce volume d’utiles renseignements. Le 2 février, Gaspard Hédion donne à Melanchthon des nouvelles de Strasbourg où, en vertu de l’Intérim, les « papistes » continuent d’occuper trois temples ; devant un auditoire réduit, ils y célèbrent des « messes profanatoires » tandis que, dans les quatre autres paroisses, on prêche la « saine doctrine » (no 5993). Vers la mi-avril, Melanchthon se fait l’écho d’un écrit selon lequel c’est par le poison que Bucer et Fagius seraient morts en Angleterre (no 6052a). Une dizaine de jours plus tard, les théologiens de Leipzig et de Wittenberg écrivent aux pasteurs de Strasbourg au sujet du Concile (no 6063). Le 20 septembre, Melanchthon recommande à Jean Marbach le fils d’un pasteur qui veut étudier à la Haute École dirigée par Jean Sturm (no 6210).
Comme les tomes précédents, ce volume très soigné comprend une liste des correspondants de Melanchthon (p. 469-472), un index des citations bibliques (p. 473-477) et un index des œuvres antérieures (p. 478-481) ou postérieures (p. 482-494) à 1500.
Matthieu Arnold
Registres du Consistoire de Genève au temps de Calvin. Tomes XIII et XIV (17 février 1558 – 2 février 1559). Publiés par Jeffrey R. Watt et Isabella M. Watt, Genève, Droz, coll. « Travaux d’Humanisme et Renaissance » 608, 2020, xliii + 507 pages, ISBN 978-2-600-06052-3, $ 166,80.
La publication des Registres du Consistoire de Genève… se poursuit à un rythme soutenu. Ce sont ici, exceptionnellement, deux tomes qui sont publiés en un seul volume, en raison de la brièveté du treizième tome. Les Éd. nous expliquent la raison de ces procès-verbaux concis. En février 1558, Pierre Alliod, le secrétaire du Consistoire, fut destitué pour le seul fait de n’avoir pas contredit un homme qui avait « maintenu Pierre Vandel estre homme de bien » (p. xi) ; or Vandel avait fui Genève en 1555 après avoir été condamné par contumace à être décapité pour son rôle dans la révolte des « Enfants de Genève ». De l’avis même du Conseil, Jean Boulard, qui remplace Alliod dans les fonctions de secrétaire, avait « la main un peu pesante à escripre » (p. xii), et 412ses minutes ne sont guère détaillées ; c’est pourquoi, en août 1558, Alliod reprit ses fonctions de secrétaire après avoir été pardonné.
Comme pour les années précédentes, les motifs les plus fréquents de convocation par le Consistoire sont tout d’abord les « péchés de la langue » : l’expression de blasphèmes et de « jurements par le diable », ainsi que les chansons interdites. Les questions matrimoniales continuent d’occuper une place très importante : promesses de mariage non tenues, disputes et violences conjugales, abandon du domicile ou encore adultère ; le plus souvent, le Consistoire continue de prôner la réconciliation entre les époux. Cette réconciliation s’avère parfois impossible ; ainsi, le 2 janvier 1559, le Conseil permet à Marguerite Audeberte d’être « mise en liberté » : accédant à la demande du Consistoire, elle a produit les témoins attestant que son mari l’avait abandonnée et s’était « remarié en son pays de Picardie » (p. 226, 11 août 1558). Plus largement, les relations sexuelles illicites (« fornication ») valent à leurs auteurs une comparution devant le Consistoire, que suit généralement une sanction du Conseil.
Si les pratiques de dévotion traditionnelles semblent en recul, les cas d’absence au sermon sont fréquents (« ilz ne hantent gueres les presches, ny moings y font aller leurs femmes » ; à propos de sept hommes, p. 353, 17 novembre 1558). Nombreux sont les pères qui, après avoir accompagné un enfant au baptême, quittent l’église avant la prédication (voir p. 243, n. 317). Bezanson Dada et Claude Châteauneuf sont admonestés pour avoir perturbé le culte en riant, « et ne se sayt souvenir de ce que le prescheur a dit » (p. 215, 28 juillet 1558). Pierre Buisson est entendu pour avoir singé les ministres et déclaré « Demain est le consistoire, il fault faire quelque chose de nouveau » (p. 284, 15 septembre 1558) ; en tournant les pasteurs en dérision, il manifeste son opposition au contrôle social qu’ils s’efforcent de mettre en place.
Comme pour les volumes précédents, l’apparat critique est très soigné. Une introduction détaillée (p. xi-xxvi) situe les décisions de février 1558 à 1559 dans leur contexte historique et met en évidence les principaux thèmes qui se dégagent de ces décisions. Les notes infrapaginales, détaillées et claires, permettent de mieux comprendre les cas traités et d’identifier les protagonistes. Lorsque ces derniers sont renvoyés devant le Conseil de la ville, les Éd. ne manquent pas de signaler comment les autorités civiles ont tranché l’affaire. Enfin, des parallèles éclairants sont établis avec les traités 413ou la correspondance de Calvin. Un glossaire (p. 467-473) et des index détaillés (thèmes, p. 475-478 ; lieux, p. 479-483 ; personnes, p. 485-505) facilitent la consultation de cette édition de référence.
Matthieu Arnold
Clément Marot, Théodore de Bèze, Les Pseaumes mis en rime françoise. Volume I : texte de 1562. Édition critique, variantes, notes et glossaire par Max Engammare, Genève, Droz, coll. « Texte courant » 9, 2019, clxvii + 538 pages, ISBN 978-2-600-05980-0, € 19,80.
Le « Psautier huguenot », paru au début de 1562 et diffusé alors à trente mille exemplaires, connaît enfin, grâce au labeur et à l’érudition de Max Engammare, sa première édition critique.
L’introduction de près de 150 pages constitue une véritable monographie sur l’histoire de la paraphrase versifiée des cent cinquante Psaumes, dont les auteurs comptent au nombre des plus grands poètes de leur époque – Clément Marot pour la poésie de langue française, Théodore de Bèze pour celle de langue latine. L’Éd. commence par présenter l’histoire des huit éditions de ces Psaumes, depuis la parution du psaume 6 translaté en françoys par Clement Marot (1531-1532) jusqu’aux Pseaumes mis en rime françoise, en passant notamment par Aulcuns pseaulmes et cantiques mys en chant (Strasbourg, 1539). Cette édition strasbourgeoise contient, outre 13 psaumes versifiés par Marot, une demi-douzaine de compositions dont on peut attribuer la paternité à Calvin avec plus ou moins de certitude. C’est à partir de l’édition de 83 psaumes par Jean Crespin (Genève, 1551) que Bèze complète, tout d’abord par 34 psaumes, le « beau chef d’œuvre qui en avoit esté laissé imparfait par Clement Marot » (dès 1543, Calvin a fait disparaître ses propres paraphrases). S’il faut attendre 1560-1561 pour que Bèze retrouve l’élan des années 1550-1551, c’est, établit l’Éd. de manière convaincante, parce qu’entretemps son travail exégétique, la polémique contre Castellion et l’organisation de l’Académie de Genève avaient retenu toute son attention. Dans son introduction, l’Éd. signale également les principales corrections apportées par Bèze aux psaumes de 1551. Il traite des sources des deux poètes et, plus longuement, de leur langue dans ses rapports avec l’hébreu. Se 414fondant notamment sur les travaux de V. Ferrer, il développe enfin la question d’une poétique réformée. Il conclut son introduction par des réflexions sur la religion de Marot (voir aussi p. xliv-xlix) : à la différence de Bèze, le « fils spirituel de Calvin », Marot ne serait pas devenu calviniste, mais il serait « resté évangélique » (p. cxvi).
L’édition des 150 psaumes est extrêmement soignée. Ni pesant ni insuffisant, l’apparat critique va à l’essentiel, l’Éd. s’attachant surtout à repérer les modifications opérées par Marot et Bèze sur leur propre texte ainsi que les changements que Bèze a effectués sur la paraphrase de Marot. Ces modifications font parfois l’objet de commentaires développés : ainsi, à propos du fait qu’en 1539, Marot ne parle pas encore, au Ps 1, des « reprouvez ». L’annotation est également attentive à l’original hébreu et elle effectue, entre autres, des comparaisons avec la Bible d’Olivétan, le commentaire des Psaumes de Bucer (édition de Genève, 1554) ou encore les Chrestiennes méditations de Bèze (1583). L’Éd. donne par ailleurs en annexe les textes de Calvin d’après la Forme des prieres et chantz ecclesiastiques (Genève, 1542) : les psaumes 25, 36, 46, 91, 113 et 138 ; le cantique de Siméon ; l’« oraison de nostre Seigneur Jesus Christ » (« […] Mais du maling cauteleux et subtil, Delivre nous O Pere ainsi soit-il ») ; « Les articles de la foy » ; « Les dix commandemens [sic] ». Dans l’introduction comme dans l’annotation, l’Éd. souligne, à la suite d’interprètes tels que P. Pidoux, la supériorité des vers de Marot sur ceux de Calvin, dont les psaumes versifiés ont disparu dès 1543. On le concèdera sans peine, mais si l’on fait abstraction de la virtuosité de la technique poétique de Marot, la traduction par Calvin du début du Ps 46, « Nostre Dieu nous est ferme appuy, Vertu, fortresse et seur [= sûr] confort » (p. 489), est plus rigoureuse et plus forte que celle de Marot, « Des qu’adversité nous offense, Dieu nous est appuy et defense » (p. 155). Chez Calvin comme chez Luther (« Ein’ feste Burg ist unser Gott »), l’essentiel est dit dès les premiers mots.
Une bibliographie (p. cxxix-cxxxviii), un tableau des 150 psaumes versifiés par Marot, Calvin et Bèze (p. cxlix-cxlvii), un glossaire (p. 513-528) et un index (p. 529-535) contribuent à faire de cette édition, proposée à un prix fort raisonnable, un ouvrage de référence.
Matthieu Arnold
415Rasse des Neux, Recueil poétique (BnF, Manuscrit français 22565). Édition critique par Gilbert Schrenck avec la collaboration de Christian Nicolas, Paris, Classiques Garnier, coll. « Textes de la Renaissance » 218, 2019, 582 pages, ISBN 978-2-406-07921-7, 59 €.
Il y a quelques années, G. Schrenck a présenté, dans les colonnes de la RHPR (97, 2017, p. 527-544), les livres théologiques de la riche bibliothèque de François Rasse des Neux (vers 1525 – vers 1587), chirurgien parisien aux convictions huguenotes. Il soulignait, dans cette étude, que Rasse n’avait rien écrit à titre personnel mais qu’il avait réuni un nombre important de pasquils, poèmes énigmatiques et satiriques. Le Recueil poétique (Ms fr 22565 de la Bibliothèque nationale de France) fait partie des six recueils manuscrits dans lesquels Rasse a regroupé les pièces les plus diverses sur les affaires de son temps. Les 252 feuillets du Ms fr 22565 constituent un épais cahier de 345 pièces (la plupart ont été transcrites, quelques-unes ont été collées, imprimées), leur ajoutant à l’occasion des titres, des dates (pour 47 d’entre elles) et des soulignements.
L’introduction des Éd., fort substantielle (p. 9-109), traite de la réception des recueils de Rasse, des travaux critiques qui leur ont été consacrés et du milieu familial de Rasse, avant de s’attarder sur sa bibliothèque. Cette dernière s’est constituée en grande partie par des échanges avec des membres de l’élite curiale dont Rasse faisait partie. À côté de la théologie, évoquée plus haut, les sciences et techniques, de même que l’histoire contemporaine (ainsi, de nombreux livres consacrés aux événements de la guerre contre les Turcs), occupent une place de choix. La collecte de Rasse s’est étendue de 1540 à 1575, mais elle ne documente les guerres civiles que de manière incomplète (ainsi, la conjuration d’Amboise, no CCLVI, la mort de Condé à Jarnac, no VI et CXCVI, la paix de Saint-Germain, no XLVIII, ou encore les années 1574-1576). Les pièces collectées ne ressortissent pas seulement à la satire politique, avec un « tableau glaçant de la cour » (p. 88), mais elles relèvent aussi de la satire des mœurs (avec maintes pièces gaillardes d’une verve toute rabelaisienne) et de la satire religieuse (à commencer par la satire de Rome et de la papauté). Rasse a réuni les pièces de nombreux poètes, souvent anonymes, mais Du Bellay et Ronsard sont quasi absents de sa collecte.
Ce recueil de poèmes, édité avec grand soin (p. 117-485 ; les variantes sont données aux p. 487-493), met en évidence le vif 416intérêt de Rasse à la fois pour le parti des Politiques et pour les théologiens marqués par la dissidence. Un tableau chronologique et historique (p. 112-114) et un glossaire (p. 499-503) complètent l’annotation historique, religieuse et littéraire. L’ouvrage comporte une importante bibliographie (p. 505-530). La consultation des pièces est facilitée par une table alphabétique des incipit et une table chronologique (p. 545-568) ainsi que par un index des noms de personnes (p. 531-543).
Matthieu Arnold
Julien Gœury, La Muse du Consistoire. Une histoire des pasteurs poètes des origines de la Réforme jusqu’à la révocation de l’édit de Nantes. Préface d’Olivier Millet, Genève, Droz, coll. « Cahiers d’Humanisme et Renaissance » 133, 2016, ix + 867 pages, ISBN 978-2-600-01960-6, 45 €.
Professeur de littérature française du xvie siècle à l’Université de Picardie-Jules Verne, l’A. est un spécialiste de la poésie de la Renaissance et de l’âge baroque, en particulier de Jean de La Ceppède (étude sur L’autopsie et le Théorème. Poétique des Théorèmes de Jean de La Ceppède, 2001), de Laurent Drelincourt (édition critique des Sonnets chrétiens sur divers sujets, 2004), d’Agrippa d’Aubigné (édition critique de l’Hécatombe à Diane en 2007, revue et augmentée en 2010) et d’André Mage de Fiefmelin (édition critique d’un premier volume d’Œuvres, 2015).
Il convient d’emblée de saluer le travail de l’A., qui dresse une histoire parallèle du protestantisme de langue française d’avant la Révocation sous un angle original, sous forme d’ellipse dont les deux foyers seraient le pastorat et la poésie : les définitions de « pasteur » et de « poésie » sont ici entendues au sens large. Il s’agit de pasteurs réformés, mais aussi de prédicants, de chefs de communautés diverses ayant rédigé des ouvrages en vers (y compris des textes rimés relevant du genre théâtral). Le corpus d’ouvrages étudiés (88 au total) est réparti en trois grandes périodes : 1533-1568, de Mathieu Malingre à Louis Des Masures, correspond à l’établissement des Églises réformées à Genève et dans le Royaume de France ; 1569-1609, d’Antoine de Chandieu à Simon Goulart, recouvre les guerres civiles ; 1610-1680, de Paul Ferry à Laurent Drelincourt, se situe sous le régime de l’Édit de Nantes.
417L’A., à travers ces trajectoires diverses – une quarantaine –, cherche à établir une sorte de portrait du pasteur poète, celui qui met son art au service de son Église, mais aussi (ces œuvres sont signées) à son propre service, marquant son appartenance à « […] une grande communauté lettrée, pour laquelle la poésie constitue toujours un signe de reconnaissance infaillible » (p. 712). Mais au-delà de ces considérations sociologiques, on lira cet ouvrage comme un inventaire de trajectoires souvent singulières, à commencer, pour ce qui est des grandes figures, par Jean Calvin (assez curieusement, le très utile tableau bibliographique de fin de volume ne mentionne pas Aucuns Pseaulmes et cantiques mys en chant de 1539, contenant, à côté de ceux de Marot, des psaumes traduits et versifiés par le réformateur, alors pasteur à Strasbourg) et Théodore de Bèze, mais aussi Louis des Masures (ami de Ronsard), Antoine de Chandieu, Simon Goulart, le théologien Moyse Amyraut, le marginal Jean de Labadie ou encore le pasteur de Niort, Laurent Drelincourt.
Tous ces auteurs, connus par ailleurs, sont présentés à l’aune de leurs publications poétiques, ce qui a pour effet de redistribuer les hiérarchies héritées de l’histoire strictement théologico-ecclésiale. L’un des autres intérêts de l’ouvrage est d’attirer l’attention du lecteur sur une série de pasteurs dont l’histoire ecclésiastique n’avait pas spécialement retenu le nom, en particulier au xviie siècle, mais auxquels la qualité de poètes confère dans la société le rang d’hommes de lettres – et cela, même si leur production relève strictement du genre religieux. Reste que l’A., fidèle à son programme de départ, n’aborde pas la question de la valeur littéraire des œuvres. Toutes les œuvres citées ne figurent d’ailleurs pas dans l’ouvrage et ne sont pas consultables aisément, même en bibliothèques virtuelle ou réelle, ce qui pourrait frustrer le lecteur amateur de poésie religieuse. Le volume comporte toutefois en annexe une série de liminaires permettant de préciser le projet littéraire d’un certain nombre de ces pasteurs-poètes, ainsi qu’une volumineuse bibliographie, un index des noms des personnes et un index des noms de lieux.
Philippe François
418xix e -xxi e siècle
Jean-Frédéric Oberlin, Gesammelte Schriften / Écrits choisis. Tome I/6 : Briefwechsel und zusätzliche Texte / Correspondance et textes complémentaires 1811-1819. Textes établis et annotés par Gustave Koch, Herzberg, Verlag Traugott Bautz, 2020, 399 pages, ISBN 978-3-95948-504-3, 50 €.
Avec plus de 200 lettres et documents divers (no 864-1070), y compris des prières, cet avant-dernier tome de la correspondance du pasteur Jean-Frédéric Oberlin (1740-1826) couvre la période qui va de 1811 à 1819.
Oberlin, désormais sexagénaire, connaît en février 1811 une alerte très sérieuse (une « violente pleurésie » selon Jean Frédéric Claude, no 867, p. 28, n. 28). Il se plaint de plus en plus non seulement de son labeur incessant (« ce qui me peine le plus, c’est la quantité innombrable de travaux, dont je suis assailli et accablé de toutes part », no 869, p. 30), mais encore de sa santé et de son âge. C’est sans doute pour cette raison que, le 2 avril 1811, il rédige un testament qui confie aux soins de ses enfants Louise Scheppler, « ma fidèle garde, celle qui vous a élevés, l’infatigable Louise » (no 871, p. 32). Or, à lire Louise Scheppler écrivant à l’une des filles d’Oberlin, « il se porte bien, Dieu en soit loué, pour son âge. Il continue ses fonctions et ouvrages comme à l’âge de 50 à [sic] 60 ans » (no 893, p. 66).
De fait, durant cette décennie, Oberlin poursuit inlassablement son action pastorale et éducative indépendamment des changements politiques et il a le bonheur de vivre quelques succès significatifs. Ainsi, dès 1812, grâce à l’intervention du préfet du Bas-Rhin, Adrien Lezay-Marnésia, qui lui témoigne une vive estime, le procès concernant la propriété des forêts du Ban-de-la-Roche se termine à son avantage. Ce même Lezay-Marnésia adresse vers la fin de 1812 à Oberlin, qui en est un « zélé défenseur », un rapport sur les vaccinations dans le Bas-Rhin (no 924, p. 113 sq.). En 1814, Oberlin se voit accorder, en récompense de son « dévouement au Roi [Louis XVIII] », la décoration de la Fleur de Lys (no 951, p. 153 ; no 958, p. 159). Quelques années plus tard, à la fin de 1819, le Roi le nommera chevalier de la Légion d’Honneur (no 1059 à 1061, p. 364-369). En 1815, afin de prévenir les villages des pillages et des représailles des puissances alliées contre la France, Oberlin prie fermement les préposés de Bellemont et de Bellefosse de rassembler 419et de déclarer armes et poudre : « Soyez fermes et sévères comme des lions. Le repentir viendrait trop tard » (no 966, p. 171).
En 1816, la Société royale et centrale d’agriculture reçoit un rapport détaillé sur son action dans les domaines de l’instruction primaire, de l’agriculture et de l’industrie (no 980, p. 191-200) ; toutefois, ce n’est que deux ans plus tard qu’elle décide de lui accorder la médaille d’or pour ses services « rendus à l’humanité et à l’agriculture dans le Ban de la Roche » (no 1025, p. 295 ; cf. no 1027, p. 308 ; no 1030, p. 316-325, où Oberlin est présenté comme un « miracle de vertu »). Entretemps, au début de 1817 et suite aux mauvaises récoltes de l’année précédente, Oberlin est contraint d’appeler à l’aide le Directoire de l’Église de la Confession d’Augsbourg ; les luthériens de la région viennent au secours de leurs « frères du Ban de la Roche [qui] sont prêts à succomber à la famine » (no 999, p. 252 ; cf. no 1001, p. 255 sq. et no 1004, p. 261).
C’est en 1816 que, en lien avec la Société biblique britannique, est créée la Société biblique de Waldersbach (voir no 984, p. 210-212 ; no 986, p. 214-223) ; dès lors, des Bibles sont distribuées en grand nombre dans toute la France à partir du presbytère d’Oberlin (voir ainsi no 993, p. 239-243). Auparavant, Oberlin achetait quantité de Nouveaux Testaments et de Bibles en français chez le libraire parisien d’origine strasbourgeoise Jean Georges Treuttel (voir no 892, p. 65). C’est après une tournée « biblique » dans le sud de la France que Henri Gottfried, fils d’Oberlin, décède le 15 novembre 1817 (voir no 1017, p. 282). La visite que John Owen, secrétaire de la Société biblique britannique, fait à Oberlin du 11 au 14 septembre 1818 nous vaut une belle description de l’action et de la personnalité du patriarche (no 1040, p. 336-340).
La correspondance des années 1811-1819 est riche en informations sur l’œuvre éducative d’Oberlin et de ses conductrices : à Jean Laurent Blessig il rapporte, le 8 avril 1811, comment une conductrice, envoyée dans un hameau où certains enfants ne connaissaient que l’allemand alors qu’elle n’en savait pas un mot, est parvenue, grâce aux enfants patoisants, à leur enseigner des histoires en français (no 874, p. 38 sq.) ; c’est à Blessig également qu’Oberlin transmet des informations sur sa catéchèse (« Kinderlehre », no 880, p. 48 sq.), qu’il se garde de fonder sur la contrainte. Le rapport qu’Oberlin fait en 1816 sur l’instituteur Nicolas Claude, en poste à Waldersbach depuis 1801, renferme quant à lui d’utiles informations sur l’instruction primaire, depuis l’enseignement de l’alphabet jusqu’à l’inspection hebdomadaire des écoles de la paroisse par le pasteur (no 988, p. 225-227).
420Oberlin récompense les comportements civiques de ses paroissiens (ainsi, le fait de couvrir de terre ou d’« autre litière » toute « ordure humaine ») par des dons d’ouvrages religieux et de recueils de cantiques, ainsi que de vêtements et d’outils ; sont toutefois exclus des bénéficiaires « ceux qui suivent les nouvelles modes, soit pour les cheveux des femmes, soit pour l’habillement des hommes et des femmes » (no 906, p. 88 ; cf. no 919, p. 105 : « […] de partager les cheveux sous le bonnet, de ne pas peigner les cheveux assez en arrière, de porter des corcelets trop courts, etc. »). Le souci de la vêture « décente » et la lutte contre le « luxe » ou « quelque nouvelle mode » se retrouvent dans le Règlement de l’aumône qu’Oberlin rédige le 14 juin 1818 (no 1035, p. 331 sq.). Il y fustige aussi les « coureurs de fêtes ou danses » et ceux qui « font jetter les cartes ». Dans le domaine pastoral et théologique, signalons les deux dessins qu’Oberlin – qui continue par ailleurs de s’intéresser aux cas de possession (no 865, p. 23-26) – a réalisés le 4 mars 1818, et qui représentent respectivement l’« image du cœur qui est le temple du Saint-Esprit » et l’« image de l’Intérieur d’un homme qui sert le péché et se laisse dominer par Satan » (p. 312-315). On ne sera guère surpris que le premier témoigne « activité et zèle puisé dans l’amour de Dieu et des humains », tandis que le second, comme l’escargot, se caractérise par sa « paresse », sa « froideur », sa « lenteur » et sa « tiédeur ».
Comme dans les volumes précédents, l’annotation est sobre mais toujours pertinente, et chaque lettre allemande ou française est précédée par un résumé dans l’autre langue. Une liste chronologique des lettres et autres textes (p. 11-17), une liste des correspondants (p. 18-20) et deux index (Bible, p. 385 ; personnes, p. 387-398) facilitent la consultation de cette édition de référence.
Matthieu Arnold
Hélène Lanusse-Cazalé, Protestants et protestantisme dans le sud aquitain au xixe siècle. Une minorité plurielle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2018, 385 pages, ISBN 978-2-7535-7512-7, 29 €.
En dépit d’études locales portant notamment sur le Béarn, une enquête sur le protestantisme dans le sud aquitain (Landes, Basse-Pyrénées, Hautes-Pyrénées) entre la promulgation des Articles organiques et la Séparation des Églises et de l’État faisait défaut 421jusqu’à présent. C’est tout le mérite de la présente étude, qui se fonde sur une thèse de doctorat sans doute fortement réduite pour la publication, que de combler cette lacune.
La première partie, « Les Églises protestantes : instances normatives, dissidences et jeux de pouvoir », examine les protestants principalement sur le plan des institutions et des doctrines, après avoir analysé quelques données démographiques et sociologiques ; l’« infime minorité » que constituent les protestants disséminés de cette région se caractérise par sa grande hétérogénéité socio-professionnelle (ch. 1). Le long chapitre 2 (« Un protestantisme pluriel ») nous renseigne non seulement sur les protestants réformés, avec leurs pasteurs et leurs Anciens, mais encore sur les cultes protestants minoritaires : l’Église évangélique indépendante et les darbystes, dont le mouvement se développa dans le sud aquitain dès 1837, non sans heurt avec les réformés. Entre 1848 et 1852, les Églises réformées béarnaises sont elles-mêmes divisées par la querelle doctrinale provoquée par Felix Pécaut, alors pasteur à Orthez. C’est au chapitre 3, qui entend « délaisser un temps les institutions pour s’intéresser aux individus » (p. 111), qu’il est question des cultes dans leur diversité, mais aussi du rôle des femmes de pasteurs dans les relations entre les communautés protestantes françaises et étrangères, ou encore des prises de position protestantes par rapport à la Séparation.
Les trois chapitres de la deuxième partie, « Une présence affirmée au sein de l’espace public », traitent successivement de l’assise matérielle des cultes protestants, des œuvres charitables et sociales et de l’engagement politique des protestants. Les Articles organiques, nous apprend le chapitre 4, n’ont pas permis au protestantisme sud-aquitain de jouir du jour au lendemain des mêmes droits que le catholicisme mais, en maints lieux, il lui a fallu attendre le milieu du xixe siècle pour pouvoir bâtir ou reconstruire ses temples et y célébrer ses cultes. L’architecture de ces édifices cultuels est présentée de manière détaillée, photographies ou plans à l’appui. Dans les œuvres charitables (ch. 5), les femmes exercent un rôle actif et important, puisqu’elles assurent la gestion quotidienne des établissements caritatifs. À la fin du xixe siècle, le développement du christianisme social renforce l’engagement des protestants auprès des plus démunis, et cette action sociale s’accompagne de la lutte pour la tempérance et la moralité. Dans le Béarn comme dans le reste de la France, l’adhésion des protestants à la iiie République 422(ch. 6) se manifeste comme une opposition au catholicisme monarchiste, et leur attitude dans l’Affaire Dreyfus ne diffère pas de celle de leurs coreligionnaires à l’échelle nationale.
La troisième partie pose la question d’une identité protestante, marquée selon l’A., qui suit ce point A. Encrevé, par la non-appartenance à la majorité catholique, ainsi que par la mémoire. Aussi est-ce dans cette dernière partie que sont traitées les œuvres éducatives (écoles protestantes, Écoles du dimanche et Union chrétiennes, ch. 7), lesquelles participent aussi d’une démarche évangélisatrice. Des pages utiles, mais trop brèves, sont consacrées aux bibliothèques populaires protestantes (il est difficile d’en connaître le contenu précis), ainsi qu’au journal Le Protestant béarnais. La relation des protestants à la mémoire et, plus largement, l’émergence d’une culture protestante (ch. 8), ne manquent pas de raviver les controverses avec l’Église catholique. Les Lettres aux habitants d’Orthez, qui professent la religion protestante, publiées en 1825 par l’évêque de Bayonne (voir p. 272-277), ne sont pas sans rappeler l’épître que, près de trois siècles auparavant, Jacques Sadolet avait adressée aux Genevois en l’absence de Calvin. Toutefois, la mémoire des protestants du sud aquitain s’est rattachée aussi à la culture locale, puisqu’ils ont joué un rôle important dans la redécouverte des Pyrénées à partir des années 1850. C’est également une touche locale qui caractérise le rapport des protestants de cette région aux missions (ch. 9). Certes, comme leurs coreligionnaires à l’échelle de la France, ils soutiennent activement la Société des Missions évangéliques de Paris (1822), d’autant plus que le célèbre Eugène Casalis a grandi à Orthez ; mais ils se distinguent aussi par leur soutien à l’évangélisation clandestine qui se développe en Espagne dès les années 1820.
Les perspectives retenues permettent par l’A., dont l’enquête se fonde sur de nombreux documents d’archives et des sources imprimées (voir p. 335-340), lui ont permis de dresser un tableau fort complet des protestantismes dans le sud aquitain : les protestants à l’échelle d’une ville – en particulier celle d’Orthez ; les relations entre les Églises locales et avec le niveau régional, voire national ; les relations internationales, par le biais notamment des Sociétés de missions. Seule la question de la piété nous semble n’avoir guère été traitée, en dépit du titre du chapitre 3, « La religion vécue par les fidèles ». Par ailleurs, l’ouvrage présente un certain nombre de coquilles et l’on rendra leurs prénoms à Roger Mehl (« Robert », p. 126) et à Jean-Pierre Bastian (« Jean-Paul », p. 341).
423Cette étude fouillée ne se lit pas moins avec un grand intérêt, et l’on espère que l’A. pourra en développer maints aspects dans des publications ultérieures.
Matthieu Arnold
André Encrevé, Les protestants français et la vie politique française. De la Révolution à nos jours, Paris, CNRS Éditions, 2020, 599 pages, ISBN 978-2-271-12057-1, 29 €.
Il y a trente-cinq ans, l’A. publiait une synthèse magistrale sur les Protestants français au milieu du xixe siècle. Le présent volume, recueil de 25 articles parus entre 1971 et 2015, repris tout ou partie et remaniés pour la plupart d’entre eux, complète cet ouvrage en amont comme en aval. En effet, ces études couvrent plus de deux siècles, depuis l’Édit de tolérance de 1787 (ch. 1) jusqu’au début du xxie siècle (ch. 25). Il n’est pas surprenant qu’elles se recoupent sur certains points et que l’on trouve par conséquent quelques répétitions ; c’est le cas, par exemple, de la mention à trois reprises de la fameuse lettre de Karl Barth au théologien tchèque Hromadka (19 septembre 1938).
La page de couverture est illustrée par la photographie noir et blanc de François Mitterrand et du premier gouvernement de Pierre Mauroy (27 mai 1981). Figuraient dans ce gouvernement pas moins de six protestants (tous ces ministres n’entretenaient pas, il est vrai, un rapport étroit avec leur confession), chiffre élevé puisque les protestants représentaient alors, selon les estimations les plus optimistes, 2 % des Français. Est-ce à dire que, de la Révolution à nos jours, le protestant français serait nécessairement un homme de gauche ? À cette question il faut apporter une réponse nuancée, comme le montre la lecture du présent livre.
En effet, chacune des vingt-cinq études fouillées, nuancées et de première main, met en évidence la palette assez large des positions politiques des protestants français ; toutefois, ainsi que l’établissent notamment les articles sur les protestants et la Commune de Paris (ch. 10) et sur Réforme face à la guerre d’Algérie (ch. 21), ces positions se rapprochent très majoritairement d’un « juste milieu ».
Ces articles mettent aussi en lumière combien durablement le protestantisme français s’est défini en opposition au catholicisme, 424et ils confirment la thèse de Patrick Cabanel sur les « affinités électives » entre le protestantisme et le judaïsme français. (En retour, on aurait aimé en apprendre davantage sur les réactions du judaïsme français face à ce soutien presque sans faille depuis l’affaire Dreyfus jusqu’en 1948, voire jusqu’à la Guerre des six jours – ch. 23.) Ainsi, la remarquable étude sur les protestants et l’affaire Dreyfus (ch. 13), attentive aux évolutions des positions protestantes entre 1897 et 1899, établit que le soutien à Dreyfus s’est appuyé sur des considérations morales et sur la solidarité avec le « peuple juif », mais aussi qu’il a aussi pris sciemment le contrepied de l’attitude antidreyfusarde des ecclésiastiques catholiques.
La virulence des rapports entre catholiques et protestants, marqués au tournant entre le xixe et le xxe siècle par une véritable haine, ne manquera pas de surprendre les protestants d’Alsace et de Moselle. Ces derniers sont, il est vrai, largement absents du présent ouvrage, même si, de 1648 à 1871, puis depuis 1918 à l’exception des années 1940-1944, leur région est bien française. Il est significatif qu’Albert Schweitzer, qui pourtant a été salué comme un « homo politicus », et Oscar Cullmann, qui a refusé que les « révolutionnaires » de son temps se réclament du Nouveau Testament, n’apparaissent nulle part dans ce livre où ils auraient eu toute leur place. La portion congrue accordée aux protestants d’Alsace et de Moselle s’explique en partie, il est vrai, par le fait que nombre des articles ici réunis sont issus d’actes de colloques ou de volumes collectifs ; dans ces volumes, d’autres historiens que l’A. ont consacré une contribution au protestantisme « concordataire ». Toutefois, il aurait été d’autant plus intéressant que cet ouvrage fît entendre la voix de ce protestantisme, majoritairement luthérien, que l’un des fils conducteurs de l’histoire du protestantisme français au xxe siècle est son rapport à l’Allemagne : au lendemain de la « Grande Guerre » (ch. 16), entre 1933 et 1939 (ch. 17), durant la Seconde Guerre mondiale (ch. 19) et juste après cette dernière, lorsque Réforme fit connaître à ses lecteurs la Déclaration de repentance de Stuttgart, la figure de Martin Niemöller et la situation dramatique de l’Allemagne au début de 1946 (ch. 20).
Matthieu Arnold
425Anthony Obikonu Igbokwe, Albert Schweitzer’s Thoroughgoing De-Eschatologization Project as a Secular Soteriology, Münster, Aschendorff, coll. « Studia oecumenica Friburgensia » 87, 2019, vi + 369 pages, ISBN 978-3-402-12219-8, 54 €.
Prêtre catholique, l’A. a étudié la philosophie au Nigéria et en Espagne. Le présent ouvrage est le fruit de sa thèse de doctorat, soutenue à Fribourg sous la direction de Barbara Hallensleben. L’introduction rappelle, à propos de l’« énigme Schweitzer », les jugements variés et souvent contradictoires qui ont été portés sur Schweitzer philosophe et théologien. Mais faut-il imputer cette absence de consensus à l’« ambiguité » de la pensée de Schweitzer (p. 3) plutôt qu’aux différents points de vue d’après lesquels on a considéré son œuvre polymorphe ? Les véritables connaisseurs de l’œuvre de Schweitzer, tels que Fritz Buri ou Werner Zager, rappellent fort justement qu’il fut un théologien de formation et qu’il est resté théologien « jusqu’au bout » (p. 5). L’introduction pose aussi la question, qui sous-tend l’ensemble de l’ouvrage, des rapports entre le pan théologique et le pan philosophique de l’œuvre écrite de Schweitzer.
L’intérêt du présent livre est donc de considérer l’œuvre de Schweitzer comme un tout, sans vouloir opposer sa théologie et sa philosophie ; mais c’est aussi, on le verra, sa principale faiblesse… L’A. défend la thèse selon laquelle Schweitzer aurait attribué à son éthique une signification sotériologique (le mysticisme éthique de Schweitzer serait une « sotériologie séculière », p. 25) et que son étude de la vie du Jésus historique aurait été sous-tendue par la question implicite suivante : « Quelle signification salvifique (messianique) la vie et l’enseignement de Jésus revêtent-ils pour nous aujourd’hui ? » (p. 21 et 359). On pourra discuter cette thèse, de même que le choix de contextualiser les recherches de Schweitzer sur le Nouveau Testament à partir des influences philosophiques qui se sont exercées sur lui (Kant, Schopenhauer et Nietzsche, ch. 1) plutôt qu’à partir des travaux néotestamentaires de ses devanciers et de ses contemporains, que l’A. connaît d’ailleurs assez mal. On pourra regretter aussi la relative faiblesse des développements sur le libéralisme théologique et les liens entre Schweitzer et ce courant de pensée (ch. 2, p. 85-87). Il n’en demeure pas moins que l’analyse de la Geschichte der Leben-Jesu-Forschung est menée – à partir de la seule version anglaise, The Quest of the Historical Jesus – de 426manière rigoureuse et présentée avec une grande clarté (ch. 2). Il en va de même pour la présentation des idées de Schweitzer sur le Royaume de Dieu tel que l’aurait compris Jésus, même si ses différents travaux néotestamentaires y sont agglomérés dans un exposé qui ne laisse guère de place aux évolutions de sa pensée (ch. 3). La question de la messianité de Jésus puis celle de sa passion et de sa mort ne sont abordées qu’aux chapitres 4 et 5, alors qu’elles avaient préoccupé Schweitzer dans ses premiers travaux. Le chapitre 6 traite principalement du « mysticisme éthique » de Schweitzer, et, outre les travaux exégétiques, il se fonde sur la Kulturphilosophie (d’après l’édition anglaise, The Philosophy of Civilization). L’A. estime que l’eschatologie conséquente de Schweitzer a constitué une phase préparatoire de sa « mystique éthique » (p. 310), donc le « respect de la vie ». Schweitzer philosophe aurait ouvert une boîte de Pandore qu’il aurait été incapable de refermer ensuite en tant que théologien (voir p. 311). L’évaluation de la pensée de Schweitzer est menée au moyen de comparaisons avec d’autres théologiens protestants, tels que Dietrich Bonhoeffer ou Paul Tillich (ch. 7). La conclusion reprend l’idée qu’il faut lire les travaux exégétiques de Schweitzer à la lumière de sa conception philosophique du monde et que, dans son « œuvre », c’est la philosophie qui l’emporte clairement sur la théologie (p. 357).
Qu’il y ait des passerelles entre les différentes disciplines dans lesquelles Schweitzer s’est illustré tombe sous le sens. Que son œuvre soit marquée par une grande cohérence apparaît aussi à ceux qui l’ont lue de manière approfondie. Il n’empêche, Schweitzer ne mélange pas les genres, et les méthodes qu’il met en œuvre dans son analyse impitoyable des biographies de Jésus ne sont pas les mêmes que celles qui sous-tendent la Kulturphilosophie. Ses travaux sur le Nouveau Testament, même s’ils sont nécessairement marqués par des présupposés théologiques, ne se prêtent pas d’abord à une analyse relevant de la théologie systématique et indifférente à la chronologie.
Les faiblesses liées au parti pris méthodologique de l’A. sont accentuées, nous semble-t-il, par la peine qu’il a parfois à trancher lorsqu’il présente les positions antagonistes de travaux de valeur très inégale. Son ignorance de la littérature en français (la bibliographie, p. 361-369, est assez limitée), voire de la correspondance théologique et philosophique de Schweitzer, l’amène par ailleurs à souscrire encore au jugement selon lequel les critiques portées sur la Geschichte der Leben-Jesu-Forschung l’auraient persuadé qu’il 427n’avait aucun avenir universitaire (p. 6). Faut-il rappeler que, dans les années 1920 encore, en Suisse et en Allemagne, des Facultés de Théologie prestigieuses offrirent des postes à Schweitzer ?
En dépit de ses limites, ce livre témoigne de l’attrait durable exercé par la pensée de Schweitzer, donne un aperçu clair de ses principaux écrits et nous introduit à des débats stimulants.
Matthieu Arnold
Heinrich Rusterholz, « … als ob unseres Nachbars Haus nicht in Flammen stünde ». Paul Vogt, Karl Barth und das Schweizerische Evangelische Hilfswerk für die Bekennende Kirche in Deutschland 1937-1947, Zurich, Theologischer Verlag, 2015, 712 pages, ISBN 978-3-290-17712-6, 65 €.
L’importance du présent ouvrage justifie la publication du présent compte rendu, fût-il tardif. L’A., ancien président du conseil de l’alliance des Églises protestantes en Suisse, livre en effet une étude qui apporte nombre d’informations nouvelles sur le protestantisme en Suisse et en Allemagne entre 1937 et 1947, et sur ses liens avec le judaïsme : non seulement cet ouvrage confirme combien, depuis la Suisse, Karl Barth a continué à agir en faveur de l’Église confessante, mais il établit encore qu’en Suisse, des protestants – à commencer par le pasteur Paul Vogt – se sont mobilisés avec force et persévérance pour sauver les juifs des camps d’extermination auxquels les vouait le régime nazi. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, des monographies et des ouvrages collectifs publiés par une commission indépendante d’experts sur la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale avaient critiqué tant l’ensemble de la Confédération helvétique que le protestantisme suisse pour son « humanité rationnée » (H. Kocher). Le présent ouvrage, fruit d’un travail de longue haleine qui se fonde en grande partie sur les archives de Karl Barth (Bâle), montre qu’il faut nuancer ce propos et qu’à maints égards, les réformés suisses (plus de 700 paroisses ont soutenu Vogt et son œuvre) n’ont pas à rougir de leur attitude durant la Seconde Guerre mondiale.
Le fondateur et l’âme du « Schweizerisches Hilfswerk » fut Paul Vogt (1900-1984), pasteur de paroisse à Zurich-Seebach qui s’était tout d’abord engagé dans le soutien aux chômeurs. Tôt sensible au sort de 428l’Église confessante – notamment de sa figure emblématique, Martin Niemöller – et des juifs en Allemagne, il gagna le soutien puis l’amitié de Karl Barth pour créer en 1937 son œuvre en faveur des confessants ; il chercha inlassablement, mais pas toujours avec succès, à convaincre le protestantisme suisse de prendre officiellement parti en faveur de l’Église confessante et des réfugiés allemands. Il entretint des contacts directs avec les membres de cette Église et en accueillit en Suisse. Entre 1938 et 1942, il organisa, avec Barth et E. Thurneysen, des colloques destinés aux théologiens comme aux « laïcs » ; largement fréquentées, ces manifestations traitaient en particulier du rapport entre l’Église et Israël. À partir de 1943, Vogt obtint de l’Église réformée de pouvoir se consacrer à temps plein au secours aux réfugiés – pour lesquels il était déjà intervenu sans relâche depuis 1933.
L’aide apportée aux confessants, qui avaient été laminés par le nazisme et dont certains chefs s’étaient discrédités aux yeux de l’opinion internationale en publiant, à Pâques de 1940, un message de soutien sans réserve au combat des soldats allemands (ils luttaient pour la « paix » et le « salut de [leur] patrie » !, p. 199), fit place à celle prodiguée aux juifs et aux chrétiens « non aryens ». Grâce à ses nombreux contacts à l’étranger, dès 1942 Vogt put informer l’opinion publique des déportations ; il organisa des rencontres avec les rabbins de Zurich, de Bâle et de Genève. Avec le soutien de 36 personnalités (dont Barth, E. Brunner, Ch. von Kirschbaum, A. de Quervain, E. Thurneysen et W. Vischer), il adressa, à Noël 1942, une lettre officielle aux juifs de Suisse pour leur témoigner la solidarité des protestants dans leur « détresse sans nom » et pour condamner sans ambiguïté la « pensée païenne qui prenait la remorque de l’antisémitisme » (p. 344). En dépit d’un « antisémitisme latent » (p. 322) dans leur pays, les réformés suisses étaient d’autant plus sensibles au sort des juifs qu’ils tenaient fermement à l’Ancien Testament ; en revanche, le théologien catholique de Lucerne Aloïs Schenker exprima, dans la Schweizerische Kirchenzeitung, le scandale que constituait pour lui un « confiteor unilatéral » qui « dissimulait la culpabilité des juifs » (p. 353)… C’est grâce aussi à l’œuvre de soutien de Vogt que l’« opération des sept (Unternehmen Sieben) », à laquelle Bonhoeffer était lié et qui incluait le sauvetage de Charlotte Friedenthal, fut couronnée de succès à l’automne 1942. Charlotte Friedenthal, qui œuvrait depuis 1938 avec le pasteur Grüber à Berlin pour soutenir les chrétiens « non aryens », fut par la suite une collaboratrice très efficace du Schweizerisches Hilfswerk.
429Tout en critiquant la politique très restrictive d’accueil des réfugiés menée par les autorités suisses, Vogt en appela publiquement à partir de 1943 à la solidarité pour que les communautés protestantes augmentent leurs capacités d’accueil – condition sine qua non pour que les réfugiés puissent rester en Suisse sans redouter une expulsion aux conséquences tragiques. Il fonda des foyers qui hébergèrent des centaines d’exilés. En 1944, il contribua à ce que l’opinion publique suisse se mobilisât avec force contre la déportation des juifs hongrois. Dès 1945, il invita Niemöller en Suisse et se préoccupa, avec Barth, de l’aide matérielle et spirituelle à apporter désormais à l’Allemagne. « Malheur à la Suisse, s’indignait-il encore en 1947, si, elle qui a été épargnée par la guerre, se détournait à présent des victimes de la persécution » (p. 540). En 1947, Vogt redevint pasteur de paroisse, et l’Université de Zurich lui décerna le doctorat honoris causa pour ses engagements humanitaires.
C’est tout le mérite de l’A. que d’avoir exhumé Paul Vogt de l’anonymat dans lequel il avait sombré depuis lors. À maints égards, le présent livre constitue plus une chronique qu’une histoire ; il donne de nombreux et longs extraits de documents, mais le plus souvent sans les analyser. Toutefois, la richesse de ces sources, de même que les annexes biographiques (p. 562-583) et l’histoire de l’Église confessante (p. 584-691 ; les références aux travaux de K. Scholder et de W. Niesel auraient certes gagné à être complétées par une bibliographie plus récente) qui concluent cet épais ouvrage contribuent à son grand intérêt.
Matthieu Arnold
HISTOIRE DES RELIGIONS
Mohammad Ali Amir-Moezzi, Ali, le secret bien gardé. Figures du premier Maître en spiritualité shi’ite. Avec des contributions de Orkhan Mir-Kasimov et Mathieu Terrier, Paris, CNRS Éditions, 2020, 469 pages, ISBN 978-2-271-12497-5, 25 €.
Ce volume réunit neuf études que l’A. a fait paraître dans des revues savantes et des publications collectives entre 2000 et 2017. Ce dernier s’explique sur le principe qui a guidé ses recherches 430dans une introduction générale. Plutôt que d’étudier la « vie du ‘Alī historique », il s’agit de « faire une histoire des représentations de ‘Alī dans les différents milieux musulmans », dans le but de mettre au jour la « tradition ésotérique originelle ». À cette fin, l’A. met en œuvre plusieurs approches. La pétition de principe, tout d’abord. Constatant la centralité du culte de ‘Alī dans le shi’isme, l’A. avance qu’il est « difficilement envisageable qu’une telle religion, une telle dévotion à l’égard d’une personne, soit née du néant » (p. 60). Ensuite, le syllogisme : « Muhammad annonce la fin du monde […] il doit par conséquent annoncer l’avènement du Sauveur eschatologique » (p. 80). Puis, prolongeant la thèse de Wilferd Madelung sur la succession à Muhammad au-delà des limites prudentes de celle-ci, l’A. voit dans la parenté entre Muhammad et ‘Alī la preuve de l’« élection divine » (p. 142) de ce dernier. Enfin, l’A. s’efforce de remonter des sources shi’ites tardives aux prônes de ‘Alī lui-même (p. 161-171). Il peut ainsi proposer, dans un « Épilogue », une nouvelle histoire de l’islam des origines. Muhammad est venu annoncer la fin imminente du monde. Il a fait des adeptes au sein de son propre clan, les Banū Hāshim. Plus tard, ce premier noyau de croyants sera rejoint par le clan rival des Banū ‘Abd Shams, les futurs Omeyyades. Après la mort de Muhammad, « dans des conditions mystérieuses », les deux groupes de croyants s’opposeront. Alors que les Banū ‘Abd Shams se lancent dans des conquêtes sanglantes, les fidèles de la première heure se rassemblent autour de ‘Alī, en qui ils voient la « nouvelle manifestation du Messie ». C’est la « tradition ésotérique originelle ».
Le problème avec cette thèse est qu’elle est non réfutable. Objecterait-on qu’aucun texte du Coran ne soutient la divinité de ‘Alī ? L’A. répondrait que la Vulgate est une version officielle promulguée par les Omeyyades, d’où ont été expurgées toutes les références au cousin de Muhammad. Ferait-on observer que la doctrine imamologique duodécimaine est le fruit d’une longue évolution ? L’A. invoquerait le devoir de tenir secrètes certaines doctrines aux non-initiés afin de les protéger (taqiyya). Nous touchons là au grand paradoxe d’un livre intitulé ‘Alī, le secret bien gardé. Il s’agit de montrer au grand public cultivé que ‘Alī est bien l’Imam métaphysique cosmique dont parlent les sources shi’ites, tout en conservant le caractère ésotérique de cette connaissance.
Jason Dean
431Majied Robinson, Marriage in the Tribe of Muhammad. A Statistical Study of Early Arabic Genealogical Literature, Berlin – Boston, De Gruyter, 2020, xii et 219 pages, ISBN 978-3-11-062416-8, 89,95 €.
De tous les genres littéraires pratiqués par les historiens musulmans médiévaux (maghāzī-sīra, asbāb al-nuzūl, ḥadīth, ādāb, prosopographie, histoire universelle, géographie humaine), la généalogie est peut-être celle qui a le moins retenu l’attention des chercheurs. Une étude sur le mariage dans la tribu de Muhammad sur la base du Kitāb Nasab Quraysh (« Livre de la généalogie des Quraysh ») de Musᶜab b. ᶜAbd Allah al-Zubayrī (m. 851) intrigue donc forcément, en même temps qu’elle fait craindre de ne produire que des résultats limités. Il n’en est rien. À travers l’examen des pratiques matrimoniales des Qurasyh, c’est tout un pan de l’histoire sociale de la tribu de Muhammad que l’A. éclaire.
Avant de procéder à une étude statistique du Nasab Quraysh, l’A. s’attache, dans la première partie de son ouvrage, à démontrer l’authenticité de ce texte médiéval. Il se heurte aussitôt à une interrogation bien connue des islamologues : quelle valeur historique peut-on attribuer à des ouvrages rédigés un siècle, voire deux, après les événements qu’ils prétendent rapporter ? Plutôt que de prendre position dans le débat qui oppose ceux qui affirment la fiabilité des sources musulmanes à ceux qui la nient, l’A. considère que ce qui pose problème dans les histoires littéraires traditionnelles est moins l’exactitude des faits qu’elles contiennent que l’usage que leurs auteurs en font. Dans cette perspective, les ouvrages généalogiques, dont le Nasab Quraysh, offriraient une possibilité de contrôle de l’histoire narrative. À l’appui de cette thèse, l’A. avance trois types d’arguments : des études ethnographiques montrant que la manipulation des généalogies n’intervient généralement pas dans les trois premières générations, mais seulement dans les générations suivantes ; une comparaison entre le Nasab Quraysh et deux autres livres de généalogie arabe, la Jamharat al-nasab d’Ibn al-Kalbi (m. 819 ou 822) et le Kitāb al-akhbār wa al-ansāb d’al-Balādhurī (m. 892), attestant de larges correspondances ; l’accord entre les données du Nasab Quraysh et les principaux événements structurant l’histoire littéraire.
Considérant qu’il n’y aucune raison impérieuse de récuser l’authenticité du Nasab Quraysh, l’A. procède, dans la deuxième 432partie de son ouvrage, à l’analyse de l’information qu’il contient. Les principaux résultats de son enquête sont au nombre de trois : l’essor de la pratique du concubinage consécutif aux premières conquêtes islamiques ; une diversification de l’origine géographique des épouses non-quraysh d’hommes quraysh pendant la même période ; une augmentation du taux de mariages endogames chez les Umayyades à partir de l’établissement du califat de Damas. Les deux premiers résultats dessinent un portrait de la tribu de Quraysh à l’époque préislamique très différent de celui donné par les grands historiens arabes. Plutôt que d’être la puissance dominante de la péninsule arabique, bien insérée dans le commerce international, Quraysh n’aurait été qu’une tribu mineure du Hedjaz avant que l’expansion de l’islam n’ouvre à ses hommes de nouvelles perspectives matrimoniales.
En montrant l’intérêt de la littérature généalogique pour la compréhension de l’histoire sociale de l’Arabie centrale, l’A. a ouvert un champ de recherche potentiellement vaste, dépassant les limites du seul Nasab Quraysh et pouvant inclure, par exemple, les Ṭabaqāt d’Ibn Saᶜd.
Jason Dean
Bernard Rougier (dir.), Les Territoires conquis de l’islamisme, Paris, Presses universitaires de France, 2020, 360 pages, ISBN 978-2-13-082075-8, 23 €.
Sous un titre choc digne de la presse populaire, cet ouvrage collectif réunit des travaux d’étudiants du Centre d’études arabes et orientales de l’Université Sorbonne-Nouvelle, dirigé par Bernard Rougier, et de quelques chercheurs confirmés rattachés à d’autres laboratoires. Ces auteurs se donnent pour tâche de « cartographie[r] » la « géographie islamiste du pouvoir » dans quelques villes françaises : Aubervilliers, Mantes-la-Jolie, Argenteuil, Toulouse, mais aussi à Molenbeek, en Belgique, et à la prison de Fleury-Mérogis (Île-de-France). Le grand mérite de cette approche est de sortir du discours psychologisant sur la radicalisation individuelle en ligne pour montrer que l’islamisme s’inscrit dans un « écosystème » qui lui fournit les bases idéologiques et matérielles de son expansion. Mais qu’est-ce qui justifie de traiter des mouvements 433aussi différents que les Frères musulmans, le salafisme, le Tabligh et le jihadisme sous le vocable générique d’« islamisme » ? L’Éd. défend ce choix dans l’article programmatique sur lequel s’ouvre l’ouvrage : « L’islamisme est entendu ici comme le refus assumé de distinguer l’islam comme religion, l’islam comme culture et l’islam comme idéologie, ainsi que par le souci de soumettre l’espace social, voire l’espace politique, à un régime spécifique de règles religieuses promues et interprétées par des groupes spécialisés » (p. 19). Bref, l’islamisme est une « idéologie » qui doit être distinguée de l’« islam en soi ».
Cette approche entraîne deux conséquences majeures.
La première est de relativiser les spécificités des groupes assimilés sous le terme d’« islamisme ». Bernard Rougier récuse la qualification de « quiétiste » donnée à une certaine forme de salafisme « sur la seule base de son refus du jihadisme », affirmant l’existence d’un « continuum idéologique entre salafisme et jihadisme », alors que Julien Durand parle, lui, de « synthèse salafo-frériste ». Les trajectoires de militants analysées dans cet ouvrage semblent donner raison à ces généralisations. Certaines d’entre elles montrent en effet que l’on peut commencer par militer dans les rangs des Frères avant d’embrasser le salafisme puis le jihadisme. (Le Tabligh apparaît en revanche plus hermétique aux changements d’appartenance.) Mais c’est faire peu de cas des rivalités entre ces groupes, pourtant abondamment documentées par les auteurs de ces études. Plutôt que de considérer que tout engagement islamiste est susceptible d’évoluer vers le jihadisme, n’aurait-il pas été plus pertinent de s’interroger sur les raisons des changements d’affiliation, ou de la fidélité au groupe d’origine, ou du désengagement ?
La deuxième conséquence de la qualification d’« idéologie » donnée à l’islamisme est de méconnaître le caractère religieux des groupes étudiés, en privilégiant une définition étroite de la religion comme relevant de la seule sphère privée. Plutôt que de déplorer leur influence, ne faudrait-il pas reconnaître que, en édifiant des communautés alternatives, les islamistes répondent très exactement à la définition que donne Émile Durkheim de la religion : un phénomène collectif consistant à créer un être moral capable d’exercer une contrainte sur les individus ? Et c’est peut-être là que le bât blesse : plus encore que le catholicisme ou l’évangélisme, l’islam remet en cause les efforts de l’État français de reléguer la religion dans les frontières de la vie privée. Mais le défi que pose l’islam à 434une certaine conception de la laïcité ne justifie pas d’adopter une définition de la religion qui relève plus de considérations politiques que de critères sociologiques.
Jason Dean
THÉOLOGIE ET HISTOIRE DE L’ART
François Boespflug (avec le concours d’Emanuela Fogliadini), Crucifixion.La crucifixion dans l’art, un sujet planétaire, Montrouge, Bayard, 2019, 560 pages, ISBN 978-2-227-49502-9, 59,90 €.
Cet ouvrage d’iconographie chrétienne prend la suite d’un précédent volume, consacré aux images de Dieu et de la Trinité (Dieu et ses images. Une histoire de l’Éternel dans l’Art, Bayard, 2008), où il était déjà question, à travers le thème du trône de grâce, de la crucifixion. On trouvera dans ce livre volumineux (il pèse 2,2 kg, le précédent pesait 3,5 kg) la même performance, qui consiste à suivre l’évolution d’un sujet majeur de l’iconographie chrétienne sur 20 siècles, la même profusion de notes et de références bibliographiques (p. 483-545, soit 62 pages + 7 index), la même abondance d’illustrations et la même qualité esthétique. Il s’agit, assurément, d’un opus magnum.
Rendons tout d’abord hommage à Emanuela Fogliadini, dont la discrète mention dans le titre ne laisse pas présager qu’elle est la rédactrice de 4 chapitres (sur 15) qui traitent la Crucifixion dans l’art des chrétiens orientaux (de l’Arménie à l’Éthiopie), ainsi que des domaines byzantin, post-byzantin et orthodoxe.
L’auteur principal, à qui l’on doit la mise en valeur de l’iconographie chrétienne à la fois en tant que telle mais aussi comme discipline faisant partie de l’histoire de théologie, commence par introduire le lecteur dans les nombreuses subtilités lexicographiques liées au thème de la « staurologie » (étude de tout ce qui tourne autour du supplice comme de la représentation de la crucifixion) : spites, patibulum, titulus, sedile, suppedaneum, colobium, perisonium, subligaculum, crux commissa, crux immissa, crux decussata n’auront plus de secret pour lui. De même, l’A. prend soin de bien distinguer 435sémantiquement – ce qui permettra ensuite de mieux traiter et de limiter ce sujet immense – entre signe de la croix, croix, crucifix, Crucifié/crucifié, Crucifixion/crucifixion, chrisme, christogramme, staurogramme. On apprend aussi à nommer les personnages autour de la crucifixion, souvent présents dans les représentations mais non dans les textes bibliques : Dismas et Gestas (les deux larrons) et Longinus et Stephanos.
Il est impossible de rendre compte de la diversité des thèmes et représentations, auteurs, styles, époques, lieux et aires géographiques qui sont abordés, ainsi que des sources littéraires et historiques prises en compte pour explorer la Crucifixion dans l’art. Une analyse iconographique, inspirée de la méthode de Panofsky, qui commence par une description rigoureuse de l’œuvre, laquelle révèle une multitude de détails non vus au premier abord, se poursuit par une étude iconologique, faisant appel à des décryptages plus approfondis, en particulier à partir des sources textuelles.
La progression de cette immense étude suit les différentes périodes de l’histoire de l’art occidental (paléochrétien, médiéval, renaissant, baroque, moderne et contemporain), tout en ne se limitant pas à l’Occident, ce qui constitue l’un de ses grands apports. Non seulement le christianisme oriental est pris en compte – on l’a déjà souligné – mais aussi, pour le xxe siècle, le christianisme non-européen (chapitre 15).
On découvrira une quantité impressionnante d’œuvres, certaines très connues et qui constituent des passages obligés quand on étudie cette thématique, d’autres beaucoup moins (les crucifixions sans Christ, ou de femmes etc.), et c’est évidemment sur ce point que l’ouvrage est précieux, renouvelant une problématique rebattue dans de nombreux livres grand public consacrés à la croix ou à la crucifixion dans l’art (occidental essentiellement). Des œuvres atypiques, voire choquantes (Félicien Rops, James Ensor – dont celles qui heurtent le plus ne sont pas montrées) ou qui firent scandale à leur époque (James Tissot, Nicolaï Nilolaevich Ge, Emil Nolde, Renato Guttoso) sont également commentées ; on regrettera que l’A. n’ait pas présenté le Piss Christ (1987) de Andres Serrano qui, par-delà ses multiples effets et rebondissements médiatiques plus récents liés aux polémiques à propos de ce montage photographique, a fait l’objet de colloques universitaires et de documentaires des plus sérieux ces dernières années.
Les deux chapitres consacrés aux Crucifixions contemporaines comprennent quelques faiblesses : Alexeij Jawlensky, qui a consacré 436la quasi-totalité de son œuvre à représenter des croix qui forment aussi des visages (et pas simplement des Saintes Faces), aurait mérité mieux que quelques lignes (p. 361), et l’A. est passé complètement à côté de la compréhension des Crucifiés (il y en a plus que deux) du principal représentant de l’« art brut » qu’est Louis Soutter, découvert par Le Corbusier, de surcroît l’un des rares artistes de culture calviniste qui se soit approprié ce thème (ibid.). Deux représentations auraient à notre sens mérité un développement plus important, car elles ont donné lieu à des conflits d’interprétations multiples, mêlant le politique et le religieux : le Crucifié de Ludwig Gies (qui se trouvait dans la cathédrale – il aurait fallu préciser : luthérienne – de Lubeck) ; celui de George Grosz, qui fut d’abord utilisé comme décor pour une pièce de théâtre, avant d’être imprimé puis de faire l’objet d’un procès, pour être finalement réutilisé par les nazis comme tract anticommuniste. Autre absence surprenante, tant ce thème est récurrent chez cet auteur et tant ce dernier est étudié, cité et montré dans les milieux catholiques germanophones (on ne compte plus le nombre de thèses à son sujet) : les croix/crucifix/crucifiés « surpeints » de Arnulf Rainer, artiste provocateur qui s’est vu décerner un doctorat honoris causa par la Faculté de Théologie catholique de l’Université de Münster. D’autres types de représentations manquent : les installations, performances, photographies, ainsi que les nombreuses mises en scènes de croix et crucifixions contemporaines (on pense à Joseph Beuys – qui dialogua théologiquement avec le jésuite Friedhelm Mennekes –, ou à quelques films représentatifs d’un processus d’acculturation, comme le Jésus de Montréal de Denis Arcand). Font également défaut les crucifixions militantes et/ou provocatrices contemporaines qui montrent des Christa (parfois crucifiée enceinte, comme In the name of God, 2006, de Jens Galschiot, sculpture qui fit le tour du monde), ou des Christs représentés en crucifiés noirs, homosexuels, etc. On comprend que l’A. ait précisé en introduction qu’il ne pouvait pas traiter ce thème dans toute son exhaustivité, l’époque contemporaine faisant éclater toutes les limites, et qu’il privilégiait l’image fixe à deux dimensions par rapport aux autres formes de représentations artistiques ; certains Crucifiés/crucifiés contemporains sont toutefois incontournables. Par ailleurs, vu le nombre d’œuvres étudiées et d’artistes cités, certains commentaires ont inévitablement pris la forme de courtes notices ; c’est là une des limites de ce travail encyclopédique.
437L’A. a étudié quelques crucifixions luthériennes, celles du temps de la Réforme et quelques-unes ultérieures (K.D. Friedrich), même si l’immense production des Christs dans les églises luthériennes d’Allemagne et d’Europe du Nord n’a pas pu être prise en compte. Il en va de même des nombreux crucifiés représentés après Auschwitz ; celui, connu et emblématique, de Alfred Hrdlicka (1970), qui se trouve dans l’église protestante de Berlin-Plötzensee, aurait avantageusement remplacé le Christ quittant sa croix en athlète de Fritz Cremer, que l’on peut voir dans une autre église berlinoise (p. 409).
L’étude des croix ou des Crucifiés contemporains in situ, présents dans les églises, contemporaines ou non, pourrait constituer nouveau domaine de recherche, à l’heure où les frontières confessionnelles, pour les artistes en tous cas, sont devenues poreuses, les Crucifix actuels exprimant la diversité des christologies contemporaines et l’inculturation de la foi.
Jérôme Cottin
Jean-François Lagier, Centre international du vitrail (éd.), Images et lumière. Le vitrail contemporain en France, 2015-2019. Préface [de] Maurice Hamon ; introduction [de] Jean-Paul Deremble ; photographies [de] Henri Gaud, Chartres, Centre international du vitrail, 2019, 212 pages, ISBN 978-2-908077-09-4, 45 €.
Grâce à dix mécènes institutionnels et d’entreprise, le Centre international du vitrail de Chartres poursuit sa publication, sous la forme de très beaux livres d’art, de vitraux contemporains d’églises. Cet ouvrage se situe dans la suite de celui publié sous le titre Vitraux français contemporains, 2000-2015 (voir RHPR 95, 2015, p. 106-107) et fait preuve des mêmes qualités d’écriture et d’iconographie. Sont présentées les œuvres de dix-neuf artistes, lesquels ont proposé des vitraux pour 26 lieux répartis dans toute la France métropolitaine (et l’un à la Réunion). Parmi ceux qui reviennent plusieurs fois, il y a l’indéfectible Kim En Joong (3 fois), mais aussi Udo Zembok (3 fois), artiste allemand vivant en France et dont le style, épuré et dépersonnalisé, se caractérise par des monochromes aux couleurs vives et chatoyantes – il est l’auteur des vitraux de la chapelle de l’hôpital Sainte-Anne à Strasbourg – après avoir réalisé les vitraux de la cathédrale agrandie de Créteil, 438programmes qui ne se trouvent pas dans cet ouvrage. Ces vitraux s’inscrivent dans des architectures d’églises traditionnelles, souvent médiévales, et d’autres plus contemporaines, voire à peine terminées (centre spirituel du diocèse de Lyon ; église saint-Joseph de Montigny-lès-Cormeilles dans le Val d’Oise). Les monastères, anciens ou plus récents, ne sont pas en reste.
La tendance à l’aniconisme (ou à la non-représentation) des vitraux contemporains se confirme, ce qui permet de mettre plus en valeur les trois éléments qui constituent la richesse et la spécificité du vitrail : le verre, la couleur et la lumière. La figuration n’est toutefois pas complètement absente, et parmi les vitraux figuratifs réussis on peut nommer ceux de Gérard Garouste pour une chapelle privée à Aiserey en Côte d’Or, ainsi que le « vitrail du millénaire » de Véronique Ellena pour la chapelle Sainte-Catherine de la cathédrale de Strasbourg : un Salvator Mundi inspiré de Memling est constitué de photographies de multiples visages d’hommes et de femmes de tous âges, représentant le peuple actuel de Dieu. Tous ces programmes d’églises dans lesquels les artistes travaillent en général avec des ateliers de maîtres verriers, le cas des frères Loire faisant exception, font l’objet d’une étude minutieuse (qui en retrace la genèse et la réalisation) et de magnifiques illustrations.
La seule fausse note, à notre sens, a trait à la présentation de deux programmes d’un artiste, Alban de Chateauvieux : non seulement le style figuratif, illustratif et naïf, est passéiste, mais encore les thèmes représentés sont au service d’un catholicisme traditionaliste, identitaire et apologétique. Nous avouons ne pas comprendre la raison de la présence, ici, de ce qui relève davantage de l’imagerie catholique que de la création artistique ; et cette erreur rejaillit, hélas ! sur l’ensemble de l’ouvrage.
Jérôme Cottin
Frank Muller, Hans Baldung Grien. Entre christianisme et paganisme, Strasbourg, Éditions du Signe, 2019, 127 pages, avec 48 illustrations en quadrichomie, ISBN 978-2-7468-3773-7, 30 €.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est là le premier ouvrage en français consacré à Hans Baldung Grien (1484-1545), artiste qui nous est doublement proche : comme Strasbourgeois, 439et comme personne ayant embrassé la Réforme (pour des raisons tenant sans doute davantage aux conventions qu’aux convictions).
L’A., professeur émérite de l’Université de Strasbourg, est connu pour ses travaux sur l’iconographie de la Réforme et du xvie siècle dans l’aire du Rhin supérieur. Deux expositions, qui eurent lieu en automne 2019-hiver 2020, furent l’occasion de l’écriture de cet ouvrage : celle intitulée Regards sur Hans Baldung Grien, qui s’est tenue au musée de l’Œuvre Notre-Dame à Strasbourg et, surtout, la grande rétrospective de la Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe : HansBaldung Grien, Heilig-Unheilig / Sacré-profane (l’exposition fut bilingue, tout comme l’est le catalogue). Le sous-titre du présent ouvrage, « Entre christianisme et paganisme », fait d’ailleurs écho à ce double regard porté sur l’œuvre de l’artiste strasbourgeois, qui traita abondamment des thèmes chrétiens traditionnels tout en abordant des thématiques novatrices, en particulier autour de l’érotisme féminin, ce dernier étant, époque oblige, travesti sous d’autres thématiques, qu’elles soient bibliques (Ève – et Adam, la Vierge à l’enfant) ou, plus souvent, profanes (les sorcières, la jeune fille et la mort, Aristote et Phyllis, les différents âges de la vie, le couple « mal assorti »).
La structure de l’ouvrage suit la biographie de l’artiste, qui passa la plus grande partie de sa vie à Strasbourg, sauf pendant une période d’apprentissage dans l’atelier de Dürer à Nuremberg et à la faveur d’un séjour à Fribourg (de 1513 à 1517). C’est à cette période qu’il réalisa le fameux retable de la cathédrale de cette ville, sur lequel on trouve un autoportrait de l’artiste, lequel avait ajouté le mot « vert » (Grien) à son nom, sans doute à cause de sa prédilection pour la couleur verte.
Il est impossible de rendre compte des multiples facettes d’un artiste qui excella aussi bien par le trait (gravures et dessins) que la couleur (retables, tableaux d’églises ou de dévotion privée), et que l’on situe désormais comme l’égal des « grands » de son époque, Dürer et Cranach.
En matière d’iconographie et d’esthétique, on relèvera sa manière novatrice de traiter un thème traditionnel (par exemple, Le déluge, 1516, ou La création de l’homme, 1533), son attirance pour des thèmes existentiels (l’amour mais aussi la mort), la précision de son trait et son sens des couleurs (pas simplement la couleur verte), sa capacité à citer ou à imiter d’autres styles et artistes, ainsi que l’introduction du paysage (souvent fantasmé) dans les scènes.
440En ce qui concerne la représentation figurative de l’histoire de Strasbourg et de la Réforme, soulignons sa gravure sur bois de 1521 représentant le portrait de Luther en « saint protestant » – il est auréolé et surmonté d’une colombe –, l’encadrement de la page de titre d’un ouvrage de Hutten, ainsi qu’un dessin à la mine d’argent exécuté du haut de la cathédrale de Strasbourg (vers 1535-1540) et sur lequel on voit en premier plan l’église des dominicains et la Haute École. Parmi ses portraits au trait, on notera encore celui de Gaspar Hédion (1543) ou de Nikolaus Kniebs (1545), figures de proue du protestantisme strasbourgeois. Un émouvant portrait mortuaire d’Érasme (1536), réalisé quelques heures avant ou après sa mort à Bâle, lui est aussi – et plus récemment – attribué.
Grâce à une écriture à la fois précise, pédagogique et vivante, mais aussi du fait qu’il maîtrise parfaitement les domaines historiques, esthétiques, iconographiques et même théologiques, l’A. offre un aperçu complet de l’œuvre de cet artiste tout en restituant la richesse symbolique et la complexité sémantique d’un langage d’images.
Jérôme Cottin
VIENT DE PARAÎTRE
Paul Ricœur, La Religion pour penser.Écrits et conférences 5. Textes rassemblés, établis, annotés et présentés par Daniel Frey, Paris, Éditions du Seuil, coll. « La couleur des idées », 2021, 435 pages, ISBN 978-2-02-147709-2, 26 €.
Pour Paul Ricœur, l’autonomie philosophique n’est possible qu’à partir d’une « reprise » de ce qui n’est pas philosophie. Non philosophique par excellence, la religion a ainsi constitué pour lui un foyer de langages et de convictions qui lui a donné à penser pendant près d’un demi-siècle.
Dans ce cinquième volume des Écrits et conférences publiés sous les auspices du Fonds Ricœur, nous avons établi, corrigé et annoté douze écrits et conférences publiés entre 1953 à 2003. Trois d’entre ces textes le furent d’ailleurs dans la RHPR : « Culpabilité tragique et culpabilité biblique » (1953), « Philosophie et religion chez Karl 441Jaspers » (1957) et « La philosophie et la spécificité du langage religieux » (1975). L’ensemble ainsi formé se veut représentatif de la cohérence, de la richesse et de la variété de l’approche ricœurienne de la religion, essentiellement laïque et philosophique. Du problème du mal à celui de la nature poétique du langage religieux, en passant par l’évaluation de la justesse – ou non − des critiques (freudienne, marxienne…) de la religion, du rapport entre expérience et langage dans le discours religieux à des études spécifiques d’herméneutique biblique, en passant par des réflexions sur le sacrifice, la dette et le don, Ricœur s’appuie sur la religion pour penser, tout en ne cessant de penser la religion pour elle-même.
Ce sont ces enjeux de pensée à partir de la religion et sur la religion que nous avons cherché à énoncer dans la présentation d’une vingtaine de pages ouvrant le volume – qui s’appuie elle-même sur une monographie à paraître chez Hermann au cours de cette année, préparée en parallèle de la présente édition et intitulée précisément La Religion dans la philosophie de Paul Ricœur.
Daniel Frey