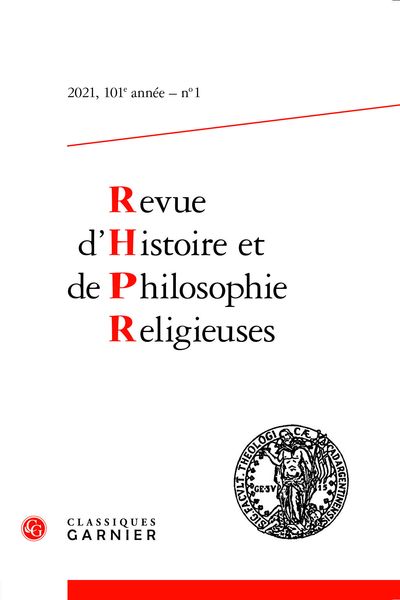
La « philosophie religieuse » de Jean Héring
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Revue d’histoire et de philosophie religieuses
2021 – 1, 101e année, n° 1. varia - Auteur : Mehl (Édouard)
- Résumé : L’ouverture des archives de Jean Héring (Strasbourg) permet de jeter un regard neuf sur celui qui fut le premier disciple français de Husserl, et accessoirement un contributeur actif de la RHPR durant plus de quarante ans. L’article s’attache à rappeler l’importance qu’a eue pour lui la fréquentation des philosophes du premier cercle de Husserl (Koyré, Ingarden, Reinach), et d’expliquer ce que, comme phénoménologue, Héring entend par le terme de « philosophie religieuse ».
- Pages : 55 à 73
- Revue : Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses
- Thème CLIL : 4046 -- RELIGION -- Christianisme -- Théologie
- EAN : 9782406115021
- ISBN : 978-2-406-11502-1
- ISSN : 2269-479X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11502-1.p.0055
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 15/03/2021
- Périodicité : Trimestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : phénoménologie, théologie protestante, idéalisme, religion, Strasbourg, Edmond Husserl, Jean Héring, Roman Ingarden, Alexandre Koyré, Adolf Reinach.
La « philosophie religieuse »
de Jean Héring
Édouard Mehl
Université de Strasbourg – CREPhAC (UR 2326)
La vie académique et les travaux scientifiques de Jean Héring (1890-1966) commencent depuis peu à être mieux connus des philosophes et des théologiens1. Nous n’aurons donc besoin que de rappeler sommairement les éléments essentiels de sa biographie, avant d’aborder certains des problèmes fondamentaux à l’exposition et à la formulation desquels Héring a apporté une contribution majeure, mais souvent méconnue, en nous concentrant sur l’œuvre philosophique de la première période. L’exploration et le dépouillement du fonds conservé à la Médiathèque protestante du Chapitre de Saint-Thomas et la reconstitution d’une importante correspondance aujourd’hui éparpillée aux quatre coins du monde permettront sans doute de mieux comprendre l’œuvre discrète d’un phénoménologue dont on parle peu, pour cette raison que Héring n’a jamais recherché la moindre ostentation, et qu’il est resté, tout au long de sa vie, exceptionnellement fidèle à la pensée de Husserl.
Né à Ribeauvillé en 1890 – dans l’Alsace annexée par le Reich après la défaite de 1870 – Jean Héring a entamé des études de philosophie à l’Université de Strasbourg, en 1908. Il y a fait ses premières armes en philosophie, suivant également, en théologie protestante, des cours d’histoire de l’Église et de la Réforme. Sa 56vocation philosophique ne se décide qu’un an plus tard, lorsqu’il arrive à l’Université de Göttingen. Il y est aussitôt captivé par l’enseignement magistral du fondateur de la phénoménologie transcendantale, Husserl, et sera bientôt un des principaux protagonistes du « mouvement phénoménologique » créé par les auditeurs et collaborateurs de Husserl. Dans cette ambiance fervente et révolutionnaire2, Héring noue des relations d’amitié durable avec Alexandre Koyré, Adolf Reinach, Édith Stein, Hedwig Conrad-Martius, ou encore le polonais Roman Ingarden3. Jusqu’à la mort de Husserl, en 1938, Héring a entretenu avec lui une relation amicale et fidèle, sans que la stature imposante du maître n’étouffe sa liberté de pensée. Ces liens amicaux ont certes été favorisés par la proximité de Fribourg-en-Brisgau et de Strasbourg, et par la situation de l’Université alsacienne en laquelle Husserl a pu voir, dans ses dernières années, un lieu idéal d’expression et d’écoute, sinon un unique refuge, à l’heure où les Universités allemandes se renfermaient peu à peu dans le carcan d’une idéologie délétère4.
Göttingen-Paris-Strasbourg : Iter alsaticum
Au sortir de la grande guerre, Héring fait partie des Alsaciens qui ont repris la nationalité française. Il s’installe donc à Paris, et suit, au début des années 1920, des études à la section des sciences religieuses de l’École pratique des Hautes études. Il suit notamment les cours sur Descartes d’Étienne Gilson, jeune professeur qui avait 57fait un bref passage par l’Université de Strasbourg5, et il y retrouve son compagnon d’études de Göttingen, Alexandre Koyré, dont il suit les cours sur Boehme et les hétérodoxes allemands du xvie siècle – travaux dont la RHPR se fera l’écho quelques années plus tard6. Héring assiste donc au premier aboutissement des travaux de jeunesse de Koyré : la double publication de l’Essai sur L’idée de Dieu et les preuves de son existence chez Descartes (Paris, Leroux, 1922) et L’idée de Dieu dans la philosophie de saint Anselme (Paris, Leroux, 1923). Les deux anciens de Göttingen ont jusque-là une trajectoire parfaitement parallèle et synchrone, puisque Héring soutient lui-même, en 1923, un mémoire en sciences religieuses sur « la doctrine de la chute et de la préexistence des âmes chez Clément d’Alexandrie » – étude publiée, comme celle de Koyré, chez Leroux en 1923. C’est en faisant la recension des deux ouvrages de Koyré que Héring fait son entrée dans la RHPR (1924/4-6, p. 574-577), tandis que les deux amies allemandes des deux philosophes devenus parisiens, Edith Stein et Hedwig Conrad-Martius, se chargent de la traduction allemande de la petite thèse de Koyré7. Héring lui-même n’est sans doute pas totalement étranger à l’initiative de cette publication allemande, puisqu’il a été associé, comme on le verra, à la publication posthume des œuvres d’Adolf Reinach par Conrad-Martius et Edith Stein (1921), et que l’infatigable assistante de Husserl avait également œuvré pour la publication de la première contribution majeure de Héring en phénoménologie : les Bemerkungen über das Wesen, die Wesenheit und die Idee, publiées dans le Jahrbuch für Phänomenologie und phänomenologische Forschung (1921, vol. IV).
Ceci explique le choix que fait ensuite Héring, après moult tergiversations – et après avoir envisagé de faire depuis Paris sa 58thèse sous la direction de Husserl – de se diriger vers la Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg. Il s’en était fait connaître, comme on vient de le voir, en recensant pour la RHPR les travaux de Koyré, et après avoir établi des premiers contacts avec Charles Hauter8, dont la thèse de 1922, Religion et réalité, revendiquait une inspiration « phénoménologique », quoique dans un sens large et beaucoup moins déterminé que celui que l’on verra apparaître dans la thèse que Héring soutient, devant un jury présidé par le même Hauter, en décembre 1925 : Phénoménologie et philosophie religieuse. Étude sur la théorie de la connaissance religieuse. Nous devons donc considérer maintenant la teneur de cet ouvrage à maints égards singulier.
Jean Héring, critique de l’idéalisme husserlien ?
Lorsque, trente ans après cette soutenance, Charles Hauter rend hommage à son collègue Héring, il ne manque pas de souligner l’originalité d’un travail qui est le premier livre d’introduction à la phénoménologie en langue française, mais qui se veut plus fidèle au « mouvement phénoménologique » qu’à Husserl lui-même, soupçonné par plusieurs des disciples de déroger lui-même à la phénoménologie conçue comme discipline descriptive pure, et de retomber dans un idéalisme métaphysique auquel son œuvre pionnière, les Recherches logiques [1900], avaient précisément pour but d’échapper :
[…] Héring appartient à la classe des phénoménologues qui n’ont pas suivi Husserl dans l’évolution inaugurée par les « Idées » [1913]. Les « Recherches Logiques », plus encore le célèbre article sur « la Philosophie comme Science exacte » paru au premier volume de la Revue « Logos », sont restés la charte de ces phénoménologues de la première heure, dont les chefs devaient être Pfaender et Reinach9.
59Quoique ce diagnostic ne soit pas dénué de toute pertinence, et que, sans doute, l’intéressé ait pu lui-même y souscrire sans trop se faire violence, il mérite d’être aujourd’hui reconsidéré, pour éviter que la discussion passionnée des élèves de Husserl au sujet de l’« idéalisme transcendantal » des Idées directrices ne tourne à une dispute stérile, voire un dialogue de sourds opposant de manière inconciliable « réalistes » et « idéalistes ».
Disons, sans trop entrer dans les détails, que la philosophie des Recherches logiques est caractérisée par son refus du relativisme : pour Husserl, l’idée d’aller puiser dans l’étude de la constitution subjective du pouvoir de connaître le fondement de toute connaissance est une erreur, ou plutôt ce qu’il appelle, d’un terme qu’il affectionne particulièrement, un « contresens ». Ce fondement est plutôt à chercher dans les « lois d’essences » sur lesquelles se règlent les objets, que la phénoménologie a pour tâche de clarifier et de mettre en évidence. Ces lois d’essences existent par elles-mêmes, indépendamment de toute subjectivité et de tout arbitraire – même divin10. Le « réalisme » de Reinach auquel on rattache souvent les positions de Reinach ou de Héring doit donc s’entendre comme cette autonomisation du royaume des essences, affranchi de toute relativité à la conscience psychologique. Il y a en ce sens une essence propre des phénomènes religieux, ou une « spécificité du donné religieux », selon les termes d’Étienne Gilson11, irréductible à toute interprétation psychologisante. Au stade des Recherches logiques, on peut dire que la question de l’être du moi n’intéresse que modérément et marginalement Husserl, comme un cas limite du donné phénoménologique12. Et Husserl – en cela en 60accord avec Kant – se contente d’opposer à la tradition philosophique inaugurée par Descartes le projet de bâtir une psychologie pure émondée de toute présupposition métaphysique concernant la nature de l’esprit, comme si l’on devait se contenter d’analyser les actes de conscience (ou vécus intentionnels) sans tirer aucune conclusion sur le sujet de ces actes.
On peut donc comprendre la surprise des étudiants de Husserl à la parution des Ideen (1913), qui peuvent sembler – du moins ont-elles effectivement semblé – opérer un virage complet en ce qui concerne le primat ontologique de la conscience. En effet, Husserl s’appuie sur la distinction radicale non entre les types d’objets (physique et psychique) mais entre les manières dont ils sont donnés : l’objet extérieur étant donné par esquisses (Abschattungen), il ne peut jamais être donné de manière totale dans une perception intégrale et adéquate. Toute perception peut être complétée, précisée, corrigée, poussée au-delà de ce que nous percevons effectivement. Au contraire, dans les perceptions dites internes, nous avons des vécus (Erlebnisse) qui sont absolument tels que nous les avons. Les passions, les émotions, sont, pour reprendre un mot de Descartes que les phénoménologues connaissent bien « si proches et si intérieures à notre âme, qu’il est impossible qu’elle les sente sans qu’elles soient véritablement telles qu’elle les sent ». À telle enseigne que, nous dit Descartes, « encore qu’on soit endormi et qu’on rêve, on ne saurait se sentir triste ou ému de quelque autre passion, qu’il ne soit très vrai que l’âme a en soi cette passion13 ». Cette différence conduit Husserl à insister sur le caractère absolu de ces vécus, par opposition au caractère seulement relatif de la perception externe14.
Mais c’est à ce point que Husserl commet une extrapolation métaphysique qui lui fait transférer ce caractère d’absoluité des vécus à la conscience elle-même, en employant de manière symptomatique une expression empruntée au vocabulaire le plus solidement métaphysique qu’ait jamais employé Descartes : « L’être immanent [du vécu] est donc indubitablement être absolu, en ce sens que, par principe, nulla ‘re’ indiget ad existendum15 ». De 61fait, cette phrase est susceptible d’une double interprétation, et presque tous les disciples de Husserl en ont dénoncé le caractère au minimum équivoque. Pour comprendre en quoi consiste cette équivoque, il faut commencer par remarquer la provenance de la formule que Husserl emprunte à Descartes, mais pour s’opposer diamétralement à lui. En effet, Descartes définissait en général le concept de substantia par le fait d’exister de manière indépendante : « per substantiam nihil aliud intelligere possumus, quam rem quae ita existit, ut nulla alia re indigeat ad existendum16 ». Mais c’était pour aussitôt remarquer que cette indépendance absolue ne peut convenir qu’à Dieu seul, toutes les choses créées, âmes ou corps, dépendant du concours général de la puissance divine qui les maintient dans l’être en les créant. Ce que Husserl, de toute évidence, nie catégoriquement ici : l’être absolu de la conscience ne présuppose aucun être antérieur à elle, dont elle tienne le sien. On peut donc considérer cette formulation comme signifiant une fin de non-recevoir aux preuves cartésiennes de l’existence de Dieu, en particulier la seconde preuve de la Méditation III, qui repose précisément sur l’argument de l’indigence existentielle de la substance créée : n’ayant pas en soi le pouvoir de se conserver dans l’être, l’ego a besoin d’une cause qu’il n’est pas, et c’est cette cause que l’on appelle Dieu17.
L’absolutisation husserlienne de l’être de la conscience qui, affirme Husserl, ne présuppose pas même l’existence d’un monde actuel hors de nous18, a donc chez lui, de toute évidence, un sens radicalement antimétaphysique. L’erreur cartésienne, en affirmant que la mens humana exige, au même titre que toute autre chose créée, une cause conservatrice de son être, serait donc d’avoir attribué par anticipation à l’ego la transcendance chosique, c’est-à-dire l’existence mondaine, alors même que l’existence de ce monde tout entier a été « révoquée en doute », et que rien ne permet, à ce stade, d’en affirmer l’existence19.
62Dans la lecture que Héring donne de ce passage des Ideen, Husserl n’aurait contesté la pertinence de la déduction cartésienne de l’existence de Dieu que pour lui substituer une absolutisation de la conscience elle-même — et qui dit absolutisation passe volens nolens au point de vue métaphysique20. Husserl affirmerait donc le « primat ontologique de la conscience », et retomberait donc dans l’« idéalisme » que Kant prétendait avoir définitivement réfuté dans la Critique de la raison pure, par son fameux « théorème » anticartésien : « la simple conscience, mais empiriquement déterminée, de ma propre existence, prouve l’existence des objets dans l’espace hors de moi21 ». Lorsque Héring affirme résolument : « Ce que Husserl affirme sans équivoque, c’est que le “cogito” peut exister sans entraîner par là l’existence du κόσμος22 », il affirme aussi bien que Husserl revient grosso modo à la position cartésienne révélée par le doute hyperbolique des Méditations, et donc à l’« idéalisme » critiqué par Kant, c’est-à-dire la thèse selon laquelle l’existence de l’ego est plus certaine que toute autre existence et que cette certitude, première et inconditionnée, est absolument indépendante de tout autre jugement d’existence.
Sans doute est-ce là une raison suffisante pour pousser Husserl à rédiger ses Méditations cartésiennes, ce qu’il fera quelques années plus tard, au retour de conférences données à Paris et Strasbourg, à l’invitation de Jean Héring. À ces conférences, dont Husserl gardera un souvenir mémorable, ont notamment assisté plusieurs membres des facultés de théologie de l’Université de Strasbourg, comme l’Abbé Émile Baudin, qui entamera une relation philosophique intense et amicale avec Husserl23, ou, pour le côté protestant, le 63théologien Albert Schweitzer, auteur bien connu d’un diagnostic pessimiste sur le déclin moral de l’Occident24, très probablement renseigné sur Husserl par une de leurs connaissances communes, qui a eu sur le jeune Husserl une influence morale décisive, et que Schweitzer vient de rencontrer à Prague : le « philosophe président » Tomáš Masaryk25. Or, avec ces Méditations cartésiennes, qui sont comme des réponses aux objections faites par ses élèves aux Ideen, Husserl est allé beaucoup plus loin dans l’explicitation de la question ultime de la phénoménologie : celle de la transcendance du monde.
Husserl, tout d’abord, martèle avec force que « la transcendance, sous quelque forme que ce soit, est un caractère d’être immanent qui se constitue au sein de l’ego. Tout sens concevable, tout être concevable, qu’on les dise immanents ou transcendants, relèvent du domaine de la subjectivité transcendantale en tant qu’elle est ce qui constitue le sens et l’être26 ». Au lieu, toutefois, de voir dans cet idéalisme une position philosophique parmi d’autres à laquelle finirait par se ranger le phénoménologue conséquent, Husserl insiste sur le fait que la phénoménologie se confond avec cet idéalisme, et n’est rien d’autre que le procès de son dévoilement. Dans l’ego méditant, « La dé-monstration [Erweis] de cet idéalisme est donc la phénoménologie elle-même ». Bien évidemment, cet idéalisme absolu se démarque de celui de toute la tradition philosophique, et il subsume dans son universalité toutes les positions philosophiques déterminées, tous les « réalismes » possibles – qui ne sont bien souvent que des « idéalismes » déguisés.
Mais l’originalité des Méditations cartésiennes réside surtout dans la place éminente qu’elles font à la problématique de l’intersubjectivité transcendantale, en faisant valoir que le fait d’avoir-un-monde en général n’a de sens que parce qu’il est un monde commun, qu’il est ce même monde auquel nous appartenons tous et auquel nous avons conscience d’appartenir. On comprend 64donc mieux l’erreur des philosophes à la suite de Descartes, ignorant le fait qu’il ne peut y avoir de « vrai » monde qu’au sens où il est celui de tout-un-chacun, et donc présuppose l’être-pour-moi des autres. Husserl aborde donc, dans la Cinquième Méditation Cartésienne, la problématique cruciale de la constitution d’autrui, et l’expérience de l’étranger (Fremderfahrung).
Encore une fois, la magistrale synthèse des Méditations cartésiennes devait se heurter à un nouveau front d’incompréhension et de refus, de la part de plusieurs générations de lecteurs, qui ont voulu y voir un triomphe du « logicisme » et un pur « idéalisme de la signification » (Levinas, Sartre, Ricœur), comme si Husserl avait, par son objectivisme impénitent, confondu la possibilité de l’intersubjectivité avec la possibilité de la connaissance d’Autrui. Husserl a toujours été désespéré et exaspéré par l’incompréhension pour sa thèse qu’il présente lui-même comme la clef de voûte de la phénoménologie transcendantale : l’idéalisme transcendantal n’est pas un idéalisme de ceci ou de cela, il n’est pas plus opposé au « réalisme » que, chez Kant, la liberté (« nouménale », donc idéale) n’est opposée à la nécessité (dans les phénomènes). Husserl présente donc l’idéalisme comme le sens supérieur et ultime de l’être ; au lieu de dire, comme Aristote, que l’être se dit en plusieurs sens, Husserl dira plutôt qu’être signifie avoir-le-sens-d’être, et que cela même n’a de sens que dans la subjectivité où ce sens se forme. Toutes les objections possibles de ses disciples sont donc des « contresens », et l’idée même d’une « phénoménologie réaliste » est, aux yeux du maître, comme celle d’un cercle carré.
Le « manuscrit du Docteur Reinach »
et la vocation philosophique de Jean Héring
Héring compte-t-il, comme son ami Ingarden, au nombre des disciples réfractaires ? On aurait pu le croire, à s’en tenir aux analyses de 1926. Mais il y a au moins deux raisons d’en douter : la première, c’est la découverte, dans le fonds Héring, d’une lettre inédite de Ingarden, adressée à Héring très peu de temps avant sa mort (lettre datée de décembre 1965 ; Héring meurt en février de l’année suivante). Ce document est précieux, car il atteste que Héring, 65revenant une fois de plus sur le « nulla ‘re’ indiget ad existendum » du § 49 des Ideen, a finalement bien compris que Husserl entend cette formule en un sens nouveau, décapé de son sens cartésien, et effectivement phénoménologique. Il ne s’agit certainement pas d’une tardive rétractation, mais bien de l’expression d’une profonde fidélité à Husserl et d’un assentiment à cet « idéalisme transcendantal » transcendant l’opposition traditionnelle et artificielle entre « idéalisme » et « réalisme ». Lisons cette ultime lettre que le philosophe polonais a adressée à Héring, ramenant décidément la position de Husserl à une problématique trivialement cartésienne et à sa métaphysique substantialiste-spiritualiste sous-jacente (ce qui indique a contrario que Héring soutenait l’interprétation phénoménologique et transcendantaliste que Ingarden conteste ici) :
Quant à vos remarques ultérieures concernant l’orientation renouvelée que Husserl donne [à l’expression] nulla re indiget ad existendum, je crois pour ma part que Husserl a voulu entendre ici par le terme de « res » un ‘quelque chose’ qui a l’être autonome et qui subsiste par soi. Car il est clair que la conscience pure de Husserl a besoin pour exister des corrélats intentionnels (les noemata de différents niveaux), car son être présent-subsistant est la conséquence nécessaire des actes de conscience (des noèses). En ce sens même pour Husserl la pure conscience a besoin du monde réal (simplement visé intentionnellement) : ce monde [intentionnel] existe avec la même nécessité que les flux de conscience, dès lors qu’ils en reflètent la structure (c’est-à-dire dès lors que ces flux de conscience sont concordants et qu’ils sont accomplis en compréhension réciproque avec d’autres egos). Mais, dans le passage cité des Ideen, ce n’est pas de cela que parle Husserl : il traite indubitablement ici du monde des choses matérielles, en tant qu’il a un être autonome (et spécifiquement indépendant de la conscience pure). Husserl cherchait (et cela jusqu’à sa mort) à déterminer la vieille question de la substantialité de l’âme personnelle (du Je pur), car il est vraisemblable que cela était pour lui étroitement lié au problème de l’immortalité27.
66La seconde raison nous ramène au commencement de l’histoire, et à la période de Göttingen pendant laquelle Héring a activement fréquenté Husserl (1909-1919). Notons premièrement que le thème de l’idéalisme transcendantal ne désigne pas encore chez Husserl le tout de la philosophie (par synecdoque), comme on vient de le voir dans les Méditations cartésiennes. Les premières notes de 1908, puis leur reprise de 1913 à 1918, portent souvent le titre de « Beweis für den transzendentalen Idealismus ». L’allusion au célèbre Lehrsatz de Kant est ici tout à fait évidente, puisque Kant pensait avoir démonstrativement réfuté l’idéalisme (empirique), en montrant que « la simple conscience de ma propre existence (das bloße Bewußtsein meines eigenen Daseins) prouve (beweiset) l’existence des objets dans l’espace hors de moi ». Or Husserl n’a pas contesté la validité de l’argument kantien, mais il a plutôt inversé le sens de l’énoncé, en disant que l’être même des choses (Dingliches Sein) n’a aucun sens concevable autrement que relativement à une conscience possible. Pareille conclusion n’était certainement pas l’intention obvie de l’auteur de la Critique de la raison pure, pour qui les objets de la connaissance n’avaient certes de sens que par rapport à la sphère de l’« expérience possible », mais pour qui aussi la « chose en soi » (et donc « l’être-chosique » dont parle Husserl) restaient étrangers à cette inclusion dans l’orbe infini de la subjectivité. On voit là toute la distance qui sépare l’idéalisme transcendantal de Husserl de celui de Kant : au lieu que Kant le détermine négativement par le défaut d’intuitivité et de réalité objective, Husserl en fait le principe ultime d’où procède le sens d’être de toute chose, et de l’étant en général.
Or il n’est pas sans intérêt de noter que Husserl travaille précisément à son manuscrit sur l’idéalisme transcendantal entre septembre 1917 et juin 1918. C’est au cours de cette période, précisément à la Pentecôte de l’année 1918, que Husserl reçoit la visite de son étudiante Edith Stein accompagnée de Jean Héring28. Au cours 67d’une séance sans doute décisive pour l’orientation ultérieure de Héring, il lit et commente avec le maître un texte d’Edith Stein portant sur la conception de la toute-puissance divine, et – comme on va le voir, les deux choses sont liées – « un manuscrit de philosophie religieuse (religionsphilosophisch) venant du Nachlaß du Dr. Reinach tombé au champ d’honneur ».
L’histoire de ce manuscrit est fascinante : rédigées par Adolf Reinach au cours de l’année 1916-1917 – il meurt à la fin de l’offensive de la troisième bataille des Flandres (novembre 1917) –, ces pages sont les seules de ses œuvres non éditées qui aient échappé à la destruction. Récupérées par la veuve d’Adolf Reinach, elles sont communiquées à Héring et Edith Stein. Véritable trésor, le dactylogramme de ces Aufzeigchnungen a été pieusement conservé par Héring tout au long de sa vie – c’est dire le prix qu’il attachait à ces fragments qui seront partiellement édités dans le volume des Gesammelte Schriften édité par ses élèves en 1921.
Héring en placera d’ailleurs un extrait en exergue de sa thèse de 1926 :
Surtout respectons le sens intrinsèque des événements de la vie religieuse ! Même s’il nous mène à des énigmes. Ces énigmes mêmes auront peut-être la plus grande valeur pour la connaissance de la vérité29.
Ce n’est pas sans raison que Héring traduit ici la notion, centrale dans la phénoménologie husserlienne, d’« Erlebnis », que l’on traduit habituellement par le terme de « vécu », par le terme d’« événement ». Dans ce choix de traduction se révèle une bonne partie de l’ambition philosophique de Héring que nous ne pourrons qu’esquisser dans les dernières pages de cette contribution.
De fait, traduire « Erlebnis » par « événement » éclaircit le sens que peut à la rigueur avoir la notion de « phénoménologie réaliste ». Le « réalisme » (si l’on tient absolument à conserver ce terme) signifie en somme la même chose que ce que les Reinach et consorts 68appellent la « Sachlichkeit » : L’Erlebnis n’est pas le vécu tel qu’une subjectivité peut l’interpréter mais elle est ce que cette subjectivité reçoit tel qu’il s’offre à elle, tel qu’il se donne. Le « vécu » ne dépend donc pas de celui qui le vit, de sa perspective et de sa faculté de comprendre ce qui lui arrive, mais il dépend précisément de ce qui arrive tel qu’il se donne, dans sa tonalité affective déterminée (ce que Heidegger appellera la Befindlichkeit du Dasein30).
Dans ces conditions, on doit considérer que l’expérience religieuse est celle dans laquelle « l’objet » a pour matière et pour source ce type particulier de « vécu » que Héring appelle « événement31 ». Dans l’expérience religieuse, l’Erlebnis est à considérer comme un Ereignis, et ce qui m’arrive, au plus profond de mon cœur, est à considérer comme un événement à décrire en toute objectivité, sans y surajouter d’interprétation : il n’est pas « motivé », il est « incompréhensible », il n’a pas d’objet : il peut être un sentiment de joie, de sécurité, de gratitude sans cause. Reinach précise que la philosophie religieuse peut bien « éclaircir » (klären) de tels « événements », ne serait-ce qu’en les portant au discours – mais ce n’est alors pas pour les soumettre au principe de raison suffisante : cela ne peut être que dans le but de permettre à de tels « événements » de se reproduire et de se développer dans une conscience plus pure32.
On ne saurait traiter avec plus d’objectivité et de sérieux le « sentiment religieux », en faisant radicalement abstraction de toute 69explication par un enchaînement de causalité, ou des discours (métaphysiques ou sociologiques) sur le phénomène religieux qui ne seraient jamais qu’une manière déterminée d’en ignorer la spécificité essentielle : dans l’expérience religieuse, les déterminations de l’objet « Dieu » (toute-puissance, omniscience) sont en fait déduites de la matière du vécu, et donc, en l’occurrence, d’un sentiment de sécurité (Geborgensein in Gott). C’est là, bien sûr, tout le sens fondamental, « phénoménologique », de 1 Jn 4,7 (« Qui diligit… cognoscit Deum »), que Adolf Reinach a consigné dans son testament, puis que Edith Stein et Jean Héring ont discuté avec Husserl à la Pentecôte de l’année 1918.
*
* *
Contentons-nous d’en tirer au sujet de Héring une conclusion générale. Premièrement, si le travail de Jean Héring a pu trouver à Strasbourg un cadre propice, c’est qu’il apportait avec lui un concept de « philosophie religieuse » tout à fait original, qui revendiquait le plus haut degré d’objectivité, et qu’il voulait absolument irréductible aux réductionnismes de toutes sortes (positiviste, sociologique, psychologique, et même métaphysique). Deuxièmement, cette philosophie (phénoménologique) consiste à considérer le « vécu » religieux comme un « événement », donc à ne considérer pas moins sérieusement les illuminations de Padre Pio que les preuves cartésiennes de l’existence de Dieu. Troisièmement – et à titre programmatique – le fait de considérer un vécu comme un événement constitue un préalable, voire l’axiome fondamental de toute philosophie de la révélation. Car la foi, en général et en définitive, n’est pas un savoir doctrinal, mais elle est l’événement du secours pour les humbles, les réprouvés, les pécheurs.
Comment donc la révélation est-elle donnée ? Elle l’est de manière naturelle, dans l’affectivité non modifiée par la réflexion, donc de manière privilégiée dans le rêve. Que l’on ne s’étonne donc pas si Jean Héring a tant insisté sur la nécessité de bâtir une « phénoménologie du rêve », et s’il soutient, contre toute la tradition philosophique, que le rêve est un bien une modalité particulière de la perception sensible, dans laquelle il doit donc y avoir une intersubjectivité (que toute perception comme telle présuppose)33. 70N’est-ce pas dire que la « philosophie de la religion » des années vingt et la « phénoménologie du rêve » des années cinquante sont essentiellement liées, et ne diffèrent l’une de l’autre que par une distinction de raison ? C’est ce que l’examen plus précis du fonds Héring, et surtout l’étude de son exégèse, dont il n’a pas été dit mot ici, nous permettront de vérifier. Que le royaume de Dieu apparaisse en songe ou dans un délire vaticinateur, il n’en est pas moins perçu, et tout ce qui est perçu est, par définition, réel. Ni le philosophe qu’il a d’abord été, ni l’exégète qu’il est ensuite devenu n’en ont jamais douté.
71Bibliographie
Arnold, Matthieu, La Faculté de Théologie Protestante de l’Université de Strasbourg de 1919 à 1945, Strasbourg, Association des Publications de la Faculté de Théologie protestante, coll. « Travaux de la Faculté de théologie protestante de Strasbourg » 2, 1990.
Baudin, Émile, recension de Ch. Hauter, Essai sur l’objet religieux, Paris, 1928, Revue des Sciences Religieuses 10, 1930/2, p. 326-334.
Descartes, René, Œuvres, éd. par Charles Adam et Paul Tannery [AT, suivi du no de vol. en chiffres romains], nouv. prés. Par Bernard Rochot et Pierre Costabel, 11 vol., Paris, Vrin, 1964-1974.
Dupont, Christian, « Jean Héring and the Introduction of Husserl’s Phenomenology to France », Studia Phaenomenologica 15, 2015, p. 129-153.
Feldes, Joachim, « Le “Puzzle” Héring. Récit d’un parcours de jeunesse », Claudia Serban et Dominique Pradelle (dir.), Revue de théologie et de philosophie, vol. 148, 2016/1, p. 409-419.
Gilson, Étienne, Études de philosophie médiévale, Strasbourg et Paris, Istra, coll. « Publications de la Faculté des Lettres de l’Université de Strasbourg » 3, 1921.
Gilson, Étienne, Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien, Paris, Vrin, 1930.
Hauter, Charles, Essai sur l’objet religieux, Paris, Alcan, coll. « Études d’histoire et de philosophie religieuses » 17, 1928.
Hauter, Charles, « Hommage de la Faculté de théologie de Strasbourg au Professeur Jean Héring », RHPR 37, 1957/1, p. 1-2.
Héring, Jean, « Bemerkungen über das Wesen, die Wesenheit und die Idee ». Jahrbuch für Phänomenologie und phänomenologische Forschung 4, 1921, p. 495-543.
Héring, Jean, Phénoménologie et philosophie religieuse. Essai sur la connaissance religieuse, Paris, Alcan, coll. « Études d’Histoire et de Philosophie religieuses » 15, 1926.
Héring, Jean, « Kyrios Anthropos », RHPR 16, 1936/3-5, p. 196-209.
Héring, Jean, « La phénoménologie d’Edmond Husserl trente ans après. Souvenirs et réflexions d’un étudiant de 1909 », Revue internationale de philosophie 2, 1939, p. 366-373.
Husserl, Edmund, Recherches logiques, II, 2, trad. Hubert Élie, Arion L. Kelkel et R. Scherer. Paris, PUF, 1961.
Husserl, Edmund, La philosophie comme science rigoureuse, trad. Marc B. de Launay, Paris, PUF, 1989.
72Husserl, Edmund, Méditations cartésiennes, trad. Marc B. de Launay, Paris, PUF, 1994. [Trad. E. Levinas – J. Peiffer, Paris, Armand Colin, 1931.]
Husserl, Edmund, Idées directrices pour une phénoménologie pure et une philosophie phénoménologique, trad. Jean-François Lavigne, Paris, Gallimard, 2018. [Édition originale, 1913.]
Ingarden, Roman, Lettre inédite à J. Héring, 26 décembre 1965 [Strasbourg, Fonds Héring, Médiathèque protestante du Chapitre de Saint-Thomas].
Ingarden, Roman. Husserl. La controverse Idéalisme-Réalisme. Introduit, traduit et annoté par Patricia Limido-Heulot, Paris, Vrin, 2001.
Kant, Imanuel, Critique de la raison pure (seconde éd. 1787), trad. A. Renaut, Paris, GF, 2001.
Koyré, Alexandre, Essai sur L’idée de Dieu et les preuves de son existence chez Descartes, Paris, Leroux, 1922.
Koyré, Alexandre, L’idée de Dieu dans la philosophie de saint Anselme, Paris, Leroux, 1923.
Koyré, Alexandre, Descartes und die Scholastik. Trad. Edith Stein et Hedwig Conrad-Martius (1923), Freiburg, Herder, coll. « Edith Stein Gesamtausgabe » 25, 2005 (=1923b).
Koyré, Alexandre, « Un mystique protestant, Maître Valentin Weigel », RHPR 8, 1928/3, p. 227-248 ; 1928/4, p. 329-348 ; repris dans les « Cahiers de la RHPR » 21, Paris, Alcan, 1930.
Koyré, Alexandre, « Sébastien Franck », RHPR 11, 1931/4-5, p. 353-385 ; repris dans les « Cahiers de la RHPR » 24, Paris, Alcan, 1932.
Koyré, Alexandre, recension de Leo Strauss, Die Religionskritik Spinozas als Grundlage seiner Bibelwissenschaft, Berlin, 1930, RHPR 11, 1931/4-5, p. 443-449.
Koyré, Alexandre, Mystiques, spirituels et alchimistes du xvie siècle allemand (Cahiers des annales, no 10), Paris, 1955.
Lienhard, Marc, « La RHPR et les dissidents des xvie et xviie siècles », RHPR 100, 2020/1, p. 85-109.
Marion, Jean-Luc, D’ailleurs, la Révélation, Paris, Grasset, 2020.
Mehl, Édouard – Serban, Claudia – Vongehr, Thomas, « Une lettre inédite de Husserl à Jean Héring (4 février 1937) », ALTER. Revue de phénoménologie 28, 2020, p. 307-315.
Monseu, Nicolas, « Héring, Levinas et le sens de l’idéalisme husserlien », Revue de Théologie et de Philosophie 148, 2016/1, p. 419-432.
Pradelle, Dominique, Intuitions et idéalités. Phénoménologie des objets mathématiques, Paris, PUF, coll. « Épiméthée », 2020.
Reinach, Adolf, Gesammelte Schriften, herausgegeben von seinen Schülern, Halle, Niemeyer, 1921.
Reinach, Adolf, Aufzeichnungen aus dem Nachlaß [Tapuscrit original, Strasbourg, Fonds Héring, Médiathèque protestante du Chapitre de Saint-Thomas].
73Schmitz-Perrin, Roland, « Strasbourg, “banlieue de la phénoménologie”. Edmond Husserl et l’enjeu de la philosophie religieuse », Revue des sciences religieuses 69, 1995/4, p. 481-496.
Schuhmann, Karl, Husserl-Chronik. Denk- und Lebensweg Edmund Husserls. Publié par le Husserl-Archiv (Leuven) sous la direction de Samuel Ijsseling, Den Haag, Nijhoff, coll. « Husserliana. Dokumente » I, 1977.
Schweitzer, Albert, Kultur und Ethik in den Weltreligionen, éd. Ulrich Körner et Johann Zürcher, Munich, Beck, coll. « Werke aus dem Nachlass », 2001. [Édition originale, 1919-1921.]
Sebestik, Jan, « Thomas Guarrigue Mazaryk ou le positivisme détourné », Revue d’Histoire des Sciences Humaines 8, 2003/1, p. 103-123.
Serban, Claudia – Pradelle, Dominique, « Jean Héring – de l’eidétique à la phénoménologie de la religion. Présentation du dossier », Revue de théologie et de philosophie 148, 2016/1, p. 401-407.
Serban, Claudia, « De l’eidétique à la phénoménologie du rêve », Claudia Serban et Dominique Pradelle (dir.), Revue de théologie et de philosophie 148, 2016/1, p. 481-496.
Serban, Claudia, « Le vécu : acte, accomplissement ou événement ? », Heideggers Hermeneutik der Faktizität. Die Grundbegriffe / L’herméneutique de la facticité de Heidegger. Les concepts fondamentaux / Heidegger’s Hermeneutics of Facticity. The Fundamental Concepts, éd. par Sylvain Camilleri, Guillaume Fagniez et Charlotte Gauvry, Nordhausen, Traugott Bautz, 2018, p. 99-112.
Sorg, Jean-Paul, « Le philosophe médecin Albert Schweitzer et le philosophe président Tomas Guarrigue Mazaryk », Revue des deux mondes, juin 2007, p. 92-99.
Vincent, Gilbert, « La Faculté de théologie protestante et l’accueil de la phénoménologie dans l’entre-deux guerres », RHPR 68, 1988/1, p. 121-131.
1 Vincent, 1988, p. 121-131 ; Arnold, 1990, p. 74-76 ; Schmitz-Perrin, 1995, p. 481-496 ; Dupont, 2015, p. 129-153. Le renouveau de l’intérêt pour Héring est surtout attesté par la parution du dossier « Jean Héring – de l’eidétique à la phénoménologie de la religion » (Serban – Pradelle, 2016). Et, tout récemment, Marion, 2020, p. 57-58. Pour la présentation du fonds d’archives de Strasbourg, voir Feldes, 2016, p. 409-419.
2 Évoquée par Héring dans une brève notice autobiographique (Héring, 1939).
3 Schuhmann, 1977, p. 173. Au Wintersemester 1912-1913, Héring prend la direction de la « Société philosophique de Göttingen ».
4 Voir à ce sujet, la lettre inédite de Husserl à Jean Héring (4 février 1937) que nous publions avec Claudia Serban et Thomas Vongehr : Mehl – Serban – Vongehr, 2020. Mentionnons ici que cette lettre accuse réception du premier numéro des Recherches théologiques (vol. I : À la mémoire de Guillaume Baldensperger [1856-1936], par les professeurs de la Faculté de Théologie protestante de l’Université de Strasbourg, Paris, Félix Alcan, 1936 = RHPR 16, 1936/3-5). Husserl y évoque allusivement les noms de Hauter, Monod, Ménégoz, Strohl et Will, mais curieusement ne commente pas la publication de Héring, « Kyrios Anthropos », sans doute parce que les problèmes philologiques et historiques qui sont étudiés ici dépassent de loin les compétences de Husserl. En tout état de cause, la contribution de Héring n’a reçu de la part des théologiens qu’un accueil plutôt tiède, voire franchement réservé.
5 Gilson publie à Strasbourg, en 1921, ses Études de philosophie médiévale qui deviendront quelques années plus tard, moyennant d’assez importantes transformations, les Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien (1930).
6 Koyré deviendra donc, par l’intermédiaire de Héring, collaborateur de la RHPR : notons ici sa double étude sur Valentin Weigel (Koyré, 1928, p. 227-248 ; 328-348) puis sur Sebastian Franck (Koyré, 1931, p. 353-385), suivie d’une importante recension du Spinoza de Leo Strauss (Die Religionskritik Spinozas als Grundlage seiner Bibelwissenschaft, ibid., p. 443-449). Cette recension est elle-même immédiatement suivie par celle que Héring donne de la thèse d’État de Koyré consacrée à Jacob Boehme (ibid., 449-451). Les deux articles de Koyré sur Valentin Weigel et Sebastian Franck sont repris dans Mystiques, spirituels et alchimistes du xvie siècle allemand, 1955. Sur Koyré dans la RHPR, voir également Lienhard 2020, p. 85-109.
7 Koyré, 1923b.
8 Sur Charles Hauter, voir Arnold, 1990, p. 65-67. Le fonds Héring contient un tiré-à-part des Bemerkungen adressé à Hauter en ces termes : « À son ami monsieur Charles Hauter, de la part de l’auteur, avec ses meilleures félicitations et salutations. Paris, 7. 4. 24, J. Héring ».
9 Hauter, 1957, p. 1. « Idées » renvoie ici au premier tome des Idées directrices pour une phénoménologie, publié dans le premier volume du Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, en 1913. Cet ouvrage fondamental a fait l’objet d’une première traduction française par Paul Ricœur, alors qu’il enseignait à Strasbourg (Gallimard, 1950). Nous nous reporterons cependant à l’édition plus récente et complète de Lavigne (Husserl, 2018). L’article que Husserl donne à la jeune revue Logos (1911) est traduit et édité par Marc B. de Launay sous le titre La philosophie comme science rigoureuse (Husserl, 1989).
10 Ces « lois » sont constitutives du domaine de la vérité, selon Husserl qui emprunte volontiers la métaphore politique : « Das Reich der Wahrheit is kein ungeordnetes Chaos, es herrscht in ihm Einheit der Gesetzlichkeit » (Logische Untersuchungen, § 6 ; voir Pradelle, 2020, p. 29).
11 L’expression se trouve sous la plume d’Étienne Gilson, dans la lettre inédite qu’il adresse à Héring en accusant réception de l’ouvrage de 1926 (9 juin 1926) : « Le problème est capital, et j’attacherais la plus haute importance à ce qu’en milieux protestants on reprît pleine conscience de la spécificité du donné religieux ».
12 Husserl, 1961, Recherche V, p. 163. Husserl a supprimé tout un paragraphe consacré à la délimitation réciproque de la psychologie et de la science de la nature, en précisant que « la prise de position adoptée ici, concernant la question du moi pur, demeure inessentielle pour les recherches de ce volume » (p. 163).
13 Descartes, Passions de l’âme, art. XXVI, AT XI, p. 348-349.
14 Husserl, 2018 [1913], § 42, p. 126 : « Un vécu ne s’esquisse pas ». En marge de cette proposition cardinale, Husserl a ajouté dans son exemplaire personnel : « Add. : sa présence n’est pas esquissée par l’esquisse présente ». Autre formulation dans Husserl, 1961, Recherche V, p. 348 : « L’intuition adéquate est la même chose que la perception interne ».
15 Husserl, 2018 [1913], § 49, p. 150.
16 Descartes, Principia Philosophiae, I, art. 51, AT VIII-1, p. 24.
17 Descartes, Meditationes, III, AT VII, p. 49-50 ; Secundae Responsiones, AT VII, p. 168-169.
18 Husserl, 2018 [1913], § 49, p. 149-150 : « […] si nous pensons à la possibilité de ne pas être que comporte l’essence de toute transcendance chosique, il apparaît alors clairement que l’être de la conscience, de tout flux de vécu en général, serait certes nécessairement modifié par un anéantissement du monde des choses, mais ne serait pas atteint dans sa propre existence ».
19 Sur l’hostilité husserlienne envers toute métaphysique, voire à toute « philosophie » préconçue, voir le Projet d’Introduction [1912] aux Ideen (Husserl, 2018 [1913], p. 478) : « Nous souhaitons… engager tout spécialement ceux qui mettent leur fierté à bannir toute “métaphysique” hors du champ des efforts humains vers la connaissance […] à se livrer sans prévention à l’étude de nos démonstrations. »
20 Sur ce point, voir Monseu, 2016, p. 426-429.
21 Kant, 2001 [1781, 17872], B 275, p. 283.
22 Héring, 1926, p. 85.
23 Nous renvoyons l’examen détaillé des relations entre Baudin et Husserl à une autre étude. Il suffira pour notre propos de citer ici un extrait de la recension que fait Baudin de la thèse de Hauter : « À notre connaissance, c’est la première fois qu’on étudie l’“objet religieux” ut sic, dans l’intention d’en définir l’essence et les variétés, indépendamment de ses réalisations de fait. L’histoire, la psychologie, la sociologie, etc., ne sont admises à audience que pour soumettre leurs résultats à une analyse […] nettement philosophique, ou pour mieux dire phénoménologique, au sens husserlien du mot. Par là, le livre de M. Hauter rejoint celui de son collègue M. Héring, Phénoménologie et science [sic] religieuse […] Tous ces volumes témoignent d’un même effort d’objectivisme qui est comme la caractéristique de la nouvelle faculté de théologie protestante de Strasbourg. Elle tend par là à se dégager du subjectivisme de Ritschl… » (Baudin, 1930, p. 326.)
24 Schweitzer, 2001 [1919-1921].
25 Schuhmann, 1977, p. 343 [8-12 mars 1929]. Sur Mazaryk et Husserl, voir Sebestik, 2003. Sebestik rapporte que Mazaryk est celui qui a fait connaître Brentano à Husserl ; c’est également lui qui aurait déterminé la conversion de Husserl au protestantisme. Sur Schweitzer et Mazaryk, et leur rencontre à Prague en décembre 1928, voir Sorg, 2007. L’article montre la conviction constante de Mazaryk, depuis sa thèse de 1879 sur le suicide : la modernité est rongée par l’hypertrophie du subjectivisme. On comprend quel effet ce positiviste opposé à toute métaphysique, voire à toute théorie conçue comme superstruction spéculative, a pu faire sur le jeune Husserl.
26 Husserl, 1994 [1931], § 41, p. 132.
27 Roman Ingarden à Jean Héring, Cracovie, le 26 décembre 1965 : « Was ihre spätere Bemerkungen zu der Husserlschen Erneuerung der Wendung “nulla re indiget a[d] existendum” betrifft, so glaube ich, dass Husserl da unter “res” ein seinsautonomes und seinsselbstbeständiges Etwas gemeint hat ; denn es ist klar, dass das Husserlsche reine Bewusstsein die intentionalen Korrelate (die Noemata verschiedener Stufe) zu seiner Existenz braucht, weil ihr Vorhandensein die notwendige Folge der Bewusstseinakte (der Noesen) ist. In diesem Sinne braucht es nach Husserl auch die (bloss intentionale vermeinte) reale Welt : diese existiert mit eben derselben Notwendigkeit, wie die Bewusstseinströme selbst, sobald sie nur die entsprechende Struktur haben (d.h. einstimmig verlaufen und im Einverständnis mit den Alter egos vollzogen werden). Aber darum handelt es sich unzweifelhaft um die Welt der materiellen Dinge und Vorgänge al sein seinsautonomen (und insbesondere auch vom dem reinen Bewusstsein seinsunabhängigen) Welt. Husserl suchte – und zwar bis zu seinem Tode – die alte Substanzhaftigkeit der eigenen Seele (des reinen Ichs), da dies für ihn wahrscheinlich mit dem Unsterblichkeitsproblem streng verbunden war. »
28 Schuhmann, 1977, p. 226 [Bernau Pfingstferien 1918] : « […] da kam eine Flut befreundeter, herzlich willkommener Gaste, darunter Frl. Dr. Stein und aus Straßburg Herr Hering […] Hering las mit Ihre Schrift und wir unterhielten uns über Ihre Auffassung der göttlichen Allmacht. Wir lasen zusammen ein im Felde hingeworfenes religionsphilosophisches Ms. aus Dr. Reinachs Nachlaß ». C’est dans cette même période que Ingarden rédige sa programmatique lettre à Husserl Sur la 6e Recherche Logique et l’idéalisme (Ingarden, 2001, p. 149-167), où il est notamment relevé que Husserl, après avoir établi dans les Ideen l’hétérogénéité absolue de la conscience et de la « réalité » – ce que Ingarden approuve – en vient à nier que celle-ci ait un être absolu et indépendant, et à réduire, voire déduire la distinction entre conscience et réalité de la distinction plus fondamentale entre noèse et noème : « Alors, finalement, selon votre interprétation, la chose par exemple, en tant que corrélat d’une multiplicité infinie de perceptions, n’est rien d’autre qu’un sens noématique (et “au-delà de cela elle n’est rien”) » (ibid., p. 153) – ce que Ingarden conteste.
29 Reinach, 1921, p. xxiv : « Vor allem den religiösen Erlebnisse ihren Sinn lassen ! Auch wenn er zu Rätseln führt. Gerade diese Rätsel sind vielleicht für die Erkenntnis von dem höchsten Werte. »
30 De fait, comprendre le vécu comme un « événement » est précisément ce que fait le jeune Heidegger en 1919, mais indépendamment de Reinach et Héring, et selon toute apparence contre Husserl. Voir à ce sujet Serban, 2018.
31 Adolf Reinach, Aufzeichnungen aus dem Nachlaß (25.4.16) : « Intentionale Erlebnisse haben eine Ichquelle, eine Gegenstandsquelle, eine Gegenstandsbeziehung. Sie schöpfen immer wieder aus der Gegenstands-Quelle als ihrem Nährboden. Andere intentionale (religiöse) Erlebnisse suchen ihre gegenständliche Beziehung aus ihrer Erlebnismaterie heraus, statt umgekehrt. Dagegen können sie auch ihre Gegenstandsquelle als Nährboden haben (die fromme Dankbarkeit). Die Frömmigkeit gehört zur Erlebnismaterie. Und es mag wohl so sein, daß sie zu Gott führt und nicht von Gott (phänomenal) herrührt. » (Les vécus intentionnels ont une source dans le Je, une source dans l’objet, et une relation à l’objet. Ils se créent toujours à nouveau à partir de l’objet fontal. D’autres vécus intentionnels [religieux] tirent leur relation à l’objet de la matière même du vécu, au lieu du contraire. Ils peuvent pourtant aussi avoir une relation à l’objet source comme sol nourricier [la pieuse gratitude]. La piété appartient à la matière du vécu. Et il se peut bien qu’elle mène à Dieu, plutôt qu’elle n’en provienne [phénoménalement]). La Frömmigkeit est définie un peu plus loin (10.5.1916) comme la disposition ouverte, comme le se-s’ouvrir-à (das « Geöffnetsein ») la verticalité absolue.
32 Adolf Reinach, Aufzeichnungen aus dem Nachlaß (28.4.16) : « Die Religionsphilosophie dient aber nur, sie mag Erlebnisse klären, aber nur um wieder reinere Erlebnisse erwachsen zu lassen. »
33 Serban, 2016.