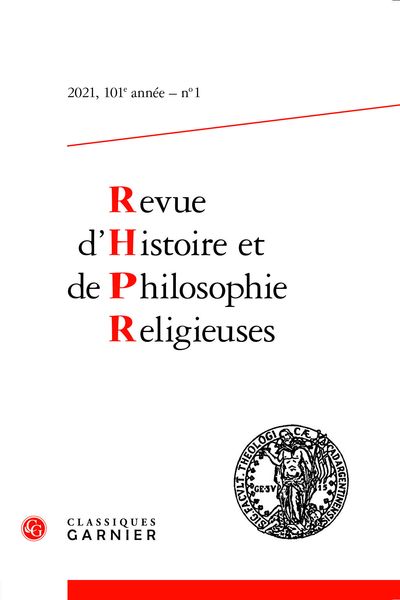
Revue des livres
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Revue d’histoire et de philosophie religieuses
2021 – 1, 101e année, n° 1. varia - Auteurs : Grappe (Christian), Hunziker-Rodewald (Régine), Rognon (Frédéric)
- Pages : 75 à 130
- Revue : Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses
- Thème CLIL : 4046 -- RELIGION -- Christianisme -- Théologie
- EAN : 9782406115021
- ISBN : 978-2-406-11502-1
- ISSN : 2269-479X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11502-1.p.0075
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 15/03/2021
- Périodicité : Trimestrielle
- Langue : Français
REVUE DES LIVRES
SCIENCES BIBLIQUES
Généralités
Lukas Bormann (éd.), Abraham’s Family. A Network of Meaning in Judaism, Christianity, and Islam, Tübingen, Mohr Siebeck, coll. « Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament » 415, 2018, ix + 498 pages, ISBN 978-3-16-156302-7, 154 €.
Fruit d’un projet commun de recherche aux universités d’Åbo et de Marbourg, conclu par un colloque qui s’est tenu dans la seconde de ces villes en 2016, l’ouvrage rassemble 22 contributions, dont dix (3 et 7) sont dues à des auteurs appartenant aux deux institutions partenaires.
Il couvre les trois religions précisément appelées abrahamiques et s’intéresse à la fois à la figure du patriarche lui-même mais aussi à sa famille dès lors que c’est non seulement autour d’Abraham mais aussi autour de sa descendance que se sont cristallisés controverses, débats et polémiques.
Le champ de l’Ancien Testament est d’abord couvert. K. Schmid distingue trois phases, successivement pré-sacerdotale, sacerdotale et post-sacerdotale, au sein du développement de la tradition d’Abraham dans l’histoire littéraire du Pentateuque. A. Laato propose, en tension avec l’étude précédente, que différents récits du cycle d’Abraham conservent la trace de l’idéologie royale sous la monarchie unifiée de David et de Salomon et soutenue par l’Égypte. M. Kartveit montre comment les Samaritains se sont employés à rattacher les figures d’Abraham et de Salomon à leur lieu de culte, le mont Garizim. L. Valve s’intéresse à la façon dont est présentée Rébecca en Gn 24 et montre combien la riche histoire de la réception du passage s’en écarte en opérant des coupes, des reformulations ou des développements.
76C’est ensuite la littérature juive ancienne qui est abordée. J. van Ruiten traite de la famille d’Abraham dans les Jubilés et montre notamment que cet écrit fait remonter la séparation entre Israël et les autres nations non à Abraham mais à la création du monde. A. El Mansy se focalise sur Jubilés 27,17 et y voit, à travers la présentation de Jacob en tant qu’homme parfait et véritable, la promotion d’un type de masculinité hégémonique en opposition à la figure d’Ésaü, conçu comme représentant d’une masculinité marginalisée mettant en danger la conception de la judéité promue par l’écrit. J. Høgenhaven s’intéresse au rôle sacerdotal attribué à Abraham qui apparaît à la fois comme ancêtre de la lignée sacerdotale, et notamment des sadocites, et fondateur de pratiques sacrificielles dans la littérature qumrânienne. M. Becker se penche sur Abraham et l’offrande d’Isaac dans les exégèses juives et chrétiennes anciennes et conclut à l’existence d’influences vraisemblables, notamment sur Rm 8,32. Chr. Noack traite de la famille d’Abraham chez Philon en montrant l’importance qu’y revêtent la signification étymologique des noms et l’interprétation allégorique qui en est proposée pour gagner les lecteurs à la véritable philosophie.
Vient le tour du Nouveau Testament. L. Bormann scrute Rm 4,1 et l’appellation unique, que l’on y rencontre, d’Abraham en tant qu’ancêtre et montre comment elle sert l’argumentation de Paul visant à faire d’Abraham un modèle pour le peuple de Dieu. A. Standhartinger se penche sur la figure d’Agar en recourant aux théorisations féministes de l’intersectionnalité. Chr. Boettrich traite d’Abraham conçu, avec un regard orienté vers le futur plutôt que vers les origines, comme un personnage céleste, image de l’espérance, avocat des justes et « symposiarche de l’eschaton » en Luc-Actes. G. Baltes propose de comprendre la parabole du fils perdu et retrouvé sur l’arrière-plan de l’histoire de Jacob et Ésaü, l’itinéraire du fils prodigue illustrant l’inclusion à venir des gentils en dépits des réticences de Jacob-Israël. J.C. de Vos s’intéresse au traitement d’Abraham et de sa famille en Hébreux et y voit autant de figures types pour le présent et le futur, sur lesquelles les destinataires sont appelés à modeler leur propre foi et leur propre espérance sur la voie conduisant à la cité céleste. E.-M. Kreitschmann traite, de façon globale, du réseau familial d’Abraham dans le NT et relève une différence entre la plupart des écrits, qui mettent en œuvre le motif d’Abraham, Isaac et Jacob en tant que représentants d’une entité ethnique, Israël, et Paul, qui s’intéresse à Abraham en tant que père universel des croyants.
77Part est faite ensuite à la littérature chrétienne ancienne. M. Meiser présente Abraham et sa famille dans l’exégèse patristique latine qui affronte en Gn 12–25 des questions proprement exégétiques et des problèmes moraux. A.M. Laato aborde, dans la perspective du dialogue interreligieux contemporain, l’exégèse proposée de la prophétie relative à Jacob et Ésaü en Gn 25,23 jusqu’à Augustin. M. Durst s’intéresse à la manière dont l’empereur Julien l’Apostat intègre, en fonction de sa conception d’une universalité englobant toutes les nations tout en maintenant leurs différences, Abraham et sa famille dans sa polémique anti-chrétienne.
Enfin, la famille d’Abraham est étudiée au sein de l’exégèse juive et dans la rencontre qui s’effectue avec l’islam. R. Firestone se concentre sur l’importance que revêtent Agar et Ismaël dans la tradition musulmane, au sein de laquelle ils deviennent des personnages clés alors qu’ils sont respectivement absents et peu présents dans le Coran. M. Gomez Armenda présente les vifs débats relatifs à la rivalité entre Jacob et Ésaü dans l’exégèse juive médiévale, cela au sein de discussions mettant en tension justice et malice, idolâtrie et éducation rabbinique, ou encore le peuple d’Israël et les autres nations. B. Beinhauer-Köhler montre comment le récit que propose Ibn Jubayr (1145-1217) de son pèlerinage à La Mecque révèle que les pèlerins devenaient eux-mêmes partie prenante du récit relatif à Abraham, Ismaël et Agar. Enfin, C.-St. Popa s’intéresse à la façon dont les auteurs chrétiens syriaques en appelaient à Abraham en faveur de la doctrine de la Trinité et de la christologie à l’aube de la domination musulmane.
L’ouvrage, complété par les index (des textes anciens cités, thématique, des auteurs modernes cités, les deux derniers n’étant cependant pas exhaustifs) habituels dans la collection qui l’accueille, est extrêmement riche et divers. Il ouvre bien des perspectives et invite au dialogue entre traditions diverses et religions monothéistes autour d’une figure et d’une famille centrales et fondatrices. Le néotestamentaire pourra cependant regretter que place ne soit quasiment pas faite au conflit d’interprétation auquel donne lieu la figure d’Abraham chez Paul et chez Jacques.
Christian Grappe
78Jörg Frey, Claire Clivaz, Tobias Nicklas (éd.) en collaboration avec Jörg Röder, Between Canonical and Apocryphal Texts. Processes of Reception, Rewriting, and Interpretation in Early Judaism and Early Christianity, Tübingen, Mohr Siebeck, coll. « Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament » 419, 2019, ix + 490 pages, ISBN 978-3-16-153927-5, 149 €.
L’ouvrage est le fruit quelque peu tardif de deux colloques et d’une école d’été qui ont eu lieu à l’Université de Zurich en 2011 et 2012 et qui avaient pour thème le processus de composition de textes ou paratextes apocryphes à partir de textes revêtant déjà un statut canonique ou faisant autorité (Apokryphisierung). Il ne fait l’objet ni d’une introduction détaillée ni d’une segmentation particulière, si bien que le lecteur n’est pas guidé dans la découverte des différentes contributions – 19 au total, dont 9 en anglais, 9 en allemand et 1 en français – qui se succèdent, même si on devine que c’est un principe chronologique qui a été privilégié le plus souvent pour ordonner les diverses études après les trois premières qui se situent davantage sur le plan méthodologique.
J. Frey part d’abord en quête de procédés d’« apocryphisation » dans les littératures juive et chrétienne anciennes, tandis que S. Mimouni revient sur le débat mettant en jeu concept d’apocryphicité et concept de canonicité et que M. Meiser se penche sur des problèmes de méthode dans la prise en compte des techniques d’interprétation à l’œuvre dans la Septante des prophètes.
V. Bachmann étudie, au miroir du livre d’Esther tel qu’il se présente respectivement dans le texte massorétique, dans la Septante et dans le texte Alpha, les variations que l’on observe et les approches différentes qui sont proposées de la thématique pouvoir et identité. M. Becker étudie la présentation d’Abraham en tant que patriarche non dépourvu de faiblesses dans l’Apocryphe de la Genèse. D. Hamidović s’intéresse à la chaîne scripturaire faisant autorité visant à garantir un lien direct entre ciel et terre dans le livre des Jubilés. J. Jokiranta s’interroge, entre citation, écriture et lecture, sur ce qui fait autorité dans le Pesher d’Habacuc à Qumrân. St. Krauter situe Esdras entre Canon et apocryphes. A. Houtman montre comment leur croyance en une juste rétribution post mortem et en la résurrection des corps a influencé le travail des traducteurs du targum d’Ésaïe. K.H. Ostmeyer compare le Prière de Manassé 79dans les formes respectives qu’elle revêt à Qumrân (dans le fragment 33 de 4Q381), dans la Septante et dans la version rabbinique retrouvée dans la geniza du Caire. E.E. Popkes traite de l’« apocryphisation » du message de Jésus dans l’Évangile de Thomas, en tenant le plus grand compte de la place qu’il occupe au sein du deuxième codex des écrits de Nag Hammadi. Cl. Cilvaz met en parallèle les témoins les plus anciens d’Hébreux et de l’Évangile selon les Hébreux et propose de les lire en tant que reflets de la manière dont ils étaient lus dans le premier lieu connu de leur réception, l’Égypte. W. Grünstäudl s’intéresse à la construction de l’autorité apostolique de Pierre dans l’Apocalypse de Pierre et en 2 Pierre en établissant que le second de ces écrits est en fait dépendant du premier et en tirant des conséquences de ce fait pour ce qui est de la nature et de la fonction du canon. M. Henning aborde la notion d’Enfer en tant qu’hétérotopie et présente la façon dont elle est construite depuis la littérature hénochique jusqu’aux apocalypses de Pierre et de Paul. J. Snyder considère le degré de dépendance variable entre les différents actes apocryphes et les Actes des Apôtres canoniques. Trois contributions tournent ensuite autour des récits de miracles et de leur réception : J. Spittler étudie le développement que connaissent les traditions de miracles dans les actes apocryphes des apôtres et invite à le situer dans le contexte du monde réel et pas d’une réalité séparée ; J. Röder s’emploie à préciser le rapport entre littératures biblique et parabiblique au miroir des récits de miracles que l’on trouve dans les Actes de Pilate ; T. Nicklas situe les récits de miracles chrétiens anciens entre les deux notions de canonicité et d’apocryphicité. Enfin, M. Sommer propose des réflexions sur la réception de l’Écriture, sur l’eschatologie et sur la conception de l’auteur que défend l’auteur de l’épître « apocryphe » aux Laodicéens.
L’intérêt de ces différentes études est indéniable et les deux index (textes anciens cités et des thématique) sont très utiles. On aurait cependant aimé que le lecteur soit davantage guidé et que lui soit indiqué un fil conducteur, même si la première contribution pose les questions essentielles et présente l’état actuel des débats.
Christian Grappe
80Michael R. Jost, Engelgemeinschaft im irdischen Gottesdienst. Studien zu Texten aus Qumran und dem Neuen Testament, Tübingen, Mohr Siebeck, coll. « Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe » 505, 2019, xvi + 454 pages, ISBN 978-3-16-156740-7, 104 €.
Version légèrement retravaillée d’une thèse préparée sous la direction de Jörg Frey, soutenue à la Faculté de Théologie de l’Université de Berne et récompensée par le prix de la « Fondation pour l’enseignement du judaïsme à l’Université de Lausanne », l’ouvrage présente une approche encore plus large que ne l’indique son sous-titre puisque, même s’il se concentre bel et bien sur l’analyse des données qumrâniennes et néotestamentaires, il conduit en fait de l’Ancien Testament jusqu’aux littératures rabbinique et patristique.
Après une introduction très claire, une première partie est dévolue à la détection des textes et des motifs clés que l’on trouve dès l’Ancien Testament et les écrits deutérocanoniques et hénochiques : le Temple en tant que lieu de la présence de Dieu ; la représentation des chérubins dans le Temple ; la vision des séraphins dans le Temple en Es 6 ; la louange cosmique dans les Psaumes ; l’assistance des anges dans la prière (Tb 12,12.15) ; la communion eschatologique avec les anges (Dn 12,3 et 1 Hénoch). On peut regretter toutefois ici que ne soit pas discutés et pris en compte des passages comme Za 3,7 ou Ps 73,23-26, qui permettent d’envisager dès ce stade que la liturgie fasse communiquer les mondes, ou encore Testament de Job 46-51, où les trois filles de Job, Héméra, Casia et Corne d’Amalthée, se mettent à chanter dans la langue des anges après que leur père leur a donné à chacune une cordelette magique.
Sont ensuite mis en perspective et étudiés les uns après les autres les manuscrits de la mer Morte. Les données qui résultent de cette étude sont récapitulées ainsi : le culte est conçu comme le fondement même d’une identité dans le cadre d’un cosmos en guerre ; la communion avec les anges est partie constitutive non seulement de la réalité cultuelle mais aussi de la réalité terrestre ; la louange de Dieu revêt une dimension à la fois communautaire et cosmique qui se concrétise dans la communion présente avec les anges, conçue elle-même dans une perspective eschatologique ; les divers aspects de la communion avec les anges donnent lieu au développement d’une taxinomie propre.
81Vient le tour du Nouveau Testament, trois écrits étant successivement étudiés : 1 Corinthiens ; Hébreux et l’Apocalypse, l’A. se concentrant en fait, pour ce qui est des deux premiers d’entre eux, sur 1 Co 11,2-16 et He 12,18-24. Il conclut son parcours en affirmant qu’il n’y a pas de preuve en faveur de la conception d’une véritable communion avec les anges, dans un cadre cultuel, dans le NT. Au fil de la discussion, même là où d’autres avant lui ont suggéré que pareille conception puisse cependant être au moins implicitement présente, notamment dans l’Apocalypse où de nombreux rapprochements ont été effectués avec les Chants pour l’Holocauste du Sabbat, l’A. déclare que les rapprochements sont frappants (augenfällig ; p. 328) mais que l’on n’a pas affaire pour autant explicitement à une communion avec les anges. Il est quelque peu révélateur, nous semble-t-il, dans cette perspective, qu’il n’étudie pas un passage comme 1 Co 13,1, dans lequel Paul envisage pourtant qu’il pourrait parler la langue des anges, ou encore qu’il ignore la deuxième édition du commentaire de l’Apocalypse de Pierre Prigent, pourtant traduite en anglais chez Mohr Siebeck en 2001 et qui s’appuie également sur le témoignage des Chants pour l’Holocauste du Sabbat pour défendre que l’idée d’une communion avec les anges est sous-jacente à nombre de passages de l’écrit.
L’A. en vient enfin aux perspectives rabbiniques et patristiques pour arriver là aussi à des conclusions négatives, Origène et Jean-Chrysostome étant tenus pour responsables, en ce qui concerne la littérature chrétienne ancienne, du passage d’une représentation d’une communion eschatologique à une communion présente avec les anges. On peut être quelque peu surpris de constater que, pour ce qui est de la littérature rabbinique, une seule page soit dévolue à la mystique juive et aux Hekhalot (p. 350) dont une prise en compte sérieuse aurait pu permettre de tracer des lignes – de continuité – avec les représentations déjà attestées à Qumrân.
L’ouvrage, complété par de précieux index (textes anciens et auteurs modernes cités, thématique), apparaît ainsi, aux yeux du présent recenseur, un peu trop catégorique dans ses conclusions. Cela ne doit pas pour autant minimiser l’intérêt d’une enquête dont les résultats auraient sans doute gagné à être quelque peu nuancées.
Christian Grappe
82Jörg Frey, Nicole Rupschus (éd.), Frauen im antiken Judentum und frühen Christentum, Tübingen, Mohr Siebeck, coll. « Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe » 489, 2019, viii + 320 pages, ISBN 978-3-16-154290-9, 99 €.
Fruit d’une journée d’étude qui s’est tenue à l’Académie catholique de Schwerte en 2015 et dédié au regretté Michael Becker auquel est dû la contribution qui le clôt, cet ouvrage, introduit avec beaucoup de soin par N. Rupschus, rassemble douze études.
B. Ego traite d’abord des figures respectives de la Sara du livre de Tobit, d’Esther et de Judith, et de leur attitude religieuse caractérisée par la prière et l’observance de prescriptions halachiques, dans un monde marqué par la place revenant au Temple, si bien qu’elles se trouvent à l’entrecroisement de la piété privée et du culte célébré dans le sanctuaire. A. Standhartinger s’intéresse, à partir surtout du De vita contemplativa de Philon d’Alexandrie et du Testament de Job, aux femmes exerçant des fonctions liturgiques à l’époque du Second Temple. C. Wassén compare les lois de pureté concernant les hommes et les femmes dans les manuscrits de la mer Morte et considère que les sectaires qumrâniens, loin de faire de l’impureté un problème féminin, tenaient l’observance des règles de pureté telles qu’ils les concevaient comme une question les concernant tous et qui s’avérait constitutive de leur identité même. N. Rupschus prend en compte 4Q502 et 4Q184 et se demande si ces deux documents, qui ne sont pas proprement sectaires et qui relèvent l’un du registre liturgique et l’autre de la sphère sapientiale, peuvent être reliés d’une manière ou d’une autre à des préoccupations de la communauté qumrânienne. K. Czajkowski propose une nouvelle approche de la Loi telle qu’elle est comprise dans les archives privées de deux femmes, Babatha et Salomé Komaïse, archives qui ont été retrouvées dans la Grotte aux lettres du Nahal Hever et qui permettent de reconstituer la manière dont ces femmes s’employaient à faire valoir leurs droits. T. Ilan s’intéresse à un autre aspect que laissent transparaître ces mêmes archives, à savoir la discrimination dont font l’objet les femmes et qui les amène à conserver des documents écrits précisément parce qu’elles ne bénéficient pas du même statut que les hommes. Chr. Kreinecker se penche sur le quotidien des femmes, leurs droits et les possibilités qui leur étaient offertes à l’époque néotestamentaire, cela à partir de papyri égyptiens qui montrent qu’elles étaient avant tout considérées comme épouses et mères mais qu’elles pouvaient aussi mener des actions juridiques, si du moins elles disposaient des moyens financiers 83pour ce faire. M. Sommer aborde la question des veuves au début du christianisme et invite, en recourant à la sémantique mémorielle, à considérer d’abord les textes où il est question d’elles comme des tentatives de transformer l’environnement historico-social des destinataires plutôt que comme des témoins d’une vulnérabilité particulière qui aurait été la leur. Chr. Böttrich, dans une contribution particulièrement remarquable, situe entre sensibilité de l’auteur et conventions ambiantes le rôle assigné et reconnu aux femmes dans l’œuvre double à Théophile. A. Merz jette un regard critique sur la thèse de B. Winter dans son ouvrage Roman Wives, Roman Widows. The Apparence of New Women and the Pauline Communities (2003) et sur sa réception au sein de l’exégèse contemporaine. St. Janz explore la place occupée par Marie Madeleine dans l’Évangile de Marie et s’emploie à faire le départ entre tradition littéraire et réalité historique d’un rôle particulier joué par Marie Madeleine aux côtés de Jésus, rôle qui se reflète dans son érudition et dans les conflits concernant sa position au sein de la communauté des disciples. Enfin, M. Becker aborde le champ de la littérature rabbinique, relève que les femmes y sont largement sous-représentées mais que, dans les textes relatifs à Hanina ben Dosa en particulier, son épouse fait l’objet d’une évaluation tout à fait positive en tant que femme d’un personnage doué d’un don de guérison charismatique.
L’ouvrage, complété par plusieurs index (textes anciens et auteurs modernes cités, thématique), jette des éclairages tout à fait intéressants et parfois nouveaux sur les écrits et les passages qui sont abordés. Reflet aussi d’approches méthodologiques diverses, il donne à penser et invite à reconsidérer des thèses prétendument avérées au sein de la recherche.
Christian Grappe
Jörg Frey, Michael R. Jost, Franz Tóth (éd.), unter Mitwirkung mit Johannes Stettner, Autorschaft und Autorisierungsstrategien in apokalyptischen Texten, Tübingen, Mohr Siebeck, coll. « Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament » 426, 2019, xii + 462 pages, ISBN 978-3-16-157024-7, 149 €.
Fruit d’un symposium qui s’est tenu à Zurich en 2016 en l’honneur d’Adela Yarbro Collins et de John J. Collins qui avaient été distingués l’année précédente d’un doctorat honoris causa de l’université de 84la ville, ce volume, pourvu d’un préambule mais pas d’une réelle introduction, se divise en quatre parties.
Sont proposées d’abord une introduction et des généralités. F. Tóth traite du sujet même du volume et l’explicite en quelque sorte, en se livrant à une discussion des notions d’auteur et d’autorité, qui prend en compte notamment l’approche narratologique, introduit les notions d’auteur implicite et d’auteur abstrait et s’achève par un exercice d’application des catégories préalablement définies à l’Apocalypse de Jean pour établir un modèle de communication en son sein. M. Janßen s’interroge à son tour sur la notion d’auteur en étudiant, à l’aune de la littérature grecque, à la fois la représentation et la mise en scène de la paternité des œuvres dans l’Antiquité.
Place est faite ensuite au judaïsme antique. K. Schmid s’intéresse à la manière dont les prophètes sont devenus, au fil des actualisations et de l’expansion progressive de leurs textes, des auteurs bibliques capables d’embrasser de leur regard la totalité de l’histoire du monde et comment, en fonction de ce processus, les auteurs bibliques sont devenus prophètes. E. Bosshard-Nepustil fait valoir, à la lumière d’Es 34,16 (« Cherchez dans le livre du Seigneur et lisez »), que Jhwh lui-même est présenté comme l’auteur du livre d’Ésaïe et comme l’autorité suprême qui s’y exprime, cela pour laisser entendre que la médiation de ce livre permet de se rapprocher de lui et de trouver la voie du salut en des temps troublés. J.J. Collins traite de la présence de plus en plus forte de la Torah au sein des apocalypses juives et montre que même là où elle constitue en quelque sorte le point de départ (à Qumrân, en 4 Esdras et en 2 Baruch), elle n’en est pas moins surpassée en quelque sorte dans la mesure où il est fait appel à une révélation plus haute encore pour guider son interprétation, la compléter, voire l’outrepasser. M.J. Goff montre comment, en en appelant comme auteur à une figure antédiluvienne conçue comme transmetteur d’une connaissance divine préservée en son sein, la littérature hénochique veut offrir à ses lecteurs un moyen de se relier au passé primordial et de le comprendre. S. Krauter se demande pourquoi 4 Esdras se revendique de ce personnage et propose que l’auteur fictif du livre soit en fait un Esdras redivivus qui plaide à la fois en faveur d’une continuité avec la tradition biblique et, en des temps où cette tradition traverse une crise profonde, en faveur d’une issue à cette crise, qui consiste en une transformation de cette tradition. I. Czachesz reconsidère, à la lumière des neurosciences et en recourant aussi au comparatisme, les origines et la transmission 85des visions apocalyptiques en accordant une attention particulière aux pseudépigraphes juifs et chrétiens. Il estime que le recours à la pseudépigraphie permet un ancrage dans la tradition culturelle tout en générant des chaines de représentations, d’expériences et de conduites à travers les siècles. J. Kiffiak comprend le recours à la pseudonymie en 2 Baruch en considérant de manière plus particulière Jr 45,1-5 et montre que le Baruch qui s’exprime désormais, dans le contexte postérieur à la première révolte juive, et dont les propos sont garantis par Dieu – ce qui n’était pas le cas pour son devancier – est tout désigné pour exhorter les destinataires à la fidélité à la Torah afin qu’ils bénéficient, dans le présent, de la protection divine et, dans le monde à venir, de la vie éternelle. Dans une contribution très riche, Chr. Böttrich se tourne vers l’Échelle de Jacob et étudie la présentation qui y est faite du patriarche en tant que porteur de révélation. Enfin, M. Tilly se penche sur l’apocalyptique et la mystique au sein du judaïsme rabbinique et conclut que, pour ces milieux rabbiniques, les traditions apocalyptiques que l’on trouve au sein de la littérature des Hekhalot font autorité non parce qu’elles viennent du ciel mais parce qu’elles y conduisent.
Le christianisme antique est illustré pour sa part par quatre contributions. A. Yarbro Collins étudie la construction de l’autorité de l’auteur dans l’Apocalypse, un auteur dont le rôle se limite à la simple médiation, mais la médiation d’un texte qui revêt lui-même la plus haute et la plus sûre autorité divine, si bien que l’auteur apparaît en retour paré des plus grands privilèges et d’une autorité insigne. J. Dochhorn traite de la construction de l’auteur dans l’Ascension d’Ésaïe, écrit qu’il tient pour témoin d’une frange du christianisme antique qui avait tendance à faire parler et vivre les prophètes en un sens explicitement chrétien. T. Nicklas dissèque la construction de l’autorité de l’auteur dans l’Apocalypse de Pierre, un « Pierre » qui tient son autorité du Christ lui-même, qui, en tant que Fils de Dieu, annonce aux siens qu’ils auront part ultimement à sa miséricorde et peut leur ouvrir l’accès à la corporéité céleste dans le Paradis. Quant à T.J. Kraus, il traite du Paul de l’Apocalypse de Paul et conclut que c’est moins le personnage ayant autorité qui est mis en avant que, dans une perspective émotionnelle, celui qui perçoit l’au-delà, qui a compassion et qui prie et intercède pour les autres.
Une dernière étude, due à G. Regen, franchit les siècles, et explore révélation, allégorie et poésie dans la Divine comédie de Dante.
86L’ensemble, dont on cherche parfois avec quelque peine le fil conducteur alors que les contributions qu’ils rassemblent sont d’excellente qualité, est complété par trois index (des textes anciens, des auteurs modernes et thématique).
Christian Grappe
Jörg Frey, Qumran, Early Judaism and New Testament Interpretation. Kleine Schriften III. Edited by Jacob N. Cerone Tübingen, Mohr Siebeck, coll. « Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament » 424, 2019, ix + 905 pages, ISBN 978-3-16-156015-6, 214 €.
Ce volume rassemble 24 contributions qui ont toutes été écrites ou traduites (pour 10 d’entre elles) en anglais et qui ont été publiées entre 1997 et 2019, deux d’entre elles paraissant d’ailleurs ici avant même qu’elles soient publiées par ailleurs.
Il s’ouvre par deux études que l’on peut tenir pour programmatiques, la leçon inaugurale de l’A., donnée en 2011 à l’Université de Zurich et intitulée « Recherche néotestamentaire et judaïsme ancien : problèmes, représentations, perspectives », et un article très développé qui a paru dans la Realenzyklopädie für Antike und Christentum en 2017 sous le titre « Qumrân : un panorama » et qui traite, dans sa dernière partie, de l’importance de Qumrân et des manuscrits qui y ont été retrouvés pour la compréhension du christianisme primitif. La conclusion illustre fort bien la position générale de l’A. : « Les découvertes de Qumrân ont changé, comme aucune autre découverte, l’image des contextes juifs dans lesquels s’inscrit le christianisme primitif. Sont concernés l’interprétation de l’Écriture, l’eschatologie, le messianisme, l’angélologie et la démonologie, la coexistence de partis religieux et de discours halachiques, les calendriers et les fêtes, le développement de la sagesse et de l’apocalyptique, les genres littéraires et les traditions liturgiques. Rien de tout cela ne saurait être compris de manière adéquate sans les textes de Qumrân. Cela étant, toute spéculation relative à des liens directs entre esséniens et premiers chrétiens est infondée. Plus importante que la question des influences “esséniennes” sont les affleurements qui apparaissent à travers les analogies et parallèles [que l’on observe] dans les textes (qu’ils soient spécifiques du 87groupe ou non) et qui aident à comprendre le mouvement chrétien naissant au sein du judaïsme multiforme contemporain » (p. 81).
Sont regroupées ensuite des études relatives aux textes de Qumrân et juifs anciens qui se réfèrent peu au Nouveau Testament. Elles traitent successivement : de la recherche qumrânienne et de la recherche biblique en Allemagne ; de Qumrân au miroir de l’archéologie (l’A. se rallie dans l’ensemble à l’hypothèse de Roland de Vaux tout en la nuançant sur bien des points ; il conclut qu’il y a encore de nombreux arguments en faveur de la thèse selon laquelle un groupe religieux juif a utilisé Khirbet Qumrân comme installation communautaire) ; de la valeur historique des anciennes sources relatives aux esséniens ; de l’importance des découvertes de Qumrân pour la compréhension de l’apocalyptique ; des différents modèles de pensée dualiste (dualisme cosmique, eschatologique, éthique, anthropologique… avec toute une série de nuances possibles) attestés dans la bibliothèque qumrânienne ; de la formation et de l’histoire des débuts du dualisme apocalyptique ; des origines du genre littéraire des testaments ou discours d’adieu ; du texte relatif à la Nouvelle Jérusalem dont des fragments ont été retrouvés dans plusieurs grottes à Qumrân et qui est replacé ici dans son contexte historique et dans l’histoire, qu’il vient rendre plus complexe, d’une tradition allant d’Ézéchiel à l’Apocalypse ; des témoignages relatifs aux repas communautaires à Qumrân (pour conclure que, loin des conclusions proposées par les premiers chercheurs, ils fournissent au mieux des analogies indirectes aves le dernier repas de Jésus) ; de l’autorité des Écritures dans les écrits qumrâniens ; de la vision du monde, à la fois temporelle et spatiale, du Livre des Jubilés et de la façon dont elle contribue à façonner l’identité collective d’un peuple appelé à être à la fois sacré et saint ; des temples concurrents du Temple de Jérusalem (à Éléphantine, au mont Garizim et à Léontopolis).
Suivent des contributions dévolues pour leur part directement à l’importance des découvertes faites à Qumrân pour l’étude des textes du NT et la recherche néotestamentaire en général. La première, qui est un article paru dans une encyclopédie, passe en revue, dans une perspective méthodologique, des questions cruciales en la matière et invite à la prudence déjà recommandée dans le passage, cité ci-dessus, de la page 81. Suivent : des propositions, des questions et des perspectives relatives à l’impact des manuscrits de la mer Morte sur l’interprétation du NT à l’exemple de la 88figure de Jean Baptiste et de l’opposition entre chair et esprit ; des considérations herméneutiques sur le même thème mais en lien plus particulièrement avec la tradition relative à Jésus et les origines de la christologie ; une étude qui constitue une nouvelle variation sur le thème envisagé par les deux précédentes ; un exemple (Mt 5,25-26) de l’intérêt de littérature retrouvée à Qumrân pour éclairer le NT, exemple pour lequel les parallèles proposés, tirés notamment de 4QInstructions, écrit qui n’apparaît pas propre à la secte, illustrent pour l’A. que les textes non sectaires retrouvés sur le site sont peut-être plus importants encore que les textes proprement qumrâniens pour éclairer le NT dès lors qu’ils livrent un aperçu des traditions en vigueur dans le judaïsme aux alentours du tournant de notre ère ; deux études qui reviennent l’une et l’autre sur la tension chair – esprit, la première consacrée tout entière à la manière dont Paul conçoit l’esprit à la lumière de Qumrân, la seconde envisageant de manière plus large comment la tradition sapientiale juive et les textes de Qumrân incluant ici encore 4QIntructions peuvent éclairer cette tension ; des contributions relatives respectivement à l’intérêt de 4QMMT, qui fournit l’arrière-plan de l’emploi terminologique de l’expression « œuvres de la Loi » chez Paul, à la manière dont le dualisme johannique peut être mieux cerné à la lumière des dualismes attestés dans la bibliothèque qumrânienne, et cela sans qu’il y ait pour autant influence qumrânienne directe, à l’intérêt de la bibliothèque qumrânienne pour éclairer la question, éminemment complexe, de l’émergence progressive du canon de la Bible hébraïque en la replaçant dans le cadre d’un judaïsme décidément pluriel.
L’ensemble est complété par différents index (des textes anciens, des auteurs modernes, thématique, des mots araméens, hébreux et grecs). Si la matière est parfois quelque peu redondante dès lors que plusieurs thèmes sont étudiés à diverses reprises, l’ouvrage illustre à merveille la hauteur de vue de l’A., sa capacité à présenter de manière à la fois très honnête et très bien informée des débats complexes et à faire saisir les enjeux de la recherche tout en proposant des vues équilibrées et toujours parfaitement argumentées. Ce recueil d’articles s’avère ainsi d’une remarquable cohérence et de la plus grande utilité.
Christian Grappe
89Mikael Tellbe, Tommy Wasserman (éd.) with assistance of Ludwig Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity, Tübingen, Mohr Siebeck, coll. « Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe » 511, 2019, xii + 317 pages, ISBN 978-3-16-158936-2, 79 €.
Fruit d’un colloque éponyme qui a eu lieu en Suède, à l’Örebo School of Theology, en 2018, l’ouvrage, introduit par M. Telbe, se divise en deux grandes parties.
La première est dévolue au judaïsme du Second Temple et au christianisme émergeant. L.-S. Tiemeyer explore la façon dont les trois prophéties de Za 3,1-10, 5,1-4 et 5,5-11 envisagent l’expulsion du mal hors du pays pour purifier, restaurer et, de quelque manière, guérir ce dernier, cela en exportant spatialement le mal dans une terre étrangère. Elle trouve des analogies avec des textes proche-orientaux et aussi avec Lv 16 et esquisse des trajectoires très suggestives qui conduisent, pour Za 5,5-11, jusqu’à Mc 5,1-20 et au récit de la rencontre entre Hanina ben Dosa et Agrat dans le Talmud. C. Wassén s’intéresse à l’impureté et aux esprits impurs dans les évangiles, considère que cette dernière appellation remonte au Jésus de l’histoire lui-même et que, en associant ainsi ces esprits à l’impureté, d’une part, le Nazaréen relie maladie et péché et reproche aux démons d’égarer ceux qui sont leur proie et, d’autre part, les démasque en tant qu’impurs par nature et, en les combattant, pose des signes de l’irruption du Royaume. S. Grindheim envisage les implications christologiques des exorcismes et du pardon des péchés. Il fait valoir, quant à lui, que dans le Nouveau Testament aucun lien n’est effectué entre exorcisme et pardon de pardon des péchés mais que, dans les deux cas, ce qui est jeu, c’est l’autorité de Jésus, une autorité sans égale qui le fait agir en lieu et place de Dieu lui-même. S.R. Garrett fait valoir que le miracle que Jésus ne peut pas faire chez Marc, c’est ouvrir à son message les esprits des humains dès lors que la défaite de Satan n’a pas encore été consommée lors des événements décisifs de la Crucifixion et de la Résurrection, ce qu’illustre Mc 8,33, en lien avec Mc 8,22-26 (ou encore avec la fuite des disciples en Mc 14,50) et en tension avec Mc 4,11-12. Après voir très opportunément cité les passages qui, dans la littérature intertestamentaire, associent émergence des temps derniers et défaite ou disparition de Satan et de ses troupes (1QS 4,18-21 ; 1 Hénoch 55,4 ; Jubilés 23,29 ; 50,5 ; Testament de 90Moïse 10,1 ; Testament de Siméon 6,6 ; Testament de Lévi 18,12-13 ; Testament de Zabulon 9,8-9 ; Testament de Dan 5,11), passages qui auraient pu être pris en considération dans les trois précédentes contributions, S. Walton envisage, en termes de sunkrisis, les deux passages de l’œuvre à Théophile dans lesquels Jésus et Paul adressent une consigne de silence à des démons (Lc 4,31-37 et Ac 16,16-18) et estime que ce motif a pour but d’éviter une mécompréhension de Jésus, de sa mission et de la proclamation évangélique en empêchant un dévoilement prématuré et partiel de son identité. G. Twelftree fait valoir, à l’aune de Paul, de Marc et de Jean, que l’on a affaire à des approches sensiblement différentes des guérisons et des exorcismes au sein de l’Église primitive mais qu’elles ont en commun le fait que le motif de la guérison apparaît comme une expression de la bonne nouvelle et que cette guérison advient par le nom de Jésus. L. Hurtado se penche précisément sur le recours rituel au seul nom de Jésus dans les récits d’exorcismes et de guérisons aux origines du christianisme et y discerne une marque de la centralité de la personne de Jésus au cœur de la première prédication chrétienne.
La deuxième partie traite de l’Église ancienne. J. Knust et T. Wasserman s’intéressent à la première réception du quatrième évangile au miroir de l’ancienne numérotation des chapitres (kephalaia) et font valoir que cette numérotation atteste que l’œuvre était lue alors comme un évangile empli de récits miraculeux, et cela alors même, ajouterons-nous, que le mot « miracle » n’y est jamais employé, le terme « signe » lui étant systématiquement préféré. K.O. Sandnes traite des débats relatifs à Jésus thaumaturge à partir de deux exemples, les controverses opposant respectivement Origène à Celse et Eusèbe de Césarée à Hieroclès, et constate que le fait que Jésus ait pu faire des miracles n’est pas contesté, l’explication étant seule en débat. C.J. Berglund fait valoir que la lecture que propose Héracléon de la guérison du fils de l’officier royal en Jn 4,46-54 n’est pas valentinienne et se comprend très bien à partir de la méthodologie de critique littéraire gréco-romaine et du recours à des parallèles pauliniens et synoptiques. B. Corsini analyse l’homélie que Cyrille de Jérusalem consacre au paralytique de la piscine de Bethesda en Jn 5,1-18, homélie dans laquelle il compare le grabat que doit porter le paralytique à la litière de bois de Salomon, dont il est question en Ct 3,9-10 et qui est elle-même conçue comme préfiguration de la croix. A. Lappin étudie comment, dans la seconde moitié du ive siècle, les chrétiens ont purifié, le plus souvent de manière non 91violente, les lieux (notamment les temples) et les objets qui étaient associés à une présence démoniaque.
L’ensemble, à la fois ciblé et cohérent, rassemble une documentation précieuse tout en examinant des textes et des écrits représentatifs et s’avère aussi bien édité que conçu.
Christian Grappe
David Lincicum, Ruth Sheridan, Charles M. Stang, Law and Lawlessness in Early Judaism and Early Christianity, Tübingen, Mohr Siebeck, coll. « Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament » 420, 2019, x + 232 pages, ISBN 978-3-16-156708-7, 109 €.
Fruit d’un colloque qui s’est tenu en 2015 à Oxford, l’ouvrage, bien mis en perspective par les trois Éd., regroupe onze contributions sur le thème choisi. Précisons tout de suite que traduire lawlessness en français n’est pas évident et que nous rendrons ici le terme par « non-respect de la Loi ».
L. Doering traite d’abord de la Loi et du non-respect de la Loi à Qumrân et constate que, dans une communauté dont les membres sont convaincus qu’ils sont élus et prédestinés à l’être et que, en tant que tels, ils sont ceux qui se tournent vers la Loi de Moïse, le non-respect de la Loi sert essentiellement à stigmatiser l’autre sur les plans temporel (dans le passé, tous ceux qui se sont égarés et, dans le présent, tous ceux qui n’adhèrent pas à la communauté), social (ceux qui ont rejoint la communauté dans une démarche insincère ou qui l’ont reniée) et halachique (ceux qui ne rejoignent pas la communauté dans son interprétation de la Loi). G. Macaskill aborde le thème dans la littérature hénochique et se livre à une analyse successive des différents écrits qui constituent ce corpus (1 Hénoch, avec une étude à part des Paraboles, et 2 Hénoch). Il constate qu’ils partagent une appréciation positive de la Loi, mais dans le cadre d’une sotériologie qui accorde dans chaque cas la priorité à quelque chose d’autre. J. Garroway met en parallèle l’itinéraire de Paul et celui du rabbin allemand Samuel Holdheim (1806-1860), qui est à l’origine du judaïsme réformé radical aux États-Unis, et suggère qu’une telle juxtaposition permette de mieux comprendre Paul comme se situant à l’intérieur de judaïsme tout 92en remettant en cause la Loi et sa valeur permanente tant pour les païens que pour les juifs. P. Fredriksen montre comment Origène et Augustin, confrontés respectivement aux vues des marcionites et des manichéens, eux-mêmes influencés par Marcion, se rejoignent pour dépeindre un Paul respectueux de la Loi face à des adversaires qui la rejettent. D. Moffitt fait valoir que l’auteur d’Hébreux, en recourant aux notions de pureté, de perfection et en envisageant la possibilité de s’approcher de la présence divine, qui se concrétise à travers Jésus, est loin de rejeter la Loi et comprend en fait la perfection d’une manière qui recouvre très largement les préoccupations juives relatives à la pureté tout en les subvertissant. D. Lincicum propose une taxonomie des formes de critique de la Loi que l’on rencontre au sein du christianisme primitif (disputes halachiques relatives à l’interprétation de la Loi ; approches en termes d’histoire du salut ; critique de fond de la Torah elle-même ; approches herméneutiques) et situe celle que l’on rencontre dans l’Épître de Barnabé dans la dernière catégorie, l’épisode du veau d’or faisant office de tournant herméneutique. P. Bradshaw, en partant de la Didachè et en allant jusqu’au ve siècle, propose que les ordonnances ecclésiastiques les plus anciennes soient des lois ecclésiastiques et qu’elles prennent au fil du temps un aspect plus apologétique. S. Fraade étudie les manières dont les rabbins comprennent et interprètent le non-respect de la Loi par les païens en fonction de la possession par les juifs non seulement de la Loi, qui a été communiquée en hébreu, mais aussi et plus encore des lois orales véhiculées par la tradition rabbinique. M. Bar-Asher Siegal compare les traditions légales rabbiniques et les règles monastiques et fait valoir que dans les unes et les autres les références à l’Écriture jouent un rôle central et que, par ailleurs, on relève des préoccupations communes quant à des gestes quotidiens comme le port de la ceinture. Chr. Rowland étudie, à l’aune de textes postérieurs pour la plupart au xvie siècle, comment l’assujettissement à une loi externe se transmue en une internalisation de la loi sous l’effet de textes comme Ez 36,25-27 et Jr 31,33-34. Enfin, M. Peppard mène une réflexion à partir de l’arrêt du tribunal de Cologne qui, en 2012, a interdit la circoncision au motif que le droit d’un enfant à son intégrité physique prime sur le droit des parents, tout en enrichissant sa réflexion par des rapprochements avec les données de Galates et l’histoire allemande récente.
93L’ensemble propose des jalons plus qu’un continuum autour du thème retenu, mais, redisons-le, l’introduction des trois Éd. s’emploie à assembler le tout et à en montrer la cohérence.
Christian Grappe
Proche-Orient ancien
Spencer L. Allen, The Splintered Divine. A Study of Ištar, Baal, and Yahwe Divine Names and Divine Multiplicity in the Ancient Near East, Boston – Berlin – Munich, De Gruyter, coll. « Studies in Ancient Near Eastern Records » 5, 2015, xxi + 457 pages, ISBN 978-1-61451-293-6, 119,95 €.
Cette thèse de doctorat soutenue à l’Université de Pennsylvania a été dirigée par Jeffrey H. Tigay, Professeur émérite d’hébreu et de langues et littératures sémitiques, et par Grant Frame, Professeur associé émérite d’assyriologie et de langues et civilisations du Proche-Orient ancien. L’A. procède à un vaste survol d’une quantité importante de textes de genres variés et émanant de différents siècles, le spectre géographique s’étendant de la Mésopotamie à l’Anatolie, en passant par l’Italie moderne (sic), et de la Syrie du Nord à Israël/Juda, et pose à ces écrits une même question : qu’est-ce ou qui était un dieu ? Son enquête concernant l’unicité ou la multiplicité de divinités associées à un certain lieu géographique est motivée par la recherche d’éventuelles divinités yahwistes localisées.
Dès l’introduction est énoncée l’idée qui sera exprimée à plusieurs reprises dans l’ouvrage (p. 11, 309, 316), selon laquelle, malgré un manque de données et de preuves, les Assyriens et Phéniciens avaient probablement tenu le Yhwh de Samarie et le Yhwh de Teman pour des divinités distinctes. Le chapitre portant sur les inscriptions trouvées à Kuntillet Adjrud au Sinaï occupe en conséquence la plus grande partie du livre. Il s’appuie sur la lecture incertaine de « Samarie » dans un texte et, trois fois sur quatre, sur la lecture reconstruite de Teman (p. 411), ainsi que sur quelques expressions figurant dans la Bible hébraïque et provenant de différents contextes et siècles (dans les livres de Juges, de Samuel, d’Ésaie, de Joël et des Psaumes), voire de différentes idéologies et théologies qui associent Yhwh au Sinaï (une fois), à 94Sion ou à Hébron (une fois). L’A. traite ces textes sans aucun esprit critique, ne s’interroge pas sur la fonction qu’ils revêtaient dans leur contexte spécifique (c’est-à-dire sur le « comment » de leur signification), sa démarche étant exclusivement orientée, dans une perspective sémantique, vers la représentation (c’est-à-dire vers le « quoi » de la signification impliquée). À la fin du livre (p. 316, 318 sq.), il postule qu’un Israélite polythéiste aurait facilement pu considérer le Yhwh de Samarie et le Yhwh de Teman comme des divinités distinctes, tout en concédant qu’une telle affirmation ne trouve appui dans aucun texte biblique.
La soussignée ne craint pas de dire que l’objectif de l’enquête n’est pas atteint. Le livre est doté d’un nombre très réduit de notes de bas de pages (149 notes pour 319 pages de texte), d’une annexe, de listes d’abréviations, d’index et d’une bibliographie.
Régine Hunziker-Rodewald
Beate Pongratz-Leisten, Religion and Ideology in Assyria, Boston – Berlin, De Gruyter, coll. « Studies in Ancient Near Eastern Records » 6, 2015, xvii + 553 pages, ISBN 978-1-61451-482-4, 113,95 €.
L’A., Professeur d’études du Proche-Orient ancien au prestigieux Institute for the Study of the Ancient World (ISAW) de l’Université de New York, axe ses recherches sur l’histoire politique, intellectuelle et religieuse du Proche-Orient ancien, la culture matérielle, la formation de communautés textuelles, la transmission de la mémoire culturelle et la performativité des textes rituels. La présente monographie est consacrée aux rapports qu’entretiennent religion et idéologie, que l’A. considère inextricablement liées dans le contexte du monde ancien (p. vii). Le sujet principal est le développement de l’idéologie royale assyrienne telle qu’elle se dégage des textes, rituels et images remontant à la période s’étendant du IIIe au Ier millénaire avant J.-C. en interaction notamment avec les traditions babyloniennes, hourrites et hittites.
L’A. s’interroge en particulier sur le rôle (agentivity) des artisans-artistes, scribes et prêtres dans l’entourage du roi ; elle voit ces agents activement impliqués dans la construction de son « corps politique », tel qu’il a été présenté au monde et aux dieux (p. 448). 95Le roi et les érudits étaient à tout moment en conversation l’un avec les autres, puisqu’ils devaient se mettre d’accord sur le message idéologique qu’ils entendaient transmettre en fin de compte (p. 450). À partir de Sennachérib (fin viiie-début viie siècle) l’image du roi guerrier victorieux s’est doublée de celle du roi savant, habile et sage, ce qui a puissamment contribué à la formation du « corps politique » royal (p. 456) ; les savants l’ont placé dans la proximité des dieux (p. 457). Les érudits se révèlent ainsi les gardiens de la mémoire culturelle et les agents d’un réseau d’intertextualité et d’intermédialité qui relie la réalité historique de la société à son passé mythique (p. 467).
Le livre, divisé en 11 chapitres, contient des cartes, des tableaux, des dessins et des photos en noir et blanc d’assez bonne qualité. Il est complété par une annexe contenant deux textes assyriens transcrits (mais sans traduction), une bibliographie et une série d’index. Livre dense et fascinant, fruit de plus de dix ans de recherche, cet ouvrage se recommande par la richesse des informations inédites qu’il recèle.
Régine Hunziker-Rodewald
Ancien Testament
Carolyn J. Sharp (éd.), The Oxford Handbook of the Prophets, Oxford – New York, Oxford University Press, 2016, xxxv + 726 pages, ISBN 978-0-199859559, 139,60 €.
Cet important volume de la prestigieuse collection des Oxford Handbooks contient 37 contributions portant sur Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les Douze Petits Prophètes, rédigées par des spécialistes et destinées non seulement aux chercheurs, mais encore aux non-initiés. Il est divisé en trois parties qui visent, respectivement, à contextualiser les prophètes (I), à les interpréter (II) et à entrer en discussion avec eux (III).
Les articles de la première partie s’attachent à préciser la période durant laquelle des prophètes sont apparus et ont été actifs – dans le Proche-Orient ancien, la Diaspora et en Yehud à l’époque perse. Sont également abordées les relations que la prophétie entretient avec la prêtrise ou l’apocalyptique. Dans la deuxième partie, on 96trouve des contributions sur la structure, les thèmes et des questions controversées de chacun des livres (les Douze étant ici considérés comme formant un seul livre), ainsi que sur des sujets transversaux tels que l’utilisation de métaphores, la critique du genre, le prophète en tant que persona, Dieu et la violence chez les prophètes. Une attention particulière est accordée à l’histoire de la réception (à Qumrân, dans le Nouveau Testament, chez les rabbins, les premiers chrétiens et au Moyen Âge). Dans la troisième partie, des points de vue récents sont mis en avant : approches juives modernes, féministes, matérialistes, postcolonialistes et postmodernes. Particulièrement novateur est le chapitre 30, portant sur la « Queer Theory », qui expose les structures de pouvoir culturel et déstabilise les normes de genre. Le volume se clôt par deux contributions qui s’interrogent sur les perspectives futures en matière de méthodes, d’angles d’approche et d’interprétations, et plaide en faveur d’une lecture qui, dépassant la simple détermination du sens originaire des textes, prenne également en compte la situation contemporaine.
On regrette l’absence de référence aux approches fondées sur la théorie cognitive comme, par exemple, celle illustrée par J. Sørensen dans « Ideology, Prophecy and Prediction : Cognitive Mechanisms of the “Really Real” » (A. K. Petersen et al. [éd.], Evolution, Cognition, and the History of Religion : a New Synthesis, Brill, 2018, p. 334-347). Il n’en reste pas moins que ce volume est incontournable et qu’il profitera tant aux chercheurs et aux étudiants qu’à un public plus large.
Régine Hunziker-Rodewald
Rüdiger Lux, Ein Baum des Lebens. Studien zur Weisheit und Theologie im Alten Testament. Herausgegeben von Angelika Berlejung und Raik Heckl, Tübingen, Mohr Siebeck, coll. « Orientalische Religionen in der Antike » 23, 2017, viii + 377 pages, ISBN 978-3-16-155377-6, 129 €.
Ce volume, formellement très soigné, réunit 21 contributions de Rüdiger Lux, qui a été pasteur, aumônier, enseignant d’hébreu biblique et, à partir de 1995, Professeur d’Ancien Testament à l’Université de Leipzig. Il lui a été offert par ses collègues de l’Institut d’études de l’Ancien Testament de l’Université susdite 97à l’occasion de son 70e anniversaire, sous le mot d’ordre d’Odo Marquard (« grise est toute théorie, et vert l’arbre de vie – Grau ist jede Theorie und grün der Baum des Lebens »). Il recueille des articles, tous rédigés en allemand, qui, à l’origine, ont paru entre 1984 et 2015, dans lesquels l’A. s’attache à différents aspects de la sagesse et de la théologie dans l’Ancien Testament. On y trouve des études sur Job, Qohéleth, la Nouvelle de Joseph, 1 Samuel 1–3, ainsi que sur des thèmes comme l’art de vivre la vieillesse, le mythe dans l’Ancien Testament, la généalogie comme principe structurel, la promesse et la construction de l’histoire, la relation entre l’histoire de la religion d’Israël et sa théologie, l’image de Dieu et des dieux, la diaspora et, finalement, l’interprétation des écritures d’Esdras. L’ouvrage, qui contient une bibliographie de 30 pages, est rehaussé d’utiles index.
Régine Hunziker-Rodewald
Ernst Axel Knauf, Richter, Zürich, Theologischer Verlag, coll. « Zürcher Bibelkommentare AT » 7, 2016, 176 pages, ISBN 978-3-290-14756-3, 43 €.
L’A., Professeur associé émérite (depuis 2018) d’Ancien Testament et du monde biblique à la Faculté de Théologie de l’Université de Berne (Suisse), propose souvent, et à vrai dire même toujours, des interprétations astucieuses et novatrices. À l’instar de son commentaire sur le livre de Josué (Zürcher Bibelkommentare AT 6, 2008, 203 pages), cet ouvrage concis sur le livre des Juges est d’une qualité extraordinaire. Qu’on en juge : classification des textes du livre des Juges au sein du contexte pour lequel ils ont été rédigés, fondée sur des arguments historiques relatifs à la langue ; datations appuyées sur des caractéristiques linguistiques et phraséologiques, historico-culturelles et archéologiques ; démarcation par rapport à la théorie d’un ouvrage historique deutéronomiste (Dt – 2 R) ; sélection des sources (les Codices d’Alep, du Caire, de Léningrad, la Vulgate comme tradition parallèle du texte massorétique) ; traduction prudente et précise, qui veut ouvrir au texte source et ne pas l’obstruer en recourant aux traditions modernes de traduction ; interprétation qui témoigne de l’immense culture philologique, historique et socioculturelle de l’A. et de sa connaissance fine de la Bible hébraïque ainsi que de sa réception au sein du judaïsme 98antique (livres deutérocanoniques, Nouveau Testament, Philon d’Alexandrie, Flavius Josèphe) et rabbinique.
Ce commentaire est écrit de manière très dense et comprend de nombreuses références intra- et intertextuelles qui sont justifiées par le fait que le livre des Juges présuppose, dans sa forme finale, au moins la Torah (Gn – Dt) et les Nebiim (Jos – Ml). L’enchaînement des phrases suit un principe de cumul, supposant beaucoup d’informations implicites. Une lecture rapide et superficielle manquerait le but et l’intérêt de la présentation. Le volume est complété par des illustrations, des tableaux, des cartes, des liens sur internet (non datés), une bibliographie sélective d’ouvrages majoritairement récents et un fichier mis sur le site Academia de l’A. qui contient des détails philologiques et exégétiques ayant guidé l’interprétation sans pouvoir trouver leur place dans le volume. Il n’est malheureusement doté d’aucun index. Cet ouvrage constitue un commentaire ambitieux, stimulant et intéressant.
Régine Hunziker-Rodewald
Jean-Daniel Macchi, Le Livre d’Esther, Genève, Labor et Fides, coll. « Commentaire de l’Ancien Testament » xive, 2016, 588 pages, ISBN 978-2-8309-1598-3, 49 €.
Ce commentaire d’Esther prend également en compte les six additions (A-F) qui figurent dans les traductions grecques du livre. Son A., Professeur d’Ancien Testament à l’Université de Genève, les a ajoutées à la fin du volume et les a rapidement présentées et analysées. Devenues canoniques au sein du catholicisme et de l’orthodoxie, ces additions représentent une partie importante du Livre.
L’ouvrage, riche en explications, est le fruit de dix ans de recherche. Il contient une longue introduction de quelque 150 pages, le commentaire proprement dit s’étendant sur plus de 350 pages, à quoi s’ajoutent presque 30 pages sur les additions ; une bibliographie de plus de 30 pages clôt l’ensemble.
L’introduction renferme des informations détaillées sur les étapes rédactionnelles de l’œuvre, sur le contexte intellectuel de sa production, sur les caractéristiques littéraires et thématiques de la forme massorétique, du proto-Esther et des versions grecques, sur l’organisation spatiale et le système chronologique du livre d’Esther, et sur la canonisation et la réception de l’œuvre. La structure du 99commentaire suit le modèle classique d’une présentation scientifique qui avance chapitre par chapitre, péricope par péricope et ensuite verset par verset. Au début de chaque chapitre, un résumé des thèmes et enjeux établit un certain cadre de compréhension qui est suivi d’une traduction plutôt littérale du Codex Leningradensis et accompagné de notes textuelles très détaillées (incluant les variantes figurant dans les traditions grecques et latines). Suit le commentaire au sens strict, bien annoté et augmenté d’encadrés très utiles sur des sujets pertinents comme, par exemple, les banquets, le vin, les édits, les eunuques, la fiscalité, les vêtements et le pouvoir. Une section intitulée « processus rédactionnel » complète le commentaire de chacun des chapitres.
La grande compétence de l’A. et sa passion pour le livre d’Esther font du travail qu’il présente un ouvrage fort réussi.
Régine Hunziker-Rodewald
Judaïsme
A. Jordan Schmidt, Wisdom, Cosmos, and Cultus in the Book of Sirach, Boston – Berlin, De Gruyter, coll. « Deuterocanonical and Cognate Literature Studies » 42, 2019, xiii + 505 pages, ISBN 978-3-11-060110-7, 129,95 €.
Version légèrement révisée d’une thèse soutenue en 2017 à la Catholic University of America (Washington), l’ouvrage se concentre en fait, d’une part, sur la relation entre l’enseignement de Ben Sira relatif à l’ordre de l’univers créé, sa doctrine de la création, et la compréhension qui est la sienne de l’acquisition par les humains et de la dispensation par Dieu de la sagesse et, d’autre part, sur la manière dont il conçoit que les êtres humains constituent et maintiennent à la fois l’ordre de la création par leur conduite empreinte de sagesse.
Une introduction nourrie et fort bien informée, faisant une large place, tout comme le reste de l’ouvrage, aux travaux des auteurs francophones et surtout à ceux de M. Gilbert et de J.-S. Rey, situe la rédaction du livre, dont il fait remonter la rédaction finale aux années 185-175 avant notre ère, dans le contexte historique, politique et social de cette période et présente les importants problèmes de critique textuelle qui se posent à propos de l’œuvre ainsi que sa structure.
100L’ensemble se présente ensuite en deux parties.
Dans la première sont étudiées les instructions de Ben Sira relatives au cosmos, cela en trois volets. L’A. s’intéresse d’abord, à partir de Si 16,24–17,14, à la conception d’un cosmos bien ordonné au sein duquel la Torah joue tout son rôle dans la mesure où elle permet à ceux qui l’observent de contribuer à l’ordre cosmique en préservant et en promouvant l’ordre divinement institué du monde terrestre. Il étudie ensuite, à partir de Si 39,16-31, le rôle que Ben Sira assigne, en fonction de cet univers de représentation, aux bonnes œuvres. Il explore enfin, au miroir de Si 42,15–43,33, la merveilleuse beauté, expression de la gloire divine, que l’écrit associe au cosmos et dont il invite ses lecteurs à faire l’expérience dans leur propre vie pour être conduits à la louange et à la prière.
Dans la seconde partie, il traite du rôle des humains au sein du monde créé. Il présente, à l’appui de Si 1,1-10 et de Si 24,1-34, la façon dont Ben Sira conçoit la sagesse et sa présence dans le cosmos sur les deux plans spatial et temporel, son acquisition devant habiliter à comprendre l’ordre cosmique et à agir en fonction de lui pour le conforter. Il s’intéresse ensuite à la contribution humaine à l’ordre cosmique, à l’exemple des responsables de la cité (Si 9,17–10,5), des épouses (26,13-18, des médecins (38,1-8), des travailleurs manuels (38,24-34ab), des scribes (38,34c–39,11) et, enfin et surtout, du personnel cultuel et du grand prêtre, ce dernier jouant un rôle clé au centre du microcosme de l’univers qui se fait présent dans le sanctuaire pendant la célébration du rituel sacrificiel, ce qui confère au peuple juif le privilège d’accéder à une compréhension plus profonde de cet ordre créé (45,6-26 ; 50,1-24). L’ensemble, remarquablement construit et cohérent, impressionne et convainc à la fois.
Christian Grappe
Dale C. Allison, 4 Baruch. Paraleipomena Jeremiou, Berlin – Boston, De Gruyter, coll. « Commentaries on Early Jewish Literature », 2019, vii + 640 pages, ISBN 978-3-11-026973-4, 89,95 €.
Ayant déjà publié un commentaire du Testament d’Abraham dans la même série, l’A. nous en propose désormais un des Paralipomènes 101de Jérémie, écrit qui pose des problèmes pour le moins complexes. Il nous est parvenu sous deux formes, l’une longue, attestée par 24 manuscrits (grecs pour la plupart, mais aussi éthiopiens…) sans que les éditeurs successifs du texte aient toujours privilégié les mêmes parmi ces témoins – un projet de recherche mené à l’université de Würzburg devait apporter plus de lumière sur la question mais a été abandonné avant terme –, l’autre brève, qui est manifestement secondaire. Le texte commenté ici est un texte éclectique, l’A. ne proposant donc pas une nouvelle édition, ce qui eût représenté une tâche considérable, et se limitant à signaler les lieux variants les plus complexes à démêler, ceux qui présentent un enjeu quant au sens ou encore qui font apparaître des différences importantes entre témoins grecs et éthiopiens… Il assigne l’écrit au genre littéraire de la Bible réécrite tout en précisant que ce n’est vraiment le cas que pour les chapitres 1–4 et que l’auteur fait preuve de beaucoup d’imagination et ne suit jamais pas à pas le texte biblique. Il propose une structuration de l’œuvre en trois grandes parties, les deux premières (exil et lamentation ; retour et réjouissance) se répondant de façon contrastée autour d’une section centrale narrant le temps de l’exil et la façon dont il a pris fin. Il identifie les thèmes principaux suivants : la souveraineté divine ; l’espérance en Dieu ; la lamentation ; la prière ; le nouvel exode et le nouveau Moïse ; la séparation avec les païens. Il estime que l’œuvre, écrite dans un grec simple de la koinè, a été initialement rédigée dans cette langue et que les sémitismes qu’elle contient dérivent soit de la Septante, soit d’autres sources que l’auteur, dont il suppose qu’il devait être pour le moins bilingue (grec et hébreu), a utilisées. Il pose encore la question cruciale de l’origine juive ou chrétienne de l’œuvre et se rallie à l’opinion de Charles selon lequel on a affaire à un écrit fondamentalement juif qui a été refondu par un auteur chrétien, tout en se montrant encore plus enclin à majorer la composition juive puisqu’il parle finalement de la présence de touches chrétiennes ici et là (p. 34). Quant aux phénomènes d’intertextualité, ils lui apparaissent si nombreux qu’il faut supposer que l’auteur a recouru, outre au substrat biblique, à des nombreux récit et légendes préexistants. L’A. envisage encore les parallèles de l’œuvre avec des écrits comme 2 Baruch, l’Apocryphe de Jérémie ou encore Pesiqta Rabbati 26 et situe la rédaction du substrat juif de l’œuvre quelque part en Palestine avant la Deuxième guerre juive, la rédaction chrétienne, imputable à plusieurs mains successives, s’étalant ensuite dans le temps et transformant l’écrit 102de légende juive conçue pour des juifs en une légende chrétienne conçue pour des chrétiens.
Le commentaire à la fois précis, érudit et détaillé s’effectue chapitre par chapitre. L’ensemble est complété par des index fort utiles mais un peu trop aérés (près de 200 pages) qui achèvent de faire de ce commentaire un ouvrage de référence.
Christian Grappe
Nouveau Testament
Garrick V. Allen (éd.), The Future of New Testament Textual Scholarship. From H. C. Hoskier to the Editio Critica Maior and Beyond, Tübingen, Mohr Siebeck, coll. « Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament » 417, 2019, xi + 523 pages, ISBN 978-3-16-156662-2, 149 €.
L’ouvrage se propose d’envisager l’avenir de la critique textuelle du Nouveau Testament à partir du passé et du présent de cette discipline. Il traite de la manière dont les changements technologiques, idéologiques et politiques ont modifié le discours scientifique dans ce champ très technique, et cherche à savoir si les profondes évolutions technologiques (liées au recours à l’outil informatique) qui font désormais partie intégrante de la recherche en matière de critique textuelle ont des effets similaires. L’une des originalités du volume est de ne pas se cantonner à la critique textuelle elle-même mais de s’intéresser aussi aux manuscrits, à leur disposition, leur format, leur écriture… L’ensemble se déploie en trois grandes sections.
La première se consacre à l’histoire intellectuelle de l’approche scientifique en matière de critique textuelle et se concentre surtout sur la figure et les travaux de Herman Charles Elias Hoskier (1864-1938) dont il est question à de nombreuses reprises dans le reste du volume. G.V. Allen évoque l’infatigable chercheur dans son rapport avec la philologie de l’au-delà, cela dans la mesure où il s’est passionné pour la théosophie et a même écrit deux œuvres sous le pseudonyme de Signpost (panneau directionnel). Une bibliographie annotée d’écrits significatifs d’Hoskier complète cette contribution. J. Hernández Jr. étudie ensuite la contribution d’Hoskier à l’histoire du texte de l’Apocalypse, en prenant en compte sa théorie polyglotte et les regroupements de manuscrits 103qu’il a opérés, sujet que M. Karrer étudie d’une autre manière. J. Karns revient pour sa part sur le monde spirituel d’Hoskier et son rapport au spiritisme, influencé qu’il a été par Louis de Guldenstubbé. Quant à J. Wright Knust, elle se penche sur la collation du Codex Evangelium 604 par Hoskier et fait valoir que, si ses collations gardent leur valeur, ses excentricités, sa propension à transformer une théorie en fait et son intérêt pour le spiritisme déroutent. Enfin, P.J. Gurry revient sur l’élaboration du Greek New Testament de Wescott et Hort et montre combien il a marqué la recherche et a pu servir en quelque sorte de référence pour ceux qui ont suivi.
La deuxième partie établit un état des lieux et s’intéresse à l’avenir de l’approche scientifique en matière de critique textuelle. S.E. Porter revient sur le but et le propos de la critique textuelle, puis sur la notion même de lieu variant avant d’aborder la place accordée aux donnée para- et métatextuelles, tout cela en articulant état de la recherche et perspectives d’avenir. G.P. Fewster s’intéresse à la manière dont, au ive siècle, Eusèbe et Euthalius ont innové en développant des systèmes paratextuels de références croisées, qu’illustrent notamment les demeurés célèbres canons d’Eusèbe. Chr. Kreinecker traite plus particulièrement des papyri et de la manière dont la papyrologie contribue au développement des études néotestamentaires. J.W. Peterson s’intéresse, à l’exemple du Papyrus 46, sur l’intérêt qu’il peut y avoir à considérer les corrections apportées à un texte non pas isolément mais en réseau pour en tirer des indications sur le correcteur ou la communauté qui a corrigé le texte. D. Jongkind part en quête d’éléments rédactionnels dans le codex Vaticanus (B) et y voit un texte qui reflète la liberté d’expression d’un auteur ne cherchant pas l’uniformité et qui a été élaboré sans doute dans un cadre au sein duquel on possédait une expertise philologique à la fois en grec et en hébreu. H.A.G. Houghton s’emploie à montrer, à l’aide de ressources électroniques et de données digitales, l’importance du Codex Usserianus Secundus (r2) pour ce qui est du texte latin de Matthieu, alors que ce témoin est resté jusque-là négligé. C. Niccum revient, dans une perspective méthodologique, sur la façon dont Hoskier, en comparant le Papyrus 46 et la version éthiopienne, a exagéré leurs correspondances. Th.J. Kraus insiste sur la place qui doit être faite aux ostraca et aux talismans à côté des papyri et des manuscrits en tant que témoins majeurs en vue de l’étude du christianisme des premiers siècles. A.-T. Yi présente l’apparat critique du Nouveau Testament grec de Robert Estienne (1550) et l’usage 104qui y est fait du Codex Regius (L ou 019). T. Wasserman traite des méthodes permettant d’évaluer les relations textuelles entre les manuscrits, de Bengel à la CBGM (Coherence-Based Genealogical Method) et de la détermination de grandes familles de manuscrits à l’étude plus fine des relations entre manuscrits grâce à l’outil informatique. J.K. Elliott, prônant une critique textuelle éclectique, s’intéresse aux témoins de l’Apocalypse, moins nombreux que pour d’autres écrits du NT, d’où la nécessité de porter une attention plus grande aux manuscrits écrits en minuscules et à des variantes en leur sein. J. Unkel présente la collection, éclectique, des manuscrits écrits en diverses langues, rassemblés par Alfred Chester Beatty et les efforts qui sont effectués afin de les faire mieux connaître.
La troisième section traite de l’édition du NT à l’ère du numérique. D.C. Parker envisage l’avenir de l’édition critique en insistant sur le fait qu’il ne s’agira plus seulement d’éditer un texte mais aussi d’explorer l’histoire du texte en reconstituant une ou plusieurs formes de textes plus anciennes que d’autres, de comparer les états dans lesquels le texte a pu exister à différentes époques, de s’intéresser à l’intérêt de tel témoin original… C. Smith dresse un historique de l’édition électronique et présente les outils numériques à disposition pour éditer le NT ainsi que les problèmes qui se posent en matière de transcription, de collation et aussi de préservation et de durabilité des données recueillies. K. Wachtel présente la CBGM et son importance dans le cadre de l’élaboration de l’Editio Critica Maior (ECM) du NT grec. Enfin, A. Hüffmeier présente, à l’aide d’exemples concrets, les aspects méthodologiques et techniques de l’élaboration de l’apparat critique à l’ère de l’ECM.
Un ensemble très intéressant et complet qui, à partir de l’œuvre pionnière de Hoskier, donne un excellent aperçu de l’histoire et du développement d’une discipline en constant renouvellement.
Christian Grappe
Eyal Regev, The Temple in Early Christianity. Exploring the Sacred, Yale – New Haven – London, Yale University Press, coll. « The Anchor Yale Reference Library », 2019, xiii + 480 pages, ISBN 978-0-300-19788-4, $ 55.
L’ouvrage se propose de traiter du Temple, de sa signification, de sa fonction et de la manière dont il était considéré par les 105premiers chrétiens. Pour ce faire, l’A., qui enseigne à l’Université Bar Ilan à Ramat Gan en Israël, définit quatre critères pour classer les attitudes à l’endroit du Temple : participation (en se rendant au Temple) ; analogie (dès lors que l’on modèle des idées ou des rites en fonction du Temple et des sacrifices), critique, rejet. Dès l’introduction, il pose la thèse qu’il va développer tout au long de l’ouvrage : « il n’y a pas de raisons de présupposer qu’il y a une tension directe entre le premier christianisme et le Temple, et il n’y a aucun indice du fait que Jésus aurait hérité cette approche de son maître, le Baptiste » (p. 7).
Dans un premier temps, l’A. traite de la figure de Jésus à travers trois temps forts : l’expulsion des marchands du Temple, dans laquelle il discerne une affirmation par Jésus du fait que l’argent de personnes injustes corrompt ou souille le culte du Temple ; la Passion, au sein de laquelle il voit, dans le logion de Jésus annonçant la destruction de sanctuaire, l’élément déclencheur, dans la mesure où il aurait été compris comme une attaque politique contre le pouvoir romain ; le dernier repas, qui permettrait à Jésus non pas de remplacer le sacrifice mais de l’étendre à un nouveau domaine. Il aborde ensuite les lettres de Paul et fait valoir que Temple et sacrifice n’y revêtent pas leur signification originale, telle qu’on la trouve dans la Loi, mais servent à dépeindre une nouvelle symbolique. De fait, Paul utiliserait les caractéristiques générales et symboliques du système sacrificiel juif et les rapporterait à la communauté chrétienne, à Jésus et à lui-même pour leur conférer une valeur similaire, mais seulement dans un sens métaphorique. L’A en infère qu’il n’y a pas de contradiction fondamentale entre la foi de Paul en Christ et le culte au Temple. Il se demande ensuite où se situe Marc et arrive à la conclusion selon laquelle Marc souhaite que son lecteur conçoive Jésus en relation avec le Temple et le comprenne comme un personnage qui se situe au cœur même de la religiosité juive et a autorité en son centre que représente le sanctuaire. Quant à Matthieu, envisagé ensemble avec la source Q, il prioriserait à la fois le Temple et Jésus, Mt 12,3-7 étant un exemple du fait que le culte sacrificiel est pleinement reconnu, tout en affirmant, à travers Mt 12,42, que Dieu est présent en Jésus dans une plus large mesure encore que dans le sanctuaire. L’ensemble Luc-Actes présenterait quant à lui le Temple comme un marqueur de l’identité juive, un symbole du judaïsme, et Jésus, les apôtres et les chrétiens comme étant parfaitement respectueux du Temple et de son culte, non seulement pour protéger les chrétiens 106de toute suspicion de la part des autres juifs mais aussi parce que l’auteur à Théophile lui-même était attaché au judaïsme et voulait dire que le christianisme est non seulement fidèle à ses racines juives mais qu’il est le judaïsme. Le quatrième évangile utiliserait pour sa part le Temple comme un modèle explicatif pour comprendre Jésus en analogie avec le sanctuaire. Jésus n’y ferait donc pas figure de nouveau Temple mais serait conçu à la manière du Temple, sans d’ailleurs en assumer toutes les fonctions, et cela à une époque où le sanctuaire n’est plus qu’un symbole et un objet de mémoire, laissant le lecteur avec Jésus incarnant un mode vivant d’adoration et de rapprochement avec Dieu. Dans l’Apocalypse, le Temple céleste et son culte joueraient un rôle majeur en réponse à la perte du Temple terrestre, l’idée étant que, si les Romains ont détruit le Temple de Jérusalem, ils ne peuvent pas détruire son homologue céleste vers lequel juifs et païens sont appelés à se tourner. Enfin, Hébreux ferait valoir que le système sacerdotal continue d’avoir cours dans un format à la fois nouveau et meilleur dès lors qu’il sert de clé de compréhension du Christ et de la manière dont il sauve le monde. Hébreux estimerait ainsi que le christianisme est le successeur direct du culte sacrificiel et non pas celui qui vient l’abolir.
Un dernier chapitre, qui traite de la relation du mouvement chrétien naissant au judaïsme, se clôt par des propos d’une grande profondeur : « Leur manière de se situer par rapport au Temple fournit aux auteurs du NT et à leurs lecteurs l’occasion d’exprimer leur dette à l’endroit de la tradition juive, et en même temps leur différence avec elle. Plus encore, cette manière de se situer renforce leur sentiment de se sentir forts, authentiques et sacrés – c’est-à-dire proches de Dieu. Pour eux, le Temple est un moyen d’expérimenter le sacré de manière à la fois ancienne et nouvelle, quelque part sur le spectre compris entre ce qui sera appelé plus tard “judaïsme” et “christianisme” » (p. 313).
Même si l’on est loin, comme l’auteur de ces lignes, de suivre en tout l’A., il faut reconnaître l’importance de cet ouvrage, dû à un savant juif qui fait preuve d’une compréhension et d’une sympathie profondes envers le christianisme et qui engage un dialogue qui ne peut que contribuer à rapprocher les points de vue entre juifs et chrétiens et montre la voie pour cheminer dans cette direction : le profond respect de la tradition de l’autre et la volonté de la comprendre et de la faire aimer.
Christian Grappe
107Simon Butticaz, Le Nouveau Testament sans tabous, Genève, Labor et Fides, coll. « Essais bibliques » 53, 2019, xv + 188 pages, ISBN 978-2-8309-1683-6, 18 €.
La vocation de cet ouvrage de vulgarisation de haute voilée est expliquée par l’A. à partir de la citation suivante de Paul Ricœur : « À défaut de sens objectif, le texte ne dit plus rien ; sans appropriation existentielle, ce qu’il dit n’est plus une parole vivante. C’est la tâche d’une théorie de l’interprétation d’articuler dans un unique procès ces deux moments de la compréhension. » L’écriture du livre a donc été guidée par ce souci d’articulation et cela autour de questions d’une brûlante actualité sur lesquelles est proposée ici, dans une perspective herméneutique souvent conçue en tension, un éclairage à partir des textes néotestamentaires : Le monothéisme est-il intolérant ? Faut-il sauver Dieu de la tentation ? Pourquoi le NT ne condamne-t-il pas l’esclavage ? Paul, l’ennemi des femmes ? Le NT contre l’homosexualité ? Le tombeau était-il vide ? Quelle espérance pour Israël ?
Un excellent livre dont on espère qu’il rencontrera le succès qu’il mérite.
Christian Grappe
Arie W. Zwiep, Jairus’s Daughter and the Haemorrhaging Woman. Tradition and Interpretation of an Early Christian Miracle Story, Tübingen, Mohr Siebeck, coll. « Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament » 421, 2019, xxvi + 454 pages, ISBN 978-3-16-157560-0, 139 €.
Fruit d’un long compagnonnage de l’A. avec le passage étudié (Mc 5,21-43 ; Mt 9,18-26 ; Lc 8,40-56) et d’une attraction qu’il confesse pour les textes dans lesquels il est question d’une absence – ici celle d’une jeune fille morte –, l’ouvrage s’ouvre par un historique de la recherche et passe ainsi en revue les essais d’harmonisation, les interprétations allégoriques, les théories historico-critiques, les perspectives ouvertes par l’histoire des formes, la quête de sources, les approches littéraires et narratives, et enfin les approches contextuelles, féministes et psychanalytiques surtout.
Il procède ensuite de manière très méthodique pour avancer dans l’analyse successive et en parallèle du passage et des trois 108temps que l’on peut y distinguer dans chacun des trois évangiles synoptiques (interpellation de Jésus par Jaïrus et mise en route avec lui ; intervention de la femme hémorroïsse et guérison de cette dernière ; résurrection de la fille de Jaïrus). Sont d’abord envisagées les questions relatives au texte et à sa traduction, traitées à partir de notes lexicales, syntaxiques et sémantiques qui font apparaître la multitude des enjeux et des aspects à prendre en compte, cela dans la mesure où la traduction est elle-même un phénomène qui s’inscrit dans l’histoire de la réception du texte lui-même. Vient le tour de la structure et de la forme, mais aussi du contexte littéraire, un appendice fort utile proposant d’ailleurs un tableau des anciennes divisions des péricopes dans la tradition manuscrite grecque des évangiles synoptiques. On passe ensuite à l’histoire de la tradition et de la rédaction. Il apparaît à l’A. que Marc a utilisé deux récits autonomes ou peut-être déjà combinés au stade de la tradition et que Matthieu, en émondant le passage, et Luc, en le réarrangeant, se sont appuyés sur lui, même s’ils ont pu disposer chacun d’une forme différente de son œuvre. Mais l’analyse ne s’arrête pas là car l’A. poursuit dans la veine de l’oralité, en quête de marqueurs de cette dernière et les trouve surtout chez Marc. Il voit là un argument très fort en faveur de l’hypothèse déjà formulée précédemment. L’avant-dernier chapitre, intitulé « Histoire et récit », propose que Marc ait utilisé les deux récits enchâssés pour illustrer les pouvoirs que confère à Jésus l’advenue du Royaume et la façon appropriée de se situer par rapport à son message, que Matthieu les ait repris en les mettant au service de sa christologie en fonction d’Es 49,7 LXX et que Luc en ait fait des illustrations, dans le sillage de la prédication de Nazareth, de la proclamation du Royaume de Dieu par Jésus et par les disciples. Un dernier chapitre, conclusif, noue la gerbe, tandis que trois appendices viennent prolonger l’étude. Ils sont consacrés respectivement : à la critique textuelle et à l’histoire de la transmission du texte ; au texte et à l’intertexte, une attention toute particulière étant portée à l’évolution de l’annotation marginale du Nestle-Aland au fil des éditions ; à la réception et à la Wirkungsgeschichte du texte.
L’A. effectue ainsi un parcours exégétique très complet, qui illustre les vertus et les fruits que peut porter une approche qui conjugue les perspectives pour qu’elles se complètent mieux. On pourra parfois hésiter à le suivre sur les chemins de l’oralité qu’il retrace car on se meut là dans un champ très hypothétique, ce 109qu’il reconnaît tout en n’hésitant pas à se montrer assez affirmatif lorsqu’il s’agit de conclure. Il n’en demeure pas moins, et c’est très important, que l’enquête qu’il conduit est exemplaire et montre ce que peut être encore aujourd’hui une véritable travail d’exégèse conduit par quelqu’un qui en maîtrise à la fois les techniques et les méthodes.
Christian Grappe
Kylie Crabbe, Luke/Acts and the End of History, Berlin – Boston, De Gruyter, coll. « Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche » 238, 2019, xvii + 418 pages, ISBN 978-3-11-061455-8, 86,95 €.
Fruit d’une thèse rédigée sous la double direction de Christopher Rowland et de Markus Bockmuehl, l’ouvrage reprend un questionnement marqué par les travaux de Hans Conzelmann (Die Mitte der Zeit) et d’Oscar Cullmann (Christ et le temps et Le salut dans l’histoire) en s’appuyant sur un éventail de textes grecs et latins de la période gréco-romaine, tant juifs que païens : l’Histoire générale de Polybe ; l’Histoire universelle de Diodore de Sicile ; l’Énéide de Virgile ; les Faits et paroles mémorables de Valère Maxime ; les Histoires de Tacite ; 2 Maccabées ; le Règlement de la Guerre (1QM) retrouvé à Qumrân ; la Guerre juive de Flavius Josèphe ; 4 Esdras ; 2 Baruch. Elle justifie son choix de retenir ainsi des écrits de genres littéraires différents dans un chapitre argumenté dans lequel elle fait valoir que la présence de motifs communs dans des textes transcende précisément la question du genre littéraire. Elle se livre ensuite, dans quatre chapitres qui constituent le cœur de la thèse, à une étude comparée de motifs que l’on retrouve en Luc-Actes.
Ce sont tout d’abord le sens et la schématisation de l’histoire qui sont explorés, l’A. partant en quête de textes qui puissent faire écho d’une manière ou d’une autre à la périodisation et à la conception téléologique de l’histoire que l’on trouve dans l’œuvre double à Théophile. L’Énéide, 1QM, la Guerre juive, 4 Esdras, 2 Baruch, et, à un degré moindre, 2 Maccabées s’avèrent ici les plus éclairants. Ce sont ensuite le déterminisme et la conduite divine de l’histoire qui sont étudiés. Les parallèles que l’A. observe avec 1QM, 4 Esdras, 1102 Baruch, et même la Guerre juive, écrits qui tous conjoignent conduite divine et conception téléologique de l’histoire, l’amènent à affirmer que Luc considère que la volonté et la conduite divines englobent et concernent tous les temps jusqu’à la fin. Pour ce qui est de la responsabilité et de la liberté humaines, l’A. fait valoir que, si Luc-Actes suggère une forme de synergie entre action divine et action humaine, la plupart des personnages étant appelés tout au long du récit à prendre une décision urgente en relation avec la fin prochaine, d’autres apparaissent aussi qui entravent temporairement la volonté et l’action divines mais sont finalement mis hors d’état de nuire (c’est le schéma de l’échec paradoxal mis en évidence par Jean Zumstein, que l’A. ne connaît pas). Sont enfin pris en considération le présent et la fin de l’histoire, l’A. aboutissant au constat selon lequel, en Luc-Actes, la vie est vécue par des personnages conscients que le temps présent s’inscrit dans la période finale de l’histoire et confiants dans le fait que les événements de la fin des temps qui restent à venir sont déjà en cours.
Malgré les fréquentes affirmations de l’A. selon lesquelles elle parviendrait à des résultats nouveaux, le présent recenseur n’a pas été si convaincu que cela de leur originalité et de l’apport de l’ouvrage à la recherche, même si l’analyse est conduite de manière méthodique et fine. Il reste au final, mais on s’en doutait dès le départ, que la proximité de Luc-Actes est plus grande avec les écrits qui ont un horizon eschatologique ou une dimension apocalyptique.
Ce que pourra regretter aussi le lecteur, c’est que la bibliographie n’inclue quasiment pas de titre en une langue autre que l’anglais, dans laquelle heureusement un certain nombre d’ouvrages en allemand et en français ont été traduits.
Christian Grappe
Eduard Käfer, Die Rezeption der Sinaitradition im Evangelium nach Johannes, Tübingen, Mohr Siebeck, coll. « Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe » 502, 2019, xiv + 479 pages, ISBN 978-3-16-156240-2, 104 €.
Fruit d’une thèse préparée sous la direction de Florian Wilk à l’Université de Göttingen, l’ouvrage s’ouvre par des considérations d’ordre méthodologique sur l’intertextualité, qui lui permettent de 111préciser que cette dernière va se concentrer sur la signification et la fonction communicative de la référence intertextuelle dans un texte. Le modèle d’analyse suivi, celui de Stocker, consiste, pour chaque passage du quatrième évangile pris en compte, à étudier la relation établie entre auteur, texte et lecteur et à procéder selon trois étapes successives fondamentales : analyse du phénomène de désintégration par lequel le lecteur, alerté par un marqueur donné qui fait fonction d’interférence co-textuelle, est en quelque sorte distrait (abgelenkt) de son axe de lecture linéaire ; prise en compte de la phase de digression au cours de laquelle, dévié (umgelenkt) de sa lecture linéaire, il va partir en quête de l’hypotexte, guidé qu’il est en cela par des phénomènes d’échos et de correspondances qui font l’objet d’une étude spécifique dans chacun des cas ; analyse de la phase de réintégration à l’occasion de laquelle le lecteur tient compte de l’hypotexte ou des hypotextes qu’il a identifiés pour poursuivre sa lecture linéaire du texte en le réinterprétant en conséquence. Il convient d’ajouter à cela que la tradition du Sinaï qu’envisage l’A. ne se limite nullement à la Bible hébraïque et à la Septante, mais aussi aux targumim et à d’autres interprétations juives anciennes.
Dans le corps de l’ouvrage, quatre passages sont étudiés dans le cadre précédemment décrit. Il s’agit d’abord de Jn 1,14-18 en lequel l’A. discerne une allusion évidente à la tradition du Sinaï, avec un marqueur intertextuel explicite, quoique non littéral, renvoyant au don de la loi (v. 17a) et d’autres motifs collatéraux qui peuvent y être rattachés : la tente (v. 14) ; la vision de la gloire (v. 14) ; l’impossibilité de voir Dieu (v. 18) ; l’expression « plein de grâce et de vérité » (v. 14) dont l’A. affirme peut-être un peu vite qu’il s’agit d’une citation littérale. Il en résulte, selon l’A., que ce n’est pas la Loi ou son interprétation qui mène à la connaissance et à la relation à Dieu octroyant la vie éternelle mais celui par lequel grâce et vérité sont advenues dans la mesure où les lecteurs croient en lui. Il s’agit ensuite de Jn 5,37-38 (« vous n’avez ni écouté sa voix, ni vu son aspect, et vous n’avez pas sa parole demeurant en vous »), dans lequel elle discerne un résumé concis du récit de la théophanie au Sinaï, sans correspondance littérale, mais qui serait détectable en raison de la présence de trois motifs (écouter la voix ; voir son aspect ; sa parole). Il en résulterait que la révélation au Sinaï et la Torah avec elle se situent dans un continuum avec la révélation de Dieu en le Christ et que la fête à l’arrière-plan de laquelle 112se déploie Jn 5 serait celle des Semaines. On notera ici que, dans son commentaire du quatrième évangile, qui est ignoré par l’A., X. Léon-Dufour plaide aussi dans le sens d’une compréhension de Jn 5,37-38 à partir de Dt 5,24, passage dont on peut s’étonner qu’il ne soit pas évoqué. On passe ensuite à Jn 6,31-32.45-46, étudié en deux temps, à partir d’abord de l’épisode de la manne et des échos qu’il trouve en 6,31-32 et ensuite de la révélation finale relative à Dieu (6,45-46) que celui qui vient du ciel de la part de Dieu apporte, ce que n’avaient pu faire ni Moïse ni la Torah, incapables qu’ils étaient de conférer comme lui la vie éternelle. Vient enfin le tour de Jn 10,34-36 qui, pour l’A., montre que la Loi sinaïtique est pour l’auteur du quatrième évangile parole de Dieu, qui fait de ceux qui la reçoivent des dieux et constitue un jalon sur une trajectoire qui conduit à la révélation de Dieu en Jésus qui en représente le climax.
L’A. conclut de manière très logique que nulle part dans le quatrième évangile on ne trouve de polémique contre la révélation au Sinaï comme lieu central de l’histoire du salut ou encore une discontinuité radicale entre révélation au Sinaï et en Christ et que la révélation sinaïtique est, au contraire, valorisée car elle rend témoignage au Fils.
L’ouvrage, complété par les index habituels dans la collection qui l’accueille, est à la fois intéressant et solide.
Christian Grappe
R. Alan Culpepper, Jörg Frey (éd.), Expressions of the Johannine Kerygma in John 2:23–5,18. Historical, Literary, and Theological Readings from the Colloquium Ioanneum 2017 in Jerusalem, Tübingen, Mohr Siebeck, coll. « Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament » 423, 2019, xviii + 324 pages, ISBN 978-3-16-157636-2, 129 €.
L’ouvrage est issu d’un troisième colloque johannique qui a eu lieu en 2017 à Jérusalem et qui a rassemblé du beau monde puisque la plupart des auteurs des commentaires majeurs du quatrième évangile parus ces vingt dernières années étaient au rendez-vous. Les contributions, au nombre de treize et qui sont publiées en anglais sauf deux qui le sont en allemand, se suivent logiquement en fonction de l’ordre des passages étudiés dans le quatrième évangile et, 113si l’on va jusqu’en 5,18, c’est que le colloque se tenait à Jérusalem et que le récit de 5,1-18 a pour cadre la ville.
J. Zumstein s’interroge sur la stratégie de révélation en Jn 3 et 4 et montre que les deux chapitres recourent à un même modèle rhétorique qui se déploie en deux temps : un moment dialogal où le Jésus johannique se révèle de manière indirecte (à travers le motif de la nouvelle naissance ou de l’eau vive) en traitant de questions anthropologiques ou sotériologiques ; une phase de révélation directe contribuant à dévoiler son identité. Cette gradation suggère selon lui une stratégie cognitive qui vise à faire passer d’une connaissance élémentaire à une connaissance authentique tout en éclairant la condition humaine (autour de la question du salut) plus encore que l’identité de Jésus. Par ailleurs, un langage de changement est présent dans les deux passages qui ont encore commun de mettre en œuvre le motif de la reconnaissance et de reconfigurer la figure de Dieu.
Chr. Karakolis propose ensuite une lecture centrée sur le lecteur de l’histoire inachevée de Nicodème, ce dernier faisant office de personnage représentatif des pharisiens dont il est espéré que, comme lui, ils jettent des ponts entre judaïsme et christianisme. J. van der Watt s’intéresse, à partir de Jn 3,3.5, au Roi et au Royaume en Jean et propose que ces deux versets soient programmatiques au sein du macro-récit et soulignent la présence du Royaume en la personne et en les œuvres de Jésus dès le début du macro-récit. Conjointement à celle du Fils qui se déploie par ailleurs, l’imagerie du Royaume suggèrerait que ce qui est en jeu, c’est la constitution de la famille du Roi, non pas sous le mode d’une relation souverain – peuple mais d’une relation Père roi – enfants érigés eux-mêmes à la dignité royale. W. Loader examine le lien exaltation/glorification/ascension à partir de Jn 3,13-15, en fonction du contexte proche et dans le cadre général du macro-récit. Il le fait à la lumière du motif de l’heure qui pointe vers le grand événement à venir, la mort de Jésus qui inclut précisément ces trois moments. R. Zimmermann s’interroge sur la façon dont s’articulent œuvres et éthique en Jn 3,19-21 et propose que « faire la vérité » ne se limite pas à croire en le Christ mais consiste aussi, et peut-être plus encore, à suivre ses actes et ainsi à œuvrer comme lui en Dieu. J. Frey propose des réflexions historiques et théologiques sur Jn 3,22-30 et la présentation qui y est faite de Jésus et de Jean en tant que baptiseurs, et relève fort opportunément que Jean place l’accent bien davantage sur le don de l’Esprit qui s’effectue à partir de l’événement de la Croix que sur 114l’eau, sans que cela ne signifie pour autant qu’il y ait dénigrement du baptême. C. Williams étudie, en fonction de l’espérance samaritaine et des promesses scripturaires, le dialogue avec les Samaritains et ses enjeux en Jn 4 et arrive à la conclusion selon laquelle Es 45,18-25 est le passage qui éclaire le mieux la façon dont le quatrième évangile conçoit que l’offre du salut se déploie au-delà des frontières traditionnelles jusqu’aux extrémités de la Terre. U. Schnelle aborde à son tour Jn 4, dans la tension entre tradition enracinée localement et programme universel, et y voit, dans la ligne de la contribution précédente, l’émergence d’un nouveau système de pensée et de valeurs au sein du mouvement chrétien naissant. M. Theobald considère que 2 R 17,24-41 constitue l’hypotexte de Jn 4,4-26 et plaide en faveur d’une compréhension allégorique des cinq maris de la Samaritaine. Il comprend dès lors ce passage comme reflétant la religion présente et tenue pour illégitime des Samaritains plutôt que comme une description de la situation immorale dans laquelle se trouverait présentement la femme. A. Reinhartz se penche sur Jn 4,19-23 et surtout sur le verset 22 et estime que l’affirmation du Jésus johannique selon laquelle le salut vient des juifs ne saurait exonérer le quatrième évangile d’antisémitisme dès lors que son auteur est convaincu que l’on n’accède au salut qu’en Christ et que les juifs s’en trouvent donc exclus. R.A. Culpepper considère Jn 4,35-38 dans le contexte de la théologie missionnaire du quatrième évangile et pense que Jésus doit en fait jouer le rôle du semeur dont le labeur va permettre la moisson future. Quant à la référence aux autres, elle aurait pour fonction de rappeler à la communauté qu’elle a été introduite dans la longue histoire de l’œuvre de Dieu dans le monde. Avec D.F. Tolmie, on quitte la Samaritaine et on aborde la caractérisation de l’officier royal en Jn 4,46-54. Il propose ultimement de lire le passage autour de la tension vie/mort et observe que, pour finir, ce n’est pas seulement le fils de l’officier royal qui revient à la vie mais toute sa maisonnée, incluant donc le fils, qui accède au croire et ainsi à la vie au sens plénier du terme. Enfin, C. Koester propose de jeter un éclairage sur Jn 5,1-18 à partir des données archéologiques relatives à la piscine de Bethesda, des pratiques juives et gréco-romaines et du récit johannique, et conclut que ce qui est le plus sûr, c’est que le quatrième évangile met en scène la manière dont, à travers Jésus, la réponse divine est accordée à ceux qui sont en quête de guérison et qui trouvent en lui non seulement la guérison physique de leurs maux mais l’accès à la vie.
115Un ensemble à la fois divers et varié et dont la cohérence apparaît tout naturellement dès lors qu’est étudiée une section relativement brève du quatrième évangile qui trouve là des éclairages tout à fait intéressants et stimulants.
Christian Grappe
Bruce D. Chilton, Resurrection Logic. How Jesus’ First Followers Believed God Raised Him from the Dead, Waco, Baylor University Press, 2019, xiii + 305 pages, ISBN 978-1-4813-1063-5, 164 €.
L’A. aime sortir des sentiers battus et proposer de nouvelles perspectives sur des questions essentielles et lourdes d’enjeux existentiels. Il se propose ici d’explorer la logique de la résurrection en se centrant sur la manière dont Jésus a pu être vu en tant que ressuscité par les premiers témoins de sa résurrection telle qu’en est dressée la liste en 1 Co 15,5-7. Cela étant, il ne s’intéresse pas à la nature même de la résurrection, à la façon dont elle s’est ou se serait produite, mais aux diverses manières dont, au miroir des textes, on peut envisager que les disciples ont été amenés à croire que Jésus était ressuscité. Il fait valoir ainsi d’emblée que la variété des manières dont les disciples envisagent la résurrection suscite la question non pas de ce que (what) mais de comment (how) les disciples ont été amenés à croire (p. 3). Et c’est ce comment, qui se décline en fait de différentes manières, que l’on retrouve dans le sous-titre de l’ouvrage alors que le titre lui-même évoque une logique, et non pas des logiques, de la résurrection car ce qui est finalement en jeu, pour l’A., c’est ce qui a amené les disciples à confesser que Jésus était ressuscité. Pour autant, il ne se livre nullement à une étude qui ferait abstraction de l’histoire et du terreau qui a vu naître la foi des premiers chrétiens et fait commencer cette enquête par une première partie dans laquelle il traite des conceptions de la vie après la mort que l’on rencontre dans le monde antique, que ce soit à Sumer, autour de Gilgamesh et Utnapishtim, en Égypte, autour d’Isis et d’Osiris, en Grèce, autour de Sémélé et de Dionysos, en Syrie, autour d’Ishtar et de Tammuz. Il aborde ensuite le tournant que représente ce qu’il appelle la révolution de l’espérance d’Israël, une révolution très lente à s’opérer dès lors que les textes de la période du premier Temple manifestent une réticence à dénier à la mort sa victoire et 116que ceux du second Temple laissent certes percevoir une montée en puissance de l’eschatologie mais pas encore une affirmation claire d’une espérance post mortem, sauf en 1 Hénoch. Cette dernière va surgir en fait avec la révolte maccabéenne, mais elle ne sera plus telle que l’immortalité soit conçue sans solution de continuité avec la vie quotidienne. De fait sera envisagée une résurrection en rupture avec le cours de la vie présente, cela à partir de l’expérience des martyrs promis à être victorieux en étant justifiés par Dieu. Cette résurrection – et le terme prend ici une acception très large qui recouvre au moins partiellement, nous semble-t-il, la notion d’immortalité – peut revêtir plusieurs modalités (esprits ressuscités, résurrection astrale, résurrection sous forme angélique, résurrection de la chair, résurrection de l’âme immortelle). Il n’en demeure pas moins que ces représentations diverses – l’A. parle de sciences – de la résurrection ont en commun, selon lui, de supposer un Jugement final à l’occasion duquel la justice de Dieu et d’Israël l’emportent dans le cadre d’un scénario cosmologique permettant à Dieu d’accueillir les siens dans un sens large. Ce que l’A. fait valoir ensuite, c’est que, dans la logique de telles espérances, celles qui se font jour dans le Nouveau Testament sont fédérées en quelque sorte par la conviction selon laquelle Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts, si bien que l’on passe du domaine d’une espérance générique en quelque sorte à une espérance déterminée par le fait qu’un précédent a déjà eu lieu. Dès lors, l’attente n’est plus conçue en fonction de ce qui doit arriver mais en fonction de ce que Dieu a fait dans le cas de Jésus. Ainsi, la résurrection devient l’affirmation d’une réalité présente : Jésus vit après la mort et s’implique activement dans la transformation de l’humanité en tant que telle dans un état de résurrection. Ainsi, chaque témoin de la résurrection de Jésus fait l’expérience d’une rencontre décisive qui modifie le cours de sa propre existence, mais il n’en a pas forcément la même perception que d’autres. C’est là que, pour l’A., la liste des témoins de la résurrection de Jésus produite par Paul en 1 Co 15,5-7 s’avère déterminante. Que Jésus ait été vu par Céphas et par les Douze renvoie, pour l’A., à partir des finales respectives de Matthieu et de Jean, à une expérience telle que tout ce que Jésus a enseigné, ainsi que ce que l’Esprit continue d’attester, représente la présence vivante qu’il s’agit de proclamer. Qu’il ait été vu par 500 frères à la fois renvoie, pour l’A., à la lumière surtout du début des Actes, à l’expérience d’une rencontre qui n’est pas limitée à un cercle fermé mais résolument ouvert, expérience déterminée 117par la réception de l’Esprit à l’occasion du baptême. Qu’il ait été vu par Jacques renverrait à la conviction selon laquelle la présence de nature angélique de Jésus requiert l’accomplissement de la pureté. Qu’il ait été vu par tous les apôtres renverrait tant aux expériences à caractère visionnaire de Marie-Madeleine qu’à la perception de Jésus ressuscité en tant que Fils de l’Homme appelé à juger la terre ou bien encore à la compréhension de Jésus en tant que personnage venu accomplir les Écritures ou en tant que figure dont la mort et la résurrection génèrent un ébranlement cosmique promis à se poursuivre jusqu’au Jugement dernier (Mt 27,51-53). Quant à Paul lui-même, son témoignage en 1 Co 15 attesterait qu’il perçoit le Ressuscité comme corps spirituel alors que Lc 24,39 montre que d’autres ont été convaincus de la réalité charnelle de la résurrection. Mais ce qui fait, pour l’A., l’unité de ces perceptions pourtant très différentes en soi, c’est que chacun des témoins développe un récit qui fait état d’un impératif donné par le Ressuscité, impératif en rupture avec les pratiques et les conduites du passé et qui génère une nouvelle représentation du monde selon laquelle c’est à partir du Ressuscité que Dieu refaçonne le monde et que cela a des conséquences fondamentales sur les plans ontologique et sociologique tout à la fois. L’A. fait valoir dès lors que le véritable enjeu, aujourd’hui comme hier, est de percevoir Jésus en tant que réalité vivante et requérante, en ce sens que, ressuscité, il nous appelle à une perception, à une vie, à un engagement nouveaux.
Un livre original, brillant et important qui offre une synthèse fort stimulante par-delà la diversité des textes et qui atteste la profondeur et la hauteur de vue d’un auteur qui est la fois un éminent bibliste et un vrai théologien.
Christian Grappe
Martin Hengel, Anna Maria Schwemer, Die Urgemeinde und das Judenchristentum, Tübingen, Mohr Siebeck, coll. « Geschichte des frühen Christentums » 2, 2019, xxiv + 790 pages, ISBN 978-3-16-149474-1, 134 €.
Invitée à œuvrer en ce sens par Martin Hengel quelques mois avant sa mort en 2009, A.M. Schwemer est désormais parvenue au terme de la tâche consistant à écrire une histoire de la communauté 118primitive et du judéo-christianisme des débuts, la période couverte allant pour l’essentiel jusqu’aux années 48-49 de notre ère, exception faite pour le judéo-christianisme dont la trace est suivie jusqu’à la séparation entre judéo-christianisme palestinien et judaïsme. Elle a pu s’appuyer pour ce faire sur des travaux du maître dont elle prolonge ainsi l’œuvre qui se caractérise par l’extraordinaire ampleur que l’on sait.
L’ouvrage se divise en quatre grandes parties.
La première, consacrée à la communauté primitive, s’emploie à reconstruire les origines même du mouvement chrétien. Est abordée la naissance de l’Église primitive de Jérusalem au prisme de la présentation idéale, mais tenue néanmoins pour globalement fiable, même s’il faut prendre en compte la tendance à harmoniser de l’auteur à Théophile, qui en est proposée en Actes 1–12, mais aussi des traditions anciennes dont Paul fait usage surtout en Romains et dont il est défendu ici qu’elles remonteraient aux années 30, l’existence d’une tradition indépendante galiléenne, que préserverait la source Q, étant, quant à elle, écartée. L’impulsion donnée par les apparitions du Ressuscité qui ont généré elles-mêmes le retour des disciples à Jérusalem, l’événement de la Pentecôte, dont l’authenticité substantielle est admise, l’expérience de l’Esprit, la constitution d’une première communauté de salut à connotation eschatologique et l’instauration du baptême au nom de Jésus sont posées avant que ne soit étudiée cette assemblée elle-même dont la communauté des biens est admise et est expliquée notamment en fonction d’une attente eschatologique imminente et d’un souci d’anticiper de quelque manière la plénitude du Royaume. Les charismes et les fonctions en son sein sont passés en revue avant que ne soit abordé le premier culte chrétien dont l’originalité par rapport à son homologue juif est conçue en fonction du repas communautaire célébré en tant que repas du Seigneur et de l’émergence d’un service de la Parole. Quant au contenu de l’enseignement chrétien, il est présenté autour de trois pôles : l’élaboration en un temps court d’une christologie et d’une sotériologie comprises en termes kérygmatiques ; l’attente prochaine du retour du Christ ; la poursuite de la proclamation de Jésus, l’ensemble de ces points déterminant l’ethos communautaire.
La deuxième partie est consacrée à l’accroissement de la communauté et aux commencements de la mission aux païens. Il est question ici : des hellénistes, de leur mission active et de leur 119persécution sélective ; de la mission de Philippe en Samarie et de sa rencontre avec l’eunuque éthiopien conçue comme exemplaire d’une mission qui se déploie aux marges des communautés synagogales juives et prépare la voie à la mission aux païens ; des débuts de Paul, de ses origines à Tarse à sa conversion, envisagée surtout au miroir d’Ac 26,1-23 ; de son séjour à Damas, de sa mission en Arabie et de sa visite à Pierre à Jérusalem, interprétée comme une visite écourtée en raison de la menace exercée sur lui par ses anciens amis. Au passage, une chronologie est insérée telle que l’avait déjà proposée M. Hengel dans une de ses publications.
La troisième partie traite du conflit (Kampf dans le titre, selon la volonté expresse de M. Hengel) autour de la mission aux païens. La séquence des Actes est suivie alors même qu’Ac 11,19-20 laisse clairement transparaître une antériorité de l’annonce aux païens par les hellénistes une fois ces derniers parvenus à Antioche. C’est ainsi que la conversion de Corneille par Pierre est étudiée en premier lieu, l’A. reconnaissant cependant que la présentation lucanienne vise à conférer à Pierre l’initiative de la mission aux païens pour mieux la légitimer. Il est question ensuite des hellénistes et de Paul et Barnabas en Syrie, un développement fort intéressant étant consacré à l’éclairage que peut apporter l’interprétation juive ancienne de la promesse d’une terre à Abraham sur la première mission chrétienne. La nouvelle situation des chrétiens à Antioche est abordée ensuite. Puis sont évoquées la persécution à Jérusalem et la libération de prison de Pierre sans que ne soit à aucun moment pris en compte le genre littéraire des récits de libération merveilleuse de prison dans lequel a pourtant été coulée ici la narration lucanienn. La priorité accordée à l’enquête historique occulte ainsi, de notre point de vue, la part revenant à la rédaction lucanienne, ce qui vient précisément fragiliser les conclusions que l’on peut tirer sur le plan historique des données du récit tel qu’il nous est parvenu. [Peut-être pourrais-tu faire 2 phrases ?]On aborde ensuite le premier voyage missionnaire de Barnabas et Paul puis le concile apostolique, l’incident d’Antioche et le décret apostolique interprété de manière très classique comme devant permettre aux judéo-chrétiens de partager leur table avec les pagano-chrétiens tout en préservant leur identité juive et sans encourir le risque d’être expulsés de la Synagogue.
La quatrième partie en vient enfin au judéo-christianisme palestinien. Ici, on abandonne pour la première fois la séquence des Actes pour passer à des présentations successives de différents 120sujets : la situation de la communauté palestinienne ; la figure de Jacques, frère du Seigneur, dans le Nouveau Testament et dans l’épître qui lui est attribuée et dont l’A. est encline à lui reconnaître la paternité ; Jacques le Juste tel qu’il apparaît dans les sources non canoniques ; son martyre ; la migration de la communauté de Jérusalem à Pella, dont la réalité est là aussi acceptée ; Siméon, fils de Clopas et successeur de Jacques ; l’expulsion des judéo-chrétiens palestiniens du judaïsme, que l’A. situe avec son maître dès la fin du premier siècle.
L’ouvrage est complété par près de 60 pages de bibliographie et par des index extrêmement bien faits concernant tant les textes anciens, les auteurs modernes, les thèmes étudiés (54 pages !). Très classique, on l’aura compris, et défendant des thèses finalement traditionnelles – on pourra comparer aux résultats qu’atteint Backhaus (voir ci-après) –, il n’en déploie pas moins une impressionnante érudition et constitue dès lors une mine et un livre de référence. Il faut savoir gré à l’A. pour le tour de force qu’elle a réalisé et pour l’hommage qu’elle rend ainsi à M. Hengel et à son œuvre considérable.
Christian Grappe
Knut Backhaus, Die Entgrenzung des Heils. Gesammelte Studien zur Apostelgeschichte, Tübingen, Mohr Siebeck, coll. « Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament » 422, 2019, viii + 496 pages, ISBN 978-3-16-154687-7, 154 €.
Après avoir publié en 2009 à la fois un commentaire et un recueil d’études sur le sermon aux Hébreux, l’A. se tourne résolument désormais vers l’étude des Actes, selon une trajectoire déjà amorcée auparavant comme l’atteste le fait que les 19 contributions ont été rédigées entre 1998 et 2018, même si la plupart sont postérieures à 2012.
La première de ces études, qui fait office d’introduction, est aussi la seule qui soit inédite. L’A. y présente les Actes comme un récit, rédigé de main de maître, qui vise à faire apparaître le mouvement chrétien comme transcendant et abrogeant toutes les frontières géographiques, culturelles, ethniques, chronologiques et théologiques. Il fait valoir que cette capacité à briser les frontières 121s’enracine dans le choix qui y est fait de représenter le salut en tant que relation au Ressuscité et au Seigneur de tous (Ac 10,36).
On trouve ensuite deux études qui ont trait à l’histoire de la recherche, l’une situant les Actes au sein de la littérature gréco-romaine et à l’entrecroisement de l’histoire ancienne, de la philologie classique et de l’exégèse néotestamentaire, l’autre les présentant au miroir de la recherche actuelle, une attention toute particulière étant accordée au commentaire de R. Pervo qualifié de majeur. Le débat contemporain relatif à la datation des Actes est aussi abordé, l’opinion traditionnelle (rédaction dans les années 80-90) étant de plus en plus battue en brèche par des tenants soit d’une datation plus ancienne soit d’une datation nettement plus récente, l’A optant quant à lui pour une composition relativement tardive (entre 100 et 130).
Les trois contributions suivantes s’intéressent à la reconstruction lucanienne de l’histoire. L’historiographie gréco-romaine est étudiée d’abord dans son recours à l’hybridation littéraire entre reconstruction des circonstances extratextuelles et facteurs d’ordonnancement régis par la construction rhétorique, la mimétique narrative et l’organisation de l’ensemble. Luc est décrit ensuite comme un peintre qui recourt à l’historiographie apologétique et plus particulièrement à la peinture commémorative pour décrire ce qui va devenir le christianisme dans la profondeur apparemment objective de sa première période, et cela à des fins diverses : le doter d’une origine biblique et d’un récit de fondation ; faire apparaître ce qui le rend attractif ; le situer dans une histoire à la fois présente et à venir. La troisième contribution vient situer plus précisément la manière d’écrire l’histoire lucanienne dans le cadre du discours de vérité antique, l’objectif étant de proposer une reconstruction théologique en vue de façonner une mémoire chrétienne spécifique ayant trait à la fois à l’origine et à une autodéfinition reliée à un passé.
Sont abordés ensuite différents thèmes ou passages : le recours récurrent à l’humour dans la deuxième partie des Actes ; le récit des pèlerins d’Emmaüs conçu comme programme christologique des Actes ; la mise en œuvre de l’argument de l’ancienneté du judaïsme en faveur de l’attractivité du christianisme ; la fonction historiographique d’Ac 12, qui est conçu ici comme le premier chapitre de l’histoire de l’Église, une histoire appendue à l’histoire d’Israël et aussi à la vie de Jésus qu’elle prolonge à sa manière ; le Paul lucanien qui fonctionne en fait en tant que topos théologique 122si bien que, avant de se demander comment Paul a influencé Luc, il faut se demander comment Luc a façonné Paul ; le récit de naufrage d’Ac 27 placé sous l’éclairage de l’idéologie gréco-romaine à la lumière duquel il devient le reflet d’une transition décisive ; Paul et les Dioscures qui, associés largement au salut, à la justice et à la revendication de l’Empire romain sur le monde, font figure de patrons protecteurs de l’Évangile au moment où il parvient à Rome (Ac 28,11) ; le tyran comme topos : Néron/Domitien dans la perception juive ancienne et chrétienne primitive, une contribution qui traite aussi des Oracles sibyllins et de l’Apocalypse ; Marcion et les Actes, étude qui fait valoir que l’on ne peut pas dire que Marcion a rejeté les Actes ni que les Actes réagissent à Marcion, comme certaines voix récentes le laissent entendre, mais qu’Irénée, en redécouvrant les Actes, leur a offert une deuxième carrière ; la dimension apologétique de Luc-Actes ; la portée symbolique du fait qu’il soit dit que Paul enseigne durablement dans l’auditoire de Tyrannus en Ac 19,9 ; la découverte de l’Oikouménè, contribution conclusive qui outrepasse les frontières temporelles pour montrer combien les Actes demeurent actuels dans la pluralité post-moderne.
L’ensemble, complété par des index particulièrement bienvenus (textes anciens, auteurs modernes, notions et termes grecs et latins, noms propres, noms de lieu, thèmes) est d’une érudition extraordinaire et ouvre de nouveaux horizons. Comme déjà le recueil d’études sur Hébreux, il laisse augurer d’un commentaire qui fera date, et nul spécialiste des Actes ne pourra l’ignorer sans se priver d’éléments aussi stimulants que nouveaux.
Christian Grappe
Scott J. Hafemann, Paul : Servant of the New Covenant. Pauline Polarities in Eschatological Perspective, Tübingen, Mohr Siebeck, coll. « Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament » 435, 2019, xviii + 420 pages, ISBN 978-3-16-157701-7, 154 €.
L’ouvrage rassemble différentes études rédigées par l’A. (douze au total si l’on inclut l’introduction et la conclusion) autour de ce qui représente sa thèse majeure qui a trait à la nature à la fois eschatologique et frappée du sceau de l’histoire du salut de Paul. L’A. 123explique d’emblée que l’orientation qu’a prise sa recherche a été déterminée par la monographie qu’il a consacrée en 1985 chez le même éditeur à 2 Co 3,4-18 et qui l’a convaincu que, si le ministère de Moïse est tenu pour un ministère de mort et de condamnation, ce n’est pas en raison de quelque déficience qualitative ou quantitative de la Loi, mais du fait de l’endurcissement du peuple. Il en résulte, selon lui, que le problème résidait non dans la nature de l’alliance conclue avec Israël, mais dans la nature d’Israël avec qui elle avait été conclue, le peuple ayant reçu la Loi sans l’Esprit et donc sans la capacité octroyée par Dieu d’y obéir. Selon lui, le ministère de l’Esprit et de justice que proclame Paul est en revanche celui qui médiatise la gloire de Dieu rayonnant sur le visage du Christ et qui rend possible, par l’octroi du pardon des péchés dans le cadre de la nouvelle Alliance, la transformation du peuple eschatologique de Dieu désormais en capacité d’accomplir la Torah. L’A. affirme en conséquence que, pour comprendre Paul, il faut partir de son auto-compréhension en tant qu’apôtre du Christ appelé à être serviteur de la nouvelle alliance qui a été établie par le Messie et habilitée par l’Esprit Saint. Il estime aussi que les polarités que l’on rencontre chez Paul et dont un tableau cumulatif est proposé aux pages 18 à 21 s’éclairent dans la perspective eschatologique qu’il adopte, un nouvel âge succédant à l’ancien et induisant, sur le plan anthropologique, une transformation radicale, la nouvelle alliance venant à la fois ratifier et renouveler la relation d’alliance ancestrale avec Dieu, qui demeure la même mais qui a été en quelque sorte recréée par la délivrance, tant attendue, du peuple de Dieu du monde présent mauvais.
Comme l’A. le précise encore dans son introduction, selon lui, « les polarités dans la pensée de Paul, considérées d’un point de vue eschatologique, présupposent une continuité dans la structure de la relation d’alliance de Dieu avec son peuple tout au long de l’histoire du salut tout en reflétant en même temps la discontinuité qui existe entre la nature du peuple dans les deux ères de cette même histoire » (p. 9).
Les diverses études mettent plutôt l’accent sur ce qu’induit la nouvelle alliance. Les unes portent sur la réalité présente de cette nouvelle alliance et traitent respectivement de la perspective eschatologique, plutôt qu’anthropologique, de Paul (à partir de Ga 3,6-14), de la restauration eschatologique en Christ (à partir de Ga 3–4), du ministère de la nouvelle alliance de Paul qui a trait 124à la vie eschatologique (à partir de 2 Co 3,6-18 conçu le cœur de 2 Co 1–9), de la légitimité de son apostolat (à partir de 2 Co 10,12-18), de la souffrance apostolique qu’il endure, conçue elle aussi dans une perspective eschatologique (à partir de Ga 4,12-20 et de 2 Co 4,7-12), de l’unique justice prévalant au cours de chacune des deux ères de l’alliance (à partir de Ph 3,8-9). Les autres études ont trait, quant à elles, à l’espérance future de la nouvelle alliance. Elles portent : sur Rm 2,12-16, que l’A. interprète comme si, en 2,14, les païens dont il est question étaient en fait les gentils de la nouvelle alliance, gentils dont l’observance de la Torah sera le critère du jugement eschatologique de ceux qui pèchent sans la Loi ou alors dans la Loi ; sur l’espérance de Paul pour Israël conçue comme le parachèvement de l’alliance (à partir de Rm 11,25-32) ; sur l’avenir d’Israël et l’espérance de Paul pour les nations (à partir de Rm 15,1-13) ; sur le lien entre nouvelle création et parachèvement de l’alliance (à partir de Ga 6,15 et de 2 Co 5,17).
Un chapitre conclusif porte sur l’eschatologie de la nouvelle alliance qu’élabore Paul, cela en comparaison avec la documentation qumrânienne. L’A. discerne de nombreuses analogies : une même conviction que la communauté est le peuple de la nouvelle alliance, qu’elle est le lieu de la présence de Dieu dans le monde et qu’elle est fondée sur une interprétation eschatologique et juste des Écritures ; une même conviction aussi que l’obéissance à la Loi est rendue possible au sein de la nouvelle alliance par la puissance de l’Esprit Saint, la différence se situant en fait dans la conviction que Jésus est le Messie.
Ces études ont, pour la majorité d’entre elles (8 sur les 12 apparemment), été publiées antérieurement, même si cela n’apparaît pas très clairement dès lors qu’il faut chercher dans une note de bas de page les explications relatives à leur origine (p. xiii) et qu’un addendum bibliographique placé au terme de la préface ne contribue pas à clarifier la situation puisqu’il a été indiqué juste avant, dans la note dont il vient d’être question, que les textes ayant connu une publication antérieure ont été quelque peu actualisés. Cela étant, et par-delà les oppositions initiales, dont on peut estimer qu’elles sont formulées de manière un peu brutale, l’ouvrage est en fait plein de nuances et, même si le lecteur ne suivra pas forcément l’A. dans toutes ses analyses, il trouvera là une synthèse qui ne manque ni de cohérence ni de pertinence sur bien des points.
Christian Grappe
125Peter J. Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries, Tübingen, Mohr Siebeck, coll. « Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament » 418, 2019, xix + 827 pages, ISBN 978-3-16-154619-8, 264 €.
L’impressionnant volume qui est proposé là vient couronner les patientes recherches de l’A. qui a inlassablement labouré le champ du judaïsme ancien et du Nouveau Testament pour les mettre en relation et en dialogue.
Comme il l’explique à la fin d’un prologue par ailleurs plus descriptif que programmatique, sa démarche consiste à mettre en relation les textes, et cela sans privilégier un sens plutôt qu’un autre : « On peut utiliser les lettres de Paul comme sources qui documentent les phénomènes juifs du premier siècle de notre ère. On peut aussi utiliser les sources juives pour éclairer les lettres de Paul, les sources qumrâniennes pour démontrer la préhistoire de certains éléments et les sources rabbiniques pour mettre en évidence l’existence précoce d’autres. Dans le cadre d’une même discussion, il ne faut pas faire les deux choses à la fois. Ce livre contient différents types de discussions et, en conséquence, différentes manières de comparer des sources antérieures et postérieures ou alors juives et chrétiennes. En fin de compte, notre discipline suppose que l’on travaille avec un réseau de sources littéraires et archéologiques qui s’éclairent mutuellement. » (P. xiv.)
Concrètement, 26 études sont rassemblées, et le plus souvent mises à jour. Elles ont été écrites et longuement mûries sur une durée de près de 35 années, mais l’immense majorité a été publiée entre 2003 et nos jours, deux d’entre elles étant d’ailleurs inédites. L’ensemble s’ordonne en quatre parties.
La première est consacrée à la halakha, une halakha dont l’A. trouve les premières attestations dans la documentation qumrânienne mais qu’il discerne aussi à l’œuvre dans le NT et, bien sûr, dans la littérature rabbinique. Il s’emploie à la fois à définir le terme, à montrer l’ancienneté des halakhot que l’on trouve en Mishna Zavim 5,12, à comparer des lettres halakhiques que l’on trouve à Qumrân, dans le NT et dans le Talmud de Babylone, à comparer les systèmes halakhiques que l’on trouve chez Flavius Josèphe (celui du Contre Apion s’avérant beaucoup plus rigoureux de celui de la Guerre juive et des Antiquités juives), à confronter les dispositions halakhiques en matière de divorce que l’on rencontre dans le NT et dans le judaïsme ancien, à montrer comment les prières juives évoquent les règles de 126pureté d’une manière qui n’est pas immédiatement lévitique et qui pourrait porter la trace d’usages hellénistiques. Deux études enfin, distantes de 15 années, abordent, pour essayer d’éclairer le plus objectivement possible les données du quatrième évangile, les noms « Israël » et « juif » tels qu’ils sont employés dans les sources juives et chrétiennes anciennes. Elles montrent la complexité des emplois des deux termes, la deuxième contribution revenant d’ailleurs sur certaines des conclusions de la première pour prendre acte d’une forme d’antijudaïsme dans les emplois de Ioudaios chez Jean.
La deuxième partie traite des enseignements de Jésus et du développement de la tradition juive et chrétienne. L’A. s’intéresse successivement à l’annonce de la bonne nouvelle aux pauvres qui se trouve au centre du message de Jésus, à la présence du Cantique des Cantiques dans ses enseignements, à la parabole des dix vierges, au Notre Père, au passage que l’on observe, chez Matthieu, de la Maison d’Israël à l’ensemble des nations, à Jn 7,22-23 qu’il met en regard d’un midrash rabbinique halakhique. On retrouve dans toutes ces contribution une perspective ouverte tant à d’éventuels antécédents aux textes ou aux thèmes étudiés qu’à leur réception ultérieure.
Six études se concentrent ensuite sur Paul et sa place au sein du judaïsme : 1 Th 4,1-12 est lu dans une perspective à la fois hellénistique et juive ; l’expression « ceux qui font la loi seront justifiés », que l’on trouve en Rm 2,13, est comprise dans le cadre de l’argumentation générale du Paul dans l’épître ; Rm 7,1-4 est étudié au prisme de ceux qui connaissent la Loi dont il est question au v. 1 ; Paul est envisagé en tant que récipiendaire et enseignant des traditions à la fois halakhiques et « mystico-apocalyptiques » qu’il hérite de Jésus ; 2 Co 6,14–7,1 est étudié à la lumière du dualisme et du séparatisme tel qu’il est attesté dans certains écrits juifs au tournant de notre ère, les incrédules que vise le passage étant rapprochés pour leur part de ceux qui sont en ligne de mire en 4,4 ; 2 Co 8–9 et les développements que l’on y trouve sur la collecte au profit des saints qui sont à Jérusalem sont interprétés sur fond d’un durcissement qui se serait produit en peu de temps au sein de la communauté corinthienne contre le principe même de cette collecte, rassemblée par les païens, raidissement qui aurait été suscité par des adversaires judéo-chrétiens radicaux de Paul.
La dernière partie est dévolue à l’importance que revêt la documentation chrétienne des deux premiers siècles non seulement pour l’histoire chrétienne mais aussi pour l’histoire juive. La Didachè, 127Matthieu et l’Épître de Barnabé sont ainsi étudiés en tant que sources pour l’histoire à la fois juive et chrétienne. Josèphe et l’auteur de Luc-Actes sont comparés notamment en ce qu’ils s’emploieraient l’un et l’autre à complaire à des milieux romains influents ; Flavius Josèphe mais aussi Galates, Romains et Actes sont conçus comme des sources pour mieux appréhender la politique conduite en Judée dans les années 50 ; les épîtres pauliniennes sont étudiées en tant que sources relatives aux pharisiens ; le conseil donné par Gamaliel en Ac 5,38-39 est analysé comme un révélateur de la stratégie apologétique poursuivie par l’auteur des Actes ; l’expulsion des chrétiens de la Synagogue dont il est question dans le quatrième évangile est analysée est rapprochée d’un passage de Tosefta Hullin qui prône qu’une distance soit prise par rapport aux adeptes de Jésus. Elle est située ainsi au début du iie siècle.
Comme on le voit, on a affaire à un ensemble tout à fait cohérent et aux fruits d’une œuvre résolument ouverte aux diverses sources juives et chrétiennes pour les faire entrer en résonnance et mieux comprendre ainsi à la fois le judaïsme ancien et le mouvement chrétien naissant qui en émane et se meut encore en son sein. Les index fort bien faits qui complètent le volume auront toute leur utilité pour ceux qui voudront venir puiser dans cette mine et bénéficier ainsi de la grande érudition de l’A. et de sa remarquable connaissance des textes.
Christian Grappe
VIENT DE PARAÎTRE
Christian Grappe (dir.), La cathédrale de Strasbourg en sa ville. Le spirituel & le temporel, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, coll. « Études alsaciennes et rhénanes », 2020, 240 pages, ISBN : 978-2-86820-760-9, 39,50 €.
Le présent ouvrage est le fruit tardif d’un colloque qui s’est tenu les 3 et 4 septembre 2015 à l’Université de Strasbourg, dans le cadre du Palais Universitaire, pour marquer le millénaire de la pose de la première pierre symbolique de la cathédrale de Strasbourg par l’empereur du Saint-Empire Henri II et l’évêque de Strasbourg Werner, en 1015. Un événement que la ville avait souhaité célébrer avec un éclat tout particulier, mais que l’université n’avait pas 128prévu de marquer, d’où l’initiative d’un protestant pour pallier ce qui lui était apparu, à l’orée de l’année dudit millénaire, comme un manque. Le colloque avait pour particularité de ne réunir que des spécialistes strasbourgeois et d’être résolument interdisciplinaire, tout en se concentrant sur la thématique définie. L’ouvrage traite ainsi de l’articulation du temporel et du spirituel tant dans le rôle, la situation, la construction, le décor, la symbolique et l’entretien de la cathédrale de Strasbourg, tout en faisant également une place à la manière dont elle rythme le temps de la ville depuis les processions qui scandaient la vie de la cité au Moyen-Âge jusqu’à la sonnerie des cloches qui garde toute son importance de nos jours.
Les contributions rassemblées, au nombre de quatorze, brossent, pour les unes, un cadre et montrent l’intrication de la vie respective de l’édifice religieux et de la cité depuis les origines, le bâtiment en étant venu à symboliser l’identité et la liberté mêmes de la ville. Les autres s’attachent à des éléments de l’architecture et du décor de l’édifice – et plus particulièrement aux programmes iconographiques et à la statuaire. Elles montrent notamment en quoi ils intègrent et reflètent les relations, fluctuantes mais toujours prégnantes, entre spirituel et temporel, au cœur d’une ville dont ils attestent aussi l’ouverture à la modernité.
Quatre enseignants-chercheurs de la Faculté de Théologie protestante ont participé à cette entreprise qui débouche sur un volume très richement illustré et d’une mise en page particulièrement soignée. L’ouvrage est dédié à la mémoire de deux éminents universitaires strasbourgeois, Lucien Braun et Francis Rapp, décédés tous deux en mars 2019, le premier cheville ouvrière des Presses universitaires de Strasbourg pendant plusieurs décennies, le second auteur ici d’une magistrale étude, liminaire, sur la cathédrale et la ville.
Christian Grappe
Frédéric Rognon, Martin Niemöller. Prisonnier personnel de Hitler, Paris, Éditions Ampélos, coll. « Résister », 2020, 164 pages, ISBN 978-2-35618-175-6, 12 €.
Martin Niemöller (1892-1984) reste méconnu en francophonie. Le seul ouvrage en français qui lui est consacré date de 1938, et s’inscrit dans un registre nettement hagiographique. Le petit livre que viennent de publier les éditions Ampélos, dans une collection 129consacrée aux figures protestantes qui ont diversement décliné le principe de la résistance, vient donc combler un manque.
Il s’agissait aussi, en retraçant la trajectoire biographique du pasteur allemand, d’en souligner les ruptures et les tensions : de l’officier de marine durant la Première Guerre mondiale au pacifiste radical d’après la Seconde ; du militant ultranationaliste des Freiekorps (« Corps francs ») en 1920 à l’instigateur de la Pfarrernotbund (« Alliance pastorale de détresse ») en septembre 1933 ; de la cheville ouvrière du Synode de Barmen en 1934 au pourfendeur de la Communauté économique européenne en 1977 ; du chef de file de la Bekennende Kirche (« Église confessante ») hostile aux Deutsche Christen (« Chrétiens allemands ») à l’artisan de la réconciliation au sein d’une unique Evangelische Kirche in Deutschland (« Église protestante en Allemagne ») ; du déporté qui subit huit années durant le terrifiant régime des camps de concentration (Sachsenhausen puis Dachau), au chantre, dès sa libération en 1945, d’un acte de repentance de la part de l’ensemble du peuple allemand convaincu de sa « culpabilité ».
Martin Niemöller ne laisse pas d’intriguer l’observateur attentif du fait des discontinuités de sa vie et des paradoxes hyperboliques de sa personnalité : ses revirements sont-ils des reniements ou, au contraire, l’indice d’une quête exigeante, jamais en repos, de plus grande fidélité à soi-même ?
L’ouvrage met au jour l’itinéraire hors du commun de l’homme, avant d’interroger sa théologie : si Martin Niemöller s’apparente davantage à une figure d’engagements et d’actions qu’à un systématicien en chambre, c’est essentiellement parce que sa compréhension des textes bibliques en fait un vecteur de permanente intranquillité. S’il rejoint son ami Dietrich Bonhoeffer pour rappeler le prix de la grâce, c’est au gré d’une inflexion singulière : le coût élevé qu’il convient de payer réside dans l’articulation étroite entre la grâce et la Croix.
Frédéric Rognon
Frédéric Rognon, Le défi de la non-puissance. L’écologie de Jacques Ellul et Bernard Charbonneau, Lyon, Olivétan, coll. « Convictions et Société », 2020, 299 pages, ISBN 978-2-35479-524-5, 22 €.
Un quart de siècle après sa mort, Jacques Ellul (1912-1994) commence à bénéficier d’une relative reconnaissance. Bernard 130Charbonneau (1910-1996), pour sa part, continue à rester dans l’ombre. La mise en regard de ces deux amis, « unis par une pensée commune », permet cependant de mieux saisir les influences mutuelles entre le barthien converti et l’agnostique de culture protestante. C’est pourquoi ce livre a pris le parti d’alterner les œuvres de l’un et celles de l’autre, en trente-deux chapitres, sur une thématique au sujet de laquelle ils sont deux insignes précurseurs : l’écologie.
Suivant un ordre chronologique, le parcours entraîne le lecteur des écrits de jeunesse, en date des années trente, jusqu’au bilan d’une vie de réflexion et d’engagement, en passant par les analyses offertes durant la période de maturité : La Technique ou l’enjeu du siècle (1954), Le jardin de Babylone (1969), L’espérance oubliée (1972), Tristes campagnes (1973), Le système technicien (1977), Le Feu vert (1980)… Études sociologiques et essais théologiques s’entremêlent, en dialectique, autour de deux notions-phares : « la Grande Mue » des campagnes françaises tout au long du xxe siècle, décryptée par Bernard Charbonneau, et « l’éthique de la non-puissance » proposée par Jacques Ellul comme chemin spécifiquement chrétien, inspiré du geste du Christ, et qui veut en décliner une forme de fidélité pour notre temps, face aux enjeux environnementaux.
L’actualité de ces deux œuvres, pourtant rédigées au siècle passé, offre une ultime porte d’entrée : le changement climatique, les promesses transhumanistes, la pandémie de la Covid-19, le succès relatif des partis écologistes, incitent à revisiter une pensée qui non seulement les avait prévus, mais en suggérait déjà, il y a cinquante ans, une grille de lecture. C’est cette dernière que le présent ouvrage expose dans ses différentes dimensions : la dialectique brisée entre liberté et responsabilité dans la tradition judéo-chrétienne, l’aspiration à une immortalité sans résurrection, la sacralisation de l’innovation technologique accélérée et de la croissance économique exponentielle comme traductions modernes de l’hybris, la mobilité permanente comprise en tant que droit inaliénable par nos contemporains, l’impuissance des acteurs soucieux des générations futures à imaginer d’autres formes d’engagement que l’intégration dans les formes politiques institutionnelles classiques, et finalement l’esquisse d’une issue aux impasses actuelles du côté d’un « engagement dégagé » qui consiste à profaner la loi de Gabor.
Frédéric Rognon