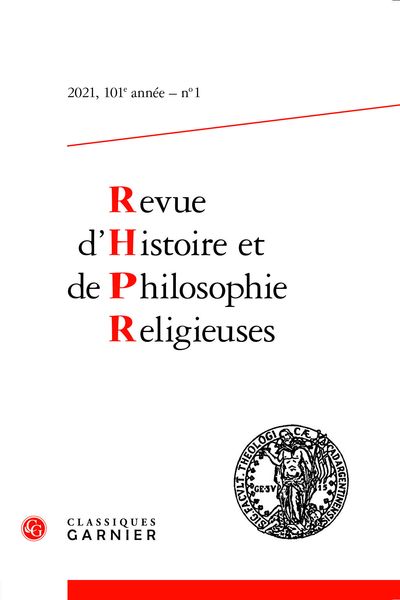
Andreas Osiander et les Juifs Les années 1522-1540
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Revue d’histoire et de philosophie religieuses
2021 – 1, 101e année, n° 1. varia - Auteur : Noblesse-Rocher (Annie)
- Résumé : Andreas Osiander est considéré par l’historiographie comme l’un des rares Réformateurs favorables aux communautés juives. Les travaux récents d’Anselm Schubert semblent nuancer cela. Qu’en est-il vraiment ? L’examen des écrits d’Andreas Osiander concernant le judaïsme permet de constater sa fascination pour la culture juive et son expertise en ce domaine, mais révèle aussi l’ambivalence de sa relation au judaïsme quand il s’agit d’entrer dans l’action et de favoriser la Réforme à Nuremberg.
- Pages : 7 à 21
- Revue : Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses
- Thème CLIL : 4046 -- RELIGION -- Christianisme -- Théologie
- EAN : 9782406115021
- ISBN : 978-2-406-11502-1
- ISSN : 2269-479X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11502-1.p.0007
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 15/03/2021
- Périodicité : Trimestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : Andreas Osiander, Nuremberg, Judaïsme, Réforme, Humanisme, hébraïsants, araméïsants, polémique anti-juive
Andreas Osiander et les juifs
Les années 1522-1540
Annie Noblesse-Rocher
Université de Strasbourg – Faculté de théologie protestante (UR 4378)
En 1529, Andreas Osiander rédigeait un petit traité intitulé Ob es war und glaublich sey (Est-il vrai et crédible…) dans le cadre d’un procès intenté à des Juifs de Pösing comme suite à une accusation de meurtre rituel. Ce traité ne fut rendu public que bien des années plus tard, en 15401, lorsqu’une affaire similaire éclata et que deux Juifs de Sappenfeld, près d’Eichstätt, en Franconie, comparurent soupçonnés du même crime. Ils se munirent de ce traité pour leur défense et furent d’ailleurs relaxés2. Ce traité a permis à Andreas Osiander de jouir jusqu’à aujourd’hui d’une réputation de philosémitisme dans une période peu propice à soutenir les Juifs et dans un milieu qui ne leur était guère favorable. Confortablement installés sur ce constat rassurant, à savoir qu’un Réformateur au moins n’avait pas poursuivi les Juifs de vindicte et de haine, les historiens ne se sont pas interrogés plus avant sur les véritables sentiments que ce Nurembergeois ombrageux et pugnace nourrissait à l’égard des Juifs3.
Or, voilà que récemment les travaux d’Anselm Schubert ont jeté le trouble sur cette certitude. Andreas Osiander ne serait en fait pas plus philosémite que ses coreligionnaires, Sébastien Munster 8ou Martin Bucer ; il appartiendrait à cette sodalitas d’hébraïsants chrétiens développant cette schizophrénie, propre aux intellectuels chrétiens médiévaux et à leurs héritiers du xvie siècle, qu’a mise en évidence Gilbert Dahan dans ses travaux4. D’un côté, les Juifs sont une autorité intellectuelle indiscutable, dont les commentateurs chrétiens s’inspirent, en utilisant leurs commentaires, surtout médiévaux, les plus connus, présents dans la Biblia Rabbinica dès 1517 ; de l’autre, ces mêmes Juifs sont considérés comme un peuple rebelle qu’il convient de dénoncer et de combattre, à défaut de les convertir.
L’étude des écrits d’Andreas Osiander et de son activité pendant cette période qui s’écoule entre 1529 et 1540, entre la rédaction de son traité de défense des Juifs et son utilisation par deux Juifs à Sappenfeld, nous permet-elle de mieux comprendre la position foncière du Nurembergeois ? N’est-il pas au fond, tel Janus, un homme à double visage, l’un tourné gracieusement vers la culture juive, l’autre la pourfendant de son mépris ? C’est à ces questions que nous tenterons de répondre après avoir évoqué, dans un premier temps, l’activité d’Andreas Osiander hébraïsant puis, dans un second, temps ses écrits relatifs aux Juifs entre 1529 et 1540.
Andreas Osiander hébraïsant
L’aspect positif des relations qu’entretint Andreas Osiander avec les Juifs réside indéniablement dans ses compétences d’hébraïsant. Sa formation se fit auprès des meilleurs maîtres en la matière. En effet, il fut immatriculé5, c’est la seule information qui soit bien attestée sur sa jeunesse, à l’Université d’Ingolstadt, en Bavière, le 9 juillet 1515. Il y étudia l’hébreu auprès de l’humaniste Johann Böschenstein, qui sera professeur ordinaire à l’Université de Wittenberg, nommé dans le cadre de la réforme des études visant à tisser un lien entre l’étude de l’hébreu et la théologie, en 1518-1519. Johann Böschenstein, dont nous reparlerons ci-après, fut l’auteur en 1519 d’une grammaire hébraïque, sur le modèle de celle de Johannes 9Reuchlin, les Hebraicae grammaticae institutiones (Wittenberg, 1519), et d’une introduction au yiddish (Elementa introductorium in hebraeos litteras, Augsbourg, 1514)6. Mais Andreas Osiander se perfectionna aussi au contact de maîtres juifs, comme Wölflein7, habitant dans la localité juive de Schnaittach, près de Nuremberg. Auprès de lui, Osiander ne découvrit pas seulement les rites juifs et des livres de prières juives (Siddurim), mais aussi le Talmud. Osiander fréquenta également le converti Paul Ricius (dont il salue l’érudition dans le Ob es war und glaublich sey8), professeur d’hébreu à Pavie en 1521, architecte de la kabbale chrétienne par la traduction en latin de l’œuvre de Josel Gikatilla Shaʻarei Orah (Portae lucis, 1516), que consulta Conrad Pellican et qui inspire les traductions du Zohar de Guillaume Postel.
L’apport d’Andreas Osiander comme hébraïsant, peut-être le moins connu mais le plus fructueux, est une Biblia, Vulgate révisée, qu’il fit paraître en 1522 à Nuremberg9, matrice d’autres bibles latines corrigées par la famille Osiander, représentative des premiers essais de correction par annotations marginales, dans le premier tiers du siècle10. Dans sa préface, Andreas Osiander précise qu’il a utilisé de « vieux exemplaires » dont l’antiquité assurait la fiabilité ou dont la diversité révélait non seulement l’erreur, mais aussi la nécessité d’une révision11. Il souhaitait pallier l’incurie des typographes – motif récurent dans les préfaces des vulgates protestantes mais aussi dans beaucoup de bibles corrigées, y compris au Moyen Âge, ou l’ignorance de la grammaire, des barbarismes ou des expressions inadéquates, en consultant le texte massorétique et la Septante12, mais avec prudence pour ne pas heurter son lecteur13. Les livres 10de Genèse à Nombres sont annotés en marge, en référence au texte massorétique, avec une fréquence décroissante. Systématiquement, Osiander précise ce que propose le texte massorétique pour tel ou tel terme de la Vulgate qui lui semble trop éloigné du sens littéral du texte hébraïque.
Prenons les trois premiers exemples dans le premier chapitre de la Genèse.
–Pour « ciel » (caelum) en Gn 1,1, Osiander précise qu’en hébreu le terme (shamayim) est toujours au pluriel. Note marginale : Hebrei celos ubique pluraliter enunciant.
–En Gn 1,4, Osiander rétablit beyn. Vulgate : Et divisit lucem a tenebris. Note marginale : Hebrei : et divisit inter lucem et inter tenebras (= hébreu : wa-yavdel <Elohim> beyn ha-’or u-beyn ha-hoshekh).
–En Gn 1,5, il précise qu’en hébreu on utilise fréquemment unus et non primus comme certaines traductions latines le font. Vulgate : Factum est mane dies unus. Note marginale : Heb<raei> unum pro primo frequenter usurpant14 (= hébreu : ehad).
Malheureusement, les annotations marginales se raréfient après le vingtième chapitre de la Genèse, Osiander n’ayant pas eu le temps d’achever sa révision, dans le contexte tourmenté de la réforme nurembergeoise15. Cette entreprise survit à la postérité grâce aux travaux de son fils Lucas Osiander. En effet, la Biblia de Lucas Osiander est une Vulgate révisée sur l’hébreu pour l’Ancien Testament et sur le grec pour le Nouveau. Lucas dit avoir utilisé, en regard de la version latine, la Bible allemande de Luther en allemand, dans la version « autorisée », c’est-à-dire celle qu’il a révisée de son vivant, avant 1545. Il précise que le texte biblique a été établi sur la version d’Andreas Osiander et qu’ont été ajoutées des lettres en plus petits caractères pour signaler, par rapport à la version d’Andreas : a) ce qui manque ou est sous-entendu ; b) ce qui est redondant ; c) par un signe de croix, ce qui est traduit plus rigoureusement, notamment dans l’Ancien Testament ; d) enfin ce qui peut être dit de façon plus explicite que dans la version 11paternelle. Ainsi survit l’hébraïsant Andreas Osiander à travers une bible latine publiée par son fils et révisée sur l’hébreu.
Le soupçon de judéité
et la situation des juifs à Nuremberg
Reconnu comme hébraïsant, et sans doute pour cela précisément, Andreas Osiander doit affronter le redoutable soupçon d’être un Juif converti au christianisme16. Le danger d’un tel soupçon est réel et l’inquiétude qu’il suscite est perceptible dans la lettre que Johann Böschenstein, lui aussi accusé d’être juif17, adressa à Andreas Osiander en 152318. Plus qu’une lettre amicale, Johann Böschenstein écrivit une Verantwortung, une apologie pour lui-même et pour son ami Osiander, car celui-ci aussi était accusé d’avoir des parents juifs. Le ton de la lettre est anxieux, la justification permanente et le poids à porter pour exercer l’expertise comme hébraïsant fort lourd : Boschenstein se sait haï parce qu’hébraïsant. Il répète à plusieurs reprises qu’il est bien né de parents chrétiens, donnant même des précisions sur l’origine et l’activité professionnelle de sa parentèle. Les motifs de suspicion s’apparentent aux thèmes des disputationes médiévales entre Juifs et chrétiens : Johann Böschenstein serait iconoclaste et cette opinion s’expliquerait aisément par ses origines juives, car son père serait, selon un ancien moine devenu luthérien, un rabbin très érudit. Le deuxième thème touche à la nécessité de maintenir ou non l’Ancien Testament dans le canon chrétien. « Des personnes avancent que l’Ancien Testament n’est nécessaire qu’aux Juifs ». Il est possible ici que Böschenstein ait été visé par des prédicateurs de la mouvance anabaptiste. Il répond à ces détracteurs au moyen de deux textes bibliques : Matthieu 23,2 : « [Les experts en Écriture sainte] sont assis dans la chaire de Moïse19 » et Luc 16,29 : « [Vous avez] Moïse et les prophètes ». Le troisième thème touche à la vénération due à Marie et aux saints. Accusé de ne pas rendre un juste culte à la mère du Christ, Böschenstein rétablit la 12juste hiérarchie, selon lui, qui veut que l’on honore Marie tout juste après le Christ ; quant au culte dû aux saints, il l’ignore et cite le Psaume 113,1 : « Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. »
Si la situation des chrétiens soupçonnés d’être juifs n’était pas confortable, celle des Juifs à Nuremberg ne l’était pas davantage. La chronique de Yossel de Rosheim, avocat et représentant des Juifs de l’Empire, est l’une des sources de la vie de ces communautés. Yossel rapporte dans sa Chronique, et cela jusqu’en 1547, toutes ses missions en faveur des Juifs attaqués, agressés ou mis injustement en cause à travers l’Empire. Il consacre un chapitre de sa Chronique à la ville de Nuremberg, pour l’année 1522. En croisant cette Chronique avec les Deutsche Reichsakten de la même période, nous obtenons une photographie des problèmes que pouvaient rencontrer les Juifs de Nuremberg et pressentons le climat dans lequel Osiander a pu les rencontrer.
Dès 1500, les Juifs sont en effet expulsés des villes libres d’Empire, de Reutlingen, de Nuremberg, d’Ulm, de Colmar, de Ratisbonne, de Nördlingen20. La chronique de l’année 5282 (1521/1522) fait référence à une assemblée convoquée par le rabbin Samuel de Worms, dont Yossel semble penser qu’elle a eu lieu simultanément à la réunion de la Diète dans cette ville. Yossel ne précise pas pourquoi le rabbin a appelé les membres de la communauté juive à une réunion urgente et ne donne pas d’explications sur le contenu des discussions.
Il est probable que cette assemblée ait été convoquée comme suite à l’obligation d’une taxe nouvelle demandée aux Juifs pour subvenir au Reichsregiment, qui était, depuis les années 1520, un corps gouvernemental permanent stationné à Nuremberg entre deux sessions de la Diète. Le rabbin Samuel aurait ordonné la collecte de cette taxe spéciale pour tous les Juifs de l’Empire. La Diète réunie à Nuremberg en 1522 aborda de fait à plusieurs reprises les questions liées à la présence des communautés juives et les Deutsche Reichstagsakten21 de 1522 mentionnent que les états impériaux présentèrent un projet de levée de taxe sur les Juifs, en plus des taxes régulières, une somme assez forte, en l’occurrence un gulden par personne. En outre, plusieurs appels furent entendus pour que l’on continue d’interdire la pratique du commerce d’argent aux 13Juifs. Ces propositions ont attiré l’attention de l’Empereur qui se trouvait alors en Espagne22. Charles Quint fournit une réponse dans laquelle il autorisait la levée de taxes mais uniquement pour ses propres besoins. Il souligne qu’il était tout à fait disposé à expulser totalement les Juifs si cela était souhaitable pour l’amour de la foi chrétienne23. Il était préférable d’expulser les Juifs plutôt que de les charger d’impôts supplémentaires24.
Pour Yossel, la convocation de l’assemblée de la communauté juive a peut-être un lien avec les allégations contre Luther, soulevées lors de la réunion de la Diète, selon lesquelles il aurait professé des idées proches des Juifs. Yossel note à plusieurs reprises que les Juifs étaient accusés d’avoir enseigné sa doctrine à Luther25. Un autre élément d’importance est la diffusion de Flugschriften missionnaires dénotant l’attitude commune en vigueur à Nuremberg juste après la Diète26. En février 1524 parut ainsi un Dialogue entre un chrétien et un juif, ainsi qu’un aubergiste (Gespräch zwischen einem Christen und einem Juden, auch einem Wirt), mettant en scène trois personnages s’étant rencontrés par hasard dans une auberge, devant les portes de Nuremberg. Selon Thomas Kaufmann, ce Dialogue, comme d’autres d’ailleurs, traduit « une nouvelle ouverture d’esprit dans la relation avec les Juifs27 » : au cours d’une rencontre de hasard dans une auberge de Nuremberg, une discussion commence, évoquant l’imminence d’une décision eschatologique. Le participant juif transporte avec lui une image acquise en route : il s’agit du Christ, pierre angulaire. Cette image sert d’élément didactique au cours de la discussion. Les Juifs doivent se déterminer dans leur relation au Christ maintenant28 !
Il faut ajouter un dernier personnage à ce tableau de Juifs de Nuremberg. C’est le converti Jakob Gipher, rabbin de Göppingen (baptisé à l’été 1519), qui donna des cours d’hébreu à Wittenberg et devint le messager de Luther notamment en direction de Nuremberg et d’Osiander. Il exerça une influence non négligeable, selon Thomas Kaufmann, sur la genèse du petit traité de Luther de 152329. Par 14cette sodalitas, il est clair que les idées missionnaires du traité Que Jésus est né juif30 sont parvenues jusqu’à Nuremberg et probablement jusqu’à Osiander. C’est dans ce contexte que la Réforme fut adoptée : le Conseil de la ville convoqua en effet du 3 au 14 mars un Colloque religieux. Après d’âpres débats au cours desquels Osiander se fit remarquer par sa détermination, le Conseil scella le passage de Nuremberg à la Réformation, le 14 mars 152531.
Les actualisations ambiguës de son savoir d’hébraïsant par Andreas Osiander
Si l’on examine maintenant les écrits d’Osiander, pendant cette période, rédigés en tant que Réformateur et homme politique nurembergeois, on constate que la tonalité de sa relation au judaïsme évolue sensiblement. Les exemples mettant en scène négativement des Juifs pour viser à travers eux le monachisme apparaissent. Les années 1522-1525, préparatoires à l’introduction de la Réforme à Nuremberg, sont marquées par la lutte acharnée qu’Osiander entreprend contre la Papauté et le monachisme nurembergeois. La ville possédait une tradition humaniste importante qu’incarnait la sodalitas staupitziana au couvent des Augustins mais représentée aussi par la grande famille des Pirckheimer, dont Willibald, conseiller de Maximilien Ier, et sa sœur, l’abbesse du couvent des clarisses, Caritas, l’une des figures de proue de la résistance monastique à la Réforme32. Dans cette perspective politique, Andreas Osiander opère un déplacement ambigu des thèmes traditionnels anti-judaïques sur la Papauté et le monachisme. Nous prendrons deux exemples de ce déplacement. Un troisième exemple permet de mettre en évidence le lien qu’Andreas Osiander opère entre l’apprentissage de l’araméen et son utilisation dans la polémique, thème traditionnel des polémiques médiévales.
Évoquons d’abord une prédication parue en mars 1524 à Augsbourg et sans doute donnée pendant la semaine de la Passion, 15entre le 20 et le 26 mars, à Nuremberg, Osiander transpose le motif traditionnel des Juifs ennemis du Christ sur l’Église romaine. L’éditeur de cette prédication, Gottfried Seebass, revendique une certaine prudence dans l’interprétation de ces motifs car cette prédication lui semble incomplète, trop courte pour une prédication dite par Osiander et parce que, de plus, elle n’a pas été éditée par lui. Il estime que des parties où figurent habituellement les dénonciations traditionnelles des Juifs liées à la Passion manquent peut-être33. Toujours est-il que cette prédication a été publiée sans qu’Osiander s’y opposât et que les éléments qui sont en notre possession ont donc été approuvés par lui. La prédication est fondée sur les chapitres 26 et 27 de l’évangile selon Matthieu, lus en ouverture de la Semaine Sainte : elle donne le ton des célébrations à venir. Un événement s’est produit quelques jours auparavant, qui permet l’interprétation allégorique et l’actualisation polémique d’Osiander : le 14 mars 1524, le légat pontifical Lorenzo Campeggio est venu en visite pastorale à Nuremberg34.
Osiander identifie brutalement et sans ménagement « le Pape, les cardinaux et les évêques » avec les Grands Prêtres et les scribes, mais, bien plus, avec Judas livrant Jésus. Poussant plus loin l’accusation en une sorte d’inflation, le Réformateur identifie le Pape à l’Antéchrist. Comme le Christ l’a fait en son temps, les Nurembergeois doivent eux aussi dire aux prélats de la Curie romaine : « Vous avez pour père le Diable » [Jean 8,44]. Ces prélats foulent aux pieds au pied la Parole et acceptent, comme le Grand Prêtre, que le Christ soit pris, frappé et tué avec l’assentiment de Pilate, comprenons des autorités séculières35. L’assimilation de la Curie romaine au Grand Prêtre livrant le Christ à Ponce Pilate est pour le moins ambiguë, car elle place en regard deux acteurs perçus aussi négativement l’un que l’autre.
Prenons notre deuxième exemple. Dans une préface épistolaire, Andreas Osiander dresse une autre analogie, cette fois entre les juifs et le monachisme. Il s’agit de la préface à la lettre que Johann von Schwarzenberg adresse à l’évêque de Bamberg Weigand, le 12 novembre 1524, dont il est le conseiller36. Veuf et père de 12 enfants, Johann von Schwarzenberg fit entrer une de ses filles, 16Barbara, née le 9 février 1490, au couvent des dominicaines de Bamberg en 150337. Mais, en 1520, alors qu’il est en charge du Reichsregiment, Johann von Schwarzenberg embrasse les idées luthériennes et, en 1524, retire sa fille du couvent alors qu’elle en était devenue prieure. C’est pour prévenir l’évêque de ce retrait que Johann von Schwarzenberg lui écrit. Dans la préface à cette lettre, Andreas Osiander veut pourfendre le monachisme féminin conçu comme une union matrimoniale spirituelle avec le Christ. Il procède à une exégèse analogique audacieuse et compare la situation précitée aux chapitres 19 et 20 du livre des Juges, annonçant par cet exemple la fin d’un monachisme qui livre de jeunes vierges (ou des concubines de prêtres) à un mariage contre nature38.
Enfin, une autre lettre met en évidence l’ambiguïté qui caractérise l’utilisation par Osiander de son savoir d’hébraïsant. Dans une lettre au Conseil de Nuremberg, écrite avant le 17 février 1529, il présente en fait un mémoire sur la signification des trois langues bibliques pour la compréhension de l’Écriture sainte. Plus précisément, le Réformateur s’attache à l’importance de l’araméen dont il rappelle la propagation chez les Juifs du temps du Christ et sans la connaissance duquel les chrétiens ne peuvent comprendre ces textes écrits en cette langue. Quand les Juifs sous le roi Nabuchodonosor étaient prisonniers 70 ans à Babylone, ils ont abandonné l’hébreu, explique Andreas Osiander, et ont appris le babylonien ou le chaldéen qu’ils appellent Targum. Ce serait donc un avantage que les chrétiens s’approprient l’araméen, pour l’employer dans la polémique contre les juifs et pour leur propre besoin. Pour ce faire, Osiander demande la permission d’embaucher un maître juif, habitant de Schnaittach, pour six mois et prie le Conseil de lui fournir un laisser-passer39.
Les fondements institutionnels de la réflexion sur les langues bibliques au xvie siècle sont constitués, et c’est clairement le cas ici, par les décisions du Concile de Vienne, réuni à partir du 16 octobre 1311 et jusqu’au 6 mai 1312, sous la présidence du Pape Clément V. Ce concile promulgua le Décret Inter sollicitudines40 évoquant l’étude des langues et son principal argument est la conversion des « infidèles », au cours de débats théologiques institués depuis le Haut Moyen Âge. Par « souci de ramener les égarés 17dans la voie de la vérité41 », la prédication était un outil essentiel dans une visée missionnaire car le Pape désirait vivement que « la sainte Église soit abondamment pourvue de catholiques versés dans la connaissance des langues dont usent les Infidèles42 ». Le but était de pouvoir enseigner aux non-chrétiens (juifs et musulmans à cette époque) la doctrine catholique pour « les agréger ensuite à la communauté des chrétiens par le moyen de la foi chrétienne et de la réception du baptême43 ». Dans ce but, le Pape décida la construction d’écoles pour l’enseignement de l’hébreu, de l’arabe, de l’araméen. Deux « experts » de chaque langue devaient exercer dans ces écoles, à la Cour romaine et dans les centres d’études de Paris, Oxford, Bologne et Salamanque. Ces enseignants « traduiront fidèlement en latin les ouvrages rédigés en ces diverses langues et enseigneront ces langues elles-mêmes à d’autres44 », en d’autres termes à des prédicateurs-missionnaires.
Finissons sur une note plus positive. L’actualisation des données bibliques est une activité permanente d’Andreas Osiander. Il l’emploie parfois avec ambiguïté, nous l’avons vu, mais parfois aussi avec une grande expertise, en considérant les commentaires rabbiniques comme des sources fondamentales pour l’élaboration de la nouvelle théologie ou pour résoudre des questions éthiques importantes. Nous pourrions citer ainsi la lettre qu’il reçut de Philippe Melanchthon le 6 février 1536 à propos du mariage et du lévirat et dans laquelle celui-ci prie Osiander de lui fournir des indications relatives à la tradition rabbinique sur cette question, lui-même étant sous la pression d’une délégation anglaise venue à Wittenberg pour connaître la position de Martin Luther à propos du divorce d’Henri VIII45. Dans une longue réponse, Andreas Osiander s’appuie sur les textes bibliques de référence (Lévitique 18,16, Deutéronome 25,5 notamment) mais plus encore sur des sources juives, cités sur un même plan d’autorité, comme Moïse Maïmonide « vir doctissimus », le Talmud de Babylone ou indistinctement des « cabalistae ».
Cet échantillon d’écrits d’Andreas Osiander touchant à sa relation au judaïsme fait apparaître la complexité et du personnage et 18de sa situation en tant que réformateur de Nuremberg, face à un monachisme qui ne veut pas laisser la place et à des autorités séculières, soucieuse de ménager la religion du Prince. Indéniablement, Andreas Osiander est un hébraïsant talentueux qui demeure en contact avec la communauté juive réelle à fin d’expertise plus que d’amitié sans doute. On peut concéder à Anselm Schubert qu’il est possible que, par l’intermédiaire de Reuchlin, la Kabbale juive ait pu passionner Andreas Osiander et que les sources juives antiques et médiévales sont véritablement pour lui des outils herméneutiques pour la nouvelle théologie, comme l’exemple de la question sur le lévirat vient de le montrer. Cela étant, Andreas Osiander reste un luthérien, même si ses relations théologiques avec Luther ont été difficiles. C’est dans la perspective de l’opposition de la Loi, obsolète pour lui aussi, et de l’Évangile qu’il faut comprendre les principes d’exemplarité négative (Juges 19) issus de l’Ancien Testament que nous avons cités. Plus largement, comme le relève Matthias Morgenstern dans sa contribution à ce même volume, la situation au xvie siècle est beaucoup complexe et ambivalente qu’elle ne l’est aujourd’hui dans le domaine des relations entre Juifs et chrétiens. Il est fort difficile à nos esprits contemporains d’entrer dans cette schizophrénie généralisée des intellectuels chrétiens concernant les Juifs. Pour une juste appréciation des positions à cette époque, il est toutefois nécessaire d’en passer par cette clef d’interprétation indispensable. À partir de cela, il faut porter au crédit d’Osiander d’avoir laissé à l’Histoire (et à l’humanité) ce traité de défense des Juifs dans une période si peu bienveillante à leur égard. Le faire l’exposait à la vindicte des populations comme au jugement et au courroux des intellectuels de sa famille confessionnelle. Est-ce une exigence intellectuelle qui poussa le Réformateur à produire cette dangereuse défense des Juifs ? Il aurait pu rédiger une apologie plus intellectuelle, moins engagée personnellement, décontextualisée des événements de 1529. Osiander a pris le risque – et il était très grand – de cette publication située dans un contexte précis et tendu, fort argumentée, sans que rien ne l’y oblige. À ce titre, Osiander reste un exemple unique et somme toute mystérieux, de bienveillance envers ses contemporains juifs.
19Bibliographie
Arnold Matthieu, « Luther et les Juifs : état de la question », Positions Luthériennes 50, 2002, p. 139-165.
Arnold, Matthieu, « Les écrits relatifs aux juifs », Martin Luther, Paris, Fayard, 2017, p. 506-512.
Arnold, Matthieu, « Martin Luther et les Juifs (1523, 1543). De la coexistence à la ségrégation », RHPR 97, 2017/3, p. 423-438.
Dahan, Gilbert, La polémique chrétienne contre les juifs au Moyen Âge, Paris, Albin Michel, 1991.
Dahan, Gilbert, « L’enseignement de l’hébreu en occident médiéval (xiie-xive s.) », Histoire de l’éducation 57, 1993, p. 3-22.
Dahan, Gilbert, « Les éditions de la Vulgate de 1500 à 1546 », in Dahan – Noblesse-Rocher, 2018, p. 13-51.
Dahan, Gilbert – Noblesse-Rocher, Annie (éd.), La Vulgate du xvie siècle, Genève, Droz, 2018.
Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V. (1519–1523), Bd. 4 (Jüngere Reihe), éd. Adolf Wrede, Gotha, F.A. Perthes, 1905.
Fraenkel-Goldschmidt, Chava, The Historical writings of Joseph of Rosheim. Leader of Jewry in Early Modern Germany, Leiden – Boston, Brill, coll. « Studies in European Judaism » 12, 2006.
Hägler, Brigitte, Die Christen und die „Judenfrage“ : Am Beispiel der Schriften Osianders und Ecks zum Ritualmordvorwurf, Erlangen, Palm und Enke, 1992.
Kaufmann, Thomas, Les juifs de Luther, Genève, Labor et Fides, coll. « Histoire », 2017.
Lecler, Joseph, Vienne, Paris, Éditions de l’Orante, coll. « Histoire des conciles œcuméniques » 8, 1964.
Luther, [Martin,] Œuvres I, sous la dir. de Marc Lienhard et Matthieu Arnold, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade » 455, 1999.
Midrash Rabba Genèse, tome 1. Trad. Bernard Maruani et Albert Cohen-Arazi, Paris, Verdier, coll. « Les Dix Paroles », 1987.
Morgenstern, Matthias, « Réflexions sur l’image et l’histoire du Temple dans le Midrash Bereshit Rabba », in Les récits de la destruction de Jérusalem (70 ap. JC). Contexte, représentations et enjeux, entre Antiquité et Moyen Âge, éd. Frédéric Chapot, Turnhout, Brepols, coll. « Judaïsme ancien et origines du christianisme », 19, 2020, p. 259-291.
Morgenstern, Matthias – Noblesse-Rocher, Annie, « La réfutation des accusations de crimes rituels d’Andreas Osiander », RHPR 97, 2017/3, p. 449-467.
Müller, Arndt, Geschichte der Juden in Nürnberg 1146-1945, Nürnberg, Statdt Bibliothek Verlag, 1968.
20Münster, Sebastian, « Extrait de la Préface de la Bible hébraïque (1534) », trad. Gilbert Dahan, Études théologiques et religieuses 92, 2017/1, p. 237-248.
Noblesse-Rocher, Annie, « Les “révisions” de la Vulgate dans les cercles protestants au xvie siècle », in Dahan – Noblesse-Rocher, 2018, p. 123-141.
Osiander, Andreas, Biblia sacra utriusque Testamenti, diligenter recognita, emendata, non paucis locis, quae corrupta erant, collatione hebraicorum voluminum restitutis…, Nuremberg, 1522.
Osiander, Andreas, Ob es war und glaublich sey, dass die Juden der christen kinder heymlich erwürgen und ir blut gebrauchen. Ein treffenliche schrifft, auff eines yeden urteyl gestelt. Wer menschenblut vergeusst, des blut sol ouch vergossen werden, [Nuremberg ?], [1540 ?].
Osiander, Andreas, Schrift über die Blutbeschuldigung. Wiederaufgefunden und im Neudruck herausgegeben, éd. Moritz Stern, Berlin, Der Hausfreund, 1903 [1893].
Osiander, Andreas d. Ä. [der Ältere], Gesamtausgabe. Vol. 1 : Schriften und Briefe 1522 bis März 1525, éd. Gerhard Müller et Gottfried Seebass, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1975.
Osiander, Andreas d. Ä. [der Ältere], Gesamtausgabe. Vol. 3 : Schriften und Briefe 1528 bis April 1530, éd. Gerhard Müller et Gottfried Seebass, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1979.
Osiander, Andreas d. Ä. [der Ältere], Gesamtausgabe. Vol. 6 : Schriften und Briefe 1535 bis 1538, éd. Gerhard Müller et Gottfried Seebass, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1985.
Osiander, Andreas d. Ä. [der Ältere], Gesamtausgabe. Vol. 7 : Schriften und Briefe 1539-1543, Gutachten zur Blutbeschuldigung, éd. Gerhard Müller et Gottfried Seebass, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1988.
Osiander, Andreas, Que les juifs ne tuent pas les enfants chrétiens (1540). Une réfutation des accusations de meurtre rituel. Trad., introd., comm. et notes Matthias Morgenstern et Annie Noblesse-Rocher, Genève, Labor et Fides, « Collection Histoire », 2017.
Quentin, Henri, Mémoire sur l’établissement du texte de la Vulgate, Rome – Paris, Desclée – Gabalda, 1922.
Schubert, Anselm, « Andreas Osiander als Kabbalist », Archiv für Reformationsgeschichte 105, 2014, p. 30-54.
Seebass, Gottfried, Das reformatorische Werk des Andreas Osiander, Nuremberg, Selbstverlag des Vereins für Bayerische Kirchengeschichte, 1965.
Seebass, Gottfried, Bibliographia Osiandrica. Bibliographie der gedrückten Schriften Andreas Osianders d. Ä. (1496-1552), Nieuwkoop, De Graaf, 1971.
21Seebass, Gottfried, « Die Reformation in Nürnberg », Reformation in Nürnberg. Umbruch und Bewahrung, 1490-1580, Nürnberg, Medien und Kultur, 1979, p. 105-117.
Shuali, Eran, « Les deux versions de l’évangile de Matthieu en hébreu publiées par Sebastian Münster (1537) et par Jean du Tillet et Jean Mercier (1555) : un réexamen des textes et de la question de leurs auteurs », Les hébraïsants chrétiens en France au xvie siècle, éd. Gilbert Dahan et Annie Noblesse-Rocher, Genève, Droz, 2018, p. 217-251.
Terzer, François, Caritas Pirckheimer, Paris, Cerf, coll. « Cerf Histoire », 2013.
1 Le lecteur voudra bien se reporter à l’édition critique de ce traité, dans les Œuvres complètes d’Andreas Osiander (Osiander, 1988), et à la traduction française, commentée, que nous avons publiée avec Matthias Morgenstern : Osiander, 2017 [1540].
2 Nous renvoyons ici à notre article sur ce sujet, rédigé en collaboration avec Matthias Morgenstern : Morgenstern – Noblesse-Rocher, 2017.
3 Schubert, 2014, p. 31.
4 Dahan, 1991.
5 Seebass, 1965 (l’ouvrage possède une bibliographie d’Osiander) que l’on actualisera avec Seebass, 1971.
6 Hägler, 1992, p. 220.
7 Seebass, 1965, p. 81.
8 « Je considère le vénérable et très savant docteur Paul Ricius comme l’homme le meilleur et le plus honnête qui soit passé de la longue tradition juive à la foi chrétienne depuis des centaines d’années », Osiander, 1988 [1540], p. 232.
9 Osiander, 1522. Voir Quentin, 1922, p. 100-101.
10 Sur ce point, voir Noblesse-Rocher, 2018.
11 Osiander, 1522, « Prio lectori » (s’agit-il vraiment d’une préface d’Andreas Osiander ? La page qui contient ce texte a été ajoutée à un exemplaire de l’édition de 1523, voir Dahan, 2018, p. 33).
12 « In partem laboris ab eis sum invitatus, rogatusque ut expunctis erroribus, quos typographorum vel incuria, vel rerum grammaticarum ignorantia invexerat, simul etiam, sicubi barbaries, vel aliud sermonis incommodum suspitionem faceret, consultis hebraea veritate, et septuaginta interpretibus, subodorarer quid esset legendum », Ibid.
13 « Senes vero morosos aequanimiores redderem, iis, si qui forte Erasmi exemplum imitati novam veteris Testamenti translationem molirentur, nonnulla vero prudens dissimulavi… », Ibid.
14 Osiander fait sans doute référence à un theologoumenon rabbinique qui est présent dans le Midrash Bereshit Rabba (dont l’édition princeps date de 1512). Voir Midrash Rabba Genèse, 1987, p. 64 (nous remercions Matthias Morgenstern de nous avoir fourni cette information). Voir à ce propos Morgenstern, 2020, p. 273-275.
15 Seebass, 1979, p. 105.
16 Voir Hägler, 1992, p. 220.
17 Sur l’accusation d’être juif prononcée par Martin Luther contre Johan Böschenstein, voir WA Br 1, 368, 12 sq.
18 Osiander, 1975, p. 67-69.
19 Nos traductions sont faites sur le texte allemand d’Andreas Osiander.
20 Müller, 1968, p. 99 ; Fraenkel-Goldschmidt, 2006, p. 13 et p. 131, note 22.
21 Fraenkel-Goldschmidt, 2006, p. 131.
22 Ibid., p. 132.
23 Ibid., p. 132.
24 Deutsche Reichstagsakten, 1893, p. 234.
25 Fraenkel-Goldschmidt, 2006, p. 134.
26 Kaufmann, 2017, p. 88.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Ibid., p. 48.
30 Sur la question de Luther et les juifs : Arnold, 2002 et 2017. Sur son traité Que Jésus est né juif, voir Luther, 1999.
31 Terzer, 2013, p. 72.
32 Terzer, 2013.
33 Osiander, 1975, p. 130.
34 Osiander, 1975, p. 131.
35 Osiander, 1975, p. 133.
36 Osiander, 1975, p. 293.
37 Osiander, 1975, p. 283.
38 Osiander, 1975, p. 293.
39 Osiander, 1979, p. 336.
40 Lecler, 1964, p. 193 ; Dahan, 1993, p. 7.
41 Lecler, 1964, p. 193.
42 Ibid.
43 Ibid.
44 Ibid.
45 Osiander, 1985, p. 152.