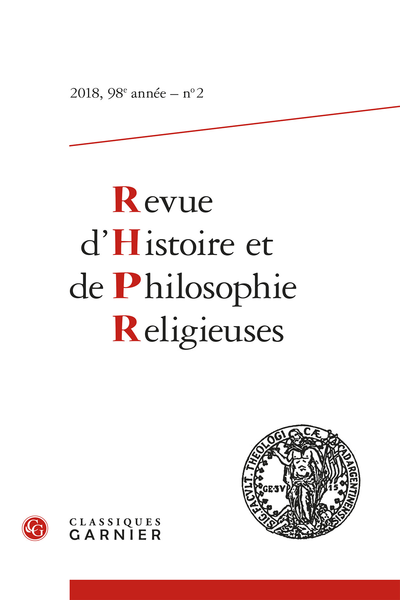
Une interprétation sociologique de la diffusion mondiale d’un christianisme de l’émotion
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses
2018 – 2, 98e année, n° 2. varia - Auteur : Bastian (Jean-Pierre)
- Pages : 155 à 172
- Réimpression de l’édition de : 2018
- Revue : Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses
- Thème CLIL : 4046 -- RELIGION -- Christianisme -- Théologie
- EAN : 9782406093312
- ISBN : 978-2-406-09331-2
- ISSN : 2269-479X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-09331-2.p.0042
- Mise en ligne : 23/04/2019
- Périodicité : Trimestrielle
- Langue : Français
155
UNE INTERPRÉTATION SOCIOLOGIQUE DE LA DIFFUSION MONDIALE D'UN CHRISTIANISME DE L'ÉMOTION
Jean-Pierre Bastian 2 route de Vevey - CH-1095 Lutry Résumé : Alors que le christianisme en Europe perd son emprise sur la société, le pentecôtisme poursuit une progression continue aux périphéries de rOccident. Bien qu'informé au départ par la culture religieuse pro¬ testante nord-américaine, il est devenu un christianisme de l'émotion, de terrain aussi bien protestant que catholique et messianique, une quatrième expression du christianisme au côté du protestantisme, du catholicisme et de l'orthodoxie. Il participe de l'émiettement du religieux dans la modernité tardive et s 'inscrit dans un marché religieux global. Abstract : Whilst Christianity in Europe loses its purchase on society, Pente- costalism advances constantly on the fringes of the West. Although informed at the outset by North American Protestant religious culture, it has become a Christianity of emotion whether on Protestant, Catholic or Messianic territory, a fourth distinct expression of Christianity alongside Protestantism, Catho¬ licism and Orthodoxy. It is one aspect of the crumbling of the religious in late modernity and is one product in a global religious market. Le pentecôtisme est le mouvement religieux le plus dynamique du xx^ siècle durant lequel il s'est diffusé à l'échelle mondiale ; né aux Etats-LFnis en 1906, dans une mouvance inspirée par la théo¬ logie revivaliste protestante de racines méthodistes, il est devenu un christianisme de l'émotion à même de s'adapter aux diverses populations d'accueil. Il a ainsi contribué à profondément transfor¬ mer le paysage religieux contemporain. Pendant longtemps, il est resté largement méconnu en Europe, en grande partie à cause de son expression ultra-minoritaire et marginale dans la région. Il est principalement un phénomène des périphéries de l'Occident et c'est pour cela que trop rares sont ceux qui le perçoivent comme un qua¬ trième courant au sein du christianisme, à côté du catholicisme, du protestantisme et de l'orthodoxie. Il s'agit d'une tradition religieuse jeune qui représente un défi pour l'avenir du christianisme. Très diversifiés et fissipares, les églises et organisations relevant du pentecôtisme rassemblent dans le monde, selon des données récentes.
REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES 2018, Tome 98 n° 2, p. 155 à 171
43J.-p. BASTIAN, SOCIOLOGIE D'UN CHRISTIANISME DE L'ÉMOTION
plus d'un demi-milliard d'individus, alors que le catholicisme en compterait environ un milliard deux cents millions, le protestantisme trois cent quarante millions et l'orthodoxie deux cents millions ^ Durant les années 1970, les chercheurs de tendance marxisante et les clercs catholiques se sont contentés de soutenir l'hypothèse conspirationniste selon laquelle ces mouvements enthousiastes crois¬ sants constituaient, de par leur genèse, une sorte d'avant-garde reli¬ gieuse de l'impérialisme nord-américain dans ce que l'on appelait alors le Tiers-monde, renforçant l'aliénation des pauvres et des marginaux qui y adhéraient. Depuis, de nombreux travaux se sont intéressés à distinguer les contextes et les cultures qui informent les pentecôtismes. Tenant compte de la capacité des grandes églises pentecôtistes à utiliser les moyens modernes de communication et à créer des « mega-churches », certains chercheurs traitent les mouve¬ ments actuels de « néo-pentecôtisme », pensant ainsi les distinguer des premières expressions émotionnelles et de celles du milieu du xx^ siècle. Pour ma part, je préfère éliminer ce préfixe inutile, car il s'agit d'un même élan religieux qui, comme d'autres, tel le catholicisme, au fil du temps, use de nouveaux moyens de commu¬ nication, sans que pour autant il faille parler de néo-catholicisme. Afin de saisir l'homogénéité pentecôtiste, malgré la diversité de ses manifestations et contextes à l'échelle mondiale, je commencerai par définir ce qu'il convient d'entendre par pentecôtisme à partir de ses croyances et pratiques, ensuite je donnerai quelques éléments factuels décrivant l'expansion mondiale du mouvement et enfin je mettrai en avant un des aspects les plus significatifs de son déploie¬ ment, la multilatéralité de l'expansion dans une logique de marché. I. Définir le pentecôtisme : une religion de l'émotion Extrêmement diffus au sein d'amples secteurs sociaux ruraux et urbains, le pentecôtisme est un phénomène pluriel, lié à la trans¬ nationalisation religieuse. A moins d'en faire une lecture théolo¬ gique, le sociologue doit distinguer les contextes et les cultures qui informent ces expressions religieuses extrêmement malléables par leur faible exigence dogmatique. Il doit aussi mettre en exergue ce qui les constitue et leur assigne une commune appartenance religieuse. Dans ce sens, sous le terme pentecôtisme, on peut inclure un ensemble de mouvements religieux relevant du type-idéal sociologique de la secte conversionniste et se réclamant d'une
' Cf. Johnson - Ross, 2009.
REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES 2018, Tome 98 n° 2, p. 155 à 171
44157
tradition chrétienne pneumatologique et apocalyptique articulée à des traditions religieuses locales. Ils se caractérisent par une triple pratique centrée sur l'exercice de la glossolalie, de la thaumaturgie et de l'exorcisme. Il s'agit d'un large éventail d'organisations aux frontières poreuses, allant du pentecôtisme originel de filiation pro¬ testante et revivaliste aux messianismes chrétiens endogènes et aux mouvements de renouveaux charismatiques catholiques. Avant tout, le pentecôtisme est une pratique religieuse, reven¬ diquée par des secteurs sociaux issus des populations paupérisées des périphéries des mégapoles du tiers-monde et des campagnes marginalisées des pays du sud, que l'on retrouve dans les diasporas issues des courants migratoires dans les grandes villes d'Europe et des États-Unis. Pour ces adeptes, au statut social précaire et à la faible scolarisation, il est un moyen d'expression effervescent et émotionnel dont on peut relever quatre traits fondamentaux, articulés les uns aux autres : - Une théologie de l'Esprit, informée par le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres et liée à un fondamentalisme biblique qui refuse tout rapport cognitif à une tradition religieuse. Pneumato- logie et apocalyptique sont deux pôles d'une théologie qui vise à nier l'historicité, à extraire l'acteur religieux des pesanteurs de la réalité sociale et de l'exclusion. Ce langage abolit la pauvreté. Le fondamentalisme pentecôtiste n'est pas la gestion d'un savoir, ni l'accès savant à un texte. Il est un rituel qui permet de gérer l'émotion dans le sens de créer un acteur social nouveau dont l'autonomie relative se fonde dans un acte communautaire dont le langage est la louange^ informée par la puissance d'une force mobi¬ lisatrice que la tradition chrétienne dénomme l'Esprit-Saint. La louange est l'énoncé premier du discours de cet acteur social qu'est toute sociabilité pentecôtiste. Elle s'exprime à la fois par un dire (la glossolalie) et par un faire (thaumaturgie, exorcisme) collectifs. - La glossolalie (ou parler en langues) qui est un discours de pauvres, une manière de s'exprimer lors des cultes dans un brouhaha de sons incompréhensibles ; c'est le langage brisé de ceux qui ne parviennent pas à s'exprimer et à se faire entendre dans des sociétés où prédomine l'exclusion des couches sociales défavorisées. Le parler en langues est une forme extraordinaire et archaïque de parole qui entre dans une chaîne de discours. De l'autre côté, une forme hypermoderne de communication est représentée par les télévan- gélistes qui usent des médias les plus sophistiqués pour répandre cette forme de louange. Les deux fonctionnent de la même manière.
^Corten, 1995 ; 1999.
REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES 2018, Tome 98 n° 2, p. 155 à 171
45J.-p. BASTIAN, SOCIOLOGIE D'UN CHRISTIANISME DE L'ÉMOTION
on parle aux pauvres et on abolit symboliquement la pauvreté. Pour Olivier Roy, « l'annulation de la langue au profit de la parole [glossolale] est sans doute l'exemple le plus achevé de la sainte ignorance^ ». - La thaumaturgie en tant que pratique de « guérison divine » qui inscrit le pentecôtisme dans une longue tradition chamanique, en Amérique latine ou encore en Corée du sud, et sorcellaire, en Afrique, mettant l'accent sur le caractère magique de la guérison. On constate, certes, un rejet apparemment radical des pratiques religieuses traditionnelles, condamnées comme « païennes ». Mais si les esprits démoniaques sont diabolisés lors de la conversion, leur efficacité n'est pas niée. Les forces spirituelles de la secte sont simplement tenues pour plus puissantes. On passe au pentecôtisme en y retrouvant ce que l'on avait investi dans le système religieux traditionnel. La maladie y a le même statut. Elle représente un moment de désorganisation des éléments qui composent la person¬ nalité. Elle est comme un message à déchiffrer et elle s'apparente à une possession ratée et mal accomplie, car la maladie est, pour le pentecôtiste, le signe d'une malédiction que le pasteur-guérisseur conjure. - La pratique de l'exorcisme qui est étroitement liée à la précé¬ dente, car il faut expulser les démons. La transe religieuse sous forme d'une possession par l'esprit s'inscrit dans les registres des mentalités religieuses populaires. Le dispositif des esprits est dis¬ qualifié, mais il est nommé, reconnu, maintenu et même renforcé comme dispositif thérapeutique d'une guerre spirituelle menée par la secte pentecôtiste. Par ces trois pratiques, les pentecôtismes se caractérisent comme l'expression de l'émotion du pauvre, d'un sentir. Celui-ci évince tout autre énoncé possible, en particulier celui du contrat dans la tradition occidentale-libérale. Au contraire, par exemple, de la théo¬ logie de la libération, qui construisait le pauvre "conscientisé" à même d'entrer dans les luttes sociales pour l'instauration de la démocratie, ou du protestantisme missionnaire, qui prétendait former des acteurs sociaux autonomes et critiques, le pentecôtisme construit la catégorie du pauvre, non pas au plan cognitif, mais au plan émotionnel, dans un discours sur la consolation et une pratique thérapeutique au travers desquels s'atteste la véracité de la secte en tant que louange. Dans la louange, le pauvre se met dans le halo de la gloire de Dieu. Face à cette gloire si grande, les inégalités sociales paraissent si petites ; c'est un moyen d'invalider la pauvreté, de
^ Roy, 2008, p. 189.
REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES 2018, Tome 98 n° 2, p. 155 à 171
46159
s'en libérer. C'est une libération sans intentionnalité et un discours sur la souffrance pour ceux qui savent qu'ils ne peuvent en sortir. Mais ce n'est pas un discours démobilisateur ; au contraire, il s'agit d'une mobilisation des pauvres dont il faut examiner les effets sociaux. En partant de cette définition mettant en avant les caractéris¬ tiques énoncées, il n'est en aucune manière possible de réduire le phénomène à sa composante « protestante » ou « évangélique ». Il informe aussi bien des protestantismes de réveil que des pratiques catholiques émotionnelles et des messianismes autochtones. Dans tous les cas, la mobilisation des fidèles s'opère par le charisme d'un individu transformé en prophète et fondateur du mouvement religieux. Ces pasteurs-prophètes et prêtres charismatiques inscrivent la dynamique des mouvements dans le registre weberien de l'autorité religieuse dotée de charisme articulée à une autorité religieuse traditionnelle, éloignée de toute gestion démocratique du pouvoir religieux. II. Quelques données factuelles d'une expansion mondiale D'un point de vue historique, les premiers signes d'un mouve¬ ment pentecôtiste datent de la fin du xix^ siècle aux Etats-Unis, en particulier avec la formation, en 1897, à Memphis dans le Tennessee, d'une Church of God in Christ par deux pasteurs noirs-américains. Mais le moment qui fait date est l'année I90I, lorsqu'un prédi¬ cateur méthodiste, Charles Parham, de l'Institut biblique de Topeka au Kansas, anima des assemblées religieuses au cours desquelles des participants firent l'expérience du baptême de l'Esprit-Saint qui se traduisit par le parler en langues, selon le modèle de la Pentecôte biblique qui donnera son nom au mouvement. Peu après, en 1906, un prédicateur noir d'origine baptiste reproduisit les pratiques expérimentées à Topeka dans l'église qu'il fonda à Los Angeles où se produisit un réveil religieux. Comme le souligne Harvey Cox^, le pentecôtisme est né lorsque des pratiques religieuses essentielle¬ ment afro-américaines se sont intégrées au christianisme des blancs pauvres du sud des Etats-Unis. Mais le pentecôtisme naissant n'est pas un mouvement d'origine afro-américaine. Il porte la même ambigùité ou hybridité que d'autres traits culturels de la société américaine, comme par exemple le jazz ^
^Cox, 1994. ^ Cox, 1993, p. 181-187.
REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES 2018, Tome 98 n° 2, p. 155 à 171
47J.-p. BASTIAN, SOCIOLOGIE D'UN CHRISTIANISME DE L'ÉMOTION
La plasticité et l'expressivité des pratiques dans les couches sociales nord-américaines les plus défavorisées ont entraîné une rapide diffusion du mouvement dans les grandes villes américaines, suivant en cela les courants migratoires du sud pauvre vers les centres économiques du nord. Ainsi sont nées les Assemblies of God, Church of God, Foursquare Church, et bien d'autres initiatives conversionnistes enthousiastes. Au fil du xx^ siècle, ces grandes organisations ont structuré le paysage religieux contemporain nord- américain où le pentecôtisme suit les fragmentations ethniques du pays, rencontrant un écho certains au sein de la population afro- américaine, au sein des immigrés hispano-américains et parmi les blancs pauvres de la Bible belt, en particulier. Mais, contrairement aux autres régions du monde où il s'est étendu, il baigne aux États- LFnis dans un champ religieux marqué par la culture protestante. Elle l'informe dans son déploiement et son rapport aux autres mou¬ vements religieux du pays, participant d'un continuum religieux protestant, comme Richard H. Niehbur l'a clairement montré''. En même temps, une expansion par étincelles, ou par capilla¬ rité, s'est opérée rapidement durant les années 1910 et 1920 dans le reste du monde. Ainsi, en Amérique latine, la première manifesta¬ tion pentecôtiste se produisit tout au sud du continent en 1910, dans le port chilien de Valparaiso, au sein d'une communauté d'origine méthodiste en contact avec des missionnaires pentecôtistes nord- américains. Au Brésil, dés 1914, surgirent des communautés à Bélem, dans le « nordeste » du pays, et à Sào Paulo, alors qu'au Mexique des migrants revenus des champs de tomates du sud des Etats-LFnis en crise économique rapportèrent, dés 1914 aussi, la nou¬ velle expression religieuse aux périphéries des villes de Guadalajara et de Monterrey. En Afrique du sud, les premiers missionnaires pentecôtistes nord-américains arrivèrent en 1908 et les premières églises appelées « indépendantes » se formèrent, dés 1917, donnant naissance, entre autres, à la Zion Apostolic Church of South Africa fondée par le zoulou Elias Malhangu. De cette église surgiront plu¬ sieurs autres églises indépendantes africaines. Dans la diffusion du pentecôtisme africain, le rôle des pays anglophones, de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique du Sud, fut déterminant. Des pays comme le Ghana, le Nigeria, le Liberia et la Sierra Leone constituèrent des plaques tournantes de l'expansion pentecôtiste vers les pays franco¬ phones d'Afrique. Cela se produisit au travers, par exemple, du «prophète » libérien William W. Harris (dés 1913) qui se nomma « prophète des temps modernes » et parcourut le golfe de Guinée. En Côte d'Ivoire, son influence se traduisit par la fondation, par ses
■^Niebuhr, 1922.
REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES 2018, Tome 98 n° 2, p. 155 à 171
48161
disciples, VEglise harriste dans les années 1920 et par la fon¬ dation des Églises Aladura (mouvement de réveil de « priants », adura étant un terme yoruba pour désigner la prière) au Nigeria (1930), à partir desquelles se sont créées de nombreuses églises africaines au cours du xx^ siècle, contribuant à dessiner un paysage religieux foisonnant et multiple. Ainsi émergèrent les églises indé¬ pendantes, dont la Church of Pentecost du Ghana (1962), une des plus importantes multinationales religieuses africaine aujourd'hui^. CÉglise du christianisme céleste, fondée en 1947 par le « prophète » Samuel Oschoffa (7-1985) au Dahomey (Bénin aujourd'hui), est l'exemple type d'une de ces églises africaines de la seconde géné¬ ration, à cheval sur le Bénin francophone et le Nigeria anglophone. Comme l'observe l'anthropologue André Mary, plongeant « ses racines dans le cycle rituel et dans le système des interdits de la religiosité africaine, toutes ses pratiques (y compris la polygamie) trouvent toujours une justification ultime dans la Bible S>. Elle s'est rapidement transformée ainsi en une transnationale religieuse, s'introduisant au Nigeria et en Côte d'Ivoire dés 1956, puis au Togo en 1962, au Gabon, au Cameroun, au Congo et au Zaïre par la suite. Aujourd'hui, elle revendique une implantation en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en France, accompagnant les migrants africains dans un processus de re-communautarisation ethno-religieuse. En Afrique, comme ailleurs dans le monde, le pentecôtisme a pris le visage de quelques grandes entreprises religieuses transnationales et d'une multitude d'organisations plus modestes à l'échelle locale, régionale ou nationale. Toujours selon André Mary, leur croissance exponentielle s'explique « par une activité d'emprunt et de synthèse de diverses traditions religieuses^ ». Pour en revenir à l'Amérique latine, un phénomène semblable d'expansion s'est produit après la fondation de la Iglesia metodista Pentecostal (1910) au Chili, de la Congregaçâo Crista no Brasil (1910) et des Asembleias de Deus (1911) au Brésil, de la Iglesia Apostolica de la Fe en Cristo Jesùs (1914) au Mexique, entre autres initiatives. Pendant un demi-siécle, ce phénomène religieux indépendant du protestantisme missionnaire resta limité dans son expansion géographique et numérique. C'est dans les années 1960, avec l'énorme migration de populations rurales vers les métropoles latino-américaines en pleine expansion, que le pentecôtisme com¬ mença à « exploser » dans de multiples communautés urbaines au sein de secteurs sociaux immigrés aux périphéries des mégapoles
^ Fancello, 2006a. ^Mary, 2009, p. 65. ^Mary, 1999, p. 33. '^Martin, 1990.
REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES 2018, Tome 98 n° 2, p. 155 à 171
49J.-p. BASTIAN, SOCIOLOGIE D'UN CHRISTIANISME DE L'ÉMOTION
OU, en zone rurale, dans leurs foyers migratoires d'origine. Ces églises furent fondées par des dirigeants latino-américains érigés en prophètes qui donnèrent ainsi naissance, par exemple, aux églises Brazil para Crista (1955) et Deus es amor (1965) au Brésil, La Luz del Mundo (1955) au Mexique, Los Israelitas (1957) au Pérou. Pour ce qui est des grandes organisations pentecôtistes urbaines, leur expansion fut liée au recours à la radio et à des campagnes d'évangélisation de masse. Le mouvement prit de l'importance avec la fondation de nouvelles églises usant de Γ hyper-modernité médiatique tout en s'inscrivant dans un registre émotionnel puisant dans l'archaïsme religieux populaire, mettant l'accent sur le miracle et l'intercession afin d'obtenir les faveurs divines. Parmi celles-ci, notons les églises brésiliennes, telles la Igreja Universal do Reino de Deus (1977) et la Igreja Internacional da Graça de Deus (1980) ; ainsi le Brésil est-il devenu le premier pays pentecôtiste au monde avec environ 20 % de sa population, soit quelques 40 millions de pratiquants dans un univers religieux pentecôtiste à la fois frag¬ menté et capable d'élire des pasteurs-députés s'organisant en coali¬ tion politique (bancada evangélica) au Parlement dés les années 1986 jusqu'à aujourd'hui. En même temps, le pentecôtisme a pénétré l'Eglise catholique avec l'apparition de grandes communautés charis¬ matiques dont les plus fameuses sont celles du père Marcello Rossi, prêtre-faiseur de miracles à Sào Paulo dés les années 1990, et celle du père Reginaldo Manzotti à Curitiba. Aujourd'hui, on retrouve ailleurs en Amérique latine ce pentecôtisme catholique en pleine croissance, comme par exemple dans le mouvement de Renovacion carismatica catolica de Colombie avec le père Javier Riveros. Ces acteurs catholiques miment les cérémonies et les pratiques pente¬ côtistes non-catholiques, intégrant pleinement une religiosité du miracle qui n'est pas étrangère à leur tradition religieuse. On retrouve une même expansion d'un pentecôtisme catholique aux Philippines avec la communauté El Shaddai, fondée en 1984 par le frère Mariano Valverde, qui revendique aujourd'hui 3 millions de fidèles dans la capitale et dans le pays. Pour expliquer une pareille expansion, sa proximité avec la spiritualité chamanique semble déterminante ; les Philippins, ayant un système de croyances fondé sur le monde des esprits, se trouvent attirés par les pratiques pen¬ tecôtistes qui semblent plus médiatiques, sans éliminer l'univers religieux de référence, alliant l'hyper-modernité des modes de com¬ munication aux pratiques chamaniques. L'articulation du pentecô¬ tisme aux pratiques chamaniques très diffuses se manifeste de manière identique en Corée du sud, comme l'a montré Nathalie Luca^^ Le
Luca, 1997.
REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES 2018, Tome 98 n° 2, p. 155 à 171
50163
pentecôtisme y a pris racine dès les années 1960, de manière très modeste, pour connaître une expansion fulgurante dès les années 1990. À Séoul, l'Église du Plein Évangile d'Oido, fondée par le pasteur David Yongi Cho, rassemble en une seule communauté urbaine quelques 500 000 membres. La forte croissance pentecôtiste en Asie se manifeste aussi en Chine, où le mouvement reste encore sou¬ terrain. En revanche, au Japon, le pentecôtisme n'est pas parvenu à prendre pied, et, plus loin, en Inde ou en Indonésie, il ne semble pas connaître un même succès, même si sa présence se marque aussi progressivement. De fait, seul le monde musulman lui est interdit comme à tout autre mouvement religieux qui ne soit pas islamique. Pour ce qui concerne l'Europe à la sécularisation avancée, le pentecôtisme demeure un phénomène marginal bien qu'il se soit manifesté dés les années I9I0. Aujourd'hui, il intéresse principa¬ lement les immigrés africains et latino-américains qui souvent l'ont amené avec eux, mais aussi les gitans (tsiganes, roms) qui y ont adhéré massivement dès les années 1970, en Espagne {Iglesia Filadelfia en Andalousie), en France (la Mission évangélique tsigane issue des Assemblées de Dieu), en Roumanie. Là encore, la plasticité culturelle du pentecôtisme permet la reformulation de pratiques ancestrales dans un univers religieux doté de charisme La capacité à intégrer les pratiques ancestrales explique aussi la progression du pentecôtisme au sein des communautés indiennes d'Amérique latine, en zones rurales, avec la fondation d'églises ethniques comme, par exemple, la Iglesia evangélica Toba (I96I) en Argentine, où les danses traditionnelles chamaniques intègrent les pratiques pentecôtistes Ainsi, un siècle après leurs débuts, les pentecôtismes repré¬ sentent un mouvement religieux chrétien diffus à l'échelle mondiale, fissipare, divisé en dizaines de sociétés religieuses rivales, dominé par quelques grandes organisations nationales et internationales et constitué d'une infinité de petites organisations locales ou régio¬ nales Il est difficile de donner des chiffres détaillés de son expansion ; selon les recherches récentes du sociologue Sébastien Fath, qui en reste malgré tout à une compréhension confessionnelle protestante du pentecôtisme en l'incluant dans ce qu'il appelle « l'évangélisme » dont il représente la part majeure, sauf en Europe, l'Asie reste « le poumon de l'évangélisme » dans le monde, avec 62 millions de Chinois, 28 millions d'Indiens, 15 millions d'Indo¬ nésiens et 13 millions de Philippins. En Afrique, sur 165 millions
Canton Delgado, 2004. Miller, 1979. Fancello, 2006b.
REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES 2018, Tome 98 n° 2, p. 155 à 171
51164 J.-p. BASTIAN, SOCIOLOGIE D'UN CHRISTIANISME DE L'ÉMOTION d'évangéliques, 54 millions vivent au Nigeria. Suivent le Kenya (20 millions), la RD Congo (15 millions) et l'Afrique du Sud (15 millions). En Amérique latine, on compte 120 millions d'évan¬ géliques (dont 46 millions au Brésil), et 98 millions en Amérique du Nord. En Europe vivent 20 millions d'évangéliques, dont le quart au Royaume-Uni, et 600 000 fidèles réguliers en France ΙΠ. La multilatéralité des échanges dans une eogique de marché La croissance exponentielle des pentecôtismes dans le monde depuis un demi-siécle s'explique par les bouleversements sociaux provoqués par la mutation économique et l'explosion démogra¬ phique des périphéries de l'Occident. A l'expansion urbaine, à l'état d'anomie qui en découle et au manque d'encadrement religieux des populations nouvelles, répondent les pentecôtismes dans un mou¬ vement d'internationalisation du religieux. C'est une religion de migrants et de déracinés. Au début de leur expansion, les pente¬ côtismes se diffusèrent selon une logique missionnaire dont les églises-méres se trouvaient aux États Unis. Les modèles religieux importés, centrés sur un discours chargé de transmettre une vérité, étaient repris intégralement, la société religieuse pentecôtiste fonction¬ nant comme succursale d'une organisation d'origine nord-américaine. Or, durant les années 1950, ce schéma s'est brisé. Des sociétés pentecôtistes, telles les Assemblées de Dieu brésiliennes, se sont nationalisées, leur succès étant dû à leur indépendance financière De nouvelles entreprises pentecôtistes ont vu le jour et de nouveaux dirigeants dotés de charisme et d'origine nationale sont apparus. En organisant leurs propres sociétés religieuses, ceux-ci ont même ren¬ versé la tendance en exportant leurs mouvements vers les États-Unis et ont mis en place des stratégies multilatérales d'expansion en réseau aussi bien vers le reste de l'Amérique latine que vers l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Les pentecôtismes latino-américains exportent leurs pratiques et croyances alors que, jusque dans les années 1960, ils avaient été essentiellement récepteurs des initia¬ tives nord-américaines. Les pentecôtismes brésiliens en particulier ont trouvé de nouveaux marchés en Europe et en Afrique en suivant les diasporas lusophones. Étudiant le pentecôtisme guatémaltèque.
Fath, 2015 (voir le billet de L[oup] B[esmond de] S[enneville], « Dans le monde, un chrétien sur quatre est évangélique », sur le site du journal La Croix : https://www.la- croix.com/Religion/Actualite/Dans-le-monde-un-chretien-sur-quatre-est-evangelique-2015- 01-29-1274453 [page consultée le 20/04/2018]). Lehmann, 1996. Bastian, 2001 ; Silveira Campos, 1997.
REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES 2018, Tome 98 n° 2, p. 155 à 171
52165
Sylvie Pédron-Colombani souligne à juste titre « le caractère inter¬ national des cures » et le fait que certains pasteurs « guérisseurs » voyagent beaucoup, « comme si ces "guérisseurs" étaient d'autant plus efficaces qu'ils venaient d'ailleurs ^S>. En même temps, les influences exogènes perdurent, mais elles ne sont plus seulement nord-américaines. Des sociétés religieuses latino-américaines (Igreja Universal, Luz del Mundo) ou coréennes (Jonggi Cho) diffusent leurs modèles de gestion religieuse et les pentecôtismes africains s'exportent vers l'Europe en suivant les diasporas migrantes. L'usage innovant des moyens de communication de masse, combiné à une intense vie communautaire, a favorisé une expan¬ sion transnationale par capillarité. Celle-ci se révèle plus dynamique que l'expansion internationale antérieure régulée par les sociétés missionnaires ou les églises mères nord-américaines, car elle crée des réseaux relationnels et organisationnels dont les relais sont les croisades d'évangélisation, les agences humanitaires, les alliances, les conférences, les confraternités, les associations d'hommes d'affaire ou d'athlètes chrétiens, les missions, et, last but not least, les réseaux de radios et de télévision. Ainsi, au cours des années 1980, est née une économie religieuse globale issue d'une production religieuse orientée au marché La nouveauté réside dans le fait que le discours pentecôtiste s'est transformé. Il répond à une logique de marché et est construit non pas d'abord pour transmettre une vérité à l'image de l'effet produit par un discours prophétique, mais pour s'assurer d'un succès. Cette « machine narrative qui produit du succès » se caractérise par son interdépendance qui tend à dis¬ soudre la géographie historique de l'internationalisation religieuse commandée par des régulations étatiques et religieuses à la fois. On peut parler de dérégulation religieuse dans la mesure où, par exemple, l'Église catholique, pour la première fois de son histoire dans la région latino-américaine, ne parvient plus à maîtriser la religiosité des masses qui passent au pentecôtisme. De même, le protestantisme international ne régule plus les pratiques et discours pentecôtistes qui se transforment, par capillarité, dans le sens de l'hybridité. En Afrique, se produit ce qu'André Mary appelle « le bricolage africain des héros chrétiens ». La dérégulation en cours se caractérise par l'éclatement du religieux hégémonique et la multilatéralité des échanges dans une logique transnationale de marché
'^Pédron-Colombani, 1998, p. 155. Beyer, 1990 ; Poewe, 1994. ^^Corten, 1999, p. 171. Mary, 2000. Pour un développement latino-américain, voir Bastian, 2006, p. 65-80.
REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES 2018, Tome 98 n° 2, p. 155 à 171
53J.-p. BASTIAN, SOCIOLOGIE D'UN CHRISTIANISME DE L'ÉMOTION
L'univers pentecôtiste est marqué par rimprovisation, la faible régulation théologique et la fissiparité par schismes qui assurent une grande flexibilité et adaptabilité à des mouvements porteurs d'une culture religieuse populaire. Ceux-ci, en parvenant à s'ancrer à la fois dans la religiosité traditionnelle « archaïque » par les pra¬ tiques thaumaturgiques ou exorcistes et à utiliser l'hypermodemité musicale et médiatique à leur profit, sont devenus une religiosité hybride. On peut même avancer qu'ils sont une expression de ces "cultures hybrides" caractéristiques de la modernité religieuse contemporaine. Cette reformulation des expressions et des moyens de communication s'opère dans le cadre de la transnationalisation du religieux. Celle-ci conduit à une déterritorialisation du religieux à l'ancrage institutionnel faible et la fluidité forte. Elle est informée par une logique de marché qui, dans un régime concurrentiel, pousse agents et organisations religieuses à innover sans cesse afin de créer ou de stimuler la demande en créant des produits religieux qui visent la performance. Le recours aux moyens les plus modernes de communication est un instrument privilégié parce qu'il s'inscrit souvent, en contexte catholique (Amérique latine, Philippines), dans une tradition de l'image miraculeuse qu'il prolonge. Il facilite aussi la promotion, au plan national et international, d'une religiosité délocalisée dont l'usage fluctue certes en fonction des conjonctures et des contextes. Par ailleurs, la transnationalisation stimule la créativité et renforce la respectabilité des mouvements religieux d'origine nationale. Elle leur donne une légitimité symbolique et apparaît comme l'espace de référence incontournable en vue du développement d'une expression religieuse puisant simultanément dans divers registres. Elle leur permet de capturer et de mettre à profit, immédiatement, toute innovation produite et accélérée par cette mise en réseau - c'est sans doute ce qui attire les masses vers ce type de religiosité. Elle leur offre la possibilité de s'incorporer à la modernité tardive non pas au travers du projet culte d'éducation scolarisée, qui fut typique par exemple des protestantismes histo¬ riques, mais au travers de l'industrie culturelle transnationalisée fondée sur l'oralité, le spectacle et l'image. Par rapport à l'oralité première du pentecôtisme originel qui répondait à un régime de « vérité », les sociétés pentecôtistes élaborent une oralité seconde, une oralité structurée par la syntaxe audiovisuelle qui allie codes archaïques de narration et dispositifs technologiques hypermodernes de communication. Celle-ci répond à un régime de performance et de succès. En acquérant une dimension transnationale, les pente¬ côtistes sortent des ghettos de la misère où ils restaient cantonnés jusque-là pour intégrer les classes moyennes, réceptives à la « théologie de la prospérité » surgie dans les réseaux pentecôtistes
REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES 2018, Tome 98 n° 2, p. 155 à 171
54J.-p. BASTIAN, SOCIOLOGIE D'UN CHRISTIANISME DE L'ÉMOTION 167 au cours des années 1990. Loin d'être une théologie élaborée dans le sens d'une éthique protestante en affinité élective avec un « esprit du capitalisme » (Weber), cette pseudo-théologie met au cœur de la pratique religieuse l'appel au miracle économique et la pratique religieuse primaire du do ut des, visant à s'assurer les faveurs du divin selon le principe de réciprocité selon lequel il faut donner pour recevoir et que plus on donne, plus on reçoit. Cela prête à tous les scandales de détournements de fonds par les dirigeants, mais aussi à l'enrichissement de ces derniers qui deviennent les symboles emblématiques d'une réussite inaccessible au commun des fidèles. C'est une manière d'adapter les pratiques aux demandes sociales de secteurs sociaux de classe moyenne au statut économique précaire, qui cherchent dans le pentecôtisme une protection que la société ne leur offre pas et un imaginaire du salut économique par le miracle. C'est aussi, pour les organisations pentecôtistes et leurs dirigeants, un instrument d'accès à une visibilité et à une légitimité acquises durant les années 1980, qui les font aujourd'hui émerger dans l'espace public, avec des effets sociaux et politiques déjà percep¬ tibles dans certains pays, comme par exemple au Chili, où le pentecôtisme rassemblant les principales organisations du pays a été reconnu en 2000 comme corporation religieuse de droit public, et au Brésil, où, aujourd'hui, environ 15% des députés au parlement de Brasilia sont des pasteurs-prophètes.
IV. Un christianisme populaire du miracle Loin d'épuiser toutes les lectures possibles du pentecôtisme, la mise en perspective du mouvement dans les logiques de marché qui l'informent permet de souligner son caractère polymorphe qui en fait une expression religieuse particulièrement bien adaptée à la modernité tardive. Au cœur de la modernité, dans l'Europe sécula¬ risée, ce mouvement reste marginal et répond à l'incertitude et à l'atomisation individualiste que génère la modernité, par l'émotion et le lien communautaire. Il est un accroc aux théories de la sécularisation parce qu'il atteste la persistance et la vitalité des croyances. Lorsque le rationalisme et le matérialisme en particulier se généralisent au point que les individus sont confrontés de façon douloureuse à leurs effets, en particulier à la perte du sens, se développent des idéologies ou des modes de pensée religieux, c'est-à-dire des visions du monde closes, saturées de sens, comme le sont les pentecôtismes.
REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES 2018, Tome 98 n° 2, p. 155 à 171
55J.-p. BASTIAN, SOCIOLOGIE D'UN CHRISTIANISME DE L'ÉMOTION
Aux périphéries de l'Occident, en particulier là où les formes culturelles traditionnelles sont menacées par la modernité globale, le pentecôtisme favorise les recompositions religieuses. Le fond culturel de la religion dite populaire active en effet certaines poten¬ tialités du pentecôtisme souvent non exprimées dans les sociétés sécularisées où le champ religieux est encore régulé par le christia¬ nisme établi. En Amérique latine, la régulation ne s'opère plus par l'Église catholique et on peut se demander si le pentecôtisme est un cas particulièrement heureux de l'indigénisation du christianisme dans une culture populaire marquée par l'imaginaire du miracle ou s'il est la poursuite des formes les plus saillantes de la religion populaire sous un nouveau masque. Cela pourrait être le cas dans les communautés indiennes latino-américaines, où passer au pen¬ tecôtisme, ce n'est pas rompre avec la différence ethnique, mais l'affirmer en marquant le rejet de la culture catholique dominante et des pouvoirs qui lui sont liés et poursuivre sous d'autres modes les pratiques religieuses ancestrales. Il en va de même avec les tsiganes en Europe devenus pentecôtistes non pas pour adhérer à un évangile déterritorialisé, mais pour renforcer une commune appartenance ethnique et leur autonomie symbolico-culturelle. La diversité des pentecôtismes conduit enfin à se demander s'il s'agit encore d'un «protestantisme de l'émotion^A>, ou s'il ne convient pas plutôt de le considérer comme un christianisme populaire de l'émotion, qui s'est libéré de la tutelle des grandes organisations chrétiennes historiques (catholicisme, protestantisme, orthodoxie) et qui contribue à l'émiettement du christianisme et du religieux dans la modernité tardive. Cet émiettement s'accompagne, de manière générale, d'une religiosité migrante, dans un univers religieux flottant amenant les fidèles à passer d'une expression religieuse à une autre, sans conviction doctrinale, allant simplement là où le culte est le plus attrayant, le miracle le plus performant, la musique la plus rythmée et les bancs les plus confortables. Ils transitent d'un centre cultuel à un autre, à la recherche du meilleur miracle ou du meilleur spectacle. Ils participent d'un retour du christianisme vers des formes primaires d'accès au sacré, en mettant l'accent sur le miraculeux et l'inouï, et en déployant une pratique de la médiation qui rend indispensable la figure du prophète-guérisseur et de l'intercesseur. Dans ce sens, on peut, avec bon nombre de cher¬ cheurs, constater la proximité du mode de pensée et du système de représentations pentecôtiste-charismatique avec les modes de pen¬ sées et les visions du monde coutumiéres dans des sociétés où ils sont encore prégnants. Même lorsqu'il cherche à se démarquer des
Willaime, 1999.
REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES 2018, Tome 98 n° 2, p. 155 à 171
56169
cultures chamaniques et sorcellaires, on remarque que le pente- côtisme se nourrit du discours médiumnique omniprésent, tout en le reformulant dans des modes de communication hyper-modernes qui lui assurent une aura transnationale. C'est pourquoi le pentecôtisme contemporain en pleine expan¬ sion est à interroger dans son rapport au protestantisme historique en déclin. Comme l'a fort bien remarqué Jean-Paul Willaime : l'émotion est socialement instable et peut être facilement manipulée. Elle est aussi sémantiquement disponible, comme l'est l'interprétation de la glossolalie. Si le pentecôtisme représente une certaine culture de l'émotion, celle qui s'inscrit dans l'univers du christianisme protestant, cet encadrement symbolique de l'émotion peut s'effacer au profit d'une religion expérientielle, sémantiquement malléable et fluctuante au gré des eirconstanees et de l'inspiration de tel ou tel acteur. La disponi¬ bilité sémantique permet toutes sortes de codages. De là, l'émergence de groupes dont on peut légitimement se demander s'ils font partie de l'univers penteeôtiste L'interrogation finale sous-entend une définition normative du pentecôtisme par rapport à sa genèse protestante américaine, au début du xx^ siècle, ou en ayant pour référence son ancrage histo¬ rique européen, souvent lié au terreau protestant. Mais un siècle plus tard, avec la croissance exponentielle des organisations religieuses porteuses de pratiques pentecôtistes, on a affaire plutôt à un christianisme global de l'émotion. Contrairement au protestantisme, il ne laisse pas de place au théologien porteur d'une herméneutique critique et régulatrice de la doctrine ; il est un christianisme émo¬ tionnel participant de l'émiettement du religieux dans la modernité tardive. Il s'apparente, comme l'avait déjà perçu avec acuité en 1965 Pierre Chaunu dans le contexte latino-américain, à un « christianisme sans prêtre d'une partie des masses ».
Willaime, 1999, p. 9. Chaunu, 1965, p. 17.
REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES 2018, Tome 98 n° 2, p. 155 à 171
57J.-p. BASTIAN, SOCIOLOGIE D'UN CHRISTIANISME DE L'ÉMOTION
BIBLIOGRAPHIE Bastian, 2001 : Jean-Pierre Bastian (dir.), La modernité religieuse en perspeetive comparée. Europe latine - Amérique latine, Paris, Karthala, 2001. Bastian, 2006 : Jean-Pierre Bastian, « La nouvelle économie religieuse de l'Amérique latine », Social Compass 53, 2006/1, p. 65-80. Beyer, 1990 : Peter Beyer (éd.), Religion and globalization, Londres, Sage, 1990. Canton Delgado, 2004 : Manuela Canton Delgado, Gitanos penteeostales. Una mirada antropolôgica a la Iglesia Filadelfia en Andalucia, Sevilla, Signatura, 2004. Chaunu, 1965 : Pierre Chaunu, « Pour une sociologie du protestantisme latino-américain », Cahiers de Sociologie Économique (Le Havre) n° 12, mai 1965, p. 5-18. r Corten, 1995 : André Corten, Le pentecôtisme au Brésil. Emotion du pauvre et roman¬ tisme théologique, Paris, Karthala, 1995. Corten, 1999 : André Corten, « Pentecôtisme et "néo-pentecôtisme" au Brésil », Archives de Sciences Sociales des Religions n° 105, 1999, p. 163-183. Cox, 1993 : Harvey Cox, « Jazz and Pentecostalism », Archives de Sciences Sociales des Religions n° 84, 1993, p. 181-188. Cox, 1994 : Harvey Cox, Fire From Heaven. The Rise of Pentecostal Spirituality and the Reshaping of Religion in the Twenty-first Century. Reading, Addison-Wesley Publishing Company, 1994. Fancello, 2006a : Sandra Fancello, Les aventuriers du pentecôtisme ghanéen. Nation, conversion et délivrance en Afrique de l'Ouest, Paris, IRD-Karthala, 2006. Fancello, 2006b : Sandra Fancello, « "Akanité" et pentecôtisme : identité ethno- nationale et religion globale », Autrepart n° 38, 2006/2, p. 81-98. Fath, 2015 : Sébastien Fath, « 610 millions d'évangéliques en 2015 (monde) », sur le blog http://blogdesebastienfath.hautetfort.eom/archive/2015/01/21/610-millions- d-evangeliques-en-2015-monde.html ; cf. http://blogdesebastienfath.hautetfort.com/ media/02/02/1996733043.pdf [pages consultées le 20/04/2018]. Johnson - Ross, 2009 : Todd M. Johnson et Kenneth R. Ross (éd.), Atlas du christia¬ nisme global de 1910 à 2010, Edimbourg, Presse de l'Université d'Edimbourg, 2009. Lehmann, 1996 : David Lehmann, Struggle for the Spirit. Religious Transformation and Popular Culture in Brazil and Latin America, Cambridge, Polity Press, 1996. Luea, 1997 : Nathalie Euea, Le salut par le foot. Une ethnologue chez un messie coréen, Genève, Labor et Fides, 1997. Martin, 1990: David Martin, Tongues of Fire. The Explosion of Protestantism in Latin America, Cambridge, Blaekwell, 1990. Mary, 1999 : André Mary, « Culture pentecôtiste et charisme visionnaire au sein d'une Église indépendante africaine », Archives de Sciences Sociales des Religions n° 105, 1999, p. 29-50. Mary, 2000 : André Mary, Le Bricolage africain des héros chrétiens, Paris, Cerf, 2000. Mary, 2009 : André Mary, Visionnaires et prophètes de l'Afrique contemporaine. Transe initiatique, culture de la transe et charisme de délivrance, Paris, Karthala, 2009. REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES 2018, Tome 98 n° 2, p. 155 à 171
58171
Miller, 1979 : Elmer Miller, Armonia γ Disonancia en una Sociedad. Los Tobas Argen- Îinos, México, Sigio XXI, 1979. Niebuhr, 1922 : Richard H. Niebuhr, The Social Sources of Denominationalism, New York, Meridian Books, 1922. Pédron-Colombani, 1998 : Sylvie Pédron-Colombani, Le Pentecôtisme au Guatemala. Conversion et identité, Paris, C.N.R.S. Éditions, 1998. Poewe, 1994 : Karl Poewe, Charismatic Christianity as a Global Culture, Columbia, University of South Carolina Press, 1994. Roy, 2008 : Olivier Roy, La sainte ignorance. Le temps de la religion sans culture, Paris, Seuil, 2008. Silveira Campos, 1997 : Leonildo Silveira Campos, Teatro, templo e mercado. Orga- nizaçao e marketing de um empreendimento neopentecostal, Petropolis, Vozes, 1997. Willaime, 1999 : Jean-Paul Willaime, « Le pentecôtisme : contours et paradoxes d'un protestantisme émotionnel », Archives de Sciences Sociales des Religions n° 105, 1999, p. 5-28.
REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES 2018, Tome 98 n° 2, p. 155 à 171
59Positions luthériennes Théologie - Histoire - Spiritualité REVUE TRIMESTRIEEEE 16, me Chauchat - 75009 PARIS C.C.P. 24253 43 Y-Paris Rédacteur en chef : M le Professeur Matthieu ARNOLD Sommaire du n° 2018/1
• Dorothea WENDEBOURG La parole, le sacrement et les sens • Gilbert DAHAN Musique et exégèse : la mise en musique des psaumes, XVI^-XVIII® siècles • Theodor DIETER Retour sur la commémoration oecuménique des 500 ans de la Réformation 39 • Albert H. FRIEDLANDER « Frère Martin ne peut même pas me voir... » Martin Luther vu par un juif • Gérard SIEGWALT L'existence chrétienne comme combat spirituel face aux défis de la vie • Christian KRIEGER La Déclaration fraternelle du protestantisme au Judaïsme
« Cette mémoire qui engage » : éléments de contexte 85 • Ceffe mémoire qui engage. Déclaration fraternelle de la Fédération protestante de France au Judaïsme 95 • Halm KORSIA Fraternité et espérance 102 • François CLAVAIROLY Entre détresses et promesses 109 • Roland POUPIN À propos de Cette mémoire qui engage 113 • Matthieu ARNOLD Une mémoire qui engage : observations à propos de la déclaration fraternelle « Protestantisme et Judaïsme » 117
Abonnement 2018 : · France (particuliers) 35 € • France (institutions) 42 € • Étranger 47 € • de soutien 55 € Prix de ce numéro : 10 € - Franco : France 12 €, étranger 15 €
63 75
REVUE DmiSTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES 2018, Tome 98 n° 2, p. 172