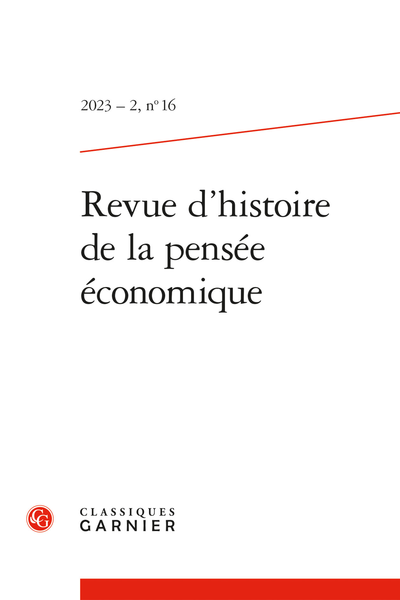
Revue des livres
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Revue d'histoire de la pensée économique
2023 – 2, n° 16. varia - Auteurs : Le Donne (Alessandro), Bensimon (Guy), Bazzoli (Laure), Desmedt (Ludovic)
- Pages : 373 à 392
- Revue : Revue d’histoire de la pensée économique
- Thème CLIL : 3340 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Histoire économique
- EAN : 9782406159971
- ISBN : 978-2-406-15997-1
- ISSN : 2495-8670
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15997-1.p.0373
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 20/12/2023
- Périodicité : Semestrielle
- Langues : Français, Anglais
Claudio Napoleoni, Discorso sull’economia politica, Nocera, Orthotes Editrice, 2019 (prima edizione Torino, Bollati Boringhieri, 1985).
Claudio Napoleoni, Discours sur l’économie politique, Édition critique par Massimo Amato, trad. Massimo Amato et Dominique Saatdjian, Paris, Classiques Garnier, Écrits sur l’économie, 2019, 190 pages.
Alessandro Le Donne
Università di Genova (Italie)
Republishing a book written more than thirty years ago may be interpreted as an archaeological reconstruction of knowledge in its best sense. This is certainly the case with the initiative of a fine publisher (Orthotes Editrice), which gives again life to the stimulating words of an Italian thinker: Claudio Napoleoni, Christian and communist, economist and philosopher, who confronted Marx with marginalism and Sraffa, always adopting critical and original positions and in close and fruitful dialogue with intellectuals and politicians. In general, the pages of his theoretical and committed publications, and the issues of Rivista Trimestrale, which he contributed to found, have left a major imprint on Italian culture.
The Discorso sull’economia politica is a challenging and rich book that summarized the reflections of a lifetime and stimulated important debates. At its heart lies the intersection between economic theory and philosophical ideas, and from the very first pages the author engages in a lively debate with Piero Sraffa’s thought and, in particular, his book Production of Commodities by means of Commodities (PCMC).
We read in the preface to PCMC that the purpose of the book is to re-establish on different basis the classical approach to political economy, “submerged and forgotten” after the advent of marginalism. As is well known, Napoleoni devoted to Classical political economy, marginalism and the respective theories of value, various essays exemplary for clarity and depth: we recall, among others, L’equilibrio economico generale (1965), Smith, Ricardo, Marx (1970) and the concise volume of the Isedi philosophical encyclopedia dealing with the theory of value: Valore (1976).
374On this basis, Napoleoni proposes his own interpretation of Sraffa’s work. The analytical rigor that he was supposed to confer to the classical approach, substituting the labor theory of value with systems of simultaneous equations, has had no other effect than proposing a method of studying economics akin to the one proper to the natural sciences. Every analysis becomes a computational problem, the model is “closed”, but the theory becomes socially silent. According to Napoleoni, this loss is unacceptable; therefore, classical concepts must be reconstructed under different interpretative lenses, and the only means to carry out this mission is recurring to philosophy. In its essence, this is a very brief sketch of the topics discussed in Discorso sull’economia politica, through which the methodological novelty of Napoleoni’s reading of Sraffa should emerge.
Then, philosophical thought becomes relevant again into the economic theory; indeed, it would be useful in answering the question about the origin of surplus, a key category in the Classical economic science, which cannot be understood, as it would happen in Sraffa, as a mere empirical quantity, being the inevitable result of the functioning of the institutions of capitalism. According to the author, both marginalism and Marxian theory have offered answers in this regard, and it is from these insights that we must start again, no longer considering them as rival, but complementary, theories. This would give rise to a “neoclassical theory of surplus”, where the latter category would be explained both by human labor and the postponement of consumption.
Marginalist authors, with an excessive recourse to abstraction, can regain contact with reality thanks to the ability of Marxian theory to open up to history; however, to do that, the notion of exploitation must be reformulated in different terms than the ones provided by what Napoleoni calls the “traditional” interpretation.
The non-contradictionprinciple, and the concepts of separation and dialectics are therefore discussed in the last part of the book, where the ideas of surplus and exploitation are redefined differently from what is commonly intended, and the critique of political economy seems to become ipso facto a critique of the capitalist system, where individuals are under the domination of the exchange value. Napoleoni suggests the need of a new subjectivism, freeing man from capitalism in a way that can never be realized just within the creation of a welfare state along Keynesian lines. In this new framework, Schumpeter’s theory would 375be essential to explain income distribution: however, Napoleoni does not develop this proposal any further.
As mentioned above, after the release of the book a lively debate took place, which the reader can approach beginning with Duccio Cavalieri’s volume Scienza economica e umanesimo positivo (Milan, Franco Angeli, 2006). Cavalieri observes that Napoleoni’s critique of capitalism, starting with the Marxian category of alienation rather than that of exploitation, has certainly broadened the horizon of reflection to the point of comparing two distant philosophers as Marx and Heidegger; but it has left undefined many important aspects of social analyses. Perhaps this weakness stems precisely from the wide purpose of Napoleoni’s inquiry, since his critique of capitalism is strictly related to the critique of the subject. Not only does the idea of surplus not find its origin in the action of human labor, nor in the action of capital, but the individuals themselves disappear in the capitalist society: the “social subjects” are no more subjects, exploited or exploiters, but characters that live in an independent mechanism. These ideas were already present in nuce in his thought in the late 1970s, as attested by the debate in the journal Rinascita in 1978–1979, and were clarified and reiterated by Napoleoni during the discussion that followed the book’s publication.
The continuous shift from the economic analysis to the ontological dimension constitutes perhaps the book’s richest element, which justifies its re-publication decades later, at a time when the heuristic capacity of marginalist economic theory appears to be in crisis; but it also raises questions about the resulting interpretation of Classical political economy and Sraffa. In this regard we propose a couple of observations.
Napoleoni suggests to go “beyond” Sraffa, trying to grasp the less obvious aspects of his “premises to a critique of economic theory”. To accomplish this task, it seems to us that the correct starting point would be “to interpret Sraffa through Sraffa”, i. e. through his unpublished papers now available, which, however, cannot be known to Napoleoni. Then, it emerges that he did not intend to reduce the economic problem to a mere matter of calculation, without any social reference. To clarify this point, textual analysis can be useful. Napoleoni wants to reformulate “traditional” concepts in different terms that, however, still relate to Hegel’s logical and linguistic structures. Sraffa, on the other hand, suggests to abandon Hegelian idealism, adopting a modern terminology 376so that the concepts are comprehensible and arouse a new emotional implication. In the note “Metaphysics,” written in 1927, when the ideas at the basis of PCMC were being defined, we read:
I foresee that the ultimate result [of the book?] will be a restatement of Marx, by substituting to his Hegelian metaphysics and terminology our own modern metaphysics and terminology: by metaphysics here I mean, I suppose, the emotions that are associated with our terminology and frames (schemi mentali) – that is, what is absolutely necessary to make the theory living (lebendig), capable of assimilation and at all intelligible.
Sraffa’s goal, then, is not the “death” of Marx, but rather a revival of it. However, a new language is essential to make intelligible a theory that in its essence is correct, but fails to “live” in today’s cultural context. In the note cited above, he also continues arguing that this change in metaphysics might give the erroneous impression that in his book the only side emphasized is the analytical one, while the historical and philosophical dimension are not relevant. Indeed, we read:
In this theory it will be thought that the important part is the analytical and constructive. The significance of the historical side will be missed. And yet, this is the truly important, that which gives us a real insight into the mystery of human mind and understanding, into the deep unknown relations of individuals between themselves and between the individual and society (the social, or rather the class mind).
Sraffa seems to say that the language used to construct a theory is essential in order to be received in a given cultural context, so to have no limits to its understanding and dissemination. Therefore, it would be possible to establish a “new” Marxian historical materialism that would fit into the intellectual debate in forms appropriate to the current scientific language. In this sense, the line of interpretation initiated by Garegnani, and brought forward by Ginzburg, which draws also a continuity between Sraffa and Gramsci’s philosophy of praxis, should be juxtaposed to and compared with Napoleoni’s view.
Our second observation is about the relationship between philosophy and economic theory in Napoleoni. He rejects Sraffa as a “new” beginning in the history of economic thought, but, at the same time, he underlines his destructive critique of neoclassical and Marxian theory of value. However, according to Napoleoni both theories still would 377maintain an adequate philosophical foundation. It seems to us that the reflection, at this point, reaches an impasse: the re-proposition of traditional concepts in different language ends up setting the analysis exclusively at the philosophical level, whereas the economic theory occupies just a residual, scarce space. Indeed, recalling the positions adopted by the philosopher Emanuele Severino, Napoleoni states that capitalism is certainly determined by historically given modes of production, but it is mostly a way of thinking, an attitude of mind; the distinction between Marx and Hegel thus becomes very subtle (p. 150).
This complex elaboration by Napoleoni certainly stimulates further reflection, and we would like to propose a possible way out of the impasse. In the complex debate around the labor theory of value, the most solid criticism, such as that of Böhm-Bawerk, did not meet an immediate, solid response, partly because of the overall defensive stance of Marxist culture at the time; as Garegnani recalls, the philosophical issues related to the exploitation of labor, in which the analytical part of the reasoning remained in the background, gained relevance. However, the revolutionary role of a philosophical thought loses its effectiveness when the dialogue with the economic science lacks; thus, the possibility of creating economic-political reflections may be carried out only with heavy limits. It seems to us that this is precisely the point where Sraffa’s contribution can be grafted: not as a critique of economic theory as such, but just of marginalist theory, opening the way to resume the fruitful part of the Classical economic thought, which Sraffa places among its sources, amended from the errors of the labor theory of value.
The Discorso sull’economia politica summarizes Claudio Napoleoni’s long critical research around economy, philosophy, the study of society and the theories that seek to describe them. The author tries to seize the meaning of Sraffa’s work, and dialogues with Sraffa’s critique of marginalist theory and his re-proposition of classical theory. Napoleoni’s position does not seem to us established on an always solid ground, but this is one of those cases in which reading a dense, clear and original contribution is recommended in virtue of the great intellectual stimulation it offers, even though it does not leave completely convinced: ultimately, this is an indispensable book, re-published at the right time.
378*
* *
Çinla Akdere, L’Arrière-plan philosophique de l’économie politique de John Stuart Mill, Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque de l’économiste, 2021, 526 pages.
Guy Bensimon
Sciences Po Genoble
La publication de l’ouvrage de Çinla Akdere est une heureuse initiative dans la mesure où il constitue une sorte de somme de la pensée philosophique de John Stuart Mill. Et il est bienvenu dans le contexte du renouveau de l’intérêt porté à l’œuvre de Mill.
L’objet de l’ouvrage est de montrer l’unité de la pensée de Mill dans les principaux domaines qu’il a explorés, l’économie politique, la philosophie morale et la philosophie politique. Cette unité est fondée sur sa philosophie des sciences inductives, plus précisément sur deux de ses aspects, selon l’auteur, les lois hétéropathiques et l’expérience spécifique (qui est le stade observationnel de la vérification du raisonnement à partir des lois). C’est dans la sélection de ces aspects de la philosophie de Mill, dans leur analyse et dans celle de leurs ramifications dans les méandres de sa pensée morale, politique et économique que réside l’originalité de l’ouvrage.
De par son objet même, ce dernier couvre des domaines très divers de la philosophie des sciences (place de la déduction et de l’induction, complexité, émergence, contrefactuelles, mondes possibles, …). L’auteur se meut avec aisance dans les débats relatifs à ces domaines qu’elle rapporte et analyse, bien que certaines formules obscures subsistent.
Outre une Préface de l’auteur, l’Introduction et la Conclusion, l’ouvrage est divisé en sept grandes sections non numérotées (on aurait préféré, d’un point de vue pratique, une division traditionnelle en parties et chapitres). Chacune des sections est l’occasion de faire état des interprétations divergentes et des controverses récentes relatives à différentes facettes de la pensée de Mill, ce qui donne un aspect « touffu » au livre, d’autant que les différents thèmes ne sont pas traités au sein d’une section ou d’un paragraphe uniques, mais traversent à peu près toutes les 379sections. Il faut saluer l’immense travail bibliographique effectué par l’auteur, tout en regrettant l’absence de références directes à des auteurs classiques en philosophie des sciences, tels Carnap, Hempel, Nagel ou Quine pour ne citer qu’eux, qui auraient permis de préciser certaines notions, notamment celle de loi scientifique. Il n’en demeure pas moins que l’interprétation de la philosophie de Mill propre à Çinla Akdere est clairement exposée et souvent rappelée.
Il est impossible de résumer ce gros volume portant sur un sujet aussi vaste. Aussi nous contenterons-nous d’indiquer l’idée principale qui s’en dégage, ainsi que quelques-unes des réflexions qu’elle suscite.
La notion centrale de l’interprétation de la pensée de Mill par l’auteur est celle d’hétéropathie causale, mentionnée dès l’introduction et qui parcourt tout le livre (par ex. p. 31 & sq., p. 108 & sq., p. 138 & sq., p. 346 & sq., etc.). Cette notion s’analyse comme il suit.
Les phénomènes économiques, moraux et politiques, et sociaux en général, ne suivent pas le principe de la composition des causes en ce sens que leurs propriétés sont différentes de celles qui résulteraient de la composition de leurs lois ou de la composition de celles, que l’on ne connaît pas toujours, de toutes leurs causes perturbatrices que l’on découvre lors de l’induction spécifique ou lors de l’expérience spécifique.
En d’autres termes, tout comme les propriétés de l’eau ne sont pas réductibles à celles de l’oxygène et de l’hydrogène, les propriétés des phénomènes sociaux ne sont pas réductibles à celles qui sont énoncées dans leurs lois et dans celles de leurs causes perturbatrices connues, ou qui en sont déduites.
Relativement aux lois économiques, morales et politiques et aux lois connues de leurs causes perturbatrices, les phénomènes économiques sont des phénomènes émergents, et les lois de ces phénomènes, en tant qu’ils sont émergents, sont les lois hétéropathiques de l’économie, mais elles nous sont inconnues.
S’agissant de l’économie politique, on peut distinguer dans l’ouvrage trois niveaux dans la construction de ses lois hétéropathiques : 1, les lois connues du désir de richesse ; 2, les lois perturbatrices (connues ou pas) qui relèvent de la morale et de la politique comme la jouissance immédiate de plaisirs coûteux et l’aversion pour le travail (voir infra) ; 3, les lois hétéropathiques de l’économie politique, encore inconnues et auxquelles on se heurte lors de l’expérience spécifique.
380Si l’on découvre ces lois hétéropathiques, on n’a plus affaire aux causes perturbatrices, et on s’affranchit de la clause ceteris paribus. Aussi, l’ouvrage consiste-t-il au fond en une réflexion sur le statut des causes perturbatrices dans la philosophie de Mill et dans son application à l’économie politique et aux sciences morales et politiques, et sur la façon dont il faut les traiter.
L’intérêt de l’approche hétéropathique développée par l’auteur est qu’elle s’appuie sur le consensus des phénomènes sociaux décrit par Mill (et par Comte), c’est-à-dire leurs interdépendances, leurs influences mutuelles et leurs corrélations : aucun phénomène social, qu’il soit économique, moral ou politique ne peut exister sans la présence des autres. D’où l’importance de la notion d’état de société chez Mill que l’auteur de l’ouvrage ne manque pas de souligner (p. 362 & sq., voir p. 270). Un état de société donné spécifie les conditions plus concrètes, économiques, morales et politiques, dans lesquelles agissent les lois universelles des phénomènes sociaux.
Finalement, l’approche hétéropathique privilégiée par l’auteur dans son interprétation de la philosophie de Mill trouve son fondement dans l’« excès » des causes perturbatrices des lois des phénomènes sociaux. La difficulté de toutes les connaître limite la connaissance possible de ces phénomènes Pour y remédier, l’auteur propose ce qu’elle appelle « deux méta-méthodes milliennes en économie » : la pensée contrefactuelle d’une part, et la pensée multidisciplinaire d’autre part.
L’écart entre les conclusions tirées des lois économiques et ce qui est observé ramènera ces conclusions au statut de propositions contrefactuelles qui définiraient un monde possible, lequel est un monde stipulé. Les lois économiques définiraient elles aussi un monde possible ou imaginaire qui n’est pas le monde réel, par exemple un monde uniquement peuplé d’hommes mus par le désir de richesse, et seulement par ce désir, dont le comportement est décrit par les affirmations sur ces hommes.
Quant à la multidisciplinarité, elle s’inscrit dans l’étape de l’expérience spécifique, qui met en évidence l’imbrication des phénomènes économiques et des autres phénomènes sociaux ; elle serait alors une garantie que les lois hétéropathiques ou les super-lois qui expliqueront le phénomène observé multi-disciplinairement seront les bonnes lois.
Parmi les réflexions que suscite cet ouvrage, retenons celles qui portent sur le statut logique des causes perturbatrices, sur la place 381de l’abstraction dans la démarche inductive et sur les méta-méthodes imaginées par Çinla Akdere.
L’auteur indique correctement les rapports que Mill établit entre les lois et les causes perturbatrices : à savoir qu’une loi ne connaît pas d’exceptions, et ce qui apparaît comme étant une exception n’est jamais que l’action d’une loi qui contrecarre l’action de la première, ce qui en fait une cause perturbatrice.
Cela dit, dès que l’on énonce une loi scientifique, la porte est ouverte à toutes sortes de causes perturbatrices, en vertu de son universalité : en effet, une loi scientifique est un énoncé qui n’est vrai que dans certaines conditions. Si ces conditions sont réunies, l’énoncé est partout et toujours vrai de tout objet de la classe des objets sur lesquels il affirme quelque chose ; par-là, l’énoncé en lequel consiste la loi est universel et ne souffre pas d’exceptions. L’essentiel, ici, est que les conditions d’une loi scientifique ne sont jamais réalisées dans la réalité, ce qui donne son caractère d’universalité à l’énoncé et qui fait qu’une loi scientifique ne peut être ni vérifiée ni réfutée par l’expérience. Si les conditions de la loi étaient réalisées dans la réalité, la vérité de l’énoncé de la loi serait limitée aux seuls objets soumis à ces conditions, et, par suite, la loi ne serait pas universelle. Chez Mill, la condition abstraite des lois économiques qu’il énonce, celles qui gouvernent le comportement des hommes dans leur quête de richesse, c’est la condition que l’homme est soumis au désir de richesse, et seulement à ce désir ; comme il l’écrit, un tel homme n’existe pas dans la réalité, c’est un homme abstrait. Les lois qu’il énonce sont des affirmations sur cet homme abstrait, ce qui fait qu’elles sont universelles. Par exemple, les énoncés « l’homme préfère une richesse plus grande à une plus petite », ou « l’homme recherche la jouissance immédiate de plaisirs coûteux » ou encore « l’homme est habité par l’aversion pour le travail » sont vraies de tous les hommes considérés comme exclusivement mus par le désir de richesse, et ont le statut de lois économiques. Dès que l’on associe à la loi une condition qui existe dans la réalité, on « perturbe » nécessairement la loi initiale. Ce qui explique que lorsque l’on associe à une loi des conditions concrètes, qui peuvent être extrêmement variées, la loi donnera naissance non pas à des régularités de comportement, mais à des irrégularités de comportement.
Une loi est donc faite pour être « perturbée » lorsque l’on conduit une recherche concrète. On peut alors se demander si ce que l’on appelle 382habituellement « causes perturbatrices » appartient à ce genre de perturbations indispensables. Dans la mesure où les lois scientifiques sont inventées pour expliquer tous les phénomènes d’une classe, quelles que soient les conditions de leur existence, et que pour expliquer un phénomène particulier de la classe, on se doit d’énoncer des conditions concrètes dans lesquelles le phénomène existe, les causes perturbatrices sont les conditions non énoncées du phénomène étudié. Ce qui veut dire que la clause ceteris paribus signifie que seules les conditions énoncées sont les conditions retenues pour l’explication du phénomène. Si l’on comprend de la sorte les causes perturbatrices, il n’y a pas de différence entre les clauses ceteris paribus et ceteris absentibus.
Il découle de tout cela que les lois hétéropathiques des phénomènes sociaux, pour autant qu’elles aient le statut de lois scientifiques, seront-elles aussi sujettes aux causes perturbatrices, sous la condition millienne que le cerveau humain ne peut prendre en compte l’immense complexité des phénomènes sociaux. Mais alors il sera impossible de s’affranchir de la clause ceteris paribus.
L’auteur a tendance à confiner l’induction chez Mill à l’expérience spécifique et à la recherche des causes perturbatrices. Cela ne semble pas exact. Quand Mill décrit la méthode déductive, dans le chapitre xi du Livre III du Système de logique, il en indique les trois opérations : 1) l’induction directe, qui conduit à l’invention des lois des causes ; 2) un raisonnement, qui consiste à déterminer, d’après les lois des causes, quel sera l’effet produit par une combinaison de ces causes ; et 3) la vérification, qui constitue la contre-épreuve de la déduction par le raisonnement.
Plus généralement, Mill indique qu’il y a deux conditions indispensables de l’induction : l’observation d’une part et l’abstraction d’autre part (chapitre 2 du livre IV), ce que l’auteur a indiqué mais n’a pas développé. À partir de l’observation des objets et par abstraction on forme une conception générale ou un concept de façon à faire surgir, comme l’écrit Mill « la lumière et l’ordre au sein des ténèbres et de la confusion ». Au fond, c’est ce qu’a voulu faire Mill avec l’économie politique.
Mill s’est donné pour but, dans l’Essai, qu’il reprend dans le Système de logique, de construire la théorie « générale » des phénomènes économiques, c’est-à-dire de construire les abstractions ultimes ou les derniers principes de cette science. Par exemple, l’homme mû par le 383désir de richesse peut être considéré comme l’abstraction à la fois du capitaliste recherchant le taux de profit maximum, du salarié recherchant le salaire le plus élevé et du propriétaire recherchant la rente la plus élevée. En créant cette abstraction « homme mû par le désir de richesse » et en énonçant ses principales propriétés sous forme de lois universelles, il se donne les moyens d’élargir le champ de la déduction à toutes les situations où se présentent des phénomènes de richesse, et pas seulement aux situations limitées par la présence de capitalistes, de salariés et de propriétaires. Pour dire les choses autrement, l’induction et les abstractions réalisées avant Mill avaient conduit l’économie politique à un certain niveau d’abstraction, et Mill a mené le processus d’abstraction à son terme. Les derniers principes sont le couronnement de l’abstraction ou de l’induction.
L’induction ne s’arrête pas à la construction de la théorie. Supposons que la théorie soit constituée, et que l’on recherche l’explication d’un phénomène concret à l’aide propositions de la théorie. La recherche consistera principalement à déterminer les conditions du phénomène, qui, associées aux lois ou à certaines d’entre elles, permettent de l’expliquer par déduction. La recherche de ces conditions est un phénomène inductif, une expérience spécifique, qui consiste à abstraire de l’environnement du phénomène étudié les conditions que l’on pense pertinentes, et dont on juge de la pertinence par le processus déductif. C’est dans cette phase déductive que les derniers principes, formulés au terme du processus d’abstraction, deviennent les premiers principes, au départ du processus déductif.
Les relations Mill-Ricardo peuvent alors se comprendre. Mill produit une théorie de l’économie, des propositions universelles sur les phénomènes économiques, qui lui permet et même lui impose d’y associer la notion d’état de société, alors que Ricardo ne fait qu’une théorie du capitalisme naissant. En admettant que les deux théories soient satisfaisantes, celle de Ricardo serait une sous-théorie de celle de Mill. En ce sens, comme le souligne l’auteur, les Principes de Mill se présentent comme une défense de l’économie politique ricardienne : il s’agit à la fois de respecter et de dépasser l’économie ricardienne, de l’élargir sur les questions de répartition et de bien-être individuel.
L’auteur a tendance à surestimer ce que peuvent apporter les contrefactuelles et les mondes possibles dans la recherche économique.
384L’utilisation des contrefactuelles est à la limite banale quand on conduit une recherche : cela se traduit par des expressions comme : « que se passerait-il si j’éliminais cette condition », « que se passerait-il si j’interdisais aux banques les opérations de marché », ou « que se passerait-il si la France sortait de l’euro », etc. Ici, on traite des questions de prédiction, et on peut y adjoindre les modalités : « [E]st-il possible que la France sorte de l’euro ? », « l’apparition de ce phénomène est-elle possible ? », « est-elle nécessaire ? »,… La réponse à ces questions ne dépend pas de la logique contrefactuelle ou des mondes possibles, mais de la science concernée.
De même, tout individu qui conduit une recherche s’est dit à un moment : « Admettons que » ou « Supposons que », ou plus généralement « Admettons que l’objet x ait la propriété P ». Ces expressions sont identiques en signification à « Faisons comme si l’objet x avait la propriété P ».
En ce qui concerne les mondes possibles, on peut se demander si la connaissance du monde réel requiert leur stipulation. Il ne faut pas confondre ici la construction d’abstractions comme moyens de la connaissance du monde réel, et la stipulation de mondes possibles. Construire une abstraction revient à définir le terme d’un objet abstrait à partir de l’observation du monde réel, et la signification du terme est donnée par la définition elle-même, sans qu’il soit besoin aucunement de recourir aux mondes possibles.
L’introduction des contrefactuelles et des mondes possibles ne fait que compliquer les questions méthodologiques qui nous intéressent, sans rien y ajouter.
Les moyens de la connaissance en sciences sociales consistent plutôt à créer des situations artificielles de recherche, fixées dans le langage, qui se substituent à l’expérimentation.
*
* *
Alessandro Stanziani, Capital Terre. Une histoire longue du monde d’après (xiie-xxie siècle), Paris, Éditions Payot & Rivages, 2021,430 p.
Laure Bazzoli
Triangle / Université Lumière-Lyon 2
Le dernier essai d’Alessandro Stanziani, Capital Terre, poursuit le travail d’économiste historien ou d’historien économiste que l’auteur a entrepris depuis longtemps en proposant une contribution stimulante et importante à l’histoire globale et à l’appréhension du capitalisme et de sa dynamique. En s’appuyant sur l’histoire du travail contraint à laquelle il a contribué 1 et en mobilisant la perspective de l’histoire globale attentive aux « entrelacements du monde » dans laquelle il s’inscrit 2, l’auteur les articule à une histoire qui n’a pas encore été vraiment écrite dans ses multiples dimensions, celle de l’environnement, de l’écologie, de la planète ; c’est ce qui conduit Thomas Piketty à intituler sa préface de l’ouvrage : Capital Terre : vive l’éco-histoire ! Sur cette base, A. Stanziani élargit en effet le champ de l’histoire économique globale et, aboutissant à une périodisation originale, souligne son apport à une histoire du capitalisme complétant ou allant au-delà des conceptions de Marx, Braudel ou Polanyi. L’ambition de l’auteur, comme le porte le titre de son essai, est alors de faire contribuer la connaissance historique du temps long à la réflexion sur le « monde d’après » et les solutions à construire face aux crises actuelles.
La grille de lecture historique de l’auteur, qui sous-tend les apports de l’essai, met ainsi en lien trois axes. Premièrement, A. Stanziani intègre tout ce à quoi les termes multiformes d’environnement ou d’écologie renvoient sous le vocable de « terre » (« au double sens de planète et de facteur de production » (p. 15)), soit : l’agriculture et les économies paysannes, les semences, les terres, l’alimentation, l’élevage, la biochimie, les sources et modalités d’exploitation des énergies, le climat et la déforestation… En combinant les différentes variables environnementales, A. Stanziani 386montre combien et comment celles-ci ont des influences réciproques sur les dynamiques historiques des économies et des sociétés, permettant de renouveler l’histoire du capitalisme. Deuxièmement, et c’est une ambition centrale de l’ouvrage, A. Stanziani relie deux domaines encore trop rarement traités ensemble que ce soit au niveau de l’analyse ou de la pratique, de la recherche ou de la politique, alors qu’ils fonctionnent en interaction depuis le début de l’histoire du capitalisme et sont au cœur des tensions (si ce n’est des contradictions) de la situation présente : le travail et l’environnement, les inégalités sociales et les crises écologiques, les objectifs de justice sociale et ceux de protection de l’environnement, bref le rouge et le vert. Cette articulation qui nous semble essentielle aujourd’hui (ce qui est de plus en plus souvent reconnu) permet à l’auteur de retravailler la définition du capitalisme et d’élargir la problématique de l’histoire économique existante. Troisièmement, A. Stanziani intègre cette articulation dans une perspective d’histoire globale, c’est-à-dire dans une approche historique non européocentrée qui souligne le rôle important des métissages (négatifs-forcés ou positifs) des cultures et du « couple infernal » Nord/Sud pour comprendre la dynamique historique. Pour A. Stanziani, il faut articuler ces deux couples – travail/environnement et Nord/Sud – pour appréhender le capitalisme et son histoire sur le temps long.
Cette grille de lecture conduit A. Stanziani à se démarquer de deux idées classiques de l’histoire économique : d’abord, celle de F. Braudel du « poids du nombre », puisque les problèmes de population apparaissent alors plus comme un symptôme que comme une cause des problèmes économiques et écologiques ; ensuite, celle de Marx du rôle de la première révolution industrielle et d’une vision exclusivement industrielle du capitalisme, puisque d’une part, l’histoire du capitalisme doit intégrer celle de l’agriculture, des économies paysannes et de l’alimentation qui ne peut être une histoire secondaire (le présent nous le rappelle), et d’autre part, la rupture majeure dans le fonctionnement du capitalisme, dès lors que l’on prend en compte le couple travail/environnement, est de fait la seconde révolution industrielle qui associe la rationalisation et le productivisme tant dans l’agriculture que l’industrie et qui lance la seule véritable transition énergétique, où les sources d’énergie non liées au travail humain et animal deviennent dominantes. De cette double relativisation résulte d’abord une conception du capitalisme qui met en 387avant deux processus spécifiques à cette forme d’économie et de société : le premier, dans la lignée de Braudel et Sombart, est la finance – la financiarisation du capital – qui induit une logique monopolistique, spéculative et de privatisation des communs ; le second, l’apport spécifique de l’ouvrage – un mode d’usage des ressources fondamentales que sont le travail et l’environnement (la terre et ses produits) marqué par l’extraction-exploitation créant inégalités fortes et « insouciance par rapport aux ressources naturelles » (p. 334). Sur cette base, A. Stanziani découpe l’histoire du capitalisme en trois grandes phases cohérentes avec sa grille de lecture.
Une première phase, le « capitalisme aristocratique » – reposant sur une convergence entre ancienne aristocratie foncière et nouvelles formes de capital – couvre une longue période (12e-19e siècle) qui met dans un même ensemble la période médiévale, le développement du capitalisme marchand et la première révolution industrielle. Selon les trois dimensions sur lesquelles l’auteur construit son analyse, ce qui caractérise cette phase peut être synthétisé ainsi : une faible pollution (globale mais forte par tête, ce qui peut renvoyer à l’idée de « croissance verte ») avec superposition des sources d’énergie, accaparement encore limité des terres (où la pluriactivité paysanne domine) et marchés encastrés avec logique des communs (terres communes et réserves publiques) contribuant à réduire l’aléa écologique ; une croissance intensive en travail (humain et animal) au Nord avec fortes inégalités, un travail essentiellement contraint à l’échelle de la planète et une extraction violente des ressources dans les colonies ; une longue période de métissage des cultures idéelles et matérielles ancré d’abord dans les échanges autour des routes de la soie puis dans le nouveau commerce atlantique.
La seconde phase, le « capitalisme productiviste » – mettant en scène une économie dorénavant intensive en capital – couvre un siècle (1870-1970) et est marquée par la « grande divergence » Nord-Sud avec une « grande accélération » menant à la suprématie de l’Occident. Si c’est la seconde révolution industrielle qui est décisive, c’est d’abord parce qu’elle marque une rupture dans l’exploitation des ressources de la planète : c’est le début de l’usage massif des ressources non renouvelables et fossiles, de la « modernisation » de l’agriculture avec domination des gros producteurs et éclatement-prolétarisation de la paysannerie au Nord, et de la dérégulation des bourses de commerce et des matières 388premières. De plus, cette phase contraste un régime intensif en capital avec le développement de l’État social au Nord et un régime intensif en travail contraint et exploitation impérialiste au Sud, montrant la « violence de la grande transformation » (p. 233) dès lors que l’on comprend que l’exploitation du Sud est la contrepartie de la régulation du marché du travail du Nord.
Enfin la troisième phase, le « capitalisme sauvage » ou « économie de casino », nous mène jusqu’au monde d’après (1970-2050). Marquée par la « haute globalisation », c’est-à-dire une spéculation effrénée qui s’étend aux terres et nous fait entrer dans le « paradigme de l’accaparement » (p. 26) qui s’oppose à celui des communs, le productivisme s’étend au Sud post-colonial, l’intensification de l’agriculture et la dégradation des écosystèmes sous-tendent les fléaux environnementaux (avec une remise en cause de la frontière homme/animal comme « effet boomerang », p. 300), tandis que de nouveaux cercles vicieux touchent les rendements agricoles. Par ailleurs, « la fin de la décolonisation s’accompagne de la crise de l’État social et du succès du néo-libéralisme à l’échelle mondiale » (p. 235), induisant un accroissement des inégalités riches/pauvres tant internes qu’externes. Dans cette phase, éclate au grand jour le lien fondamental entre la logique spéculative-extractive du capitalisme, les inégalités sociales croissantes, et les problèmes écologiques.
On voit bien à l’œuvre dans cette périodisation les mouvements croisés des deux couples – travail/environnement et Nord/Sud – qui selon A. Stanziani permettent de comprendre le nœud actuel de contradictions auxquelles conduit le capitalisme néo-libéral et qui se traduit dans une triple crise : sociale, écologique et démocratique. « Le problème est que si égalité et environnement semblent incompatibles, c’est parce que le système dans lequel nous vivons les a structurés ainsi », telle est la conclusion centrale à laquelle aboutit l’auteur (p. 333). Et comme pour A. Stanziani « penser le temps » c’est aussi « s’approprier le futur » dans une « perspective globale » (p. 19), ce travail historique ouvre sur une contribution à la réflexion sur les changements à mener pour construire le « monde d’après » (dernier chapitre et conclusion) : la nécessité de rendre compatible justice sociale et protection de l’environnement (soutenabilité-durabilité écologique) implique de rompre avec la logique spéculative et extractive au cœur du capitalisme – donc pose la question de sortir du capitalisme, de transiter vers un autre système historique 389abolissant bourses de marchandises, brevets sur les plantes et privatisation des semences, accaparement des terres et spéculation sur les produits virtuels. L’auteur consacre alors sa conclusion à ce que les chercheurs en sciences sociales, histoire, économie et philosophie peuvent apporter aux solutions à construire : contribuer à changer notre vision en élaborant une « nouvelle économie politique », qui repense la philosophie politique et l’anthropologie de l’économie.
L’essai proposé par A. Stanziani nous apparaît être, sur son versant positif, une étape importante pour développer une histoire économique globale plus complète réinvestissant l’histoire agricole et environnementale et mettant au premier plan le mode d’usage des deux ressources fondamentales, travail et terre. On peut certes discuter de la périodisation du capitalisme, non pas tant sur la relativisation de la 1re RI (l’ouvrage ajoute des arguments à celle-ci), que sur la première longue période identifiée que l’auteur cherche à « désenclaver » pour l’« inscrire dans l’histoire longue du capitalisme » (p. 114). De fait, elle gomme la bascule que l’on peut aussi repérer aux 16e et 17e siècles où l’Europe change de place dans les relations économiques et politiques mondiales et développe sous forme d’un capitalisme marchand un mode d’articulation spécifique entre pouvoir politique et pouvoir économique : or, cela impacte tant l’interne que l’externe en sous-tendant la « force de la violence et de la contrainte » (p. 123) et en transformant nous semble-t-il les modalités des métissages culturels par rapport à la période médiévale 3. On peut aussi se demander si finalement, l’histoire longue du capitalisme ne pourrait pas se résumer à deux grandes périodes, celle que l’on vient d’évoquer, et une seconde qui couvrirait de 1870 à aujourd’hui et renverrait à une phase de « capitalocène » (mais en perdant probablement de la finesse dans les mouvements croisés travail/environnement et Nord/Sud). Toute périodisation étant relative à l’angle d’attaque choisi, on partage avec l’auteur le refus de substantialiser la périodisation (« le métier d’historien ne consiste pas à figer le temps mais à la problématiser » (p. 28)). Le travail d’A. Stanziani a le mérite d’écrire une histoire longue du capitalisme 390mettant au premier plan le mode d’usage des ressources lié la « financiarisation sur fond de marchés non concurrentiels » (p. 333), qui permet de contribuer intelligemment aux débats du présent.
Concernant ceux-ci et d’un point de vue normatif, l’auteur ne se concentre pas sur la recommandation de politiques publiques : s’il souligne les limites radicales des politiques « vertes » (fiscalité verte, croissance verte …) et l’insuffisance de « l’idée d’un capitalisme moral […] revenue à la mode » (p. 323), il s’attache en amont à la nécessité de « changer nos manières de raisonner » sur l’économie. L’enjeu est pour lui de remettre au premier plan la question des valeurs et la centralité du travail, la réflexion sur les buts de l’économie et les critères de justice, auxquels on pourrait ajouter ceux de durabilité. A. Stanziani convoque alors Kant (dans sa perspective de « citoyen du monde »), Rousseau (dans son potentiel de dépassement de la fracture nature/culture) et Sen (comme base pour envisager comme un tout les droits et capacités économiques, sociaux et politiques) afin d’initier cette réflexion dans sa conclusion. Celle-ci convainc sur les limites aujourd’hui des idées et idéaux réformistes typiques du début du 20e siècle, celui d’un « capitalisme régulé » (à la Keynes), d’un capitalisme qui pourrait être rendu raisonnable (à la Commons), face aux contradictions du régime capitaliste globalisé et ses impacts humains et environnementaux, probablement parce que ces idéaux se sont essentiellement focalisés sur le travail alors qu’aujourd’hui c’est l’articulation des problèmes du travail et des problèmes écologiques qu’il faut penser (en théorie) et résoudre (en pratique). Il nous semble cependant qu’un grand philosophe du début du 20e siècle, John Dewey, extrêmement mobilisé aujourd’hui en philosophie et sciences sociales pour penser le présent, devrait être intégré dans ces références pour fonder nos représentations du « monde d’après », car en centrant sa philosophie de l’expérience sur le « processus de vie », il va plus loin que ses contemporains : sa philosophie sociale et politique cherche justement à penser la subordination des processus économiques à la fois aux valeurs (critère de justice sociale), aux besoins communs (critère de durabilité) et à la démocratie (critère d’extension des droits et de la participation). C’est bien l’enjeu selon nous vers lequel tend un récit de la longue durée tel que celui proposé par A. Stanziani : identifier les conditions qui permettent de construire une société meilleure sur une planète vivable, étant entendu qu’une « solution commune 391est désormais impérative à l’ensemble de l’humanité » (p. 19) ce qui implique un regard global, donc de « mettre l’accent sur les influences mutuelles entre des parties différentes du monde menant au métissage de leurs valeurs respectives » (p. 359).
*
* *
Jacques Mistral, Guerre et paix entre les monnaies. Économie et géopolitique au xxie siècle. Édition revue et augmentée, Paris, Folio Actuel, 2021, 368 pages.
Ludovic Desmedt
LEDI / Université de Bourgogne
La première édition du livre de Jacques Mistral date de 2014 et l’auteur a actualisé son travail pour cette nouvelle édition en format poche. De fait, depuis dix ans, la chronique de la mondialisation s’est considérablement enrichie, avec les événements Brexit, Trump, cryptomonnaies, Covid… À travers les périodes, les notions de pouvoir, souveraineté, hégémonie, institutions organisent le propos car un constat sous-tend l’ensemble du livre : « La monnaie et la politique sont en effet, toujours et partout, intimement mêlées » (p. 16). L’intérêt de l’ouvrage est de proposer une synthèse remarquablement claire sur plusieurs siècles, avec une construction en trois parties : 1) monnaie internationale et mondialisation 2) un monde multi-monétaire 3) multilatéralisme et monnaies internationales.
Il est d’abord question de l’étalon-or et de la prééminence britannique, de la montée en puissance de l’Allemagne et des États-Unis, des deux guerres mondiales, puis de l’installation et de la désagrégation de Bretton Woods. Puis, J. Mistral détaille précisément les changements intervenus depuis les années 1980, la montée des émergents et les conséquences monétaires et financières des glissements dans la répartition du pouvoir économique.
392Au premier abord, il est peu question d’histoire de la pensée, mais le lecteur saisit parfaitement le rôle majeur des idées. En premier lieu, on perçoit que le « réflexe » mercantiliste rejaillit à chaque crise importante. À propos du xxie siècle, Mistral souligne d’ailleurs « les noces tardives, et inattendues, de la mondialisation et du mercantilisme » (p. 30), thème parfaitement illustré à de nombreuses reprises, sur tous les continents ou presque. En second lieu, l’histoire racontée est incarnée, avec une insistance sur le rôle joué par les convictions de personnages tels que Keynes, White, Triffin, Werner, Draghi ou Den Xiao Ping, Xi Jinping, Trump, May… Des moments clés tels que la conférence de Bretton Woods, la crise des subprimes ou celle de la zone euro sont parfaitement mis en perspective et J. Mistral souligne les interventions décisives de certains acteurs.
Un petit bémol à propos de la bibliographie : certes, elle est précisément recensée dans un « essai » qui présente les principales sources en fin de volume, mais on aurait aimé parfois se référer à des notes de bas de page pour des citations ou événements. En même temps, on comprend ce choix qui allège la lecture d’un livre rédigé dans un style très alerte qui ne néglige jamais les analyses saillantes.
1 A. Stanziani (sous la dir.), 2010, Le travail contraint en Asie et en Europe (17e-20e siècle), Paris, Éditions de la MSH ; A. Stanziani, 2020, Les métamorphoses du travail contraint. Une histoire globale (18e-19e siècle), Paris, Presses de Sciences Po.
2 A. Stanziani, 2018, Les entrelacements du monde. Histoire globale, pensée globale, Pairs, CNRS Éditions ; A. Stanziani, 2012, Bâtisseurs d’empires. Russie, Chine et Inde à la croisée des mondes (15e-19e siècle), Paris, Raisons d’agir.
3 Cette remarque suggère aussi qu’il n’est pas forcément évident de tenir ensemble les deux couples pour construire la périodisation historique, la bascule du 16e siècle étant surtout importante pour le couple Nord-Sud et n’en constituant pas une de fait pour le couple travail-environnement, ce qui explique que la « grande divergence » Nord-Sud ne s’observe qu’au 19e siècle, contribuant au choix de l’auteur de faire une seule période des 12e-19e siècles même si sa genèse commence au 16e siècle.