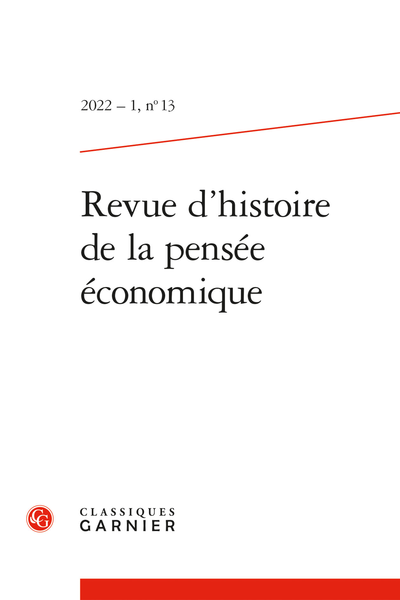
Revue des livres
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Revue d’histoire de la pensée économique
2022 – 1, n° 13. varia - Auteurs : Boyer (Jean-Daniel), Ravix (Joël Thomas), Demeulemeester (Samuel), Friboulet (Jean-Jacques), Champs (Emmanuelle de), Hurtado (Jimena), Diatkine (Sylvie)
- Pages : 425 à 458
- Revue : Revue d’histoire de la pensée économique
- Thème CLIL : 3340 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Histoire économique
- EAN : 9782406132547
- ISBN : 978-2-406-13254-7
- ISSN : 2495-8670
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-13254-7.p.0425
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 01/06/2022
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Daniel Diatkine, Adam Smith. La découverte du capitalisme et de ses limites, Paris, Éditions du Seuil, 2019, 336 pages.
Jean-Daniel Boyer
Université de Strasbourg, BETA – UMR CNRS 7522
L’ouvrage de Daniel Diatkine était attendu par ceux qui ont pu suivre ses interventions lors de colloques ou de journées d’études au cours de ces dernières années. Il permet de donner une vue d’ensemble de ses travaux sur Smith et de rendre compte de son approche articulant, de manière originale, les perspectives économiques et politiques, sans oublier la philosophie morale.
Daniel Diatkine rappelle d’emblée que la Richesse des nations a été écrite pour les législateurs et les citoyens, « contre les privilégiés et les privilèges », contre le système mercantile et son caractère partial. Il souligne en outre que, pour Smith, « au-delà des expédients ou même de la corruption pure, il existe un lien d’accointance intellectuelle entre les législateurs (et donc les citoyens) et les marchands (ou les capitalistes) » (Diatkine, 2019, p. 7-9). Les perspectives sont ainsi clairement établies et visent à faire de Smith un critique de l’économie politique de son temps et plus généralement du capitalisme.
L’ouvrage est articulé autour de trois parties.
La première dénommée « La justice et l’enrichissement », ancre la Richesse des nations dans les réflexions morales et politiques de son auteur. Daniel Diatkine interroge dans un premier temps la nature des idées libérales de Smith (chapitre 1). Il rappelle au préalable que le libéralisme est une doctrine et revient brièvement sur la transformation de sa terminologie aux dix-huitième et dix-neuvième siècles comme sur la progressive affirmation de son sens économique. Malgré le caractère anachronique du terme, Smith peut apparaître comme un libéral dans un sens politique car il suppose que « personne ne connaît mieux ses intérêts privés que le citoyen concerné » (Diatkine, 2019, p. 36), défend le droit de propriété, critique les monopoles et les privilèges, et juge 426que la défense de la valeur d’une monnaie sur le marché des changes est inutile. Néanmoins, des caractères l’en distinguent. Smith raisonne, en effet, en supposant l’existence de classes sociales dont l’une, la classe marchande, parviendrait à faire croire que ses intérêts sont compatibles avec l’intérêt général et le bien commun. Dans un deuxième moment, l’auteur propose une réflexion sur les promesses et le sentiment d’obligation (chapitre 2). En revenant sur le Traité de la nature humaine de David Hume, il suggère que l’obéissance aux lois ne se fait pas pour une question d’utilité générale. Il interroge alors les raisons de l’obligation prise dans le jugement moral et le respect des règles générales. Il montre que Smith propose une réponse dissemblable de celle de Hume : elle est fondée sur la sympathie et le spectateur impartial. Par ce fait, elle transformerait la théorie de la justice et réhabiliterait la cupidité et, par extension, l’accumulation du capital. La philosophie morale de Smith permettrait en outre de définir les règles des jeux sociaux, économiques et politiques tout comme celles du jeu du système capitaliste (chapitre 3). Le désir illimité des richesses est dès lors relié à des motivations relevant de l’amour du système et non de l’utilité. Cet amour du système animerait les grands hommes politiques comme les marchands. Il expliquerait l’affirmation du système mercantile, produit de « la rencontre de deux amateurs de systèmes, celle des entrepreneurs et des hommes politiques » (Diatkine, 2019, p. 97).
Le seconde partie, véritable cœur de l’ouvrage, est intitulée “The very violent attack I had made upon the whole commercial system in Great Britain”. Elle cherche à qualifier la teneur de la Richesse des nations et à centrer le propos sur l’adversaire de Smith c’est-à-dire sur le système mercantile, produit de l’histoire européenne et résultat non intentionnel des actions humaines (chapitre 4). Outre la recherche des excédents commerciaux posée comme objectif de politique économique, le système mercantile se caractérise par la promotion du commerce colonial de l’exclusif et des compagnies à privilèges. Remettant en cause « l’identification désastreuse du marchand et du souverain » (Diatkine, 2019, p. 130), Daniel Diatkine rappelle que Smith était un fervent critique des politiques mercantiles de son temps. Il les considérait comme néfastes à l’enrichissement général en témoigne l’exemple historique du Bengale dans lequel le déclin économique se combinait avec les surprofits de l’East India Company. Si les excédents commerciaux ne 427pouvaient constituer un objectif de politique économique, le change ne devait pas non plus être l’objet de manipulations. Outre les effets relatifs à la structuration du système économique, l’auteur les complète par l’examen des conséquences politiques du système des marchands (chapitre 5). Il en propose une contextualisation, évoquant les débats politiques de l’époque, le whiggisme et l’originalité des positions de Smith. Il revient égalementsur la crise économique et financière de 1772 en soulignant son aspect polymorphe, en relation avec le développement économique de la Grande-Bretagne, les projets de la Compagnie des Indes orientales, le Bengale et ce, non sans rappeler les effets qu’elle eut sur le soulèvement des colons américains. Daniel Diatkine évoque enfin les conséquences politiques d’un surinvestissement dans la branche coloniale laquelle était de nature à engendrer l’apoplexie du corps politique qui résultait « non pas de la suppression des marchés coloniaux [protégés], mais de l’amplification politique procédant de l’anticipation de cette perte » (Diatkine, 2019, p. 144). Il montre ainsi que l’objectif de Smith était de refonder l’empire britannique sur un idéal : celui du système de la liberté naturelle ; celui d’un empire représentatif valorisant la tolérance religieuse et prévenant la partialité comme la confusion des intérêts marchands avec l’intérêt général expliquant que le législateur doive se situer à bonne distance des marchands.
La troisième partie revient sur « le marché et l’accumulation de capital ». Elle rappelle que, dans une économie de marché, « les relations de chose à chose remplacent les relations d’homme à homme » (Diatkine, 2019, p. 194). L’économie de marché est de ce fait caractérisée par l’anonymat des rapports marchands qui la distingue de l’état primitif des sociétés (chapitre 6). Le septième chapitre revient sur l’accumulation du capital et ses dynamiques. L’auteur y souligne que Smith réhabilite partiellement le désir d’enrichissement via l’accumulation de capital et qu’il cherche à prouver que « l’accumulation du capital engendre une tendance à la baisse du taux de profit », « une augmentation des taux de rente et des taux de salaires », rendant nécessaire « le commerce extérieur pour éviter la baisse du taux de profit » (Diatkine, 2019, p. 225). Dans cette dynamique, Daniel Diatkine évoque les possibles « désordres de l’accumulation du capital » (chapitre 8) en revenant sur le rapport salarial et sur le régime monétaire et financier comme sur le rôle du banquier et sa nécessaire prudence, devant être fondée sur des 428relations privées et directes, et sur un collatéral solide, expliquant sa défense d’un taux légal de l’intérêt à laquelle s’opposera Bentham dans sa Défense de l’usure de 1787.
À la lecture de l’ouvrage de Daniel Diatkine, il apparaît très clairement, et de manière tout à fait convaincante, que Smith se pose en critique du système mercantile et, par extension, du capitalisme marchand peut-être trop rapidement dénommé « capitalisme ». Smith est en effet bien moins le critique d’un capitalisme productiviste fondé sur la division du travail, l’accumulation du capital, l’épargne et le réinvestissement des profits ; caractères qui lui vaudront, dès 1804, la réprobation de Lauderdrale dans son Inquiryinto the Nature and Origin of Public Wealth.
*
* *
Victor Riqueti, marquis de Mirabeau, François Quesnay, Théorie de l’impôt suivi de Supplément à la Théorie de l’impôt, édités et présentés par Pierre Le Masne, Genève, Éditions Slatkine, 2020, 476 pages.
Joël Thomas Ravix
Université Côte d’Azur, GREDEG – UMR CNRS 7321
Cet ouvrage est le quatorzième volume de la collection « Naissance de l’économie politique » des éditions Slatkine qui, depuis dix ans, réédite des textes anciens et rares d’économistes, principalement du xviiie siècle. Cette collection regroupe des ouvrages accompagnés d’une présentation historique et analytique des textes et de leurs auteurs. Elle offre ainsi à ceux qui s’intéressent à l’histoire de la pensée économique un outil irremplaçable, associant une grande précision éditoriale (concernant les variantes, les corrections, les diverses éditions, etc.) à une remise en contexte indispensable pour comprendre la genèse, les incidences théoriques et la portée socio-historique de chacun des textes. L’édition critique réalisée par Pierre Le Masne de la Théorie de l’impôt (1760) et du 429Supplément à la Théorie de l’impôt (1776) de Mirabeau et Quesnay, s’inscrit pleinement dans cette perspective et vient enrichir cette belle collection.
L’intérêt de l’ouvrage est double : d’une part, il regroupe sous un même volume, les deux principaux textes physiocratiques sur la question centrale de l’impôt ; d’autre part, il est accompagné d’un ensemble important de notes qui rendent en particulier possible l’appréciation de la contribution précise de Quesnay. Publiés à seize ans d’intervalle, ces deux textes permettent de se faire une idée complète des fondements, mais aussi de l’évolution de la pensée physiocratique sur un des sujets importants qui ont animé les débats en France entre la fin du xviie siècle et la Révolution.
La présentation générale de 39 pages, rédigée par Pierre Le Masne, s’accompagne d’un index, d’une bibliographie de plus de 150 références, d’une annexe très utile puisque rappelant les principaux traits de la fiscalité française au milieu du xviiie siècle, ainsi que d’une note sur les éditions retenues et les règles de transcriptions utilisées. Logiquement, cette présentation consacre une partie à chacun des textes.
La première partie porte sur la Théorie de l’impôt, publiée en décembre 1760, sans mention de nom d’auteur, de lieu d’édition ou encore d’éditeur. Elle insiste sur le fait que l’ouvrage a été rapidement attribué à Mirabeau, alors même que Quesnay en avait étroitement dirigé la rédaction, comme le confirment ses très nombreuses notes reproduites dans cette nouvelle édition. De même, trois autres contributeurs sont intervenus à des degrés divers dans le texte. Il s’agit de Butré, Le Grand et Morin, dont les noms figurent donc sur la couverture comme auteurs secondaires. En mobilisant la correspondance de Mirabeau ainsi que d’autres sources, Pierre Le Masne retrace en détails les conditions de la collaboration entre les deux principaux auteurs en montrant que « Mirabeau rédige, mais que Quesnay dirige » (p. 10). Il rappelle également qu’en dépit de cette étroite collaboration, seul Mirabeau sera inquiété par la publication de l’ouvrage. En effet, arrêté le 17 décembre 1760 et incarcéré au château de Vincennes, Mirabeau est libéré le 24 décembre de la même année. Son emprisonnement ne dure donc que quelques jours, mais il est ensuite exilé hors de Paris, dans sa propriété de Bignon, jusqu’en février 1761. Le Pouvoir lui reproche son « ton trop libre vis-à-vis du roi » et « sa critique des fermiers généraux » (p. 12). Les deux éditeurs sont également condamnés, car « le livre n’a fait l’objet d’aucune demande de permission de publier » (p. 13).
430Pierre Le Masne considère que la Théorie de l’impôt présente trois types d’intérêts. Le premier est de proposer une présentation générale de la doctrine économique et fiscale de la physiocratie, dont l’originalité repose sur un impôt unique prélevé sur le produit net, c’est-à-dire sur le seul revenu des propriétaires fonciers. La démarche retenue par Mirabeau et Quesnay s’appuie en particulier sur une critique du système fiscal d’Ancien Régime et du rôle de la Ferme générale. Le deuxième intérêt concerne les tableaux chiffrés retenus par les auteurs qui sont « supérieurs à ce qu’a produit Vauban au début du xviiie siècle et constituent un progrès comptable important, avant la publication des Comptes d’Antoine Laurent de Lavoisier en 1791 » (p. 15). Ces tableaux s’inscrivent dans l’histoire de la comptabilité nationale et en marquent une étape importante. Le troisième type d’intérêt est la place occupée par la Théorie de l’impôt dans l’histoire de la période qui court jusqu’à la Révolution française. Pierre Le Masne rappelle en effet que « certaines idées physiocratiques sont reprises par la Révolution française et certains principes de la Théorie de l’impôt se retrouvent dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » (ibid.). Toutefois, les raisons de la persistance de certaines de ces thèses, alors même que le mouvement physiocratique n’existe plus, ne sont pas véritablement explicitées. Il semble que le clivage retenu renvoie à l’opposition entre impôt sur le revenu et impôt sur la consommation, sans proposer de réflexion plus approfondie sur le concept même de revenu.
Il devient alors possible de montrer que l’influence de l’idée physiocratique d’un impôt unique portant sur le revenu parcours toute l’histoire de la pensée économique jusqu’à nos jours. Ainsi, Le Masne indique que Léon Walras fait explicitement référence aux physiocrates lorsqu’il justifie son idée d’un impôt unique sur les fermages. De même, les socialistes de la seconde moitié du xixe siècle, et Proudhon en particulier, reprennent le principe d’une fiscalité taxant les seuls revenus fonciers des plus aisés et non la consommation qui affecterait les plus modestes. Jusqu’à « la mise en avant par Keynes de l’impôt sur le revenu [qui] est différente de celle des Physiocrates, mais il n’est pas interdit d’y voir [une] influence indirecte » (p. 27-28). On peut toutefois rester dubitatif face à cette volonté d’attribuer aux Physiocrates la paternité d’une conception triviale dont l’origine est certainement plus ancienne.
431La seconde partie de la présentation est consacrée au Supplément à la Théorie de l’impôt, publié en 1776. Il est possible de remarquer que, dans l’intervalle de seize années séparant les deux ouvrages, la question de l’impôt n’a pas disparu. Elle reste largement débattue dans les milieux économistes, comme le montre par exemple le sujet sur « l’effet de l’impôt indirect sur le revenu des propriétaires de biens-fonds », proposé par Turgot au concours de la Société royale d’agriculture de Limoges de 1767, au terme duquel ont été primés le mémoire physiocratique de Saint-Péravy, mais aussi celui anti-physiocratique de Graslin. Cette question anime également les mardis économiques organisés chez le marquis de Mirabeau puisque, la même année, dans une lettre adressée à Dupont de Nemours, Turgot écrit : « M. de Mirabeau m’a proposé, mon cher Du Pont, d’aller entendre un Mémoire sur l’impôt au mardi économique. Je vous prie de m’excuser auprès de lui. Mon rhume continue et je veux le vaincre par la famine1 ».
Cependant, Pierre Le Masne laisse cette perspective de côté pour se concentrer sur les difficultés de publication rencontrées par Mirabeau. Il montre que « le Supplément, à la différence de la Théorie de l’impôt, n’a pas été un succès de librairie » (p. 28). Il analyse donc en détail les conditions de rédaction et de publication qui, selon lui, expliquent que Mirabeau se montre peu satisfait d’une édition dont il n’a pas pu contrôler la réalisation matérielle. Mais, le point important est qu’en raison de son décès survenu en 1774, Quesnay n’a pas participé à la rédaction de l’ouvrage. Il en résulte que le Supplément introduit un certain nombre de révisions par rapport à la Théorie de l’impôt, à propos desquels Le Masne observe que « les apports sont plus substantiels en matière politique qu’en matière économique » et que « Mirabeau s’exprime souvent de façon plus conservatrice que dans les travaux précédents écrits avec Quesnay » (p. 31). Ces deux aspects sont traités séparément alors qu’il est possible d’y voir un retour de Mirabeau aux préoccupations politiques qui étaient les siennes avant sa rencontre et sa collaboration avec Quesnay. En particulier, le lien qu’il établit entre la dimension économique et la dimension politique de l’impôt, explique sans doute pourquoi il revient à l’idée d’assemblées municipales qu’il avait déjà abordée dans son Mémoire concernant l’utilité des États provinciaux (1750) et 432dans son Traité de la monarchie, resté à l’état de manuscrit, avec des notes de Quesnay. Dans l’édition qu’il en a donnée en 1999, Gino Longhitano2 précise la nature du clivage qui séparait Mirabeau et Quesnay dans leur manière d’appréhender les questions politiques. Un approfondissement de ce clivage aurait pu permettre, peut-être, de mieux comprendre les raisons qui ont incité Mirabeau à publier un Supplément à la Théorie de l’impôt, après la disparition de François Quesnay.
La présentation proposée par Pierre Le Masne, malgré toutes ses qualités et sa précision, n’apporte pas toujours de réponse aux diverses questions que cette double édition soulève. Elle pique néanmoins suffisamment la curiosité du lecteur pour l’inciter à approfondir le problème de la fiscalité au xviiie siècle, sujet important de l’histoire de la pensée économique.
*
* *
Irving Fisher, 100 % Monnaie. Édition française par André Tiran et Marc Laudet, Classiques Garnier, Paris, 2019, 283 pages, traduite depuis l’œuvre originale : Irving Fisher, 100% Money, New Haven, City Printing Company, 1945 (1re édition, 1935).
Samuel Demeulemeester
ENS Lyon, Triangle –
UMR CNRS 5206
Cette édition en français du livre 100% Money d’Irving Fisher, par André Tiran et Marc Laudet, constitue le dixième numéro de la collection Écrits sur l’économie des Classiques Garnier, qui vise à « redonner actualité à des textes majeurs de la science économique, du xive au xxe siècle3 ». Initialement paru en 1935 aux États-Unis, cet ouvrage connut deux rééditions du vivant de l’auteur : une seconde édition, révisée, 433en 1936, et une troisième, identique à la seconde mais enrichie d’un addendum, en 1945. C’est cette dernière édition qui a servi de base à la traduction française.
100 % Monnaie fut rédigé dans le contexte de la Grande Dépression des années 1930. Après que la quantité de monnaie scripturale aux États-Unis se fut contractée d’un tiers entre 1929 et 1933, un groupe d’économistes de l’Université de Chicago, emmené par Frank Knight et Henry Simons, entreprit de faire circuler un plan de réforme appelant à imposer 100 % de réserves derrière les dépôts bancaires en comptes courants. Ce « Plan de Chicago », combiné à ses propres réflexions, inspira à Fisher son livre de 1935. Ce dernier constitue, aujourd’hui encore, l’exposé le plus détaillé et le plus argumenté de cette idée de réforme. Le cœur de l’ouvrage se compose de trois parties : la première donne un aperçu du système proposé ; la seconde détaille son fonctionnement ; la troisième en explique l’importance pour stabiliser l’économie, ainsi que les implications pour les banques, les entreprises et l’État.
En quoi consisterait cette réforme « 100 % monnaie » ? Son essence, selon Fisher, est de « rendre la monnaie indépendante des prêts ; c’est-à-dire séparer le processus de création et de destruction de la monnaie, des activités bancaires » (p. 59). Concrètement, les dépôts bancaires servant de moyens de paiement (transférables par chèque ou virement) seraient soumis à 100 % de réserves en monnaie légale (papier ou scripturale) émise par une Commission de la Monnaie nouvellement instituée (p. 71). Cela empêcherait que le volume de moyens de paiement ne s’accroisse ou ne se contracte de façon procyclique, au gré de l’octroi et du remboursement des prêts bancaires. La masse monétaire cesserait ainsi, selon l’auteur, d’être une source d’aggravation des booms et des dépressions (p. 161). L’autorité monétaire exercerait alors un contrôle parfait sur la quantité de monnaie, qu’elle régulerait selon le mandat qui lui serait confié – par exemple, stabiliser un indice du niveau des prix, de sorte à ajuster le volume de monnaie à la croissance de l’économie (p. 85, 212). L’État, bénéficiant de l’intégralité du seigneuriage, pourrait réduire sa dette (p. 231). Le système de paiement, à l’abri des faillites bancaires, serait rendu parfaitement sûr (p. 73). Quant aux banques de prêt, celles-ci exerceraient une pure fonction d’intermédiation entre épargnants et emprunteurs, sans pouvoir créer de moyens de paiement (p. 131). Cette 434réforme ne fut finalement jamais adoptée, bien que l’économiste de Yale la défendît jusqu’à la fin de sa vie.
Quelques mots maintenant sur les spécificités de cette édition française. Les éditeurs mentionnent en introduction une autre traduction récente du même ouvrage4, à laquelle ils reprochent son caractère incomplet et son manque de rigueur (« il n’est pas jusqu’au titre, disent-ils, qui a été changé », p. 72). Sur ce dernier point, malheureusement, la nouvelle traduction proposée ici est elle-même loin d’être irréprochable. La tournure des phrases est souvent inesthétique, les fautes de frappe et d’orthographe sont nombreuses, et il n’est pas jusqu’aux noms et prénoms des auteurs cités qui aient été écorchés (par exemple Aaron Director, Lauchlin Currie, Renato Cirillo ou encore Dalgairns Arundel Barker). Surtout, les approximations de la traduction altèrent parfois le sens du texte, par exemple lorsque le titre de la section The « Accommodation » of Business, évoquant les prêts aux entreprises, se trouve traduit par Les « Arrangements » d’affaires (p. 175), ou lorsque la discrétion (discretion) de l’autorité monétaire devient les « secrets » de celle-ci (p. 236). Certaines italiques présentes dans l’édition originale ont également disparu. Il est donc difficile de ne pas regretter qu’un tel ouvrage n’ait pas fait l’objet d’une traduction plus soignée.
L’on appréciera en revanche le caractère complet de cette édition, qui reproduit l’ensemble des éléments composant l’édition finale de 1945. Les éditeurs ont adjoint au texte des notes de bas de page qui apportent un éclairage utile sur certains points. Dans une introduction éditoriale de près de trente pages, ils offrent également une mise en perspective historique de l’ouvrage. L’on s’étonnera toutefois que le regain d’intérêt pour l’idée de « 100 % monnaie » depuis la crise financière mondiale de 2007-2008, bien que conférant un sens particulier à une réédition de ce livre aujourd’hui, ait à peine été noté. L’introduction mentionne un rapport du FMI de 2012, ainsi qu’un référendum suisse de 2018, qui s’en sont inspirés. Elle aurait gagné à préciser qu’un grand nombre d’économistes et de banquiers centraux se sont également intéressés à cette idée de réforme, qui a fait l’objet de nombreux articles académiques récemment. L’on peut aussi regretter l’absence, dans la bibliographie générale, de deux références pourtant incontournables de la littérature 435secondaire sur le sujet : le livre de Ronnie Phillips sur l’histoire du Plan de Chicago5, ainsi que l’article de Robert Dimand sur Fisher et le plan 100 % monnaie6.
Certaines remarques des éditeurs, par ailleurs, appellent des commentaires. Ils affirment par exemple que « 100% money n’est pas un ouvrage de théorie ou d’analyse économique » (p. 7), alors qu’il contient pourtant d’importants développements analytiques. Ils estiment également que l’utilisation de l’équation des échanges (MV + M’V’ = PT) comme base de raisonnement rendrait la portée de l’œuvre incompréhensible, au motif qu’elle supposerait la neutralité de la monnaie (p. 8). Fisher utilisait pourtant cette équation aussi bien pour analyser la neutralité de la monnaie à long terme (théorie quantitative) que sa non-neutralité à court terme (théorie des cycles), et celle-ci continue de sous-tendre son analyse dans 100% Money. Les éditeurs résument bien sa pensée, en revanche, lorsqu’ils écrivent : « Pour Irving Fisher, en aucun cas la monnaie n’est intrinsèquement neutre. La neutralité de la monnaie doit se construire et c’est une nécessité de la construire, faute de quoi les dysfonctionnement[s] des systèmes monétaires […] sont susceptibles d’aggraver les crises » (p. 26). Ils rapprochent très justement, à cet égard, la pensée de Fisher de celle de Léon Walras (p. 28-31), et auraient d’ailleurs pu noter qu’en 1898, ce dernier avait également préconisé une couverture intégrale des dépôts en comptes courants7.
Cette nouvelle édition permettra, quoi qu’il en soit, aux lecteurs francophones de (re)découvrir les origines d’une idée de réforme qui continue de faire débat aujourd’hui.
436*
* *
John Maynard Keynes, Comment financer la guerre. Un plan pour le chancelier de l’échiquier, Traduction et édition critique de Marc Laudet avec la collaboration d’André Tiran, Paris, Classiques Garnier, 2020, 253 pages.
Jean-Jacques Friboulet
Université de Fribourg
M. Laudet et A. Tiran offrent au public francophone une traduction de How to pay for the war publié par J.M. Keynes au printemps 1940. L’heure pour la Grande-Bretagne était particulièrement critique. Elle devait choisir une stratégie financière pour payer la guerre et ne pas sombrer dans l’inflation qui avait caractérisé la période 1918-1920.
Comme il l’avait fait pour Lamonnaie et les finances de l’Inde (1913)et Les conséquences économiques de la paix (1919), J.M. Keynes se livre à un exercice de politique économique magistral qui entre curieusement en résonnance avec nos préoccupations d’aujourd’hui. En cet automne 2021, le monde est confronté à un déséquilibre macroéconomique profond entre une demande globale stimulée par les crédits distribués durant le Covid 19 ajoutés à la reprise économique et une offre globale réduite par le même Covid en Asie et les problèmes du transport international. En 1940, la Grande-Bretagne allait se heurter à un écart croissant entre une demande macroéconomique stimulée par la hausse des salaires et les besoins de l’industrie de guerre, et une offre globale réduite par la mobilisation de l’armée. Les deux chocs conjoncturels sont proches. Relisons donc Keynes pour mieux le comprendre.
Pour pénétrer dans le contenu de l’ouvrage, M. Laudet et A. Tiran ne se contentent pas d’en offrir une édition bilingue. Ils l’accompagnent d’une longue introduction qui permet d’en cerner le contexte historique, les outils théoriques, la méthode et le contenu. Ils complètent ce panorama par un aperçu de l’accueil qui a été réservé au livre par ses contemporains. Nous reprenons ici ces différents éléments en notant au passage leur parfaite pertinence eu égard au projet de J.M. Keynes.
437Le contexte tout d’abord. L’auteur a été profondément marqué par les conséquences financières de la première guerre mondiale. Même si la Grande-Bretagne s’en était mieux sortie que la France grâce à des prélèvements fiscaux plus élevés et au rôle de place financière de la City, elle est obligée de dévaluer fortement sa monnaie au sortir du conflit en raison des sorties de capitaux et de l’inflation. Le maître de Cambridge connaissait bien cette situation de l’intérieur puisqu’il avait été chargé par le Trésor britannique des financements extérieurs durant la guerre. Il la connaît d’autant mieux qu’il avait été, dans les années 1920, le grand adversaire du retour de la livre sterling à sa parité d’avant-guerre contre l’avis du monde bancaire et de W. Churchill. Il ne veut pas que son pays connaisse de nouveau une telle situation de déséquilibre.
Pour ce faire il élabore une stratégie en deux temps. Il sait, depuis la crise des années 1930, le rôle de l’opinion publique et des différents groupes de pression sur la politique économique. Il va essayer de les gagner à sa cause dans trois articles publiés dans le Times en novembre 1939. Il tient compte des réactions en modifiant son plan et en ne le publiant qu’en février 1940.
Ce plan a bien sûr un intérêt historique. Mais sa pertinence est surtout théorique et sa méthode devrait être portée à la connaissance de tous les étudiant(e)s en politique économique. Il s’appuie sur des données statistiques fournies, pour l’année 1938, par Erwin Rothbarth. Celles-ci concernent les grands agrégats macroéconomiques que sont la production, les salaires, l’épargne, les dépenses privées et gouvernementales, les importations et les exportations. À partir de ces données, l’auteur raisonne en utilisant les grandes identités définissant l’offre globale et la demande globale. Il démontre aisément que la guerre va engendrer un excédent de dépenses de consommation en raison de l’augmentation des salaires et de l’affectation de ressources aux dépenses d’armement. La solution ne pourra être trouvée dans une augmentation des importations, sauf à créer un lourd déséquilibre des finances extérieures au moment où le pays devra massivement emprunter pour financer la guerre. Il faudra donc résorber cet excédent de demande. En théorie il n’existe que cinq méthodes et cela est toujours vrai aujourd’hui : le rationnement, le contrôle des prix, l’impôt, l’épargne et l’inflation.
Le rationnement et le contrôle des prix paraissent être des mesures de bon sens. Mais ils ne peuvent être, dans les faits, généralisés dans 438une économie de marché. Le premier entraîne des détournements et du marché noir comme on l’a constaté en France durant les années de guerre. Le second n’est jamais effectif sauf pour un nombre limité de produits de base, solution à laquelle l’auteur se rattache d’ailleurs dans son plan. Il reste alors les vrais remèdes que l’auteur développe dans la suite de son livre.
L’impôt doit être sollicité. C’est ce qui avait été fait en Grande-Bretagne durant la première guerre mondiale. Mais son augmentation au-delà d’un certain seuil, se heurte au maintien nécessaire du pouvoir d’achat pour les travailleurs. J.M. Keynes qui souhaite l’appui des Trade-Unions à son plan, leur démontre qu’une augmentation trop forte de la masse imposable s’en prendra fortement aux revenus des salariés et non à celui des seuls « profiteurs ».
Peut-on compter sur la seule épargne volontaire pour accompagner la hausse des impôts ? Celle-ci est précieuse et l’auteur sait qu’elle est fortement suscitée en temps de guerre y compris avec des arguments abusifs comme l’attractivité des taux d’intérêt sur les bons du Trésor. Mais ici encore, instruit par son expérience, l’auteur sait que la limite de captation de l’épargne volontaire est très vite atteinte.
Il reste alors à examiner le rôle que peut jouer l’inflation. J.M. Keynes sait que, pour les politiciens, c’est le chemin de la facilité. Il sait aussi que l’inflation est inévitable. Mais il veut la limiter autant que faire se peut en raison de ses effets redistributifs. L’inflation accroît d’abord les profits. Elle n’est jamais accompagnée d’une hausse équivalente des salaires sauf à tomber dans une hyperinflation ruineuse pour le pays. L’auteur veut en convaincre les syndicats pour accepter le remède qu’il propose : l’épargne différée. L’auteur souhaite soumettre l’ensemble des travailleurs durant la guerre à un plan d’épargne dont le remboursement serait reporté et garanti après le conflit par la création d’un impôt sur le capital. Pour s’assurer le soutien des Trade-Unions, il ajoute à son plan la création d’un système d’allocations familiales dès le début du conflit.
À sa parution, le plan est bien accueilli. Même F. Hayek même lui apporte son soutien. Seuls J.R. Hicks et M. Kalecki sont réservés. Le premier craint que les propositions de Keynes fassent « fuir » les riches, le second redoute l’impact de l’épargne reportée sur l’épargne volontaire.
Ce qui frappe l’observateur aujourd’hui c’est la logique d’ensemble et la cohérence de ce plan. C’est aussi son caractère innovateur à travers 439la mise en place d’une épargne différée et des allocations familiales. Ce caractère va faire peur au gouvernement britannique qui ne le prend que partiellement en compte en 1940. Le budget national prévu pour 1941 montre qu’il n’a pas pris la mesure de ce que va coûter la guerre. Ce plan va donc rester un exercice en partie théorique.
Pourtant Stone, l’inventeur de la comptabilité nationale montrera durant la guerre que les chiffres sur lesquels s’appuyait J.M. Keynes étaient très solides. Les enseignements de l’auteur sur les faux remèdes, les limites de l’épargne volontaire et les résultats de l’inflation ont été validés par les faits. Comme dans les années 1920, J.M. Keynes a joué les Cassandre. Peu écouté, il va consacrer son énergie à préparer l’architecture des finances internationales d’après-guerre, dès 1941.
En cette période où renaît l’inflation, l’outil publié par M. Laudet et A. Tiran comble une double lacune. Une lacune dans l’histoire de la pensée parce que Comment financer la Guerre est à la manière des Conséquences économiques de la paix une excellente porte d’entrée à l’œuvre du Maître de Cambridge. On ne peut que conseiller sa lecture à ceux et celles qui ont envie de découvrir les richesses de la pensée keynesienne. Lacune également dans la macroéconomie contemporaine qui néglige tant les analyses d’ensemble. Abreuvée de vues sectorielles, elle ne parvient plus à saisir les logiques qui gouvernent les politiques économiques en cette fin d’année 2021. La lecture de Comment financer la Guerre nous donne des explications sur le rationnement, le contrôle des prix, la fiscalité, l’épargne et l’inflation qui restent parfaitement valides, même si le contexte de ce début de siècle n’a rien à voir avec celui de 1940.
*
* *
Christophe Salvat, L’utilitarisme, Paris, La Découverte, collection « Repères-Philosophie », 2020, 128 pages.
Emmanuelle de Champs
CY Cergy Paris Université, AGORA – EA 7392
Le propos de cet ouvrage, paru dans la collection Repères aux éditions La Découverteest d’offrir une introduction précise et nuancée à l’utilitarisme comme courant philosophique depuis Bentham jusqu’aux utilitaristes contemporains (Peter Singer, Derek Parfit notamment). Dans un petit format (128 pages dont 108 de texte et 13 de bibliographie), Christophe Salvat donne une synthèse problématisée et efficace des avancées récentes de la recherche et met en valeur leur contribution aux questions éthiques contemporaines.
Dans le paysage intellectuel anglophone, l’utilitarisme occupe une place spécifique depuis le début du xixe siècle. Les idées de Jeremy Bentham, de John Stuart Mill puis de Henry Sidgwick ont été diffusées, commentées et attaquées, elles ont joué un rôle structurant dans les controverses de l’époque victorienne. Au xxe siècle, une riche tradition universitaire – notamment dans les départements de droit, de politique et de philosophie – a contribué à considérablement élargir les problématiques, au-delà de l’affirmation fondatrice de l’utilitarisme selon laquelle, dans les termes de Bentham, « le plus grand bonheur du plus grand nombre » doit être l’objectif unique de la morale et de la législation (Introduction aux principes de morale et de législation, 1788). Aujourd’hui, l’étudiant.e français.e, qui n’a le plus souvent reçu qu’une introduction à la philosophie anglophone en général et à l’utilitarisme en particulier, se trouve confronté.e à une production scientifique complexe et parfois décourageante où se bousculent les références à l’« hédonisme », à « l’utilitarisme de l’acte », « l’utilitarisme de la règle », la « conclusion répugnante », le rôle de l’« archange et du prolos », « le fétichisme de la règle », « l’altruisme efficace », « le principe d’impartialité », « le monstre d’utilité »…. En proposant une introduction aux écrits utilitaristes et sur l’utilitarisme, l’ouvrage de Christophe Salvat fournit le vocabulaire, les concepts et les références (en français et en anglais) qui doivent permettre au lecteur de poursuivre des recherches autonomes.
441Le livre se concentre sur les enjeux éthiques plutôt que sur les questions politiques, juridiques et économiques qui occupent aussi les utilitaristes depuis le début du xixe siècle. Comme le remarque l’auteur, ce parti pris correspond aux orientations actuelles de l’utilitarisme car « sa dimension juridique, politique et institutionnelle est quasi absente et rarement assumée » dans les travaux depuis les années 1970 (p. 4). La question des rapports de l’économie, comme discipline, à l’utilitarisme classique et contemporain aurait gagné à être traitée de façon plus directe dans l’ouvrage : en effet, l’auteur est spécialiste de philosophie économique et chargé de recherches CNRS au Centre Granger (Aix-Marseille Université) et est l’auteur de nombreux travaux en philosophie économique. Dans cet ouvrage, il contribue à outiller la réflexion théorique sur des questions qui sont au centre des problèmes éthiques actuels : « la détérioration de l’environnement, la malnutrition d’une partie de la population mondiale, l’extinction de certaines espèces, la souffrance animale ou encore le bien-être des générations à venir » (p. 107), mais qui intéressent aussi la réflexion des économistes.
L’introduction définit l’utilitarisme comme « une philosophie morale » reposant sur quatre piliers : conséquentialisme, hédonisme, impartialité et maximalisme. C’est finalement le conséquentialisme et l’application du principe d’impartialité qui relient l’utilitarisme classique à celui d’aujourd’hui. Comme Christophe Salvat l’explique, dans l’éthique contemporaine, hédonisme et maximalisme sont considérablement nuancés voire progressivement abandonnés après Sidgwick. À la lecture de l’ouvrage, le champ de l’utilitarisme apparaît en reconfiguration constante et loin d’un « système de pensée homogène » (p. 18). Si les auteurs qui se définissent comme utilitaristes sont finalement peu nombreux, l’utilitarisme apparaît plus comme un espace de débats et de contestation qu’une école ou qu’un courant. Surtout, il est depuis le début du xixe siècle en prise directe avec les grands débats théoriques qui irriguent les sciences humaines et sociales, ce que le livre montre très bien en mobilisant des références plus larges que les auteurs identifiés comme utilitaristes.
La première partie est consacrée à l’utilitarisme classique, celui de Bentham, Mill et Sidgwick qui sont présentés tour à tour. Appuyé sur une bibliographie solide, l’auteur se concentre sur les enjeux théoriques des positions des trois philosophes. Bentham ambitionne de révolutionner 442la morale en déconstruisant les traditions et les fictions de l’éthique religieuse ou de celle du sens commun. Christophe Salvat met particulièrement en exergue le côté impartial et égalitaire de l’approche de Bentham, pour qui le principe d’égalité des intérêts entre les individus est central. Les modalités du calcul de félicité (felicific calculus) sont présentées et discutées et ses difficultés sont soulignées : peut-on retenir un critère de mesure unique ou au moins uniforme ? comment juger des effets potentiels d’une action ? (p. 16-17). Avec John Stuart Mill, l’auteur pose la question, récurrente au fil de l’ouvrage, de la compatibilité entre utilitarisme et libéralisme sur laquelle cette recension reviendra brièvement. Enfin, il présente la carrière et les idées de Sidgwick qui déjà se démarque fortement de ses prédécesseurs en refusant de condamner le recours à l’intuition en matière morale. Pour brèves qu’elles soient, ces présentations sont claires et précises. L’auteur met en exergue ce qui constitue pour lui l’essence de l’approche de Bentham, Mill et Sidgwick et leur contribution principale à l’utilitarisme contemporain : l’affirmation des principes hédonistes et l’égalitarisme, ce « principe d’impartialité » auquel il reviendra dans le chapitre 3 et dont il fait le pilier central de la pensée utilitariste aujourd’hui à laquelle est consacrée le reste de l’ouvrage.
Dans une deuxième partie, Christophe Salvat s’intéresse aux questions de la quantification, de la classification et de la maximisation de l’utilité et fait état des débats considérables qui portent sur chacun de ces termes depuis les années 1970. Il explique comment la critique de l’hédonisme s’est affirmée au fur et à mesure que les débats théoriques sur la mesure et sur la quantification du plaisir, ou du bien-être, achoppaient sur la variété des expériences et sur leur incommensurabilité. Ce chapitre fournit aussi l’occasion de présenter les contributions d’Arrow, de Rawls et de Sen à la construction de l’utilitarisme contemporain, leurs critiques ayant considérablement reconfiguré les fondements théoriques de l’utilitarisme. Comment mesurer ou classer les utilités ? à quelle échelle géographique ou temporelle effectuer le calcul ? L’objectif de maximisation de l’utilité collective peut-il être remplacé par un optimum comme celui de Pareto ?
Les objections nombreuses au calcul de la valeur d’utilité d’un acte donné ont conduit les utilitaristes, comme l’explique Christophe Salvat dans la partie 3, à adopter progressivement un « utilitarisme de 443la règle » (rule utilitarianism), dont il propose la définition suivante : « Une action est bonne (right) si elle est conforme à une règle qui, si elle est suivie, produit au moins autant d’utilité totale que n’importe quelle autre règle possible » (p. 56). L’utilitarisme contemporain, que ce soit dans les travaux de Hare, ou de Hooker et de Mulgan, contribue directement à une réflexion plus générale sur la normativité en matière morale. Quels sont les avantages de l’utilitarisme de la règle ? Il fait peser une responsabilité moindre sur l’agent, qui n’est pas seul face à ses calculs et à ses choix et permet d’éviter les situations où un calcul donné conduirait à des situations perçues comme immorales, comme la justification du mensonge ou le sacrifice d’un innocent. Pour préciser le propos de l’auteur, on pourrait ajouter que ces interrogations ne sont pas l’apanage des utilitaristes de la fin du xxe siècle, mais traversent également les travaux de leurs précurseurs : loin d’être un strict « utilitariste de l’acte » (p. 56), Bentham définit très vite quatre objectifs indirects de l’utilitarisme : subsistance, abondance, égalité et sécurité qui prennent une importance croissante dans ses écrits à mesure qu’il développe les implications distributives de la maximisation du bonheur.
Consacré à la « théorie et critique » du principe d’impartialité, le chapitre 4 fait le point sur une question qui traverse l’utilitarisme, comme le formulait déjà John Stuart Mill dans son article « Utilitarisme » : « Ce principe n’est qu’un assemblage de mots sans signification rationnelle si le bonheur d’une personne, supposé égal en intensité (avec part faite pour la qualité), n’est pas compté exactement pour autant que le bonheur d’une autre personne. » (L’utilitarisme). En refusant de faire primer les intérêts ou le point de vue d’un individu sur les autres et en imposant un regard impartial, les auteurs utilitaristes entendent aller à rebours du primat accordé à la sympathie dans la construction de la morale (c’est l’un des combats de Bentham et de Mill), ou bien pour reprendre l’exemple récent de Peter Singer, à accorder plus d’attention à l’enfant qui se noie devant nous qu’à celui qui meurt de faim loin des caméras de télévision. Face aux critiques de Bernard Williams, de Rawls, de Dworkin et plus récemment de Sen et de Nozick, les utilitaristes ont fortement défendu le principe d’impartialité tout en l’infléchissant parfois, comme chez Hare.
À plusieurs reprises, l’auteur aborde la question des liens entre utilitarisme et libéralisme. D’abord sur le plan historique : Mill est une 444figure fondatrice de l’un et de l’autre. Mais comme il le rappelle, le choix de l’utilité comme principe fondateur a immédiatement achoppé sur la question des droits humains. Les positions de Bentham sont à cet égard particulièrement critiques (la Déclaration de 1789 étant ramenée à un « nonsense sur des échasses »), et Mill est tiraillé entre la préservation de l’individualité qu’il met au cœur de son système politique et les objectifs de maximisation. À la même époque, tandis que la tradition marxiste voyait dans l’utilitarisme un épigone du capitalisme bourgeois, le rôle de l’État dans la poursuite du plus grand bonheur du plus grand nombre chez les utilitaristes classiques a fait l’objet de critiques importantes après la Seconde guerre mondiale, tant par Berlin que par Rawls. Christophe Salvat rattache clairement la question aux débats philosophiques sur l’impartialité en montrant comment l’utilitarisme de la règle a permis de réintégrer la question des droits individuels, ou au moins de disculper les utilitaristes de l’accusation récurrente de ne pas attacher une importance suffisante à l’intégrité de l’individu. Comme le précise l’auteur, depuis les années 1970, ces critiques ont été reformulées et développées par Dworkin et par Nozick en ciblant l’utilitarisme de la règle autant que celui de l’acte. La dialectique entre droits et utilité apparaît ainsi comme un puissant moteur du débat contemporain autour de la justice politique et sociale et c’est peut-être sur ce point que la contribution des utilitaristes est la plus significative. Tant pour Rawls que pour Sen, dont les idées sont discutées à plusieurs reprises dans l’ouvrage, la confrontation avec les arguments utilitaristes s’est révélée décisive. À cet égard, la section consacrée à la façon dont l’utilitarisme contemporain s’est attaché à « (ré)intégrer la notion de personne » (p. 92-98) est particulièrement éclairante.
Dans chaque chapitre, un encadré fait le point sur des problématiques qui se situent en marge de la démonstration de l’auteur, mais les contraintes éditoriales imposées par le format des 128 pages laissent parfois le lecteur sur sa faim. Le premier, consacré à « John Stuart Mill et Harriet Taylor », introduit la question de l’égalité des sexes et revient rapidement sur celle de l’attribution des œuvres de Mill. Il y aurait sur ce thème (repéré par Amartya Sen dès le début des années 1990) des ponts à tracer avec l’utilitarisme contemporain, qui depuis les travaux de Jonathan Glover travaille les questions liées au contrôle de la fertilité. Au chapitre 2, les liens entre « mesure de l’utilité et théories du 445bien-être » sont présentés en quatre colonnes très denses où se côtoient Lionel Robbins, Paul Samuelson, John Harsanyi, Kenneth Arrow, Peter Hammond, Charles Blackorby et enfin Amartya Sen sans que le cadre théorique qui relie les théories du bien-être à l’utilitarisme soit explicité. Clarifier en quoi les théories utilitaristes sont à même de contribuer aux approches normatives de l’économie aurait pourtant permis d’asseoir le propos de l’ouvrage dans un cadre disciplinaire plus précis. L’encadré 3 porte sur « utilitarisme de la règle et généralisation utilitariste » et apporte un complément d’information utile aux débats du chapitre 3. Au contraire, le dernier hors-texte sur « le système des enchères de Dworkin » nous éloigne un peu, par sa précision, du propos du livre.
L’ouvrage se clôt sur quelques cas d’éthique appliquée largement travaillés par l’utilitarisme contemporain : les famines, le bien-être animal et l’éthique environnementale. Les figures de Peter Singer et de Derek Parfit se détachent par la force avec laquelle ils défendent un cadre d’analyse et proposent des mesures concrètes : encourager les citoyens du monde riche à donner 10 % de leurs revenus à des ONG efficaces, adopter un régime végétarien ou quasi-végétarien, agir fortement dans les pays développés pour contrer le dérèglement climatique. Le traitement des enjeux contemporains peut sembler un peu rapide dans l’ouvrage au regard du projet de l’auteur mais contient les références qui permettent aux lecteurs d’aller plus loin. Il aurait été intéressant de développer aussi la façon dont l’utilitarisme permet de poser ces questions non pas seulement dans le champ de l’éthique, mais aussi comme des questions politiques et économiques.
Cela aurait également permis de mettre en valeur la continuité, plus que la rupture, entre l’utilitarisme classique et celui d’aujourd’hui. Sur les questions économiques et politiques, les intuitions et le raisonnement de Mill gagneraient à être mieux connus par les utilitaristes contemporains. Qu’on pense aux derniers chapitres des Principes d’économie politique (1848), qui soumettent le progrès technique et la maximisation des ressources à l’exigence morale d’émancipation individuelle, envisageant ainsi qu’une société puisse faire le choix de préserver un « état stationnaire », renonçant aux objectifs de croissance illimitée :
Il n’y a pas grand plaisir à considérer un monde où il ne resterait rien de livré à l’activité spontanée de la nature, où tout arpent de terre propre à produire 446des aliments pour l’homme serait mis en culture : où tout désert fleuri, toute prairie naturelle seraient labourés ; où tous les quadrupèdes et tous les oiseaux qui ne seraient pas apprivoisés pour l’usage de l’homme, seraient exterminés comme des concurrents qui viennent lui disputer sa nourriture ; où toute haie, tout arbre inutile seraient déracinés ; où il resterait à peine une place où pût venir un buisson ou une fleur sauvage, sans qu’on vint aussitôt les arracher au nom des progrès de l’agriculture. Si la terre doit perdre une grande partie de l’agrément qu’elle doit à des objets que détruirait l’accroissement continu de la richesse et de la population, et cela seulement pour nourrir une population plus considérable, mais qui ne serait ni meilleure ni plus heureuse, j’espère sincèrement pour la postérité, qu’elle se contentera de l’état stationnaire longtemps avant d’y être forcé par la nécessité. (Principes d’économie politique, livre IV, chap. vi, § 2)
Dense malgré sa concision, le livre de Christophe Salvat est bien construit et remplit le programme qu’il s’est fixé en présentant de façon rigoureuse les concepts et les penseurs de l’utilitarisme. Il bat ainsi en brèche l’image d’une philosophie marginale et autocentrée et démontre qu’elle occupe une place centrale dans la pensée contemporaine anglo-saxonne. Il serait dommage que la publication de l’ouvrage dans la collection « Repères-Philosophie » et son orientation autour des enjeux éthiques fasse oublier la dimension politique et économique de l’utilitarisme. En effet, par sa contribution à la réflexion sur les dilemmes éthiques contemporains, l’utilitarisme mérite d’être réinvesti par les disciplines qui se confrontent à la question de la normativité, du gouvernement et de la prospective.
*
* *
Samuel Ferey & Sylvie Rivot (dir.), Histoire de la pensée économique, Montreuil, Pearson, France, 2019, 550 pages.
Jimena Hurtado
Universidad de los Andes
Il peut paraître surprenant d’écrire un manuel sur l’histoire de la pensée économique aujourd’hui, alors que ce domaine de l’économie est, au mieux, relégué et, au pire et très souvent, absent de la formation et du travail des personnes impliquées dans l’économie. Les directeurs de l’ouvrage, Samuel Ferey et Sylvie Rivot, expliquent la pertinence de cet ouvrage collectif par le questionnement que la crise économique et financière de 2008 a fait subir à la discipline économique. Nous pourrions maintenant ajouter la crise sanitaire, économique et sociale sans précédent générée par la pandémie de Covid-19. Les crises de cette ampleur, comme le soulignent les directeurs dans leur introduction, remettent en question nos connaissances et la manière dont nous cherchons des explications et des solutions. L’économie, en particulier, tombe dans l’œil du cyclone non seulement pour sa prétendue incapacité à prévoir la crise, comme dans le cas de 2008, mais aussi pour sa supposée préférence pour la subsistance matérielle par rapport à la vie elle-même. Les difficultés et les défis structurels engendrés par la crise déclenchée par la pandémie mettent en évidence les limites de l’économie dans l’analyse et la réponse à la pauvreté et à l’inégalité, et remettent en question sa capacité à proposer des lignes d’action qui donnent la priorité à la vie dans la dignité. Dans ce contexte de questionnement et de critique de l’économie, il est d’autant plus important de noter, comme le rappellent Ferey et Rivot, l’influence de l’histoire de la discipline pour comprendre, d’une part, qu’au sein de l’économie coexistent des « positions méthodologiques, théoriques et politiques » (p. ix) qui s’enracinent dans le passé et, d’autre part, que cette histoire pèse et éclaire la manière dont l’économie, dans son hétérogénéité, étudie et cherche à agir sur le présent.
Bienvenue donc ce manuel, qui sera une référence pour les étudiants et les historiens de la pensée économique, avec son appel à voir l’histoire de la discipline au-delà de la chronologie et comme partie intégrante de l’éducation à la citoyenneté.
448Grâce à une analyse judicieuse et informée des textes originaux, ce manuel cherche à initier ses lecteurs à une manière spécifique d’aborder l’histoire de la pensée économique qui leur permettra de comprendre et de participer au débat civique qui est à la base de la discipline en tant que champ de discussion ouvert sur les projets de société. C’est pourquoi, au lieu de suivre un ordre strictement chronologique, le livre est organisé de manière thématique afin de montrer les thèmes et les discussions au fil du temps sur des questions qui ont été transversales à l’histoire de la discipline. Ainsi, quiconque lit ce livre, de manière systématique ou par chapitres, y trouvera des positions et des arguments actuels et pertinents, même s’ils font référence à des théories datant de plusieurs siècles. La méthode analytique du volume est un engagement clair des auteurs envers une manière spécifique et, dirons certains, obsolète ou inadéquate, d’aborder l’histoire des idées et des théories économiques. La recherche, tout au long de l’ouvrage, des relations entre les faits économiques et l’analyse économique permet, comme le disent les directeurs, d’introduire la pluralité en économie ainsi que de participer à une conversation en temps présent.
Cette analyse thématique permet de trouver différents protagonistes dans des conversations diverses et parfois inattendues. Mais elle nous permet également d’aborder ces protagonistes de telle sorte que la complexité et la richesse de leurs théories et de leurs pensées puissent être explorées sous différents angles. On retrouve ainsi Léon Walras dans les chapitres sur la valeur (Jean Dellemotte), le fonctionnement du marché (Nathalie Berta et Claire Pignol) et la banque et la monnaie (Rebeca Gómez-Betancourt) où les auteurs de chaque chapitre intègrent le professeur de Lausanne pour explorer et répondre à des questions transversales de la pensée économique. En traitant de la valeur, par exemple, Jean Dellemotte, au chapitre 2, le fait en incluant des aspects moraux et politiques qui relient Thomas d’Aquin, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx et les marginalistes, jusqu’à John Bates Clark. Mais dans le chapitre 3, Nathalie Berta et Claire Pignol, en approfondissant le fonctionnement du marché et le rôle central joué par le concept d’équilibre chez les marginalistes, laissent Menger de côté pour suivre la ligne walrasienne et néo-walrasienne en se rattachant à Antoine Augustin Cournot, Alfred Marshall, Vilfredo Pareto et Francis Y. Edgeworth. Le fait de retrouver ces protagonistes dans différents 449chapitres offre également différentes lectures et interprétations selon l’auteur du chapitre. C’est par exemple le cas d’Adam Smith dans le chapitre précité de Jean Dellemotte sur la valeur et la répartition, dans le chapitre de François Allison sur la dynamique du capitalisme ou dans celui de Laurie Bréban sur, comme elle le montre dans son chapitre, la douteuse rupture chronologique entre l’analyse en classes sociales et l’individualisme. Le même penseur sur différents sujets et sous plus d’une grille de lecture est d’autant plus intéressant pour trouver des continuités et aussi des emphases différentes.
Ce volume est particulièrement ambitieux, non seulement en raison de son approche analytique, mais aussi de l’ampleur que cette même approche lui permet de traiter dans le temps. En traitant de questions et de thèmes transversaux, le volume va d’Aristote, dans l’avant-propos de Rodolphe Dos Santos Ferreira, à l’économétrie et l’économie expérimentale dans le chapitre d’Ariane Dupont-Kieffer, en passant par l’économie du bien-être et les théories économiques de la justice dans le chapitre d’Antoinette Baujard et Herrade Igersheim. Cette ampleur et cette ambition signifient également que les auteurs font appel à d’autres protagonistes, au-delà de ceux que nous considérons traditionnellement comme des « économistes », pour leur analyse. On retrouve l’anthropologue Louis Dumont mobilisé par Laurie Bréban pour comprendre l’émancipation supposée de l’économie du politique et l’émergence de l’« individu », ou encore Louis Blanc comme protagoniste des débats des socialistes utopiques dans le chapitre de Ludovic Frobert.
Et, en même temps, il nous permet de suivre, si l’on veut, les discussions microéconomiques depuis l’abandon des classes sociales pour l’individualisme dans le chapitre de Laurie Bréban et l’émergence et la remise en cause de la théorie du choix rationnel présentée par Cyril Hédoin, ou celles associées à la théorie de l’équilibre général et à la théorie des jeux dans le chapitre de Jean-Sébastien Lenfant, et à la macroéconomie dans les chapitres sur son émergence par Sylvie Rivot, le modèle IS-LM jusqu’à la révolution des anticipations rationnelles par Goulven Rubin et la croissance et les cycles par Michaël Assous et Muriel Dal Pont Legrand. Bien entendu, il s’agit là d’une des nombreuses possibilités de regroupements ou de fils de lecture de ce manuel qui permet, je le répète, de suivre des thèmes plutôt que des courants ou des développements historiques.
450Les multiples possibilités de lecture reflètent un autre engagement méthodologique du volume, associé à sa méthode analytique. Il n’y a pas de progrès linéaire de la science. La théorie économique d’aujourd’hui ne reprend pas les idées, concepts et outils qui ont survécu à l’épreuve du temps et qui ont prouvé leur pertinence et leur utilité dans l’analyse et l’explication des phénomènes économiques. L’histoire de la pensée économique est un réservoir de sens et une conversation au présent ; son exercice ne se réduit pas à un exercice de mémoire ou de souvenir du passé ou à une archéologie des idées. Son exercice est un exercice de débat d’idées et d’interprétations du monde d’aujourd’hui, avec tous ses changements et dans toute sa complexité.
Les chapitres consacrés à des sujets inhabituels dans ce type d’ouvrage sont tout aussi rafraîchissants et novateurs. Les chapitres sur l’économie et la politique de l’État par Samuel Ferey, sur la guerre et la paix entre les nations par Victor Bianchini et Lucy Brillant, sur l’utopie et l’idéologie par Ludovic Frobert, sur la place des économistes dans le débat public au xxe siècle par Béatrice Cherrier, sur la construction d’un ordre économique international entre 1919 et 1976 par Pierre-Hernan Rojas reflètent un spectre d’analyse plus large de l’histoire de la pensée économique et une autre caractéristique fondamentale de l’ouvrage : la recherche des liens entre économie et politique. Cela nous rappelle que l’économie, en tant qu’économie politique, en tant qu’analyse des interactions sociales, est aussi une réflexion sur le pouvoir, sur la vie partagée dans la cité. Comme le soulignent Ferey et Rivot dans l’introduction, « faire l’histoire de la pensée économique, c’est aussi faire l’histoire de la place sociale des économistes dans la cité et de leur rapport au débat public » (p. xiii). L’histoire de la pensée n’est donc pas l’histoire des idées du passé mais l’engagement dans le débat civique des idées.
Il est difficile de rendre justice à la richesse de ce volume, dans lequel chacun des auteurs est un expert en la matière avec une longue histoire de recherche qui se reflète dans la synthèse sans simplification, réduction ou concessions contenue dans chaque chapitre. Il s’agit d’un volume exigeant car il va au-delà des informations chronologiques et biographiques avec un résumé de ce qui est traditionnellement considéré comme les principales contributions d’un auteur ou d’un courant à l’analyse économique. Chaque chapitre est une invitation à poursuivre la conversation, à relier le passé, le présent et le futur et d’explorer 451aujourd’hui avec les questions, les pistes et les réponses construites à travers le temps en retrouvant des controverses et des approches qui imprègnent l’économie contemporaine.
L’analyse thématique invite à une lecture engagée des discussions suscitées par des questions qui traversent la discipline. Ce manuel est l’œuvre d’une génération d’historiens de la pensée économique française qui reprend la tradition de ceux qui ont fait de l’histoire de la pensée une façon de faire de la théorie économique, mais, en même temps, une génération qui trace de nouvelles voies interdisciplinaires, proches de la philosophie politique et de la philosophie et de la sociologie des sciences.
C’est peut-être l’une des principales forces de ce volume, mais c’est aussi sa faiblesse. Ce manuel nous présente peu de choses provenant d’autres voix, d’autres lieux et d’autres expériences. On ne trouve dans le volume que peu d’ouvertures vers l’histoire des idées économiques et les questions transversales de l’économie depuis d’autres latitudes et avec des points de vue divers. Dans ce réservoir de sens que peut être l’histoire de la pensée économique, le sens de la diversité semble nous manquer lorsque nous promouvons le pluralisme, mais toujours à partir d’interprétations qui, bien que novatrices, traitent des mêmes auteurs depuis les mêmes lieux.
*
* *
Maria Cristina Marcuzzo, Ghislain Deleplace & Paolo Paesani (éd.), New Perspectives on Political Economy and Its History, Palgrave Studies in the History of Economic Thought, Palgrave Macmillan, 2020, 477 pages.
Sylvie Diatkine
Université Paris 1, PHARE –
EA 7418
I. Maria Cristina Marcuzzo, Université de Rome « La Sapienza », Italie, Ghislain Deleplace, Université de Paris 8, France, et Paolo Paesani, Université de Rome « Tor Vergata », Italie, collègues et amis 452de Annalisa Rosselli, Université de Rome « Tor Vergata », ont rassemblé les contributions et organisé la publication de ce livre en son honneur.
L’engagement d’Annalisa Rosselli en faveur d’un pluralisme en économie est clair dans ses publications, son rôle académique en soutenant les jeunes chercheurs et en créant et dirigeant les institutions nationales, européennes et internationales qui ont donné un nouvel essor à l’histoire de la pensée économique. C’est pourquoi le livre est clairement centré sur l’histoire de la pensée économique mais inclut aussi des domaines adjacents qui ont constitué des centres d’intérêt d’Annalisa Rosselli.
II. Comme le soulignent les éditeurs, dans leur introduction, Annalisa Rosselli ne considère pas l’histoire de la pensée économique comme la nostalgie d’auteurs anciens qui seraient périmés mais comme la mise en évidence de débats toujours actuels et récurrents8. Les questions non résolues ou solutions non abouties que l’on trouve dans les théories anciennes ne sont pas nécessairement le résultat d’erreurs mais plutôt des symptômes de difficultés que l’on peut retrouver dans les théories actuelles ou qui sont communes, indépendamment des différents contextes, à la science économique passée et présente. Et c’est cette conception qui assure l’unité du livre.
Tout d’abord, dans une première partie, Sheila Dow dans sa contribution intitulée « The methodological Role of the History of Economic Thought » présente la critique de la conception « whigiste » de l’histoire de la pensée économique qui lui semble pourtant gagner du terrain et selon laquelle les écrits anciens ne sont que des anciennes formulations des théories modernes.
L’auteur s’interroge ensuite sur le rôle de l’histoire des idées dans la méthodologie de A. Smith qui procède d’une approche historique plus générale du savoir (dans le domaine des sciences sociales), typique de l’École écossaise (Scottish Enlightenment). Comment cette approche pourrait-elle nous éclairer aujourd’hui ? Elle peut nous servir à comprendre la théorie économique moderne mais aussi à la critiquer ; c’est pourquoi elle doit faire partie intégrante de l’économie.
Les contributions du livre reviennent sur Ricardo (partie III), Sraffa (partie IV), Keynes (partie V), auteurs particulièrement étudiés par Annalisa Rosselli, de même que sur la perspective classique de Quesnay, Stuart Mill, Smith et Marx (partie II).
453III. Un nouveau lien entre économie et histoire est recherché par l’histoire de la pensée économique et est présenté dans le livre. Il ne s’agit pas d’une simple contextualisation des théories ni de se tourner vers l’histoire comme critique de l’économie. Il s’agit d’une façon historique et analytique de faire de l’histoire de la pensée économique (« an historical-analytical way » selon les éditeurs). Cependant, l’on voit à travers les différentes contributions rassemblées la difficulté de mettre en œuvre cette conception.
Celle-ci trouve un champ d’application important dans la théorie monétaire
Dans l’ouvrage écrit en collaboration avec Maria Christina Marcuzzo à propos de la théorie monétaire de Ricardo de l’étalon or, Annalisa Rosselli montre qu’il faut prendre en compte le fonctionnement précis du marché de l’or et du marché des changes, le rôle des marchands et institutions pour comprendre l’essentiel de la théorie de Ricardo et ne pas commettre d’erreurs dans l’interprétation de ses textes9.
Carlo Benetti et Jean Cartelier, dans leur contribution intitulée « From Ricardo to Sraffa : Gold as Monetary Standard in a Classical Theory of Money », bien que reprenant la distinction entre étalon des marchandises et étalon monétaire chez Ricardo introduite par Marcuzzo et Rosselli (1991 ; 1994), cherchent plutôt à construire une théorie sraffaienne des prix monétaires et de la monnaie qu’à faire une analyse de Ricardo. La question centrale est celle de la régulation de la quantité de monnaie par les arbitrages sur le marché de l’or lingot. Ils critiquent Deleplace (2017) qui explique la déviation du prix de marché du prix légal de l’or (à la source des arbitrages) par l’altération (« debasement ») des pièces. Selon eux, ce mécanisme ne peut s’appliquer à une théorie classique de la monnaie entièrement composée de papier convertible en or (qui est aussi celle de Ricardo). Dans cette économie, ces facteurs ne peuvent expliquer la déviation ; l’analyse théorique ne permet pas de la mettre en évidence et de la relier à la quantité de monnaie et les deux prix ne peuvent donc différer (p. 251) ; ceci remet donc en cause le mécanisme ricardien spécifique. La régulation de la quantité de monnaie doit alors être envisagée autrement selon les auteurs (en revenant au mécanisme plus traditionnel du multiplicateur de monnaie vis-à-vis des réserves en or ; mécanisme non utilisé par Ricardo). L’analyse économique ici 454ne s’articule pas à une nécessaire prise en compte des institutions du système économique.
Au contraire, José Luís Cardoso, dans sa contribution « Money, Banking and Politics in Early Nineteenth-Century Portugal », étudie les liens entre le développement historique du système bancaire (ici la création de la Banque de Lisbonne) et les débats théoriques sur les questions monétaires et financières, notamment la dette publique.
Les autres contributions de la partie 3 sur Ricardo envisagent ce dialogue entre histoire économique et analyse économique sous la forme de l’histoire intellectuelle. Il en est ainsi de l’histoire de l’introduction de Ricardo au Japon et de sa résonance différente selon les époques pour les économistes japonais (Masashi Izumo, Yuji Sato, and Susumu Takenaga « How Ricardo came to Japan ») ou de l’influence possible de Bentham sur Ricardo. Mais celle-ci s’avère introuvable selon Christophe Depoortère, André Lapidus et Nathalie Sigot (« Bentham et Ricardo’s Rendez-vous Manqués »).
Christian Gerhke, Heinz Kurtz et Richard Sturn, dans « Classics Today : Smith, Ricardo, Marx », s’interrogent sur l’intérêt pour un lecteur contemporain d’étudier Smith, Ricardo ou Marx. Selon eux, celui-ci se situe au niveau de la dynamique d’une économie capitaliste. Peut-on considérer qu’il y a une unité en ce domaine entre les trois auteurs ? Si Smith conçoit la croissance comme une interdépendance incluant économie, politique, système de gouvernement, par contre, Ricardo et les néo-ricardiens prolongent l’idée des rendements croissants en articulant deux niveaux de demande effective (l’un pour déterminer les prix, et l’autre l’étendue du marché pour déterminer les quantités). Marx a repris le rôle de l’influence du développement des « machines » sur l’évolution du taux de profit (et le sous-emploi) introduit par Ricardo mais en modifiant la détermination de celui-ci (rôle de la composition organique du capital). Sraffa donnera des précisions nécessaires à ce sujet.
IV. La partie IV propose des interprétations modernes de Sraffa, où l’on retrouve des préoccupations de lier économie et histoire
La contribution de Jean-Pierre Potier intitulée « Dialogues Manqués Between Antonio Gramsci and Piero Sraffa on Ricardo, Classical Political Economy and “Pure Economics” », revient justement sur la liaison entre théorie économique pure et institutions et histoire que Gramsci cherche chez Ricardo (son historicisme), mais à tort selon Sraffa, qui pense, 455lui, que Ricardo est un tenant de « l’économie pure » car il ne se place jamais dans une perspective historique ; le seul élément culturel que l’on y trouve est dérivé des sciences naturelles (p. 267).
Richard Arena dans « What can still be learnt from Sraffa’s Study of Prices in a Surplus Economy”, propose de réévaluer l’apport de Sraffa aujourd’hui, en insistant moins sur la théorie des prix et plutôt sur l’organisation d’une économie de production où le concept de surplus est central et lié historiquement aux diverses institutions et règles de répartition, ce qui l’éloigne du monde néo-walrasien et même du monde de l’économie pure mais le rapproche d’une analyse économique et historique. Sraffa s’est montré soucieux de prendre en compte le contexte de la réalité sociale à partir de ses critiques de A. Marshall10. R. Arena cite aussi des conférences de Sraffa de 1929 et des années 1940 sur les banques et l’organisation de l’industrie, insistant sur les relations asymétriques et de hiérarchie, contrastant avec la vision marshalienne des marchés ; montrant la généralisation des marchés financiers. Cependant R. Arena reconnait que, « pour des raisons diverses », Sraffa n’a pas poursuivi dans cette voie et a choisi ultérieurement de limiter son analyse à une construction moins complexe (un « prélude »)
V. La partie V propose de nouvelles perspectives sur Keynes. Annalisa Rosselli s’est intéressée à Keynes et aux keynésiens de plusieurs façons.
On retrouve ici une conception analytique et historique de l’histoire de la pensée comme elle a été définie plus haut. Ainsi la contribution de Mario Sebastiani, « The State and the Market in John Maynard Keynes and His Relevance Today », tente de préciser la vision de Keynes d’un capitalisme « dirigé ». Il s’agit donc d’un projet politique de réforme du capitalisme. Revenant sur les « agendas » du gouvernement et sur les formes de gouvernement capables de les remplir, l’auteur s’interroge sur ce que seraient les « agendas » selon Keynes aujourd’hui. Quel serait l’héritage de Keynes dans l’organisation des économies de marché européennes ? Quelles sont les affinités et différences entre les propositions de Keynes et les politiques publiques européennes ? Quels sont les « services d’intérêt économique général » selon la loi européenne vers lesquels il faut diriger les investissements ?
On peut prolonger ces interrogations sur l’affectation des investissements en les rattachant à des contributions de la Partie 1 sur les dépenses 456publiques et leur impact sur les inégalités de « genre ». Ces contributions se situent dans la ligne des travaux d’Annalisa Rosselli qui a soulevé cette question en proposant les bases d’une nouvelle méthodologie d’analyse11. Car il s’agit de faire sortir les questions d’égalité de genre des marges de la théorie économique et de la politique économique en les intégrant au cœur des processus économiques et pour cela de repousser les frontières de la discipline économique ainsi que le tentent Elisabeth Klatzer and Angela O’Hagan, dans leur contribution « Moving Boundaries with Gender Budgeting : From the Margins to the Mainstream », p. 79). Il est alors possible de proposer des mesures de réaffectation des budgets et fiscales selon leur influence sur l’allocation des ressources en se posant comme objectif d’agir sur ces inégalités qui permette de faire avancer un point de vue féministe (gender budgeting).
Et l’on retrouve aussi ici la nécessité de recourir à l’histoire pour mettre au jour les biais en ce sens des politiques économiques, y compris macroéconomiques. Paola Villa, dans « Family, Gender Inequality and Growth : History Matters », montre comment, en Italie, les structures et les normes familiales jouent un rôle déterminant sur les résultats économiques. Le haut niveau de production « domestique » réduit l’étendue du marché et conduit à peser sur la recherche d’emplois efficaces en termes de croissance et en réalité à une baisse du taux de fertilité. Dans les sociétés à liens familiaux forts, il y a un risque que la pression en faveur de politiques publiques efficaces soit faible.
Les liens entre Sraffa et Keynes sont soulignés à propos du taux d’intérêt par Jan Kregel et Alessandro Roncaglia, dans « An Outline of a Keynesian-Sraffian Macroeconomics », pour lesquels il s’agit d’une variable de clôture du modèle. Sraffa considère que le taux de profit peut être déterminé, de l’extérieur, par un taux d’intérêt monétaire (mais dont il ne donne aucune « théorie ») et Keynes cherche à déterminer ce taux monétaire. On sait que cette détermination va poser problème et qu’il faudra introduire les institutions politiques et sociales.
Il en résulte selon Jan Kregel et Alessandro Roncaglia une commune volonté d’approche de la part de Sraffa et Keynes d’une économie monétaire de production, concept construit à partir des Classiques et de leur approche en termes de surplus, augmentée de la notion keynésienne d’incertitude et de liquidité et donc la prise en compte de la manière dont les facteurs 457financiers affectent l’économie et la répartition du revenu (p. 371). On obtient ainsi une vision d’un système composé de différentes « briques ». Une brique supplémentaire pourrait être l’analyse de la liquidité et de la fragilité financière selon Minsky (1975) (p. 378). Cependant il n’est pas précisé comment cette dernière analyse en termes de portefeuilles financiers s’articulerait avec la représentation de l’économie sraffaienne.
La notion de liquidité est revisitée d’un point de vue d’histoire de la pensée par Luca Fantacci et Eleonora Sanfilippo, dans leur contribution « The Original Meaning of “Liquidity Trap” in the Early Discussion Between Roberston and Keynes ». La « trappe à liquidité » n’apparait plus comme un problème d’inefficacité de la politique monétaire à un certain niveau du taux d’intérêt (donc des formes des courbes d’offre et demande de monnaie) mais comme un problème plus général d’incertitude qui peut se manifester à différents niveaux du taux d’intérêt sous forme de « préférence pour la liquidité » non temporaire fragilisant le système productif. Les auteurs montrent que cette conception keynésienne est élaborée au cours des échanges entre Robertson et Keynes et que ce dernier ne se réfère pas à la notion de « trappe à liquidité ».
On retrouve les mêmes préoccupations dans l’étude de Richard Van den Berg, « Keynes, Schumpeter. Mercantilism and Liquidity Preference : Some Reflections on How We Do History of Economic Thought ». L’auteur s’interroge sur la vision de Schumpeter de la préférence pour la liquidité de Keynes à partir de sa lecture d’un passage de celui qu’il considère comme un prédécesseur de Keynes en la matière : Postlethwayt, en fait inspiré de Forbonnais (Schumpeter, 1954, p. 372, n. 15). En réalité, on doit prendre en compte le fait que Schumpeter est amené à faire cette interprétation car il écrit après la révolution keynésienne. Et ceci peut être le cas de plusieurs historiens de la pensée économique qui, cherchant à relier les théories et politiques à leurs origines intellectuelles, se croient exempts de toute méthodologie rétrospective et qui sont en fait les « esclaves » de quelques économistes qui sont leurs contemporains (p. 336). Pour éviter ce biais, il est nécessaire de prendre en compte les contextes historiques différents dans lesquels les auteurs écrivent comme l’a souligné Annalisa Rosselli.
La richesse des contributions de ce livre et les débats auxquels il introduit rendent compte du renouvellement et de l’actualité de la recherche en histoire de la pensée économique qui se considère comme partie intégrante 458de la recherche en économie. Proposant une approche pluraliste et critique, l’ouvrage met aussi en évidence une vision non conventionnelle ou même hétérodoxe qui peut être utile pour explorer les problèmes économiques contemporains dans des perspectives nouvelles. Ainsi ce livre intéressera des lecteurs qui ne sont pas des historiens de la pensée économique mais qui sont concernés par divers domaines du champ économique et social.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Ouvrages
Deleplace, Ghislain [2017], Ricardo on Money. A Reappraisal. Abingdon, Routledge.
Marcuzzo, Maria Cristina & Rosselli, Annalisa [1991], Ricardo and the Gold Standard : The Foundations of the International Monetary Order, London, Macmillan.
Marcuzzo, Maria Cristina & Rosselli, Annalisa [2002], “Economics As History of Economics : The Italian Case in Retrospect”. In : E.R Weintraub (ed.), The Future of The History of Economics, Durham, NC, Duke University Press, p. 98-109.
Minsky, Hyman P. [1975], John Maynard Keynes. New York, Columbia University Press.
Schumpeter, Joseph A. [1954], History of economic analysis, London, Allen and Unwin.
Revues et contributions dans des ouvrages collectifs
Bettio, Fabio & Rosselli, Annalisa [2018], Gender Budgeting in Italy : A Laboratory for Alternative Methodologies ? In 0’Hagan Angela & Klatzer Elisabeth (éd.), Gender Budgeting in Europe, Cham, Palgrave Macmillan, p. 100-220.
Marcuzzo, Maria Cristina. & Rosselli, Annalisa [1994], “The Standard Commodity and the Standard of Money”, Cahiers d’économie politique, vol. 23, no 1, p. 19-31.
Marcuzzo, Maria Cristina & Rosselli, Annalisa [2011], « Sraffa and His Arguments Against ‘Marginism’ », Cambridge Journal of Economics, vol. 35, no 1, p. 219-231.
Rosselli, Annalisa [2013], “Economic History and History of Economics : in Praise of an Old Relationship”, The European Journal of the History of Economic Though, vol. 20, no 6, p. 865-881.
1 Turgot, « Lettre à Du Pont » de 1767, dans Gustave Schelle, Œuvres de Turgot et documents le concernant, tome deuxième, Paris, Félix Alcan, 1914, p. 678.
2 Marquis de Mirabeau, François Quesnay, Traité de la monarchie (1757-1759), édité et présenté par Gino Longhitano, Paris, L’Harmattan, 1999.
3 Site des Classiques Garnier, consulté le 30/10/2021.
4 I. Fisher, [2015]100 % Monnaie. Changer de système monétaire pour sauver le capitalisme, Omnia Veritas.
5 R. J. Phillips, [1995]The Chicago Plan and New Deal Banking Reform, Armonk, NY, M.E. Sharpe.
6 R. W. Dimand, [1993] “100% Money : Irving Fisher and the Banking Reform in the 1930s.”, History of Economic Ideas, vol. 1, No 2, p. 59–76.
7 L. Walras, [1898] « La Caisse d’épargne postale de Vienne et le comptabilisme social », Revue d’économie politique, vol. 12, No 3, p. 202-220.
8 Marcuzzo & Rosselli (2002).
9 Marcuzzo & Rosselli (1991).
10 R. Arena s’appuie sur les arguments de Marcuzzo & Rosselli (2011).
11 Bettio & Rosselli (2018).