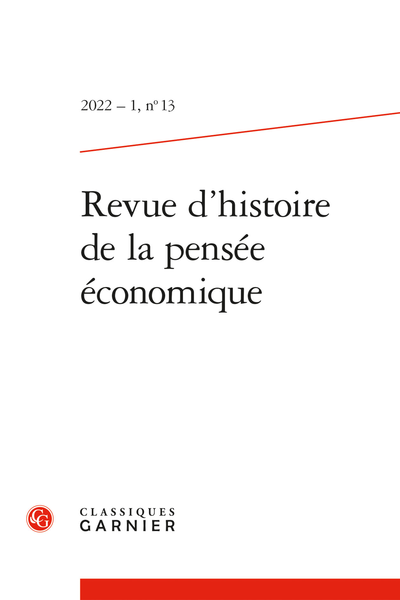
Benjamin Constant et l'économie politique
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Revue d’histoire de la pensée économique
2022 – 1, n° 13. varia - Auteur : De Luca (Stefano)
- Résumé : Dans la réflexion de Benjamin Constant, l’économie politique occupe une place importante, qui a rarement reçu l’attention qu’elle méritait. Le but de cet essai est de reconstruire analytiquement cette réflexion, telle que Constant l’a développée dans les Principes de politique (1806) et le Commentaire à Filangieri, et de répondre aux questions suivantes : quel genre de rapport Constant entretient-il avec l’économie politique ? Quelle place les libertés économiques occupent-elles dans son système de pensée ? Et enfin, est-ce que la question sociale, dont la présence est manifeste dans le Commentaire, a affecté ses convictions économiques ?
- Pages : 79 à 113
- Revue : Revue d’histoire de la pensée économique
- Thème CLIL : 3340 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Histoire économique
- EAN : 9782406132547
- ISBN : 978-2-406-13254-7
- ISSN : 2495-8670
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-13254-7.p.0079
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 01/06/2022
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : Constant, Économie politique, Smith, Malthus, Sismondi, Dunoyer
BENJAMIN CONSTANT
ET L’ÉCONOMIE POLITIQUE
Stefano De Luca
Université « Suor Orsola Benincasa » de Naples
INTRODUCTION
Dans la réflexion de Benjamin Constant, l’économie politique occupe une place importante qui a rarement reçu l’attention qu’elle méritait1. Ce n’est pas par hasard que parmi les critiques qu’il adresse à Montesquieu et à Rousseau il y a celle de leur ignorance en matière d’économie : à l’auteur de l’Esprit des lois, qu’il admirait pourtant profondément, il reproche de n’avoir « que des notions très superficielles en économie politique » (Constant, 1806a, p. 305) ; tandis qu’à l’auteur du Contrat social, mais aussi de l’entrée Économie politique dans l’Encyclopédie, il fait grief de n’avoir « aucune lumière » en matière de finances, mais plutôt un « mélange absurde de préjugés monarchistes et d’opinions républicaines » (Constant, 1806a, p. 267). D’ailleurs, les limites de Montesquieu et de Rousseau reflétaient une société caractérisée, à cette époque-là, par une « ignorance universelle des premiers principes de l’économie politique » (Constant, 1806a, p. 223) dans toutes les classes sociales. C’est précisément la raison pour laquelle cette même société était gouvernée par des lois qui avaient eu des effets funestes sur le commerce et les activités 80productives. Constant est si attaché à ce sujet que, lorsqu’il commencera à travailler sur son grand traité de politique – les Principes de politique de 1806, restés longtemps inédits, – il accordera une grande importance au débat sur les problèmes économiques et citera, plus souvent que tout autre auteur, Adam Smith.
La circonstance n’est pas à négliger. Les Principes de politique de 1806 constituent une œuvre importante dans l’histoire de la pensée politique. Lorsqu’elle sera publiée pour la première fois en 1980, on découvrira que la vision traditionnelle de Constant – considéré comme l’auteur d’écrits politiques sagaces et brillants, mais quand même d’écrits de circonstance – était erronée. En fait, Constant avait écrit une œuvre architectonique, dans laquelle il avait abordé tous les points principaux d’une théorie politique. D’abord contraint de la laisser de côté pour des raisons circonstancielles (la publier en 1806 aurait signifié susciter la colère de l’Empereur, qui venait de l’expulser du Tribunat quatre ans plus tôt), Constant préféra, dans les années de la Restauration, l’utiliser comme réservoir afin d’en pouvoir extraire des écrits plus percutants et polémiques, capables d’influer sur les questions politiques les plus urgents. Ainsi, le grand traité de 1806 resta au fond d’un tiroir et ne fut redécouvert par les savants qu’un siècle et demi plus tard, pour être finalement publié en 1980. Cette publication fut un événement considérable, précisément en vertu du caractère systématique de l’œuvre elle-même. Comme l’a écrit Tzvetan Todorov, jusqu’à ce moment-là on avait eu l’impression que la pensée politique européenne, dans les années qui suivirent la Révolution française, avait vécu une période de moindre intérêt : après la riche production des Lumières, culminant avec l’Esprit des lois et avec le Contrat social, et avant que la Démocratie en Amérique n’apparaisse à l’horizon, aucune œuvre ne semblait avoir atteint la même complexité théorique. Mais au moment de la découverte des Principes de politique, cette impression s’était évanouie : c’était comme si « le chaînon maquant », celui qui donnait un « sens nouveau » à l’histoire de la pensée politique, avait été retrouvé (Todorov, 1997b, p. 5). Les Principes, constituent en effet, la première tentative de repenser systématiquement, après le bouleversement révolutionnaire, une théorie des libertés (individuelles et collectives) appropriée à une société moderne. Et le fait que, à l’intérieur d’une tentative de ce genre, les thématiques économiques occupent 81une place significative devient alors, on le comprendra, quelque chose d’une valeur particulière.
Mais d’où vient l’intérêt de Constant – auteur qui est et restera essentiellement un penseur politique et un théoricien constitutionnel2 – pour l’économie politique ? Et quelles sont les raisons qui, vingt ans après la rédaction des Principes de politique, le pousseront à écrire « J’aime bien l’économie politique » ? Nous pouvons identifier au moins trois raisons.
On retrouve la première dans sa conception de la modernité, déjà pleinement développée dans le traité de 1806. Parmi les traits les plus importants qui permettent distinguer les Modernes des Anciens, Constant inclut le rôle fondamental assumé par le commerce3, terme avec lequel il indique les activités économiques au sens large : le but unique vers lequel les peuples modernes se dirigent n’est pas, comme dans l’Antiquité, la gloire militaire, mais « le repos, avec le repos l’aisance et pour arriver à l’aisance l’industrie » (Constant, 1806a, p. 423). D’où la centralité de l’activité économique, dont le développement est à la fois la cause et l’effet d’une indépendance toujours plus grande de la société civile et des individus par rapport au pouvoir politique. Cette indépendance est encore renforcée, selon Constant, par deux circonstances : le fait que la propriété, à l’époque moderne, est devenue mobile (et il est donc devenu difficile pour le pouvoir de la contrôler) et le rôle acquis par le crédit, qui, à bien des égards, a placé les gouvernants au service des gouvernés, en renversant les relations de pouvoir traditionnelles. Si l’opinion publique ne fait pas confiance aux gouvernements et à leurs comptes, le crédit disparaît et les gouvernements échouent : « un déficit de 60 millions a fait la Révolution française. Un déficit de 600 millions ne produisit pas, sous Vespasien, le moindre ébranlement dans l’Empire » (Constant, 1806a, p. 426). Mais si l’économie est devenue si importante dans le 82monde moderne, la nouvelle discipline qui en a fait son objet d’étude ne peut en aucun cas être négligée.
La deuxième raison de l’intérêt de Constant pour l’économie politique dériverait de ses convictions libérales. Tout en soutenant, comme nous le verrons, que la propriété et les activités économiques, contrairement à la pensée et à la religion, appartiennent à la juridiction de la société, Constant est convaincu que l’État fait toujours pire, et en dépensant plus, que les particuliers ; il est également convaincu qu’il existe une étroite corrélation entre les libertés économiques, d’un côté, et les libertés civiles et politiques, de l’autre. Ainsi, même si en théorie l’État peut intervenir dans la sphère économique, il est bon qu’il le fasse le moins possible : une thèse qui trouvait dans le courant dominant de l’économie politique de ces années-là (inspiré par Adam Smith et fortement représenté en France au premier chef par Jean-Baptiste Say) les arguments les plus solides et convaincants.
Enfin, la troisième raison de l’intérêt de Constant pour l’économie politique est liée au milieu culturel dans lequel – entre la fin du Directoire et l’âge consulaire – il consolide ses convictions les plus profondes. Il suffit de penser, à cet égard, à la proximité de Constant avec Say (et, plus en général, avec la culture idéologique) et avec Sismondi. Avec le premier, il partage l’aventure du Tribunat et l’expulsion à cause de leur ‘esprit d’opposition’ envers le Premier Consul ; avec le second, il partage l’appartenance au cercle des intellectuels qui se réunissaient autour de Mme de Staël. Et, comme on le sait, tous deux sont auteurs, entre 1802 et 1803, de deux ouvrages qui s’inscrivent dans le vif de la querelle française sur l’économie politique, une querelle qui intègre, relance et enrichit le débat d’outre-Manche4. Débat dans lequel l’Enquiry on Political Justice de Godwin (dont Constant entreprend, en 1798, une traduction française, avec ses commentaires)5 entre indirectement, puisque c’est aussi pour répondre à Godwin que Malthus écrit son Essay on Population, 83un essai dont Constant tient bien compte à l’époque et qui sera destiné à animer le débat économique pendant plusieurs années à venir (ainsi qu’à donner les bases pour définir l’économie en tant que ‘science triste’). Sur les thèses de Malthus, Constant reviendra abondamment dans la seconde œuvre, dans laquelle il traite directement des questions économiques : il s’agit du Commentaire à l’ouvrage de Filangieri, qui voit le jour entre 1822 et 1824 dans un contexte historique et sociopolitique profondément transformé par rapport à 1806. Non seulement pour des raisons de politique interne (Constant se retrouve face au pire moment de l’offensive ultra-royaliste contre les libéraux), mais aussi pour des raisons socio-économiques. C’est à ce moment-là qu’on assiste, en fait, à la survenance de la ‘question sociale’, qui, dans plusieurs pays d’Europe, et surtout en Angleterre, a produit non seulement des formes radicales de protestation, mais aussi l’apparition sur la scène d’un ‘quatrième État’ potentiellement révolutionnaire, composé de travailleurs salariés (ceux que Constant, déjà en 1824, appelait à plusieurs reprises « prolétaires »).
Nombreuses sont, donc, les raisons qui poussent Constant à s’intéresser à l’économie politique et à faire en sorte d’obtenir une connaissance de première main de ses auteurs : en plus de ceux qu’on a déjà nommés, c’est-à-dire Smith, Say et Sismondi (les auteurs qu’il cite le plus souvent), Constant se réfère également à Ganilh6 et au « judicieux » Garnier, ainsi qu’à Turgot, à Necker, à Steuart, aux physiocrates (en particulier au marquis de Mirabeau), à Condillac et à Galiani. Il faut dire que dans les œuvres où il prend position sur les questions économiques, Constant n’abordera jamais aucune question théorique fondamentale, comme le problème de la valeur ou celui du statut épistémologique de l’économie politique (même s’il est certainement proche de Say)7. Son intérêt et sa réflexion se focaliseront, comme on disait à l’époque, sur les « systèmes » qui découlent (ou : émanent) des doctrines.
84Le but des pages suivantes est, donc, de reconstruire analytiquement cette réflexion, telle que Constant l’a développée dans les sections économiques des Principes de politique (§ II) et du Commentaire à Filangieri (§ III). À la lumière de cette reconstruction, nous essaierons de répondre (§ IV), finalement, aux questions suivantes : quel genre de rapport Constant entretient-il avec l’économie politique ? Quelle place les libertés économiques occupent-elles, plus généralement, dans son système de pensée ? Et enfin, est-ce que la question sociale, dont la présence est manifeste dans le Commentaire, a affecté ses convictions économiques ?
I. L’ÉCONOMIE POLITIQUE DANS
LES PRINCIPES DE POLITIQUE DE 1806
Les Principes de politique de 1806 représentent l’aboutissement d’un long itinéraire de recherche, commencé en 1798 avec la traduction et le commentaire à l’Enquiry on Political Justice de Godwin et parsemé d’œuvres destinées à rester manuscrites8. Comme nous l’avons déjà évoqué, il s’agit d’une œuvre systématique et volumineuse, composée de 18 livres, subdivisés en 131 chapitres, suivis de denses Additions. À l’intérieur des Principes, il est possible de repérer un ordre logique clair, qui se développe en trois parties. Le but de la première partie (livres I-IX) est d’argumenter de manière exhaustive et innovatrice le principe de la limitation du pouvoir. Dans ces pages – où Constant critique Rousseau et se distingue de Montesquieu – la liberté et la souveraineté sont représentées comme deux sphères mutuellement exclusives. Dans la sphère de la liberté, toute décision est laissée à l’individu et l’intervention de l’État est toujours illégitime : c’est la sphère des droits individuels inaliénables, qui concernent la pensée, la religion, la liberté personnelle. Par contre, 85dans la sphère de la souveraineté les décisions n’appartiennent qu’à l’État : elle concerne la sécurité intérieure, la défense contre le danger extérieur et le prélèvement fiscal nécessaire à assurer ces fonctions. Il y a cependant une troisième sphère, intermédiaire ou mixte, à laquelle Constant consacre la deuxième partie de son traité (livres X-XV) : et c’est ici qu’on retrouve les sujets économiques, de la propriété aux activités économiques au sens large, en passant par les impôts. Enfin, la troisième partie (livres XVI-XVIII) fournit un contexte historico-philosophique à la théorie politique élaborée dans les livres précédents : c’est ici que Constant met au point sa théorie de la modernité politique, dans laquelle il y a tous les éléments qu’on retrouvera ensuite dans le célèbre Discours de la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes de 1819.
En ce qui concerne l’analyse des œuvres dans lesquelles Constant aborde des questions économiques, le premier point remarquable est leur étendue : les livres consacrés à la propriété et aux activités économiques (livres X et XII) occupent un quart de l’œuvre entière, qui, comme nous venons de le voir, est composée de 16 autres livres. On peut facilement en déduire que Constant attache une grande importance à l’économie, afin de mettre au point une théorie politique complète. Cette importance est bien mise en évidence dans le livre concernant la propriété, où l’économie et la politique sont inextricablement entrelacées, comme le démontre la question du droit de vote. Et c’est justement sur cette question, qui ouvre le livre X, qu’il faut s’attarder brièvement, car, bien qu’il s’agisse d’une question éminemment politique, elle met en lumière l’attitude de Constant envers ce que nous appellerions aujourd’hui une économie de marché. Une attitude qu’on pourrait ainsi résumer : Constant est conscient des duretés de l’économie de marché (dans certaines pages sa description de la propriété fait penser au « droit terrible » évoqué par Beccaria), mais en même temps il est convaincu que ce « droit terrible » est le meilleur outil pour garantir, certes non sans peine, le progrès économique et social, y compris celui orienté vers une plus grande égalité.
i.1 La propriÉtÉ, nÉcessaire et terrible
Notre analyse va, donc, commencer à partir de la question des droits politiques. Ce que Constant veut démontrer, c’est que les droits politiques, contrairement aux droits civils, ont besoin de certaines capacités pour être exercés. Si les droits civils représentent une protection contre 86les intrusions et le harcèlement du pouvoir, les droits politiques sont eux-mêmes un pouvoir, puisqu’ils permettent aux individus (quoique indirectement, à travers le système représentatif) de participer au pouvoir législatif. Les droits civils, écrit Constant, sont un bouclier ; les droits politiques sont une arme.
Il s’ensuit que les droits politiques ne peuvent être reconnus à n’importe qui : et ce n’est pas à cause d’une distinction arbitraire, comme celle entre hommes libres et esclaves dans l’Antiquité ou entre nobles et plébéiens sous l’Ancien Régime, mais c’est à cause d’un principe de raison, en vertu duquel, pour rendre des décisions contraignantes pour tous, il faut une véritable maturité au niveau de sa propre capacité de jugement (fruit de l’éducation) et une série d’intérêts durablement liés à la communauté à laquelle on appartient. Ce principe ‘capacitaire’ est respecté, souligne Constant, même dans les démocraties les plus pures, dans lesquelles on ne reconnaît le droit de vote ni aux mineurs ni aux étrangers : aux premiers parce qu’ils n’ont pas le jugement nécessaire, aux seconds parce que leurs intérêts ne sont pas durablement liés au sort du pays où ils se trouvent.
En abordant l’application de ce principe de raison à la société de son temps, Constant affirme que l’âge de majorité et la nationalité ne sont pas suffisants pour garantir ces qualités requises :
Ceux que l’indigence retient dans une éternelle dépendance et qu’elle condamne dès leur enfance à des travaux journaliers ne sont ni plus éclairés que les enfants sur les affaires publiques ni plus intéressés que des étrangers à une prospérité nationale, dont ils ne connaissent pas les éléments et dont ils ne partagent qu’indirectement les avantages (Constant, 1806a, p. 201).
La seule à donner le temps et les moyens nécessaires pour s’instruire, la seule à lier strictement les intérêts de l’individu à la prospérité de la nation, c’est la propriété : les propriétaires sont, donc, les seuls auxquels il faut reconnaître le droit de vote9. Ceux qui, à partir du principe général 87d’égalité, en font dériver immédiatement la nécessité d’égalité politique, raisonnent « dans une hypothèse inapplicable à l’état actuel des sociétés » (Constant, 1806a, p. 201). L’existence de la propriété détermine une inégalité bien plus grande que celle d’avoir ou ne pas avoir de droits politiques : si l’on admet cette inégalité, il faudra en déduire toutes les conséquences qui en découlent. Elle ne peut pas être surmontée par des moyens purement politiques ; la seule solution serait économique et impliquerait que tout le monde soit propriétaire ou que personne ne le soit pas. Mais l’abolition de la propriété, selon Constant, serait nuisible au progrès, à la prospérité et à l’égalité elle-même.
Les raisons de cette conclusion apparaissent lorsque Constant aborde le thème de la nature de la propriété. Il rejette la conception fondée sur le droit naturel, qui caractérisait l’école physiocratique (ainsi que celle d’ascendance lockéenne), en l’accusant d’être une conception métaphysique. La propriété n’est pas un droit naturel, c’est-à-dire un droit antérieur à la société, puisque « sans l’association, qui lui donne une garantie, elle ne serait que le droit du premier occupant, en d’autres mots, le droit de la force, c’est-à-dire un droit qui n’en est pas un » (Constant, 1806a, p. 202). La preuve en est que s’il est possible d’imaginer une société sans propriété (même s’il s’agirait d’une société extrêmement pauvre), il est, au contraire, impossible d’imaginer la propriété sans une forme de société garantissant sa jouissance. La propriété « n’est autre chose qu’une convention sociale » (Constant, 1806a, p. 202) basée sur l’expérience : 88la société a découvert qu’elle est la meilleure façon d’allouer des biens rares et d’encourager le travail. En d’autres termes, la société reconnaît le droit à la propriété parce qu’elle y voit le meilleur outil pour garantir le progrès et la prospérité (meilleur outil qui, il est bon de le répéter, ne l’est pas sans peine).
Conformément à cette approche utilitariste, Constant n’échappe pas à la confrontation avec les théoriciens de son abolition. Il pense surtout à l’Enquiry on Political Justice de Godwin, à l’époque écrivain célèbre et influent (que, comme nous l’avons déjà vu, Constant connaissait très bien). Les thèses d’auteurs tels que Godwin lui semblent viciées par un optimisme utopique : elles postulent un épanouissement de la culture qui un jour sera peut-être atteint, mais sur lequel il serait absurde de fonder les institutions actuelles ; et, plus important encore, elles prétendent démontrer qu’il y aura une diminution du travail nécessaire à la subsistance, ce qui dépasse toute invention à laquelle on peut songer. Il faut remarquer que Constant reconnaît le rôle du progrès technologique, il en est le défenseur (il considère comme une conquête chaque étape vers le remplacement du travail manuel par des machines) et il est également convaincu que sa course est destinée à une accélération progressive. Mais il estime que l’humanité est très loin de pouvoir formuler l’hypothèse d’une disparition complète du travail manuel. Et pourtant, c’est seulement cette disparition, associée à une très large disponibilité de biens, qui pourrait rendre la propriété superflue. À moins de supposer, continue Constant, que ce type de travail soit également partagé entre les hommes : mais cette division est non seulement impossible, elle serait aussi indésirable, car elle entraînerait non pas le progrès mais la régression de l’humanité. En effet, elle détruirait « la division du travail, base du perfectionnement de tous les arts et de toutes les sciences ». D’où l’hétérogenèse des buts :
La faculté progressive, espoir favori des écrivains que je combats, périrait faute de temps et d’indépendance ; et l’égalité grossière et forcée qu’ils nous recommandent mettrait un obstacle invincible à l’établissement graduel de légalité véritable, celle du bonheur et des lumières (Constant, 1806a, p. 203).
Comme on le voit, Constant est en contraste avec l’optimisme utopique de Godwin, mais il ne tombe pas dans le pessimisme malthusien, car il croit que le progrès technologique est destiné à créer une disponibilité de ressources toujours plus grande ; en même temps, à la suite de Smith, 89il reconnaît dans la division du travail la base de toute amélioration et donc la source de toute prospérité.
Nous avons analysé jusqu’ici le fondement utilitariste et économique de la propriété. Mais il y a un autre aspect que Constant met en évidence. S’il est vrai que la propriété appartient à la juridiction de la société – et que par conséquent la société a sur la propriété « des droits qu’elle n’a point sur la liberté, la vie et les opinions de ses membres » (Constant, 1806a, p. 233) – il est aussi vrai que la propriété est intimement liée aux domaines sur lesquels la société n’a pas de juridiction, à commencer par la pensée. « La société doit en conséquence restreindre sa juridiction sur la propriété, parce qu’elle ne pourrait l’exercer dans toute son étendue, sans porter atteinte à des objets qui ne lui sont pas subordonnés » (Constant, 1806a, p. 233).
Nous pouvons maintenant récapituler. Pour Constant, la propriété, de plein droit, est sous la juridiction de la société et donc l’État peut intervenir sur elle. Mais deux ordres de considération – le premier lié à sa fonction de ‘moteur’ du progrès économique, le second lié à sa relation particulière avec les droits inaliénables – rendent nécessaire la limitation la plus rigoureuse de l’intervention de l’État. Constant théorise donc un rôle essentiellement négatif pour l’État, qui doit se borner à garantir la libre utilisation et circulation de la propriété, sans promulguer ni lois favorisant son accumulation, ni lois imposant sa division. Les premières privent la propriété de sa vraie nature et de son plus grand avantage (la mobilité, la circulation incessante), elles la transforment en privilège et déshéritent, de fait, les non-propriétaires. Les secondes sont inutiles et nuisibles : inutiles, puisqu’elles veulent imposer avec force « ce qui se ferait naturellement », la propriété tendant par sa nature à « se diviser » (Constant, 1806a, p. 238) ; nuisible, car une intervention perçue comme attentatoire à la liberté pousse les individus à la contourner, ce qui oblige l’autorité à intervenir à nouveau avec d’autres règles et, donc, déclenche un processus qui, dans le cas de la propriété, finit par créer d’innombrables obstacles à sa mutation, concrétisation et transmission. En réalité, le moyen le plus simple et le plus sûr de promouvoir la dissémination de la propriété est l’abolition de toutes les lois qui en entravent la division ; la seule intervention à mettre en œuvre est de type négatif. Le problème, c’est que « les gouvernements ne se contentent jamais d’actions négatives », même si la question de la transmission de la propriété « fournit un exemple 90frappant […] du bien que produirait quelquefois sans gêne et sans effort l’absence de l’intervention de l’autorité sur un objet » (Constant, 1806a, p. 238-239). Et c’est l’approche, nous allons bientôt le voir, que Constant soutiendra dans la sphère générale des activités économiques : l’État ne doit pas intervenir, il doit se taire, il doit laisser faire.
i.2 L ’ État minimal
En ouvrant le livre XII, consacré aux activités économiques et à la population, Constant ressent le besoin d’expliquer la raison pour laquelle il n’a pas placé la liberté économique parmi les droits inaliénables des individus. Cette raison réside dans la nature controversée du sujet : bien que les philosophes les plus éclairés du xviiie siècle aient démontré jusqu’à l’évidence que la restriction de la liberté économique est injuste, inutile et contre-productive, il y a encore beaucoup de doutes à ce propos. Et comme les principes de la liberté économique s’appuient sur une multitude de faits, pour surmonter ces doutes il faudrait un examen long et détaillé, qui dépasserait les limites et la nature d’un travail sur les principes de la politique. C’est pourquoi Constant, bien que convaincu que les libertés économiques et civiles sont liées les unes aux autres, préfère ne pas les mettre au même niveau : il craint que les désaccords sur les premières ne se répercutent sur les secondes. Mais, différemment des questions constitutionnelles, elles n’ont pas été effacées du traité : au contraire, Constant leur consacre un livre entier, qui se révèlera être le plus long de l’œuvre.
La première étape de Constant consiste à fixer les limites de la juridiction sociale sur les activités économiques : la société n’ayant qu’un seul droit sur les individus – de les empêcher de se nuire les uns aux autres –, sa juridiction sur les activités économiques ne sera légitime que si ces dernières sont nuisibles. Et puisque la « nature de l’industrie est de lutter contre l’industrie rivale, par une concurrence parfaitement libre et par des efforts pour atteindre une supériorité intrinsèque » (Constant, 1806a, p. 276), l’État aura le droit – en effet, l’obligation – d’intervenir uniquement si des moyens oppressifs ou frauduleux sont utilisés dans cette compétition. Mais ce droit d’intervention n’implique pas que l’État puisse employer contre l’entreprise de l’un ou en faveur de celle d’un autre les moyens qu’il doit également interdire à tout le monde : employer la « force du corps social, pour tourner au profit de 91quelques hommes les avantages que le but de la société est de garantir à tous » équivaut à créer un véritable « privilège » (Constant, 1806a, p. 277), quoique de nature économique.
Comme on le voit, Constant expose une conception libérale des relations économiques dès le début. L’État a une fonction négative : il doit garantir le fonctionnement régulier de la concurrence, sanctionner les comportements illégaux et empêcher la formation de monopoles. Par contre, toute fonction positive est exclue : l’État ne doit pas intervenir directement dans les mécanismes du marché – ni par des soutiens ni par des interdictions – car des interventions pareilles sont toujours nuisibles, et non seulement d’un point de vue économique.
Pour illustrer sa thèse, Constant prend en considération quelques exemples de réglementation de la vie économique. Tout d’abord, il porte son attention sur les corporations, c’est-à-dire sur les institutions destinées à réglementer l’accès et la formation pour certains métiers. Ces institutions, dit Constant, sont à la fois injustes et absurdes. Injustes, car entre l’individu et le travail (un travail qui le protège souvent du crime) il y a l’approbation des autres. Absurdes, car sous prétexte de perfectionnement, ils entravent « la concurrence, le plus sûr motif de perfectionnement » (Constant, 1806a, p. 281) : la qualité de la production est en effet beaucoup mieux garantie par l’intérêt des consommateurs plutôt que par une série de réglementations arbitraires. L’expérience, souligne Constant, s’est partout prononcée contre l’utilité prétendue de cette manie réglementaire. Par ailleurs, il faut rappeler que quelques années plus tard, Hegel attachera une grande importance aux corporations, en les plaçant au sommet de la section de la Philosophie du droit consacrée à la société civile, en leur attribuant la tâche de récupérer l’éthique perdue dans le « système des besoins » (coïncidant essentiellement avec le système de marché). De son côté, Sismondi, dans le Nouveaux principes d’économie politique, tout en considérant comme mauvaise l’idée de faire revivre les corporations et les jurandes, recommandera aux législateurs de s’appuyer sur leur expérience pour protéger les salariés des conséquences fortement négatives de la concurrence universelle comme la seule loi de la vie économique10.
92Parmi les réglementations injustes et inutiles, Constant place aussi celles visant à limiter l’augmentation des salaires. Il s’agit d’une vexation particulièrement « révoltante », non seulement parce qu’il s’agit, comme déjà remarqué par Smith, du sacrifice de la majorité de la société à la plus petite minorité, mais aussi parce qu’il s’agit du sacrifice des pauvres aux riches, de la partie industrieuse à la partie oisive (au moins comparativement), de la partie souffrante à cause des dures lois de la société à la partie favorisée par le destin et les institutions.
On ne saurait se représenter sans quelque pitié cette lutte de la misère contre l’avarice, où le pauvre, déjà pressé par ses besoins et ceux de sa famille, n’ayant d’espoir que dans son travail et ne pouvant attendre un instant, sans que la vie même des siens ne soit menacée, rencontre le riche, non seulement fort de son opulence et de la faculté qu’il a de réduire son adversaire en lui réfutant ce travail, qui est son unique ressource, mais encore armé de lois vexatoires, qui fixent les salaires sans égard aux circonstances, à l’habilité, au zèle de l’ouvrier (Constant, 1806a, p. 282).
Ces lois, continue Constant, visent à freiner les revendications ‘exorbitantes’ des salariés, comme si l’urgence des besoins ne les préparait pas à vendre leur temps et leur force au-dessous de leur valeur et comme si la concurrence n’avait pas tendance à maintenir le prix du travail à ce minimum compatible avec la subsistance. Fixer des limites à la croissance des salaires est donc tout à fait inutile et, ce qui compte le plus, est profondément injuste, car cela nuit à une classe qui est déjà socialement désavantagée et qui ne peut trouver le moyen d’améliorer sa condition que dans le travail.
Comme on peut le voir, Constant trace un cadre brutalement réaliste en ce qui concerne la condition des salariés dans la société capitaliste de l’époque. Ils représentent la classe sociale la plus laborieuse mais aussi la plus pauvre, ils sont défavorisés à cause de leur destin et des institutions et ils sont essentiellement à la merci des employeurs, qui souvent les sous-rémunèrent. S’il est vrai que le revenu de la classe sociale la plus nombreuse est ‘naturellement’ au minimum de subsistance et 93s’il est vrai que cette classe apparaît objectivement défavorisée dans la compétition sociale, on ne peut s’empêcher de constater qu’une telle analyse ne s’accorde pas avec l’optimisme constantien sur le progrès social et économique. Mais Constant ne semble pas avoir conscience de cette contradiction latente : malgré l’analyse réaliste des déséquilibres sociaux, les accents compatissants à l’égard de la condition des salariés et les critiques sévères adressées à la classe propriétaire, il pense encore que le mécanisme du marché ne peut en aucun cas être modifié, et que la classe la plus défavorisée devrait mettre tout son espoir dans le travail. D’ailleurs, un peu plus loin, il critique ouvertement les auteurs (Filangieri et le marquis de Mirabeau) qui suggéraient une intervention de l’État pour remédier à des situations de malaise social (on pensait en premier lieu aux travailleurs agricoles) ou pour encourager certaines activités : ceux-ci ne comprennent pas, selon Constant, que la cause de ces situations est généralement la présence d’un gouvernement arbitraire, que les mesures de secours ou d’encouragement éventuelles ne seraient que des palliatifs artificiels et temporaires, et que le seul remède efficace devrait être recherché « dans la liberté et dans la justice » (Constant, 1806a, p. 311).
Il est clair que, à l’intérieur d’une approche pareille, il n’y a pas de place pour des mesures protectionnistes. Ces mesures, explique Constant, visent à amener un pays à produire les biens qui sont généralement importés ; mais si ces biens sont importés, leur production sur placesera évidemment antiéconomique. Constant utilise le célèbre exemple smithien du vin : grâce à une série d’expédients, on pourrait produire un excellent vin en Écosse aussi, mais il coûterait trente fois plus cher que ce que coûte un bon vin importé d’un autre pays. De la même manière, on ne peut pas penser, comme certains croient, que l’importation de certains biens cause une sorte de paresse dans la population, car pour importer il faut, de toute façon, pouvoir disposer d’un capital et pour pouvoir en disposer il faut travailler. Il en résulte que c’est la totale liberté de production qui permet à un pays (et à un individu) de choisir les activités productives les plus profitables et de s’y parfaire. Constant, donc, prône la division internationale du travail, qui produit « les mêmes effets pour l’industrie des nations que pour celle des individus » (Constant, 1806a, p. 284). La logique du marché se révèle alors être une logique par excellence internationale.
94Après avoir critiqué les lois interdisant l’exportation de monnaie, Constant se focalise sur un thème qui avait à l’époque (et aura pendant les décennies suivantes) une très grande importance : le commerce du blé. Dans ce domaine, écrit Constant, les mesures prohibitionnistes sont de deux types : il y a celles visant à interdire l’entremise des particuliers (pour éviter les accumulations et les augmentations anormales du prix du blé) et celles visant à interdire les exportations (par crainte de famine). Dans les deux cas, les intentions sont louables, mais les moyens sont insuffisants et, en effet, ils n’atteignent pas leur but. Quant à l’intervention privée, Constant prononce un véritable éloge – encore une fois au nom de la division du travail – des marchands, dont les magasins produisent les effets positifs qu’on attend en vain des magasins publics, qui sont « une source d’abus et de dilapidations, comme tout ce qui est d’administration publique » (Constant, 1806a, p. 290). La classe marchande fait tout cela « par intérêt personnel sans doute, mais c’est que sous le régime de la liberté, l’intérêt personnel est l’allié le plus éclairé, le plus constant, le plus utile de l’intérêt général » (Constant, 1806a, p. 290).
Quant à l’exportation du blé, Constant reconnaît qu’il est très facile de donner des accents pathétiques au débat sur ce sujet, car on pense immédiatement aux individus avides et impitoyables qui exportent du blé alors que leur pays est en proie à la famine. Mais la question doit être abordée en évitant les déclamations et en partant d’un principe économique qui a été adopté dans tous les secteurs : l’abondance d’un bien découle de l’encouragement de la production et la production est encouragée en augmentant le nombre d’acheteurs possibles, certainement pas en le réduisant. L’erreur des apologistes des interdictions est de n’avoir considéré le blé que comme un objet de consommation, et non comme un objet de production. Ils disent : si on en consomme moins, il en restera davantage. Faux raisonnement, objecte Constant, car plus la consommation est limitée, plus la production est réduite et plus elle risque de devenir insuffisante, aussi parce qu’elle ne dépend pas exclusivement de l’homme, mais aussi de la variable incontrôlable des saisons. Et comme l’agriculteur se base sur les produits des années moyennes, s’il borne sa production à ce qui est strictement nécessaire, il ne suffit que d’une mauvaise année pour rendre ses approvisionnements insuffisants. Bref, le commerce des céréales doit être considéré comme 95tout autre commerce : il n’a besoin que de liberté et concurrence. Après avoir également abordé la question des taux d’intérêt11, Constant peut tirer des conclusions de son analyse : les « prohibitions en fait d’industrie et de commerce, comme toutes les autres prohibitions et plus que toutes le autres, mettent les individus en hostilité avec les gouvernements », et elles engendrent plus de corruption. En effet, elles donnent lieu à l’apparition de deux catégories d’êtres humains : ceux qui sont prêts à violer les lois et ceux qui vivent de la répression de telles violations, souvent par des méthodes immorales. Voilà pourquoi les restrictions à la liberté économique ont des effets pires que les restrictions civiles, qui sont quand même moralement plus graves : parce que leur violation assure un profit.
Après avoir critiqué le système des prohibitions – en s’adressant idéalement à ses auteurs, c’est-à-dire aux gouvernants –, Constant passe à l’examen du comportement des destinataires de ce système, à savoir les capitalistes (qu’il entend au sens de détenteurs de capitaux), les propriétaires de manufactures, les commerçants. L’image qui en ressort est, à certains égards, surprenante. Il ne faut pas croire, dit essentiellement Constant, que ces classes soient toujours favorables à la concurrence : même si elles opèrent dans le système de marché, elles sont prêtes à fouler aux pieds leurs principes si leurs intérêts sont lésés. Elles s’adressent elles-mêmes à l’autorité pour qu’elle entrave la concurrence et empêche l’introduction de nouvelles machines, de nouvelles productions, des améliorations dans les communications. Généralement, lorsque les profits baissent, les commerçants s’adressent à l’autorité pour obtenir des interventions extraordinaires et les capitalistes font de même lorsque les taux d’intérêt baissent ; quant aux propriétaires de manufactures, 96« chaque manufacture, comme chaque religion naissante, réclame la liberté », mais « chaque manufacture, comme chaque religion établie, prêche la persécution » (Constant, 1806a, p. 304).
Tout cela se produit, paradoxalement, au moment de la prospérité (c’est-à-dire au moment où le système basé sur la liberté économique prouve sa supériorité intrinsèque) : les profits des commerçants baissent à cause de la concurrence, de l’afflux plus important de capitaux et de la hausse des salaires, facteurs qui indiquent tous une phase de prospérité ; tout comme la baisse de l’intérêt se vérifie en période de prospérité, alors qu’il y a une hausse lorsque la situation financière est mauvaise ; enfin, des nouvelles manufactures apparaissent en période de croissance économique. Néanmoins, cette prospérité générale peut aller de pair avec les dommages causés à certains intérêts particuliers : ainsi, ces derniers apparaissent, en protestant contre la dégradation du commerce ou du capital, alors qu’au contraire le commerce et le capital prospèrent et il n’y a que certains commerçants et certains capitalistes qui connaissent un déclin.
Bref, Constant met en relief avec lucidité d’esprit les adhésions ‘idéologiques’ (c’est-à-dire ‘hypocrites’) au système des libertés, sans être victime, comme les marxistes ont longtemps cru, de la moindre illusion de classe. Si, dans la sphère de la vie civique, l’arbitraire signifie l’absence de règles égales pour tous (les règles qui visent à garantir la liberté personnelle et intellectuelle de chacun), dans la sphère de la vie économique l’arbitraire signifie la même chose, même si dans ce cas l’isonomie vise à garantir une compétition parfaite. Constant établit donc un parallélisme explicite entre la liberté civile et la liberté économique ; et il est très significatif que ce parallélisme soit invoqué en opposition avec l’attitude de ces classes sociales qui « recueillent, produisent ou accumulent pour vendre » (Constant, 1806a, p. 303).
Une fois la question des prohibitions conclue, Constant consacre quelques pages au système des récompenses et des encouragements. Ce système présente moins d’inconvénients que le premier, mais il reste toutefois dangereux pour au moins trois raisons. Premièrement, les encouragements ouvrent la voie à l’idée que l’autorité peut et doit intervenir dans le domaine économique ; et lorsque l’autorité n’atteint pas les objectifs qu’elle s’était donnés à travers les encouragements, elle aura probablement recours à des mesures coercitives. Deuxièmement, 97les encouragements dénaturent le mécanisme du marché et pèsent sur la société entière. En effet, les capitaux vont naturellement vers les emplois les plus profitables, sans nécessité d’aucun encouragement. Par conséquent, si un encouragement est nécessaire, cela signifie que l’emploi du capital n’est pas profitable et qu’il y a donc des fortes probabilités de subir des pertes. Un tel investissement est économiquement et socialement négatif. Une industrie qui ne peut pas se maintenir sans encouragement est une industrie qui produit malgré son déficit, ce qui signifie que le gouvernement l’indemnise ; et comme cette indemnité ne peut que provenir des impôts, l’encouragement reçu par cette industrie pèse sur tous les citoyens. Troisièmement, les encouragements nuisent à l’éthique du travail, car les classes laborieuses – au lieu de se baser sur le jugement des individus, un jugement qui dépend de la sagesse de la spéculation, de la qualité des produits, de la régularité de la conduite – se basent sur l’intervention des autorités. Et si la concurrence pousse à fabriquer des bons produits et à établir des bonnes relations commerciales, l’espoir d’un encouragement de l’État pousse à cultiver des relations de prudence et de clientèle. Mais le travail est une source de moralité précisément parce qu’il rend l’homme indépendant des autres hommes et il le fait dépendre exclusivement de l’engagement, de la prudence et de la régularité qu’il met dans sa vie. Constant, comme on peut voir, souligne la valeur éthique du système de marché : il accoutume les individus à ne dépendre que de leur propre engagement et de leurs capacités – en un mot, de leur travail – sans rechercher la protection ou les faveurs des autres hommes ; et le sentiment qui donne à l’homme plus d’énergie et de moralité, observe Constant, est celui de n’avoir de devoirs qu’envers soi-même et de ne pouvoir compter que sur ses propres forces. Seulement dans deux cas les encouragements sont, selon Constant, légitimes : lorsqu’il s’agit de créer une nouvelle branche industrielle qui a besoin d’anticipations considérables et lorsqu’il s’agit d’aider les classes industrielles ou agricoles touchées par des calamités imprévues.
Après avoir analysé et critiqué les formes spécifiques des interventions de l’État dans l’économie, Constant conclut sa réflexion en examinant leur présupposé théorique, à savoir la conviction que l’activité économique ne peut pas être laissée à elle-même, mais doit être dirigée d’en haut. En lisant les œuvres de nombreux écrivains – observe Constant, qui se réfère explicitement à Filangieri, mais fait allusion quand même à Quesnay 98et à Mercier de La Rivière –, on serait tenté de croire qu’il n’y a rien de plus stupide et de moins éclairé que l’intérêt individuel. Ces auteurs soutiennent que si le gouvernement n’encourageait pas l’agriculture, tous les agriculteurs se retourneraient vers le secteur manufacturier et les campagnes resteraient en friche et que si le gouvernement n’encourageait pas la manufacture, tous les travailleurs resteraient dans les campagnes. Bref, ils sont convaincus que sans l’intervention de l’autorité la vie économique languirait ou serait, en tout cas, le théâtre de comportements irrationnels et désavantageux. Constant est d’un avis diamétralement opposé : les différentes branches de l’activité économique et productive ne trouvent leur équilibre optimal que si elles sont laissées libres de suivre l’intérêt individuel. Lorsqu’il n’y a pas de privilège abusif qui renverse l’ordre naturel de la vie économique, l’avantage d’une profession vient toujours de son utilité absolue et de sa rareté relative. Le véritable encouragement pour tous les types de travaux est donc la nécessité de travailler ; et la liberté, seule, suffit pour les maintenir tous dans une proportion saine et exacte. Les productions ont toujours tendance à se mettre sur le même niveau que celui des besoins – écrit Constant, en se référant en note à Smith et Say – sans que l’autorité n’intervienne. Lorsqu’un certain type d’industrie est rare, le prix de ses produits augmente ; avec cette augmentation de prix, cette branche productive attire des capitaux, des entrepreneurs et des travailleurs. De cette façon, elle devient plus populaire et, par conséquent, le prix de ses produits baisse ; pour cette raison, une partie du capital et des travailleurs se retournent vers d’autres emplois. Ensuite, la production étant de nouveau plus rare, le prix monte et les conditions antérieures réapparaissent encore une fois : tout cela jusqu’à ce que la production et son prix aboutissent à un équilibre parfait.
Constant peut maintenant conclure sa réflexion approfondie sur la relation entre l’État et l’économie. Bien qu’il soit conscient de ne pas avoir été capable de démontrer pleinement ses principes, il croit :
[D]’avoir dit assez pour prouver que l’effet de l’intervention de l’autorité, dans ce qui concerne l’industrie, quelquefois nécessaire peut-être, n’est jamais avantageux. L’on peut s’y résigner comme à un mal inévitable ; mais on doit tendre toujours à circonscrire ce mal, dans les limites plus resserrées. Mon opinion rencontrera sans doute un grand nombre d’opposants. Dans un pays où le gouvernement distribue des secours et des récompenses, beaucoup 99d’espérances sont éveillés. Avant d’avoir été déçues, elles doivent être mécontentes d’un système qui ne remplace la faveur que par la liberté. La liberté fait un bien, pur ainsi dire négatif, quoique graduel et général. La faveur procure des avantages positifs, immédiats et personnels. L’égoïsme et les vues cortes seront toujours contre la liberté et pour la faveur (Constant, 1806a, p. 314).
II. LE COMMENTAIRE À FILANGIERI :
ENTRE SMITH ET SISMONDI
Le Commentaire à Filangieri a été publié au bout de trois ans : le premier volume, contenant la première partie de l’œuvre (consacrée à la politique), a été publié en 1822 ; le deuxième volume, qui contient les trois autres parties, a été publié en 1824. Paradoxalement, nous savons très peu à propos de la rédaction de cette œuvre – contrairement aux Principes de politique12. On sait, toutefois, que le contexte politique et social était bien pire que celui des premières années de la Restauration : sur le plan politique, en raison du virage réactionnaire qui a suivi l’assassinat du duc de Berry ; sur le plan économique, en raison des crises répétées qui, notamment en Angleterre, avaient provoqué de très fortes tensions sociales.
Dans le Commentaire, c’est la deuxième partie qui est consacrée aux problèmes économiques : elle se compose de 15 chapitres, dont le premier est un véhément « J’accuse » contre la traite des Noirs (une accusation dans laquelle Constant ne manque pas de signaler le racisme répandu dans l’opinion publique européenne)13 ; ce premier chapitre est suivi de 100six autres chapitres consacrés au sujet de la population (sujet qu’il avait abordé dans les Principes plutôt hâtivement), d’un chapitre consacré à la division des propriétés (le plus novateur, comme on le verra) et d’autres chapitres consacrés aux sujets déjà abordés dans le livre XII des Principes de 1806.
Dès la première partie du Commentaire, consacrée à la politique mais pleine de réflexions économiques, Constant réaffirme l’idée de l’État minimal déjà exposée dans les Principes de 1806, en lui donnant, si possible, des formulations encore plus claires : le « résultat unique, éternel, seul raisonnable et seul salutaire » de toute enquête sur le rôle de l’État est que le maintien de l’ordre intérieur et la défense contre les agressions extérieures sont son seul but légitime : « le reste est du luxe et du luxe funeste » (Constant, 1822-1824a, p. 65). Parler, comme Filangieri, de législation ne change rien du tout : « La législation comme le gouvernement n’a que deux objets : le premier, de prévenir les désordres intérieurs ; le second, de repousser les invasions étrangères. Tout est usurpation par de là cette borne » (Constant, 1822-1824a, p. 51). Par conséquent, les « fonctions du gouvernement sont purement négatives ». Et cela, dans la sphère économique, signifie que l’État doit adhérer à la formule que les physiocrates ont lancée au milieu du xviiie siècle (mais à laquelle ils n’ont pas été entièrement fidèles) : laissez faire, laissez passer14. L’État ne doit pas intervenir pour interdire ou encourager telle ou telle activité, ni pour redistribuer les revenus :
La législation ne doit point chercher à fixer les richesses dans l’État et à les distribuer avec équité. […] Les richesses se distribuent et se répartissent d’elles-mêmes dans un parfait équilibre, quand la division des propriétés n’est pas gênée et que l’exercice de l’industrie ne rencontre point d’entraves. Or, ce qui peut arriver de plus favorable à l’une et à l’autre, c’est la neutralité, le silence de la loi (Constant, 1822-1824a, p. 53).
À la lumière de ces thèses, Filangieri – avec son exaltation de la législation – représente une sorte de cible idéale : il incarne le mythe 101du législateur, c’est-à-dire la conviction que l’État peut et sait faire face, mieux que tout autre acteur, à chaque question de la vie sociale, de l’économie à la morale, de l’éducation à la religion. Cette conviction naît, selon Constant, d’une méprise répandue parmi plusieurs philosophes bien intentionnés du siècle des Lumières (parmi lesquels le plus célèbre est Rousseau) : ils ont vu le pouvoir, avec son immense puissance, causer de nombreux maux et ils l’ont à juste titre et efficacement dénoncé ; mais ils sont convaincus qu’en confiant cette même puissance au bon acteur (le peuple, dans le cas de Rousseau) ou en attachant son action à la raison (c’est le cas de Filangieri), le pouvoir pourrait également bien faire. Aux yeux de Constant, il s’agit d’un formidable malentendu, qui inspire « mille espérances gigantesques », mais qui se base sur « un principe que les faits sont loin de nous présenter comme démontré, c’est que ceux qui font les lois sont nécessairement plus éclairés que ceux qui leur obéissent » (Constant, 1822-1824a, p. 64-65). En fait, les gouvernants non seulement sont dépourvus d’une sagesse supérieure à celle des gouvernés, mais, au contraire, leur condition (le fait même d’avoir ce pouvoir) nuit encore plus à leur faible jugement. Filangieri, Rousseau et Mably considéraient l’autorité comme une solution, sans comprendre qu’elle faisait partie du problème : il ne s’agissait pas de la déplacer d’un détenteur à un autre ou de l’éduquer, mais de la limiter, de la circonscrire, de la contrôler. « Ils ne sentirent point que le vice était dans son intervention même, et que, loin de la solliciter d’agir autrement qu’elle n’agissait, il fallait la supplier de ne point agir ». Ils n’avaient pas compris qu’« il fallait s’en remettre à la liberté, à l’intérêt individuel, à l’activité qu’inspirent à l’homme l’exercice de ses propres facultés et l’absence de toute entrave ». Sous un régime de liberté, Constant le répète avec les mêmes mots de 1806, en effet, « l’intérêt personnel est l’allié le plus éclairé, le plus constant, le plus utile de l’intérêt général » (Constant, 1822-1824a, p. 176).
Jusqu’ici Constant est, donc, disciple de Smith et Say, en 1824 comme en 1806 (en fait, dans une mesure encore plus grande, vu qu’il a reconnu à ce point le caractère plus moderne et dynamique de la propriété industrielle par rapport à la propriété foncière). Même sur des sujets tels que le commerce des céréales, la fixation des salaires, les corporations, les privilèges accordés à l’agriculture, à l’industrie et au commerce, Constant se borne à reprendre les chapitres correspondants 102dans le livre XII des Principes de politique, s’inspirant toujours du principe smithien de la concurrence et du rôle négatif de l’État. Et pourtant, il y a, dans certains chapitres, des tournures nouvelles. Il y a des sujets sur lesquels on ressent l’influence du malaise social qui avait éclaté à plusieurs reprises en Angleterre après 1815 et qui avait poussé Sismondi à rédiger ses Nouveaux principes d’économie politique, que Constant a lu attentivement.
Le premier de ces sujets est celui de la population. La thèse sous-jacente est toujours ‘smithienne’ : l’État ne doit intervenir ni pour augmenter la population ni pour la réduire. Pour faire en sorte qu’elle augmente, il ne faudra que l’absence de harcèlement, une liberté totale de choisir son propre travail et une « division plus égale des propriétés », un processus qui se déroule naturellement, lorsqu’il n’est pas entravé, et qui amène à « l’augmentation des moyens de subsistance » (Constant, 1824, p. 128). À réduire la population, si nécessaire, ce seront les rigueurs de la nature et les calculs de l’intérêt personnel. Il n’y a, donc, pas besoin des formules impitoyables et tristes proposées par Malthus. Constant partage l’opposition de l’auteur anglais aux aides publiques (« qui sont communément mal administré[e]s, mal réparti[e]s » et surtout anti-éducatives)15, mais il met en garde contre la nature impitoyable et impolitique de son idée. Et c’est à ce moment que Constant ressent le besoin de clarifier son rapport avec l’économie politique.
J’aime bien l’économie politique ; j’applaudis aux calculs qui nous éclairent sur les résultats et sur les chances de notre triste et douloureuse destinée : mais je voudrais qu’on n’oubliât pas que l’homme n’est pas uniquement un signe arithmétique, et qu’il y a du sang dans ses veines et un besoin d’attachement dans son cœur (Constant, 1824, p. 135).
Malthus, avec la dureté de ses formules, s’inscrit parmi ces partisans exagérés de la propriété qui finissent par lui rendre un mauvais service, en poussant ses prérogatives au-delà de toute équité et prudence, et en fermant les yeux face aux conditions de ceux que Constant appelle maintenant les ‘prolétaires’, conditions sur lesquelles il écrit une page qui ressemble à un acte d’accusation :
103Il ne vous suffit pas que le prolétaire se résigne à n’avoir part à aucun des biens dont vous possédez le monopole ; il ne vous suffit pas qu’il renonce au feu, à la terre, à l’eau, à l’air même ; car sa condition l’oblige, tantôt à descendre au fond des abymes, tantôt à s’enterrer dans des ateliers où il respire à peine, et toujours à se priver de ce qu’il produit pour vous et de ce dont il vous voit jouir au prix de ses fatigues et de ses sueurs : une consolation lui restait, une consolation que la Providence touchée de pitié a répartie entre tous les êtres ; vous la lui disputez ! vous voulez que cette faculté donnée à tous, dont les animaux même ne sont pas privés, soit interdite à votre semblable parce qu’il est pauvre. Je le répète, il y a là au moins autant d’imprudence que d’iniquité (Constant, 1824, p. 143. C’est moi qui souligne en italique).
Si dans ce passage Constant décrit avec des accents presque ‘socialistes’ la condition de la classe ouvrière de ces années, il revient ensuite au droit de propriété lui-même, en réaffirmant sa nécessité, mais en soulignant son côté ‘terrible’ plus clairement qu’en 1806 :
La société, telle qu’elle existe, a consacré le droit de propriété, c’est-à-dire a voulu que le sol appartînt sans contestation à celui qui l’occupe de temps immémorial, ou d’après une transmission dont elle a prescrit les formes ; elle a voulu de plus que les productions, fruit du travail, appartinssent, soit au producteur, soit à ceux qui, par des conventions légales, lui fournissent les matériaux et les moyens de produire. La nécessité excuse ce qu’a fait à cet égard la société ; mais la condition néanmoins est dure et sévère. Les trois quarts de l’espèce humaine naissent déshérités ; les biens, communs à tous dans l’ordre naturel, deviennent dans l’ordre social le monopole de quelques-uns ; et ces derniers pour les conquérir ne se donnent, comme on l’a dit énergiquement, que la peine de naître (Constant, 1824, p. 146-147. C’est moi qui souligne en italique).
À la « classe dépouillée » des prolétaires ne restent que deux consolations : le travail et l’émigration. À travers le premier « le pauvre homme trouve dans ses bras, dans son industrie, un équivalent à la propriété dont les détenteurs oisifs sont forcés de lui abandonner une portion, pour qu’à leur profit il fasse valoir le reste ». À travers la seconde, il peut chercher ailleurs des conditions plus favorables. Pourtant, l’autorité lui conteste également ces deux ressources, en opprimant sa capacité de travailler à l’intérieur de la nation et en l’empêchant de l’emmener à l’étranger. « Avec une législation pareille, je le déclare, il n’y a aucun excès qu’on ne doive attendre, il n’y a pas de désordre qui nous puisse étonner » (Constant, 1824, p. 146-147).
104On retrouve des considérations similaires dans le chapitre sur la division de la propriété, dont la cible controversée est la grande propriété foncière : cette classe, en utilisant des lois telles que celles sur les substitutions ou le droit d’aînesse, entrave le processus naturel de division/distribution des propriétés et, pour cette raison même, crée les conditions d’une explosion révolutionnaire. La concentration de la propriété foncière, en effet, signifie que des grandes étendues de terres restent en friche, ce qui cause une diminution des moyens de subsistance et, donc, une diminution de la population, qui, en même temps, s’appauvrit. Le « nombre des prolétaires » double : mais parler de prolétariat, c’est parler de conditions sociales si misérables qu’elles rendent cette classe potentiellement révolutionnaire. Ainsi, paradoxalement, les « amis de l’ordre » les plus convaincus – les grands propriétaires fonciers – contribuent à créer les conditions qui menacent la stabilité des gouvernements. Mais ce n’est pas tout. Les grands propriétaires fonciers semblent ignorer les transformations sociales en cours, en particulier le poids croissant de la classe industrielle.
L’industrie fait chaque jour des progrès immenses, élève de nouvelles fortunes, et place de nouveaux riches à côté de ceux que la propriété a créés. Ils brillent du même éclat, la même clientèle les entoure, ou plutôt, comme ils ont besoin de plus de bras pour commencer et perpétuer leur fortune que le propriétaire foncier, une clientèle bien plus nombreuse que la sienne se presse chaque jour autour d’eux (Constant, 1824, p. 153).
Cette nouvelle classe est un redoutable concurrent de la classe des grands propriétaires fonciers. D’abord, parce que dans son sein il y a, selon Constant, une sorte d’homogénéité, puisque le simple ouvrier considère le riche industriel comme un homme qui s’est enrichi grâce au travail, donc à travers un chemin qu’il pourrait suivre lui aussi ; deuxièmement, la classe industrielle est stratifiée dans son intérieur, c’est-à-dire qu’elle abrite une grande classe moyenne.
Des classes intermédiaires plus ou moins opulentes, toutes dans l’aisance, viennent prendre place entre les riches et les simples ouvriers ; une chaîne se prolonge sans interruption depuis le plus pauvre journalier jusqu’au manufacturier millionnaire, et ses chaînons inégaux se lient par l’intérêt du jour, le souvenir de la veille, l’espoir du lendemain ; corps puissant, l’industrie étend sur toutes ses vastes ramifications ; corps homogène, toutes ses parties se soutiennent et s’entraident, parce que toutes, dans des classes différentes, 105ont quelque chose à défendre, et que la fortune du plus modeste marchand ne serait pas hors de danger, si l’on ébranlait celle de l’opulent banquier, acquise par les mêmes moyens. Ainsi l’intérêt de la masse, seul garant de celui du riche, vient de lui-même chez les industriels l’étayer et le garantir (Constant, 1824, p. 154).
L’opposition entre les deux classes esquissées par Constant semble suivre celle entre le Tiers-État et la Noblesse sous l’Ancien Régime : la classe industrielle est unie grâce au travail, stratifiée dans son sein, socialement et économiquement dynamique ; la classe des propriétaires fonciers est au contraire déséquilibrée, polarisée entre les richissimes et les misérables paysans, statique. La seule manière dont la classe des propriétaires fonciers peut conserver son influence sociale et politique est de « créer un grand nombre de petits propriétaires qui s’interposent entre le prolétaire et l’homme opulent […]. Lorsque le pauvre même peut acquérir un champ, il n’existe plus de classe ; tout prolétaire espère par ses travaux arriver au même point, et la richesse devient dans la propriété comme dans l’industrie une question de travail et d’assiduité. Dans l’autre hypothèse, la propriété foncière est une barrière qu’on ne peut franchir » (Constant, 1824, p. 155).
En faveur de cette thèse, Constant cite le récent écrit économique de Sismondi : « La plus forte garantie que puisse recevoir l’ordre établi, dit M. de Sismondi dans ses Nouveaux Principes d’économie politique, consiste dans une classe nombreuse de paysans propriétaires ». La référence concerne principalement la propriété foncière, mais Constant, en fait, se sert des préoccupations de Sismondi pour le secteur industriel aussi, en souhaitant une participation des travailleurs à la propriété. Tout cela à partir, encore une fois, d’une réflexion sur les droits de propriété :
Quelque avantageuse que soit à la société la garantie de la propriété, c’est une idée abstraite que conçoivent difficilement ceux pour lesquels elle semble ne garantir que des privations. Lorsque la propriété des terres est enlevée aux cultivateurs, et celle des manufactures aux ouvriers, tous ceux qui créent la richesse, et qui la voient sans cesse passer par leurs mains, sont étrangers à toutes les jouissances. Ils forment de beaucoup la plus nombreuse portion de la nation ; ils se disent les plus utiles, et se sentent déshérités. Une jalousie constante les excite contre les riches : à peine ose-t-on discuter devant eux les droits politiques, parce qu’on craint sans cesse qu’ils ne passent de cette discussion à celle des droits de propriété, et qu’ils ne demandent le partage des biens et des terres (Constant, 1824, p. 160. C’est moi qui souligne en italique).
106Enfin, il vaut la peine de constater l’apparition dans ces pages, dans au moins trois cas (que nous avons mis en évidence en italique), d’une sorte de théorie de la plus-value : les salariés sont définis par Constant comme les véritables créateurs de richesse, richesse qui, pourtant, en vertu du principe de propriété des moyens de production, ne reste pas entre leurs mains. Constant observe de façon réaliste qu’il est difficile pour eux d’arriver à comprendre les avantages de la propriété.
III. « J’AIME BIEN L’ÉCONOMIE POLITIQUE, MAIS… »
À la lumière de l’analyse menée jusqu’ici, nous pouvons maintenant essayer de répondre aux questions posées au début. En ce qui concerne la relation que Constant entretient avec l’économie politique, il s’agit bien évidemment d’une relation constante et approfondie, basée sur une connaissance de première main et mise à jour par rapport aux principaux économistes de l’époque (à la seule exception de Ricardo, qui n’est jamais mentionné). Il est tout aussi remarquable que Constant ait été le premier penseur politique de haut rang à reconnaître à l’économie politique un rôle important et un espace considérable. Cela n’échappa pas à son contemporain Charles Dunoyer, qui en 1827 écrivit que Constant était le premier écrivain politique à ne pas s’être borné « à disserter sur la nature, les principes, la forme des gouvernements », mais à avoir identifié le but de l’activité sociale, le principe de reproduction de la société, et à avoir demandé à en tenir compte aux fins de l’organisation politique. Ce principe était l’industrie, c’est-à-dire l’activité économique au sens large. Naturellement, Dunoyer n’avait pas pu lire les Principes de politique, mais il connaissait bien l’Esprit de conquête, d’où Constant avait repris à la lettre le passage de 1806 sur la triade « repos – aisance – industrie » en tant que but des peuples modernes. Say lui-même, écrivait Dunoyer, n’avait pas osé aller si loin, car il avait analysé les processus économiques, mais il les avait considérés comme des processus indépendants de l’organisation politique16. D’où le véritable éloge rendu à Constant :
107Je dois dire, à la gloire de M. Benjamin Constant, qu’il est le premier écrivain, du moins à ma connaissance, qui ait fait remarquer le but d’activité des peuples de notre temps, et qui ait mis ainsi sur la voie de reconnaître quel est le véritable objet de la politique (Dunoyer, 1827, p. 370).
Et pourtant, dans cette démarche, Dunoyer allait trop loin et finissait par faire de Constant un précurseur de l’industrialisme, c’est-à-dire une doctrine qui, même dans sa version libérale, attribue à l’activité économique un rôle ‘structurel’ et à la politique un rôle ‘de superstructure’. En fait, pour Constant, l’objet de la politique ne peut pas être borné à la création des conditions favorisant l’épanouissement maximum de l’activité économique. Il considère l’économie comme une dimension incontournable de la réflexion sur la politique et de la conception des institutions, mais sans lui attribuer un rôle fondamental ou directif17. Comme on l’a déjà vu, Constant rappelle à Malthus que l’être humain n’est pas seulement un homo œconomicus, un homme exclusivement guidé par le calcul rationnel de ses intérêts : il est quelque chose de beaucoup plus complexe, caractérisé par des besoins spirituels et culturels et par un besoin d’appartenance. Et ce que Constant écrit sur l’intérêt personnel dans son Commentaire est emblématique. D’un côté, il adhère, comme nous l’avons vu, au paradigme smithien : dans un régime de liberté, l’intérêt personnel est l’allié le plus sûr et le plus fiable de l’intérêt collectif. Mais, de l’autre, il met en garde contre la prétention d’en faire le seul principe (explicatif et régulateur) de la conduite humaine.
Il ne faut pas croire que les gains du commerce, les profits de l’industrie, la nécessité même de l’agriculture soient un mobile d’activité suffisant pour les hommes. L’on s’exagère souvent l’influence de l’intérêt personnel. L’intérêt est borné dans ses soins et grossier dans ses jouissances ; il travaille pour le présent sans jeter ses regards au loin dans l’avenir. L’homme dont l’opinion languit étouffée n’est pas longtemps excité même par son intérêt ; une sorte de stupeur s’empare de lui, et comme la paralysie s’étend d’une portion du corps à l’autre, elle s’étend aussi de l’une à l’autre de nos facultés (Constant, 1822-1824, p. 76-77).
Donc, l’activité économique ne peut pas devenir, comme Dunoyer le voudrait, l’objet exclusif de la politique. Dans cette perspective, les 108libertés économiques – et nous sommes arrivé à la deuxième question que nous nous sommes posée au début – sont, pour Constant, un ingrédient indispensable pour un système de liberté moderne, mais elles n’en constituent pas le fondement18 ; en effet, dans les Principes de 1806, Constant les avait sous-ordonnées axiologiquement par rapport aux libertés personnelles et de conscience. En d’autres termes, la sauvegarde des libertés économiques ne doit jamais être garantie au détriment de la sauvegarde des libertés civiles et politiques. Ce que Constant compose c’est une mosaïque, formée de différents carreaux qui doivent s’emboîter sans se chevaucher.
Pour mieux comprendre ce point, il faut s’attarder, quoique brièvement, sur la relation très débattue entre les libertés civiles (les libertés individuelles si chères aux Modernes) et les libertés politiques. Dans les textes dans lesquels il développe sa théorie de la modernité politique, Constant réalise une opération double. Contre les admirateurs des anciennes républiques, il souligne avec véhémence que la liberté des Modernes est principalement une condition d’indépendance individuelle, que le pouvoir politique doit respecter et protéger : et cela en vertu des changements dans lesquels le développement du commerce (à savoir, de l’économie) a joué un rôle essentiel. Mais Constant met en garde les Modernes contre eux-mêmes, c’est-à-dire contre leur tendance excessive à se retirer dans la dimension privée, favorisée par les jouissances que précisément le commerce a rendues possibles. Et contre cette tendance (instrumentalement encouragée par les détenteurs du pouvoir) Constant souligne l’importance de la liberté politique, c’est-à-dire du moment participatif et collectif de la liberté. Tout d’abord, il rappelle que sans la liberté politique, il est impossible de contrôler le pouvoir et qu’un pouvoir sans contrôle violera aussi, tôt ou tard, les libertés privées (y comprises les libertés économiques) auxquelles les Modernes sont si attachés. La participation politique est donc indispensable exactement pour protéger l’indépendance privée de l’invasion de l’État : une thèse libérale classique, selon laquelle les libertés individuelles sont le but et la liberté politique le moyen. Mais Constant a recours à un autre argument aussi : celui selon lequel la liberté politique – et le débat public qui en découle – élève les individus au-delà de la sphère des intérêts 109personnels, leur offrant un horizon plus large et plus haut, qui permet le perfectionnement moral. Comme on peut le voir, nous sommes ici en présence d’une thèse d’ascendance républicaine.
Le fait est que chez Constant il y a deux besoins distincts qui coexistent dans un équilibre instable, qui change selon les contextes et les objectifs polémiques. L’un est d’affirmer et de protéger la liberté moderne, qui voudrait émanciper l’individu de toute forme de pouvoir collectif et lui laisser le contrôle de ses propres choix. Il s’agit de la liberté individuelle, dont une partie indispensable s’exprime dans la sphère économique. L’autre besoin vient de la conscience aiguë des limites de l’individualisme moderne, s’il est conçu d’une façon exclusivement utilitariste-hédoniste : c’est ici que la liberté politique entre en jeu, comme moyen de perfectionnement moral. Liberté politique qui veut dire un débat public tournant autour de grands enjeux et permettant la formation de l’opinion publique, sans laquelle les États meurent ou se transforment en des déserts arides (ce qui s’est produit pendant l’ère napoléonienne). Ces déserts où les individus sont comme des grains de sable, des grains qui, quand la tempête arrive, écrit Constant dans De la religion, se transforment en boue. Ce sont des considérations qui anticipent celles de Tocqueville et qui nous font comprendre jusqu’à quel point la dimension politique de la liberté est importante pour Constant.
Si ces considérations s’appliquent aux droits civils et politiques, elles s’appliquent également aux libertés économiques qui leur sont étroitement liées. Encore une fois, il s’agit de combiner des types différents de liberté. Constant, comme nous l’avons vu, est un adepte du système smithien, un ardent défenseur des vertus de la concurrence et un théoricien de l’État minimal. Au-delà des différences d’accents (tantôt Constant écrit que l’État doit, tantôt qu’il peut, s’arrêter à ses fonctions minimales), le sens de sa position est indubitable : l’idéal régulateur est l’État minimal, même s’il n’est pas à exclure que, presque toujours pour des raisons circonstancielles, l’État puisse étendre son champ d’intervention. À cet égard, l’attitude de Constant en ce qui concerne la question sociale émergente est intéressante et révélatrice. Comme on l’a vu, il montre sans dissimulations le côté ‘terrible’ de la propriété et de l’économie de marché : sa description des conditions de vie du prolétariat a une connotation presque socialiste. Mais tout cela ne conduit pas Constant à franchir le seuil que franchira son ami 110Sismondi, c’est-à-dire à remettre en cause le système économique basé sur la concurrence et à demander l’intervention de l’État à des fins de péréquation et de distribution. Constant ne remet pas en cause le système smithien : la solution à ses maux doit être trouvée à l’intérieur de ses bornes, à travers le processus ‘naturel’ de subdivision/diffusion de la propriété et une valorisation toujours plus forte du travail. Face à la question sociale, la cible de Constant n’est pas l’économie de marché, mais la classe des grands propriétaires fonciers, qu’il oppose à la classe industrielle en tant qu’aristocratie privilégiée renouvelée par rapport à une classe nouvelle, plus large et plus dynamique : le Troisième État. Cependant, nous rencontrons ici l’une des rares occasions où Constant manque de réalisme : sa description de la classe industrielle – conçue comme l’ensemble de tous ceux qui travaillent dans les domaines de la manufacture, du commerce, de la finance – pèche clairement par optimisme. La stratification que Constant y voit – et surtout son caractère homogène, l’absence de conflit entre les propriétaires manufacturiers et les salariés – l’empêche de saisir les tensions très fortes qui l’agitent. Cela l’empêche aussi de saisir la dureté de la nouvelle aristocratie industrielle, qui, à certains égards, est supérieure à celle de l’aristocratie foncière, parce qu’elle est étrangère à toute considération qui ne soit pas strictement économique. Ici, c’est par le voile de l’idéologie (c’est-à-dire de l’illusion) que le regard de Constant a été obscurci.
111RÉFÉRENCES bibliographiQUeS
Bourdeau Michel, Fink Béatrice[2008], « De l’industrie à l’industrialisme : Benjamin Constant aux prises avec le Saint-Simonisme. Une étude en deux temps », Œuvres & Critiques, vol. XXXIII, n. 1, p. 61-78.
Constant, Benjamin [1798-1800], De la justice politique, d’après l’Enquiry on Political Justice de William Godwin. Volume dirigé par Lucia Omacini et Étienne Hofmann. Textes établis et annotés par Laura Saggiorato, introductions de Mauro Barberis et Laura Saggiorato. Tübingen, Niemeyer, 1998, 2 vol.
Constant, Benjamin [1806a], Principes de politique applicables à tous les gouvernements. Texte établi d’après les manuscrites de Lausanne et de Paris avec une introduction et des notes, par Étienne Hofmann, Genève, Droz, 1980.
Constant, Benjamin [1806b], Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs (texte de 1806). Volume dirigé par Kurt Kloocke. Établissement des textes, introductions, notes et répertoires par Liza Azorin, Fabien Detoc, Étienne Hofmann, Kurt Kloocke, Giovanni Paoletti et Laura Wilfinger, Berlin/New York, De Gruyter, 2011.
Constant, Benjamin [1822-1824a], Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri, Paris, Les Belles Lettres, 2004.
Constant, Benjamin [1822-1824b], Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri. Volume dirigé par Kurt Kloocke et Antonio Trampus. Établissement des textes, introductions et notes et par Kurt Kloocke, Michel Lutfalla, Franco Motta, Antonio Trampus ; instruments bibliographiques par Laura Wilfinger, Tübingen, Niemeyer, 2012.
Delbouille, Paul [2015], Benjamin Constant (1767-1830) : les égarements du cœur et les chemins de la pensée, Genève, Slatkine.
De Luca, Stefano [1997], « La riscoperta di Benjamin Constant (1980-1993) : tra liberalismo e democrazia », La Cultura, a. XXXV, n. 1, p. 145-174, n. 2, p. 295-324.
De Luca, Stefano [2003], Alle origini del liberalismo contemporaneo. Il pensiero di Benjamin Constant tra il Termidoro e l’Impero, Marco Editore.
De Luca, Stefano [2007], « Introduzione », in B. Constant, Principi di politica. Versione del 1806, a cura di S. De Luca, prefazione di E. Hofmann, Soveria Mannelli, Rubbettino, p. xxvii-lxii.
De Luca, Stefano [2015], « Alle origini della democrazia liberale. Benjamin Constant e la relazione tra indipendenza e partecipazione », Il Pensiero politico, n. 1-2, p. 46-57.
112Dunoyer, Charles, [1827] « Esquisse historique des doctrines auxquelles on a donné le nom d’Industrialisme, c’est-à-dire, des doctrines qui fondent la société sur l’Industrie », Revue encyclopédique, t. 33, p. 368-394.
Gauchet, Marcel [1980], « Benjamin Constant : l’illusion lucide du libéralisme », préface à B. Constant, De la liberté chez les modernes. Écrits politiques, Paris, Le Livre de Poche, p. 11-91.
Geiss, Peter [2011], Der Schatten des Volkes : Benjamin Constant und die Anfänge liberaler Repräsentationskultur im Frankreich der Restaurationszeit, 1814-1830, München, Oldenburg.
Hofmann, Étienne [1980], Les “Principes de politique” de Benjamin Constant : la genèse d’une œuvre et l’évolution de la pensée de leur auteur, 1789-1806, Genève, Droz.
Holmes, Stephen [1984], Benjamin Constant and the making of modern liberalism, New Haven-London, Yale University Press.
Jaume, Lucien [1997], L’individu effacé, ou le paradoxe du libéralisme français, Paris, Fayard.
Kloocke, Kurt, Lutfalla, Michel, Trampus, Antonio [2012], Introduction, dans Œuvres complètes de Benjamin Constant, t. XXVI, Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri, Tübingen, De Gruyter, 2012, p. 23-91.
Laurent, Alain [2004], Benjamin Constant, ce libéral radical en tout, dans B. Constant, Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri, Paris, Les Belles Lettres, p. 7-16.
Lee, James Mitchell [2002], “Doux Commerce, Social Organization, and Modern Liberty in the Thought of Benjamin Constant”, Annales Benjamin Constant, n. 25, p. 117-149.
Meuwly, Olivier [2002], « Constant économiste », dans Liberté et société. Constant et Tocqueville face aux limites du libéralisme moderne, Genève, Droz, p. 61-73.
Minart, Gérard [2019], Benjamin Constant, économiste. Pour un libéralisme économique qui concilie efficacité et justice, Paris, Édition L’Harmattan.
Paoletti, Giovanni [2006], Benjamin Constant et les anciens : politique, religion, histoire, Paris, Honoré Champion.
Paoletti, Giovanni [2017], Pensare la rivoluzione. Benjamin Constant e il gruppo di Coppet, Pisa, ETS.
Rosenblatt, Helena [2004], “Re-evaluating Benjamin Constant’s liberalism : industrialism, Saint-Simonianism and the Restoration years”, History of European Ideas, n. 30, p. 23-37.
Rosenblatt, Helena [2008], Liberal values : Benjamin Constant and the politics of religion, Cambridge, Cambridge University Press.
Rosenblatt, Helena (dir.) [2009], The Cambridge Companion to Constant, Cambridge, Cambridge University Press.
113Roulin, Jean-Marie, Bordas, Éric [2018] (sous la direction de), Benjamin Constant, l’esprit d’une œuvre, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne.
Say, Jean-Baptiste [1803], Traité d’économie politique, Paris, Imprimerie de Crapelet.
Sciara, Giuseppe [2013], La solitudine della libertà : Benjamin Constant e i dibattiti politico-costituzionali della prima Restaurazione e dei cento giorni, Soveria Mannelli, Rubbettino.
Sismondi, Simonde de [1803], De la richesse commerciale, ou principes d’économie politique appliqués à la legislation du Commerce, Genève, Paschoud.
Sismondi, Simonde de [1819], Nouveaux principes de l’économie politique, ou de la richesse dans ses rapports avec la population, Paris, Delaunay.
Steiner, Philippe [2003], « Say, les Idéologues et le Groupe de Coppet. La société industrielle comme système politique », Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, n. 2, p. 331-353.
Todorov, Tzvetan [1997a], Benjamin Constant. La passion démocratique, Paris, Hachette.
Todorov, Tzvetan [1997b], Préface, dans B. Constant, Principes de politique (version 1806-1810), Paris, Hachette.
Travers, Émeric [2005], Benjamin Constant, les principes et l’histoire, Paris, Honoré Champion.
Thouard, Denis [2020], Liberté et religion : relire Benjamin Constant, Paris, CNRS Éditions.
Vincent, K. Stevens [2011], Benjamin Constant and the Birth of French Liberalism, New York, Palgrave Mc Millan.
Weber, Florian [2004], Benjamin Constant und der liberale Verfassungsstaat. Politische Theorie nach der Französischen Revolution, WiesbadenVS Verlag für Sozialwissenschaften.
1 Parmi les exceptions on peut voir Fontana (1985), Lee (2002), Meuwly (2002), De Luca (2003), Rosenblatt (2004), Bourdeau et Fink (2008). Un livre intitulé Benjamin Constant, économiste (Minart, 2019), destiné essentiellement au grand public, est récemment paru.
2 La bibliographie sur Constant en tant que penseur politique et théoricien constitutionnel est naturellement très étendue. On se borne à rappeler, sans aucune exhaustivité, les études les plus significatives parues dès 1980, l’année qui a inauguré la « Constant-Renaissance » : Gauchet (1980), Hofmann (1980), Holmes (1984), Kloocke (1984), Barberis (1988), Fontana (1991), Kelly (1992), Jaume (1997), De Luca (1997, 2003), Weber (2004), Travers (2005), Paoletti (2006, 2017), Rosenblatt (2008, 2009), Geiss (2011), Vincent (2011), Sciara (2013), Delbouille (2015), Roulin et Bordàs (2018), Thouard (2020).
3 Sur la tradition du « doux commerce », dont Constant serait un théoricien, voir Lee (2002, p. 119-124).
4 J.C.L. Simonde, De la richesse commerciale, ou principes d’économie politique appliqués à la législation du Commerce, Genève, Paschoud, 1803 ; J.-B. Say, Traité d’économie politique, Paris, Imprimerie de Crapelet, 1803. Sur Say et ses relations avec Sismondi (et, plus en général, avec les membres du Groupe de Coppet) voir Steiner, 2003. Pour une vue d’ensemble concernant les thèses économiques soutenues par les Idéologues (et leur dette envers la culture écossaise), voir Lee (2002, p. 128-141).
5 B. Constant, De la justice politique, d’après l’Enquiry on Political Justice de William Godwin [1798-1800], dans Œuvres complètes de Benjamin Constant, Tűbingen, Niemeyer, 1998, 2 volumes.
6 Sur ce sujet, voir Lee (2002. p. 124-128).
7 Michel Lutfalla définit Constant, d’un point de vue économique, « un disciple de J.B. Say » (Kloocke, Lutfalla, Trampus, 2012, p. 62), opinion largement acceptable, à condition de rappeler deux différences importantes : celle sur la propriété (jusqu’à 1815 Constant considère la propriété foncière comme supérieure à la propriété industrielle) et celle sur l’utilitarisme, qui remet en question les limites de la démarche économique par rapport au problème politique. Sur la relation entre Say et Constant, voir aussi Steiner (2003, p. 334-335, 337-338) et Minart (2019, p. 19-27 et passim).
8 Sur la genèse complexe des Principes de politique, la référence obligatoire est la monographie d’Étienne Hofmann, qui accompagne la première édition de l’œuvre (Hofmann, 1980). Je me permets également de me référer à De Luca, 2003 (p. 141-150). Dans cet article, nous utiliserons l’édition critique des Principes de politique éditée par Hofmann (Constant, 1806a). En 2011, une nouvelle édition critique paraît, sous la direction de Kurt Kloocke et avec une introduction de Giovanni Paoletti, dans le cadre des Œuvres complètes de Constant (Constant, 1806b).
9 Dans les Principes de 1806, Constant soutient la thèse – dans laquelle on peut trouver un écho de la culture physiocratique – selon laquelle les droits politiques ne devraient être reconnus qu’aux propriétaires fonciers. Les caractéristiques de l’activité agricole (qui nécessite des soins constants ; qui produit des succès lents issus uniquement du travail ; qui dépend de la nature et non des désirs changeants des hommes ; qui mêle le patriotisme à l’intérêt ; qui ne nécessite pas de division excessive du travail) permettent le développement de qualités morales et intellectuelles (constance, persévérance, prudence, calme, réalisme, sagesse pratique) qui sont particulièrement utiles pour exercer les droits politiques. Les activités industrielles et/ou commerciales présentent, par contre, des caractéristiques presque opposées à ces dernières, vu qu’elles s’appuient sur le risque, qu’elles dépendent les désirs changeants des consommateurs, qu’elles séparent l’intérêt du patriotisme et développent moins de capacités mentales en raison de la grande division du travail qu’elles comportent. Quant à la propriété fondée sur les professions intellectuelles, elle se caractérise par une singulière absence d’esprit pratique, puisque les savants vivent loin des êtres humains et de leurs intérêts positifs. La conclusion de Constant est que toutes ces autres catégories de propriétaires – liées au commerce, à l’industrie, aux professions intellectuelles ou aux obligations d’État – ne pourront accéder aux droits politiques qu’après avoir acquis une propriété foncière. La description de l’activité industrielle est particulièrement défectueuse dans ce cas, où Constant, tout en lisant Say, ne semble pas distinguer entre le rôle entrepreneurial ou managérial et les rôles exécutifs. En général, il y a, en ce qui concerne ce thème, comme un écho de la culture physiocratique, filtré à travers Garnier. Constant changera d’avis en 1818, lorsqu’il reconnaîtra la propriété industrielle comme la forme de propriété la plus moderne et la plus dynamique, car fondée sur le travail.
10 « Ce ne sont point les jurandes qu’il s’agit de rétablir ; ce n’était que par hasard en quelque sorte qu’elles produisaient un effet avantageux que le législateur n’avait pas eu en vue. […] Mais c’est dans les effets que produisaient les jurandes, qu’il faut puiser des leçons sur la manière de combattre la calamité dont la société est aujourd’hui affligée. C’est dans cette expérience qu’il faut étudier les bornes que l’autorité législative peut mettre à la concurrence, de telle sorte qu’elle assure à chaque ouvrier une propriété certaine dans son travail, qu’à une époque de sa vie il puisse compter sur un revenu, et qu’il sache les chances qu’il court, lorsqu’il élève une famille » (Sismondi, 1819, p. 408).
11 Constant observe aussi la réapparition d’objections religieuses contre les prêts avec intérêt. Mais si la religion ne trouve rien à redire au fait qu’un propriétaire foncier vive du revenu de sa terre, pourquoi devrait-elle interdire au propriétaire d’un capital de vivre du revenu de son capital ? L’emprunt sans intérêt est un acte de charité privée, mais il ne peut pas devenir la règle de conduite des hommes. « Il est utile pour la société que les capitaux soient employés. Il est donc utile que ceux qui ne les emploient pas eux-mêmes les prêtent à d’autres qui les emploient. Mais si les capitaux prêtés ne rapportent aucun revenu, on aimera mieux les enfouir que les prêter, car on évitera les dangers du prêt » (Constant, 1806a, p. 297). L’autorité, à ce sujet, ne doit faire que trois choses : supprimer la fraude, garantir les accords légitimes et assurer leur exécution, déterminer le plus haut intérêt légal. En limitant le prêt avec intérêt, conclut Constant, il n’y a qu’un seul résultat : l’encouragement de l’usure.
12 Pour une reconstruction historico-philologique précise de la rédaction du texte, voir K. Kloocke, M. Lutfalla, A. Trampus, Introduction, in Œuvres complètes de Benjamin Constant, t. XXVI, Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri, Tübingen, De Gruyter, 2012, p. 77-91. Dans cet article nous utiliseront l’édition française (Constant, 1822-1824a).
13 « De nos jours, l’idée de disposer en Europe, sans rétribution du travail, et sans jugement de la vie d’un homme innocent, révolterait le moins éclairé et le moins scrupuleux d’entre nous. Mais on n’en est pas encore arrivé à ce point quand il s’agit des Nègres. Il y a malheureusement une portion du public européen qui ne les considère pas comme appartenant à la race humaine. Cette portion du public, qui rougirait d’assassiner et de voler sur la grande route, prend part sans scrupule à un commerce qui la séduit par ses bénéfices ; et elle s’étourdit par des sophismes pour se déguiser qu’entre elle et le meurtrier ou l’incendiaire il y a au moins parité » (Constant, 1822-1824a, p. 113).
14 « Les économistes eux-mêmes ont eu ce tort, pour la plupart. Ils étaient cependant d’autant plus inexcusables que leur maxime fondamentale semblait devoir les en préserver. Laisser faire et laisser passer était leur devise : mais ils ne l’appliquèrent guère qu’aux prohibitions. Les encouragements les séduisirent. Ils ne virent pas que les prohibitions et les encouragements ne sont que deux branches d’un même système et que tant qu’on admet les uns, l’on est menacé par les autres » (Constant, 1822-1824a, p. 30-31).
15 Les aides publiques « ôtent à l’homme, en le leurrant par une fausse espérance, le sentiment le plus salutaire, celui qui lui apprend que chacun ne doit compter que sur sa propre industrie, et n’attendre sa subsistance que de ses propres efforts » (Constant, 1822-1824a, p. 131).
16 « Les richesses sont indépendantes de la nature du gouvernement. Sous toutes les formes de gouvernement, un état peut prospérer s’il est bien administré. On a vu des monarques absolus enrichir leur pays, et des conseils populaires ruiner le leur. Les formes mêmes de l’administration publique n’influent qu’indirectement, accidentellement, sur la formation des richesses, qui est presqu’entièrement l’ouvrage des individus » (Say, 1803, p. ii).
17 Sur ce sujet, voir Rosenblatt (2004, p. 23-37).
18 Sur ce sujet, voir Vincent (2011, p. 204-205), qui dans son livre souligne justement la dimension culturelle du libéralisme constantien.