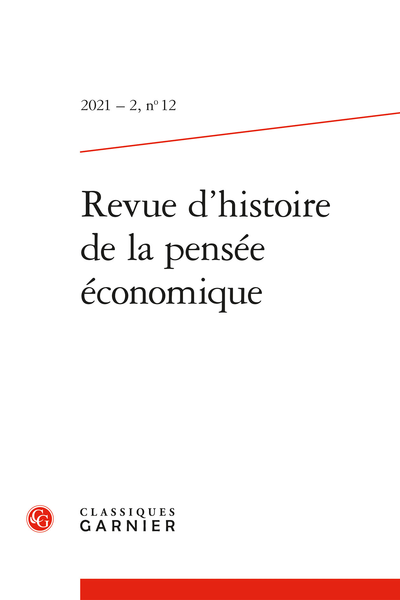
Le lexique de l’édition française de The General Theory de Keynes
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Revue d’histoire de la pensée économique
2021 – 2, n° 12. varia - Auteur : Largentaye (Hélène de)
- Résumé : Le lexique conçu par Jean de Largentaye se compose de 57 termes économiques français avec leurs équivalents en anglais. Il est le fruit de la correspondance des années 1938 et 1939 entre Keynes et Largentaye. À travers ce lexique, Largentaye a introduit de nouveaux termes dans le vocabulaire économique français tels que « le plein emploi », « la préférence pour la liquidité » ou « la propension marginale à consommer ». Seule l’édition française de The General Theory offre un pareil lexique.
- Pages : 75 à 125
- Revue : Revue d’histoire de la pensée économique
- Thème CLIL : 3340 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Histoire économique
- EAN : 9782406126157
- ISBN : 978-2-406-12615-7
- ISSN : 2495-8670
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12615-7.p.0075
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 08/12/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : Largentaye, traduction française, Keynes, The General Theory, lexique
Le lexique de l’Édition française
de THE GENERAL THEORY de Keynes1
Hélène de Largentaye
L’œuvre essentielle de la Théorie générale, c’est de donner des définitions et d’introduire des concepts nouveaux en économie. Les définitions que Keynes a données du revenu, de l’épargne, et de l’investissement sont maintenant unanimement admises.
Avant la Théorie générale (publiée en février 1936), on avait des notions extrêmement confuses sur ces concepts, ce qui explique que les économistes se disputaient en vain et que les politiques des gouvernements étaient presque toujours à contre-sens.
Jean de Largentaye (entretien avec son fils Bertrand, 1968).
76Cette observation à la fin de sa vie montre l’importance que Jean de Largentaye, traducteur de The General Theory, accordait aux définitions en langue française des termes et concepts économiques anglais.
Deux ans après sa parution en 1936 en Grande Bretagne, The General Theory n’était toujours pas traduite en français. Pourtant plusieurs ouvrages antérieurs de Keynes, The Economic Consequences of the Peace (1919), A Revision of the Treaty, (1921), A Tract on Monetary Reform (1922), The French Franc (1926 et 1928), Essays in Persuasion (1933), avaient été traduits respectivement par Paul Frank pour les trois premiers, René Lelu et Herbert Jacoby pour les deux derniers comme le précisa Keynes dans sa lettre du 22 juin 1939 (voir infra).
En 1936, la maison Payot avait décliné la proposition de l’éditeur anglais de publier une traduction française de The General Theory au motif qu’il n’y aurait pas eu de lectorat français pour un ouvrage aussi technique et sa rentabilité par suite n’aurait pu être assurée. En revanche, le contrat de traduction en allemand avait été conclu dès 1935, avant même la publication de la version originale en Angleterre et l’édition allemande était en vente dans les librairies dès décembre 1936 (voir Hélène de Largentaye, 2021).
Au début de l’année 1938, Jean de Largentaye, inspecteur des Finances chargé de mission sous l’autorité de Jacques Rueff à la direction du Mouvement général des fonds du ministère des Finances, constatant que ses collègues de l’administration n’avaient pas lu la dernière œuvre de Keynes, pourtant bien connue à l’étranger, entreprit de la traduire. Largentaye n’était ni universitaire, ni traducteur professionnel mais un fonctionnaire comprenant l’anglais et fortement motivé. Il avait en effet été marqué personnellement par la grande dépression de 1929 qui lui avait fait perdre son emploi d’ingénieur. Chargé de suivre l’actualité économique internationale au Mouvement général des fonds, il avait par ailleurs été impressionné par les bonnes performances de l’Allemagne nazie en matière de production et d’emploi. Il était convaincu qu’une autre politique, capable d’améliorer les résultats économiques, était possible en France à condition de bien comprendre les mécanismes de fonctionnement de l’économie, et en premier lieu les déterminants de variables telles que l’emploi, la demande effective (ou production ou revenu national) et l’investissement. L’ouvrage de Keynes fournissait la juste analyse de ces phénomènes. Outre ses obligations professionnelles au ministère des 77Finances, Jean de Largentaye était donc prêt à consacrer le temps nécessaire à cette traduction. Il estimait de son devoir de faire connaître en France une théorie nouvelle, mettant en cause les principes considérés comme sacrés tels que l’étalon-or et l’équilibre budgétaire et qui contraignaient les politiques économiques (voir Armand de Largentaye, 2021).
Lorsqu’il entreprit la traduction en 19382 certains concepts étaient inconnus et ceux qui ne l’étaient pas n’étaient pas toujours bien traduits ni correctement définis. Largentaye comprit assez vite qu’un lexique – une sorte de petit dictionnaire fournissant les définitions des termes économiques de la Théorie générale – était indispensable à la compréhension de l’œuvre de Keynes.
Le 31 janvier 1938, Largentaye écrivit à Keynes pour lui proposer ses services de traducteur (voir infra). Dans sa lettre, il lui annonça vouloir s’adresser à un public français qui n’aurait pas été limité aux seuls économistes universitaires :
The wide distribution of your work in France, by contributing to dissipate the errors which are so deeply anchored in the public mind, would certainly facilitate a solution of the difficulties in the midst of which our country is at present struggling3.
Quelques mois plus tard, dans sa lettre à Keynes du 11 juin 1938, il confirma son intention de mettre The General Theory à la portée des fonctionnaires et autres personnes chargées de la politique économique :
My main preoccupation, indeed, was to make the translation as easy to understand as possible for readers who are not students of political economy. That is why I have as far as possible made use of words belonging to everyday, or to business language4.
À cet égard, Largentaye était conscient que le lectorat qu’il visait était différent de celui de Keynes qui écrivait pour ses condisciples, ardents 78défenseurs de l’école classique comme lui-même l’avait été, et utilisant la même terminologie économique :
This book is chiefly addressed to my fellow economists (Keynes, 1936 [2007], p. xv).
Cette différence entre lectorat anglais et futur lectorat français de The General Theory doit être soulignée. En effet, elle signifie qu’un dictionnaire donnant en français les définitions de termes techniques était indispensable alors que les sens de ceux-ci étaient bien connus des lecteurs anglais, économistes professionnels. Auteur et traducteur en prirent conscience progressivement à mesure que la traduction avançait, de sorte qu’à la fin de celle-ci, en février 19395, Keynes commença sa préface pour la traduction française de The General Theory comme suit :
Pendant un siècle ou plus l’Économie Politique a été dominée en Angleterre par une conception orthodoxe […] Mais nous-mêmes, en écrivant ce livre et un autre ouvrage récent qui l’a préparé, nous avons senti que nous abandonnions cette orthodoxie, que nous réagissions fortement contre elle, que nous brisions des chaînes et conquerrions une liberté. Cet état d’esprit explique certains défauts de l’ouvrage ; il explique en particulier qu’il revête en divers passages un caractère de controverse, qu’il ait trop l’air de s’adresser aux défenseurs d’une conception spéciale et pas assez à la Ville et au Monde. Nous avons voulu convaincre notre entourage et nous ne nous sommes pas adressés assez directement au grand public. Trois ans ont passé depuis lors, nous nous sommes habitués à notre nouveau vêtement et avons oublié jusqu’à la forme de l’ancien. Si nous devions récrire cet ouvrage, nous chercherions à éviter ce défaut et nous nous efforcerions d’exposer avec plus de netteté notre propre manière de voir (Keynes, 1942, p. 9)6
Une traduction – toujours une transmission et une réécriture – peut parfois constituer aussi un enrichissement comme dans le cas présent, du fait du lexique que Largentaye a ajouté à la fin de la Théorie générale.
Keynes avait certes défini dans les quatre chapitres du livre II « Definitions and Ideas » de The General Theory certains concepts-clés 79de son œuvre – le revenu, l’investissement, l’épargne, le coût d’usage, la prévision (à court et long terme) – mais à la différence d’un lexique, la liste complète des nouveaux concepts n’y figure pas. D’autres concepts-clés tels que la propension à consommer, l’efficacité marginale du capital et le taux d’intérêt sont définis dans les chapitres ultérieurs. Enfin, un petit nombre de concepts, mais non des moindres – valeur monétaire ou préférence pour la liquidité par exemple – ne sont pas précisément définis.
En élaborant un lexique de la terminologie économique de la Théorie générale, Jean de Largentaye a présenté indirectement l’essentiel de la logique keynésienne, faisant apparaître le sens des causalités en distinguant les variables indépendantes (ou exogènes) telles que la propension à consommer, l’efficacité marginale du capital, le taux d’intérêt, ou l’unité de salaire, des deux principales variables dépendantes (ou endogènes), c’est-à-dire la demande effective (ou le revenu ou le produit qui lui sont identiques) et l’emploi.
Le traducteur avait ainsi fourni l’armature linguistique du cadre théorique sur lequel étaient construites les politiques destinées à assurer le plein emploi ou du moins à faire reculer le chômage qui frappait durement la plupart des économies occidentales à la fin des années 1930.
Le lexique – à l’origine simple table de correspondance selon le souhait de Keynes – fut élaboré parallèlement à la traduction, au cours des vingt et un mois s’écoulant d’avril 1938 à fin décembre 1939.
Comme nous le verrons dans une première partie, le fil conducteur de l’évolution du lexique apparaît dans la correspondance entre Keynes et Largentaye présentée dans la dernière partie de ce dossier. Le choix, le nombre, l’énoncé des traductions des termes techniques ainsi que les définitions de ceux-ci furent discutés en détail avec Keynes comme on le verra dans une deuxième partie. En conclusion, avec le recul de plus de quatre-vingts années depuis l’achèvement de la traduction française (fin 1939), nous proposerons quelques évolutions qui nous paraissent souhaitables.
80I. Le lexique au cœur de la correspondance
entre Keynes et son traducteur
En élaborant le lexique, le traducteur poursuivait trois objectifs : répondre à la demande de Keynes, résoudre les désaccords avec l’auteur, transformer la table de correspondance en un lexique.
I.1. Keynes demande une table de correspondance
Établir une table d’équivalence entre termes techniques anglais et leur traduction en français : telle était l’attente de Keynes, exprimée dans sa deuxième lettre au traducteur datée du 9 avril 1938 (voir infra).
The most important task, I think, is to obtain suitable equivalents for my set of technical terms. My German translator took particular trouble about this and in fact supplied, at the end of the volume, a table of the equivalents between English and German of the terms he had adopted. I think it might be useful if you would let me have a list of your suggestions in this respect7.
Commençons par définir respectivement les concepts de table de correspondance (table of equivalents), d’index, de dictionnaire et de lexique (lexicon ou glossary). Tout d’abord, une table de correspondance, comme l’indique Keynes ci-dessus, est une liste alphabétique de termes dans la langue d’origine, la traduction de ceux-ci dans la langue d’accueil figurant en regard. Une telle table constitue une étape indispensable pour le traducteur mais figure rarement dans la publication finale de la traduction, le Vokabularium que l’on trouve à la fin de la version allemande de The General Theory faisant exception. Deuxièmement, un index est une liste alphabétique de termes ou de noms propres accompagnés des numéros de pages où apparaissent ceux-ci. Par exemple, à la fin de The General Theory on trouve un Index de 18 pages (1936, p. 385-403) 81œuvre de D.M. Bensusan Butt8. Troisièmement, un dictionnaire fournit les définitions d’une liste de termes classés par ordre alphabétique dans une langue donnée. Enfin, un lexique (ou son synonyme glossaire) est un dictionnaire donnant les définitions d’un petit nombre de termes choisis en raison de leur technicité ou de leur usage peu courant. Dans le cas présent, le lexique à la fin de la Théorie générale est à la fois une table de correspondance français-anglais, un « mini dictionnaire » français de sept pages et un index pour les termes dont la définition est donnée par Keynes dans l’édition d’origine en anglais.
Dans sa première lettre à Largentaye, Keynes avait à l’esprit le Vokabularium que le traducteur allemand (Fritz Waeger9) avait ajouté à la fin de Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes (1936), plus d’un an avant le commencement de la traduction française.
Ce Vokabularium d’une demi-douzaine de pages est une liste de termes dont le choix est inspiré de l’Index de D.M. Bensusan Butt. Il est classé selon l’ordre alphabétique anglais (ce qui est peu pratique pour le lecteur allemand) avec en vis-à-vis les traductions allemandes. Ainsi, on trouve à la première page du Vokabularium (voir p. 7), pour capital investment : Kapital investition ; pour commodity rate of interest : warenzinsfub ; pour user cost : gebrauchsk, etc.
C’est une simple table d’équivalence selon la dénomination de Keynes qui ne constitue pas un dictionnaire puisqu’il ne comporte pas de définitions en allemand, ni même un index puisqu’il ne fait pas figurer à côté de chaque terme les numéros de pages où celui-ci se trouve. Son utilité pour le lecteur allemand est limitée.
De plus, cette table d’équivalence d’environ 200 termes comporte de nombreuses erreurs typographiques et d’étonnantes omissions (money value, own rate of interest in terms of a standard of value, schedule of liquidity preference…). Contrairement à l’Index anglais, le Vokabularium ne comprend 82pas tous les termes « dérivés », c’est-à-dire ceux qui, après un premier terme commun, enchaînent un ou plusieurs autres termes.
Par exemple, dans l’Index anglais, « banking system » est suivi de six termes dérivés : and creation of credit, and rate of interest, and future of investment, its condition of lending, a suggestion reform in, and wage policy alors que, dans le Vokabularium, seul figure le terme allemand Banksystem. Il ne comprend pas non plus les noms propres tels qu’Armstrong Clement, Barbon N., Bentham J., Böhm-Bawerk E. von, Bonar Law A., etc.
Dans sa préface à la traduction allemande de The General Theory, Keynes avait formé le vœu qu’au-delà de son objectif immédiat, le Vokabularium, en enrichissant la terminologie économique allemande grâce à l’apport du nouveau vocabulaire keynésien, pût être utile aux germanophones.
83
Fig. 1 – Première page de l’Index de The General Theory (1936).
84
Fig. 2 – Première page du Vokabulorium
de l’Allgemeine Theorie der Beschäftigung des Zinses und des Geldes (1936).
Quant à la traduction japonaise par le professeur Tsukuma Shionaya, terminée en 1936 (publiée en 1941)10 et préfacée par Keynes la même année, elle comprend un index de 37 pages dans lequel les termes japonais figurent en premier et sont suivis des mots anglais d’origine, mais sans leurs définitions.
Revenons à la traduction française. Le 8 mai 1938, Largentaye adressa une lettre à Keynes avec une première version de la table de correspondance – répondant de la sorte à la demande que l’auteur lui avait adressée un mois plus tôt – et un projet de traduction du chapitre 11, L’efficacité marginale du capital (voir infra).
I.2. Discussions entre auteur et traducteur
sur le principe d’un lexique
Avant de répondre, Keynes consulta son ami Piero Sraffa dont il estimait que la connaissance du français était meilleure que la sienne. En effet, le français de Keynes était d’un niveau scolaire alors que Sraffa, économiste italien réfugié en Grande-Bretagne11 connaissait mieux la langue française qu’il avait utilisée dans sa jeunesse, sa mère étant francophone.
La lettre du 2 juin 1938 de Keynes (voir infra) était plutôt circonspecte. Keynes donna deux conseils à Largentaye.
En premier lieu, laisser en anglais les nouveaux concepts économiques introduits par Keynes (liquidity preference, par exemple). En second lieu, rencontrer « M. Mantoux » qui avait publié dans la Revue d’économie politique (Mantoux, 1937) une note de lecture sur The General Theory, comprenant les traductions françaises de termes techniques12. Notons que Largentaye avait critiqué « M. Mantoux » dans son premier courrier adressé à Keynes :
86In consequence, I cannot do otherwise than deplore the fact that your work should be so little known and so ill understood in France, as is proved by the recent critical analysis by Mr. Mantoux in the “Revue d’économie politique” for December 193713.
Il semble que Keynes ait oublié cette remarque du traducteur et que Sraffa ne se fût intéressé qu’aux termes français utilisés par « M. Mantoux » pour exprimer les nouveaux concepts keynésiens tels que full employment, liquidity preference ou effective demand.
Keynes joignit en annexe à sa lettre du 2 juin 1938 les commentaires de son ami Sraffa (voir infra). Après avoir lu une première version de la traduction du chapitre 11 ainsi que la table de correspondance, Sraffa estima que Largentaye connaissait bien l’anglais, qu’il ne faisait pas de contre-sens mais qu’il n’était pas familiarisé avec les termes techniques en français. Il esquissa un essai de « glossary » (sic) dans lequel il mit en vis-à-vis la table de Largentaye avec les traductions d’Étienne Mantoux qui figuraient dans son article de 1937.
Quelques jours après, le 11 juin 1938 (voir infra), Largentaye annonça à Keynes qu’il allait lui envoyer ultérieurement une deuxième version de la table de correspondance, une fois achevée la première version de la traduction des vingt-et-un premiers chapitres de The General Theory. Ce travail était donc reporté à une date indéterminée.
La réponse de Keynes, manuscrite (voir infra), suivit six jours après (17 juin 1938). L’économiste mit en garde Largentaye contre le risque de traduire certains concepts nouveaux à l’aide d’un vocabulaire courant dans la langue de traduction. Il faut dans ce cas expliquer très clairement les nouveaux concepts en français, si nécessaire avec une périphrase, voire en gardant les termes anglais, ou en les « francisant » selon le néologisme de son ami Sraffa. On peut penser que Keynes, en définitive, suggérait alors un lexique plutôt qu’une simple table de correspondance.
À l’automne suivant, après une période de mobilisation, Largentaye rencontra Étienne Mantoux ; tous deux s’accordèrent sur une liste de traductions françaises des termes techniques utilisés par Keynes (lettre de Largentaye à Keynes le 26 octobre 1938, voir infra). Il souligna les hésitations suscitées par la traduction de certains mots, en particulier 87« expectations », terme finalement traduit d’un commun accord par « prévision ».
Keynes répondit le 22 décembre 1938 (voir infra) :
There remains your table of equivalent terms. Here again the penciled comments in the margin are my own. Pinned on the table are my friend’s comments. And here again the matter explains itself, I think14.
I.3. La table de correspondance devient un lexique
Nonobstant, Largentaye défendit son idée d’un lexique figurant à la fin de l’ouvrage pour faciliter la compréhension du lecteur français. Et Keynes proposa alors le 13 mars 1939 (voir infra) une présentation un peu différente lui permettant de distinguer les définitions énoncées par l’auteur de celles provenant du traducteur, ces dernières devant toutefois être préalablement validées par lui-même. De plus, il exigea que le traducteur prît la responsabilité du Lexicon en précisant qu’il en était l’auteur.
I should have no great objection to it if it is made entirely clear that it [the lexicon HL] is your work and not mine15.
Enfin, il fit observer que le choix des termes du projet de lexique était arbitraire et que leur nombre, cinquante-six, était trop réduit,
Moreover, the actual definitions you give are, of course, only a quite a small selection of all those occurring in the book. No doubt, you have chosen them from the point of view of helping the reader as much as possible, but surely, they remain rather an arbitrary collection out of the special terms which are used in the course of it16.
Dans sa réponse du 28 mars 1939 (voir infra), Largentaye avança une contre-proposition, une synthèse permettant de concilier les deux solutions (table d’équivalence pour l’auteur, lexique de type dictionnaire 88pour le traducteur). Il fit observer à Keynes que de nombreux termes techniques, tels que « terms of trade » ou « marginal » n’étaient pas définis dans The General Theory sans doute parce que les lecteurs anglais, économistes professionnels, les connaissaient déjà, alors que, selon Largentaye, la plupart des futurs lecteurs français de la traduction les ignoraient.
La nouvelle version du lexique datée du 28 mars 1939 remplit les conditions posées par Keynes. Ainsi, à la première page du lexique figurait une note de bas de page indiquant que celui-ci était l’œuvre du traducteur :
Le présent lexique, qui est l’œuvre du traducteur, est uniquement destiné à faciliter au lecteur l’intelligence du texte français. Beaucoup des définitions qu’il contient ont un caractère explicatif et il convient de ne pas leur accorder la même portée qu’aux définitions de l’auteur qui figurent dans le corps de l’ouvrage. Lorsque celles-ci ont été reproduites littéralement, elles sont entre guillemets et la référence au texte est indiquée (N. du T.)17.
La contre-proposition donna satisfaction à Keynes qui accepta le lexique dans ses grandes lignes et reconnût que celui-ci pouvait être d’une grande aide pour les lecteurs français. Il aurait même souhaité qu’un nombre plus élevé de termes techniques figurât dans ce lexique (lettre de Keynes à Largentaye du 3 avril 1939),
Now, as regards the glossary : I feel very much happier about it in its revised form, with reference to its being the work of the translator, and with the English terms in brackets and page references to the main text of the book. In principle, I accept the lexicon on these lines, and agree with you that it may be very helpful to French readers. The difficulty is that perhaps fifty years have passed since any modern work on economics was actually composed in the French language ; though, from what you tell me, the absence of established technical terms for English phrases, which have not been invented by me but have been established in Anglo-Saxon economics for some decades, goes further than I had realized18.
89Largentaye revint sur les objections de Keynes à certaines traductions (comme « proceeds » traduit définitivement par « produit »). Keynes remercia son traducteur et approuva la dernière version du lexique qui comprenait 57 termes techniques en français, suivis de leur définition. Il avait clos ainsi la discussion de plus d’un an entre auteur et traducteur au sujet du lexique.
La dernière version d’avril 1939 est celle qui allait être publiée dans l’édition 1942 de Payot. Elle figure en annexe de cet article (voir infra) avec les annotations portées par Keynes et Sraffa.
Nous aborderons dans la section suivante les difficultés soulevées par la traduction et par la définition des termes techniques.
II. Surmonter les difficultÉs de traduction
La principale difficulté provenait de l’absence de vocabulaire économique français keynésien dans les années 1930 comme nous le verrons d’abord avant d’examiner comment Largentaye remédia à cette lacune.
II.1. l’absence du vocabulaire de Keynes dans le vocabulaire Économique français des annÉes 1930
Comme on vient de le voir, au terme d’un an d’échanges avec Largentaye, Keynes finit par reconnaître le retard du vocabulaire économique français dans sa lettre du 3 avril 1939.
Ce retard était manifeste dans l’exposé des motifs du projet de loi du 5 avril 1938 de Pierre Mendès France « tendant à donner au gouvernement les pouvoirs nécessaires pour mettre la nation en état de faire face aux charges qui lui incombent et spécialement aux besoins de défense ».
Certes, comme l’écrira plus tard Mendès France (1984, p. 797), ce programme de relance du second gouvernement du Front populaire était sous-tendu par la théorie keynésienne mais les nouveaux termes emblématiques de celle-ci – plein emploi, demande effective, revenu national – étaient absents. Et pour cause, puisqu’ils n’existaient pas 90encore dans la terminologie économique française. De plus, cet exposé des motifs était marqué par la logique typique de l’école classique puisqu’il présentait l’épargne comme un préalable à l’investissement, erreur dans le sens des causalités dénoncée à plusieurs reprises dans la Théorie générale.
Comment y remédier ? Nous allons voir tour à tour que, ni la formation de Largentaye, ni l’état de la recherche économique dans les milieux universitaires, ni les publications en français comportant la terminologie keynésienne, ni les dictionnaires disponibles ne pouvaient fournir les traductions et définitions d’un certain nombre de termes de The General Theory au moment où Largentaye allait se lancer en 1938 dans la traduction de celle-ci.
Voyons d’abord la formation économique de Jean de Largentaye.
À l’École polytechnique où il avait été élève de 1921 à 1923, il avait suivi le cours Économie sociale et économie politique de Clément Colson qui l’avait particulièrement marqué comme le montre son souvenir évoqué quarante ans après, lors d’un dîner avec ses camarades de promotion (X21) en 1966 :
Colson était sans conteste l’interprète le plus éminent en France de la théorie économique libérale, qu’on appelle maintenant Théorie classique. D’autres analysaient la production, la distribution et la consommation des richesses. Lui n’hésitait pas à assembler ces mécanismes en une vigoureuse synthèse, impeccablement structurée. Il y avait, n’est-il pas vrai, de quoi séduire de jeunes cerveaux, épris de logique. Pour ma part je lui sais gré de m’avoir procuré les éléments du confort intellectuel19.
C’est sans doute dans ce cours d’économie politique qu’il puisa la plupart des termes économiques français lorsqu’il entreprit en 1938 la traduction de The General Theory. Et, à l’évidence, le vocabulaire de Keynes n’en faisait pas partie.
L’enseignement d’économie politique que Largentaye suivit à la Faculté de droit de l’université de Paris en même temps que sa scolarité à l’École polytechnique, puis, lors de la préparation en 1930 du concours de l’Inspection générale des Finances, celui de l’École libre des sciences politiques, ne lui aura pas non plus permis de se familiariser avec le nouveau langage keynésien. En effet, dans les années 1930, ces formations 91étaient conformes à la tradition libérale française, celle qui accordait une place prépondérante à la loi du marché et dont les ouvrages les plus représentatifs étaient le manuel Principes d’économie politique de Charles Gide (1884, 25 rééditions) et l’Histoire des doctrines économiques de Charles Gide et Charles Rist (1909, première de six éditions).
Maurice Halbwachs (1877-1945), sociologue et disciple d’Émile Durkheim, était cependant un des rares universitaires qui, en France, analysant la consommation ouvrière, s’intéressa à l’œuvre de Keynes et plus précisément au rôle de la demande effective et de l’emploi. Halbwachs rédigea plusieurs articles relatifs à Essays in the Theory of Employment de Joan Robinson et à The General Theory de Keynes. Ces articles dans lesquels figuraient en français les nouveaux mots de la terminologie keynésienne furent publiés dans les Annales sociologiques en 1937, 1938 et 1940 (Halbwachs, 2017). Cependant, ni Keynes ni Largentaye ne firent état de ces publications dont ils n’avaient sans doute pas eu connaissance, leur diffusion étant restée limitée à un lectorat de sociologues.
À l’exception notable des conférences organisées par « X-Crise » à partir de 193120 et auxquelles il ne semble pas que Largentaye ait participé, ni que The General Theory ait été présentée (Tortajada, 2021), il y avait peu d’échanges entre enseignants et chercheurs universitaires s’intéressant à Keynes d’une part, fonctionnaires responsables de la politique économique française des années 1930 de l’autre.
Prenons maintenant les Principles of Economics, l’œuvre majeure d’Alfred Marshall (1842-1924) publiée au Royaume-Uni en 1890. Cette œuvre avait été traduite en français en 1906 et la traduction avait permis d’introduire dans le langage économique français des termes marshalliens tels qu’élasticité, périodes courte et longue, prix coûtant et prix total, facteur de production, marginal, placement de capital etc., dont certains furent repris dans le lexique de Largentaye comme on le verra plus loin.
92Marshall avait fondé l’école d’économie de Cambridge ainsi que la Faculté d’économie (Keynes, 1933). Il était la principale autorité de cette discipline à l’Université de Cambridge. Keynes avait été son élève au début du xxe siècle et avait gardé pour lui une grande estime malgré son évolution au moment de l’élaboration de The General Theory marquée par la rupture avec les postulats néo-classiques conservés dans l’œuvre de Marshall.
Interrogeons-nous maintenant sur la diffusion des écrits économiques de Keynes en France dans les années 1930. Hormis Essays in Persuasion, aucun de ses articles postérieurs à 1929 n’était traduit et publié en français. On trouve bien dans Essais de persuasion l’article « Un programme d’outillage national21 » (Keynes, 1933, p. 84) mais il n’existe pas de traduction française de l’article intitulé « A Monetary Theory of Production » (1933), traduit en allemand la même année, non plus que de « The Means to Prosperity » (1933), deux textes annonciateurs de la Théorie générale utilisant déjà le langage keynésien pour exprimer de nouveaux concepts (le multiplicateur d’emploi par exemple).
Enfin, examinons les dictionnaires économiques qui sans nul doute ont été consultés par Jean de Largentaye lorsqu’il entreprit la traduction de The General Theory. Deux ouvrages de ce type existaient à l’époque, le Dictionnaire de l’économie politique (Charles Coquelin, Gilbert-Urbain Guillaumin, 1864) et le Nouveau dictionnaire de l’économie politique (Léon Say, Joseph Chailley-Bert, 1900). Ceux-ci contenaient-ils la terminologie keynésienne ?
Certes, on y trouve « capital » (« le capital est créé par l’épargne » marqueur de la théorie classique), « capital fixe », « capital circulant », « consommation », « désutilité », « épargne », « marginal », « prévision », « produit », « revenu », « revenu net », « spéculation », « taux d’intérêt », « valeur nominale ou monétaire » qui figurent tous dans le lexique. Cependant les définitions sont longues, confuses et incomplètes. Parfois, elles s’écartent nettement de celles de Keynes, le point de vue individuel étant retenu par opposition à celui de l’économie tout entière. 93Et, dans le cas de spéculation et taux d’intérêt, les aspects strictement financiers ne sont pas développés.
En revanche, on ne trouve ni coût d’usage, demande effective, équipement ou investissement (on utilisait le terme « outillage »), ni multiplicateur d’investissement, plein emploi, propension à consommer ou taux d’intérêt spécifique etc., concepts économiques introduits par Keynes.
En bref, ces deux dictionnaires n’ont pu être d’un grand secours pour traduire les principaux termes techniques keynésiens.
Concluons. La formation économique de Largentaye ne lui permettait pas de connaître le nouveau langage keynésien ; les chercheurs et universitaires français étaient peu ouverts aux nouvelles idées de Keynes et, de plus, ils communiquaient peu avec les milieux de l’administration ; les textes précurseurs de The General Theory que Keynes avait publiés à partir de 1933 n’étaient pas traduits et enfin les dictionnaires économiques ne constituaient guère une ressource.
Après son premier essai infructueux pour présenter une table de correspondance de termes techniques, Largentaye suivit les conseils donnés par Sraffa et Keynes, et consulta de nouvelles sources.
II.2. Les influences de Marshall, Mantoux, Lerner et Moisseev
Dans l’annexe à la lettre de Keynes à Largentaye du 2 juin 1938 (voir infra), Sraffa écrivit :
But obviously he is not acquainted with the technical terms : he seems to be trying to translate them with the help of a dictionary or by the usage of business. Yet most of these terms can be found in Marshall’s Principles in French, Lerner’s article in I.L.O. Review, and Étienne Mantoux’s Review of the General Theory in Rev. d’Ec. Pol. (Nov.-Dec. 1937). Mantoux, very sensibly, has « frenchified » your technical words – and it sounds quite well. I send you a glossary, which I made reading Mantoux (with page and line references to his article), which may be useful to your translator22.
94Prenons d’abord Marshall. Seul un petit nombre de termes techniques du lexique de la Théorie générale, figurent dans la traduction des Principles de Marshall avec leurs définitions23.
Choisissons deux termes typiquement marshalliens – « désutilité », et « marginal » – et comparons les définitions respectivement chez Marshall et Largentaye.
La définition de l’expression « disutilité (sic) marginale » dans la traduction française des Principles de Marshall est longue et peu précise :
[D]ans la plupart des occupations, cette partie de la tâche qui donne plus de plaisir que de peine et qui doit être d’ordinaire payée au même prix que le reste ; le prix de la tâche entière est donc déterminé par la peine qu’exige du travailleur cette partie du travail qu’il exécute avec le plus de répugnance et qu’il est presque sur le point de se refuser à exécuter (Marshall, 1906, t. 1, p. 287)
celle du lexique de la Théorie générale est courte et précise :
La désutilité du travail ou de l’emploi est l’ensemble des raisons qui font qu’on ne travaille pas pour un salaire dont l’utilité pour soi est inférieure à un certain minimum.
Le concept anglais « marginal » que l’on trouve chez Marshall est traduit en français par « limite » :
L’utilité-limite d’une chose pour une personne diminue avec toute augmentation de la quantité qu’elle en possède déjà (Marshall, 1906, t. 1, p. 222),
et dans le lexique de la Théorie générale, la définition de « marginal » est la suivante :
Le montant marginal de l’attribut d’une chose est le montant de l’attribut possédé par la dernière unité existante de cette chose, c’est-à-dire par l’unité qui disparaîtrait si la quantité de cette chose était réduite d’une unité.
Regardons maintenant Abba Lerner. Dans son article dont la version française est parue en 1936, le terme « expectations » est traduit par 95« prévision », et non par « anticipation » comme Sraffa l’avait proposé dans son essai de glossaire (voir infra).
Prenons, enfin, Étienne Mantoux qui a inspiré les remarques de Sraffa (voir infra). Largentaye les retient presque toutes. Seules font exception « emploi complet » (pour « full employment »), « préférence de liquidité » (« liquidity preference »), « rendement probable » (« prospective yields ») ; en définitive Largentaye remplacera ces termes respectivement par « plein emploi », « préférence pour la liquidité » et « rendements escomptés ». Quant à « anticipations » (traduction suggérée par Sraffa pour « expectations »), Largentaye maintint « prévision » (comme Lerner) non sans en avoir discuté à Paris avec Étienne Mantoux et s’être finalement accordé avec celui-ci sur cette traduction.
Enfin, selon la recommandation que Keynes formula dans sa lettre du 22 décembre 1938 (voir infra) Largentaye consulta l’article de l’économiste belge francophone Moise Moisseev24 notamment pour la traduction du concept « liquidity preference » :
One other suggestion relating to the technical terms I may pass on. A Belgian economist, Monsieur Moiseef (sic), who reviewed my book, is of the opinion that in the case of « liquidity preference » it is better either to adopt my English term (perhaps in italics) or to replace it in French by a direct definition ; for example – « les hommes préfèrent conserver leur avoir en argent liquide ». At any rate the latter phrase might be included in the table, which might help the reader25.
Nonobstant, Largentaye conserva sa traduction initiale, « préférence pour la liquidité ».
Muni de ces quatre sources d’inspiration conseillées par Keynes, Largentaye élabore quelques semaines plus tard une première version de son lexique (c’est-à-dire la table de correspondance complétée par les définitions de chacun des termes) puis une seconde26 qu’il envoie à 96Keynes. Sraffa et Keynes annotent ces deux versions. Le résultat final est la version d’avril 1939 du lexique qui sera publiée dans l’édition Payot 1942 de la Théorie générale (voir infra).
Examinons maintenant quelques exemples de ce lexique dans sa dernière version.
III. QUELQUES EXEMPLES DE TRADUCTION
Nous reprendrons, ci-après, par ordre alphabétique, neuf termes du lexique dont les traductions et définitions ont été les plus discutées, complétées le cas échéant par les traductions retenues par l’un ou l’autre des trois économistes ci-dessus (Lerner, Mantoux et Moisseev) et par les commentaires apportés par Sraffa et Keynes au début de l’année 1939 (transcrits intégralement dans l’annexe27). Pour certains termes, nous avons formulé nos remarques ou suggestions personnelles. Les numéros de page entre parenthèses sont ceux de l’édition Payot 2017 de la Théorie générale.
1. Le coût d’usage (user cost) est « la diminution de valeur subie par l’équipement au cours de la période considérée du fait de sa participation à la production ».
Ce terme, l’un des plus complexes du lexique, est longuement défini dans le chapitre 6, « La définition du revenu, de l’épargne et de l’investissement » de la Théorie générale et dans l’« Appendice sur le coût d’usage » à la fin de ce chapitre (p. 119 à 130).
À notre avis, il aurait été éclairant d’ajouter après la courte définition ci-dessus le fait que le coût d’usage est simplement le « désinvestissement résultant de la production », affirmation que l’on trouve dans la seconde phrase de la définition ci-après de « l’investissement courant ».
2. Investissement courant (current investment) est « l’addition à la valeur de l’équipement qui résulte de l’activité productrice de la période. 97Il est donc égal aux achats A1 faits par les entrepreneurs, diminué du désinvestissement résultant de la production, c’est-à-dire du coût d’usage : I = A1-U ».
Dans l’annexe à la lettre de Keynes du 2 juin 1938 (voir infra), Sraffa commente comme suit la traduction du terme anglais Investment par « Placement ou capital28 » figurant dans la première version de la table de correspondance de Largentaye datée du 8 mai 1938 :
These words have only the Stock Exchange sense of investment. M. [Mantoux, HL] (and also Rist) use always « investissement » : why not follow them29 ?
Sraffa a ignoré ici une des plus grandes sources de confusion issues de la polysémie du terme anglais « investment » qui, à notre avis, explique largement, comme on va le voir, la mauvaise compréhension de l’innovation majeure de l’œuvre de Keynes, c’est-à-dire l’égalité des montants globaux de l’investissement et de l’épargne et le rôle moteur joué par la première grandeur, la seconde n’étant qu’une résultante. Cette source de confusion justifie que l’on approfondisse ci-après les sens du terme « investissement » dans les deux langues, en français et en anglais.
Dans la Théorie générale, Largentaye traduit « investment » par « investissement » ou « placement » selon le contexte, en anglais : « investissement » lorsqu’il s’agit d’une addition à l’équipement en capital (Keynes écrit alors généralement, current investment) et « placement » lorsqu’il s’agit de l’acquisition de titres sur le marché financier. Ainsi, la définition de « l’investissement » dans le lexique se termine par la phrase suivante (voir infra) :
Le terme placement que l’usage tend à distinguer du terme investissement a été réservé au marché financier (Keynes, 2017, p. 483-484).
Joan Robinson, économiste cambridgienne et membre du cercle rapproché de Keynes qui contribua à l’élaboration de la Théorie générale, 98évite la confusion inhérente à la polysémie du mot « investment » en anglais, en empruntant au français le mot « placement » pour désigner « the purchase of securities », c’est-à-dire l’acquisition de titres financiers. Elle devait écrire plus tard dans son ouvrage The Accumulation of Capital (Robinson, 1956, p. 8) :
It is convenient also to borrow from France the term placement to mean the purchase of titles to debts or shares, whether out of new savings recently made or from the proceeds of selling some other property.
The term investment can then be confined to the sense of using finance to cause capital goods to be created30.
Richard Kahn, également membre du cercle rapproché de Keynes31, devait à son tour écrire en 1984 que Keynes lui-même n’échappait pas à cette confusion :
Considerable confusion is caused – Keynes was not immune to this confusion – by the ambiguity of the word « investment » which is used to mean both real investment and the purchase of Stock Exchange securities (Kahn, 1984).
Malheureusement, on constate que l’usage actuel en français est d’employer le terme « investissement » au sens financier, anglicisme qui constitue en l’occurrence un grave contre-sens : « placement » dans ce cas est la traduction juste comme on l’a vu, il importe de le souligner.
Dernière remarque, il serait utile d’ajouter à la suite de la définition de l’« investissement net », celle du terme « désinvestissement » que l’on trouve au chapitre 7, « Nouvelles considérations sur le sens des notions d’épargne et d’investissement » :
Si nous considérons la vente d’un investissement comme un investissement négatif, c’est-à-dire comme un désinvestissement, notre définition concorde avec l’usage populaire, puisque les échanges d’investissements anciens sont forcés de s’annuler (Keynes, [1942] 2017, p. 132).
993. le Plein emploi (full employment) « est une situation telle que les facteurs de production désireux de travailler soient tous employés ».
Dans son article de 1937 de la Revue d’économie politique Mantoux écrivit :
L’expression de « full employment » est d’une traduction malaisée, et son usage, dans la littérature économique contemporaine, est universel […] Ce n’est que dans la première décade (sic) du siècle actuel qu’un « volume complet de l’emploi » obtint l’égalité des droits avec l’accroissement du revenu réel comme critère de l’efficacité économique (Mantoux, 1937, p. 1562).
Sraffa proposa en juin 1938 (voir infra) de reprendre la traduction de Mantoux, « volume complet de l’emploi », ce que Largentaye ne suivit pas.
Celui-ci inventa alors « plein emploi » pour traduire le concept anglais full employment et Keynes ne s’y opposa pas. Par cette expression, Largentaye introduisit donc dans la terminologie économique française, ce nouveau concept-clé, objectif prioritaire des politiques économiques dites keynésiennes.
4. la Préférence pour la liquidité (liquidity preference) « est la préférence donnée à l’argent liquide sur les autres formes de richesse ».
Dans sa lettre du 11 juin 1938 (voir infra), Largentaye fit part à Keynes de son désaccord pour traduire liquidity preference par « préférence de liquidité » comme ce dernier le demanda, selon la traduction de Mantoux. Largentaye proposa « préférence pour la liquidité », ce qui finalement ne suscita pas d’objection de l’auteur, et le définit brièvement (voir ci-dessus).
Ce concept avait été inventé par Keynes et n’existait pas jusqu’en 1942 dans le vocabulaire économique français : on utilisait « demande de monnaie » ce qui est différent.
Sans le définir – comme Largentaye allait le faire dans son lexique – Keynes l’avait décrit succinctement, de façon indirecte et peu compréhensible au chapitre 13, « La théorie générale du taux de l’intérêt », section ii :
La préférence pour la liquidité est une virtualité ou tendance fonctionnelle qui fixe la quantité de monnaie que le public conserve lorsque le taux d’intérêt est donné (Keynes, [1942] 2017, p. 235).
100À la fin de ce chapitre, on trouve un éclairage intéressant à propos du concept de « préférence pour la liquidité » :
Le concept de thésaurisation peut être considéré comme une première approximation du concept de préférence pour la liquidité. À vrai dire, si on remplaçait la « thésaurisation » par « la tendance à thésauriser », les deux concepts seraient strictement identiques (Keynes, [1942] 2017, p. 242).
Par ailleurs, l’analyse des trois motifs de la préférence pour la liquidité – transactions, précaution et spéculation – au début du chapitre 15, « Les motifs psychologiques et commerciaux de la liquidité » – constitue une approche détaillée du concept (Keynes, [1942] 2017, p. 267-268).
L’importance et la subtilité de ce nouveau concept auraient mérité à notre avis une définition plus longue dans le lexique, inspirée des remarques ci-dessus.
5. la Prévision à court terme (short term expectations) « a trait au prix qu’un fabricant, au moment où il s’engage dans une fabrication, peut espérer obtenir en échange des produits qui en résulteront ».
En soumettant à Keynes sa première version du lexique (voir infra), Largentaye souligna la difficulté à exprimer précisément l’équivalent du substantif anglais « expectation » figurant dans le titre du chapitre 5, « Expectation as Determining Output and Employment » ainsi que dans le titre du chapitre 12, « The State of Long Term Expectation ».
Il écrivit le 26 octobre 1938 :
The word « expectation » was a very difficult one for me. As a result of long discussions, I believe that the French word « prévision » is the best to suit with your thought. This word was employed also by the translator of Lerner and by Mantoux. The present tendency is to give it in the singular a much wider meaning than before32.
Cependant, tout en utilisant « prévision » dans les différents chapitres de l’ouvrage, Largentaye s’était abstenu de faire figurer ce terme dans les deux premières versions du lexique soumises à Keynes. Ce n’est que dans le lexique de l’édition Payot de 1942 que « la prévision à court 101terme » et « la prévision à long terme » apparurent avec des définitions spécifiques liées à la durée du cycle (courte période et long terme, notions marshalliennes qui se réfèrent au cycle de production de l’entreprise).
Dans sa première table de correspondance (voir infra), Largentaye avait déjà traduit « expectation » par « prévision » et Sraffa, dans son commentaire à Keynes, remplaça « prévision » par « anticipation », tout en indiquant que :
This word probably cannot be worked in French so hard as “expectation” in English : in some cases, but not always, prévision may be substituted : but in general prévision means forecast, and stands for something too precise33.
Dans son article de 1937, Mantoux pour sa part utilisa parfois « anticipations » mais le plus souvent « prévisions » (au pluriel) pour traduire « expectations » :
Ici, Keynes fait désormais entrer en ligne de compte les anticipations et, tout au long de son livre, c’est en termes de prévisions (sic) que les nouvelles unités sont définies […] Ici apparaissent les fameuses prévisions car ce sont les prévisions des entrepreneurs qui déterminent le volume des sommes à investir… C’est sur les dépenses probables de consommation que les prévisions sont basées (Mantoux, 1937, p. 12 et 16).
Moisseev, quant à lui, traduisit, « expectation » par « espérances » :
Les espérances à court terme sont celles qui concernent un prix que le producteur peut espérer obtenir dès le lancement du processus de fabrication pour ses produits finis ou bien qu’il se décide à faire produire à un moment donné avec l’outillage existant.
Les espérances à long terme sont celles qui concernent les gains que l’entrepreneur escompte réaliser en achetant (et même en produisant) des produits finis pour renforcer son « capital equipment ».
Les espérances sont basées, partiellement, sur des faits existants, par exemple, le stock existant des types variés des biens de capital, l’importance de la demande de la part des consommateurs pour des marchandises dont la fabrication nécessite une plus large assistance du capital et, partiellement, sur des faits qu’on peut prévoir avec plus ou moins de confiance (Moisseev, 1938, p. 108).
102Aujourd’hui, le terme « anticipations » est souvent utilisé pour traduire « expectation ». Toutefois, « anticipations » comprend en anglais comme en français l’acte volontaire qui lui est associé, ce qui n’est pas le cas d’« expectation » ou de « prévision ». La théorie des « rational expectations », à laquelle font référence de nombreux articles publiés dans les années 1980 est traduite en français par la théorie des « anticipations rationnelles34 ». Cette traduction n’aurait probablement pas plu à l’auteur de The General Theory qui ne l’avait d’ailleurs pas retenue parmi les suggestions de Sraffa.
Moisseev avait choisi « espérances ». Le traducteur allemand avait traduit « expectation » par « erwartung » qui signifie en français « attente ». Dans les différents chapitres de la Théorie générale, le traducteur français a utilisé « attendu », « espéré » ou « escompté » selon le contexte pour traduire « expected ».
6. le Produit (proceeds) d’un certain volume de l’emploi est le montant en argent du « revenu global qui résulte de ce volume d’emploi, i.e. la somme du coût de facteur global et du profit global ».
Répondant aux objections récurrentes de Keynes relatives à la traduction de « proceeds » par « produits », Jean de Largentaye s’obstina et dans sa dernière lettre à Keynes, le 30 avril 1939 (voir infra) proposa une dernière fois de maintenir « produit » (plutôt que « rendement », « revenu » ou « recettes ») car ce mot comprend deux acceptions, à la fois « produit en nature » et « produit en argent ». Cependant, concédait-il, « recettes » n’est pas impossible si Keynes l’exigeait.
Keynes finalement accepta « produit » pour « proceeds », invoquant le fait qu’il ignorait la double acception en français du terme « produit » (voir infra).
7. le Revenu (income) « est la valeur de la production due à l’activité de la période considérée. Il comprend le revenu de l’entrepreneur et le revenu des autres facteurs de production. Le revenu de l’entrepreneur 103est égal à la différence entre le chiffre d’affaires et le coût premier, i.e. la somme du coût de facteur et du coût d’usage. Le revenu des autres facteurs de production est égal au coût de facteur. Donc le revenu est égal à la différence entre le chiffre d’affaires et le coût d’usage. R = A - U ».
Dans la première version du lexique, celle du début 1939, Keynes avait indiqué en marge qu’il ne reconnaissait pas la définition de « revenu » comme la sienne.
Toutefois, Sraffa qui travaillait sur cette version du lexique – annotée une première fois par Keynes – défendit le traducteur et écrivit en rouge à la main : « page [53] in fine et [54] ». Ce passage correspond en effet au chapitre 6, « La définition du revenu, de l’épargne et de l’investissement » et s’énonce comme suit :
Nous pouvons dès lors définir le revenu de l’entrepreneur comme étant l’excès de la valeur des produits finis qu’il a vendus au cours de la période sur son coût premier. Par suite, comme le revenu du reste de la communauté est égal au coût de facteur de l’entrepreneur, le revenu global est égal à A - U (Keynes, [1942] 2017, p. 106 et 107).
Le terme « revenu global », à notre avis, aurait dû figurer dans le lexique au lieu de « revenu » pour traduire « aggregate income ».
Dans les deux premières versions du lexique du début 1939, on trouve, à la suite de la définition du « revenu », la phrase suivante formulée par Largentaye et que Keynes et Sraffa avaient conservée :
Le revenu global, le « produit » et la demande effective ne sont qu’une seule et même chose, envisagée sous trois angles différents.
Cette phrase de Largentaye met en exergue l’identité de la demande effective, du revenu (global) et du produit (global), triptyque que l’on peut considérer comme un des éléments-clés de la Théorie générale. Malheureusement, Largentaye la supprima dans la version publiée en 1942.
Autre suppression regrettable, celle qui figurait dans la première version du lexique de 1939, conservée par Keynes et Sraffa :
On considère que dans la courte période, il n’y a qu’un seul montant du revenu qui soit associé à chaque volume de l’emploi.
104Largentaye supprima cette phrase dans la seconde version du lexique 28 mars 1939, ce qui est dommage car elle éclaire celle qui lui succède et qui a été gardée dans la version du lexique publiée en 1942 :
Le revenu et l’emploi varient donc35 parallèlement et sont les variables dépendantes du système.
On pourrait enfin ajouter que les trois grandeurs, le revenu global, le produit global et la demande effective ont la même valeur et sont des variables dépendantes (ou endogènes).
8. le taux de troc extérieur (terms of trade) « ou rapport réel des échanges est une notion qui tient une place importante dans les études classiques ».
Largentaye définit cette expression par sa mesure : « le rapport entre l’index de prix importés et l’index des produits exportés » (Taussig) ou « le rapport entre une quantité de travail étranger et la quantité de travail national qui s’échange contre la première sous forme de marchandises et de services » (Marshall).
L’annotation « not necessary » de Keynes en marge des mots « taux des échanges » dans la première version du lexique de début 1939 indiquait sans doute que l’auteur ne jugeait pas utile d’inclure « terms of trade » dans ce lexique.
Dans l’édition 1969 de la Théorie générale (Petite Bibliothèque Payot)36, Largentaye traduisit « terms of trade » par « termes de l’échange », expression qui était alors couramment admise en français. La définition (Keynes, [1942] 2017, p. 487) reste la même que celle du lexique de la première édition Payot (1942).
9. la vitesse de transformation de la monnaie en revenu (income velocity of money) « est un concept de l’école classique qui peut être défini par le rapport entre le revenu et la quantité de monnaie ».
La définition de cette expression dans le lexique de l’édition Payot 1942 (et ultérieures) reprend à peu près celle que Keynes lui avait donnée 105au début du chapitre 15, « Les motifs psychologiques et sociaux de la liquidité » :
[C]ar cette vitesse de transformation mesure simplement la proportion de ses revenus que le public désire conserver sous la forme liquide (Keynes, [1942] 2017, p. 266).
Keynes annota en marge de cette expression : « Do I use this term ? » et « Better omit. This is not a term I use ». Pourtant, Keynes l’avait utilisée sept fois au total dans la Théorie générale (Keynes, [1942] 2017, p. 266, p. 274, p. 282, p. 336, p. 375, p. 385, p. 391) mais il ne souhaitait pas qu’elle fît partie du nombre limité de mots du lexique français censés caractériser sa nouvelle théorie. Nonobstant, dans le lexique publié en 1942 et dans les éditions ultérieures de la Théorie générale, l’expression ainsi que sa définition seront conservées.
Les neuf termes du lexique qui ont été présentés donnent un aperçu des discussions qui ont eu lieu entre Largentaye, Keynes et Sraffa, ces deux derniers n’ayant d’ailleurs pas toujours eu le même point de vue. Le lecteur intéressé pourra se reporter à l’annexe reproduite dans ce numéro pour prendre connaissance des échanges qui ont porté sur les autres termes.
Dans sa lettre du 3 avril 1939 évoquant pour la dernière fois le lexique, Keynes exprima avec emphase sa satisfaction suscitée par cette œuvre de son traducteur :
What a heavy work it has been ! I hope you have not felt overburdened by it. I much appreciate how much trouble you have taken, and the success with which you have tackled an awkward task37.
106Conclusion
L’élaboration de la table de correspondance qui allait devenir un lexique suivit un processus se déroulant pendant vingt mois, parallèlement à la traduction des vingt-quatre chapitres de la Théorie générale. Ce lexique, œuvre du traducteur à la fois audacieuse et singulière, sans équivalent dans les traductions allemande et japonaise de 1936, joue un rôle essentiel dans la compréhension de la Théorie générale et de ses nouveaux concepts ; il constitue une armature théorique soutenant l’ensemble de la traduction. Il introduit un nouveau vocabulaire dans le langage économique français grâce à de nouveaux termes, tous validés par Keynes.
Il reste à réviser régulièrement ce canevas de concepts et définitions, nécessairement incomplet et sujet à obsolescence, en restant fidèle à la pensée de ce grand économiste du xxe siècle afin de le rendre utile au lectorat francophone contemporain. Quelques pistes seront suggérées dans cette perspective.
Il nous semble d’abord que le lexique français, qui ne comporte dans la dernière édition de la Théorie générale, celle de Payot 2017, que cinquante-sept termes, gagnerait à être enrichi comme Keynes en avait exprimé le souhait dans sa lettre du 3 avril 1939 (« I should have rather expected that there would be a larger number of terms in the complete version »)38. Trois termes en particulier auraient pu être ajoutés dès la première édition de 1942.
En premier lieu le terme « inflation » qui n’était pas employé dans le sens keynésien dans les années 1930 – on disait alors « reflation » (Armand de Largentaye, 2021) – absent du lexique, pourrait y être introduit. Sa définition est donnée au chapitre 21, « La théorie des prix » :
Lorsqu’un nouvel accroissement du montant de la demande effective ne provoque pas de nouvelle augmentation du volume de la production et se traduit par un accroissement de l’unité de coût qui lui est pleinement proportionnel, on est parvenu à un état qu’on peut proprement qualifier d’inflation véritable (Keynes, [1942] 2017, p. 390).
107Deuxièmement, plusieurs termes dérivés de « taux d’intérêt » et qui se trouvent dans l’index anglais à la fin de The General Theory, auraient pu figurer dans le lexique français, en particulier « taux d’intérêt d’équilibre », « taux d’intérêt à court terme », « taux d’intérêt naturel », « taux d’intérêt neutre » avec leurs définitions respectives. En effet, ce sont des concepts importants peut être encore plus aujourd’hui qu’à l’époque de Keynes.
Le terme « thésaurisation » tel qu’il est présenté à la fin du chapitre 13, « La théorie générale du taux de l’intérêt » (Keynes, [1942] 2017, p. 242), mériterait aussi d’entrer dans le lexique et d’être développé. Après la publication de The General Theory, ce terme a été au cœur de controverses portant sur le caractère exogène ou non de la quantité de monnaie et encore de nos jours son utilisation dans le langage courant peut être source de confusion par exemple, quand « thésauriser » au lieu de « tendance à thésauriser » (l’équivalent de « préférence pour la liquidité ») est employé.
Par ailleurs, si les anglicismes et les « francisations » de termes anglais sont à éviter d’une façon générale, constatons que certains termes économiques anglais ont fini par s’imposer dans la langue française et devraient aussi entrer dans le lexique. Ainsi, l’expression « animal spirits » que Keynes a utilisée en particulier dans le chapitre 12, « L’état de la prévision à long terme », est devenue un des emblèmes de la terminologie keynésienne. Elle a été traduite par « enthousiasme naturel » (édition 1942) puis par « dynamisme naturel » (1969). Aujourd’hui, notamment depuis la publication d’Animal Spirits d’Akerlof et Shiller en 2009, cette expression fait assurément partie du langage économique et financier français. Dans une nouvelle version du lexique, la définition pourrait s’inspirer de celle de Joan Robinson pour qui les esprits animaux « incitent les entrepreneurs à prendre des risques d’investissement » (Robinson, 1957, p. 523-538). L’expression « esprits animaux » a d’ailleurs été reprise dans l’édition 2017 de Payot de la Théorie générale (Keynes, [1942] 2017, p. 228) mais ne fait pas encore partie du lexique.
Le rassemblement de brèves notices sur les économistes figurant dans l’index anglais de The General Theory (Keynes, 1936, p. 385-403) formerait une « galerie de portraits » de condisciples de Keynes choisis et décrits par lui. Y figureraient des noms tels que Böhm-Bawerk, Hayek, Heckscher, Malthus, Marshall, Pigou, Walras… Ce recueil dont la singularité résulterait de la vision de Keynes de ces économistes et de 108leurs œuvres, en relation avec la Théorie générale, pourrait constituer un document distinct du lexique.
D’autres développements du lexique, rendus possibles par les technologies modernes et justifiés par l’internationalisation des échanges, seraient souhaitables.
À l’instar de l’index anglais, on pourrait indiquer les numéros des pages de la Théorie générale où apparaît chacun des termes définis, ce qui faciliterait l’utilisation pratique du lexique pour le lecteur français.
À partir des traductions dans la douzaine de langues de la Théorie générale qui existent déjà39, on pourrait ajouter pour chaque terme du lexique français, les traductions dans quelques langues, comme cela a été fait par exemple pour la terminologie freudienne40. Cette variante multilingue de la table d’équivalence rejoindrait ce que souhaitait Keynes en 1938, au début du processus de la traduction française. Chaque terme serait suivi de sa définition en français. Et ce dictionnaire multilingue de la terminologie keynésienne pourrait être mis en ligne sur internet facilitant ainsi les échanges à travers le monde d’économistes se réclamant de la Théorie générale.
109RÉfÉrences
Publications
Akerlof, George A. & Schiller, Robert J. [2009], Animal Spirits, Princeton (NJ), Princeton University Press, traduit en français par Corinne Faure-Geors, Les esprits animaux, Flammarion, Champs essais, 2013.
Colson, Clément [1910], Cours d’économie politique, Paris, Gauthier-Villard & Alcan.
Coquelin, Charles & Guillaumin, Gilbert-Urbain (dir.) [1864], Dictionnaire de l’économie politique, Paris, Guillaumin, 2 vol.
Gide, Charles [1919], Cours d’économie politique, 10e éd., Paris, Librairie du Recueil Sirey, 2 vol., 1930.
Gide, Charles & Rist, Charles [1909], Histoire des doctrines économiques, 5e éd., Paris, Sirey, 1926.
Halbwachs, Maurice [2016], « Keynes », Abstraction et expérience sur la Théorie générale, Gilles Montigny (éd.), Paris, Éditions rue d’Ulm.
Kahn, Richard F. [1984], The making of Keynes’ General Theory, Raffaele Mattioli Foundation, Cambridge, Cambridge University Press.
Kaldor, Nicholas [1983], « L’économie keynésienne cinquante ans après », traduction française par Hélène de Largentaye in Économie et instabilité, Paris, Économica, 1988.
Keynes, John Maynard [1933], Essais de Persuasion, traduit de l’anglais par Herbert Jacoby, Paris, Gallimard.
Keynes, John Maynard [1936], The General Theory of Employment, Interest and Money, Londres, Palgrave & Macmillan, 2007.
Keynes, John Maynard [1942], Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, traduit par Jean de Largentaye, Paris, Payot.
Keynes, John Maynard [1942], Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, traduction de Jean de Largentaye. Préface d’Hélène de Largentaye, Paris, Payot, 2017.
Keynes, John Maynard [1969], Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, traduction de Jean de Largentaye entièrement revue, Paris, Payot.
Laplanche, Jean & Pontalis, Jean-Baptiste [1967], Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, PUF.
Largentaye, Armand de [2021], « Jean de Largentaye, l’ardent traducteur de The General Theory », dans ce numéro.
110Largentaye, Hélène de [2019], « Gained in translation : the French edition of The General Theory by J.M. Keynes », Research in the History of Economic Thought and Methodology, vol. 37 B, p. 95-111.
Largentaye, Hélène de [2021], « Jean de Largentaye et Payot, quatre ans d’échanges entre le traducteur et l’éditeur de la Théorie Générale de Keynes 1938-1942 », dans ce numéro.
Lerner, Abba P. [1936], « La Théorie générale de M. Keynes sur les rapports entre l’emploi, l’intérêt et la monnaie », Revue internationale du travail, vol. 152 (2013), No HS1, p. 43-55, Shortened version of the original one published, vol. 34, No 4 (oct.), p. 465-489.
Mantoux, Étienne [1937], « La Théorie générale de M. Keynes », Revue d’économie politique, vol. 51, No 6, nov.-déc. 1937, p. 1559-1590.
Marshall, Alfred [1906], Principes d’économie politique, traduit en français par F. Souvaire-Jourdan & F. Savinien-Bouyssy, Paris, Giard et Brière.
Mendès France, Pierre [1984], Œuvres complètes, Tome 1, S’engager (1922-1943), Paris, Gallimard.
Mendès France, Pierre & Ardant, Gabriel [1954], La science économique et l’action, Paris, UNESCO-Julliard.
Moisseev, Moïse [1938], « La Théorie Générale de Mr. Keynes », Revue des sciences économiques, juin, p. 103-122.
Muth, John H. [1961], « Rational Expectations and the Theory of Price Movements », Econometrica, vol. 29, No 3, p. 315-335.
Robinson, Joan [1956], The Accumulation of Capital, London, Macmillan.
Robinson, Joan [1957], « Théorie de la répartition », traduit par M. de Felice, Économie appliquée, « Profit et croissance II », oct.-déc., vol. X, no 4, p. 523-538.
Say, Léon & Chailley, Joseph [1900], Nouveau dictionnaire de l’économie politique, Paris, Felix Alcan, 2 vol.
Tortajada, Ramón [2021], « The General Theory, Keynes et les économistes français, de sa traduction à l’immédiat après-guerre », dans ce numéro.
Documents inÉdits
Archive Centre, King’s College, Cambridge (England)
JMK/ GTE/ 3-3B Correspondance entre J.M. Keynes et J. de Largentaye (1938-1946)
– 18 lettres de J.M. Keynes à J. de Largentaye.
– 17 lettres de J. de Largentaye à J.M. Keynes.
111Archives privées (famille Largentaye)
Projets de Lexique de la Théorie générale de J.M. Keynes, corrections manuscrites et commentaires de J.M. Keynes et de P. Sraffa (versions de début 1939 et du 28 mars 1939).
112Annexe
Lexique de la Théorie générale annoté par Keynes et Sraffa
Remarques préliminaires
Les archives familiales du traducteur comprennent deux des dernières versions du projet de lexique. La première date de début 1939 sans qu’il soit possible d’en donner la date précise, la seconde accompagnait la lettre de Largentaye à Keynes datée du 28 mars 1939. Ces deux versions provisoires sur lesquelles Keynes et Sraffa ont porté leurs annotations manuscrites en anglais ont permis de reconstituer la version définitive du lexique figurant à la fin de la Théorie générale, publiée par Payot en 1942, et sur laquelle s’appuie la présente Annexe.
Les annotations en anglais de Keynes et de Sraffa sont indiquées par un astérisque et sont suivies par leur traduction en français en petits caractères.
Par exemple : Le produit (proceeds)*
* Keynes : Proceeds is a sum of money. Saying “produit” is confusing in that sense since it suggests a result in terms of goods. “Proceeds’’est une somme d’argent. Dire « produit » prête à confusion en ce sens où ce terme suggère un résultat en termes de biens.
Selon les conventions conclues entre auteur et traducteur et rappelées au début du lexique41, lorsque la définition correspond à celle que Keynes a énoncée dans un des chapitres de son ouvrage, traduite en français dans l’édition Payot, elle figure entre guillemets dans le lexique. Elle est suivie dans celui-ci, entre parenthèses, du numéro de la page de référence dans l’édition française de la Théorie générale ; à cette fin, nous avons jugé plus pratique pour la présente annexe d’utiliser la pagination de la dernière édition de la Théorie générale, celle de Payot 201742.
113LEXIQUE
Le présent lexique, qui est l’œuvre du traducteur, est uniquement destiné à faciliter au lecteur l’intelligence du texte français. Beaucoup des définitions qu’il contient ont un caractère explicatif et il convient de ne pas leur accorder la même portée qu’aux définitions de l’auteur qui figurent dans le corps de l’ouvrage. Lorsque celles-ci ont été reproduites littéralement, elles sont entre guillemets et la référence au texte est indiquée (N. du T.)43.
Le mot capital ou équipement en capital (capital equipment) s’applique aux richesses utiles de toutes sortes. Le capital comprend par conséquent les moyens de production, l’outillage, les stocks de marchandises, les maisons d’habitation, etc. En aucun cas ce mot n’est pris dans le sens restreint de monnaie qu’on lui donne parfois, par exemple lorsqu’on parle de mouvements internationaux de capitaux.
Le capital fixe (fixed capital) est le capital qui existe sous une forme durable et dont les rendements s’échelonnent sur une certaine période. Sa participation à la production n’entraîne pour lui qu’une usure graduelle. Il comprend les immeubles, l’outillage, etc.
Le capital circulant ou capital d’exploitation (working capital) comprend les marchandises en cours de fabrication.
Le capital liquide (liquid capital) comprend les produits achevés prêts à être vendus.
La crise (crisis), au sens restreint du mot, est caractérisée par la baisse soudaine de l’efficacité marginale du capital au début d’une phase de dépression.
L’efficacité marginale d’un type de capital (marginal efficiency of a type of capital) est le taux d’escompte qui rend la valeur actuelle de la série d’annuités constituée par les rendements escomptés d’une unité supplémentaire de ce capital égale à son prix d’offre. (i.e. approximativement à son prix de revient).
« L’efficacité marginale du capital (marginal efficiency of capital) est la plus élevée des efficacités marginales des divers types de capital » (p. 200).
L’efficacité marginale du capital décroît lorsque, toutes choses égales d’ailleurs, l’investissement courant augmente.
114La courbe de l’efficacité marginale du capital ou courbe de la demande de capital (schedule of the marginal efficiency of capital or investment demand schedule) relie l’efficacité marginale du capital au montant de l’investissement* courant. Cette courbe est une des trois variables indépendantes du système, c’est-à-dire qu’elle change pour des causes autonomes.
*Keynes : during a given period or current (as the definition of current is given below, current is better, I think) (p. 136). « pendant une période donnée » ou « courant » (comme la définition de « courant » est indiquée ci-dessous, « courant » est préférable, je pense) (p. 200).
Le chiffre d’affaires (sales-turnover) est le montant des ventes effectuées, tant aux consommateurs qu’aux entrepreneurs, pendant la période considérée.
La consommation (consumption). La dépense pour la consommation (expenditure on consumption) est « la valeur des biens vendus aux consommateurs durant la période considérée » (p. 115). Son montant global est égal au chiffre d’affaires A diminué des ventes A1 faites aux autres entrepreneurs, c’est-à-dire à A - A1. La ligne de séparation entre les entrepreneurs et les consommateurs peut être placée en un point arbitrairement choisi.
L’adjectif courant (current) désigne le montant d’une grandeur variable à l’époque que l’on considère ou encore pendant la période que l’on considère si la grandeur qualifiée a la dimension d’une quantité par unité de temps, comme le revenu, la consommation, l’épargne ou l’investissement. Lorsqu’on a affaire à ces dernières grandeurs, on désigne leur mesure par le mot montant, étant entendu qu’il s’agit du montant par unité de temps, ou d’une façon plus précise par le mot flux.
Le coût de facteur (factor cost) d’un certain volume d’emploi est « le montant payé par l’entrepreneur aux facteurs de production (autres que les entrepreneurs) en échange de leurs services courants » (p. 73).
Le coût d’usage (user cost) est « la diminution de valeur subie par l’équipement au cours de la période considérée du fait de sa participation à la production » (p. 125)44. La différence entre G’ - B’, valeur 115maximum qu’aurait pu avoir l’équipement à la fin de la période s’il était resté inactif et G valeur qu’il a réellement à la fin de la période provient d’une part de la diminution de valeur U résultant de sa participation à la production, d’autre part de l’augmentation de valeur A1 résultant des achats au dehors*. On a donc :
(G’ – B’) – G = U – A1
et, par suite :
U = (G’ – B’) – (G – A1)45.
Lorsqu’à la fin de la période, la valeur réelle de l’équipement dépasse, d’un montant supérieur aux achats faits hors de l’entreprise, la valeur maximum qu’il aurait pu avoir s’il était inactif, le coût d’usage est négatif.
*Keynes : isn’t this, perhaps, an unnecessary repetition of the text ? N’est-ce pas, peut-être une répétition inutile du texte ?
Le coût premier (prime cost) est « la somme du coût de facteur et du coût d’usage » (p. 105-106).
Le coût supplémentaire (supplementary cost) est « la diminution de valeur de l’équipement qui ne dépend pas de la volonté de l’entrepreneur mais que celui-ci peut prévoir. C’est encore l’excès de la dépréciation attendue sur le coût d’usage » (p. 109). Le coût supplémentaire ne résulte pas de la participation de l’équipement à la production, mais de la désuétude et des pertes assez régulières pour constituer dans l’ensemble de la communauté 116des risques assurables. On distingue le coût supplémentaire fondamental (basic) qui est déterminé à l’origine compte tenu du coût de l’équipement et de sa durée prévue, et le coût supplémentaire courant (current) qui est réévalué ultérieurement sur la base de la valeur courante de l’équipement et de l’estimation courante de sa durée future d’existence.
La courbe de la demande globale (aggregate demand function) relie les divers volumes globaux de l’emploi aux « produits »* que les entrepreneurs espèrent en tirer. Conjointement avec la courbe de l’offre globale elle détermine la demande effective et l’emploi.
*Keynes : souligne le mot « produits » ; “proceeds” is not produits. It means “sale proceeds46” ; “proceeds” n’est pas « produits ». Ce terme signifie « chiffre d’affaires ».
La demande effective (effective demand) est « le montant47 du “produit” attendu au point de la courbe de la demande globale où elle est coupée par la courbe de l’offre globale » (p. 76). En d’autres termes elle est la somme des dépenses de consommation et des dépenses d’investissement, telles que les entrepreneurs les prévoient lorsqu’ils fixent le volume de l’emploi. La demande effective a la nature d’une commande ou d’une dépense et ne doit pas être confondue avec la demande potentielle qui intervient dans la loi de l’offre et de la demande. De plus elle est une demande attendue et c’est par là qu’elle se distingue du revenu.
La désutilité (disutility) du travail ou de l’emploi est l’ensemble des raisons qui font qu’on ne travaille pas pour un salaire inférieur à un certain minimum. De même que l’utilité est l’aptitude à satisfaire un besoin, la désutilité est l’aptitude à contrarier un besoin. Un travail ou un emploi est désutile parce qu’il empêche de se consacrer à une autre occupation, utile ou non, ou simplement parce qu’il contrarie le goût de ne rien faire. La désutilité se distingue de la nuisance par son caractère subjectif – elle n’existe que par rapport au travailleur lui-même – et aussi par le fait que normalement elle est compensée par une utilité qui lui est égale ou supérieure.
L’emploi (employment) est le nombre des unités de travail employées. Pour fixer les idées, on pourrait dire qu’il est le nombre d’heures de 117travail fournies. Dans la définition plus précise donnée au chapitre 4, il est indiqué que chaque unité de travail est affectée d’un coefficient de pondération égal au rapport entre sa rémunération et l’unité de salaire. L’emploi est gouverné par la demande effective. Il varie parallèlement au revenu et ces deux quantités sont les variables dépendantes du système.
Le mot entreprise (enterprise) est généralement employé dans le sens ordinaire. Mais on l’emploie aussi dans un sens restreint applicable au marché financier. Dans ce sens, il s’oppose au mot spéculation et désigne « l’activité qui consiste à prévoir le rendement des capitaux au cours de leur existence tout entière48 » (p. 225).
L’épargne (saving) est « l’excès du revenu sur la consommation » (p. 115).
L’épargne nette (net saving) est « l’excès du revenu net sur la consommation » (p. 115).
Equipement (equipment) : voir Capital.
Seul est considéré comme facteur de production (factor of production) dans le présent ouvrage le travail y compris les services personnels de l’entrepreneur et de ses assistants.*
*Keynes : Delete. There is no such definition in the text. I do not want to exclude someone from calling a machine a factor of production49. Supprimer. Il n’existe pas une telle définition dans le texte. Je ne veux pas exclure quelqu’un qui appellerait une machine un facteur de production.
L’incitation à investir (inducement to invest) est le motif qui pousse à investir. « Elle dépend de la courbe de l’efficacité marginale du capital et du taux de l’intérêt » (p. 201)50.
118L’investissement courant (current investment) est « l’addition à la valeur de l’équipement qui résulte de l’activité productrice de la période » (p. 115-116). Il est donc égal aux achats A1 faits par les entrepreneurs diminués du désinvestissement résultant de la production, c’est-à-dire du coût d’usage,
I = A1 – U.
L’investissement net (net investment) est « l’adjonction nette à la valeur des équipements de toute nature, après déduction des variations de la valeur des anciens équipements qui entrent dans le calcul du revenu net51 » (p. 132).
I (net) = A1 – U – V.
L’investissement et l’investissement net sont identiques respectivement à l’épargne et à l’épargne nette.
Le terme placement que l’usage tend à distinguer du terme investissement a été réservé au marché financier.
La préférence pour la liquidité (liquidity preference) est la préférence donnée à l’argent liquide sur les autres formes de richesse. Elle se mesure par la valeur de ses ressources52 qu’on désire conserver à chaque instant sous forme de monnaie53.
La courbe de la préférence pour la liquidité (schedule of liquidity preference) est la courbe « indiquant le montant de leurs biens que les individus désirent conserver sous forme de monnaie en différentes séries de circonstances » 119notamment lorsque le taux de l’intérêt varie, « ce montant étant calculé en unités de monnaie ou en unités de salaire54 » (p. 233)55.
Le montant marginal (marginal) de l’attribut d’une chose est le montant de l’attribut possédé par la dernière unité existante de cette chose, c’est-à-dire par l’unité qui disparaîtrait si la quantité de cette chose était réduite d’une unité. Par exemple, le salaire marginal ou la production marginale est le salaire ou la production de l’unité de travail qui disparaîtrait si l’emploi était réduit d’une unité. Dans le calcul différentiel, le montant marginal de l’attribut est le rapport des variations corrélatives de l’attribut et de la chose à laquelle il se rapporte lorsque les deux variations tendent vers zéro.
Un procédé médiat (roundabout process) de production, est un procédé qui met en œuvre le capital*. Il se divise donc en plusieurs stades. Les stades primaires correspondent à la création du capital et les stades secondaires à l’utilisation du capital pour la production des biens de consommation.
*Keynes : ch. 1656.
Le multiplicateur d’investissement (investment multiplier) k « indique que, lorsque l’investissement croît, le montant du revenu augmente de k fois l’accroissement de l’investissement » (p. 176)57.
120Le multiplicateur de l’emploi (employment multiplier) est le rapport entre l’augmentation de l’emploi total et l’augmentation de l’emploi primaire (c’est-à-dire de l’emploi dans les industries produisant les biens de capital)58 auquel il est associé (p. 176-177).
Le prix de l’offre globale (aggregate supply price) de la production résultant d’un certain volume d’emploi est « le produit attendu* qui est juste suffisant pour qu’aux yeux des entrepreneurs il vaille la peine d’offrir ce volume d’emploi59 » (p. 74). On remarquera que « le coût d’usage n’est pas compris dans le prix de l’offre globale » (p. 74, note 2).
*Keynes : No, attendu ; annotation à côté du mot « escompté » que le traducteur avait écrit dans la version du 28 mars 1939 du lexique et que Keynes avait souligné.
La courbe de l’offre globale (aggregate supply function) relie les divers volumes globaux de l’emploi aux prix de l’offre globale de la production qui en résulte. L’emploi cesse de croître lorsque le prix de la demande globale est égal au prix de l’offre globale, c’est-à-dire lorsque le volume de l’emploi est tel que le « produit » espéré* par les entrepreneurs est juste suffisant pour les décider à offrir ce volume d’emploi.
*Keynes a entouré le mot « escompté » utilisé dans la version du 28 mars 1939 du lexique et que le traducteur a remplacé par « espéré60 » dans la version finale.
Le prix d’offre de courte période d’une richesse (short period supply price) est égal « au coût premier marginal » (p. 122) c’est-à-dire à la somme des valeurs marginales du coût de facteur et du coût d’usage. Le prix d’offre de courte 121période s’apparente à ce qu’on appelle parfois le prix de revient partiel, encore que celui-ci ne paraisse pas comprendre l’intégralité du coût d’usage.
Le prix d’offre de longue période (long period supply price) est supérieur au prix d’offre de courte période. On y peut distinguer le coût premier, le coût supplémentaire, le coût de risque et le coût d’intérêt (p. 122)*.
*Keynes : Not an exact quotation or definition Line 1861. Ce n’est pas une citation exacte ni une définition. Ligne 18.
La courte période (short period) est une notion usuelle dans l’économie classique. Elle correspond à une période assez courte pour que le volume de l’équipement ne puisse pas changer sensiblement*.
*Keynes : I think it is very useful to give to the French reader a definition of this concept. Perhaps would you prefer another. Quite satisfactory. Je pense qu’il est très utile de donner au lecteur français une définition de ce concept. Peut-être en préféreriez une autre. Très satisfaisant.
La longue période (long period) correspond à une période au cours de laquelle le volume de l’équipement peut subir des variations appréciables.
La perte imprévisible (windfall loss) est « la diminution de valeur de l’équipement qui est tout à la fois involontaire et, au sens large, imprévue » (p. 110). Elle peut être due à une variation des valeurs de marché, à une catastrophe, etc.
Le plein emploi (full employment) est une situation telle que les facteurs de production désireux de travailler soient tous employés. Elle se caractérise par le fait que l’augmentation du montant de la demande effective ne s’accompagne d’aucun accroissement des volumes de la production et de l’emploi. Le plein emploi peut encore être défini « le volume maximum de l’emploi compatible avec un salaire réel donné » (p. 62)62.
122La prévision à court terme63 (short term expectation) « a trait au prix qu’un fabricant, au moment où il s’engage dans une fabrication, peut espérer obtenir en échange des produits qui en résulteront (p. 98) ».
La prévision à long terme (long term expectation) « a trait aux sommes que l’entrepreneur peut espérer gagner sous forme de revenus futurs s’il achète (ou parfois s’il fabrique) des produits finis pour les adjoindre à son équipement en capital (p. 98)64 ».
Le produit (proceeds)* d’un certain volume de l’emploi est le montant en argent du « revenu global qui résulte de ce volume d’emploi, i.e. la somme du coût de facteur global et du profit global » (p. 74). Le « produit » est le revenu global envisagé du point de vue des entrepreneurs, i.e. le chiffre d’affaires diminué du coût d’usage.
* Keynes : Proceeds is a sum of money. Saying “produit” is confusing in that sense since it suggests a result in terms of goods65. “Proceeds’’est une somme d’argent. Dire « produit » prête à confusion en ce sens où ce terme suggère un résultat en termes de biens.
La propension à consommer (propensity to consume) est la relation fonctionnelle (ou potentielle) « entre un revenu global et la dépense de consommation à laquelle il donne naissance, les deux quantités étant mesurées en unités de salaire » (p. 148). Elle est en quelque sorte, la relation entre les divers volumes possibles du revenu réel et les volumes de la consommation réelle qui leur correspondent. La propension à consommer est la deuxième variable indépendante du système.
La propension marginale à consommer est « le rapport entre l’accroissement du revenu et l’accroissement corrélatif de la consommation, les deux quantités étant mesurées en unités de salaires » (p. 176)66.
Les ressources (resources) comprennent les facteurs de production, la richesse naturelle et le capital accumulé.
123Le revenu (income) est la valeur de la production due à l’activité de la période considérée. Il comprend le revenu de l’entrepreneur et le revenu des autres facteurs de production. Le revenu de l’entrepreneur est égal à la différence entre le chiffre d’affaires et le coût premier, i.e. la somme du coût de facteur et du coût d’usage. Le revenu des autres facteurs de production est égal au coût de facteur. Donc le revenu est égal à la différence entre le chiffre d’affaires et le coût d’usage,
R* = A – U.
Le revenu et l’emploi varient parallèlement et sont les variables dépendantes du système.
Ajoutons que le revenu est égal à la somme de la consommation et de l’investissement.
*Keynes a entouré R et annoté : “Y is my usual symbol for income. Dangerous to change. I may use R for something else”. Y est le symbole que j’utilise d’habitude pour revenu. Il est dangereux de changer. Je pourrais utiliser R pour autre chose67.
Le revenu net (net income) est égal au revenu diminué du coût supplémentaire, A – U – V. Il est égal à la somme de la consommation et de l’investissement net.
La spéculation (speculation), au sens boursier du mot, est « l’activité qui consiste à prévoir l’état psychologique du marché financier » (p. 225).
Le taux de troc extérieur68 (terms of trade)* ou rapport réel des échanges extérieurs est une notion qui tient une place importante dans les études classiques et néo-classiques consacrées aux avantages respectifs que les pays tirent de leurs échanges. Plusieurs mesures de ce taux ont été proposées. Le taux net de troc de Taussig est le rapport entre l’index des prix des produits importés et l’index des produits exportés. Le taux de troc extérieur de Marshall est en gros le rapport entre une quantité de travail étranger et la quantité de travail national qui s’échange contre la première sous forme de marchandises et de services.
124*Keynes : “I am doubtful that this is an equivalent. Doesn’t it suggest foreign exchange rates ? Perhaps les taux des marchés (internationaux)’’. « Je doute que cela soit un équivalent. Cela ne suggère-t-il pas des taux de changes ? Peut-être les taux des marchés internationaux ».
Le taux d’intérêt d’une richesse quelconque (own rate of interest), déterminé au moyen de cette richesse elle-même, est le pourcentage d’excès d’une certaine quantité de cette richesse livrable à terme sur la quantité immédiatement disponible de cette richesse qui s’échange contre la première.
Toute richesse durable a un taux d’intérêt propre qu’on appelle son taux d’intérêt spécifique.
Le taux d’intérêt spécifique d’une richesse, déterminé au moyen d’un étalon de valeur quelconque, (own rate of interest in terms of a standard of value) est le pourcentage d’excès de la valeur d’une certaine quantité de cette richesse livrable à terme sur la valeur de la quantité immédiatement disponible de cette richesse qui s’échange contre la première quantité, les deux valeurs étant exprimées au moyen de l’étalon choisi.
Le taux d’intérêt spécifique monétaire (own rate of money interest) est le taux d’intérêt d’une richesse, déterminé au moyen de la monnaie prise comme étalon de valeur.
Le taux d’intérêt de l’argent (money rate of interest) est le pourcentage d’excès d’une certaine somme de monnaie livrable à terme sur la somme immédiatement disponible qui s’échange contre la première.
Le taux d’intérêt de l’argent, qui est la troisième variable indépendante du système, est gouverné par la quantité de monnaie et par la préférence pour la liquidité
L’unité de travail (labour unit) est l’unité qui sert à mesurer l’emploi.
L’unité de salaire (wage unit) « est le salaire monétaire* de l’unité de travail » (p. 92).
*Keynes : ? en monnaie.
La valeur nominale ou monétaire (money value) est le nombre des unités de monnaie* contenu dans une valeur ou un prix. La valeur monétaire et l’emploi sont les deux seules grandeurs quantitatives utilisées dans l’analyse du système économique. Pour suivre les variations des valeurs réelles, il est souvent commode, en première approximation, de considérer les valeurs monétaires, mesurées en unités de salaire.
125*Keynes a noté un point d’interrogation en marge à gauche et a entouré “ou de salaire”.
* Sraffa : cf., p. 9269.
La vitesse de transformation de la monnaie en revenu* (income-velocity of money) est un concept de l’école classique qui peut être défini par le rapport entre le revenu et la quantité de monnaie70.
*Keynes : Better omit. This is not a term I use71. À supprimer de préférence. Ce n’est pas une expression que j’utilise.
Sraffa : This term comes from Haberler’s book “Prosperity and depression”72 translated very carefully by the Society of Nations. Cette expression vient du livre d’Haberler, Prospérité et dépression traduit avec beaucoup de soin par la Société des Nations.
1 L’article s’appuie sur des documents inédits, d’une part la correspondance de 24 lettres entre J.M. Keynes et Jean de Largentaye entre janvier 1938 et juin 1939, d’autre part deux versions de la « table d’équivalence » (ou « table de correspondance ») et deux versions disponibles du projet de « lexique », étant entendu qu’un certain nombre de versions intermédiaires de ce lexique ont disparu. La famille de Jean de Largentaye a légué en 1996 la correspondance et certains autres documents relatifs à la traduction française de The General Theory de Keynes à l’Archive Centre de King’s College, Cambridge (R.U.), où ils peuvent être consultés (voir infra). L’autrice remercie chaleureusement les réviseurs ainsi que Ramón Tortajada pour leur examen approfondi de ce texte et pour leurs propositions d’amélioration dont elle a été conduite à tenir très utilement le plus grand compte. Sauf indication contraire, toutes les traductions d’anglais en français sont faites par l’autrice de cet article.
2 Largentaye utilisa pour sa traduction la réimpression de décembre 1936 de The General Theory de Keynes. L’ouvrage est toujours dans la bibliothèque familiale. Il se l’était procuré chez « BRENTRANO’S Bookseller & Stationers, PARIS » comme l’indique une étiquette en troisième de couverture. La librairie existe toujours.
3 « En contribuant à dissiper les erreurs si profondément ancrées dans l’esprit du public, la large diffusion de votre œuvre en France faciliterait certainement la solution aux difficultés contre lesquelles notre pays se débat à présent ».
4 « Ma principale préoccupation, en effet, est de faciliter le plus possible la compréhension de la traduction pour les lecteurs qui ne sont pas des étudiants d’économie politique. C’est pourquoi, dans la mesure du possible, j’ai utilisé des mots de tous les jours ou du monde des affaires. »
5 Le texte original de la préface avait été perdu par l’éditeur anglais de Keynes de sorte que la version française fut traduite en anglais ; ce n’est que dans les années 1970 que le texte original fut retrouvé par la famille Largentaye qui le remit à l’éditeur anglais. Il figure à présent dans The General Theory (Keynes, [1936] (2007), p. xxi-xiv).
6 Nous avons repris ici la première traduction revue mot à mot par Keynes et publiée dans l’édition Payot de 1942 ; elle devait être légèrement modifiée lors de la révision de la traduction publiée en 1969 et dans les éditions postérieures.
7 « La tâche la plus importante, je pense, est d’obtenir des équivalents convenables pour mon ensemble de termes techniques. Mon traducteur allemand s’est donné un mal particulier à ce propos et a fourni en fait, à la fin de l’ouvrage, une table d’équivalents entre l’anglais et l’allemand des termes qu’il avait adoptés. Je crois qu’il serait utile que vous puissiez me remettre une liste de vos suggestions à cet égard ».
8 David M. Bensusan Butt (1914-1994), étudiant puis assistant de Keynes à King’s College, est connu, notamment, en tant qu’auteur de On Economic Growth : an Essay in Pure Theory (Oxford, Clarendon Press, 1960).
9 Eduard Rosenbaum, choisi par Keynes dans un premier temps comme traducteur avait dû renoncer en mai 1935 à la traduction (voir H. de Largentaye, 2021). La maison d’édition allemande Duncker & Humblot engagea alors Fritz Waeger. Celui-ci commença à traduire les chapitres de The General Theory qui étaient prêts dès l’automne 1935 et termina la traduction en décembre 1936. Pendant ces quinze mois, auteur et traducteur entretinrent une correspondance d’une quinzaine de lettres.
10 Dans sa préface à l’édition japonaise, le traducteur présenta ses excuses à l’éditeur pour le retard de cinq ans entre la fin de la traduction et la publication pour lequel il assumait l’entière responsabilité due simplement, selon ses propres termes, à sa paresse.
11 Piero Sraffa (1898-1983), proche ami de Gramsci, quitta l’Italie pour Cambridge (R.U.) en 1927 où il devait faire partie du premier cercle de Keynes (avec R. Kahn et J. Robinson notamment) ; il édita The Works and Correspondance of David Ricardo en onze volumes puis publia Production of Commodities by Means of Commodities. Prelude to a Critique of Economic Theory en 1960.
12 Keynes confondit l’auteur de cet article, Étienne Mantoux (1913-1945), âgé alors de vingt-cinq ans, avec son père Paul Mantoux (1877-1956) interprète militaire de Georges Clémenceau et interprète officiel à la conférence de Versailles en 1919 où Keynes avait dû faire sa connaissance.
13 « Je ne peux que déplorer le fait que votre œuvre soit si peu connue et si mal comprise en France comme le prouve la récente analyse critique de M. Mantoux dans la Revue d’économie politique de décembre 1937. »
14 « Il reste votre table de correspondance pour les termes techniques. Ici à nouveau les commentaires au crayon portés à la marge sont les miens. Sur la table elle-même figurent les commentaires de mon ami. Et ici encore, ces commentaires n’appellent pas d’autres explications ».
15 « Je n’aurais pas d’objection de taille s’il était tout à fait clair qu’il [le lexique, HL] est votre œuvre et pas la mienne. »
16 « En outre, les définitions que vous retenez constituent en fait, bien entendu, seulement une petite sélection parmi celles qui apparaissent dans l’ouvrage. Sans doute les avez-vous choisies en vue d’aider le lecteur autant que possible mais elles restent assurément un ensemble arbitraire parmi les termes spéciaux qui sont utilisés tout au long du livre. »
17 « N. du T. » signifie « note de Jean de Largentaye ».
18 « En ce qui concerne le glossaire : je suis beaucoup plus satisfait par sa forme révisée, avec la mention indiquant qu’il est l’œuvre du traducteur, et avec les termes en anglais figurant entre parenthèses ainsi que les références des numéros de pages où ils figurent [en français, HL] dans le corps du texte [de la traduction, HL]. En principe, j’accepte le lexique selon ces lignes et suis de votre avis qu’il peut être d’une grande aide pour le lecteur français. La difficulté est que peut-être cinquante ans ont passé sans qu’aucun travail économique moderne n’ait été en fait élaboré en langue française ; bien que, d’après ce que vous me dites, l’absence de termes techniques couramment acceptés pour des expressions anglaises qui n’ont pas été inventées par moi, mais qui, depuis des décennies, sont utilisées dans l’enseignement de l’économie politique en langue anglaise est plus marquée que ce que je croyais ».
19 Archives privées de la famille de Jean de Largentaye.
20 Le groupe X-Crise est né en 1931 d’une initiative de Gérard Bardet, André Loizillon et John Nicolétis, tous trois polytechniciens, pour susciter parmi leurs camarades des réflexions et des études relatives à la crise qui frappait alors la France, conséquence de la Grande Dépression. Le groupe d’études se développa rapidement pour atteindre 500 participants en 1933. Il se transforma alors en association loi 1901, le Centre polytechnicien d’études économiques (C.P.E.E.) qui comptait 2 000 adhérents en 1936. Il fut dissous par la défaite de 1940. Bien qu’accueillant toutes les sensibilités politiques, la tendance dominante du groupe X-Crise puis du C.P.E.E. était de remettre en cause l’économie libérale et de prôner une « économie coordonnée » voire dirigée.
21 « Un programme d’outillage national » est le titre français de l’essai « A Programme of Expansion » de Keynes (mai 1929). « Outillage » était le terme le plus souvent utilisé en français pour exprimer les concepts d’« equipment » ou d’« investment » en anglais jusqu’à la parution de la traduction de la Théorie générale de Keynes en 1942 qui emploie investissement.
22 « Mais à l’évidence, il n’est pas familiarisé avec les termes techniques : il semble s’efforcer de les traduire à l’aide d’un dictionnaire ou par les termes en usage dans les milieux d’affaires. Or, on trouve la plupart de ces termes dans l’édition française des Principles de Marshall, l’article de Lerner dans la Revue internationale du travail, et la recension de The General Theory par Étienne Mantoux dans la Revue d’économie politique (nov.-déc. 1937). Mantoux, très raisonnablement, a “francisé” vos termes techniques – et cela sonne tout à fait bien. Je vous envoie un glossaire que j’ai constitué en lisant Mantoux (avec les références à la page et à la ligne de son article) qui pourrait être utile à votre traducteur ».
23 Les huit termes techniques trouvés à la fois dans le lexique français de la Théorie générale (57 termes) et dans les Principes d’économie politique, traduits par F. Sauvaire-Jourdan et F. Savinien-Bouyssy, sont : capital, capital fixe, capital circulant, consommation, désutilité, marginal, revenu net, taux d’intérêt.
24 La famille Largentaye a retrouvé cet article de Moisseev dans les documents personnels du traducteur.
25 « Je pourrais vous faire part d’une autre suggestion relative aux termes techniques. Un économiste belge qui a fait une recension de mon livre, est d’avis que dans le cas de ‘‘liquidity preference’’, il est préférable, soit d’adopter mon terme anglais (peut-être en italiques), soit de le remplacer en français par une définition directe ; par exemple – ‘‘les hommes préfèrent conserver leur avoir en argent liquide’’. En tout état de cause, cette dernière phrase pourrait être incluse dans la table, ce qui pourrait aider le lecteur ».
26 Deux versions du lexique, la première datant de début 1939, la seconde du 28 mars 1939, annotées par Sraffa et Keynes ont été retrouvées dans les archives de la famille Largentaye.
27 Après la définition de chacun des neuf termes, nous avons ajouté, en chiffres écrits en petits caractères, les numéros des pages du lexique en annexe de cet article où ils figurent.
28 Sraffa s’était trompé en retranscrivant la traduction d’investment par Jean de Largentaye – « placement ou capital » – qui figure dans la table de correspondance accompagnant la lettre de celui-ci à Keynes datée du 8 mai 1938 ; Sraffa retranscrivit « placement de capital » (« de » au lieu de « ou » HL) dans l’annexe de la lettre de Keynes à Largentaye du 2 juin 1938, ce qui est une erreur.
29 « Ces mots ne traduisent Investment que dans le sens où il désigne le marché financier ; M. [Mantoux, HL] et aussi Rist utilisent toujours “investissement” ; pourquoi ne pas les suivre ? »
30 « Il est pratique d’emprunter à la France le terme placement pour signifier l’achat de titres, obligations ou actions, que ce soit à partir d’épargne récemment constituée ou à partir du produit de la vente d’autres propriétés. Le terme investissement peut alors être limité au sens de l’utilisation de la finance pour permettre la création de biens d’équipement. »
31 Richard Kahn a collaboré étroitement à l’élaboration de The General Theory notamment au titre de son invention du concept du multiplicateur de l’emploi que Keynes avait présenté en 1929, en l’empruntant à son ami, dans son article « Can Lloyd George do it ? » (Keynes, 1929, Nation and Athenaeum).
32 « Le mot “expectation” fut très difficile pour moi. Après de longues discussions, je crois que le mot français “prévision” est celui qui convient le mieux à votre pensée. Ce mot a été employé par le traducteur de Lerner et par Mantoux. La tendance actuelle est de lui donner au singulier un sens beaucoup plus large qu’auparavant. »
33 « Ce terme (anticipation) ne transmet pas aussi exactement en français le sens de “expectations” en anglais. Dans certains cas, mais pas dans tous, “prévision” peut s’y substituer mais en général “prévision” signifie “forecast” et désigne quelque chose de beaucoup trop précis ».
34 La théorie des « anticipations rationnelles » est née de l’article de Muth John H. (1961), professeur d’économie à l’université Carnegie Mellon (1930-2005). Elle a été par la suite développée notamment par l’économiste américain Robert G. Lucas. Elle est utilisée pour représenter les comportements des agents. Elle fait également partie de la théorie de l’efficience des marchés et constitue un des principes fondateurs de l’économie néo-classique contemporaine.
35 Le terme « donc » qui est présent dans la première version du lexique disparaît dans celle du 28 mars 1939 et de l’édition publiée en 1942.
36 En 1968, à la demande de Payot qui voulait publier la Théorie générale dans une collection de poche à un prix abordable, Largentaye révisa entièrement dans les mois suivants sa première traduction de 1939.
37 « Quel lourd travail cela a été ! J’espère que vous ne vous êtes pas senti trop accablé par ce fardeau. J’apprécie beaucoup la peine que vous vous êtes donnée et le succès avec lequel vous avez mené une tâche ingrate. »
38 « Je me serais plutôt attendu à ce qu’il y ait eu un plus grand nombre de termes dans la version complète du lexique. »
39 Américain, allemand, japonais, français, espagnol, italien, serbo-croate, hindi, finlandais, roumain, hongrois et russe.
40 Voir Laplanche & Pontalis, 1967.
41 Voir la mention de Jean de Largentaye au début de la page suivante.
42 Il convient cependant de noter que comme la traduction a été entièrement révisée par Jean de Largentaye en 1968-1969, il y a parfois de légères différences entre les définitions dans le texte et celles reproduites dans le lexique de 1942.
43 « N. du T. » signifie « Note de Jean de Largentaye ».
44 La version du 28 mars 1939 du lexique se poursuit par la phrase suivante : « Soit G’ - B’ la valeur nette maximum qu’il eût été possible de conserver à l’équipement s’il était resté oisif au cours de la période, B’ représentant les dépenses d’amélioration et d’entretien qu’il aurait été nécessaire d’effectuer sur cet équipement et G’ la valeur qu’il aurait eue à la fin de la période au cas où ces dépenses auraient été faites. La différence entre G’ - B’ et la valeur réelle G de l’équipement à la fin de la période provient, d’une part de la diminution de la valeur U résultant de sa participation à la production, d’autre part de l’augmentation de valeur A1 résultant des achats au dehors ». Le maintien des définitions de B’ et G’ dans la version 1942 du lexique aurait facilité la compréhension de ce paragraphe, selon nous.
45 « On peut encore dire que le coût-usage U est égal “à la somme que l’entrepreneur verse à ses collègues en paiement des achats qu’il doit leur faire, jointe au sacrifice qu’il consent en utilisant l’équipement au lieu de le laisser inactif” (cf. première page du chapitre 3, “Le principe de la demande effective”) c’est-à-dire à la somme de A1 et de la différence existant à la fin de la période entre la valeur maximum G’-B’ que l’équipement aurait pu avoir s’il était resté inactif et la valeur G qu’il a réellement U = A1 + (G’ - B’) - G ». Cette phrase figure dans la version du lexique du 28 mars 1939 mais a été supprimée dans la version publiée en 1942. On peut supposer que la remarque ci-dessus de Keynes notée après l’astérisque, en marge des deuxièmes et troisièmes phrases de la définition du coût d’usage (« n’est-ce pas peut-être une répétition inutile du texte ? »), ait conduit le traducteur à alléger le texte. Pourtant les phrases supprimées paraissent plus claires que la définition, suivie des expressions algébriques finalement maintenues dans l’édition 1942.
46 Keynes finira par accepter la traduction « produits » pour le terme anglais « proceeds » (cf. lettre de Keynes à Largentaye du 10 mai 1939 et cf. « produits », traduction de « proceeds » et sa définition ci-après dans le présent lexique).
47 « Le montant » a remplacé « la valeur » qui figure dans la version du lexique du 28 mars 1939.
48 La citation exacte du chapitre 12, « L’état de la prévision à long terme » est : « l’activité qui consiste à prévoir le rendement escompté des capitaux pendant leur existence entière. »
49 Keynes a barré en entier cette définition : nonobstant, le terme « facteur de production » figure bien dans le lexique de l’édition Payot 1942. Largentaye a trouvé ce terme au début de la section ii du chapitre 16, « Observations diverses sur la nature du capital », défini comme suit : « Il est préférable de considérer le travail, y compris bien entendu les services personnels de l’entrepreneur et de ses assistants, comme le seul facteur de production ; la technique, les ressources naturelles, l’équipement et la demande effective constituant le milieu déterminé où ce facteur opère ». On observe que dans le lexique français, la définition ci-dessus du terme « facteur de production » est circonscrite au « présent ouvrage ». Le traducteur ne prétendait pas en faire une définition économique générale, sans doute pour tenir compte de la remarque de Keynes.
50 La citation exacte du chapitre 11, « L’efficacité marginale du capital » est : « l’incitation à investir dépend en partie de la courbe de la demande de capital et en partie du taux de l’intérêt ». Elle paraît préférable car elle est plus fidèle à la définition de Keynes : « the inducement to invest depends partly on the investment demand-schedule and partly on the rate of interest ».
51 La citation exacte du chapitre 7, « Nouvelles considérations sur le sens des notions d’épargne et d’investissement » est « l’adjonction nette aux équipements en capital de toute nature, compte tenu des variations de valeur des anciens équipements qui entrent dans le calcul du revenu net ».
52 « des richesses… » dans la version du lexique du 28 mars 1939.
53 Le concept liquidity preference a été inventé par Keynes qui, sans le définir, l’a décrit succinctement, de façon indirecte au chapitre 13, « La théorie générale du taux de l’intérêt », section II : « La préférence pour la liquidité est une virtualité ou tendance fonctionnelle qui fixe la quantité de monnaie que le public conserve lorsque le taux d’intérêt est donné » (Keynes, [1942] 2017, p. 235). Á la section v de ce chapitre, Keynes éclaire le concept de « préférence pour la liquidité » en affirmant qu’il peut être remplacé par « tendance à thésauriser » (Keynes, [1942] 2017, p. 242). Par ailleurs, l’analyse des trois motifs de la préférence pour la liquidité – transactions, précaution et spéculation – au début du chapitre 17, « Les motifs psychologiques et commerciaux de la liquidité », constitue une approche détaillée du concept (Keynes, [1942] 2017, p. 266-269).
54 Dans la version du lexique du 28 mars 1939, la définition est la suivante « La courbe de la préférence pour la liquidité (schedule of liquidity preference) est la courbe indiquant la valeur des biens que les individus désirent conserver sous forme de monnaie en différentes séries de circonstances et notamment lorsque le taux de l’intérêt varie, les quantités de valeur étant mesurées en unités de monnaie ou en unités de salaire. » Les mots en italiques (valeur, quantités de valeur, mesurées) ont été remplacés dans la version finale respectivement par « montant » deux fois et « calculé » ce qui est plus proche du texte anglais « amounts of his resources, valued in terms of money » ; ce changement a été effectué à l’initiative du traducteur.
55 Le terme « prime à la liquidité » d’une richesse (liquidity premium) a été supprimé par Keynes dans la version du 28 mars 1939 du lexique. La définition du traducteur était la traduction de celle de Keynes figurant au chapitre 17, section ii « Les propriétés essentielles de l’intérêt et de la monnaie ». Elle était mise entre guillemets et s’énonçait comme suit : « Nous appellerons prime de liquidité l d’une certaine richesse le montant, mesuré au moyen de cette richesse elle-même, que les gens acceptent de payer pour la commodité ou la sécurité virtuelles procurées par le pouvoir d’en disposer (abstraction faite du rendement ou des frais de conservation qui lui sont propres » (Keynes, [1942] 2017, p. 301). On peut regretter l’omission de ce terme voulue par Keynes.
56 Chapitre 16, « Observations diverses sur la nature du capital ».
57 La définition exacte dans le texte (p. 176) est : k « indique que, lorsqu’un accroissement de l’investissement global se produit, le revenu augmente d’un montant égal à k fois l’accroissement de l’investissement ».
58 Dans le texte p. 176-177 de l’édition 2017 de la Théorie générale, le traducteur emploie l’expression « industries d’investissement » au lieu d’« industries produisant les biens de capital », traduction littérale du terme « investment industries » utilisé par Keynes dans ce passage à la fin de la section i du chapitre 10, « The marginal propensity to consume and the multiplier ». Le traducteur aurait donc pu faire le choix d’« industries d’investissement » dans le lexique de l’édition Payot 1942, mais il a dû considérer à la fin des années 1930 que le mot français « investissement » était encore trop nouveau. Cette correction n’a pas été faite cependant dans le lexique de la Théorie générale révisée par Largentaye (Petite bibliothèque Payot, 1969) ni dans celui de la dernière édition Payot (2017).
59 « [T]he aggregate supply price of the output of a given amount of employment is the expectation of proceeds which will just make it worth the while of the entrepreneurs to give that employment » (Keynes, [1936] 2007, p. 24).
60 Le mot « attendu » au lieu d’« espéré » aurait été plus logique car il a été utilisé dans la définition précédente.
61 Ligne 18 : « Ainsi le prix d’offre de longue période est égal à la somme des divers composants que l’on peut y distinguer, à savoir : le coût premier, le coût supplémentaire, le coût du risque et le coût d’intérêt », cf. « Appendice sur le Coût d’usage » du chapitre 6, « La définition du revenu, de l’épargne et de l’investissement » (Keynes, 2017, p. 122). Dans la version du lexique du 28 mars 1939 que Keynes avait annotée, la définition du traducteur était simplement « la somme du coût premier, du coût supplémentaire, du coût-risque et du coût-intérêt ». Dans la dernière version du lexique publiée en 1942, Largentaye n’a donc pas repris mot à mot la définition de Keynes du prix d’offre de longue période.
62 On constate que l’usage est maintenant d’insérer un tiret entre les deux mots ce qui n’est pas l’orthographe que le traducteur a employé pour exprimer ce nouveau concept.
63 Le traducteur a introduit cette définition de Keynes dans la dernière version du lexique publiée en 1942.
64 Idem.
65 Tenant compte de la remarque de Keynes, le traducteur précise que « proceeds » dans ce contexte est exprimé en argent. Dans la version du lexique du 28 mars 1939, le traducteur avait ajouté la phrase suivante : « Le “produit” (proceeds) qui est identique à la demande effective, est la variable qui gouverne l’emploi ». Il aurait été souhaitable à notre avis de garder cette phrase dans le lexique car elle constitue un élément central du raisonnement keynésien.
66 Le texte exact p. 176 est : « Nous proposons donc dCs/dYS comme définition de la propension marginale à consommer ».
67 Dans l’édition Payot 2017 de la Théorie générale, la lettre majuscule Y pour symboliser le revenu a été utilisée conformément au souhait de Keynes.
68 Dans la version du lexique du 28 mars 1939, le traducteur écrit « Le taux des échanges ». Largentaye a utilisé « termes de l’échange » pour traduire « terms of trade » lorsqu’il a procédé à la révision intégrale de sa traduction en 1968 et a repris cette expression dans le lexique.
69 Soit chapitre 4, « Le choix des unités », section III (Keynes, 2017, p. 92).
70 Dans la version du lexique qui précède celle du 28 mars 1939, on trouve une définition différente qui s’énonce comme suit : « La vitesse de transformation de la monnaie en revenu mesure la proportion de son revenu que le public désire conserver liquide ». Cette définition est très proche de celle que l’on trouve au début du chapitre 15, « Les motifs psychologiques et commerciaux de la liquidité » (Keynes, 2017, p. 266) : « la vitesse de transformation de la monnaie en revenu mesure simplement la proportion de ses revenus que le public désire conserver sous la forme liquide ».
71 Remarquons que Keynes écrit dans le chapitre 21, « Théorie des prix » au troisième paragraphe de la section iv : « Mais la “vitesse de transformation de la monnaie en revenu” n’est en soi qu’une expression qui n’explique rien. Il n’y a aucune raison de la croire constante ; l’analyse précédente prouve qu’elle dépend d’un grand nombre de facteurs complexes et variables. L’emploi qui en a été fait obscurcit, à notre avis, la nature réelle de l’enchaînement causal et n’a été qu’une source de confusion » (Keynes, 2017, p. 386).
72 Livre publié en 1937 par l’économiste autrichien Gottfried Haberler (1900-1995), proche de Hayek et de Mises. Dans ce livre, Haberler critique The General Theory de Keynes publiée l’année précédente, dans la mesure où, par principe, il est opposé à l’intervention de l’État, censée perturber le fonctionnement des marchés et provoquer des crises.