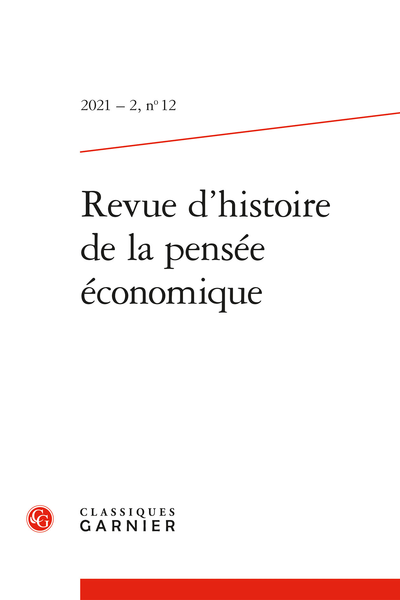
Reviews Essays
- Publication type: Journal article
- Journal: Revue d’histoire de la pensée économique
2021 – 2, n° 12. varia - Authors: Servet (Jean-Michel), Coste (Clément)
- Pages: 301 to 353
- Journal: Journal of the History of Economic Thought
- CLIL theme: 3340 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Histoire économique
- EAN: 9782406126157
- ISBN: 978-2-406-12615-7
- ISSN: 2495-8670
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-12615-7.p.0301
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 12-08-2021
- Periodicity: Biannual
- Language: French
Capital et idéologie de Thomas Piketty : un retour aux classiques en temps de crépuscule de la science économique ?
Note de lecture sur l’ouvrage de Thomas Piketty,
Capital et idéologie, Paris, Éditions du Seuil, 2019, 1232 pages.
Jean-Michel Servet
IHÉID Genève
Parmi les dix-sept ouvrages écrits ou co-écrits par Thomas Piketty, qui se présente comme « chercheur en sciences sociales » plutôt que comme « économiste », trois sont les plus connus et peuvent être lus comme formant une trilogie : Les hauts revenus en France au xxe siècle (2001), Le capital au xxie siècle (2013) et Capital et idéologie (2019). Depuis l’édition en 1994 de sa thèse Introduction à la théorie de la redistribution des richesses (soutenue en 1993 à l’ÉHESS) et d’une version résumée dans la collection Repères à La Découverte sous le titre L’économie des inégalités (livre qui a donné lieu depuis sa publication en 1997 à sept éditions en moins de deux décennies), ces travaux sont essentiellement consacrés à la question des inégalités entre revenus et surtout entre patrimoines, principalement à échelons intra-nationaux. Une problématique pendant plusieurs décennies largement absente de la science économique ; celle-ci ayant surtout développé une approche en termes de croissance pour « lutter contre la pauvreté » et non une relation entre richesse et pauvreté, qui suppose en particulier de reconnaître des déterminations non économiques liées aux discriminations1. Les hauts 302revenus en France au xxe siècle traitait essentiellement de la France au siècle passé. Le capital au xxie siècle était ouvert à l’international. Il couvrait surtout le monde dit « occidental ». Capital et idéologie, le plus récent, occupe aujourd’hui avec le précédent une large place dans les débats au sein des sciences sociales et au-delà dans la presse écrite et audiovisuelle ainsi que dans des blogs.
Thomas Piketty offre une vision mondiale et traite de l’histoire des inégalités de revenu et de patrimoine sur une longue période en remontant jusqu’aux sociétés antiques. Dans ce parcours, il intègre l’héritage colonial européen et postcolonial en Afrique, en Asie mais aussi en Amérique latine ainsi que les expériences dites « communistes » en Europe et en Asie. Alors que dans ses précédentes publications il s’appuyait surtout sur des traitements statistiques menés personnellement et en collaboration avec de très nombreux chercheurs à travers la planète, en leur donnant une large audience, il fait ici davantage référence à des lectures autres2. On peut remarquer que celles-ci viennent surtout illustrer ses thèses et qu’il consacre peu de pages à ferrailler théoriquement ou factuellement avec des auteurs avec lesquels il serait en désaccord total ou même partiel. D’où le désappointement des lecteurs, qui attirés par le mot « capital », penseraient à tort trouver une discussion approfondie et novatrice des thèses de Marx3.
303Le livre frappe par la masse des informations réunies qui dressent un panorama saisissant de l’histoire humaine à partir du spectre des inégalités dans la répartition des moyens de production, d’échange et de financement et des revenus qui en sont tirés. Au centre de cette nouvelle publication se trouve la double problématique de la répartition du capital et de l’idéologie. Le sens donné à « capital » n’est pas explicité autrement qu’implicitement comme désignant un avoir, des possessions matérielles et financières (p. 17) quel que soit l’usage qui en est fait, cela conformément à son précédent ouvrage. Par contre, l’idéologie est définie dès le début de l’ouvrage (p. 16) comme : « un ensemble d’idées et de discours visant à décrire comment devrait se structurer la société », autrement dit un système de justification soutenant un ordre social et politique (sans que l’emprunt à tel ou tel auteur ou courant de pensée ne soit spécifiée). Si cette compréhension comme logique des idées est admise, le différent peut porter sur la position occupée par cette vision du monde par rapport aux institutions et structures techniques, économiques, sociales et politiques composant le Tout que la société constitue. L’idéologie n’y apparaît pas en surplomb mais comme déterminant essentiel non seulement du fonctionnement des sociétés mais aussi de leur évolution.
Dans les deux premières parties du livre, sont présentées d’abord les sociétés à statut et rang, saisies par lui comme « trifonctionnelles » (ce qui pour certaines d’entre elles peut être discuté), parce que structurées idéologiquement entre des élites cléricales et religieuses d’une part et guerrières et militaires d’autre part soumettant les travailleurs producteurs ; puis leur transformation en des sociétés dites « de propriétaires » soumises au marché et où l’ordre est maintenu grâce à un État centralisé ; enfin est expliqué comment l’organisation économique, sociale et politique des autres parties du monde a été affectée par la colonisation européenne. Est étudiée dans les troisième et quatrième parties la manière dont, au cours du xxe siècle, la structure des inégalités a été radicalement transformée et comment les sociétés communistes et les sociétés social-démocrates ont échoué en matière de lutte contre les inégalités. Ce faisant, il interroge les au-delà possibles, notamment du fait de la montée des populismes et de la capacité d’un socialisme démocratique dont il se réclame d’y faire face.
La profusion de détails, qui font la richesse du livre et que ses plus de 1200 pages ont permise, amène ici ou là l’auteur à rappeler les mêmes 304exemples et arguments. On ne peut que regretter l’absence d’index thématique, géographique et des auteurs et personnages cités. Leur présence aurait sans doute évité ces répétitions. Ils auraient aussi facilité la rédaction d’un compte rendu car leur absence oblige à rechercher plusieurs fois certains passages sans jamais être certain d’avoir localisé le bon endroit d’un éventuel argument et référence… possiblement oubliés au fil des lectures et relectures qu’exige l’exercice. Quoiqu’il en soit la dimension même du livre rend impossible un résumé en quelques pages4 rendant compte de toutes les questions posées et de la diversité des exemples abordés5.
QUELQUES OUBLIÉS DE CETTE HISTOIRE
Une volonté d’une sorte de positivité ou de sympathie dans les citations explique sans doute la raison pour laquelle, en dépit du thème traité, Thomas More et autres utopistes, Gracchus Babeuf et les héritiers de la conjuration des égaux, Pierre Leroux, Robert Owen, Pierre-Joseph Proudhon et les coopérativistes, Flora Tristan, Friedrich Engels, Mikhaïl 305Bakounine, Rosa Luxemburg, Karl Kautsky, Vladimir Ilitch Lénine (en dehors de ses écrits sur l’impérialisme), Mao Tsé Toung, Frantz Fanon ou Fidel Castro, autant de figures emblématiques pour la pensée d’extrême gauche mais aussi de gauche des années 1960 et 1970, qui ne trouvent pas place dans son analyse (y compris quand il traite des fondements des sociétés dites « communistes ») alors qu’une grande partie de leurs écrits dénoncent les inégalités entre patrimoines et revenus et qu’ils proposent de résoudre « la question sociale » à travers une redistribution mais aussi une réorganisation plus moins radicale de l’ordre social. Parmi les auteurs qui ont poursuivi les références précédemment citées et dont certains éléments de ces analyses sont toujours d’actualité on peut penser à Samir Amin, André Gunder Frank, Paul A. Baran ou à Paul Sweezy. Tous ces auteurs constituent la base intellectuelle d’une idéologie anti-inégalités. Karl Marx ne se contente pas de décrire les inégalités et les systèmes qui les justifient. Il esquisse à plusieurs reprises dans son ouvrage, comme les auteurs que je viens de citer et comme Piketty à la fin de son ouvrage, ce qui est conçu comme solutions.
Le titre même du livre comprenant « idéologie » aurait pu également laisser penser qu’on retrouverait ces auteurs, ne serait-ce que comme des repoussoirs ; mais pas nécessairement comme tels tant la distance est grande entre les projets annoncés, qui peuvent séduire, et l’application dans un socialisme dit « réel » transformé pour certains en des régimes d’oppression. Il aurait été impensable il y a un demi-siècle que l’on ne rencontre pas sous un titre comme Capital et idéologie quelques-uns des acteurs et auteurs que j’ai cités, y compris dans des écrits antirévolutionnaires et antimarxistes. On peut ainsi s’étonner de l’absence d’une discussion des thèses de W. W. Rostow, dont le champ historique et géographique couvert par ses Étapes de la croissance économique (première édition américaine en 1960) est largement analogue à celui de Piketty et dont l’objet central est de justifier l’efficacité des inégalités économiques pour accroître le surplus dans des sociétés de marché. Son sous-titre, non traduit dans la traduction française (1962), aurait pu séduire Piketty : A non communist manifesto. Depuis les années 1970, les figures historiques de l’anarchisme et du socialisme (Karl Marx compris dont la connaissance par les économistes est devenue aujourd’hui généralement superficielle) ont très largement disparu des débats ; et par conséquent des écrits de la génération de Thomas Piketty. On peut 306d’ailleurs y voir une sorte de paradoxe. Des discours comme ceux sur l’accroissement du taux d’exploitation des salariés par le capital ou sur la baisse tendancielle du taux de profit devant provoquer l’effondrement du capitalisme étaient encore omniprésents dans les années 1960 alors qu’ils auraient pu paraître obsolètes (à la différence de ceux du jeune Marx sur l’aliénation alors qu’on s’y référait beaucoup moins). Mais, les crises successives du « capitalisme » qui auraient pu redorer le blason du marxisme ne l’ont pas (encore) fait renaître en tant qu’instrument critique. Par un raccourci historique on pourrait comparer ce flux et ce reflux des idées à la manière dont la pensée des pères de l’Église avait largement fait oublier celle d’Aristote avant, avec la réapparition d’un débat politique dans les cités et royaumes, qu’elle ne devienne hégémonique en Occident pendant quasi un demi-millénaire. Dans l’actuel contexte de crises multidimensionnelles, peut-être ne faudra-t-il pas attendre aussi longtemps pour voir resurgir quelques-uns des penseurs précédemment évoqués et, du fait de leur oubli par Piketty, que ses travaux puissent paraitre en partie obsolètes ou biaisés. Mais nous n’en sommes pas encore là et demeureront longtemps sans nul doute son analyse fouillée de statistiques et les interprétations auxquelles cette comptabilité donne lieu6.
Mais, les penseurs socialistes et anarchistes ne sont pas les seuls absents de Capital et idéologie, car il ne s’agit pas d’une histoire de toute l’humanité (même s’il est vrai que 1200 pages n’y auraient pas suffi…). On doit s’interroger sur les raisons qui l’ont amené à passer sous silence les inégalités dans les communautés humaines qui ont précédé les pratiques d’esclavage ou de divisions en castes. Cet oubli n’est pas expliqué alors qu’il porte sur des dizaines de milliers de sociétés et d’années d’histoire humaine7… et que le célèbre Discours sur l’origine et les fonde307ments des inégalités parmi les hommes, publié par Jean-Jacques Rousseau en 1755, aurait pu inciter à en parler pour le conforter ou s’en distancier. On sait aujourd’hui que les communautés de chasseurs collecteurs ne constituent pas l’idéal égalitaire auquel certains ont rêvé et sont des sociétés pouvant connaître de fortes inégalités si l’on tient compte des divisions entre hommes et femmes, classes d’âge, et même pour certaines entre groupes familiaux. Le partage et la réciprocité, dimension essentielle de leur fonctionnement, n’empêchaient pas des inégalités de genre et d’âge, voire entre les groupes familiaux constitutifs. Mais les rapports sociaux n’étant pas soumis dans ces sociétés à une logique d’accumulation matérielle, leurs inégalités ne sont alors généralement pas une inégalité dans la propriété de moyens et objets physiques de production. Elles se situent le plus souvent dans l’immatériel grâce au contrôle par les dominants de forces magiques supposées indispensables à la reproduction de ces communautés8. On peut les considérer comme une forme de capital propre à ces sociétés, pour autant qu’on ne réduise pas celui-ci à une relation d’emploi. Sous des modalités diverses et qui ne sont pas figées, il y apparaît tout aussi indispensable à la production et à l’interdépendance des activités humaines… ou est représentée comme tel par ceux (plus rarement par celles) qui le détiennent et en jouent. Ces interdits frappent également l’accès pour certains des membres de ces communautés à des fractions de leur territoire, comme lieux sacrés, cela ayant des conséquences y compris dans l’accès à certaines ressources. Mais dans beaucoup de ces sociétés, les membres qui détiennent le plus de pouvoir n’en tirent pas d’avantages matériels9 et peuvent même être ceux qui ont les consommations les plus frugales. Le pouvoir ne se confond pas systématiquement avec l’avoir. Dit autrement le pouvoir d’achat n’est pas en tout lieu et en tout temps équivalent à un pouvoir de commandement. Comme certains auteurs, à la suite de Pierre Clastres, ont parlé de « sociétés contre l’État », on pourrait les voir 308comme des « sociétés contre le capital ». Pour autant que l’on rompe avec une vision évolutionniste ou néo-évolutionniste, ces sociétés peuvent nous révéler une part de nous-mêmes et même des transformations à venir du vivre ensemble, parce qu’elles participent aussi de la grande aventure plurimillénaire des sociétés humaines10. Thomas Piketty en élargissant géographiquement le champ de son étude affirme vouloir sortir d’un « occidentalo-centrisme » (p. 28). Loin de servir à éviter des robinsonnades (dénoncées à juste titre par Marx), l’oubli de formes de possession et d’inégalités très différentes des nôtres (pour certaines liées au genre et aux groupes d’âge et que nos sociétés connaissent encore11), fait que l’auteur de Capital et idéologie ne s’est pas totalement affranchi de l’anthropocentrisme dominant la pensée économique (et pas seulement celle-ci).
Pour saisir les évolutions, le progrès et dans certains cas ce qui peut être compris comme des régressions, Thomas Piketty pratique très largement, on l’a relevé, le comparatisme : entre sociétés et entre les époques successives d’une même société. Vu les sources qu’il utilise cela conduit à une réhabilitation forte de l’échelon national, puisque c’est surtout sur cette base que sont établies les comparaisons. Ce faisant cela frustre d’une perspective à échelle proprement continentale et mondiale à la Fernand Braudel ou à la Paul Bairoch. Et surtout, les inégalités régionales au sein d’un ensemble national et les éventuels drainages de ressources périphériques au bénéfice des centres apparaissent sous-estimées. Par exemple en France ce qu’on peut considérer comme le sous-développement des régions occitanes, corses et bretonnes notamment du fait d’équipements publics longtemps concentrés dans la capitale, sans compter le sous-développement culturel qu’a engendré l’élimination des langues régionales. En Europe, la France n’a pas l’exclusivité de telles 309dynamiques inégales de développement avec un sous-développement régional lié à l’essor des États-nations et l’on pourrait dresser le même diagnostic à travers toute la planète, en confrontant par exemple la situation de la Casamance par rapport au Nord du Sénégal, des zones andines en Amérique latine par rapport aux zones côtières ou celle de l’Algérie pour ce qui est des régions berbères. À l’intérieur des ensembles nationaux, le capital et les revenus sont inégalement spatialement répartis entre régions, entre villes et au sein de celles-ci (les disparités locales sont abordées de façon très allusive (par exemple p. 884, p. 1056-1066) ; des idées qu’il aurait pu approfondir en traitant du fédéralisme (voir notamment p. 561-565).
UN RETOUR À L’ÉCONOMIE POLITIQUE DES CLASSIQUES
Le titre du livre incluant « idéologie » pourrait laisser penser, à défaut des auteurs révolutionnaires cités précédemment, que soit mobilisée l’histoire de la pensée économique pour montrer comment ont été légitimités ou critiqués la propriété privée du capital et les revenus qui en sont tirés. De façon éparse, certains anciens penseurs de l’économie apparaissent tels que Condorcet et Paine (p. 148-149), Joseph Caillaux (p. 184), Paul Leroy-Beaulieu (p. 189), Dupont de Nemours (p. 258), Petty, King, Boisguilbert et Vauban (p. 434), Irving Fisher (p. 533-534), Friedrich Hayek (p. 548, p. 564, p. 821-825, p. 973), Charles Dunoyer (p. 826-827) ou John Maynard Keynes (p. 972-973). Mais, son objet d’étude n’est pas traité à travers cette perspective générale et paraissent oubliés des travaux comme ceux de Vilfredo Pareto12 ou de Joseph Aloïs Schumpeter articulant aussi l’économie et la sociologie pour comprendre les inégalités dans la répartition et leurs effets. La science politique et la sociologie politique occupent davantage de place dans l’argumentaire que l’analyse économique.
310En conséquence, alors que son auteur met en avant le poids de l’histoire pour comprendre le fonctionnement des sociétés et qu’il se veut historien ou pour le moins s’appuie sur des sources historiques et travaille sur des archives, Capital et idéologie ne s’inscrit a priori explicitement dans aucun courant de pensée ayant fait l’économie politique puis la science économique. Pour tous les penseurs marxistes et néo-marxistes, son absence de réflexion en termes de valeur est déconcertante alors que, en révélant statistiquement les inégalités de revenu et de patrimoine, il paraît traiter, voire dénoncer, l’exploitation des groupes sociaux par d’autres. Et son discours est tout autant déroutant pour les anti-marxistes, qui se prétendent héritiers des néo-classiques et qui légitiment la répartition en la basant sur la productivité marginale des facteurs de production.
De toute évidence, en dépit de son double objet (l’accumulation du capital et l’idéologie prétendue science par les économistes), Thomas Piketty croit pouvoir réaliser son programme scientifique en faisant l’impasse sur deux siècles et demi de pensée économique et d’auteurs dont un grand nombre, et sous des formes diverses faites de controverses, ont construit une analyse justifiant les inégalités économiques au nom du progrès matériel des sociétés. S’il est possible d’ignorer l’histoire de la pensée économique, il est impossible d’échapper totalement au poids des idées passées, même en se prétendant non pas économiste mais plus généralement chercheur en sciences sociales comme le fait Thomas Piketty. Or, en portant sur Capital et idéologie un regard d’historien de la pensée économique, il est loisible d’y découvrir une continuité avec l’économie des classiques ; sans qu’il s’agisse d’un plein retour à ceux-ci du fait, comme pour la pensée économique contemporaine dominante, d’une absence de théorie de la valeur par suite de raisonnements en termes monétaires. Quels sont ses points communs avec les classiques ?
Comme chez les classiques, la production, le financement, la distribution et la consommation constituent la base matérielle essentielle définissant l’économie. Cette vision s’oppose aux approches formelles des néo-classiques qui traitent d’agents économiques éthérés supports de fonctions économiques donnant lieu à l’exercice de la rationalité des comportements dans l’ajustement des fins aux moyens disponibles. Cette perception de l’économie essentiellement substantive conduit Piketty comme chez les classiques à la reconnaissance de groupes sociaux déterminés par la source principale de leur revenu. Via cette compréhension 311tout à la fois matérialiste et sociale de l’économie, Thomas Piketty renoue avec celle des classiques13, mais de façon implicite parce qu’il ignore l’utilité des armées mortes14.
De même, sa conception de l’évolution des sociétés est proche de celle des classiques en ce qu’elle inclut l’idée de progrès ; celui-ci répondant à la satisfaction de besoins. Il reconnaît l’existence d’un « seuil de subsistance » (voir p. 320) et implicitement il se réfère donc à des besoins à satisfaire sans interroger le mécanisme par lequel ceux-ci se forment ; donc sans reconnaître leur caractère par nature artificiel (voir par exemple p. 690-691). Sa vision utilitaire des besoins les objective et elle ne les saisit pas comme déterminés par la culture induite par le système économique, social et politique. On doit remarquer que, alors que la pensée économique s’autonomisait, tous les premiers économistes n’ont pas succombé à cet économisme. Jean-Joseph-Louis Graslin dans son Essai analytique sur la richesse et sur l’impôt (1767) illustre cette pensée alternative en affirmant par : « on ne peut pas avoir besoin d’un bien dont on ignore l’existence15 ». Il est possible de la rapprocher de la critique similaire d’Étienne Bonnot de Condillac dans son Essai sur l’origine des connaissances (1746) où l’on découvre que : « À un besoin est liée l’idée de la chose pour le soulager16 ». Ce relativisme trouvera place chez un auteur à la frontière de l’économie, de l’histoire et de la sociologie comme Thorstein Veblen dans sa Théorie de la classe de loisir (1899). Mais jusqu’à nos jours, ce relativisme est demeuré exceptionnel. Thomas Piketty partage sans doute l’ethnocentrisme dominant, quasi congénital parmi l’immense majorité des économistes depuis la formation de leur discipline supposée expliquer la production par une lutte des humains contre la rareté ; et donc sans interrogation de type anthropologique sur ce que signifie la 312rareté et sur son immense relativité à travers le temps et l’espace. Or cette diversité des besoins explique aussi que les inégalités, comme on l’a indiqué en tant qu’idée ignorée par Thomas Piketty, ont pu ne pas porter dans les sociétés humaines sur les biens matériels consommés et sur leur propriété car étant notamment immatérielles, honorifiques et liées au pouvoir de commandement ; ce qu’illustrent notamment les potlatchs. Ce que George Bataille avait désigné comme part maudite (1949).
Bien que n’ignorant pas Karl Polanyi, qui a renoué avec une définition substantive de l’économie caractéristique des classiques tout en ne s’appuyant pas sur leurs théories de la valeur, Thomas Piketty ne va pas dans sa référence à La grande transformation au-delà des critiques du marché et du développement de la redistribution et il laisse de côté son apport sur la relativité de la rareté et sur l’organisation de l’économie selon des principes d’intégration, en particulier la réciprocité et le partage domestique (que l’on peut traduire par autosatisfaction). Autre biais d’une génération peu familière de l’anthropologie économique, l’autre ouvrage majeur de Karl Polanyi Trade and Market in Early Empires17 est négligé alors qu’il fournit aussi de nombreuses clefs critiques de l’inégalité et des besoins notamment à travers la lecture qui y est faite d’Aristote.
Autre rapprochement avec les classiques, leur oubli de ce qui y a pu être et est hors de l’État et du marché concurrentiel : les communs. On peut être étonné de constater que lorsque, au chapitre 2 intitulé « Les sociétés d’ordres européennes : Pouvoir et propriété », Thomas Piketty aborde les rapports entre le clergé, la noblesse et le tiers état et qu’il développe ce que chacun des groupes possède, la propriété foncière est comprise essentiellement dans un sens juridique formel. Le rapport social de domination via la terre n’y est pas explicitement traité et les rapports de travail ne sont qu’effleurés au chapitre suivant (chapitre 3 : « L’invention des sociétés de propriétaires ») consacré à la destruction ou transformation des droits anciens après 1789 et à la définition de nouveaux rapports de propriété détruisant la superposition des droits anciens. L’analyse fine qui est menée au chapitre 2 de la répartition de la propriété entre les groupes sociaux dans la France d’Ancien Régime est silencieuse sur les formes tant matérielles qu’idéologiques prises par les relations entre les maîtres de 313la terre et ceux qui l’exploitent notamment dans ce qui sera transformé ensuite en des rapports de fermage et de métayage. Et surtout si Thomas Piketty (p. 135) fait référence à : « la superposition de différents niveaux de droits perpétuels sur une même terre (ou sur un même bien en général) », ces droits (auxquels les enclosures mirent fin) ne sont pas déclinés et ainsi les droits collectifs sur les espaces cultivés et non cultivés sont largement laissés dans l’ombre. Or ils permettaient à la masse des pauvres ruraux de subsister grâce aux droits de vaine pâture, de chasse du petit gibier, de glanage après récolte, ramassage de bois de chauffe, de fruits sauvages, etc. En promouvant la propriété privée (comme l’argumente par ailleurs Piketty), la Révolution de 1789 a formellement éradiqué les anciens droits collectifs ; mais comme l’a montré Eugen Weber18, ils ont largement subsisté au cours de la première moitié du xixe siècle, voire jusqu’au xxe dans certaines régions (ce qui permet de distinguer un rapport juridique formel d’un rapport social effectif donnant lieu à du commun). Piketty signale les droits communautaires paysans à propos des Enclosures Acts britanniques mettant « fin au droit d’usage des paysans pauvres sur les terrains communaux et les pâtures » (p. 215). Il fait état du Black Act de 1723 « qui prévoyait la peine capitale pour les chapardeurs de bois et les chasseurs de petits gibiers, petites gens qui avaient pris l’habitude de s’aventurer la nuit, le visage noirci pour ne pas être reconnu, sur des terres qui n’étaient pas les leurs, et que les propriétaires de la Chambres des lords et leurs alliés aux Communes voulaient pouvoir conserver pour leur usage exclusif » (p. 215). En les assimilant à du vol (point de vue des propriétaires), est sous-estimée fortement la nature des droits collectifs très anciens des paysanneries européennes. Dans une note de bas de page (p. 216) Thomas Piketty indique : « On observe des durcissements similaires du droit de propriété ailleurs en Europe, par exemple en Prusse en 1821, ce qui marqua le jeune Karl Marx. Une scène de chapardeurs de bois violentés par une milice propriétariste ouvre d’ailleurs le film Le Jeune Karl Marx réalisé par Raoul Peck en 2017 ». On est étonné que Thomas Piketty ne fasse pas à ce propos référence au premier écrit à caractère économique de Karl Marx19 consacré à la revendication des communautés 314paysannes de la vallée du Rhin de conserver leurs droits ancestraux de ramassage du bois mort, des droits contestés devant un tribunal par les propriétaires des forêts. C’est un des exemples de ces droits collectifs dont jouissaient localement les paysans et qui ont permis pendant des siècles à des non propriétaires de survivre et de gérer en commun.
Une remarque analogue peut être faite avec une autre négligence des classiques (ou plutôt leur incompréhension) : celle des corporations d’Ancien Régime. Pendant des siècles, avant leur étatisation de plus en plus forte au cours du xviiie siècle et leur fermeture par la domination des maîtres héritant, elles ont fonctionné sur la base de principes d’autosatisfaction et de réciprocité pour ce qui est de leurs approvisionnements en main d’œuvre et en matières à transformer ainsi que pour leurs débouchés ; une autre forme de marché et de gestion par des communautés d’éléments communs opposés donc, au sens strict, à la propriété privée du capital. Au-delà des corporations elles-mêmes, l’ensemble des mécanismes de solidarité et de charité qui permettaient à de larges fractions de la population de survivre et constituaient des mécanismes efficaces de redistribution sont largement ignorés tout autant par Piketty que par les classiques.
Enfin un autre rapprochement que l’on peut établir entre les économistes classiques et l’idéologie de Thomas Piketty, qui rappelons-le ignore les classiques de la pensée économique (et pas seulement Marx), est le peu d’importance accordée aux conflits et aux contradictions et à leur dynamique. Par exemple celles qui naitraient d’une inadéquation entre les systèmes productifs, les techniques existantes20, dont les sources 315d’énergie, autre facteur considérable aussi d’inégalités. Ce qui pose la question des moteurs de l’histoire.
QUELS SONT LES MOTEURS DE L’HISTOIRE ?
Un élément frappant dans Capital et idéologie est le peu d’importance accordée aux moteurs matériels et sociaux des transformations que son auteur constate ; autrement dit à ce qui fait qu’une organisation économique se mue en une autre ou qu’une nouvelle domine une ancienne et que la situation d’un groupe s’améliore (ou se détériore). On lit p. 320 : « Il ne faut pas exagérer l’importance des déterminants “matériels” de l’inégalité. Dans la réalité historique, c’est avant tout la capacité idéologique, politique et institutionnelle à justifier et à structurer l’inégalité qui détermine le niveau de cette dernière, et non pas le degré de richesse ou de développement en tant que tel ». Au début du livre (p. 92) on avait eu un avant-goût de cette approche donnant un primat aux « idéologies » en lisant à propos des évolutions propres à la féodalité :
Une reconnaissance plus forte de la personnalité juridique des laboureurs, de leurs droits civils et personnels comme de leurs droits de propriété et de mobilité se met progressivement en place entre 1000 et 1350, au fur et à mesure que les discours célébrant les trois ordres se généralisent.
Doit-on en conclure que la noblesse et les gens d’Église ont été touchés par la grâce de la reconnaissance du troisième pilier de la société (les travailleurs qui assuraient leur subsistance matérielle) et qu’ainsi le sort de ceux-ci a pu s’améliorer ? N’est-ce pas occulter les luttes au quotidien des paysanneries asservies, que l’économiste Pierre Dockès avait si bien mises en avant dans La libération médiévale (Paris, Flammarion, 1979)21 comme moteur des transformations de rapports de production ? Très loin de cette lecture mettant en avant les conflits entre des dominants 316et des dominés, à travers lesquels ces derniers parviennent à améliorer progressivement leur sort, Thomas Piketty évoque (p. 93) le développement de fructueuses coopérations productives […] rendues possibles par des alliances nouvelles entre les différentes classes de la société ternaire », ainsi que « les laboureurs (véritables artisans silencieux de cette révolution laborieuse) » ou encore le :
[P]rocessus vertueux qui aurait permis au-delà des crises, un accroissement considérable de la production agricole et de la population ouest-européennes entre 1000 et 1500, progression qui a laissé une trace profonde dans les paysages […] et qui a été de pair avec la fin graduelle du travail servile.
Par contre, et fort heureusement, à propos de la fin de l’esclavage dans les colonies européennes des Caraïbes et des soulèvements en Chine au xixe siècle (p. 467-471), Piketty apparaît mieux inspiré en faisant explicitement référence « au rôle de la violence dans l’histoire », pour reprendre l’expression d’Engels (1887-1888) qu’il n’utilise toutefois pas. Il désigne l’abolition consécutive de l’esclavage sous la Révolution comme résultant des « révoltes organisées par les esclaves eux-mêmes, et la peur de nouvelles révoltes » (p. 259) et l’indépendance d’Haïti « d’une révolte d’esclaves victorieuse » (p. 263) qui joue un « rôle crucial ». Pourquoi ce qui a été le cas des temps modernes et du xxe en Suède ou en Allemagne (p. 579-581, p. 586) ne l’aurait-il pas été, consécutif à des luttes politiques et économiques, du Moyen-Âge ; et ce bien plus souvent que la lecture de Capital et idéologie ne le laisse penser22 ? Voire ne pourrait-il pas l’être demain dans certaines parties du monde, pour autant que l’on pense que nous ne sommes pas soumis à une « fin de l’histoire23 » ?
Si l’on pense à des causes écologiques déterminant dans les cas favorables une augmentation et défavorables une diminution du surplus produit avec leurs conséquences sur son partage, ce moteur de l’histoire 317n’apparaît pas non plus dans le livre. On pense par exemple aux vagues de froid provoquant une diminution considérable des récoltes à la suite à diverses reprises d’explosion de volcans en Islande ou en Indonésie avec des contrecoups éloignés sur les productions agricoles en Europe, provoquant famines et révoltes) ; ou aux effets directs locaux comme l’épuisement des sols ou les sécheresses (à l’origine de la quasi disparition de l’empire Maya). Comment ne pas penser dans ses vecteurs de grande transformation des sociétés aux épidémies submergeant les continents et ayant pour nom « grande peste », « cholera » et « grippe espagnole que Pierre Dockès a rapprochées de l’actuelle “Covid-19” » dans L’économie des grandes épidémies (2021) ? On pourrait donc souhaiter voir introduire l’environnement y compris dans ses conséquences pour les différences entre modes de consommation des diverses catégories de population, à échelons nationaux et mondial (en termes d’empreintes écologiques inégales notamment). Dans Capital et idéologie, le moteur n’y est pas non plus technique au sens de ce qui a pu être dit des moulins qui auraient donné la société féodale comme les machines à vapeur qui auraient engendré la société salariale, non pas pour simplement inverser le déterminisme mais pour s’interroger sur l’appropriation des techniques et les rapports de domination qu’elles introduisent.
Selon Thomas Piketty, le principal moteur de l’histoire, et ce qu’il lit comme une émancipation, se situe dans un autre champ, celui des idéologies, selon le degré de liberté qu’elles apporteraient progressivement aux individus. Il analyse surtout comment se forme et se déconstruit le système de justification des ordres sociaux. Soit de façon interne (comme dans le cas européen) ; soit de façon externe avec la colonisation. Mais s’il saisit bien les effets des idéologies, n’est pas analysé le processus de leur construction. Ou plutôt d’élection d’une idéologie plutôt qu’une autre ; se traduisant par tel ou tel choix politique (qui paraît pour lui résumer fortement l’idéologie) alors que dans certaines sociétés ce choix pourrait être religieux (voir par exemple les conflits catholiques/protestants jadis en Europe et aujourd’hui en Amérique latine ou entre les différentes fractions de l’Islam au Proche-Orient, qui renvoient aussi à des conflits… entre classes sociales). Ce qui pourrait aussi rendre nécessaire de faire référence à des éléments de détermination matérielle de ces rapports sociaux (en fonction du type d’activité, lieu de travail par rapport à un lieu d’habitation par exemple) et des façons de les penser.
318INÉGALITÉ ÉCONOMIQUE ET EXPLOITATION
Thomas Piketty met l’accent sur les inégalités économiques, et en particulier sur leur mesure et sur les mécanismes de leur justification, qui correspond à l’idéologie. Mais très peu de choses sont dites sur les mécanismes produisant une exploitation qui se traduit par un drainage des ressources au bénéfice de catégories de la population au détriment d’autres. On en apprend beaucoup sur la répartition d’un surplus produit par les sociétés et le degré de consentement à la domination et aux inégalités mais bien peu sur les mécanismes de l’extraction ou de la formation d’un excédent qui serait approprié par une catégorie de la population au détriment d’une autre. Le tableau est celui de sociétés disposant d’un surplus partagé entre différents groupes sociaux selon la règle évidente que ce qui va aux uns ne va pas aux autres ; l’affectation de la ressource pouvant selon les sociétés être une répartition essentiellement primaire ou faire aussi l’objet d’une redistribution secondaire (essentiellement par intervention publique). L’une et l’autre font l’objet d’un consentement ou de relations plus ou moins fortement conflictuelles. Les résistances des dominés à leur domination peuvent nuire à la « croissance » ; mais une répartition apparaissant plus juste peut aussi profiter à l’ensemble de la société ; ce qu’ont montré « les trente glorieuses » et a contrario « les trente piteuses », selon l’expression de Nicolas Baverez, qui les ont suivies. Le consentement des dominés, les premiers de corvée, à leur domination par les « premiers de cordée » peut favoriser l’accroissement du surplus produit. On voit les inégalités dans la répartition mais il est difficile d’observer aujourd’hui les mécanismes d’une exploitation massive et systématique de pauvres par des riches, si ce n’est dans des zones périphériques de la production matérielle par des salariés. Pourtant Piketty nous montre avec raison des inégalités économiques massives. Même si une idéologie peut les légitimer, on peut à l’encontre de Thomas Piketty, ne pas accepter d’en faire la cause ; et dans ce cas reste à expliquer par quel processus elles se réalisent.
On connaît la théorie marxiste de l’exploitation basée sur l’opposition entre le « travail vivant » et le « travail mort » accumulé dans le capital qui ne fait que transmettre sa valeur. Le premier est producteur de 319valeur tout en n’étant rémunéré qu’à son coût de reproduction et non pour la valeur qu’il produit ; la différence étant légalement appropriée par les capitalistes détenteurs des moyens de production et employeurs. La théorie proudhonienne de l’exploitation est beaucoup moins connue. Elle est celle d’une appropriation par les capitalistes du surplus créé par une activité collective par rapport à ce que serait une activité individuelle24 (chacun peut ici se souvenir de ce que dit Adam Smith de la conséquence de la concentration des travailleurs dans des manufactures, avec en particulier l’exemple d’une d’entre elles fabriquant des épingles). Les employeurs détenteurs des moyens de production sont en position d’accaparer ce surplus. Marx comme Proudhon donnent ainsi de l’exploitation une vision partant fondamentalement de la production.
Cette question des sources et mécanismes de l’exploitation, que l’on peut penser comme étant essentielle pour caractériser la construction spécifique des différents ordres économiques et sociaux est largement et de manière étonnante éludée dans Capital et idéologie. Pourquoi ? Sans doute son auteur rejette-t-il tout autant une analyse en termes d’exploitation des forces de travail par le capital25 que la réponse prétendue scientifique des néoclassiques la justifiant par la rémunération des facteurs de production à leur productivité marginale. Mais Piketty ne propose pas une théorie alternative à ces schémas, qui expliquerait les déterminants de ce qui peut apparaître comme rapport social fondamental. Un surplus est produit et fait l’objet d’un partage y compris à la suite des prélèvements fiscaux et de redistributions selon des règles qui paraissent surtout résulter d’un rapport de forces politiques (s’imposant idéologiquement). Cela explique sans doute le silence relevé de Thomas Piketty, sur une explication en termes d’exploitation (du type de celle de Marx et ou de Proudhon). Vu les pages qu’il consacre à l’accumulation par la finance, on comprend qu’il lui paraisse difficile d’attribuer la plus grande part de l’actuelle accumulation capitaliste à ce qui serait 320directement une exploitation du facteur travail dont le produit serait en quelque sorte transféré du secteur productif vers le secteur financier ; qui lui-même en transformant ce surplus permettrait à la nouvelle classe des propriétaires d’en bénéficier.
Mais une analyse du processus de formation du surplus dans l’interdépendance hiérarchisée des activités des différents groupes sociaux n’est pas plus faite pour les sociétés anciennes qu’elle ne l’est pour les actuelles. Thomas Piketty constate les inégalités dans la propriété du capital et les revenus. Mais il passe à côté de la mutation des sociétés dites « capitalistes avancées » depuis la fin du xxe siècle. Il ne donne à voir que les effets d’un système : la répartition des survaleurs entre la finance et ses acolytes techniques (services internes mais aussi externes, notamment en matière juridique, comptable, informatique et publicitaire), qui sont bénéficiaires eux aussi de l’activité du système financier. Mais le mécanisme même de formation des survaleurs financières n’est pas décortiqué. Dans un contexte d’hyper-financiarisation (mode privilégié de l’interdépendance des activités) et de surliquidités produites dans une économie d’endettement privé et public, les survaleurs sont principalement produites par une montée des cours des actifs. Le capital fonctionne là comme un rapport social de type nouveau. Le surplus est de plus en plus accessoirement formé par exploitation d’une main d’œuvre par une fraction de la société, les propriétaires ; comme c’était le cas dans les sociétés anciennes (par l’esclavage, le servage ou le salariat). Cette exploitation pèse d’un poids de plus en plus faible dans l’ensemble du système et dans sa reproduction ; une « grande déconnexion26 ». Ce qui ne veut pas dire qu’elle ait disparu si l’on pense à la production du textile ou du matériel informatique en Asie ou à des productions agricoles en Amérique latine ou en Afrique. Mais désormais la part la plus importante de la survaleur est produite au cœur même de la sphère financière ; avec toutes les conséquences qui, elles, sont bien décrites dans Capital et idéologie en matière d’inégalités entre les différents types de revenus et de patrimoines.
321DES SOLUTIONS POUR RÉDUIRE
LES INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES ?
Si l’on accepte une approche en termes d’extraction d’un surplus à travers une hyper-financiarisation, tout projet politique, par exemple celui proposé par Thomas Piketty d’une redistribution périodique du capital ou d’une augmentation de la pression fiscale au bénéfice des plus pauvres, projet qui ne s’attaque par radicalement à la formation de survaleurs, est incapable d’éradiquer les inégalités économiques ; voire même il ne peut pas les réduire fortement (pour ne pas parler des inégalités nées des discriminations). Les rapports de domination demeurant inchangés, les mêmes causes produisant les mêmes effets, ces inégalités peuvent au mieux s’atténuer mais elles ne peuvent que se reproduire structurellement.
Parmi les multiples solutions proposées pour remédier aux inégalités qui pourraient même à terme remettre en cause l’acceptation de l’organisation capitaliste des sociétés que l’on disait naguère « avancées », Piketty retient principalement deux solutions touchant à l’inégalité dans la répartition de la propriété :
–une voie que l’on peut dire réaliste qui pourrait aller dans le sens d’une interrogation sur le rapport social de production,
–et une autre qu’il est possible de qualifier d’utopiste.
Remarquons qu’il ne discute pas des alternatives telles que le socialisme de guilde dont un des défenseurs en dehors du Royaume-Uni a été Karl Polanyi27 ou de l’autogestion. Un des exemples d’application en a été la Yougoslavie après sa rupture d’avec l’Union soviétique et elle a été un champ d’inspiration pour le Parti socialiste unifié de Michel Rocard et après Mai 1968 en France dans près de 250 usines occupées ; l’expérience des Lip est la plus connue28 à travers notamment 322la figure du syndicaliste Charles Piaget. L’idée de coopératives est très rapidement évacuée (voir p. 691, 725). Autre effet de génération sans nul doute auquel s’ajoute le peu d’intérêt que Thomas Piketty porte, à la différence d’autres contemporains, aux expériences décentralisées se présentant comme des alternatives aux inégalités capitalistes et dont le xixe siècle a donné tant d’exemples en Europe et en Amérique du Nord.
– La voie réaliste, réaliste au sens où certains pays la pratiquent déjà, est la proposition que les conseils d’administration des sociétés de capitaux ne soient plus constitués uniquement de représentants des actionnaires mais aussi des salariés. Notons que la solution des premières années de l’URSS n’avait pas été seulement celle d’une présence de représentants des salariés dans les conseils d’administration des entreprises mais de la double direction des entreprises publiques, par un représentant de l’État et un représentant élu des travailleurs, une pratique très rapidement abandonnée29.
– La voie, qui apparaîtra à beaucoup utopiste, est la proposition d’une dotation en capital de chaque jeune arrivant à 25 ans (p. 1129). C’est une sorte de réforme agraire (celle qui redistribuait la propriété des terres) ou de jubilé des dettes30 mais qui bénéficierait à tous/toutes et qui serait permanente et porterait sur l’ensemble de la propriété. Cette distribution abondée par un prélèvement sur les héritages reviendrait par conséquent à réduire le montant de ces derniers et à permettre à tout membre d’une nation, y compris s’il ou elle est issue d’une famille comme l’on disait naguère « prolétaire » de démarrer dans la vie avec un capital minimum égal pour tous. Elle avait déjà été formulée dans les assemblées révolutionnaires françaises de la fin du xviiie siècle en même temps que fut décidée la suppression du droit d’aînesse. Les saint-simoniens défendirent l’idée d’une abolition de l’héritage, considéré par eux comme source de parasitisme et d’oisiveté31. Elle paraît aujourd’hui utopique, même si elle ne l’est pas plus qu’un revenu universel d’existence 323ou de citoyenneté ; car on peut facilement imaginer les résistances à cette solution « partageuse » comme on l’a qualifiée au xviiie ou xixe siècle. Est-ce par réalisme qu’il ne lui donne pas aussi une dimension internationale, qui serait tout autant légitime, vu ce qu’il dit des effets de la traite négrière ou de l’indemnité versée pendant plus d’un siècle par Haïti à la France ?
Cette proposition de partage du capital peut être rapprochée du diagnostic de trois acteurs du microcrédit ayant eu aussi une formation d’économiste et ayant bénéficié d’une notoriété similaire à celle de Piketty : Muhammad Yunus ancien dirigeant de la Grameen Bank du Bangladesh, Maria Nowak fondatrice de l’Adie en France et Jacques Attali de PlaNet Finance. Leur discours est analogue. Ce qui manquerait essentiellement aux plus pauvres serait un capital pour entreprendre. Le microcrédit devrait le leur offrir. Là où ceux-ci proposent l’endettement, Piketty suggère un don de capital. Un point commun entre une redistribution partielle du capital à chaque génération et le microcrédit, tel que très largement promu des années 1970 à 2000 (par rapport à ce qui peuvent être des versions coopérativistes) est de se faire sur une base individuelle. L‘objectif n’est pas la promotion d’une action collective dans la production (le collectif pouvant se trouver pour le microcrédit dans la solidarité /caution dans le remboursement). Comme chez Piketty avec la redistribution de l’héritage, on se situe dans l’ordre de la répartition et non dans la reconfiguration de l’organisation de la production alors que la suggestion de faire siéger des représentants des salariés dans les conseils d’administration et pouvant conduire, si ce n’est à une autogestion, à une cogestion, peut l’affecter. Même si l’exemple allemand montre que ce n’est pas le cas du fait « de la concurrence internationale » entre firmes amenant à l’acceptation des propositions de la direction dominée par les propriétaires et des limites fixées au droit des travailleurs par rapport à celui du capital. D’ailleurs, compte tenu des usages qui seraient majoritairement faits des fonds reçus, la redistribution à chaque génération d’une partie de la propriété du capital, suggérée par Thomas Piketty, a peu de chances d’aboutir à une modification des rapports sociaux de production parce qu’une redistribution ne change en rien les rapports de domination et l’organisation de la production par des salariés ; pas 324plus que ne l’ont fait les taux de prélèvement très élevés sur les revenus après la seconde guerre mondiale.
Pour conclure, remarquons que l’intérêt porté aux travaux de Thomas Piketty sur les inégalités de patrimoine et de revenu dépasse très largement la sphère des économistes et que ceux-ci résonnent désormais dans l’ensemble des sciences sociales et de la philosophie. Alors que les écrits des économistes sont apparus de plus en plus abscons à la très grande majorité des non-économistes, un économiste est à nouveau lu par des non-économistes. Dans une période où l’on peut s’interroger sur la fin de la science économique32, cet ouvrage lui apporte une bouffée d’oxygène. Car si Thomas Piketty se définit comme « chercheur en sciences sociales », et l’est par les sources principalement historiques et politiques qu’il mobilise, son analyse demeure essentiellement celle d’un économiste. Son idéologie, qui n’est ni celle des néo-classiques ni celle de Keynes, apparaît fondamentalement analogue à celle d’un Turgot, d’un Say ou d’un Ricardo. Mais les publications de Thomas Piketty suffiront-elles pour faire survivre la science économique et mieux encore à favoriser son nécessaire renouvellement ? En moins d’une dizaine d’années, Le capital au xxie siècle s’est vendu, avec une quarantaine de traductions, à 2,5 millions d’exemplaires. Aucun livre de l’éditeur Harvard University Press ne s’est autant vendu que sa traduction américaine. Au vu du nombre de conférences, séminaires et interviews auxquels son auteur est aujourd’hui invité, on peut penser que Capital et idéologie prend le chemin d’un succès au moins aussi grand33.
325Lire les « armées mortes »
et les économistes hétérodoxes
Note de lecture sur l’ouvrage d’Éric Berr, Léo Charles, Arthur Jatteau, Jonathan Marie et Alban Pellegris (pour les économistes atterrés), La dette publique. Précis d’économie citoyenne, Paris, Éditions du Seuil, 2021, 214 pages.
Clément Coste
Sciences Po Lyon
TRIANGLE – UMR CNRS 5206
Il en est ainsi des États ; leur prospérité est en raison du capital de leur dette contractée en temps de paix pour des travaux utiles ; ceux-là, qui pensent que la ressource de l’impôt doit leur suffire marchent à leur ruine par une fausse entente de l’économie, et par l’ignorance des principes du crédit (Girardin, 1858, p. 8).
Introduction
Les historiens des idées économiques sont-ils cantonnés au passé ou peuvent-ils contribuer à une analyse contemporaine critique de la dette publique ? Les économistes atterrés Éric Berr, Léo Charles, Arthur Jatteau, Jonathan Marie et Alban Pellegris publient un Précis d’économie citoyenne centré sur la question de la dette publique, cette question économique fondamentale du xxie siècle. En effet, la « crise des subprimes » d’abord – métamorphosée rapidement en « crise des dettes souveraines » – puis la 326crise sanitaire – témoin pour sa part des lacunes de l’économie française en termes de production et d’approvisionnement de biens essentiels puis de l’importante de l’État pour soutenir les économies à l’arrêt – semblent avoir fait de ce thème le sujet économique incontournable du temps présent. Cet ouvrage défend avec force une thèse s’attachant à déconstruire la réputation désastreuse qui poursuit l’endettement public et le pessimisme environnant les économies endettées : le niveau d’endettement public de la France ne doit pas être sur-interprété et il est urgent de saisir qu’il est le résultat de choix de politiques et structures économiques. Au-delà des arguments plus ou moins techniques discutés par les auteurs et sur lesquels je reviens plus loin, l’un des grands intérêts, peut-être indirect, de l’ouvrage est d’insister sur le fait que l’économie est encastrée dans le social et qu’elle est de fait ontologiquement politique. L’entrée par la dette publique rend la chose évidente : l’endettement public tisse des liens sociaux spécifiques et la manière dont il se réalise s’inscrit dans un projet politique, contraint les choix stratégiques de l’État et engage la collectivité. Le travail de Benjamin Lemoine, souvent mobilisé par les auteurs, est sur ce point édifiant : il permet de comprendre que le recours au marché financier en ce qui concerne l’endettement public doit être historicisé et resitué dans un agenda politique. Apparaît également en filigrane de cet ouvrage un enjeu méthodologique pour l’économie contemporaine. Cette conception de l’économie insiste sur l’importance de la comptabilité nationale d’une part34 et de l’approche historique d’autre part pour comprendre les phénomènes contemporains, les déconstruire et interroger leur singularité.
Plus précisément, cet ouvrage très didactique et accessible propose une déconstruction bienvenue de quelques idées reçues à l’égard de l’endettement public. Parmi les arguments développés, les auteurs rappellent les mérites de la dette publique en termes de relance économique (chapitre 2) et expliquent que celle-ci ne constitue pas, par essence, un fardeau pour les générations futures, lesquelles héritent des créances et des actifs non financiers financés par la dette en même temps que des passifs financiers (chapitre 1). Elle contribue en revanche à enrichir les porteurs de ces titres de dette et conduit ainsi à une redistribution des 327richesses à rebours (chapitre 3) – c’est notamment la raison pour laquelle Thomas Piketty insiste sur les mérites de l’impôt contre l’emprunt, le premier permettant un ciblage efficace de la redistribution (Piketty, 2013) – et elle doit alors être analysée, d’après les travaux de David Graeber (2013) lui aussi mentionné dans l’ouvrage, comme outil de domination (chapitre 4). En termes heuristiques, il convient par ailleurs, nous disent les auteurs, de rediscuter l’utilisation exclusive du ratio dette/PIB comme indicateur capable de rendre compte du niveau d’endettement public. La mobilisation d’autres indicateurs, portant sur la charge de la dette (rapportée au PIB ou à l’ensemble des recettes publiques) ou sur la comparaison entre les passifs (dette) et les actifs (patrimoine) des administrations publiques permettrait de relativiser cette musique lancinante qui survient à chaque augmentation du ratio dette/PIB, lequel compare maladroitement un stock de dette accumulée à un flux de richesse produite (chapitre 5). Comme annoncé plus tôt, figure également parmi les arguments des auteurs l’idée que le recours aux marchés financiers pour le financement de l’État ne va pas de soi. Le recours au marché financier s’est en France érigé comme alternative au circuit du Trésor, alternative dont on vante le caractère disciplinant contre les conséquences inflationnistes du précédent système (chapitre 6). Et ce changement de structure a pour conséquence de soumettre l’État et ses politiques à la supposée nécessaire discipline financière – l’agenda néo-libéral de réduction des dépenses publiques, notamment sociales, trouvait ici une justification, pense-t-on, imparable (chapitre 9). La comparaison récurrente de l’État à un débiteur lambda, l’enjoignant à agir « en bon père de famille » a tout de l’argumentation fallacieuse ou mal honnête – les auteurs rappellent notamment que la dette publique permet des dépenses qui, sans elle, seraient supportées par le secteur privé et alimenteraient ainsi une dette privée beaucoup plus risquée (chapitre 8). Ils précisent également que l’État rembourse en s’endettant et qu’il a ainsi la possibilité de « faire rouler sa dette ». La mise en relation de ces deux derniers arguments permet aux auteurs d’avancer l’argument fort que, aussi important que soit le niveau d’endettement de l’État, et quoi que suggèrent les célèbres travaux de Reinhart et Rogoff (2009) qui alimentent un « biais idéologique répandu » (p. 136) justifiant l’injonction à l’austérité, cette dette est soutenable si tant est qu’elle soit appréciée à l’aune d’autres critères. La soutenabilité de la dette 328publique, rappellent les auteurs, renvoie à la fois à la capacité de l’État à faire face à ses engagements (paiement des intérêts et remboursement du principal (capital nominal) – cela s’apprécie donc par la solidité du système fiscal et par les conditions d’emprunt dont bénéficie l’État – et à l’utilisation qui est faite du capital emprunté – les auteurs précisent que la dette publique française finance essentiellement des investissements, qui annoncent donc des retombées sociales importantes, et non des dépenses courantes (p. 138). Au chapitre plus normatif des solutions politiques envisagées, les auteurs proposent logiquement de sortir de la dépendance aux marchés financiers au moyen d’un nouveau contrat social reposant sur un véritable consentement à l’impôt (chapitres 10 et 11). Ce faisant, ils rappellent aux pourfendeurs de l’endettement public qu’il existe une alternative à la dette et que cette alternative est l’impôt. Au reste, la dette devrait être monétisée – c’est-à-dire que la Banque Centrale devra s’imposer réellement comme préteur en dernier ressort, au travers par exemple du Pandemic Emergency Purchase Programme (Cordonnier 2020) – et les dépenses liées à son financement devraient être administrées – c’est-à-dire encadrées, afin qu’elles cessent de constituer la plus grosse part du budget représentant une charge exorbitante pour les générations actuelle et futures, selon la formule consacrée. Cela permettrait à la nation de reprendre en main son destin en s’émancipant de la tutelle des marchés financiers. Il en va, insistent les auteurs, d’une aspiration démocratique.
L’enjeu de cette note est moins de pousser plus en avant l’analyse des arguments mis en évidence dans cet ouvrage que de proposer une mise en perspective de l’ambition affichée par les auteurs dès l’introduction : « proposer une analyse historique de l’évolution du niveau d’endettement actuel de la France où les cadeaux fiscaux, les crises économiques ou encore le recours aux marchés financiers sont parmi les variables explicatives » (p. 13). L’histoire racontée par les auteurs ne remonte pas au-delà des années soixante, si ce n’est quelques excursions comparatives dans les contextes de la Longue Dépression (fin xixe siècle) et des années 1930. Précisons que cela ne constitue en rien une limite de l’ouvrage. Et pour cause, il n’appartenait pas aux auteurs d’effectuer, dans le cadre de cet ouvrage dont on vante le caractère heuristique, un travail historique plus exhaustif qui aurait peut-être dilué le propos d’ensemble. Pour autant, et dans la continuité de la promotion d’une 329économie véritablement politique, cette note vise à décaler le regard pour interroger les arguments mis en avant sur un temps un peu plus long. Ce faisant, elle suggère que l’histoire de la pensée économique est intéressante, pour ne pas dire nécessaire, pour analyser et éclairer les débats contemporains. Sans toutefois tomber dans le « mythe des précurseurs » (Faccarello, 1993) il me semble intéressant de témoigner du fait que les vieux intellectuels et économistes du passé – « les armées mortes » selon l’expression consacrée par Pierre Dockès et Jean-Michel Servet (1992) – ont été en débat sur l’opportunité de l’endettement public, sur son caractère amortissable ou perpétuel, sur les dispositifs envisagés pour encadrer l’augmentation du capital nominal et le versement des intérêts. Plus qu’une simple opposition binaire entre pour ou contre la dette publique, il ressort de l’analyse des corpus du xixe siècle un triptyque complexe autour de l’endettement public (Coste, 2021) qui croise un certain nombre d’arguments mis en lumière dans l’ouvrage des économistes atterrés. Afin de pousser l’investigation dans le cadre du xixe siècle français caractérisé, relativement au siècle précédent (Théret 1992), par un recours « apaisé » à l’endettement public, j’en retiendrai quatre qui renvoient aux registres de la construction d’un marché de la dette publique – c’est-à-dire aux dispositifs et institutions qui permettent à l’État de s’endetter –, de l’opportunité de la dette, de sa soutenabilité (de son caractère amortissable ou perpétuel) et de son appréhension en tant que rapport social. À l’époque aussi le sujet était en proie à de vastes débats faisant de la dette publique un objet de controverses millénaires.
Les institutions du marchÉ de la rente
sur l’État au xixe siÈcle
Nombre de travaux historiques ont permis de mettre en lumière l’existence d’un marché de l’endettement public au xixe siècle (Gorges, 1884 ; Vührer, 1886 ; Bavelier, 1886 ; Fachan, 1904 ; Vaslin, 1999 ; Hautcœur & Gallais-Hamonno, 2007 ; Aglan, Margairaz, Verheyde (dir.), 2006 ; Lutfalla, 2017). Cet endettement se fait au moyen de l’émission 330de rentes qui sont des titres sans échéance déterminée et dont le taux d’intérêt nominal (5 % la plupart du temps) reflète la confiance (le crédit) dont bénéfice l’État. En opposition à la dette flottante qui résulte de l’émission d’obligations par exemple trentenaires, la dette résultant de l’émission de rentes est dite perpétuelle. Toutefois, évoquer un marché de l’endettement public ne doit pas laisser penser que les choses se font naturellement et s’exécutent sur un marché concurrentiel. Au début du siècle, l’État français ne suscitait pas la confiance nécessaire qui lui aurait permis de s’adresser directement au public pour contracter des emprunts – une seule souscription publique à lieu dans la première moitié du xixe siècle – l’État n’était donc pas en mesure d’économiser le coût de l’intermédiation bancaire. Si sa crédibilité financière était contestée, les banques françaises, durablement fragilisées par les différentes crises commerciales à l’aube de la Restauration, étaient pour leur part incapables de seconder l’État dans ses affaires financières. Dans ces conditions, la Haute-Banque s’imposait comme le partenaire incontournable de l’État français pour l’émission de ses emprunts (Gille, 1957, 1959, 1965, 1970). Mais là encore, le système de l’adjudication par publicité et concurrence doit être interrogé. Si le système prévoyait que chaque banque souhaitant souscrire à l’emprunt propose secrètement son prix et que l’emprunt était finalement adjugé à la banque ayant remportée l’enchère – il lui revenait ensuite de placer les titres parmi ses clients – il faut noter que la concurrence était régulièrement faussée par l’ubiquité de Rothschild capable de dicter les conditions de l’emprunt à l’État. Lors de l’emprunt de 1832 par exemple, Rothschild prenait la tête du seul syndicat de banquiers qui se présentait à la soumission : à défaut de concurrence, l’emprunt fut finalement souscrit à un prix (98,50 francs) inférieur à ce que cotait à ce moment-là la rente à la bourse de Paris (99,65 francs). Notons également que la Banque de France fut un acteur important du développement du crédit de l’État au xixe siècle. La loi du 11 juin 1817 autorisait le ministre des Finances à faire appel à la Banque de France pour assurer le paiement des arrérages de la dette, ce n’est qu’à partir de 1828 que le service est totalement assuré par le Trésor (Hautcœur & Gallais-Hamonno, 2007, vol. 1, p. 185). Mais la Banque de France continuait toutefois indirectement de peser via les avances qu’elle faisait au Trésor immobilisées sous forme de rentes (Vaslin, 1999). La Banque de France fait ainsi très tôt partie des propriétaires de rentes 331qu’elle continuait de posséder tout au long du siècle. Et l’activité de la Banque de France ne s’arrêtait pas là. En se montrant frileuse à l’égard du crédit et cherchant par là à garantir la stabilité de la valeur de la monnaie – l’inflation est quasiment nulle en France jusqu’à la première guerre mondiale – la Banque de France garantissait simultanément et indirectement la valeur des titres des créanciers de l’État.
Il faut par ailleurs relever que cette accumulation de l’épargne sur la dette de l’État n’avait rien de spontanée. Afin d’attirer les capitaux disponibles, l’État mettait en place un ensemble de dispositifs institutionnels dont l’enjeu était de s’assurer du soutien financier des capitalistes. Les porteurs de rentes étaient ainsi exemptés d’impôt – il n’existait pas d’impôt sur la rente, sa possession était libre du timbre et sa transmission n’était pas assujetti à l’enregistrement35. Notons également que c’est autour de la dette publique que la Bourse de Paris se réorganisait en 1800. Sa mission était d’organiser le commerce des titres de dette et d’assurer aux rentiers de l’État la liquidité à laquelle ils aspiraient (Hautcœur, 2011). Le cours des rentes fourni par la Bourse, en perpétuelle ascension sur toute la première moitié du xixe siècle36, et le taux d’intérêt de long terme en perpétuelle décru37, témoignent ainsi de la confiance dans l’État retrouvée.
Garantir « la foi publique » était également le défi de la « nouvelle » caisse d’amortissement – la sixième du nom – instituée par la loi du 28 avril 1816 (Aglan et al., 2006). Si cette institution imposera rapidement l’idée qu’il est impératif de lutter contre l’accroissement du capital nominal de la dette publique, il était initialement surtout question de garantir aux futurs créanciers de l’État qu’ils trouveraient toujours un agent disposé à racheter, sans condition, les titres de dette dont ils seraient porteurs. Il s’agissait pour l’État, expliquent Alfred Joubert (1896) et Philippe Verheyde (2006), de prouver sa loyauté à ses créanciers. À partir d’une dotation initiale du Trésor inscrite au budget, la Caisse 332d’amortissement pouvait se porter acquéreur de rentes à la Bourse. Les immobilisant ensuite dans ses actifs, elle en percevait les intérêts, voyait son capital grossir et pouvait ainsi augmenter ses achats. Son capital augmentait par ailleurs régulièrement par divers versements comme par exemple le produit de la vente des bois de l’État – d’un point de vue comptable, le remboursement de la dette publique imposait ainsi la privatisation d’une partie du patrimoine nationale, sans commune mesure toutefois avec le programme imposé par la Troïka à la Grèce contemporaine précisé par les auteurs de l’ouvrage (chapitre 4).
Si la caisse d’amortissement est donc l’institution qui visait à la fois à asseoir le crédit de l’État et à limiter l’augmentation de la dette publique (le capital nominal), la question du financement de cette dette demeure. L’État doit effectivement faire face au service de sa dette et ce poste représentait déjà au xixe siècle un élément prépondérant du budget. À titre d’illustration, tous postes confondus, les charges de la dette représentaient dans le budget de 1831 31,5 % de l’ensemble des dépenses38. À l’initiative du ministre Villèle qui était à la recherche des ressources nécessaires pour dédommager les émigrés de la Révolution française, la conversion des rentes devenait bientôt un sujet de finances publiques prépondérant (Labeyrie, 1878). À partir d’un savoir spécifique qui emprunte à la science des finances, il s’agissait de diminuer le revenu versé par l’État à ses créanciers. Par exemple, si la rente 5 % – qui donne droit au versement d’un revenu de 5 francs – émise lors d’un emprunt public en 1831 négocié à 80 francs côte, cinq ans plus tard, 110 francs à la bourse, son taux d’intérêt, d’environ 6 % en 1831, est en 1836 de 4,5 %. Le titre de rente 5 % ayant dépassé le pair (100 francs), l’État comprenait que s’il souhaitait émettre un nouvel emprunt il pourrait s’engager à servir à ses créanciers une rente de seulement 4,5 francs au lieu de 5 francs – il continuerait toutefois à se reconnaître débiteur de 100 francs de capital pour chaque titre de dette. L’État était donc en mesure de convertir les rentes 5 % qu’il servait actuellement à ses créanciers en rentes 4,5 %, et d’économiser ainsi sur les arrérages de la dette. Aux rentiers qui refuseraient la perte de revenu induite, l’État proposait systématiquement le remboursement, au pair (100 francs), de leur capital. Exceptée cette possibilité, la conversion des rentes n’a donc a priori aucun effet sur le volume de la dette, mais seulement sur son 333financement39. La conversion des rentes consistait ainsi à réaliser une économie sur le service de la dette en faisant valoir l’affermissement du crédit de l’État. Elle pouvait être assimilée à une forme de renégociation entre l’État et ses créanciers semblable à celle que les économistes atterrés appellent de leurs vœux pour faire face aux charges de la dette. Une telle négociation serait préférable à un coup de serpe dans les dépenses sociales – là encore le cas grec est mobilisé en contre-modèle (chapitre 4).
L’endettement public reposait donc au xixe sur tout un arsenal institutionnel et législatif. Ces dispositifs consistaient à garantir quelques avantages aux catégories sociales susceptibles de placer leur épargne sur la dette de l’État, à l’exception de la conversion des rentes qui supposait à l’inverse une diminution du revenu du rentier afin de garantir la soutenabilité de l’endettement public. Et ce n’est pas anodin si la plupart des projets de conversion qui ont émergé au cours du xixe siècle, soutenus par les députés, ont été jusqu’en 1852 systématiquement rejetés par la Chambre des pairs qui représentait alors ces catégories sociales.
II. La dette publique dans les Écrits dix-neuviÉmistes : aubaine ou mal absolu ?
L’ouvrage des économistes atterrés contribue très largement à nuancer le scepticisme répandu appréhendant la dette publique comme la preuve que l’État « vit au-dessus de ses moyens » (p. 115) et comme frein à la croissance économique (Tinel & Van de Velde, 2008). À en croire les célèbres travaux de Reinhart et Rogoff (2009), la dette publique serait à moyen terme responsable à la fois du chômage de masse et de l’accroissement des ratios d’endettement public du fait du tarissement des ressources fiscales et de la sclérose des marchés de capitaux à cause de l’augmentation des taux d’intérêt qui freine l’investissement et la croissance. Les économies concernées ne pourraient alors « s’en sortir » qu’au prix d’une forte inflation ou d’une répudiation pure et simple 334de la dette. La boucle semble alors bouclée et l’épilogue annoncé mais l’analyse est viciée. Face à cette prédiction, la macroéconomie keynésienne et post-keynésienne, relayée par les auteurs de l’ouvrage, vante les mérites de l’endettement public en matière de croissance et d’orientation de la politique économique notamment en période de crises multiples – économique, sociale, sanitaire et environnementale – (chapitres 2 et 12) et assure que le risque pour l’État – preuve en est du cas japonais – réside essentiellement dans le régime monétaire au sein duquel il évolue : le fait est de savoir si l’État est ou non souverain du point de vue monétaire (Nersisyan & Wray, 2011). Le risque de change est donc nul « pour une économie comme la France » qui s’endette dans sa propre monnaie et le risque de taux d’intérêt peut quant à lui être contenu par le soutien d’une politique monétaire accommodante (p. 160).
Si les écrits du xixe siècle ne rendent pas compte d’une analyse en tout point comparable, il convient toutefois d’interroger la teneur des débats dix-neuviémistes sur le recours à l’endettement public : les économistes de l’époque le jugeait-ils opportun pour certaines réalisations ? Pressentaient-ils un avenir aussi sombre aux économies endettées ? À l’aube de la Révolution française, Adam Smith était peu optimiste à l’égard des régimes endettés, notamment de la France qu’il décrivait comme « languissant sous un fardeau accablant de dette » (Smith, 1776, II, p. 576). Les révolutionnaires Étienne Clavière et Jacques Pierre Brissot par exemple, en réaction aux vielles pratiques de la dette du xviiie siècle, condamnaient eux aussi l’autoritarisme et l’antilibéralisme des régimes endettés. Et pour cause, c’est à l’époque essentiellement par la guerre que l’État construisait sa puissance et sa légitimité grâce au soutien financier de l’aristocratie qui bénéficiait de la redistribution de l’impôt sous forme de gages et de pensions militaires (Théret, 1992). C’était donc dans ce sillage et ce contexte que s’inscrivaient les pères fondateurs de l’économie politique néo-smithienne de tradition française (Béraud, Gislain & Steiner, 2004).
Dans son Traité d’économie politique (1803, p. 548), Jean-Baptiste Say résumait l’emprunt public en une destruction de capital, et dans son Cours complet d’économie politique ([1828-1829]1840), récusait l’idée selon laquelle chaque emprunt de l’État était un nouvel encouragement pour l’industrie. Say regrettait la consommation de capital par l’État qu’il assimilait à une destruction de valeur et dénonçait alors l’ampleur des capitaux dépensés 335improductivement par les gouvernements. Sismondi le rejoignait sur cette idée dénonçant le « capital imaginaire » que représentent les fonds publics qui appelaient pourtant une rémunération supérieure aux capitaux réels placés dans le commerce. Sismondi invoquait par ailleurs le caractère « effrayant » de la dette publique qu’il définissait comme le bien que les puissants ravissent à leurs enfants (Sismondi, 1837, p. 318-319). Il infusait déjà l’idée, également formulée par Say, que la dette publique était contractée dans le présent mais devra être payée par les générations futures. L’économiste français pouvait ainsi infuser l’idée que « le mal que fait un gouvernement quand il emprunte est irrémédiable » (Tiran, 1995, p. 528).
Au même moment, et contre cette vision catastrophée de l’endettement public, les auteurs saint-simoniens développaient une argumentation beaucoup plus optimiste en indiquant que « condamner le feu parce qu’il brûle serait un très mauvais calcul » (Enfantin, 1826). Ces auteurs appréhendaient l’emprunt comme expédient sur lequel l’État pouvait légitimement compter en insistant sur ces avantages relativement à l’impôt : ce-dernier prélève des capitaux sur la circulation là où l’emprunt ne concerne que des capitaux oisifs. Barthélémy Prosper Enfantin pouvait ainsi en ces termes justifier le recours à l’endettement public :
Toute combinaison financière employée à satisfaire aux dépenses publiques doit avoir pour unique but de prendre les produits nécessaires à ces dépenses, et ce, chez ceux qui, eu égard à la répartition actuelle de la propriété et des produits du travail, se trouvent avoir le revenu le plus disproportionné compte tenu de la part dont jouissent les autres membres. C’est bien dans ce fait que réside l’intérêt des emprunts, généralement portés pas les gros bénéficiaires de la société […] La véritable question est de savoir comment consacrer aux charges publiques les produits dont l’absence nuit le moins à la production, c’est-à-dire les capitaux employés de la manière la moins fructueuse (Enfantin, 1831)40.
Le saint-simonisme justifiait le recours à la dette publique pour financer l’industrialisation et percevait, très tôt, la dimension reproductive des emprunts publics. Les saint-simoniens faisaient ainsi du système 336d’emprunts publics le vecteur du passage à l’ordre industriel nouveau. Mais plus encore, dans leur appréhension de la réalité sociale par le prisme de l’antagonisme oisifs/industriels, les saint-simoniens percevaient le système d’emprunts publics comme un moyen efficace de rendre à l’État sa véritable mission consistant à gérer et réguler le crédit national au moyen des capitaux oisifs qu’il parviendrait dès lors à faire entrer dans la circulation. Les emprunts publics à l’usage de grands travaux leur apparaissaient comme un dispositif de circulation et de socialisation des richesses inscrit dans le développement politique des sociétés modernes. Les saint-simoniens le décrivaient comme :
[L]e levier le plus puissant que puisse employer un gouvernement moral, éclairé et habile, pour étendre à la classe la plus pauvre et la plus nombreuse l’usage des capitaux concentrés au sein de la classe privilégiée par la naissance ; nous le signalons comme la transaction la plus productive du bien-être populaire, puisqu’elle a pour objet de faire passer les capitaux, qui sont les instruments obligés du travail, des mains des oisifs qui possèdent dans celles des travailleurs qui ne possèdent pas (Le Globe, 1831, p. 57).
Et dans ses Leçons sur l’industrie et les finances, Isaac Pereire allait jusqu’à évoquer les emprunts perpétuels en tant que « monnaie de crédit social » participant d’une forme de socialisation du crédit (Pereire, 1832, p. 71). Ainsi, et de manière sans doute contre intuitive (mais cette intuition doit être resitué dans la politique fiscale de l’époque où l’impôt progressif sur le revenu n’existe pas encore et où les contributions indirectes sont préférées à l’imposition directe) l’emprunt public apparaissait aux auteurs saint-simoniens comme un dispositif susceptible d’opérer une reconfiguration des rapports sociaux qui devait permettre l’émancipation des « industriels » déshérités. Cet engouement pour l’emprunt, qui s’accompagne d’un projet de réforme fiscale visant la disparition des impôts indirects de consommation, l’augmentation de la contribution foncière et l’impôt progressif sur le revenu (Pereire, 1831b ; Coste, 2016), sera magistralement refreiné par le socialiste Jules Leroux41. Mais pour l’heure, l’idée que l’emprunt possède des vertus reproductives et peut servir à autre chose qu’à faire la guerre, semblait avoir essaimé jusque dans les rangs de la société et du journal des économistes d’une part et jusque dans les cours des titulaires de chair d’économie d’autre part.
337Les cours d’économie industrielle d’Adolphe Blanqui (1837-1839) et d’économie politique de Pellegrino Rossi ([1839] 1865) expiaient effectivement la réserve généralisée à l’égard de l’endettement public en mettant en avant quelques usages reproductifs de la dette. Aussi, la dette publique apparaissait à ces économistes comme un dispositif permettant le placement des petites épargnes oisives (Rossi, [1839] 1865). Il restait toutefois quelques esprits rétifs que l’on peut interpréter dans le contexte de 1848 et l’audience acquise par quelques idées socialistes. Ainsi de Joseph Garnier insistant sur le fait que « la voie des emprunts [était] la plus délicate à suivre et celle que l’expérience a montré la plus funeste » (Garnier, 1848, p. 357). Si dans la réédition de son Traité des finances, Garnier rendait hommage à la théorie d’Enfantin (Garnier, [1858] 1872, p. 126) et reconnaissait les vertus des emprunts pour les différentes « circonscriptions locales » – administrations publiques locales dirait-on aujourd’hui – car il existe pour elles de véritables motifs d’emprunts rationnels (voies publiques, chemins, rues, ports etc.), il dénonçait simultanément « les sophismes attachés à la question des emprunts publics » (ibid., p. 203-214) : l’emprunt « cause une énorme dépression à la fortune actuelle et à la fortune future », il « exerce une action délétère sur la moralité des peuples et des gouvernants » et agit « comme obstacle à la production et à la consommation, [il] est une cause permanente de misère » (ibid., p. 267). S’il paraissait de prime abord plus conciliant qu’un Gustave du Puynode qui, dans le célèbre Dictionnaire d’économie politique (1852), raillait l’idée selon laquelle la dette publique pouvait être signe de richesse – il assimilait l’État au débiteur particulier –42 et n’admettait finalement que deux motifs à l’endettement public, « préparer les guerres et réparer les révolutions », la conclusion de Joseph Garnier n’en était pas très éloignée : « En résumé, l’emprunt conduit à la guerre, la guerre conduit à l’emprunt » ([1858] 1872, p. 202). Face à ces différentes interprétations, le collaborateur du Journal des économistes – il en est rédacteur en chef de 1855 à 1864, du Journal des débats et de la Revue des deux mondes, Henri Baudrillart, proposait une synthèse :
L’économie politique a raison quand elle combat les folles illusions qui voudraient montrer dans la dette une richesse et lorsqu’elle signale la pente 338entrainante qui mène de la facilité d’emprunter à la facilité de dépenser. Elle va trop loin lorsqu’elle se refuse à reconnaître que tel emprunt opéré en vue d’une entreprise utile peut être une bonne affaire pour le pays, et nous croyons qu’elle fait fausse route lorsqu’elle recommande dans le cas d’une présente nécessité, de préférer l’impôt à l’emprunt (Baudrillart, [1857] 1878).
Tout en se gardant d’entrer dans la voie qui consiste à penser que les emprunts activent la circulation, Baudrillart nuançait simultanément l’argument de la destruction de capital générée par l’emprunt et l’aggravation du fardeau légué aux générations futures. Il ne serait pas plus juste, précisait-il, que ces générations ne prennent aucune part à des dépenses dont elles profiteront très largement, ce qui est notamment le cas des grands travaux publics43. Et le polytechnicien Jules Dupuit s’inscrivait dans le même sillage précisant notamment que « si restreintes que soient les fonctions de l’État dans l’esprit des économistes, il y a cependant une foule de choses qui sont d’un usage commun et durable, et pour l’établissement desquelles l’État, les provinces ou les communes peuvent très légitimement emprunter » (Dupuit, 1860). Dupuit faisait remarquer que si la dette augmentait, le revenu du contribuable pouvait augmenter plus vite encore. À l’image des indicateurs alternatifs pour appréhender le niveau d’endettement public proposés par les auteurs de l’ouvrage, Dupuit indiquait déjà qu’une dette publique d’une ampleur considérable pouvait être représentative d’une richesse nationale non moins considérable si les ressources générales du pays, notamment fiscales, abondaient.
La position des économistes évoluait donc au contact des usages transparents de la Restauration et du développement économique que permettait l’emprunt sous le Second Empire et la Troisième République (Girard, 1952). Leur acceptation de la dette publique était toutefois toute relative. À la défiance du début du siècle succédait la méfiance. Du côté de la société de statistique de Paris par exemple, on s’inquiétait de ce « triste privilège de posséder la dette publique de beaucoup la plus élevée du monde » (Stourm, 1888, p. 353). L’ancien inspecteur des Finances devenu titulaire de la chair de finances publiques à l’École libre des sciences 339politiques, évoquait « l’effroi patriotique qu’il est légitime de ressentir à cette constatation » (ibid., p. 359). Enfin, et si l’histoire chiffrée de la dette et des emprunts publics que proposaient Alfred Neymarck et E. de Bray (1889) d’une part, et L. Foyot et J. de Reinach (1894) d’autre part, dans le Dictionnaire de finances de Léon Say, semblait attester que la dette et les emprunts productifs étaient entrés dans les usages, la conclusion demeurait sans appel :
On ne saurait trop insister sur les dangers et le côté délicat que présente cette nature d’emprunt. Sous prétexte d’utilité publique, on a confié aux gouvernements la direction d’entreprises industrielles ou financières que l’industrie privée aurait pu réaliser à meilleur compte. C’est ainsi que certains États, faisant œuvre de socialisme, sont devenus assureurs, banquiers, fabricants, industriels, et que, comme tels, ils ont dû, au détriment des intérêts privés, prélever sur les capitaux du pays des sommes considérables (Foyot & Reinach, 1894, p. 56).
La méfiance à l’égard de la dette publique demeurait et se manifestait notamment à travers la phobie du socialisme. La controverse se cristallisait simultanément sur la nature de la dette à l’image des critiques adressées à l’activité de la Caisse d’amortissement.
III. La nature de la dette publique :
amortissable ou perpÉtuelle ?
En refusant l’assimilation de l’État emprunteur au débiteur particulier, et donc de la dette publique à la dette privée, les auteurs de l’ouvrage souhaitent déconstruire l’idée selon laquelle l’État se doit d’agir en « bon père de famille » n’étant pas confronté aux mêmes contraintes que le débiteur privé. Ils font valoir que, contrairement à ce dernier, l’État est en capacité de « faire rouler sa dette » et qu’on ne saurait légitimement ériger la contrainte du remboursement de la dette comme argument à son encontre. Force est de constater que cette disjonction animait déjà les débats du xixe siècle et voyait s’opposer les partisans d’une dette amortissable et les partisans d’une dette véritablement perpétuelle. C’est d’ailleurs à ce titre que les premiers justifiaient la Caisse d’amortissement 340de 1816. À leur tête, l’ancien ministre des Finances et proche de Napoléon Bonaparte en faisait la promotion :
L’amortissement qui doit s’attacher à la rente et ne cesser d’agir sur ce qui s’en présente sur le marché, jusqu’à ce qu’il l’ait complètement absorbée, peut seul opérer la libération réelle de l’État : mais il faut se résigner avec courage aux exigences de ce système ou renoncer au résultat qu’il doit assurer, s’il est bien compris et fidèlement exécuté (Gaudin, 1828, p. 18).
Il est moins question ici de discuter la capacité de la Caisse à effectivement éteindre la dette publique – son histoire témoigne de la vanité d’une telle entreprise (Aglan et al., 2006) et, hormis quelques économistes libéraux qui insistaient sur ses mérites en termes de stabilité sociale, libéraux, saint-simoniens et socialistes arguaient tous son incapacité financière (Coste, 2016, 2021) – que de montrer que les débats autour de l’amortissement de la dette publique se cristallisaient finalement autour de conceptions différenciées de l’État. À ce propos, Pierre-Joseph Proudhon, expliquait la genèse de la Caisse d’amortissement par l’assimilation de l’État au débiteur lambda :
Un gouvernement qui emprunte raisonne comme un particulier ; c’est un remède à la gêne du moment. Il s’en empare donc, parce qu’avant tout il faut sortir de l’embarras ; mais il a la ferme résolution d’éteindre ses dettes par une rigoureuse économie. L’ouvrier prend un livret à la caisse d’épargne, le négociant se crée un fonds de réserve, le gouvernement institue la Caisse d’Amortissement (Proudhon, 1857).
Les auteurs saint-simoniens se sont très tôt distingués par leur refus d’encadrer la dette publique au moyen d’une tierce caisse dédiée à son remboursement. Derrière la critique de l’institution les auteurs saint-simoniens revendiquaient la perpétuité de la dette publique. Ils reprochaient aux fanatiques de l’amortissement de non seulement croire en une chimère, mais plus largement de condamner l’émancipation de l’industrie en allant contre le principe de perpétuité de la dette. L’argument développé d’abord par Enfantin dans Le Producteur (1826) et Le Globe (1831), puis par Émile Pereire (1831, 1832, 1831-1835, 1876, 1879), consistait à faire remarquer que l’amortissement reposait sur une logique socialement paradoxale : il s’agissait de prélever un impôt supplémentaire sur les travailleurs pour rémunérer des « oisifs ». « L’amortissement en lui-même est une opération rétrograde, écrivait Enfantin, puisqu’il fait retourner 341dans les mains des oisifs des capitaux prêtés par eux aux travailleurs » (Enfantin, 1831, p. 58)44. Si renoncer à amortir la dette publique devait logiquement conduire à l’augmentation du capital nominal de la dette, les saint-simoniens, devançant Émile de Girardin, estimaient pour leur part « qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter devant le chiffre plus ou moins élevé du capital à rembourser […], il n’y a de charge réelle pour un État que le service régulier de la rente » (Girardin, 1858). Selon eux, la nouvelle bourgeoisie rentière courait après l’intérêt du capital, non après son remboursement. Les capitaux placés sur la dette de l’État sont des capitaux oisifs, si bien qu’une fois remboursés ils chercheront à se placer ailleurs et reviendraient très certainement sur la dette de l’État compte tenu de la solidité de ce placement. Ainsi le remboursement n’éteignait réellement aucune dette, il la diminuait temporairement, la déplaçait tout au plus. Et puisque le perpétuel avait les faveurs du public (Marion, 1926), l’État aurait tort d’un point de vue pratique d’émettre de l’amortissable. Ainsi, en estimant qu’il n’y avait de charges réelles de la dette que le taux d’intérêt servi par l’État à ses créanciers, les auteurs saint-simoniens comprenaient très tôt que la dette publique avait vocation à être « roulée ». Ce serait alors, estimaient les saint-simoniens, contre la nature immuable, impersonnelle et infinie de l’État que de renier la perpétuité de son crédit.
De leur côté, et s’ils mettaient eux aussi en avant l’incapacité de la Caisse d’amortissement à éteindre la dette publique par l’intermédiaire de la célèbre formule des intérêts composés du docteur Price, les économistes libéraux de la période n’en appelaient pas pour autant à la perpétuité de la dette publique. En effet, si l’on a pu relever une relative accoutumance à l’endettement public, ce dernier n’était considéré légitime que suite à l’insuffisance des impôts et devait prioritairement se réaliser en obligations d’État ce qui permettait à la dette de demeurer à l’état de dette flottante : la dette se devait de toujours être temporaire (Rossi, [1839] 1865, p. 221). 342Joseph Garnier expliquait qu’il était primordial que l’État rembourse sa dette, la perpétuité étant selon ses dires « une aberration dangereuse », un système vicieux, qui fait qu’on a l’impression de ne jamais payer sa dette alors qu’on la paye indéfiniment sous forme d’intérêt. C’est donc davantage son institutionnalisation que l’amortissement en lui-même que contestait la plus grande partie des économistes de l’École de Paris. Mais parmi eux, l’économiste ingénieur Jules Dupuit se démarquait une nouvelle fois expliquant dans les colonnes du Journal des économistes que l’amortissement de la dette publique était caduc tout simplement parce que l’État n’était pas engagé à rembourser la dette qu’il avait contractée (Dupuit, 1860). Moins « radical » que lui, Louis Wolowski indiquait également qu’il était absurde d’appliquer à l’État les règles financières qui régissaient le comportement de l’individu endetté. Le proverbe « qui paye ses dettes s’enrichit » ne fonctionne pour l’État que s’il n’écrase pas l’instrument de travail général par des impôts trop lourds (Neymarck, 1878).
On trouve dans le dernier quart de siècle une sorte de synthèse de cette idée de perpétuité de la dette sous la plume du désormais vieux saint-simonien, Isaac Pereire, devenu le célèbre brasseur d’affaires du Second Empire (Pereire, 1876 et 1879). Le saint-simonien réaffirmait les intuitions des années 1830 relatives à la nature légitimement perpétuelle de la dette publique. Il mobilisait à ce sujet les propos du banquier et républicain italien Henri Cernuschi publié dans le journal Le Siècle :
L’État est perpétuel. C’est à raison de sa perpétuité qu’il peut émettre des rentes perpétuelles. L’État a toujours le droit de racheter les rentes émises en payant leur capital nominal au pair de 100 […]. Les compagnies de chemins de fer ont devant elles une existence de 75 ans seulement, c’est pourquoi elles ne peuvent emprunter à titre perpétuel, et c’est pourquoi elles émettent, sous le nom d’obligations, des rentes amortissables en 75 ans par la voie de tirages annuels. Que ne pouvant émettre du perpétuel, les compagnies émettent de l’amortissable, c’est dans l’ordre, mais que, pouvant émettre du perpétuel, l’État aille émettre de l’amortissable, ce serait une faute (Pereire, 1879, p. 64).
Pereire insistait en faveur de la perpétuité de la dette en expliquant que les titres de rente étaient des épargnes déjà consommées dans un intérêt social et que seuls les revenus qu’ils procuraient intéressaient et étaient indispensables à leurs détenteurs. Les revenus auxquels donnaient droit ces titres de propriété devaient ainsi être supportés par les contribuables, ad vitam aeternam. Ces-derniers, arguait Pereire, « aiment mieux supporter 343une charge d’intérêt que se priver des capitaux nécessaires à leur industrie » dans le but de financer un amortissement inepte (Pereire, 1876). Cette charge d’intérêt pouvait d’ailleurs être allégée au moyen de la conversion des rentes que les saint-simoniens défendaient ardemment en faveur des contribuables. Précisons à ce sujet que du côté du Journal des économistes, on tardera à reconnaître le bien-fondé de ce procédé financier (Coquelin, 1845) : le républicain et rédacteur en chef du Journal de 1843 à 1845 Hippolyte Dussart reconnaissait finalement que « la conversion [était] la banqueroute des gens clairvoyants, comme la banqueroute [était] la conversion des aveugles » (Dussart, 1845, p. 54). La perpétuité de la dette publique semblait ainsi impliquer la diminution des charges liées à son service.
Dans leur ouvrage qui, rappelons-le, porte sur une analyse contemporaine de la dette publique, les auteurs expliquent que la renégociation avec les créanciers peut s’avérer nécessaire et apparaître comme alternative efficace à la baisse drastique des dépenses sociales. Plus précisément, ils soutiennent les appels à ce que la Banque Centrale Européenne annule les titres de dettes souveraines détenus à son actif (p. 157). Ces appels ne sont pour l’heure pas entendus. Il est alors intéressant de relever que cette supplique ne trouvait pas d’oreille plus attentive au xixe siècle. Alors que la Caisse d’amortissement allait être réformée en 1833, le banquier, gouverneur de la Banque de France et ex ministre des Finances (1830-1831) Jacques Laffitte défendait un projet visant à annuler les rentes rachetées par la Caisse d’amortissement afin qu’elles ne donnent plus lieu au versement d’intérêt. Laffitte perdait toutefois son face à face avec le ministre Humann qui souhaitait que rien, ou peu de choses, ne change. L’histoire relativise parfois le caractère radical et singulier de certaines propositions et témoigne simultanément de la permanence de certaines préoccupations et choix pour l’avenir.
IV. La dette publique comme rapport social
Le dernier argument mis en avant par les auteurs de l’ouvrage que je souhaite ici présenter dans une perspective d’histoire intellectuelle concerne l’appréhension de la dette publique en tant que rapport social 344empreint de domination (chapitres 3 et 4). Il faut effectivement avoir à l’esprit que si la dette publique constitue bien une dette pour le secteur public, elle est symétriquement une richesse pour le secteur privé et qu’en cela, elle ne saurait être décriée par toutes les forces en présence. Les auteurs expliquent à ce sujet que « la dette publique est détenue par les plus riches, et que cela leur rapporte » (p. 51). Précisons d’emblée que cela se vérifiait également au xixe siècle : la rente ne se « démocratisait » qu’à partir de 1848, si bien que dans les années 1830 une minorité de « gros rentiers » possédaient plus de 70 % du montant total de la rente (Aglan et al., 2006). À l’époque, elle constituait un placement rémunérateur : son taux d’intérêt oscillait entre 9 et 5,5 % entre 1815 et 1830 et entre 4 et 6,5 % entre 1831 et 1870 (notons que le taux d’intérêt de long terme déclinait sur toute la période exceptée durant les périodes de crises économiques et de révolutions) (Monnet & Levy-Garboua, 2016). Ce n’est donc pas étonnant si sur la période, les projets de conversion qui donnaient lieu à de nombreuses pétitions étaient finalement repoussés par la chambre des Pairs. Les premiers percevaient que le taux d’intérêt sur la dette de l’État servait de baromètre au prix de l’argent dans toutes les sphères de l’industrie, lorsque les seconds n’envisageaient que la perte de revenu induite pour le rentier dont les actifs étaient déjà suffisamment dévalorisés par l’inflation. Ainsi le rapport de force entre l’ensemble des débiteurs – les contribuables – et la minorité de créanciers tournait régulièrement à l’avantage des seconds soutenus par les Pairs de France45 – il fallait attendre 1852 et la disparition de la chambre des Pairs suite à la révolution de 1848 pour qu’un projet de conversion aille finalement à son terme.
Plus largement, je souhaiterai ici insister sur l’analyse institutionnelle de la dette publique proposée très tôt par le socialiste Jules Leroux, laquelle contribuait à tempérer l’enthousiasme des saint-simoniens à l’endroit des vertus supposées émancipatrices de la dette publique. En effet, si d’une manière générale, réformateurs sociaux et socialistes se dressent contre la vision conservatrice des économistes libéraux, il convient d’opérer une analyse plus fine de cette opposition afin de montrer que parmi les seconds, Jules Leroux avait déjà bien compris que la dette publique était avant tout un rapport social fait de domination et 345qu’elle était ainsi bien incapable, en dépit de ses vertus économiques, d’émanciper « la classe la plus nombreuse et la plus pauvre ». Tout en reconnaissant la volonté d’Enfantin dans sa « théorie de l’emprunt illimité » de permettre à l’État de « reconquérir sa couronne, en possédant des fonds pour s’enrichir par le commerce et l’industrie en désintéressant les individus qui vivent de ce patrimoine », Jules Leroux proposait au sein de l’Encyclopédie Nouvelle une analyse nouvelle de l’emprunt public qui insistait sur les rapports sociaux alors à l’œuvre. Contre l’idée, passée et présente, que la dette est la preuve d’une mauvaise gestion par l’État de ses revenus, Leroux insistait sur l’idée qu’elle est davantage l’expression d’un conflit social et la conséquence de l’agencement des pouvoirs distinguant le pouvoir exécutif, incarné dans le Roi, qui dépense les ressources de l’impôt, du pouvoir législatif, incarné dans la bourgeoisie siégeant à l’Assemblée Nationale, qui en vote la perception – l’auteur évoquait à ce titre « la dualité du pouvoir souverain ». Leroux stipulait alors que dans cette affaire d’emprunts publics la bourgeoisie exerce une tutelle sur l’État : le roi n’a plus le pouvoir d’augmenter son revenu en levant arbitrairement des impôts puisque la Révolution en a confié la tâche à l’Assemblée nationale. La bourgeoisie, expliquai alors l’auteur socialiste, était donc désormais en mesure de refuser son dû à l’État et c’est bien là que réside la genèse de l’emprunt selon Jules Leroux : l’inadéquation entre les budgets de recette et de dépense serait sciemment organisée. Le déficit public imposerait alors à l’État de s’en remettre aux catégories sociales susceptibles de lui apporter les fonds qu’il n’a pu s’adjuger par l’impôt. En retour, le pouvoir législatif votait l’impôt qui permettait de financer le prêt du capital en faisant reposer, au xixe siècle, l’essentiel de la fiscalité sur des contributions indirectes qui pèsent plus lourd dans le budget des catégories populaires, et en dégrevant régulièrement la contribution foncière notamment (Delalande, 2011).
Dans le monde des gouvernés, un petit nombre, alléché par l’appât du gain que lui offre la transaction de l’emprunt, ouvre sa bourse aux gouvernants ; un petit nombre, ami du premier ou simplement ennemi du plus grand nombre, vote l’impôt qui doit payer l’intérêt de cet emprunt ; et tout est dit, la chose a lieu (Leroux, [1843] 1991c, p. 757).
Leroux expliquait alors que la dette publique était finalement dépendante de la volonté propre de la bourgeoisie – des capitalistes – d’étendre son 346pouvoir social et de l’oreille attentive qu’elle trouvait dans les chambres qui votaient l’impôt : si la dette publique existe – et cette analyse semble en phase avec la thèse alors défendue par les économistes atterrés – c’est précisément parce que l’emprunt public constitue un bien indispensable à l’extension du pouvoir économique de certaines catégories sociales. Ainsi, à rebours de certains arguments contemporains et de ce que prétendaient déjà les économistes libéraux du xixe siècle, la justification de l’emprunt ne réside ni dans le caractère reproductif de la dépense engagée, ni dans l’incapacité pratique de l’impôt à fournir les ressources nécessaires. Sa justification réside bien davantage dans la « législation de l’impôt » elle-même qui permet d’organiser la « pénurie » des ressources fiscales et le déficit public. Jules Leroux pouvait ainsi conclure que si la dette publique s’éternise c’est bien que certaines catégories sociales y trouvent un intérêt pécuniaire qu’il ne faut pas négliger. Ainsi, à l’image de ce que suggèrent les auteurs de l’ouvrage soumis à notre examen, et à rebours d’une conception fataliste et naïve de la dette publique, celle-ci se doit d’être analysée comme dispositif par lequel il devient possible d’étendre son pouvoir économique et de contraindre les choix stratégiques de l’État. La dette publique est certes le résultat de choix politiques en matière de dépenses publiques. Mais elle est au moins autant, de manière symétrique, le résultat de choix de politiques fiscales : renoncer à certains impôts c’est mécaniquement, toute chose égale par ailleurs comme aiment dire les économistes, accepter d’augmenter la dette publique.
En guise de conclusion :
une dette publique controversÉe
Objet d’envergure, la dette publique mérite une analyse fouillée et minutieuse qui ne peut se cantonner à un cri d’alarme eu égard à l’ampleur du capital nominal de la dette et l’augmentation de son rapport avec le produit intérieur brut. Elle est par essence un objet éminemment politique que le chiffre ne saurait résumer. C’est alors ce que s’attèlent à monter Éric Berr, Léo Charles, Arthur Jatteau, Jonathan Marie et Alban Pellegris 347dans le dernier ouvrage publié pour le compte des économistes atterrés. J’ai fait le choix de le présenter avec les lunettes de l’historien des idées, accentuant sans doute, peut-être à l’excès, l’idée des auteurs de faire de la dette publique un objet historique. Si cette discussion entre économistes hétérodoxes contemporains et armées mortes du xixe siècle révèlent quelques lignes de convergences et de ruptures dans la manière de se représenter l’endettement public, elle témoigne aussi forcément de quelques singularités liées notamment à des différences de structures économiques entre le xxie et le xixe siècle, lesquelles ne peuvent que vérifier le caractère temporaire de certains savoirs. Cela n’amenuise en rien, je crois, l’intérêt du recours à l’histoire de la pensée économique pour traiter des grandes questions contemporaines. Pour preuve, cette analyse témoigne du fait qu’aujourd’hui comme hier, la dette publique, ses institutions constitutives et la manière dont l’État s’endette donnent lieu à des interprétations hétérogènes et positions contradictoires instituant de profonds et intéressants débats.
En publiant cet ouvrage, Éric Berr, Léo Charles, Arthur Jatteau, Jonathan Marie et Alban Pellegris prennent part à une controverse – ou à un ensemble de controverses – (Lemieux, 2007) et fournissent des éléments pertinents pour alimenter une position assimilable au sein de la structure triadique de la controverse – deux positions opposées et un tiers juge (le public) – à celle de « dominée ». Dans sa sociologie des controverses, Cyril Lemieux (2006) insiste sur l’importance de traiter égalitairement les différentes positions s’exprimant dans la controverse et ce, malgré « l’asymétrie souvent flagrante des positions ». Cela semble d’autant plus urgent que cette controverse a au xxie siècle ceci de différent avec celle(s) du xixe siècle qu’elle jouit aujourd’hui de multiples espaces de diffusion, notamment les médias de masse qui peuvent s’autoriser à valider l’une des positions permettant alors son appropriation par le plus grand nombre. Il ne s’agit aucunement ici de regretter la publicisation des controverses liées à la dette publique ni le fait qu’elles échappent aux seules sciences économiques, sociales et politique. Mais, parce que le discours sur la dette publique se prétendant scientifique devient moyen d’action politique ou, pour le dire autrement, parce qu’il impulse et légitime certaines politiques qui engagent la collectivité, il s’agit, à l’image de l’initiative des auteurs de l’ouvrage, de produire un contre-discours tout aussi scientifique sur la dette publique, un contre discours que le chercheur se doit de traiter « symétrique en droit » du discours dominant. Et c’est probablement pour 348cette raison que l’ouvrage dont il est ici question doit être lu. S’il est peu évident de parvenir à bousculer les certitudes, l’enjeu demeure important : la sociologie des épreuves explique que le propre des controverses est de produire finalement une transformation du monde social remettant en cause certaines croyances jugées fondamentales et objectives. Et il faut garder à l’esprit que les controverses s’inscrivent dans un contexte, soit qu’elles y prennent racines, soit que leur environnement mouvant contribue à donner aléatoirement plus de force et d’aura à l’une ou l’autre des positions antagonistes. Alors, les choses sont-elles en train de changer ?
La question est de savoir si la crise que nous connaissons contribuera à un changement de « paradigme économique » avec pour élément central notre rapport à l’endettement public. L’affaire tient à bien des égards de la quadrature du cercle. D’abord parce que du côté de la pensée dominante, il est peu probable que les « pas de côté » d’un Jean Tirole qui recommande de « monétiser la dette46 » ou d’un Alain Minc qui suggère de déclarer la dette « perpétuelle47 » suffisent à opérer le grand chambardement. La décision récente de mutualiser les dettes publiques liées à la crise sanitaire ne devrait pas davantage participer d’une grande révolution paradigmatique. Ensuite, et cela est certainement plus original, parce que la controverse semble s’être déplacée au sein même du contre discours sur la dette : les économistes hétérodoxes sont notamment en débat quant à l’opportunité d’annuler les dettes détenues par la Banque centrale européenne48. Alors que les annulationnistes ventent les mérites d’une action indolore, l’ébranlement des dogmes et le retour de marges de manœuvre pour les États en même temps qu’un saut fédéraliste à l’échelle de l’Europe, leurs détracteurs mettent en garde contre une possible réaction des marchés financiers qui pourraient exiger des taux d’intérêt plus importants sur le reste à charge, et des institutions européennes qui pourraient accompagner les annulations de dettes d’injonctions à l’ajustement structurel des économies. 349Aussi font-ils remarquer que réclamer l’annulation d’une partie des dettes sous-entend implicitement que la dette publique est un problème, et cela revient finalement à glisser de l’autre côté, à se rapprocher de la position initialement antagoniste au sein de la controverse. L’annulation des 25 % de dettes publiques détenues par la BCE pourrait ainsi être consentie par certains fanatiques de l’équilibre budgétaire comme moyen de tout remettre à plat et de réactiver le caractère coercitif et disciplinant de la dette publique sur les 75 % restant49. Car annuler 25 % de dettes publiques c’est d’abord, d’une certaine manière, entériner l’idée qu’il y aurait un bon niveau d’endettement public au-delà duquel il n’y aurait plus de salut pour les économies endettées. Par ailleurs, penser que cela se fera sans résistance c’est également sous-estimer l’existence des rapports de force qui, au xxie comme au xixe siècle, caractérisent la dette publique. Mais c’est peut-être aussi se méprendre quant à la hiérarchie des objectifs : la véritable question réside, aujourd’hui comme hier, dans le service de la dette, dans le contrôle des taux d’intérêt que les États servent à leurs créanciers. Et l’annulation d’un quart du volume global de dette détenu par la BCE n’y fera rien50.
Ces questions d’une actualité brûlante quant à l’opportunité de la dette, ses usages et ses appréhensions ont incontestablement traversé l’histoire et en particulier le xixe siècle français. Relire les armées mortes possède alors à coup sûr quelques vertus heuristiques.
350RÉfÉrences bibliographiques
Aglan Alya, Margairaz Michel & Verheyde Philippe (dir.) [2006], 1816 ou la genèse de la Foi publique : la fondation de la Caisse des dépôts et consignations, [ouvrage issu des actes de la journée d’études organisée par le Conseil scientifique et historique de la Caisse des dépôts et consignations, le 15 avril 2005], Genève, Droz.
Baudrillart Henri [1857], Manuel d’économie politique, Paris, Guillaumin & Cie, 4e édition, 1878.
Bavelier Adrien [1886], Des rentes sur l’État français, législation qui les concerne, Paris, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence Arthur Rousseau.
Béraud Alain, Gislain Jean-Jacques & Steiner Philippe [2004], « L’économie politique néo-smithienne en France 1803-1848 », Économies et sociétés, série œconomia, Cahiers de l’ISMÉA, no 34, p. 325-478.
Blanqui Auguste [1838-1839], Cours d’économie industrielle, 2 vol., Paris, Hachette.
Bray (de) E. & Neymarck Alfred [1889], « Dette publique », dans Say Léon & Chailley Joseph, Dictionnaire de finances, t. I, Paris, Berger-Levrault, p. 1418-1468.
Considérant Victor [1838], La conversion c’est l’impôt, Paris, H. Delloye.
Coquelin Charles [1845], « De la conversion des rentes », Revue des Deux Mondes, vol. 10, p. 132-151.
Coste Clément [2016], « Imposer ou créditer. Réformes et révolutions fiscales dans les économies politiques socialiste du premier xixe siècle français », thèse pour le doctorat de sciences économiques, Lyon, université Lyon 3.
Coste Clément [2021], « A trilogy of debt. The emancipatory virtue of public debt in saint-simonian, liberal and socialist discourses in nineteenth century France (1825–1852) », The European Journal of the History of Economic Thought, No 28-1, p. 1-30.
Dockès Pierre & Servet Jean-Michel [1992], « Les lecteurs de l’armée morte : note sur les méthodes en histoire de la pensée économique », Revue européenne des sciences sociales, t. 30, no 92, p. 341-364.
Dupuit Jules, [1860], « Un État qui paye ses dettes s’enrichit-il ? », Journal des économistes, 2e série, t. 26, Paris, Guillaumin.
Dussart Hippolyte, [1845], « La conversion », Journal des économistes, 4e année, t. 11, Paris, Guillaumin, p. 56-58.
Enfantin Barthélémy Prosper [1826], « Du système d’emprunts comparé à celui des impôts », Le Producteur, Journal de l’industrie, des sciences et des beaux-arts, vol. 3, p. 215-252.
351Enfantin Barthélémy Prosper [1831], « Du crédit public », Le Globe, 7, no 15, 15 janvier, p. 57-58.
Faccarello Gilbert [1993], « Introduction », dans A. Béraud & G. Faccarello (dir.), Nouvelle histoire de la pensée économique, vol. 1. Des scolastiques aux classiques. Paris, La Découverte.
Foyot Louis & Reinach (de) Jacques [1894], « Emprunts » dans Say Léon & Chailley Joseph, Dictionnaire de finances, t. II, Paris, Berger-Levrault, p. 55-73.
Garnier Joseph [1848], Éléments de l’économie politique, exposé des notions fondamentales de cette science, 2e édition, Paris, Guillaumin & Cie.
Garnier Joseph [1858], Éléments de finances, suivis de éléments de statistiques…, Paris, Garnier frères et Guillaumin et Cie.
Garnier Joseph [1858], Traité de finances…, Paris, Garnier frères et Guillaumin et Cie, 3e édition, 1872.
Gaudin Martin & Michel Charles [1828], Considérations sur la dette publique de France sur l’emprunt en général et sur l’amortissement, Paris, Les marchés de liberté.
Gaudin Martin & Michel Charles [1833], Un dernier mot sur l’amortissement, Paris, Goetschy fils et compagnie.
Gille Bertrand [1959], La Banque et le crédit en France de 1815 à 1848, Paris, Presses universitaires de France.
Gille Bertrand [1965], Histoire de la Maison Rothschild, tome 1 : Des origines à 1848, Genève, Droz.
Gille Bertrand [1967], Histoire de la Maison Rothschild, tome 2 : 1848-1870, Genève, Droz.
Gille Bertrand [1970], La banque en France au xixe siècle, Genève, Droz.
Girard Léon [1952], La politique des travaux publics sous le Second Empire, Paris, Armand Colin.
Girardin (De) Émile [1858], Questions de mon temps 1836 à 1856. Questions financières, t. 10, Paris, Serrière.
Gorges J.M. [1884], La dette publique : histoire de la rente française, Paris, Guillaumin et Cie.
Graeber David [2013], Dette : 5000 ans d’histoire, Paris, Les liens qui libèrent.
Hautcœur Pierre-Cyrille, [2011], « Les transformations du crédit en France au xixe siècle », Romantisme, no 151, p. 23-38.
Hautcœur Pierre-Cyrille & Gallais-Hamonno Georges [2007], Le marché financier français au xixe siècle, 2 volumes, Paris, Publications de la Sorbonne.
Joubert Alfred [1886], L’amortissement de la dette publique, Paris, Guillaumin et Cie.
Labeyrie Henri [1878], Théorie et histoire de la conversion de rentes ; suivies d’une étude sur la conversion du 5 % français, Paris, Guillaumin et Cie.
352Le Globe [1831], « France : Du crédit public », Le Globe, 7, 15 janvier, p. 57-58.
Lemieux Cyril, « À quoi sert l’analyse des controverses ? », Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, 2007/1, no 25, p. 191-212.
Lemoine Benjamin [2016], L’ordre de la dette. Enquête sur les infortunes de l’État et la prospérité du marché, Paris, La Découverte.
Leroux Jules [1843], « Emprunts », Encyclopédie Nouvelle, t. IV, Genève, Slatkine, p. 753-762, 1991.
Lutfalla Michel [2006a], « Économistes britanniques et français face à la question de l’amortissement d’Isaac Panchaud aux lendemains de la loi de 1816 », dans Aglan A., Margairaz M. & Verheyde P. (dir), op. cit., Genève, Droz, p. 23-42.
Lutfalla Michel [2006b], « De quelques illusions en matière de dette publique. Regard d’un économiste sur le long xixe siècle français », dans Andreau J., Béaur G. & Grenier J.-Y., La dette publique dans l’histoire, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, p. 423-443.
Lutfalla Michel (dir.) [2017], Une histoire de la dette publique en France, Paris, Classiques Garnier.
Marion Marcel [1925-1928], Histoire financière de la France depuis 1775, t. 4 et 5, Paris, A. Rousseau.
Monnet Éric & Levy-Garboua Vivien [2016], « Le taux d’intérêt en France : une perspective historique », Revue d’économie financière, no 121, p. 35-58.
Neymarck Alfred., [1878], Les contribuables et la conversion des rentes, Paris : Guillaumin et Cie.
Pereire Émile [1831a], Examen du budget de 1832 : réformes financières, examen théorique et pratique de l’amortissement, Paris, Au bureau de la Revue Encyclopédique.
Pereire Émile [1831b], « Impôts indirects, amortissement, budget », Le Globe, journal de la doctrine de Saint-Simon, 7, no 298, 25 octobre, p. 1189-1190.
Pereire Isaac [1832], Leçons sur l’industrie et les finances, prononcées à la salle de l’Athénée par Isaac Pereire, suivies d’un projet de banque, Paris, Bureau du Globe.
Pereire Isaac [1876], Questions financières. Le budget de 1877. Réforme de l’impôt par l’emprunt, dégrèvement des impôts, conversion, réduction de l’intérêt, amortissement [2e édition], Paris, Imprimerie C. Motteroz.
Pereire Isaac [1879], Politique financière. La conversion et l’amortissement, Paris, imprimerie C. Motteroz.
Piketty Thomas [2013], Le capital au xxie siècle, Paris, Le Seuil.
Proudhon Pierre-Joseph [1857], Manuel de la spéculation à la Bourse, Paris, Garnier.
Puynode (du) Gustave [1852], « Crédit public », dans Coquelin C. & Guillaumin H. (dir.), op. cit., Paris, Guillaumin, p. 508-523.
353Reinhart Carmen & Rogoff Kenneth [2009], This Time is Different : Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press. En français : Cette fois, c’est différent : huit siècles de folies financières, Pearson.
Rietsch Christian [2007], « Le “Milliard des émigrés” et la création de la rente 3 % » dans Hautcœur P.-C. & Gallais-Hamonno G., op. cit., p. 209-262.
Rossi Pellegrino & PorÉe Armand (ed.), Garnier J. (collab.) [1839], Cours d’économie politique, Paris, Guillaumin et Cie, 4e édition, 1865
Say Jean-Baptiste [1803], Traité d’économie politique, ou simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses, 2 vol., Paris, Crapelet.
Say Jean-Baptiste [1828-1829], Cours complet d’économie politique, 2 vol., Paris, Guillaumin, 2e édition, 1840.
Sismondi Jean-Charles-Léonard Simonde de [1837], Études sur l’économie politique, 2 vol., Bruxelles.
Smith Adam [1776], An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 2 vol., Londres, W. Strahan and T. Cadell.
Stourm René [1888], « Le capital de la dette publique en France », Journal de la société statistique de Paris, tome 29, p. 353-359.
Théret Bruno [1991], « Apogée et déclin du rentier de la dette publique dans le grand xixe siècle libéral (1815-1935) », Économies et sociétés – Cahiers ISMEA, vol. 25, No 1.
Théret Bruno [1992], Régimes économiques de l’ordre politique : esquisse d’une théorie régulationniste des limites de l’État, Paris, Presses universitaires de France.
Tinel Bruno [2016], Dette publique : sortir du catastrophisme, Paris, Raison d’agir.
Tinel Bruno & Van de Velde Franck [2008], « L’épouvantail de la dette », Le Monde diplomatique, Juillet, p. 6-7.
Tiran André (éd.), [1995], Jean-Baptiste Say : manuscrits sur la monnaie, la banque et la finance (1767-1832), Lyon, université Lyon 2.
Vaslin Jacques-Marie [1999], « Le marché des rentes françaises au xixe siècle et la crédibilité financière de l’État », thèse pour le doctorat de sciences économiques, Orléans, université d’Orléans.
Vührer André [1886], Histoire de la dette publique en France, 2 vol., Paris, Berger-Levrault et Cie.
Wray Randall L. & Nersusyan Yeva S. [2011], « Un excès de dette publique handicape-t-il réellement la croissance ? », Revue de l’OFCE, no 116, p. 173-190.
1 Argument développé dans : J.-M. Servet, 2007, « Les illusions des objectifs du Millénaire », in : Lafaye de Michaux, Elsa, Mulot, Éric & Ould-Ahmed, Pépita (éd.), Institutions et développement : La fabrique institutionnelle et politique des trajectoires de développement, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 63-88.
2 Sur l’ensemble de ses sources statistiques, voir : http://piketty.pse.ens.fr/files/AnnexeKIdeologie.pdf (consulté le 08/07/2021).
3 Dans une interview par Isaac Chotiner dans The New Republic, May 6, 2014, intitulée « Thomas Piketty : I Don’t Care for Marx » [https://newrepublic.com/article/117655/thomas-piketty-interview-economist-discusses-his-distaste-marx] (site consulté le 08/07/2021), Thomas Piketty avoue son absence d’intérêt pour l’œuvre de Marx mais aussi manifeste une ignorance de ses écrits. Dans cette interview datant de 2014, « the left’s rock star economist » affirme que « Das Kapital, I think, is very difficult to read and for me it was not very influential » et que « the big difference is that my book is a book about the history of capital. In the books of Marx there’s no data ». L’affirmation d’une absence de « données », autrement dit que Marx ne ferait qu’œuvre théorique, ne peut qu’étonner tout lecteur des abondantes notes du Capital et de ses chroniques pour le New York Daily Tribune entre 1851 et 1861, consultables dans https://www.marxists.org/archive/marx/works/subject/newspapers/new-york-tribune.htm (site consulté le 08/07/2021). À lire Capital et idéologie, on peut douter que Piketty ait cherché à approfondir sa connaissance de l’œuvre de Marx. Pour ce qui est des références à des sources factuelles on peut dire que Marx suit beaucoup plus les traces des économistes des écoles historiques allemandes eux-mêmes héritiers d’économistes du xviiie siècle comme Smith que celles des économistes du xixe siècle déjà beaucoup plus théoriciens.
4 Un résumé synthétique du livre est donné p. 65 à 68.
5 Par exemple, la différence de définition du capital chez Marx et Piketty pourrait faire l’objet d’un compte rendu spécifique en reprenant et en discutant un certain nombre de contributions à ce débat. Nous préférons y renvoyer. Voir notamment : Alain Bihr et Michel Husson, Thomas Piketty, une critique illusoire du capital, Paris, Syllepse, 2020 ; Romaric Godin « Deux économistes s’attaquent aux thèses de Thomas Piketty », www.mediapart.fr, 20 septembre 2020 ; Jean-Marie Harribey, « Le livre d’Alain Bihr et Michel Husson sur ceux de Thomas Piketty : une leçon de socio-économie », Les Possibles, no 25, automne 2020 [https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-25-automne-2020/debats/article/le-livre-d-alain-bihr-et-michel-husson-sur-ceux-de-thomas-piketty-une-lecon-de] ; François Morin, « Le livre de A. Bihr et M. Husson sur T. Piketty – Une critique décisive, mais inaboutie », 14 janvier 2021, www.mediapart.fr ; Éric Toussaint, 2021, « Thomas Piketty et Karl Marx : deux visions totalement différentes du Capital », 9 mars 2021 [www.cadtm.org/Thomas-Piketty-et-Karl-Marx-deux-visions-totalement-differentes-du-Capital] ; Galaad Wilgos interview de « Alain Bihr et Michel Husson : “Pour Piketty, les inégalités sociales sont inévitables” », Marianne, 29/10/2020 [https://www.marianne.net/economie/alain-bihr-et-michel-husson-pour-piketty-les-inegalites-sociales-sont-inevitables]. Tous ces sites ont été consultés le 08/07/2021. Un compte de l’ouvrage de Bihr et Husson par Esther Jeffers doit paraître sur le site d’Attac France [https://france.attac.org/], site consulté le 08/07/2021.
6 Je n’ignore pas les débats auxquels son modèle économique et le traitement des données statistiques ont donné lieu. D’une part ils ont concerné surtout Le capital au xxie siècle. D’autre part les resituer dans l’ensemble de la pensée économique depuis ses origines dépasserait largement l’objet de ce compte rendu et par mes compétences techniques je ne n’aurais apporté aucune originalité tant en les résumant qu’en reproduisant les réponses données par Thomas Piketty, ainsi que les réponses à ses propres réponses.
7 Lorsque l’on lit p. 62 : « Pendant des siècles les multiples sociétés de la planète n’avaient que très peu de liens. Puis les rencontres commencèrent à se développer », phrase digne d’une fable du troc, on peut penser que Thomas Piketty s’est peu documenté sur les sociétés ayant précédé les sociétés antiques et ayant survécu jusqu’à leur quasi extermination récente. Il y a longtemps que les anthropologues et préhistoriens connaissent la circulation à grandes distances de certains produits et techniques. Et de façon récente, il a été possible de montrer que l’ADN de ceux et celles enterrés comme des dominants, par les artefacts que contient leur sépulture, montraient des origines extérieures à leur communauté ; (donc une exogamie beaucoup plus fréquente et forte chez eux que parmi les gens du commun. Une preuve d’inégalités archaïques.
8 Maurice Godelier, 1978, « La part idéelle du réel. Essai sur l’idéologique », L’Homme, no 18, 3-4, p. 155-188.
9 Voir l’exemple de la répartition du gibier chassé dans J.-M. Servet, 2021, « Les origines de la monnaie comme “commun” », Études celtiques, no 46, p. 257-270.
10 J’ai illustré ce regard autre qu’elles peuvent nous apporter dans : J.-M. Servet, 2019, « Les Objections d’Adam Smith à Kandiaronk et leurs limites », Revue du Mauss, Blog David Graeber, 3 décembre 2019, [https://blogs.mediapart.fr/edition/dossier-david-graeber/article/031219/les-objections-dadam-smith-kandiaronk-et-leurs-limites-par-jean-michel-servet], site consulté le 08/07/2021.
11 L’actuelle pandémie joue un rôle fort de révélateur d’inégalités en termes de génération, de sexe et d’habitat, ainsi que l’analyse une étude de l’INED menée en France au printemps 2020 : Anne Lambert et al., 2021, INED, Logement, travail, voisinage et conditions de vie : ce que le confinement a changé pour les Français, INED, Note de synthèse no 10, vague 6. [https://www.ined.fr/fichier/rte/General/ACTUALIT%C3%89S/Covid19/note-synthese-Cocovi-finale.pdf], site consulté le 08/07/2021.
12 Piketty critique Pareto dans une interview : Thomas Piketty, Agnès Labrousse, Matthieu Montalban & Nicolas Da Silva, « Pour une économie politique et historique : autour de Capital et idéologie », Revue de la régulation no 28, Automne 2020 [https://journals.openedition.org/regulation/18316], site consulté le 08/07/2021. J’ai signalé le peu d’empressement de Piketty à citer des auteurs pour lesquels il est dépourvu d’empathie.
13 Lecture, ne l’oublions pas ici, ayant fortement inspiré Marx comme on le voit notamment dans le livre IV du Capital. Sur cette antériorité reconnue par Marx de la découverte des classes sociales avant lui par les classiques, voir sa lettre à Joseph Weydemeyer du 5 mars 1852 [https://www.marxists.org/francais/marx/works/1852/03/km18520305.htm], site consulté le 08/07/2021.
14 Pierre Dockès & Jean-Michel Servet, 1992, « Les lecteurs de l’armée morte : note sur les méthodes en histoire de la pensée économique », Revue européenne des sciences sociales, tome XXX, no 92, p. 341-364.
15 Jean-Joseph-Louis Graslin, Essai analytique sur la richesse et sur l’impôt, où l’on réfute la nouvelle doctrine économique qui a fourni à la Société royale d’agriculture de Limoges les principes d’un programme qu’elle a publié sur l’effet des impôts indirects. Londres, 1767, [réédité en 1911, par Auguste Dubois, chez Paris, Geuthner].
16 Cité par Daniel Roche, La culture des apparences, Paris, Fayard, p. 489, p. 554.
17 Traduit d’abord en 1975 avec pour titre son sous-titre, Les systèmes économiques dans la théorie et dans l’histoire, et republié en français par Michele Cangiani et Jérôme Maucourant en 2017 sous le titre Commerce et marché dans les premiers empires.
18 Eugen Weber, 1983, La fin des terroirs : la modernisation de la France rurale, 1870-1914, Paris, Fayard.
19 Karl Marx, « Débats sur la loi relative au vol de bois », articles parus dans la Rheinische Zeitung entre le 25 octobre et le 3 novembre 1842. Parmi les nombreuses analyses qui en ont été faites, voir celle de Daniel Bensaïd pour une traduction en espagnol, janvier 2007, sur le site de Daniel Bensaïd, « Marx et le vol de bois : du droit coutumier des pauvres au bien commun de l’humanité », [https://www.danielbensaid.org/IMG/pdf/2007_01_03_db_160.pdf], site consulté le 08/07/2021.
20 On peut aussi supposer que Thomas Piketty sous-estime la dimension idéologique et culturelle des techniques. L’usage d’une technique n’est pas socialement neutre, ce qu’a contrario a illustré l’échec de l’Union soviétique et l’abandon des principes égalitaires maoïstes. Capital et idéologie accorde très peu d’importance aux techniques. On lit p. 1102 : « Les explications fondées sur la technologie ou l’économie manque l’essentiel, c’est-à-dire le fait qu’il existe toujours plusieurs façons d’organiser les relations économiques et les rapports de propriété. » Certes des sociétés différentes peuvent utiliser en apparence les mêmes techniques, bien souvent en les adaptant ; mais des changements sociaux profonds passent par une transformation de l’organisation du travail et des techniques utilisées comme l’avait analysé Kostas Axelos, Marx penseur de la technique (Paris, Éd. de Minuit, 1961 à partir de sa thèse de doctorat soutenue en 1959). L’oublier c’est passer à côté d’un autre concept fondateur de l’œuvre de Marx : l’aliénation.
21 Pour comprendre ce que peuvent être ces formes de lutte au quotidien à l’échelon même des communautés paysannes, la lecture de Weapons of the Weak : Everyday forms of Peasant Resistance de James C. Scott (1985) à partir d’un exemple malais contemporain peut être suggestive.
22 Généralement pour expliquer en Grèce antique la fin des royaumes mycéniens les historiens font référence à des invasions venues du Nord. Or, certains archéologues ont remarqué que la fin de ces micro-États coïncidaient certes avec des incendies de palais mais aussi à l’interruption de la construction de canaux d’irrigation visant à accroître la production agricole. Il est donc possible de faire l’hypothèse de possibles révoltes d’une main-d’œuvre asservie.
23 Pierre Dockès, Francis Fukuyama, Marc Guillaume & Peter Sloterdijk, 2009, Jours de colère – L’esprit du capitalisme, Paris, Descartes et Cie.
24 Pierre-Joseph Proudhon, 1840, Qu’est-ce que la propriété. Premier mémoire, p. 78 : « Lorsque vous avez payé toutes les forces individuelles, vous n’avez pas payé la force collective ; par conséquent, il reste toujours un droit de propriété collective que vous n’avez point acquis, et dont vous jouissez injustement » [http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html], site consulté le 08/07/2021. Ce qui constitue « l’aubaine capitaliste ».
25 Pour sa relecture, voir Vincent Laure van Bambeke, 2021, La valeur du travail humain, Paris, L’Harmattan.
26 Pierre Dockès, 2019, Le capitalisme et ses rythmes, quatre siècles en perspective, Tome 2, Splendeurs et misère de la croissance, Paris, Classiques Garnier, p. 1074 sq.
27 Voir certains articles écrits en allemand dans les années 1920 et réunis dans Karl Polanyi, Essais, Paris, Seuil, 2008, textes édités par Michele Cangiani & Jérôme Maucourant.
28 Parmi les multiples travaux consacrés à la lutte des Lip et à leur écho, voir : Nicolas Hatzfeld & Cédric Lomba, 2008, « Unité ouvriers-étudiants : quelles pratiques derrière le mot d’ordre ? Retour sur Besançon en 1968 », Savoir/Agir no 6, p. 41-48 et Yves Krumenacker & Jean-François Cullafroz (dir.), CFDT 1968-2018. Transformer le travail, Transformer la société ? Des luttes autogestionnaires au réformisme, Lyon, Chronique sociale, 2018.
29 L’analyse en a été faite par Wilhelm Reich dans Psychologie de masse du fascisme (ouvrage rédigé entre 1930 et 1933).
30 Michael Hudson, 2021, Dette, rente et prédation néolibérale, Textes choisis et traduits par M. Thibault et Ch. Petit, Lormont, Le bord de l’eau.
31 La question de l’héritage a été peu abordée en histoire de la pensée économique, voir : Philippe Steiner, 2008, « L’héritage au xixe siècle en France. Loi, intérêt de sentiment et intérêts économiques », Revue économique, 2008/1, vol. 59, p. 75-97 et Gilles Jacoud, 2014, « Droit de propriété et économie politique dans l’analyse saint-simonienne, Revue économique, 2014/2, vol. 65, p. 299-315.
32 En ce sens voir, J.-M. Servet, 2021, « La science économique peut-elle survivre à la crise actuelle ? À propos de Pierre Dockès, Splendeurs et misère de la croissance, Classiques Garnier » La Vie des idées, 8 janvier 2021 [https://laviedesidees.fr/La-science-economique-peut-elle-survivre-a-la-crise-actuelle.html], site consulté le 08/07/2021.
33 Je remercie tout particulièrement Pierre Dockès, Bernard Drevon, Solène Morvant-Roux, Marlyse Pouchol et André Tiran pour les échanges que nous avons eus au cours de la rédaction de cette note de lecture.
34 La distinction stock/flux, l’appréhension des comptes courants et des comptes de patrimoines des administrations publiques sont, entre autres, nécessaires pour comprendre ce dont il est question lorsque l’on aborde la question de la dette publique.
35 Si la Monarchie de Juillet a plusieurs fois tenter de revenir sur ces avantages, les ministres des Finances (le baron Louis ainsi que Georges Humann) jugeaient qu’une telle disposition contreviendrait aux engagements pris par l’État d’immuniser ses créanciers – on note simplement quelques aménagements à la marge en 1836 et 1850.
36 La rente 5 % cote environ 75 francs en janvier 1815. Elle dépasse 120 francs en janvier 1844.
37 D’environ 8,4 % en 1815 le taux d’intérêt de long terme tombe à 4 % en 1852 (Monnet & Levy-Garboua, 2016).
38 345 451 517 francs sur un total de 1 097 708 012 francs de dépenses.
39 Le procédé peut être assimilé au remboursement d’un vieil emprunt émis au moyen de rentes 5 % pour contracter une nouvelle dette auprès des mêmes créanciers au moyen de rentes immédiatement inférieures.
40 Cette conception est partagée par le célèbre banquier Laffitte proche de certains saint-simoniens : « l’impôt est aveugle, il n’examine pas si le déplacement des capitaux est nuisible ou non. L’emprunt au contraire n’ordonne rien, ne reçoit que des capitaux qui viennent d’eux-mêmes s’offrir, ne dérange aucune combinaison en absorbant des capitaux oisifs et crée enfin un revenu qui n’existait pas et qui devient une double ressource pour les particuliers et l’État en augmentant les capitaux en circulation et le travail général » (Laffitte, 1932 ; Lutfalla, 2006b).
41 Cf. infra.
42 « Étrange ressource cependant qu’une dette ; et que de gens riches à ce compte manqueraient de pain ! » (Puynode, 1852, p. 511).
43 Louis Wolowski relativisait également l’argument du fardeau légué aux générations futures. Selon lui, ces dernières sont solidaires des générations qui les précèdent et elles préfèrent hériter d’un capital nominal de dette important relié à des charges d’intérêt faibles, plutôt que d’une dette faible arrimée à une charge annuelle plus lourde.
44 On trouvait déjà cette idée chez Montesquieu : « On ôte les revenus véritables de l’État à ceux qui ont de l’activité et de l’industrie, pour les transporter aux gens oisifs ; c’est-à-dire qu’on donne des commodités pour travailler à ceux qui ne travaillent point, et des difficultés pour travailler à ceux qui travaillent. (Montesquieu, De l’esprit des lois, livre XXII, chapitre xvii). Les saint-simoniens dénonçaient d’autant plus cette charge supportée par les contribuables que l’activité de la caisse d’amortissement contribue selon eux à augmenter le cours des rentes et donc à accroître le volume des ressources nécessaires à leur rachat (Enfantin, 1831).
45 Bruno Théret a démontré l’importance du personnage du rentier de l’État dans le paysage économique et social du xixe siècle français (Théret, 1991).
46 « Jean Tirole : quatre scénarios pour payer la facture de la crise », Les Échos, le 1 avr. 2020 (https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/jean-tirole-quatre-scenarios-pour-payer-la-facture-de-la-crise-1191019), site consulté le 08/07/2021.
47 « Alain Minc : pour une dette publique à perpétuité ! », Les Échos, 16 avr. 2020 (https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/alain-minc-pour-une-dette-publique-a-perpetuite-1195545), site consulté le 08/07/2021.
48 On pourra se référer à deux tribunes publiées par le journal Le Monde : « L’annulation des dettes publiques que la BCE détient constituerait un premier signal fort de la reconquête par l’Europe de son destin », le 5 février 2021 ; et « D’autres solutions que l’annulation de la dette existent pour garantir un financement stable et pérenne », le 27 février 2021.
49 La banqueroute des deux tiers de la dette publique de 1787 a pour longtemps fragilisé le crédit de l’État qui n’a pu être retrouvé qu’au moyen d’institutions et dispositifs techniques et fiscaux susceptibles de convaincre les futurs créanciers de l’État de lui apporter leur soutien en leur garantissant quelques privilèges.
50 Sur toutes ces questions se référer à l’article de Renaud Lambert dans le no 807 du Monde Diplomatique, de juin 2021, « L’annuler ou ne pas l’annuler ? Quand la dette fissure la gauche française », p. 22-23.