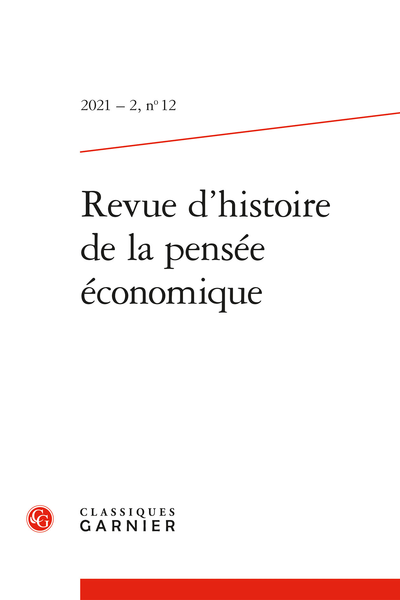
Note liminaire
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Revue d’histoire de la pensée économique
2021 – 2, n° 12. varia - Pages : 17 à 18
- Revue : Revue d’histoire de la pensée économique
- Thème CLIL : 3340 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Histoire économique
- EAN : 9782406126157
- ISBN : 978-2-406-12615-7
- ISSN : 2495-8670
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12615-7.p.0017
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 08/12/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Note liminaire
Ce numéro 12 de la Revue d’histoire de la pensée économique est dédié à une question d’importance : comment rendre compte en français de la pensée d’un auteur qui publie en anglais (ou dans toute autre langue), bref l’enjeu est la traduction. La difficulté n’est pas neuve, elle hante les économistes, les diverses sciences sociales ainsi que les littéraires1.
Deux solutions sont souvent mises en œuvre.
La première, la plus simple, semble-t-il, est de ne pas traduire. Lisez l’auteur dans sa propre langue, citez-le si le besoin s’en fait sentir mais toujours en sa propre langue. Pour nombre d’économistes contemporains, citer l’auteur dans sa propre langue, est devenu une pratique commune. Comme nous sommes dans l’ère de la domination linguistique de l’anglais (de Grande-Bretagne ou d’Amérique) tout économiste un tant soit peu distingué cite l’auteur anglais en anglais (même s’il existe une traduction en français). Si l’auteur, un ancien Grec, un Allemand, un Chinois ou bien un Arabe est traduit en anglais, par une sorte d’entraînement, la citation se fait en anglais, non en grec ancien, en allemand, en mandarin, en arabe.
L’autre solution est de traduire. Elle n’est pas aussi simple que la première mais, nous semble-t-il, plus robuste. Le traducteur mène un dialogue. Avec le texte, cela va de soi. Il doit s’approprier mot à mot, phrase par phrase, chapitre par chapitre, tout l’ouvrage, car un mot ne prend pleinement son sens particulier, ne devient un concept structurant le raisonnement, qu’accompagné des autres mots. La polysémie est là, telle une gargouille, prête à déverser sur le traducteur trop pressé faux-sens et contresens.
Parfois, le traducteur noue au cours même de sa traduction un dialogue avec l’auteur. Ce n’est pas fréquent, mais lorsqu’il s’instaure, le texte 18traduit devient dans une très large mesure un texte de l’auteur dans la langue d’arrivée.
Une traduction est toujours marquée d’une certaine asymétrie. Le texte de départ reste figé dans sa langue, par contre la traduction ne peut pas l’être. Tout se met en œuvre pour que cela ne soit pas. Si l’ouvrage traduit est une œuvre majeure, il induit des modifications dans la langue d’arrivée en suscitant l’apparition de concepts nouveaux. De plus, toute langue est un produit social, elle change nécessairement avec les structures sociales et ces structures sont tout, sauf figées. Les conséquences sont connues : une traduction se doit d’être remise à l’ordre du jour de temps en temps.
Le dossier « La Théorie générale de J.M. Keynes : une traduction française révélatrice » que publie la Revue s’inscrit dans ce schéma. C’est l’histoire de la traduction de The General Theory of Employment, Interest and Money de John Maynard Keynes par Jean de Largentaye. Ce fut l’histoire d’un dialogue épistolaire remarquable entre l’auteur et le traducteur. Trente-huit lettres inédites à ce jour ont été regroupées, analysées et publiées par la famille du traducteur, Hélène et Armand de Largentaye, accompagnées d’une mise en situation, d’une biographie du traducteur, d’une analyse des modalités de cette traduction et de ses premiers effets.
L’ouvrage de Keynes n’était pas neutre et ne l’est toujours pas.
Il incita à de nouvelles mesures de politique économique. Au niveau international, ce fut la Conférence de Bretton Woods où ses idées durent plier devant le rapport de forces monétaire. En France, les thèses de Keynes donnèrent lieu à des ouvrages et suscitèrent un débat entre un homme politique, Pierre Mendès France, et un haut-fonctionnaire, Gabriel Ardant, intime de Jean de Largentaye, sur la possibilité de politiques économiques alternatives. Ce ne fut pas un débat de circonstance. Il se poursuivit à vingt ans de distance, de 1954 à 1973. En complément de l’analyse de la traduction de The General Theory, la Revue a souhaité publier « Action économique et lucidité politique. L’Économie en République chez Gabriel Ardant et Pierre Mendès France » de Ludovic Frobert.
Le Comité éditorial
1 L’association des professeurs de langues vivantes (concernés, s’il en est, par l’enseignement des langues et du coup par les questions liées aux traductions), dédia deux numéros de suite (No 1-2, 2016) de sa revue, Les langues modernes, aux « Approches pratiques de la traduction ».