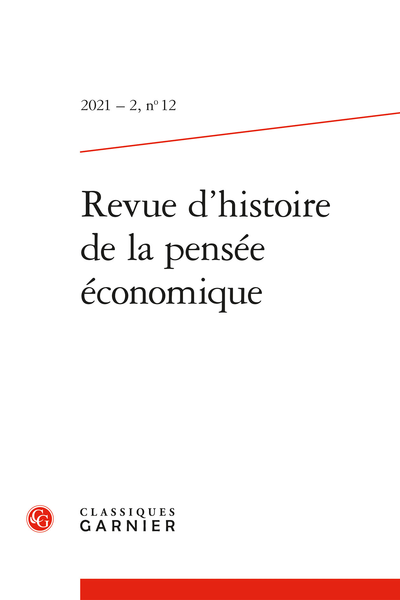
Jean de Largentaye, l’ardent traducteur de The General Theory
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Revue d’histoire de la pensée économique
2021 – 2, n° 12. varia - Auteur : Largentaye (Armand de)
- Résumé : La traduction française de The General Theory de J.M. Keynes fut l’œuvre spontanée de Jean de Largentaye, jeune inspecteur des Finances, qui lui-même avait connu le chômage. Sa liberté d’esprit lui fit immédiatement apprécier le caractère salutaire de l’ouvrage pour les démocraties en crise. Comme Keynes, Largentaye était attaché aux libertés individuelles. Il embrassa l’analyse du rôle de la monnaie fiduciaire et comprit que la libre circulation des capitaux contraignait les politiques de l’emploi.
- Pages : 33 à 55
- Revue : Revue d’histoire de la pensée économique
- Thème CLIL : 3340 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Histoire économique
- EAN : 9782406126157
- ISBN : 978-2-406-12615-7
- ISSN : 2495-8670
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12615-7.p.0033
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 08/12/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : Largentaye, traduction française, Keynes, The General Theory, Fizaine
Jean de Largentaye, l’Ardent TRADUCTEUR de The General Theory
Armand de Largentaye
La composition de cet ouvrage a été pour l’auteur un long effort d’évasion, une lutte pour échapper aux formes habituelles de pensée et d’expression ; et la plupart des lecteurs devront s’imposer un effort analogue pour que l’auteur parvienne à les convaincre […] La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles, elle est d’échapper aux idées anciennes qui ont poussé leurs ramifications dans tous les recoins de l’esprit des personnes…
Préface de la première édition anglaise, décembre 1935, Keynes, [1942] 2017, p. 24.
Le point de départ de l’analyse des circonstances qui vont nourrir le désir de Jean de Largentaye de traduire The General Theory of Employment, Interest and Money de J.M. Keynes est le mot « éblouissement » qu’employait le traducteur pour décrire à ses proches l’impression que produisit chez lui la découverte de The General Theory. Quel est donc ce bouleversement intellectuel et moral ? Comment s’explique cette brusque révélation, entraînant chez le jeune inspecteur des Finances le zèle du nouveau converti ?
Publiée en février 1936, The General Theory lui fut signalée par un camarade polytechnicien alors qu’il s’efforçait en 1937, au Mouvement 34général des fonds (devenu la direction du Trésor et des entreprises au ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance), d’apporter des éléments de réponse au ministre des Finances, Vincent Auriol. Celui-ci avait été interpellé par Gaston Bergery, député du Front populaire, qui faisait valoir que la France souffrait « d’asphyxie monétaire ». The General Theory lui permit de comprendre pourquoi l’analyse statistique de cette question, telle qu’on la pratiquait jusque-là, n’était pas satisfaisante.
Dès lors, le bouleversement que produit The General Theory dans l’esprit du jeune inspecteur des Finances est tel que celui-ci se mettra, pendant tout le reste de l’année 1937, à analyser, décrypter, diffuser le produit de ses études au ministère des Finances. En janvier 1938, Jean de Largentaye décidera de proposer à Keynes, qu’il ne connaît pas, de traduire son ouvrage de 400 pages. Il faut donc apprécier, dans le présent article, l’ampleur et la nature de l’illumination que connaît le candidat traducteur.
Jean de Largentaye trouve dans l’ouvrage de Keynes non seulement la réponse aux affirmations de Gaston Bergery mais aussi la clef du dilemme qui empoisonne la vie politique en France et le tourmente personnellement dans ses interrogations morales et politiques. La première partie du présent article expliquera l’évolution intellectuelle de Jean de Largentaye, issu d’un milieu aristocratique fortuné, monarchiste et hostile à la République. Dans l’exercice de ses fonctions, Jean de Largentaye est lui-même témoin et même victime de ce dilemme – cette difficulté à concilier démocratie, équité sociale et plein emploi – que la IIIe République française, pour son malheur, se montre incapable de surmonter.
La deuxième partie décrira le contexte factuel débouchant sur deux notes révélatrices qui ont précédé et sans doute stimulé son désir de traduire The General Theory.
La troisième partie rappellera les cadres du raisonnement économique qui guidaient l’action politique. Ces cadres, qui reposaient sur le postulat libéral de la libre circulation des capitaux associé à la théorie de l’étalon-or, s’imposaient aux milieux d’affaires, à la classe politique et à la haute fonction publique.
Tandis que la France élit en 1932 une Chambre des députés à gauche mais prisonnière de ses dogmes et d’une politique de déflation contraire à sa couleur politique, à l’étranger le dilemme est résolu dès 1933. En 35Allemagne, à la faveur de la crise, le parti nazi devient le plus grand parti politique aux élections de 1932, et accède au pouvoir en 1933. Aux États-Unis, le pouvoir bascule à gauche, aux mains de Franklin Delano Roosevelt, homme politique à la fois iconoclaste et pragmatique, élu président le 8 novembre 1932.
La Théorie générale constituera pour Jean de Largentaye, ce fils de famille exceptionnellement diplômé, la clef qui donnera accès à une pensée économique et philosophique progressiste, à la fois réaliste et cohérente. Les convictions acquises en cette période critique – les années 1930 – seront celles dont il ne s’écartera plus.
I. PREMIERS PAS
Le milieu social monarchiste de Jean de Largentaye reflète les tensions politiques qui persistent et empoisonnent la IIIe République depuis sa naissance. Jean de Largentaye est né en 1903, dernier des trois enfants de Jacques Rioust de Largentaye (1863-1946) et de Marguerite de Langle (1872-1947), grands propriétaires fonciers en Bretagne. L’aïeul des Largentaye, Jacques Rioust des Villes-Audrains, s’était illustré en 1758 dans un épisode breton de la guerre de Sept Ans, ce qui avait valu à son fils d’être anobli sous la Restauration en 1816 en relevant le nom de son épouse Agathe Éléonore Lesquen de Largentaye. En 1830, le confortable château de Largentaye, fief de la famille, dans la commune de Saint-Lormel, démembrement de celle de Pluduno, près de Plancoët (Côtes d’Armor), sera agrandi et mis au goût du jour.
Au xixe siècle, les aînés des générations successives sont députés monarchistes des Côtes du Nord, jusqu’à Frédéric, frère aîné de Jacques Rioust de Largentaye. Député de 1883 à 1910, Frédéric Rioust de Largentaye était royaliste légitimiste, antidreyfusard, et siégeait avec l’Union des droites.
Jean de Largentaye restera toute sa vie attaché à sa famille et à son milieu social, ce qui n’empêchera pas une liberté d’esprit qui lui fit, dès la sortie de l’École polytechnique (1923), refuser la carrière militaire à laquelle ses parents le destinaient. Il découvre sans doute la liberté de 36sa vie d’étudiant et de jeune diplômé avec d’autant plus d’enthousiasme que sa vie scolaire s’est déroulée entièrement en pension religieuse à St-Brieuc, à Jersey et à Versailles, notamment chez les jésuites. Ceux-ci, en voulant l’orienter contre son gré vers des études littéraires, ne s’en firent pas un ami et lui inspirèrent une certaine ingratitude nourrissant un esprit laïque bien marqué.
Jean de Largentaye n’a pas laissé beaucoup de traces de sa vie des années 1920-1930. On sait qu’il mit un certain temps pour prendre ses distances par rapport à l’idéologie politique qui l’entourait. Pourtant, son mépris pour la guerre et son antimilitarisme durent tôt le mettre en porte-à-faux par rapport à son milieu familial.
Il rencontre Louise Bernheim, jeune mère de famille, épouse d’Henri Dimier, proche de l’Action française en 1927. Le caractère affirmé de Louise ne cache pas son origine juive. Le ménage Dimier-Bernheim ne tarde pas à se déchirer. Louise divorcera et épousera en 1936 Gabriel Ardant, proche collègue de Jean de Largentaye à l’Inspection des Finances.
Licencié d’Air Liquide le 30 septembre 1929 après moins de quatre ans d’emploi dans les Asturies (Espagne), Jean de Largentaye subit une période pénible de chômage en vivant d’expédients à Paris. Il décide de suivre la suggestion de son ami Henry Bizot, inspecteur des Finances (concours 1925), et décide de préparer le concours de l’Inspection.
On peut penser que c’est à l’époque où Jean de Largentaye prépare le concours de l’Inspection (1930) et où il rencontre Louise Bernheim et Gabriel Ardant, qu’il prend définitivement ses distances par rapport à l’idéologie monarchiste, antirépublicaine et antidreyfusarde de son milieu social. Cette évolution est essentiellement intellectuelle car, comme on l’a dit, Jean de Largentaye reste attaché à ses relations de jeunesse, notamment familiales. Cependant, ses convictions profondes lui font considérer les libertés individuelles et leur épanouissement comme les valeurs suprêmes de sa philosophie politique, et le chômage comme l’obstacle majeur.
Dans l’hommage qu’il prononce en 1970 à l’Inspection des Finances, Gabriel Ardant décrit son ami comme suit :
Jean de Largentaye possédait à un degré éminent trois qualités – d’ailleurs voisines : le non-conformisme, la lucidité, la rigueur […] Lorsque surgit la grande crise de 1929 et son prolongement en France, il se refusa à considérer que les analyses classiques, orthodoxes, celles des bien-pensants du Ministère 37des Finances, étaient valables parce que les autorités consacrées les maintenaient envers et contre tous les démentis prodigués par les faits. Il comprit que cette gigantesque inutilisation des hommes et des machines ne pouvait provenir des seules exigences syndicales et qu’il ne fallait pas hésiter à remettre en cause toutes les thèses sur lesquelles reposaient la doctrine économique et la politique financière. Il fallait s’attaquer au mécanisme même des échanges, au système monétaire.
II. Les notes de 1937 et 1938 et leur contexte
Jean de Largentaye découvre The General Theory en mai 1937 à l’occasion de la réponse écrite à l’interpellation de Gaston Bergery à la Chambre des députés (voir infra, Note pour le ministre). Une autre note (voir infra, Note pour le sous-directeur), qu’il signera le 26 mars 1938, analyse le financement des dépenses extraordinaires de l’Allemagne et répond à l’interrogation des autorités du Front populaire au moment de l’Anschluss (12 mars 1938). Les dirigeants du Front populaire se demandaient alors comment l’Allemagne parvenait à relancer l’économie « sans une tonne d’or dans ses réserves » (infra, dans le même article). Voyons comment ces deux notes éclairent la découverte « éblouissante » de The General Theory.
II.1. Inspirations initiales
À l’Inspection, Jean de Largentaye se familiarise avec les mécanismes monétaires dans l’ouvrage de Hartley Withers, The Meaning of Money (1909), qui explique les mécanismes de la monnaie de crédit, fondée sur la seule confiance qu’inspirent les banques, et les techniques requises pour entretenir le leurre de la solidité du système. La réputation de l’ouvrage est fondée sur sa démonstration, devenue un adage, que « les crédits font les dépôts » (loans make deposits).
L’ouvrage explique la nature de la monnaie de crédit comme un endettement réciproque. Lorsqu’un crédit est signé, l’emprunteur s’endette auprès de la banque mais celle-ci, en s’engageant à honorer les tirages de l’emprunteur, contracte aussi une dette envers celui-ci. La monnaie de crédit représente donc bien un échange de dettes entre l’emprunteur et la banque. Elle est créée sans être adossée à la moindre ressource de 38valeur. Elle est simplement le signe d’une dette, résultant du contrat d’endettement mutuel décrit par Withers. Pour circuler, pour être accepté en guise de paiement par les porteurs, ce signe doit porter la reconnaissance de l’autorité de la banque et afficher sa réputation de solidité.
En 1933, Jean de Largentaye prend connaissance de Crise et monnaie de Louis Fizaine (Fizaine, 1933). Dans cet ouvrage, l’auteur propose, au lieu de gager la monnaie uniquement sur l’or, métal précieux de production limitée, de prendre comme terme de comparaison la valeur d’un ensemble de marchandises, en choisissant celles-ci en assez grand nombre pour obtenir une compensation et un amortissement des fluctuations inévitables de leurs valeurs.
Louis Fizaine n’a guère laissé de traces à part ses écrits. Il devait être d’une génération à peine plus âgée que celle de Jean de Largentaye. Dans les années 1930, Fizaine jouit d’une certaine notoriété et correspond avec de nombreuses personnalités internationales, notamment James P. Warburg, banquier américain et conseiller du président Roosevelt, fils de Paul Warburg, promoteur en 1907 de la Réserve Fédérale américaine. Fizaine multiplie les conférences dans les années 1930, y compris avec des personnalités politiques comme Paul Reynaud et François de Menthon. Il est cité dans la presse française et étrangère, notamment dans le New York Herald.
Fizaine observe que l’or n’a pas les qualités d’un bon étalon monétaire principalement parce qu’il ne peut pas être produit rapidement en grande quantité (sa production n’est pas « élastique »). C’est pourquoi il préconise un étalon comprenant un panier de plusieurs métaux répondant aux exigences d’une marchandise monétaire, l’idéal étant de disposer d’un étalon monétaire qui soit le reflet de la production du pays.
Cette « monnaie complexe », selon Louis Fizaine, aurait le pouvoir de réguler l’économie automatiquement. En situation de baisse des prix, le secteur des marchandises monétaires serait stimulé par le prix garanti de la banque d’émission. « L’inflation », selon l’expression de Fizaine, c’est-à-dire l’émission monétaire générée par l’achat des marchandises monétaires, créerait le pouvoir d’achat qui stimulerait le reste de l’économie. À l’inverse, en période de prospérité, « l’inflation » (l’émission ayant accru la circulation monétaire) aurait tendance à faire monter les prix et les coûts de la production des marchandises monétaires. L’industrie fabriquant ces marchandises serait ainsi découragée, puisque 39son débouché resterait bloqué au prix immuable fixé par la banque d’émission. L’économie consommerait alors les stocks de marchandises monétaires accumulés à la banque d’émission en remettant à celle-ci la monnaie en circulation, dont la quantité serait ainsi progressivement réduite.
Les idées de Louis Fizaine séduiront durablement Jean de Largentaye, au-delà de la traduction de The General Theory. Elles influenceront les écrits de ce dernier trente ans plus tard et seront au cœur de sa critique de la Théorie générale, telle qu’il la formulera dans la seconde note du traducteur, rédigée à l’occasion de la réédition de la Théorie générale en 1968. Mais pour ce qui concerne le sujet de cet article, on retient simplement l’intérêt précoce de Jean de Largentaye pour les questions monétaires.
Les années 1932-1934 sont chargées d’événements politiques. Après la dévaluation de la livre sterling en septembre 1931, la crise économique internationale atteint la France. En mai 1932, les élections législatives sont remportées par la gauche mais le « deuxième Cartel » (référence au Cartel des gauches au pouvoir après les élections législatives de 1924) a pour seule politique économique la « déflation » qui, pourtant, se révèle partout inefficace.
En Allemagne, où les effets de la crise économique mondiale sont brutaux, cette politique, appliquée par le chancelier catholique Heinrich Brüning, favorise la montée des extrémismes, notamment celle du parti nazi NSDAP (Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Son dirigeant Adolf Hitler est appelé à la chancellerie par le président von Hindenburg en janvier 1933.
D’août 1935 à juin 1936, Jean de Largentaye est chargé de mission au cabinet de Marcel Régnier, le ministre des Finances de la déflation du gouvernement de Pierre Laval. Il est aux premières loges de l’action politique avant de rejoindre le Mouvement général des fonds.
Pour les élections législatives de 1936, les partis de gauche, après l’alerte du 6 février 1934 (coup de force manqué des anciens combattants et des milieux royalistes et conservateurs sur le régime parlementaire), décident de se coordonner, notamment en matière de désistements. Malgré l’agression dont est victime Léon Blum le 17 février 1936 et qui le met hors d’état de faire campagne, le scrutin des 26 avril et 3 mai 1936 donne la majorité au Front populaire : 369 sur 610 sièges, avec 149 socialistes, 110 radicaux, 72 communistes et 38 divers gauche. Ce 40résultat est obtenu sans basculement important de l’électorat et grâce à la seule discipline des désistements.
II.2. La Note du 27 mai 1937 sur « l’asphyxie monÉtaire »
En mai 1937, Vincent Auriol, ministre des Finances, demande au Mouvement général des fonds de préparer une réponse à l’interpellation du 7 mai de Gaston Bergery à la Chambre des députés, évoquant, selon ses termes, « l’asphyxie monétaire » de la France. Gaston Bergery est assez représentatif d’une pensée sociale frustrée en France. Éminente personnalité de la gauche, classé parmi les « jeunes turcs » du parti Radical, il a été directeur de cabinet d’Édouard Herriot, président du conseil en 1924-1925. Il a participé avec son ministre et Vincent Auriol, président de la Commission des Finances de la Chambre des députés, à la négociation de la mise en place du plan Dawes sur le financement des réparations de la guerre. Bergery reproche aux gouvernements de gauche leur capitulation devant les puissances d’argent.
Élu en 1936 comme représentant du Parti frontiste qu’il a fondé, Gaston Bergery soutiendra le Front populaire mais, désenchanté par celui-ci, son discours intégrera peu à peu les thèmes d’autorité et de Révolution nationale, avec un relent perceptible d’antisémitisme. Le 10 juillet 1940 il votera les pleins pouvoirs au maréchal Pétain.
En mai 1937, Vincent Auriol veut répondre en démontrant que le gouvernement n’est nullement soumis au contrôle de l’émission monétaire par le « mur d’argent », comme l’insinue le député frontiste. Il demande donc au Mouvement général des fonds de lui dire si la quantité de monnaie est inférieure à ce qu’elle était dans les périodes antérieures. La rédaction de la réponse est confiée au jeune chargé de mission Jean de Largentaye. La réponse, datée du 27 mai 1937 est signée de Jacques Rueff, directeur du Mouvement général des fonds, sans mention de son rédacteur (voir infra, Note pour le ministre).
Celle-ci comporte deux parties. La première, sur une base statistique, conclut à la réponse négative, voulue par le ministre : la France ne manque pas de monnaie. Mais la seconde partie indique qu’un problème demeure. En effet, si l’insuffisance de la quantité de monnaie pour les besoins de la production courante n’est pas avérée, pour autant l’asphyxie se manifeste quand même par un manque d’une autre nature. 41Ce manque témoigne de la demande insuffisante de crédits, elle-même due à l’insuffisance de débouchés pour les entreprises.
Selon ce qu’il a indiqué à ses proches, Jean de Largentaye a rédigé la « Note pour le ministre » sous l’influence de The General Theory, que son camarade polytechnicien Stéphane Leven lui a signalée et qui lui a permis de trouver la bonne conclusion. Le délai de la rédaction est pourtant court ; le ministre devait être pressé ! Mais le fait que la Note se trouve en plusieurs exemplaires dans les papiers de Jean de Largentaye confirme le fait qu’elle a été rédigée par lui. Pourtant, même dans sa deuxième partie, la Note ne paraît pas d’inspiration keynésienne. La théorie classique ne considère-t-elle pas que la quantité de monnaie est déterminée, dans son offre comme dans sa demande, par l’activité économique ? Aujourd’hui on dirait que l’évolution de la quantité de monnaie est « endogène ». Sous la signature de Jacques Rueff, son supérieur hiérarchique qui deviendra son adversaire idéologique, Jean de Largentaye devait avancer masqué.
Sous-jacente à la demande de crédits, il faut sans doute deviner la référence à l’incitation à investir, titre du livre IV de The General Theory. En effet, la Note observe en conclusion que, « dans le système économique de forme capitaliste fondé sur la liberté de produire et d’acheter », l’espoir de réaliser des bénéfices est affaibli. Dans ces conditions, « il importe avant tout de le restaurer ».
Or, le chapitre xi, « L’efficacité marginale du capital », premier chapitre du livre IV, évoque dans ses premières lignes « la série de revenus escomptés qu’il (l’entrepreneur ou le financier qui investit) espère tirer pendant la durée de ce capital de la vente de sa production ». Le chapitre xi est celui par lequel Jean de Largentaye commencera la traduction de The General Theory. Il importe de le souligner ici.
Par ailleurs, il est vraisemblable qu’à l’occasion de la rédaction de cette note, Jean de Largentaye ait pris connaissance du chapitre xxi « La théorie des prix ». Ce chapitre analyse le concept de l’inflation, terme aux acceptions différentes mais qui, à l’époque – on l’a vu chez Fizaine –, signifiait le plus souvent émission monétaire, c’est-à-dire l’exact inverse de « l’asphyxie monétaire » de Bergery.
Écartant la théorie quantitative de la monnaie, le chapitre xxi de The General Theory montre la complexité de la relation entre l’émission monétaire et ses effets sur les prix et la production, ce qu’évoquait 42jusque-là imparfaitement la notion d’inflation. Keynes considère que « l’inflation véritable » se manifeste en situation de plein emploi exclusivement par la hausse des prix dès lors que la production ne peut plus augmenter sinon au rythme lent des gains de productivité. Jean de Largentaye reviendra sur ces questions dans sa note du 26 mars 1938, examinée plus loin.
La dernière phrase de la Note du 27 mai 1937 sur l’asphyxie monétaire, « Certaines réformes juridiques et fiscales et même monétaires pourraient y contribuer utilement » (c’est-à-dire contribuer utilement à restaurer l’espoir des investisseurs de réaliser des bénéfices), annonce le programme de relance qui sera préparé quelques mois plus tard dans le second et éphémère gouvernement Blum (13 mars 1938 – 8 avril 1938). Une annotation manuscrite en marge de la Note (certainement du signataire Jacques Rueff) demande, à propos des réformes : « Lesquelles dans les circonstances présentes » ? Parmi les réformes à préconiser, il y aurait certainement eu l’établissement d’un contrôle des changes, hérésie pour les adeptes de l’étalon-or, dont fait partie Jacques Rueff, mais non pour Gaston Bergery. Le programme économique du second gouvernement Blum prévoira les mesures de protection de la monnaie qu’on peut lire dans l’exposé des motifs :
Il est indispensable aujourd’hui d’établir un système monétaire qui arrête les sorties d’or et empêche que l’octroi de crédits nouveaux n’aboutisse à faciliter l’évasion des capitaux […]
Il est indispensable que les banques françaises s’astreignent au même effort de discipline (que les banques anglaises et américaines).
La Banque de France centralisera les opérations sur devises.
Elle demandera communication des pièces justifiant les besoins de change et s’assurera de leur valeur (Mendès France, 1984).
Gaston Cusin (1903-1993), à l’époque sous-chef de cabinet du ministre Auriol, racontera quelques décennies plus tard, dans un colloque consacré à Léon Blum :
La première personne qui se soit préoccupée de lire Keynes, en dehors de Georges Boris, était mon ami Jean Saltes, alors sous-directeur du Mouvement des fonds. À ses instants de loisir, il diffusait la traduction du livre de Keynes faite par un de ses amis de l’Inspection, M. de Largentaye. Il nous passait les bonnes feuilles au fur et à mesure qu’elles sortaient (Renouvin & Rémond, 1967).
43La découverte de The General Theory par Jean de Largentaye et sa lecture par Georges Boris, le conseiller économique de Léon Blum considéré comme l’un de ses premiers lecteurs en France, sont presque simultanées, puisque Georges Boris a indiqué qu’il avait lu l’ouvrage pendant l’été 1937, sans doute après la mise en minorité de Léon Blum par le Sénat le 21 juin. Mobilisé auprès de Blum pour la préparation des élections du Front populaire en 1936, Boris a certainement manqué de temps auparavant. Les notes de Jean de Largentaye lui parviendront peut-être dans la deuxième moitié de 1937 mais les convictions de Boris sont formées depuis une dizaine d’années et il est familier des écrits de Keynes. Il est un des économistes français les plus talentueux parmi ceux qui s’écartent de l’orthodoxie dominante. Dans son hebdomadaire, La Lumière (fondé en 1927), Georges Boris s’en prenait à l’orthodoxie financière française et déplorait le mépris de la presse française pour l’expérience de l’administration Roosevelt aux États-Unis.
Par ailleurs, La révolution Roosevelt, que Georges Boris publie en avril 1934, rend compte de son voyage d’étude aux États-Unis (février 1934). Le contraste est grand, dans ce court ouvrage, entre d’une part l’intérêt de l’auteur pour la dure réalité sociale et les initiatives du président américain pour la soulager, d’autre part les raisonnements théoriques des économistes français tels que Rueff, plus proches des intérêts de la finance que de ceux des classes défavorisées.
Malgré les réserves de Georges Boris à l’égard de l’étalon-or, le gouvernement du Front populaire restera attaché à la liberté de circulation des capitaux et au refus du contrôle des changes. C’est pourquoi la dévaluation de la monnaie sera retardée jusqu’en septembre 1936, d’autant qu’elle devait être opérée en coordination avec les autorités monétaires des États-Unis et de l’Angleterre, sinon sous leur contrôle (Alsop & Kintner, 1949).
II.3. La Note du 26 mars 1938
Jean de Largentaye signe le 26 mars 1938, pendant le second gouvernement Blum, une Note sur le financement des dépenses extraordinaires de l’Allemagne. La conversion économique de Jean de Largentaye est alors patente ; il a passé huit mois à étudier, résumer et commenter l’ouvrage de Keynes pour ses collègues aux Finances. Le 31 janvier 1938, il offre ses services à Keynes pour la traduction de The General Theory.
44L’influence keynésienne dans la Note pour le sous-directeur (voir infra) du 26 mars 1938 est visible dans l’interprétation de la notion d’inflation. Elle se trouve aussi dans la justification du déficit budgétaire – le financement des « dépenses extraordinaires » par la création monétaire et par l’emprunt –, qui génère un excédent du budget ordinaire. The General Theory propose enfin que l’objectif de la politique monétaire ne soit pas l’accumulation de réserves d’or ou la libre circulation des capitaux son corollaire, mais en priorité la stimulation de l’activité et l’atteinte du plein emploi.
La Note du 26 mars 1938 résout l’énigme de la relance de l’économie allemande qui faisait dire à Gaston Cusin :
[O]n n’a trouvé dans certaines industries que des limes et des marteaux pour fabriquer des chars d’assaut. Il est donc certain que l’économie française n’était pas en mesure de bénéficier de ses rentrées d’or, cependant que, sans une tonne d’or, Schacht réalisait l’expansion miraculeuse de l’économie allemande (Renouvin & Rémond, 1967, p. 291-292).
La Note de Jean de Largentaye a trois objectifs : comprendre les mécanismes de financement du programme nazi, analyser son impact sur les prix et tirer des conclusions générales. En ce qui concerne les mécanismes de financement, ils sont au nombre de trois : (i) les « traites de travail » pour les travaux publics et autres systèmes d’emploi, (ii) les emprunts d’État et (iii) l’excédent du budget ordinaire. Les « traites de travail », dont la définition et le mécanisme sont précisés dans la Note, sont émises par des institutions financières spécialisées et sont garanties par l’État. Les emprunts d’État, de moins grande ampleur, apparaissent comme un complément aux « traites de travail », celles-ci générant de la circulation monétaire tandis que les emprunts d’État la réduisent.
Quant à l’excédent budgétaire, il est le résultat des meilleures conditions économiques. Afflux de recettes fiscales et recul des postes de dépenses (dont l’aide aux chômeurs) donnent de la marge pour les dépenses extraordinaires. La Note conclut que le financement de ces dépenses est composé de 20 milliards de reichsmarks de circulation monétaire supplémentaire, 17 milliards d’emprunts et 23 milliards d’excédent budgétaire, soit un total de 60 milliards (équivalent à l’époque à 800 milliards de francs au taux de change officiel, selon la Note) qui est l’ampleur du programme allemand de dépenses extraordinaires pour la période quinquennale de 1933 à 1937.
45En dépit de la circulation monétaire accrue, l’Allemagne ne connaît pas « d’inflation véritable » (au sens du chapitre xxi de The General Theory) tant redoutée depuis 1923. La raison est que l’économie est mise en capacité de produire suffisamment pour que l’offre réponde à la demande en expansion. Tant que la demande solvable n’excède pas l’offre, c’est-à-dire la capacité de production utilisée, il n’y a pas d’inflation véritable. Le gouvernement veille cependant à décourager l’échange des « traites de travail » contre des liquidités.
La Note conclut que le contrôle des changes était nécessaire pour permettre à l’Allemagne nazie de financer ses dépenses extraordinaires alors qu’elle n’a pas de réserves de change. Les banques sont désormais assujetties aux priorités gouvernementales. De surcroît, la stricte discipline de la main d’œuvre, consentie ou forcée, a contribué à maîtriser l’inflation. Mais la main d’œuvre peut, sans que les salaires augmentent, améliorer son revenu en répondant à la demande soutenue et en percevant la rémunération des heures supplémentaires. À l’approche du plein emploi, l’auteur estime que la croissance allemande cessera d’accélérer mais maintiendra une performance élevée.
La Note contredit la théorie quantitative de la monnaie selon laquelle, si l’on se réfère à la fameuse équation d’Irving Fisher (MV = PQ) qui prend pour hypothèse que la monnaie est neutre, l’accroissement de la circulation monétaire ne se traduit que par l’augmentation des prix en proportion du volume M de la quantité de monnaie en circulation. On voit en effet, en Allemagne nazie dans les années 1930, que l’augmentation de la circulation monétaire M augmente la quantité Q de biens et de services réels, plutôt que les prix P. Qui plus est, l’étonnante performance nazie s’effectue en l’absence de réserves de change.
Ainsi, la Note montre comment une politique monétaire bien conçue et bien mise en œuvre peut contredire les principes traditionnels de la théorie monétaire et relancer l’activité et l’emploi. Il faut cependant que :
1. le contrôle des changes mette la politique autarcique à l’abri de la fuite des capitaux,
2. les banques soient soumises à la politique gouvernementale.
Tandis que l’Allemagne nazie remplit ces deux conditions au détriment des libertés du marché, un grand nombre de démocraties occidentales, 46dont la France, considéraient alors ces conditions comme inacceptables. Dans les années 1930, les exceptions étaient la politique du New Deal de Roosevelt et les programmes économiques des pays scandinaves.
Curieusement, alors que Gaston Cusin s’étonnait du paradoxe de la pauvreté des infrastructures dans l’abondance d’or, Georges Boris l’avait expliqué. Dans La révolution Roosevelt (1934), il avait notamment analysé les mécanismes inflationnistes (création de liquidités) mis en œuvre par l’intermédiaire d’institutions publiques comme la Reconstruction Finance Corporation (RFC). Dans sa Note de 1938, Jean de Largentaye s’inscrivait dans la même ligne de pensée que Georges Boris, sachant que les États-Unis quant à eux, préservèrent la libre circulation des capitaux en laissant le dollar se dévaluer en 1933.
La Science économique et l’action (Mendès France & Ardant, 1954) fait le récit de la période qui s’est écoulée entre les deux guerres mondiales, période qui « présente un intérêt exceptionnel pour l’homme d’État comme pour le particulier soucieux de son avenir » (chapitre vi, p. 51). D’une certaine manière, cet ouvrage reflète « l’éblouissement » que ressentit Jean de Largentaye. Il explique en effet, sous la plume de deux proches amis de Jean de Largentaye, les enjeux de la découverte de The General Theory. Les pages consacrées à l’Allemagne ont pu être inspirées de la note de Jean de Largentaye du 26 mars 1938. Dix-huit ans plus tard, la réédition de l’ouvrage (Mendès France & Ardant, 1972) sous le titre Science économique et lucidité politique est dédiée à Jean de Largentaye, disparu deux ans plus tôt.
II.4. Programme de relance du Front populaire
L’influence de Georges Boris sur le programme économique du second gouvernement Blum (1938) est incontestable. Son opposition aux politiques économiques orthodoxes, notamment monétaires, s’exprime depuis plus de dix ans notamment dans les pages de son hebdomadaire La Lumière (Boris, 1963). Son analyse de La révolution Roosevelt (Boris, 1934) est imprégnée d’idées que The General Theory validera à sa publication deux ans plus tard (1936).
Pierre Mendès France fut initié à The General Theory par Georges Boris lors du second gouvernement Blum en mars 1938 (Crémieux-Brilhac, 2010, p. 81). Jusqu’en 1936, il raisonnait en termes de budget équilibré. Le programme économique dont Boris et lui partageaient la 47responsabilité (Mendès France étant sous-secrétaire d’État au Trésor et Boris directeur de cabinet de Léon Blum qui cumulait le portefeuille des finances avec la présidence du Conseil) fut commenté par The Times, le quotidien de Londres, en des termes (6 avril 1938) qui rappellent l’analyse de Jean de Largentaye dans sa Note du 26 mars 1938 :
Pour la première fois depuis M. Poincaré, on tente d’embrasser le problème économique dans son ensemble et de le résoudre non par de maigres expédients mais par un plan ambitieux et détaillé […] La vérité apparaît enfin : la France est devant l’alternative du maintien d’une économie libérale ou de l’entrée dans une économie strictement réglementée. Si la confiance est rétablie, l’argent français sera rapatrié et le gouvernement disposera des ressources voulues mais si la confiance ne revient pas, ce qui est l’hypothèse retenue dans le plan Blum, le gouvernement sera obligé de créer de la monnaie et de prendre les moyens pour l’empêcher de quitter le pays. Cela signifie réglementer la finance1 (voir infra).
Gaston Cusin a fait valoir que le programme économique de 1938 avait été préparé en réalité par le Ministère des Finances. Cette version n’est pas incompatible avec la paternité du programme attribuée à Georges Boris et à Pierre Mendès France. Au Ministère des Finances, une équipe était désormais ralliée aux idées de The General Theory, peut-être sous l’influence de Jean de Largentaye. L’ouvrage Science économique et lucidité politique (Mendès France & Ardant, 1972) paraît corroborer cette interprétation.
Jean de Largentaye est frappé par la pertinence de l’analyse économique de The General Theory par rapport aux errements politiques qu’il observe en France, tout comme Georges Boris a fait valoir trois ans plus tôt la pertinence de La révolution Roosevelt pour les États-Unis. En reconnaissant le problème du chômage involontaire et en proposant les clefs du plein emploi, The General Theory apporte, comme le programme de Roosevelt, la solution au dilemme des démocraties libérales et singulièrement des partis progressistes au sein de celles-ci, prisonnières du dogme de l’étalon-or et de la libre circulation des capitaux. Jean de Largentaye rejoint ainsi tardivement le combat que mène Georges Boris contre la déflation et le chômage (Boris, 1963) depuis au moins 1927.
À l’instar de Keynes, Jean de Largentaye insistera désormais – notamment dans les années 1960 à l’occasion de débats sur les liquidités 48internationales (Largentaye, 1966) – sur le fait que la santé d’une économie, notamment le plein emploi, dépend d’abord de la politique monétaire intérieure. Le drame de la période qui s’est écoulée entre les deux guerres résulte du fait que, soumise à l’étalon-or, la politique monétaire devait plutôt sauvegarder la libre circulation des capitaux, assimilée par les milieux financiers à la liberté d’entreprendre, fondement de l’ordre économique et valeur fondamentale des démocraties libérales aux antipodes des régimes totalitaires qui étaient alors ceux de l’Allemagne nazie et de l’U.R.S.S. communiste.
III. PensÉe Économique dominante,
dogme de l’Étalon-or et Économie libÉrale
III.1. France
La période de l’entre-deux guerres est dominée par la question de l’étalon-or, cette « relique barbare » comme le qualifiait Keynes dans son ouvrage A Tract on Monetary Reform (1923, traduit en français en 1924 sous le titre La réforme monétaire). Roosevelt parlait, quant à lui, de « fétichisme » et de complot international des banquiers. C’est certainement l’apparente solidité de la théorie de l’étalon-or qui permet aux milieux financiers et à leurs alliés politiques de leurrer les milieux républicains (radicaux français notamment), respectueux au point d’être intimidés par cet apparent pilier des démocraties libérales.
La théorie de l’étalon-or fait valoir que l’ajustement des économies est automatique et tend toujours vers l’équilibre stable. Un pays en déficit des paiements extérieurs règle ses créanciers étrangers en or, ce qui fait fondre ses réserves et diminuer la circulation monétaire.
En France, le grand défenseur de l’étalon-or est Jacques Rueff. Polytechnicien, Jacques Rueff est admis au concours de l’Inspection des Finances en 1923 et commence sa carrière au Mouvement général des fonds en 1925 comme chargé de mission. Il passe cinq mois au cabinet de Raymond Poincaré, président du Conseil et ministre des Finances (1926-1927) et s’y distingue en juillet 1926, par une étude recommandant le cours d’équilibre réaliste du franc. Sa formation économique 49est influencée par les écrits de Léon Walras, théoricien de l’équilibre des marchés, et sa pensée est proche de celle de Charles Rist, influent professeur d’économie et expert monétaire partisan de l’étalon-or.
De 1930 à 1934, Jacques Rueff est attaché financier à Londres. En 1934 il est nommé sous-directeur du Mouvement général des fonds, puis directeur adjoint (1935-1936) et enfin directeur (1936-1939)2.
À Londres lorsque l’Angleterre abandonne l’étalon-or (21 septembre 1931), Jacques Rueff endosse sans état d’âme la théorie de l’étalon-or et, à l’instar du chancelier Brüning en Allemagne, prône la flexibilité des salaires à la baisse, afin d’ajuster l’économie aux prix internationaux. C’est, selon lui, la condition du maintien du plein emploi. Il estime en effet qu’en Angleterre les indemnités de chômage et les salaires minimaux, contraires à la flexibilité des salaires, ne font qu’entretenir le chômage. La résorption du chômage demande la flexibilité des prix :
[D]ans les pays où le niveau des salaires n’est pas maintenu immuable, l’économie peut s’adapter aux conditions résultant de la baisse des prix. Par-là, ainsi qu’il est toujours advenu dans le passé, le chômage se résorbe peu à peu et la crise disparaît, d’autant plus vite que l’adaptation a été plus rapide (Flandreau, 1998).
Parce que le rendement de l’investissement est supposé décroissant, les travailleurs doivent accepter, en période de conjoncture défavorable, une rémunération réduite conforme aux conditions de travail résultant d’investissements moins rémunérateurs. Cette vision est bien entendu mal acceptée dans le milieu des travailleurs désormais organisés en syndicats.
Soucieux de défendre la parité du franc après la dévaluation de la livre sterling en 1931 et celle du dollar en 1933, les gouvernements français devront recourir à des politiques de déflation pour tenter de faire baisser les coûts et maintenir la compétitivité internationale de l’économie. Sans la compréhension des mécanismes monétaires, la gauche est déroutée. Le parti radical se contente de gouvernements d’union nationale et participe aux politiques de déflation et de défense du franc affaibli. Les socialistes quant à eux, et jusqu’en 1934, s’abstiennent de participer aux gouvernements pour ne pas prêter le flanc aux dissidents communistes qui considèrent le régime démocratique comme condamné à l’effondrement.
50Dans ce contexte, la pensée de Georges Boris paraît aussi originale qu’ignorée. Son journal La Lumière fut jusqu’en 1940, selon Pierre Mendès France, « l’un des moyens d’expression les plus actifs et les plus dynamiques de la gauche ». Boris, toujours selon Pierre Mendès France,
[P]ose clairement le problème fondamental de la gauche et qui demeure d’actualité : « savoir si la révolution économique et sociale est compatible avec le maintien du régime démocratique » (Boris, 1963, p. 13).
III.2. Allemagne
En Allemagne, la crise se manifeste dès le début de 1929 par le retrait des capitaux américains. Entre l’été 1928 et avril 1930, le chômage en Allemagne passe de 355 000 à 3 336 000. Le 11 mai 1931, la faillite de la Kreditanstalt autrichienne précipite les événements en menaçant le Deutsche Mark. Sous pression américaine, une conférence organisée précipitamment à Londres en juillet 1931 décide l’interdiction de la sortie des capitaux placés à court terme en Allemagne (d’où l’expression stand still) et confie la mise en place du dispositif à un comité qui siège à Bâle, le comité dit du stand still (Jacques Rueff, 1963, p. 26).
Jacques Rueff ne craindra pas de percevoir dans le stand still une violation des contrats aux termes desquels les capitaux étaient entrés en Allemagne. En déplorant ce « tournant de la civilisation occidentale », il exprime l’attachement viscéral des milieux conservateurs à la libre circulation des capitaux :
La décision qui créa le comité avait, sans qu’on s’en rendît compte, une immense portée. Elle fut, véritablement, un tournant de la civilisation occidentale, fondée jusque-là sur le respect des contrats et sur la liberté monétaire. Elle devait aboutir, en effet, au système entièrement nouveau qui allait permettre la pratique d’une politique d’inflation interne sans dépréciation de la monnaie. Autrement dit, elle instituait en Allemagne, le contrôle des changes (Rueff, 1963, p. 28).
Selon Rueff, le contrôle des changes ainsi instauré fournit à Hitler le système tout monté, celui-là même que Jean de Largentaye analysait en mars 1938 :
Ce n’est pas le docteur Schacht, contrairement à ce que l’on croit, qui a inventé la politique monétaire caractéristique du régime hitlérien. Cette politique 51a été imaginée et instituée, presque complètement inconsciemment par les accords de « stand still » (Rueff, 1963, p. 29).
III.3. États-Unis
Aux États-Unis, le pragmatisme du démocrate Franklin Delano Roosevelt contraste avec les politiques européennes et le dogmatisme de la gauche. Au lendemain de son inauguration, le 4 mars 1933, il déclenche une avalanche de mesures, à commencer par la fermeture des banques. Le 12 mars, dans son premier « fireside chat », il convainc les déposants de remettre leur argent dans les banques. En quelques jours, par son contact direct avec l’opinion, il réalise ce que son prédécesseur, le président Hoover, n’avait pu faire pendant des mois. En juin 1933, il s’oppose à tout engagement à la conférence de Londres appelée à réformer le système monétaire international et n’hésite pas à faire capoter la conférence3. Il veut que l’autorité sur la politique monétaire américaine soit ramenée de Wall Street à Washington.
Le 31 décembre 1933, Keynes fait publier sur une page entière du New York Times une lettre ouverte qui commence par un vibrant hommage au pragmatisme de Roosevelt :
Dear Mr President,
You have made yourself the trustee of those in every country who seek to mend the evils of our condition by reasoned experiment within the framework of the existing social system.
If you fail, rational change will be gravely prejudiced throughout the world, leaving unorthodoxy and revolution to fight it out.
But if you succeed, new and bolder methods will be tried everywhere, and we may date the first chapter of a new economic era from your accession to office4.
52En fait, après les propos d’introduction flatteurs, la lettre entreprend une évaluation critique de la politique de l’administration Roosevelt et suggère de mieux distinguer les mesures urgentes de relance des réformes de structure. Les mesures de relance doivent faire augmenter la dépense, ce qui est possible par la dépense budgétaire à condition de la financer par l’emprunt et non par l’impôt, autrement dit les mesures de relance supposent un déficit budgétaire. Fin 1933, Keynes reproche à l’administration Roosevelt d’avoir manqué de hardiesse dans l’augmentation de la dépense publique et d’avoir ainsi subi une nouvelle récession à l’automne 1933. Keynes considère que la National Industrial Recovery Act relève des réformes de structure et n’avait donc pas la même urgence que l’augmentation de la dépense publique. Enfin Keynes fait observer au Président des États-Unis que la théorie quantitative de la monnaie attribue par erreur à la quantité de monnaie la fonction de la dépense. Il salue la dépréciation du change dans la mesure où elle donne de la marge pour permettre aux prix d’augmenter, et met en garde contre les effets délétères d’un retour à l’étalon-or. Deux ans avant la publication de The General Theory, on voit que certaines idées de Keynes sont déjà bien en place, notamment la fonction de la demande par opposition à la théorie quantitative de la monnaie.
Ces idées inspirent également La révolution Roosevelt de Georges Boris et nourrissent la lutte contre les politiques déflationnistes. Jean de Largentaye écrira plus tard « La cause du chômage, c’est l’épargne » (Largentaye, 1944), s’opposant à Jacques Rueff, convaincu que la propension à épargner ne s’oppose pas au maintien de l’activité économique (Rueff, 1947). Les propos de celui-ci, cités plus haut, concernant le comité du stand still de 1931 sont illustratifs de l’argumentaire offensif des milieux financiers niant résolument les dysfonctionnements du système libéral.
Conclusion
L’éblouissement de Jean de Largentaye en mai 1937 révèle sa brusque prise de conscience de l’importance de The General Theory. Il est paradoxal qu’un tel enthousiasme s’exprime à ce propos chez quelqu’un de 53son milieu social. Mais Keynes n’aurait sans doute pas trouvé anormal qu’un esprit dégagé « des idées anciennes qui ont poussé leurs racines dans tous les recoins de l’esprit » s’enthousiasmât pour des idées nouvelles qui n’étaient pas selon Keynes difficiles à comprendre.
Alors qu’en France, on commençait à s’intéresser à The General Theory (Stéphane Leven, séminaires de Pontigny, universitaires, syndicats, Georges Boris …), la curiosité naturelle de Jean de Largentaye, le non-conformisme qu’évoquait Gabriel Ardant, lui donnèrent la capacité de constater le vice flagrant des croyances économiques qui dévastaient son monde. Il observait son époque tumultueuse avec la perspicacité dérangeante d’un Candide et n’avait que faire de l’opinion générale si une idée lui paraissait fondée. Deux ans après la parution de The General Theory en Angleterre, il fut donc seul à éprouver la nécessité urgente de faire connaître l’ouvrage en langue française.
La Science économique et l’action (Mendès France & Ardant, 1954) peut se lire comme un hommage des auteurs à la diffusion des idées de la Théorie générale par Jean de Largentaye. Celui-ci et Gabriel Ardant côtoyèrent Pierre Mendès France à Alger en 1943 et 1944, et Jean de Largentaye accompagna ce dernier à la conférence de Bretton Woods en 1944.
Cependant, l’action de Jean de Largentaye ne réussit pas à convertir la classe politique ni l’opinion au-delà d’un petit cercle de hauts fonctionnaires et de dirigeants du Front populaire qui disposait déjà, avec Georges Boris, d’un conseiller économique clairvoyant et pleinement averti. Le second gouvernement Blum fut renversé le 8 avril 1938 au Sénat, sous l’influence notamment de Joseph Caillaux. Il faudra attendre la traduction de The General Theory, publiée tardivement en 1942, pour voir une certaine progression de la pensée économique française, sans toutefois que l’influence orthodoxe des milieux financiers ne soit jamais ébranlée ni le plein emploi durablement assuré.
Par ailleurs, lors de la réédition de la traduction de The General Theory en 1968, Jean de Largentaye constata dans la deuxième note du traducteur que l’ouvrage n’avait pas décelé l’incapacité de la monnaie de crédit à concilier plein emploi et stabilité des prix. Sa mise en cause de la nature de la monnaie peu de temps avant sa mort révèle l’influence durable qu’avait eue Louis Fizaine sur son esprit.
54Références bibliographiques
Alsop, Joseph & Kintner, Robert [1939], « The Great World Money Play », Saturday Evening Post, 15 avril, p. 25.
Ardant, Gabriel [1947], « À propos de la “Théorie Générale” de Lord Keynes (Réponse à M. Rueff) », Revue d’économie politique, mai-juin, No 4-6, p. 379-391.
Audiffret-Pasquier, Gaston, duc de [1938], La Maison de France et l’Assemblée Nationale. Souvenirs 1871-1873, Paris, Librairie Plon.
Boris, Georges [1934], La révolution Roosevelt, Paris, Gallimard.
Boris, Georges [1963], Servir la République. Textes et témoignages, Paris, Julliard.
Cardoni, Fabien, Carré de Malberg, Nathalie & Margairaz, Michel [2012], Dictionnaire historique des inspecteurs des finances 1801-2009, Paris, Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE), Comité pour l’histoire économique et financière de la France.
Crémieux-Brilhac, Jean-Louis [2010], Georges Boris. Trente ans d’influence. Blum, de Gaulle, Mendès France, Paris, Gallimard.
Fizaine, Louis [1933], Crise et monnaie, Nancy, Éditions de l’Union industrielle & commerciale de l’Est.
Fizaine, Louis [1946], Dirigisme ou automatisme ? Un système qui fonctionne sans fonctionnaires, Nancy, Édition de l’Association lorraine d’études économiques et sociales.
Flandreau, Marc [1998], « 1931 : la chute de la livre sterling et la crise internationale vues par Jacques Rueff », Politique étrangère, 63e année, No 4, p. 865-876.
Keynes, John Maynard [1936], The General Theory of Employment, Interest and Money, Cambridge, Cambridge University Press.
Keynes, John Maynard [1942], Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, traduction de Jean de Largentaye, Paris, Payot, 2017.
Largentaye, Hélène de [2021], « Le lexique de l’édition française de The General Theory de Keynes », dans ce numéro.
Largentaye, Jean de [1944], « L’écueil de l’économie monétaire », Revue d’Alger, No 1, première année, p. 52.
Largentaye, Jean de [1966], « De la liquidité internationale », Revue Tiers Monde, vol. 27, p. 463-480.
Mendès France, Pierre, [1962], La République moderne, Paris, Gallimard.
55Mendès France, Pierre [1984], Œuvres complètes, Tome I, S’engager 1922-1943, Paris, Gallimard.
Mendès France, Pierre & Ardant, Gabriel [1954], La science économique et l’action, Paris, UNESCO.
Mendès France, Pierre & Ardant, Gabriel [1972], Science économique et lucidité politique, Paris, Gallimard.
Renouvin, Pierre & Rémond, René (dir.) [1967], Léon Blum, chef de gouvernement : 1936-1937, Actes du colloque des 26 et 27 mars 1965 à la Fondation nationale des Sciences politiques, Paris, Armand Colin & Presses de la Fondation nationale des Sciences Politiques.
Rueff, Jacques [1947], « Les erreurs de la Théorie générale de Lord Keynes », Revue d’économie politique, No 1-3, p. 5-33.
Rueff, Jacques [1963], L’âge de l’inflation, Paris, Payot.
Tortajada, Ramón [2021], « The General Theory, Keynes et les économistes français, de sa traduction à l’immédiat après-guerre », dans ce numéro, p. 137-179.
Withers, Hartley [1909], The Meaning of Money, London, Smith and Elder.
1 Les traductions de l’anglais vers le français sont de l’auteur de l’article.
2 Voir Cardoni & al., 2012, p. 911-913.
3 Le 12 juin 1933, la conférence de Londres réunit les représentants de 66 pays avec l’objectif de remettre en marche l’économie mondiale. La France se fait la championne de la déflation et de l’étalon-or. La conférence se clôt le 27 juillet 1933 sur un constat d’échec, suite à l’opposition de Roosevelt à un accord de stabilisation des taux de change.
4 « M. le Président, Votre expérimentation raisonnée dans le cadre du système social existant a fait de vous le mandataire de ceux qui, dans tous les pays, veulent remédier à nos mauvais penchants. Si vous échouez, la conduite rationnelle du changement sera, de par le monde, gravement compromise, permettant le libre affrontement entre hétérodoxie et révolution. Mais si vous réussissez, de nouvelles méthodes seront tentées partout et on pourra dater le premier chapitre d’une nouvelle ère économique à partir de votre accession à la présidence » (AL).