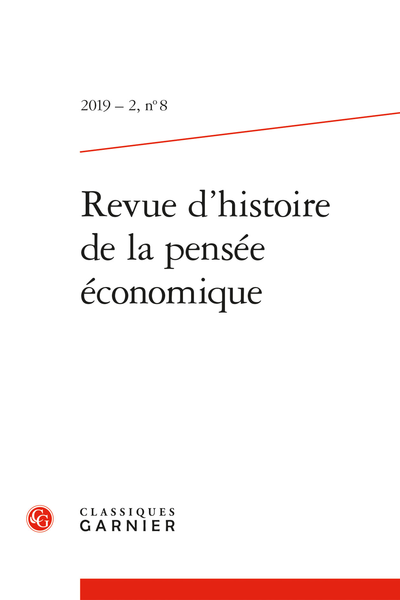
Francis Bacon et William Petty Une autre économie politique républicaine ?
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Revue d'histoire de la pensée économique
2019 – 2, n° 8. varia - Auteur : Ravix (Joël Thomas)
- Résumé : L’article montre que Francis Bacon et William Petty élaborent une économique politique républicaine, différente de celle de James Harrington. Sa particularité est d’être construite sur la notion de conflit empruntée à Machiavel. Toutefois, la dynamique engendrée par ce conflit ne se situe pas sur le terrain politique de la domination des nobles sur le peuple, mais sur un plan économique puisqu’elle porte sur la production et à la répartition des richesses.
- Pages : 153 à 183
- Revue : Revue d’histoire de la pensée économique
- Thème CLIL : 3340 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Histoire économique
- EAN : 9782406098454
- ISBN : 978-2-406-09845-4
- ISSN : 2495-8670
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-09845-4.p.0153
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 17/12/2019
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : Républicanisme, conflit, Francis Bacon, James Harrington, Machiavel, Willian Petty
Francis Bacon et William Petty
Une autre économie politique républicaine ?
Joël Thomas Ravix
Université Côte d’Azur,
CNRS-GREDEG
Ce sont de piètres découvreurs ceux qui pensent qu’il n’y a point de terre là où ils ne voient que la mer
Francis Bacon (1605)
Introduction1
Les diverses analyses qui s’intéressent à l’origine des liens entre économie politique et républicanisme se concentrent principalement sur la période historique qui s’étend de la Glorieuse révolution de 1688 à la Révolution française (Pocock, 1975, 1985 ; Pincus, 2011). Deux raisons principales semblent venir expliquer cet état de choses. La première se situe sur le plan de l’analyse politique puisque les commentateurs admettent généralement qu’il n’existait aucun signe perceptible de républicanisme en Grande-Bretagne avant la guerre civile de 1642 et que « seuls l’effondrement de la monarchie et la guerre civile permirent de franchir cette étape » (Pocock, 1975, p. 355). Ce serait donc la première révolution anglaise qui serait à l’origine de l’émergence d’un discours 154républicain s’inspirant « de l’humanisme civique et du républicanisme machiavélien » (ibid., p. 385), dont la figure de proue serait James Harrington, l’auteur de The Commonwealth of Oceana (1656). La seconde raison se situe sur le terrain de l’analyse économique où les divers discours de la première moitié du xviie siècle, portant sur la richesse et le commerce, sont habituellement regroupés sous l’appellation générique de mercantilisme. Même si les historiens de la pensée économique contestent quelquefois la pertinence de ce qualificatif ou prennent en compte certains travaux sur le républicanisme, ils négligent généralement les clivages idéologiques ou politiques qui fondent ces discours (Marquer, 2012 ; Magnusson, 2015).
Pourtant, lorsque John G. A. Pocock remarque que « Harrington fut un républicain classique, le premier humaniste civique d’Angleterre et un penseur machiavélien » (Pocock, 1977, p. 24) et qu’il ajoute que « sans doute, d’autres avant lui avaient conçu la politique anglaise dans les mêmes termes » (ibid.), il se contente de rappeler un constat déjà fait dans un ouvrage antérieur, où il se limitait simplement à signaler le cas de Francis Bacon, sans plus de commentaire (Pocock, 1975, p. 354). Toutefois, si la question des liens entre Bacon et Machiavel a été ultérieurement approfondie, c’est uniquement à propos de la notion de grandeur (Peltonen, 1995 et 1996 ; Weber, 2003) ; en négligeant complètement celle du « conflit civil comme moteur d’un État libre et puissant » (Lefort, 1978, p. 232), qui caractérise pourtant la démarche de Machiavel et fonde une autre tendance du républicanisme (Audier, 2005)2. Bien qu’en partie explorée à travers le clivage entre le modèle républicain de Rome et celui de Venise (Audier, 2015, p. 26-30), les implications de cette notion de conflit en matière d’économie politique n’ont semble-t-il jamais été véritablement abordées.
L’objet de cet article est d’en proposer une première esquisse en montrant que cette notion de conflit a été mobilisée non seulement par Francis Bacon mais aussi par William Petty, pour structurer leurs discours économiques respectifs dont la particularité est d’emprunter une voie différente de celle ouverte par Harrington et prolongée par les 155auteurs néo-harringtonniens (Pocock, 1975, ch. xiii). Pour préciser la nature de la bifurcation empruntée par Bacon et Petty, il sera nécessaire de rappeler dans un premier temps les raisons qui font que, en préférant le modèle de Venise à celui de Rome, Harrington se sépare de Machiavel. Il sera alors possible dans un deuxième temps de montrer qu’en investissant au contraire ce même modèle romain, Francis Bacon élabore les prémisses d’une autre économie politique reposant sur un conflit entre une classe active et une classe oisive. Enfin, la troisième partie sera consacrée à William Petty qui, en reprenant l’idée du conflit entre actifs et oisifs pour l’étendre aux questions de mesure de la richesse publique et de fiscalité, prolonge la démarche de Bacon dans le cadre d’une analyse économique plus structurée.
I. Rome et Venise,
deux approches différentEs de l’économique
Le modèle de république élaboré par James Harrington s’inspire directement de la république de Venise dont il admirait la perfection et la stabilité parce qu’elle avait su garder « les yeux fixés sur l’ancienne prudence » (Harrington, 1656, p. 229). Cette ancienne prudence est celle qui fait du gouvernement « un art par lequel une société civile est constituée et maintenue sur des bases de droits et d’intérêts communs ; ou, pour suivre Aristote et Tite-Live, c’est l’empire des lois et non celui des hommes » (ibid.). Harrington lui oppose « la prudence moderne, [qui] est un art par lequel un homme, ou quelques hommes, soumettent une ville ou une nation et la conduisent selon leur intérêt particulier » et dans ce cas, ce qui prévaut, c’est « l’empire des hommes et non celui des lois » (ibid., p. 229-230). C’est donc en adoptant l’ancienne prudence, qui est aussi celle à laquelle il associe Machiavel3, que Harrington se propose de reconstruire le concept de république à partir de la distinction classique entre trois formes de gouvernement.
156Le gouvernement, selon les anciens et leur savant disciple Machiavel, le seul politicien des derniers siècles, est de trois sortes ; celui d’un seul, des meilleurs, ou de tous : les noms sous lesquels ces différents gouvernements sont les plus connus, sont la monarchie, l’aristocratie, et la démocratie (ibid., p. 231).
Cependant, pour Harrington, toutes ces formes de gouvernements sont susceptibles de « dégénérer », car elles sont sujettes à la corruption dès lors que ceux qui gouvernent sont conduits par les passions et non par la raison : « C’est pourquoi, comme la raison et la passion sont deux choses, de même le gouvernement de la raison en est une, et la corruption du gouvernement par la passion une autre (…). La corruption de la monarchie est donc appelée tyrannie, celle de l’aristocratie oligarchie, celle de la démocratie anarchie » (ibid.).
Cette typologie est construite à partir de l’idée que les principes de tout gouvernement sont soit internes, soit externes. Les premiers sont les « biens de l’esprit » qui regroupent les vertus naturelles ou acquises comme la sagesse, la prudence et le courage ; les seconds sont les « biens de la fortune » qui désignent les richesses. Or ces deux types de biens ne relèvent pas de la même catégorie puisque « les biens de l’esprit répondent à l’autorité ; ceux de la fortune à la puissance ou à l’empire » (ibid., p. 232). Cette distinction entre pouvoir et autorité est essentielle pour Harrington car elle lui permet de trouver dans la richesse, et plus précisément dans la propriété de la terre, la source du pouvoir. Il observe en effet que « celui qui a besoin de nourriture est le serviteur de celui qui le nourrit, un homme, donc, qui nourrit tout un peuple, le tient sous son empire » (ibid., p. 232). Harrington attribue ainsi au pouvoir politique un fondement qui peut être qualifié d’économique (Polin, 1952) : c’est le partage des terres ou ce qu’il nomme « la balance de la propriété » qui définit selon lui « la nature de l’empire », c’est-à-dire qui donne sa forme au gouvernement.
Si un homme est unique seigneur d’un territoire, ou balance la propriété du peuple, (…), alors il est grand seigneur (…) et son empire est une monarchie absolue. Si quelques hommes, ou une noblesse, ou une noblesse et un clergé balancent la propriété du peuple, c’est la balance gothique, (…), et l’empire est une monarchie mixte (…). Si tout le peuple possède les terres d’une manière si divisée, qu’aucun homme, ou un certain nombre d’hommes, ne puissent, avec le compas de l’aristocratie le balancer, l’empire alors (sans le concours de la force) est une république (ibid., p. 233).
157Deux implications découlent de cette conception. La première est l’obligation de promulguer une loi agraire pour stabiliser le partage des propriétés foncières, de manière à garantir la pérennité de la république en empêchant un retour à l’inégalité des patrimoines. Elle a pour corollaire que l’argent ou la richesse mobilière ne saurait jouer ce rôle car, « pour que la propriété fonde un empire, il faut qu’elle ait quelques bases ou quelques racines, ce qui ne peut avoir lieu que pour celle des terres, l’autre n’étant fixée que sur les ailes du vent » (ibid.). La seconde implication est que cette conception accorde un rôle essentiel aux propriétaires fonciers et donc implicitement à la noblesse. Harrington reconnaît à ce propos s’écarter de Machiavel – qui au contraire oppose le peuple à la noblesse – en lui reprochant de ne pas avoir compris le principe de la balance de la propriété.
Machiavel a manqué ce point, très fortement et très dangereusement ; ne s’apercevant pas avec clarté que, si une république est tourmentée par la petite noblesse, c’est à cause de son trop grand nombre ; il parle de cette noblesse comme l’ennemi du gouvernement populaire, et de celui-ci comme de l’ennemi de cette noblesse (ibid., p. 236-237).
Harrington est au contraire convaincu qu’il ne peut y avoir de conflit dès lors que la balance est respectée et que le pouvoir est bien en rapport avec la propriété. Ce n’est que dans le cas inverse que le gouvernement repose sur la violence et se corrompt, car il perd alors son caractère naturel pour devenir tyrannique, oligarchique ou anarchique.
À la différence du pouvoir, l’autorité participe des biens de l’esprit et « le législateur qui peut, dans son gouvernement, les unir à ceux de la fortune, approche de l’ouvrage de Dieu » (ibid., p. 240). Toute la difficulté pour parvenir à ce résultat provient du fait que l’âme de l’homme n’obéit pas uniquement à la raison, mais qu’elle est également soumise aux passions : « deux puissantes rivales qui se la disputent continuellement » (ibid., p. 241). Si les passions forment le vice et engendrent le mépris et la honte, la raison produit au contraire la liberté et la vertu tout en procurant l’honneur et l’autorité sur les autres. Il en va de même pour le gouvernement qui est l’âme d’une nation ou d’une cité. Harrington peut alors poser l’hypothèse que, dans toute société d’hommes, il apparaitra toujours « qu’un tiers sera plus sage, ou moins fou que tout le reste » (ibid., p. 245) et ce tiers servira de guide aux autres. Cette portion de 158la population, qui correspond à « une aristocratie naturelle que Dieu lui-même a répandue parmi les hommes » (ibid.), doit former le Sénat. Chez Harrington le Sénat présente une double caractéristique : d’une part, ses membres ne sont pas choisis par droit héréditaire ni en raison de leur fortune, mais « par élection, à cause de l’excellence de leurs qualités qui servent à augmenter l’influence de leur vertu ou de leur autorité, et à conduire le peuple » (ibid., p. 246) ; d’autre part, il a pour unique fonction de débattre des intérêts de la république, de sorte que « les décrets du Sénat ne sont jamais des lois, ni appelés ainsi mais senatus-consulta : après les avoir mûrement formés, il est de son devoir de les soumettre au peuple » (ibid.).
Mais, si c’est l’assemblée du peuple qui choisit les lois proposées par le Sénat, il faut encore indiquer qui les fera exécuter. Pour Harrington, c’est la « magistrature » qui est en charge de cette fonction et « c’est dans ces trois ordres habilement liés entre eux que consiste la république ; le Sénat propose, le peuple décide, et le magistrat exécute » (ibid., p. 247). Ce dispositif, qui se présente comme un mélange « habile » de monarchie, d’aristocratie et de démocratie, vise à soustraire la république à toute forme de corruption et de conflit pour assurer sa perpétuation. Là encore contre Machiavel, Harrington affirme qu’une distinction essentielle doit être faite entre une république égale et une république inégale.
Car faire une république inégale, c’est la diviser en différents partis, qui sont dans des querelles continuelles, un des partis cherchant à conserver sa prééminence et l’inégalité, l’autre faisant ses efforts pour atteindre à l’égalité. Ce fut là ce qui fit naître à Rome les débats perpétuels entre le peuple et la noblesse ou le Sénat. Mais dans une république égale, il ne peut pas plus y avoir de discorde qu’il n’y a de surbalance entre des poids égaux ; c’est pourquoi, dans la république de Venise, dont la Constitution est la plus égale de toutes, il ne s’éleva jamais aucun débat entre le Sénat et le peuple (ibid., p. 256).
Aussi, pour être parfait, ce modèle doit encore préciser le principe de la rotation qui correspond au renouvellement périodique de l’ensemble ou d’une partie des membres des différentes assemblées et de la magistrature par « l’élection ou les suffrages du peuple ». Harrington ajoute que « le contraire est la prolongation de la magistrature, ce qui arrête la rotation et détruit la vie ou le mouvement naturel de la république » (ibid., p. 257). En fait, comme l’indique Pierre Lurbe, lorsque la république est égale, ce n’est pas parce que les citoyens seraient fondamentalement égaux, 159« mais c’est parce qu’elle est fondée sur un fonctionnement régulier de ses institutions à travers le temps qui la rend substantiellement identique à elle-même » (Lurbe, 2007, p. 96). Plus que l’égalité, c’est en fait l’équilibre ou l’harmonie que recherche Harrington parce que pour lui, « il n’y a rien de plus beau que de tirer du chaos, ou de la confusion, les ordres d’une république bien organisée » (Harrington, 1656, p. 456). Il est donc contraint d’écarter l’élément de contingence ou de hasard que Machiavel attachait à l’idée de fortune, pour se limiter à concevoir « un monde de mouvement perpétuel, enfermé dans une paix permanente » (Scott, 1993, p. 162), dans lequel sa notion de « mouvement naturel » d’une république n’est au mieux qu’une illusion.
Le modèle de république élaboré par Harrington est donc radicalement différent de celui de Machiavel qui, hostile à la république aristocratique de Venise, opte au contraire pour le modèle de Rome, dont la caractéristique principale est de se construire en réaction aux « accidents de l’histoire » (Audier, 2015, p. 19). La rupture analytique introduite par Machiavel par rapport au républicanisme classique consiste ainsi à associer une conception cyclique de l’histoire à une approche agonistique du politique.
Dans leur évolution, les pays vont d’ordinaire de l’ordre au désordre, puis passent du désordre à l’ordre. Car, ne pouvant s’arrêter, les choses du monde, lorsqu’elles arrivent à leur ultime perfection, ne peuvent plus s’élever et doivent donc décliner. De même, une fois descendues et parvenues au fond à cause du désordre, ne pouvant plus descendre, elles sont contraintes de s’élever. Ainsi l’on descend toujours du bien vers le mal et l’on monte du mal vers le bien (Machiavel, 1525, p. 829).
Le moteur de cette dynamique cyclique réside dans le conflit permanent qui oppose les grands et le peuple parce qu’ils poursuivent des fins contradictoires : « En chaque cité l’on trouve ces deux humeurs différentes ; cela naît de ce que le peuple désire n’être ni commandé ni opprimé par les grands, et que les grands désirent commander et opprimer le peuple » (Machiavel, 1513, p. 133). Un tel conflit est essentiel pour la conservation de la république puisque Machiavel explique, à propos de ces deux humeurs, que « toutes les lois favorables à la liberté procèdent de leur opposition » (Machiavel, 1531, p. 196). Il rompt ainsi avec la tradition humaniste qui considérait que l’intérêt supérieur de la cité résidait avant tout dans l’harmonie sociale. Au modèle de Venise, 160il préfère le modèle de Rome, car « ceux qui condamnent les troubles advenus entre les nobles et la plèbe blâme ce qui fut la cause première de la liberté de Rome » (ibid.). L’agitation, les troubles, les tumultes sont donc indispensables au maintien et au développement de la république ; en d’autres termes, « la république ne peut vivre et se développer que si elle n’est pas en paix » (Guineret, 2006, p. 138).
Ce conflit des humeurs ne fait qu’exprimer chez Machiavel une articulation singulière du politique à l’économique. Selon le Secrétaire florentin, c’est le développement de la richesse qui viendrait corrompre les républiques et provoquer leur ruine, parce qu’en favorisant l’inégalité entre les citoyens, elle entraînerait la perte de leur liberté. Il observe en effet que « ces cités où la liberté s’est maintenue et le régime n’est pas corrompu n’admettent pas qu’un de leurs citoyens vive comme un noble. Elles maintiennent en leur sein une parfaite égalité et sont très hostiles aux seigneurs et aux nobles vivant dans le pays » (Machiavel, 1531, p. 281).
Le terme de noble désigne les hommes riches et oisifs, c’est-à-dire les hommes qui vivent largement des revenus de leurs propriétés, sans avoir besoin de travailler la terre ou d’avoir une autre profession. Or pour Machiavel, « ces gens-là sont nuisibles dans chaque république et dans chaque pays ; mais plus nuisibles encore sont ceux qui, outre leurs biens susdits, ont encore des châteaux et des sujets sous leurs ordres. (…) Il en découle que, dans ces pays, il n’est jamais apparu de république ni de régime libre, parce que ces sortes d’hommes sont totalement opposées à toute liberté » (ibid.). C’est pour cette raison qu’il soutient l’idée que la chose la plus utile dans une république consiste à maintenir les citoyens dans la pauvreté, de manière à garantir l’égalité, car « la pauvreté est plus féconde que la richesse, que l’une a été l’honneur des cités, des pays, des religions et que l’autre les a ruinés » (ibid., p. 426 et 427).
Cependant, lorsque Machiavel affirme que la richesse est la ruine des républiques, c’est de la richesse privée dont il parle, celle des particuliers, et non de celle de l’État. Pour lui, en effet, « les républiques bien ordonnées doivent avoir de riches finances et des citoyens pauvres » (ibid., p. 253). Il convient néanmoins de relativiser ce constat pour deux raisons. D’une part, chez Machiavel la pauvreté n’est pas synonyme de dénuement mais de frugalité puisqu’il cite à l’appui de sa démonstration l’exemple de Cincinnatus et le fait qu’à l’époque de la république 161romaine, « la pauvreté n’empêchait personne d’accéder à une fonction ou à une dignité et que l’on allait cherchait le mérite sous quelque toit qu’il habite » (ibid., p. 426). D’autre part, il n’est pas fondamentalement hostile à l’idée que le développement économique puisse être favorisé.
Un prince doit encore montrer qu’il aime les talents en donnant l’hospitalité aux gens de talent, et honorer ceux qui excellent dans une profession. Ensuite, il doit encourager ses concitoyens à pouvoir exercer paisiblement leurs métiers, dans le commerce, l’agriculture et tout autre métier des hommes ; que l’un ne craigne pas d’embellir sa propriété de crainte qu’elle lui soit ôtée, ni l’autre d’ouvrir un nouveau trafic par peur des impôts ; mais il doit prévoir des récompenses pour qui veut faire ces choses et pour quiconque pense d’une façon quelconque à développer sa cité ou son État (Machiavel, 1513, p. 168-169).
Il n’en reste pas moins que, même si elles sont instituées sur ces bases, de telles républiques ne sauraient résister aux hasards de la nécessité et de la fortune.
La nécessité vous contraint à de nombreuses choses auxquelles la raison ne vous pousse pas. Si bien que, ayant organisé une république capable de se maintenir sans s’agrandir, si la nécessité vous contraint à le faire, ses fondements seront détruits et elle s’écroulera promptement. D’autre part, si le ciel lui est assez favorable pour qu’elle n’ait pas à faire la guerre, il en résultera que l’oisiveté l’amollira ou la divisera. Ces deux choses ensemble, ou chacune séparément, seront cause de sa ruine (Machiavel, 1531, p. 203).
L’oisiveté engendrée par la richesse et le luxe s’oppose donc à l’action et vient corrompre le fondement de la république, qui doit reposer sur la vertu civique, seul moyen de résister au cycle de la fortune4. Machiavel note en effet qu’il est impossible à un État de vivre en paix et de jouir de sa liberté, car, s’il n’attaque pas les autres, il sera attaqué, et s’il n’a pas d’ennemi extérieur, il le trouvera chez lui en raison de l’opposition entre les grands et le peuple. Le conflit des humeurs se double donc de la possibilité toujours présente d’un conflit extérieur, qui requiert que l’État soit institué en vue de la guerre et non de la richesse, que les citoyens soient armés et que l’art de la guerre soit l’unique objet du 162Prince (Faraklas, 1997). Il ne fait aucun doute pour Machiavel que la vertu militaire est le plus sûr moyen de dompter la fortune, car « là où il y a une bonne armée, il faut qu’il y ait de bonnes institutions et qu’il est bien rare alors que la fortune ne soit pas favorable » (Machiavel, 1531, p. 196). Le rôle négatif assigné à la richesse le conduit donc à affirmer :
Il ne peut y avoir d’idée plus fausse que l’opinion générale selon laquelle l’argent est le nerf de la guerre. (…) ce n’est pas l’or, comme le proclame l’opinion générale, qui est le nerf de la guerre, mais les bons soldats. L’or ne suffit pas à trouver de bons soldats, mais ceux-ci suffisent à trouver de l’or (Machiavel, [1531] 1996, p. 314-315).
En s’écartant ainsi de l’opinion commune, Machiavel ouvre bien la possibilité de concevoir l’économie politique, même s’il n’explore pas véritablement ce nouveau champ. C’est dans cette perspective que vient s’inscrire la réflexion économique de Francis Bacon.
II. Le conflit dans la réflexion économique
de Francis Bacon
Comme Machiavel, Francis Bacon considère que l’enrichissement des États engendre progressivement l’affaiblissement de leur vertu guerrière originelle qui annonce leur déclin et conduit pour finir à leur ruine : « Quand un État belliqueux devient mou et efféminé, on peut être assuré de la guerre ; car ces États se sont d’ordinaire enrichis dans le temps qu’ils dégénéraient, et le butin est une tentation à la guerre que le déclin de leur valeur encourage » (Bacon, 1625, lviii, p. 299). Tout l’enjeu de l’art de gouverner est alors de savoir comment parvenir à ralentir ce mouvement inéluctable. Les questions économiques se retrouvent donc placées au cœur de la science du gouvernement. Dans son ouvrage De la dignité et de l’accroissement des sciences (1623), Bacon assimile l’art de gouverner à « la doctrine de l’administration de la république ; doctrine dans laquelle est comprise l’économique, comme la famille l’est dans la cité » (Bacon, 1623, viii, 3, p. 234). Il précise également que « toutes les espèces de moyens dont se compose l’art de gouverner, embrassent 163trois offices politiques ; savoir : 1o celui de conserver un État ; 2o celui de le rendre heureux et florissant ; 3o celui de l’agrandir et d’en reculer les limites » (ibid.).
Considérant cependant que les deux premiers offices ont déjà été étudiés, Bacon se restreint au troisième, en proposant « un traité sommaire de l’art de reculer les limites d’un empire ». Ce court traité se présente comme une synthèse d’idées qu’il a développées antérieurement, d’abord dans sa « Lettre au Roi Jacques, sur la véritable grandeur du Royaume de Grande-Bretagne » (1608) et ensuite dans son essai « De la véritable grandeur des États et des royaumes », paru dans l’édition de 1612 de ses Essais de morale et de politique. La récurrence de ce thème en souligne toute l’importance, car aux yeux de Bacon la poursuite de la grandeur se présente comme le seul véritable moyen de résister aux vicissitudes des choses, qui font que « les États sont exposés à deux dangers : au dehors l’invasion, au dedans la révolte » (Bacon, 1608, p. 756). Face à ces deux conflits, Bacon est convaincu que : « Au dedans, la justice est la meilleure garantie ; au dehors, soyez prêts à la guerre, c’est le plus sûr moyen d’avoir la paix » (Bacon, 1616, p. 773).
La difficulté que pose le conflit extérieur est de savoir comment se prémunir contre la menace réelle ou potentielle des pays voisins. Bacon considère que, dans ce domaine, il est impossible de donner de règles générales en raison de la très grande diversité des situations. Il précise néanmoins qu’il y en existe une « qui vaut dans tous les cas, savoir de faire bonne garde, afin que nul de ces voisins, par l’accroissement de son territoire, par l’extension de son commerce, par des empiètements, etc., ne s’agrandisse jusqu’à devenir plus gênant qu’il n’était » (Bacon, 1625, xix, p. 99). Toutefois, si la vigilance est nécessaire, elle n’est pas suffisante, et il est indispensable de considérer que « La juste crainte d’un danger menaçant est une cause légitime de guerre » (ibid., p. 101). Aussi, le plus sûr moyen de prévenir la menace d’une autre nation est de l’éviter en frappant le premier. Chercher à agrandir ou à reculer les limites de son État se présente donc bien comme le moyen dont doivent user les souverains pour se garder des vicissitudes des choses et des hasards de la fortune. Il est toutefois important pour ces derniers de ne pas se tromper, car « il n’y a rien dans les affaires politiques qui soit plus sujet à l’erreur que l’évaluation vraie et le jugement exact de la puissance ou de la force d’un État » (Bacon, 1625, xxix, p. 151 et 153).
164Toutefois, Bacon précise que sur cette question, ce ne sont pas fondamentalement les forces matérielles qui comptent ; mais bien la vertu guerrière des hommes. Sa conception est ainsi très proche de celle de Machiavel puisqu’il affirme que, « pour la grandeur et la domination, il importe avant tout qu’une nation fasse du métier des armes l’essentiel de son honneur, de son étude et de son occupation » (ibid., p. 161). Il n’est donc pas surprenant que Bacon en appelle explicitement à l’autorité de Machiavel pour récuser l’idée que l’argent serait le nerf de la guerre.
L’opinion de Machiavel n’est pas non plus à mépriser, surtout quand on pense qu’il avait sous les yeux l’exemple de son pays et de son siècle. Il se moque de ce vulgaire préjugé fondé sur un discours de Mutianus, lieutenant de Vespasien, qui disait que l’argent est le nerf de la guerre ; Machiavel dit que c’est une dérision, et qu’il n’y a pas d’autres nerfs de guerre que les nerfs et les muscles des hommes qui savent se battre, et que jamais peuple pauvre et vaillant n’eut à lutter contre un peuple riche sans lui faire payer au moins tous les frais de la guerre (Bacon, 1608, p. 759).
Cette indispensable vocation guerrière n’implique pas cependant que Bacon dédaigne complètement le rôle de la richesse. Bien au contraire, même s’il reconnaît que dans la définition de la grandeur des États, « on attribue trop de valeur aux richesses et aux revenus » (ibid., p. 756), il affirme néanmoins que la richesse ne doit pas être négligée, parce qu’elle aide et soutient la poursuite de la grandeur.
Je ne saurais mieux dénommer les richesses que les bagages de la vertu. Le mot latin est meilleur encore : impedimenta, entraves ; car la richesse est pour la vertu ce que sont pour une armée ses bagages. On ne peut s’en passer, ni les abandonner, mais ils empêtrent la marche ; et parfois même le soin qu’on y accorde fait perdre ou dérange la victoire (Bacon, 1625, xxxiv, p. 183).
Grandeur et richesse sont dès lors étroitement associées puisque le but de la véritable grandeur des royaumes et des républiques est « d’agrandir un État en force, en richesse et en succès » (ibid., xxix, p. 151). Aussi, Bacon réaffirme la nécessité de maintenir une bonne proportion entre les grands et le peuple, car « dans les pays où les gentilshommes sont trop nombreux, la classe moyenne sera avilie ; et on en arrivera à ceci qu’il n’y aura pas un homme sur dix pour porter le casque, notamment dans l’infanterie, qui est le nerf d’une armée » (ibid., xxix, p. 155-157). Il souligne également l’importance qu’il convient d’accorder à la répartition 165de cette richesse pour éviter qu’elle s’accumule entre les mains des nobles et des gentilshommes. Dans cette perspective, il fait l’éloge de la politique du roi Henry VII, qui est parvenue à « instituer des domaines et des fermes d’un même modèle – c’est-à-dire possédant une proportion fixée de terres capables de nourrir et de maintenir les sujets dans une aisance suffisante et dans une condition libre, et de laisser la charrue aux mains des propriétaires au lieu de simples journaliers » (ibid., p. 157).
Chez Bacon, le niveau international vient donc s’imbriquer dans le niveau national puisque l’organisation de la propriété terrienne a une incidence directe sur la grandeur militaire. De même, toute conquête ayant pour effet d’étendre le territoire national, soulève la question de sa gestion. Ici encore, Bacon reprend Machiavel et oppose comme lui la politique de Rome à celle de Sparte. La Grande-Bretagne doit en effet suivre le modèle romain, non seulement en naturalisant les étrangers, mais aussi dans son « usage de fonder des colonies », que Bacon présente comme le chemin assuré de la grandeur. À propos de cette question, à laquelle il consacre son essai xxxiii, Bacon ajoute que « c’est chose honteuse et funeste que de prendre l’écume d’un peuple et des condamnés pervers pour en faire des colons » (ibid., xxxiii, p. 179). Il conçoit au contraire la colonisation comme une sorte d’extension de la nation d’origine, puisqu’il tient « les colonies nouvelles pour les enfants des anciens royaumes » (ibid., p. 177), auxquelles il faut donc laisser le temps de se développer.
Enfin, l’imbrication de l’international dans le national se retrouve dans son analyse du commerce extérieur. Pour Bacon, en effet, ce n’est pas le commerce extérieur qui est important, mais le commerce intérieur, car « c’est celui-là qui est essentiel, qui fait vivre les sujets du royaume, et qui est la base de celui que l’on fait à l’étranger. (…) Si le premier a pour but le nécessaire, le dernier a en vue l’utile et l’agréable » (Bacon, 1616, p. 775). Pour autant, il ne vante pas les mérites de l’autarcie puisqu’il assimile l’expansion commerciale à l’expansion territoriale. S’il ne fait aucun doute qu’étendre son territoire ne peut se faire qu’au détriment du territoire de son voisin, il en va de même avec le commerce : « La prospérité d’un État doit se faire aux dépends de l’étranger puisque ce qui est gagné d’un côté doit être perdu d’un autre » (Bacon, 1625, xv, p. 77). Le commerce extérieur étant une source de richesse, il contribue directement à la grandeur de la nation à condition d’être pratiqué avec sagesse.
166Ce royaume s’est depuis quelques années considérablement enrichi par le commerce extérieur. Si ce commerce se fait avec sagesse, il ne peut manquer de devenir une source inépuisable de richesses. Il faut pour cela avoir soin que l’exportation surpasse l’importation en marchandises ; autrement nous serions obligés de payer la différence en argent (Bacon, 1616, p. 776).
La sagesse dont parle Bacon requière l’application de deux principes essentiels : d’une part, « il faut surtout se garder d’autoriser des monopoles sous de spécieux prétextes de bien public. Le monopole est le chancre du commerce » (ibid., p. 776) ; d’autre part, il faut être attentif à la balance du commerce, car « de cette manière la richesse du royaume augmentera sans cesse, puisque la balance nous sera payée en argent monnayé » (ibid., p. 778).
Plus généralement, Francis Bacon considère que l’enrichissement par le commerce extérieur passe nécessairement par un développement de l’économie nationale et principalement par une amélioration des conditions de production de l’agriculture. Pour lui, « il n’y a pas de meilleur placement d’argent. Le roi ne peut reculer les bornes de son royaume insulaire, mais il peut en doubler les revenus et la population par un bon système d’agriculture » (ibid., p. 778-779). À cet avantage qu’offre une agriculture florissante s’ajoute le fait que les agriculteurs font généralement d’excellents soldats, « notamment, nous dit Bacon, dans l’infanterie, qui est le nerf d’une armée » (Bacon, 1625, xxix, p. 157), et ceci d’autant plus qu’ils sont indépendants, c’est-à-dire de condition libre et propriétaires de la terre qu’ils cultivent. Il conseille donc de laisser tous les métiers délicats aux étrangers et de cantonner l’essentiel du peuple dans les travaux relevant des catégories suivantes : « Laboureurs du sol, domestiques libres, et ouvriers des métiers virils et vigoureux : forgerons, maçons, charpentiers, etc. » (ibid., p. 161).
L’importance attribuée à l’économie nationale conduit Bacon à poser en termes nouveaux les problèmes relatifs aux risques de conflit intérieur. Si comme la plupart de ses contemporains il trouve l’origine « des troubles et des séditions » dans « le dénuement et la misère de la nation » (Bacon, 1625, xv, p. 75), il ne se limite pas à en faire le constat mais en attribue l’origine à la manière dont la richesse se distribue entre les nobles et le peuple. Or, ces deux groupes ne jouent pas le même rôle dans le processus de production de la richesse.
167En règle générale, il faut veiller à ce que la population d’un royaume (surtout si elle n’est pas fauchée par les guerres) n’excède pas la production du pays évaluée seulement par le nombre, car un nombre moindre, dépensant plus et gagnant moins, use une nation plus vite qu’un nombre supérieur vivant plus frugalement et produisant davantage. C’est pourquoi l’accroissement de la noblesse et des autres degrés de l’aristocratie dans une proportion trop forte pour la masse du peuple réduit promptement un État au besoin ; de même l’excès du clergé, qui n’apporte rien au fonds commun ; et aussi lorsqu’il y a plus de clercs que les emplois n’en peuvent absorber (ibid., p. 77).
La référence à un tel rapport entre la taille de la population et la quantité de richesse produite, montre que Bacon considère que seule une partie de la population est active ou productrice de richesse, tandis que l’autre, qui regroupe la noblesse, le clergé et les clercs, est oisive. Ce résultat s’accompagne d’une autre idée importante, bien que plus implicite, qui est que la classe oisive serait entretenue par une sorte d’excédent ou de surplus de richesse résultant de la frugalité de la classe productive, c’est-à-dire du peuple. Une partie de cette classe oisive est ainsi entretenue par les grands ou les nobles parce que ces derniers accaparent l’essentiel de la richesse nette produite. En effet, « ces immenses fortunes ne se font que par l’absorption de la substance du grand nombre, suivant l’adage qui les compare à la rate, viscère qui ne se gonfle que quand le reste du corps languit et maigrit » (Bacon, 1608, p. 762). D’où la nécessité que la richesse ne soit pas détenue par un petit nombre de personnes et, en particulier, « accumulée entre les mains des nobles et des gentilshommes », mais bien qu’elle circule entre les différentes catégories qui composent la population active.
C’est tout le contraire dans les États dont le numéraire se trouve entre les mains des marchands, des bourgeois, des artisans, des tenanciers et des fermiers. Nos voisins des Pays-Bas m’en fournissent un exemple frappant ; car jamais, avec toute leur frugalité et leur industrie, ils n’auraient pu soutenir d’aussi lourdes charges, si ce n’était qu’il y avait parmi eux une rivalité et une émulation de travail excitées par la distribution à peu près égale de la richesse entre un grand nombre de personnes, et encore que cette richesse n’appartient pas exclusivement aux nobles, mais se trouve en grande partie entre les mains des travailleurs (ibid.).
Bacon défend donc la nécessité que la richesse se distribue largement au sein du peuple, favorisant ainsi une certaine égalité ; mais surtout que l’argent circule entre les mains des divers types de producteurs pour 168assurer le bon fonctionnement de l’activité économique de la nation. Ce n’est que de cette manière que la richesse devient avantageuse à la société. Pour illustrer son propos, Bacon n’hésite pas à affirmer que « l’argent est pareil au fumier, qui ne sert de rien s’il n’est épandu » (Bacon, 1625, xv, p. 77).
Or, l’un des phénomènes qui empêche que l’argent se répande dans la population active, c’est la persistance de l’usure qui vient entraver le bon fonctionnement de l’activité économique, « car, sans ce paresseux métier de l’usure, l’argent ne resterait pas oisif, mais serait pour une bonne part employé au commerce qui est la veine porte de la richesse dans l’État » (ibid., xli, p. 215). Pour empêcher que l’argent reste oisif, Bacon propose de faire une distinction entre deux formes d’usure qui reposeraient sur l’instauration de deux taux d’intérêt différents : « L’un courant et ouvert à tous, l’autre accordé seulement sur licence à certaines personnes et dans des places déterminées » (ibid.). Son idée consiste alors à réduire l’usure qui relève de la consommation à un taux peu élevé de cinq pour cent, de manière à soulager les particuliers qui empruntent, et à réserver aux seuls négociants reconnus l’accès à un taux plus élevé. Cette solution impose alors que :
Ces prêteurs patentés soient en nombre illimité, mais qu’ils soient confinés à certaines grandes villes et cités commerçantes ; ainsi ils auront de la peine à écouler l’argent d’autres prêteurs dans le reste du pays, et les neuf pour cent autorisés n’engloutiront pas l’intérêt normal de cinq pour cent, car les gens ne voudront pas prêter leurs écus à si longue distance et les risquer entre des mains inconnues (ibid.).
La solution retenue par Bacon explique peut-être pourquoi il ne participe pas au débat, opposant principalement Gerard de Malynes (1622, 1623) à Edward Misselden (1622, 1623), qui se déroule en Grande-Bretagne dans les années 1620. Il ne pouvait pas ignorer les termes de ce débat, mais ne les évoque jamais ; sans doute pour deux raisons. La première est qu’il traite de l’usure sans jamais aborder les questions de la monnaie et du change, qui sont au cœur de cette controverse. Ce constat suggère ainsi que Bacon ouvre bien une perspective originale puisqu’il n’adhère ni à la thèse de Malynes ni à celle de Misselden. La seconde raison vient confirmer en partie ce constat puisque, en distinguant deux taux d’intérêt, Bacon admet implicitement l’idée selon laquelle il existerait deux formes de circulation monétaire : l’une entre 169producteurs et consommateurs correspondant aux achats et aux ventes de marchandises ; l’autre pouvant être qualifiée de financière, puisque mettant uniquement en relation les producteurs et les négociants avec les prêteurs détenteurs de licence. Bien qu’une telle approche du fonctionnement de l’activité économique reste chez Francis Bacon à l’état d’une simple ébauche, il est possible d’en trouver une autre version plus élaborée, quoique présentée différemment, chez William Petty.
III. William Petty et la richesse publique
Si William Petty ne fait aucune référence à Machiavel, il se réclame en revanche explicitement de la démarche de Bacon. Dans la préface à son ouvrage L’anatomie politique de l’Irlande (1691), il note que « Sir Francis Bacon, dans son Advancement of Learning, a fait un judicieux parallèle sur beaucoup de points entre le corps naturel et le corps politique, et entre les arts respectifs de préservation de la santé et de la force » (Petty, 1691, p. 129). Il ajoute qu’il est donc raisonnable de considérer que « l’anatomie est le meilleur fondement de l’un et de l’autre, et que traiter de la politique sans connaître sa symétrie, sa structure et ses proportions est aussi désinvolte que la pratique des vieilles femmes et des empiriques » (ibid., p. 129). Ce constat fait semble-t-il écho à la remarque suivante de Bacon :
Il est fort improbable, en ce qui concerne la politique et le gouvernement, que le savoir nuise plutôt qu’il n’aide : nous savons qu’on considère que c’est une erreur de confier son corps à des médecins empiriques, qui ont généralement quelques recettes agréables auxquelles ils se fient avec une audace excessive, mais qui ne connaissent ni les causes des maladies, ni les complexions des passions, ni la gravité des symptômes, ni les vrais moyens thérapeutiques. (…) Pour la même raison, si les États sont dirigés par des hommes d’État empiriques, sans alliance avec des hommes instruits, cela ne peut que conduire à des conséquences redoutables (Bacon, 1605, p. 14-15).
Petty reconnaît donc à la suite de Bacon que le savoir est indispensable à l’action politique et qu’en matière de santé et de force économique il convient de disposer d’une connaissance précise. Cependant, à la différence 170de Bacon qui considérait que « le jugement exact de la puissance ou de la force d’un État » est particulièrement « sujet à l’erreur », Petty est au contraire pleinement convaincu que la méthode de l’anatomie politique est susceptible de fournir les bases d’une telle connaissance parce que, décrivant la structure et l’organisation du royaume, elle offre les moyens d’en comprendre le fonctionnement5. Sur ce point, il ne fait que prolonger l’argument baconien selon lequel le développement de la connaissance ne peut être mené à bien « sans qu’ait été faite du monde la dissection et l’anatomie la plus exacte » (Bacon, 1620, I, 124, p. 177)6. Toutefois, si une anatomie du corps politique est indispensable, elle n’est pas pour autant suffisante pour éviter les erreurs dans l’estimation de la puissance. Elle doit encore être complétée par la méthode de l’arithmétique politique. En permettant de « s’exprimer en termes de nombres, de poids ou de mesures », cette méthode privilégie « uniquement des arguments de raison » pour justifier l’action de l’État, « en laissant de côté ceux qui dépendent des idées, des opinions, des appétits et des passions versatiles des hommes particuliers » (Petty, 1690, p. 135). L’enjeu n’est donc pas de réduire la politique à un calcul, mais d’éviter les contestations sans fin et les décisions arbitraires. Plus précisément, il s’agit pour Petty de montrer que « les obstacles à la grandeur de l’Angleterre ne sont que contingents et peuvent être levés » (ibid., p. 172), à condition que le souverain fonde son action sur une connaissance plus précise de la situation du royaume en matière de population, de commerce, de richesse et de revenu, que seule l’arithmétique politique peut lui fournir7.
Dans cette perspective, Petty introduit une distinction entre la richesse du royaume et ce qu’il nomme la « richesse publique ». Si la première repose sur l’agriculture, l’industrie et le commerce, la seconde passe par une fiscalité bien ordonnée. Ces deux notions ne sont donc pas indépendantes puisque la seconde est en grande partie issue de la 171première, mais c’est bien la richesse publique qui est essentielle, car c’est d’elle dont dépend fondamentalement la grandeur d’un royaume.
La richesse d’un souverain est de trois sortes : la première est la richesse de ses sujets, la seconde la quote-part qui lui est donnée pour assurer la défense du peuple, maintenir l’honneur et la splendeur publics, et accomplir pour le bien commun ce qu’un individu ou quelques-uns ne pourraient réaliser seuls. La troisième sorte est la proportion de cette quote-part dont le roi peut disposer à son gré et selon sa propre inclination, sans avoir à en rendre compte (ibid., p. 173).
La richesse publique correspond donc à la fraction de la richesse du royaume que le souverain prélève sur ses sujets. Elle sert à financer les différentes sortes de dépenses publiques que Petty énumère au début de de son Traité des taxes et contributions (1662). Il distingue ainsi plusieurs catégories de dépenses. Premièrement, « celles qu’exigent sa défense sur terre et sur mer, le maintien de la paix à l’intérieur et à l’extérieur » (Petty, 1662, p. 43), qui en temps de guerre peuvent devenir très importantes. Deuxièmement, celles qui concernent « l’entretien des gouvernants » (ibid.), dans lesquelles il range « les dépenses liées à l’administration de la justice » (ibid.). Troisièmement, les dépenses concernant « le soin des âmes et la direction des consciences », dont dit-il, « on pourrait penser (parce qu’elles regardent l’au-delà et seulement l’intérêt particulier de chacun dans l’autre monde), qu’elles ne devraient pas être à la charge du public dans celui-ci » (ibid., p. 44). Il admet néanmoins « qu’une contribution publique est nécessaire pour que les hommes soient instruits des lois de Dieu », mais également parce que « ceux qui travaillent à ce service public doivent aussi être entretenus avec suffisamment de splendeur » (ibid.). Quatrièmement, les dépenses publiques qui concernent « les écoles et les universités » et cinquièmement les dépenses pour « l’entretien des orphelins et des enfants trouvés et exposés, qui sont aussi des orphelins ; et celui des impotents de toutes sortes, sans oublier ceux qui sont sans travail » (ibid.). Enfin, Petty ajoute les dépenses relatives à « l’entretien des routes, des rivières navigables, des aqueducs, des ponts, des ports, et d’autres choses d’utilité et d’intérêt généraux » (ibid., p. 45).
En procédant à ce rappel, Petty confirme l’importance politique qu’il attribue à la mise en œuvre d’un système fiscal efficace. Il remarque toutefois qu’un certain nombre de causes viennent hypothéquer le recouvrement des impôts, parmi lesquelles la principale est « la répugnance 172des gens à payer leurs taxes » (ibid., p. 45). Or cette réticence, qui est fondée sur l’opinion ou sur le soupçon que « l’impôt est trop élevé, qu’il est détourné ou mal dépensé, ou, qu’il est inégalement levé ou réparti » (ibid.), peut devenir une source de troubles politiques. Petty admet, comme Bacon, que les principales causes de sédition et de guerres civiles résident dans le fait « que la richesse de la nation est entre les mains d’un trop petit nombre, et qu’on ne dispose pas de moyens sûrs pour préserver tous les hommes de la nécessité de mendier, de voler ou de se faire soldats. Elles viennent aussi de ce qu’on permet à certains de vivre dans le luxe, tandis que d’autres meurent de faim inutilement » (ibid., p. 47) ; ce qui a pour conséquence que « le pauvre se plaint toujours du riche ; l’un s’efforce de tromper ou d’opprimer l’autre, et ceux qui sont écartés du pouvoir trouvent toujours à redire contre ceux qui le détiennent » (Petty, 1672, p. 158).
Ce constat typiquement machiavélien n’incite cependant pas Petty à préconiser l’instauration d’un régime politique plus égalitaire. Il est au contraire convaincu de l’impossibilité d’éradiquer la pauvreté et l’inégalité de la société : « Que certains soient plus pauvres que d’autres, cela a toujours été et sera toujours. Et que beaucoup soient naturellement mécontents et envieux, c’est un mal aussi vieux que le monde » (Petty, 1690, p. 134-135). En revanche, il considère que le risque de sédition pour raison fiscale peut être limité parce qu’il lui semble possible de « réduire les causes de la résistance à l’impôt » (Petty, 1662, p. 54), en modifiant le montant des prélèvements. En effet, sur les six catégories de dépenses publiques qu’il distingue, Petty indique que les quatre premières peuvent, dans certaines circonstances, être diminuées mais il recommande au contraire d’augmenter les deux dernières qui concernent respectivement l’entretien des pauvres et celui des voies de communication.
Pour justifier ce conseil Petty propose une nouvelle approche théorique fondée sur la notion de surplus8, qui était implicitement présente chez Bacon, mais qu’il introduit en développant un raisonnement en trois étapes. Tout d’abord, il précise que le « soin des pauvres » doit être assuré par l’État dans des asiles, des hôpitaux ou encore des orphelinats. 173Toutefois, l’intervention publique ne peut se limiter à simplement secourir les miséreux, elle doit également combattre la fainéantise en trouvant « des emplois permanents pour tous les autres indigents » (ibid., p. 52). Ensuite, à la question de savoir « quels seront ces emplois ? », il commence par répondre :
ce qui se rapportent à la sixième branche des dépenses publiques, c’est-à-dire l’élargissement, la consolidation et l’aplanissement des routes, ce qui réduira beaucoup le coût et la fatigue des voyages et des transports ; le curage des rivières pour les rendre navigables ; la plantation d’arbres pour la production de bois et de fruits et pour l’agrément dans les endroits appropriés ; la construction de ponts et de chaussés, l’exploitation des mines, des carrières et des houillères, la manufacture du fer, etc. (Petty, 1662, p. 52).
Et enfin, pour expliquer « qui paiera ces hommes », Petty développe l’exemple suivant :
S’il y a 1000 hommes sur un territoire, dont 100 peuvent produire la nourriture et les vêtements nécessaires aux 1000 ; si 200 autres produisent une quantité de marchandises que d’autres nations sont prêtes à échanger contre leurs propres produits ou de l’argent ; si 400 autres travaillent à l’ornementation, à l’agrément et à la splendeur de tous ; s’il y a 200 gouvernants, théologiens, hommes de loi, médecins, négociants et détaillants, ce qui fait 900 en tout ; la question est la suivante : puisqu’il y a assez de nourriture pour les 100 hommes en surnombre, comment devront-ils se la procurer ? (ibid., p. 53).
Afin que ces hommes ne meurent de faim ou ne tombent dans la mendicité ou le vol, qui sont sévèrement punis par la loi, Petty suggère que :
Pour toutes ces raisons, il sera certainement plus sûr de leur accorder le superflu qui sinon serait perdu et gaspillé, ou dépensé en frivolités. Et au cas où il n’y aurait pas de surplus, il serait bon de réduire un peu la part des autres, en quantité ou en qualité ; car peu d’hommes consomment moins du double de ce qui pourrait leur suffire, s’ils s’en tenaient aux exigences de la nature (ibid.).
En mobilisant ce concept de surplus, Petty se différencie de la plupart de ses contemporains puisqu’il ne considère pas que la richesse découle directement du commerce extérieur. Au contraire, il montre qu’elle provient de la productivité du travail agricole, qui permet de nourrir non seulement les agriculteurs mais aussi les artisans et les commerçants, ainsi que toutes les autres catégories de la population travaillant directement ou 174indirectement au bon fonctionnement de la société. De plus, l’utilisation de ce surplus pour améliorer les voies de communications et non pour des dépenses futiles, ne peut que contribuer à « enrichir le royaume et augmenter sa gloire » (Petty, 1691, p 124). Toutefois, la réussite de l’action publique ne dépend pas uniquement de la dépense publique, elle est également soumise à la manière dont l’impôt est prélevé par le souverain, car « s’il ne connaît pas la richesse de son peuple, le prince ne sait pas ce qu’il peut supporter ; et s’il ne connaît pas son commerce, il ne peut juger du moment le plus opportun pour réclamer ses subsides » (ibid., p. 56). Au total, cette réticence à payer l’impôt provient donc non seulement des insuffisances du système fiscal lui-même, mais aussi des imperfections caractérisant les méthodes d’imposition. Ce sont ces dernières qui constituent l’obstacle essentiel à la grandeur du royaume.
En Angleterre, les impôts sont levés non pas sur les dépenses, mais sur l’ensemble des biens ; non pas sur les terres, le capital et le travail, mais principalement sur la terre ; et non pas selon une règle égale et impartiale, mais selon l’influence fluctuante des partis et des factions. En outre, le système de collecte de ces impôts n’est pas le plus commode ni le plus économique, car elle est confiée à des fermiers, qui l’afferment à leur tour à tel ou tel autre sans vraiment savoir ce qu’ils sont ; mais de telle sorte qu’en fin de compte, le pauvre peuple paie deux fois plus que ne reçoit le roi (Petty, 1690, p. 174-175).
Il est alors possible d’observer que le conflit entre les nobles et le peuple s’étend également au domaine de l’impôt, dans la mesure où c’est le peuple qui se retrouve principalement désavantagé par le système fiscal. Petty remarque en effet que « si les charges publiques étaient réparties proportionnellement, nul ne devrait payer plus de 1/10 de tous ses biens. Cela signifie que selon le système actuel, certains paient quatre fois plus qu’ils ne devraient, ou qu’il est nécessaire. C’est cette disproportion qui fait la véritable oppression des taxes » (Petty, 1691, p. 113). Une telle situation est d’autant plus dommageable pour la grandeur du royaume que Petty voit dans la fiscalité le moyen de redistribuer une partie de la richesse de la classe oisive à la classe active.
Les taxes, si elles sont immédiatement dépensées en produits du pays, ne font guère de tort au peuple dans son ensemble, et affectent seulement les richesses et la fortune de certains individus ; notamment en les transférant des propriétaires fonciers et des paresseux aux hommes ingénieux et industrieux (Petty, 1662, p. 58).
175Il existe donc un enjeu politique essentiel, en raison de ses retombées économiques, à bien connaître « les différentes méthodes et expédients permettant de collecter ces impôts de la manière la plus commode, la plus rapide et la moins sensible » (ibid., p. 59), de façon à pouvoir mettre en place un système fiscal qui soit plus égalitaire et plus impartial, car « aussi lourd que soit l’impôt, s’il est proportionnel pour tous, nul ne devient moins riche en l’acquittant » (ibid., p. 54). Le problème diagnostiqué par Petty est alors double : d’une part, il faut déterminer quel est le montant du surplus ou, plus précisément, quelle part « du produit total de leurs terres et de leur travail devrait constituer l’excisum, c’est-à-dire la part à retrancher du tout et à mettre de côté pour l’usage public » ; d’autre part, il faut « savoir comment l’un ou l’autre de ces prélèvements [sur la terre et sur le travail] sera effectué » (ibid.).
Pour ce qui est de taxer le travail, Petty défend l’idée que « tous les hommes ne devraient contribuer aux dépenses publiques que selon la part et l’intérêt qu’ils ont à la paix publique, c’est-à-dire selon leurs biens et leur richesse » (ibid., p. 104). Il préconise donc un impôt indirect sur la consommation. Cette méthode présente un certain nombre d’avantages, parmi lesquels Petty retient tout d’abord qu’elle favorise la frugalité car « cette taxe n’est imposée à personne et est très légère pour ceux qui se contentent des biens naturels et nécessaires » ; ensuite le fait que « si elle n’est pas affermée, mais collectée de façon régulière, elle incite à l’économie, qui est le seul moyen d’enrichir une nation » ; et enfin, que « nul ne paie le double de ce qu’il doit, ou deux fois pour la même chose, car un bien ne peut être consommé qu’une fois » (ibid.).
Pour ce qui est de l’impôt foncier, les choses sont plus délicates parce qu’elles passent nécessairement par une évaluation de la rente. Dans ce but, Petty commence par supposer « qu’un homme puisse, de ses propres mains, cultiver du blé sur une certaine étendue de terre » (ibid., p. 63), c’est-à-dire, qu’il puisse réaliser l’ensemble des opérations nécessaires pour produire du blé et qu’il dispose de l’ensemble des moyens de production indispensables pour y parvenir. Il en déduit que : « lorsque cet homme a retranché du produit de sa moisson sa semence, sa nourriture et ce qu’il a échangé contre des vêtements et d’autres biens naturellement nécessaires, le blé qui lui reste constitue la rente naturelle et vraie de la terre » (ibid.). Comme cette rente se présente sous la forme d’une quantité physique de blé, Petty est logiquement conduit à se poser la question 176de savoir : « quelle est la valeur de ce blé ou cette rente en monnaie anglaise ? ». À cette question Petty répond : « qu’elle est égale à l’argent (money) qu’un autre homme seul peut économiser dans le même temps, en plus de ses dépenses, s’il s’est entièrement consacré à le produire » (ibid.). Pour illustrer son propos, Petty retient le cas d’un autre homme qui se rend dans un pays où il y a de l’argent, qui l’extrait, le raffine et le transporte au même endroit où l’autre homme a planté son blé. Il suppose également que le même homme, pendant tout le temps où il a travaillé l’argent, a aussi récolté la nourriture pour sa subsistance, et s’est procuré son vêtement. Il peut alors en déduit que « l’argent (silver) de l’un doit être estimé de valeur égale au blé de l’autre ; soit par exemple 20 onces pour le premier et 20 boisseaux pour l’autre. Il s’ensuit que le prix d’un boisseau de ce blé est égal à une once d’argent » (ibid., p. 64).
La principale implication de cette analyse est qu’en considérant que la production et l’échange ne se déroulent pas de manière simultanée, Petty est conduit à distinguer deux concepts de prix. Le premier est celui de « prix naturel » ou de « valeur intrinsèque », qui exprime les contraintes productives propres à l’économie considérée – puisque « le prix naturel est plus ou moins élevé selon qu’il faut plus ou moins de bras pour produire les biens naturels nécessaires » (ibid., p. 103) – et dont le principe de détermination est l’égalisation des rentes des producteurs. Le second est celui de « prix courant » ou de « valeur extrinsèque », qui se forme dans l’échange et obéit à des causes « accidentelles » et « contingentes » (ibid., p. 70 et p. 103), c’est-à-dire qui dépendent de phénomènes tels que « la nouveauté, la surprise, l’exemple des supérieurs et la croyance des gens en certains effets invérifiables des choses [qui] font augmenter ou diminuer le prix » (ibid.). Ces causes accidentelles ou contingentes traduisent ainsi la manière dont la vicissitude des choses se manifeste sur les marchés par des écarts entre prix courants et prix naturels, qui peuvent venir perturber le bon fonctionnement et donc la reproduction de l’activité économique.
177Conclusion
La particularité de l’approche de Francis Bacon et de William Petty est de se situer dans le prolongement de Machiavel en concevant le fonctionnement de la société sur le mode du conflit. Toutefois, à la différence du Secrétaire florentin, ils ne placent pas véritablement la dynamique engendrée par ce conflit sur le plan politique de la domination que les nobles ambitionnent sur le peuple, mais sur un plan plus économique en le rapportant à la production et à la répartition des richesses. Dès lors, tout comme il ne peut y avoir d’harmonie politique, il ne saurait y avoir d’harmonie économique ; ce qui explique que la perspective empruntée par Bacon et Petty ne peut être que différente de celle de James Harrington. Ce changement d’approche a deux conséquences importantes.
La première est qu’il devient nécessaire de relativiser l’idée avancée par Machiavel selon laquelle le développement de la richesse provoquerait la corruption et donc la ruine des républiques, parce qu’elle engendrerait un affaiblissement de la vertu guerrière, indispensable à leur conservation. Chez Bacon, en effet, la véritable grandeur des royaumes et des républiques dépend tout autant de l’existence d’une « race de guerriers » que d’une distribution relativement égalitaire de la richesse dans l’ensemble de la société et surtout de la nécessité qu’elle circule pour animer l’agriculture, l’industrie et le commerce. De même, si contrairement à Bacon, Petty ne reprend pas l’aphorisme selon lequel « l’argent n’est pas le nerf de la guerre », il ne le dénonce pas non plus. Il est même possible d’en trouver une formulation implicite dans son Arithmétique politique, lorsqu’il affirme que « la puissance maritime consiste principalement à avoir des hommes capables de combattre en mer » et qu’il ajoute : « ce ne sont pas les navires et les canons qui combattent, mais les hommes qui les manœuvrent et les dirigent » (Petty, 1690, p. 158 et 159)9. Pour le reste, sa conception est la même 178puisqu’il dénonce de manière identique les conséquences néfastes pour la richesse et la grandeur du royaume d’une répartition trop inégale des richesses ou d’une fiscalité arbitraire, qui sont l’une comme l’autre défavorables à la partie active de la population.
La deuxième conséquence est que la dimension civique de la vertu, qui désigne chez Machiavel l’amour de la liberté et du bien commun, mais aussi « l’énergie face à l’adversité » (Audier, 2015, p. 20), se prolonge chez Bacon mais emprunte avec Petty une nouvelle orientation. Cette énergie, qui animait le citoyen en armes et s’exprimait principalement sur le terrain politique, se manifeste désormais dans l’espace économique où elle vient caractériser le comportement de la fraction active de la population. Il convient toutefois de noter que son origine relève finalement du même registre, car si chez Machiavel « c’est à la religion païenne que Rome doit aussi sa grandeur » (ibid.), c’est à la liberté de conscience que Petty l’associe pour expliquer en partie la prospérité de la Hollande. Il observe en effet, que « les Hollandais étaient encore, il y a un siècle, un peuple pauvre et opprimé, vivant dans un pays naturellement froid et inhospitalier ; et qu’ils étaient en outre persécutés pour leur hétérodoxie en matière de religion » (Petty, 1690, p. 146). Il remarque également que « les dissidents de ce type sont, pour la plupart, des hommes réfléchis, sobres et patients, qui considèrent le travail et l’industrie comme un devoir envers Dieu (aussi erronées que soient leurs croyances) » (ibid., p. 147). Aussi, en adoptant le principe de la liberté de conscience, les hollandais ont choisi une politique qui ne pouvait que favoriser l’expansion de leur commerce. Ce n’est donc pas le fait d’avoir opté pour un gouvernement républicain qui est à l’origine de la réussite économique de la Hollande, mais celui d’avoir en quelque sorte libéré l’énergie de la partie la plus dynamique de la population grâce à la tolérance religieuse. Petty peut alors en conclure que « contrairement à ce que certains croient, le commerce n’est pas plus florissant sous les gouvernements populaires, mais plutôt que dans tous les États et sous tous les gouvernements, c’est la partie hétérodoxe de la population qui s’y emploie le plus vigoureusement, et ceux qui professent des doctrines différentes de celles qui sont publiquement établies » (ibid., p. 148).
179Toutefois, si la forme du gouvernement d’une nation reste secondaire, il n’en va pas de même de sa politique, c’est-à-dire de son action. Ainsi, l’instauration de la liberté de conscience apparaît bien comme une décision politique essentielle puisque « la chose la plus importante à prendre en compte est la superlucration ; car aussi nombreux que soient les sujets d’un prince, et aussi bon que soit son pays, si à cause de la paresse, des dépenses extravagantes, ou de l’oppression et de l’injustice, ce qui est gagné est aussitôt dépensé, l’État doit être considéré comme pauvre » (Petty, 1690, p. 140)10. L’enjeu est donc bien la richesse de l’État, qui dépend non seulement des « capitaux amassés par les hommes travailleurs et ingénieux » (ibid., p. 153), mais surtout du type de politique mise en œuvre par l’État. Pour le démontrer, Petty prend un exemple : « supposons, nous dit-il, que le capital de ces gens soit diminué par une taxe et transféré à des hommes qui ne font rien d’autre que manger et boire, chanter, jouer et danser ; ou même à des hommes qui s’adonnent à la métaphysique et autres spéculations inutiles, ou à toute autre occupation qui ne produit aucun bien matériel, ni aucun objet d’utilité ou de valeur réelle pour l’État » ; il en conclut que « dans ce cas, la richesse publique sera diminuée » (ibid.). Une telle politique ne peut être que néfaste, car toute réduction de la richesse publique se traduira nécessairement par une baisse des dépenses publiques, d’autant plus dommageable pour le bien commun qu’elle pourrait devenir cumulative.
Le discours économique de Petty continue donc de s’inscrire dans l’art de gouverner que Bacon définissait comme « la doctrine de l’administration de la république ». Sa finalité reste dès lors la même : il s’agit toujours de faire face à la vicissitude des choses et aux hasards de la fortune, qui découlent des accidents de l’histoire et de la dynamique engendrée par le conflit entre une noblesse oisive et un peuple entreprenant et laborieux. La logique de cette approche demeure donc celle inaugurée par Machiavel, avec pour seule différence que la révolution commerciale a eu pour conséquence de transformer progressivement un antagonisme sociopolitique en un clivage principalement économique entre oisifs et actifs. La poursuite de la prospérité peut alors venir remplacer la recherche de puissance et l’esprit de commerce se substituer à l’esprit de conquête. Petty personnifie pleinement cette évolution 180lorsqu’il critique « l’opinion erronée selon laquelle la grandeur et la gloire d’un prince résident dans l’étendue de son territoire plutôt que dans le nombre, les arts et l’industrie de son peuple, bien uni et bien gouverné » (Petty, 1662, p. 46). Son analyse se présente alors comme l’un des aboutissements possible de la manière dont la réflexion économique a pu progressivement pénétrer, par l’intermédiaire de Bacon, la pensée républicaine élaborée par Machiavel. Dans ce mouvement, l’arithmétique politique se substitue en quelque sorte à l’ancienne vertu, dont devait faire preuve le souverain pour parvenir à maîtriser la fortune, puisqu’elle renforce sa faculté politique de saisir l’occasion, en lui permettant de connaître le moment opportun pour agir.
181Bibliographie
Amati, Frank & Aspromourgos, Tony [1985], « Petty contra Hobbes : a previously untranslated manuscript », Journal of the History of Ideas, Vol. 46, No 1, p. 127-132.
Aspromourgos, Tony [1996], On the origins of classical economics, Londres, Routledge.
Audier, Serge [2005], Machiavel, conflit et liberté, Paris, Librairie philosophique J. Vrin et Éditions de l’EHESS.
Audier, Serge [2015], Les théories de la république, nouvelle édition, Collection Repères, Paris, La Découverte.
Bacon, Francis [1605], Du progrès et de la promotion des savoir, Avant-propos, traduction et notes par M. Le Dœuff, Paris, Gallimard, 1991.
Bacon, Francis [1608], « Lettre au Roi Jacques, sur la véritable grandeur du Royaume de Grande-Bretagne », in J.-A.-C. Buchon [1838], p. 755-763.
Bacon, Francis [1616], « Lettre à Sir Georges Villiers, sur la manière de se conduire dans sa place de premier ministre », in J.-A.-C. Buchon (1838), p. 764-781.
Bacon, Francis [1620], Novum Organum, Introduction, traduction et notes par M. Malherbe et J.-M. Pousseur, Paris, Presses Universitaires de France, 1986.
Bacon, Francis [1623], « De la dignité et de l’accroissement des sciences », in J.-A.-C. Buchon (1838), p. 16-258.
Bacon, Francis [1625], Essais, Traduction et introduction par M. Castelain, Paris, Aubier, Collection bilingue, 1948.
Buchon, Jean Alexandre C. [1838], Œuvres philosophiques, morales et politiques de François Bacon, Paris, Auguste Desrez.
Deleule, Didier [2010], Francis Bacon et la réforme du savoir, Paris, Hermann éditeurs.
Faraklas, Georges [1997], Machiavel le pouvoir du prince, Paris, Presses Universitaires de France.
Guineret, Hervé [2006], « L’art de la guerre et la question des armes propres », in Lectures de Machiavel, sous la direction de M. Gaille-Nikodimov et Th. Ménissier, Paris, Ellipses, p. 129-149.
Harrington, James [1656], Océana, Paris, Belin, 1995.
Hull, Charles Henry [1899], The Economic Writings of Sir William Petty, 2 volumes, Cambridge at the University Press.
Lefort, Claude [1978], « Machiavel : la dimension économique du politique », in C. Lefort, Les formes de l’histoire, Paris, Gallimard, p. 215-237.
182Lurbe, Pierre [2007], « La conception de la république dans Oceana de James Harrington », in Monarchie et république au xviie siècle, sous la direction de Y.C. Zarka, Paris, Presses Universitaires de France, p. 73-102.
Machiavel, Nicolas [1513], Le prince, in Machiavel [1996], p. 97-178.
Machiavel, Nicolas [1525], Histoire de Florence, in Machiavel [1996)], p. 651-1000.
Machiavel, Nicolas [1531], Discours sur la première décade de Tite-Live, in Machiavel [1996], p. 187-461.
Machiavel, Nicolas [1996], Œuvres, Ch. Bec (éd.), Paris, Robert Laffont.
Magnusson, Lars [1994], Mercantilism, the shaping of an economic language, Londres, Routledge.
Magnusson, Lars [1995], Mercantilism, 4 vol., Londres, Routledge.
Malynes, Gerard de [1622], The maintenance of free trade, New York, Clifton, A.M. Kelley, 1971.
Malynes, Gerard de [1623], The center of the circle of commerce, New York, Clifton, A.M. Kelley, 1973.
Marquer, Éric [2012], Léviathan et la loi des marchands, Paris, Classiques Garnier.
McCormick, Ted [2009], William Petty and the ambitions of political arithmetic, Oxford, Oxford University Press.
Misselden, Edward [1622], Free trade or the means to make trade flourish, Clifton, A.M. Kelley, 1971.
Misselden, Edward [1623], The Circle of Commerce or The Balance of Trade, in Defence of Free Trade, in L. Magnusson (1995), Vol. I, p. 147-230.
Peltonen, Markku [1995], Classical humanism and republicanism in English political thought 1570-1640, Cambridge, Cambrige University Press.
Peltonen, Markku [1996], « Bacon’s political philosophy », in M. Peltonen (éd.), The Cambridge Companion to Bacon, Cambridge, Cambridge University Press, p. 283-310.
Petty, William [1662], Traité des Taxes et Contributions, in Petty (2017), p. 33-108.
Petty, William [1672], The Political Anatomy of Ireland, in C.H. Hull (1899), Vol. 1, p. 121-231.
Petty, William [1690], Arithmétique Politique, in Petty (2017), p. 127-184.
Petty, William [1691], Verbum Sapienti, in Petty (2017), p. 109-125.
Petty, William [2017], Genèse de l’arithmétique politique, Présentation et traduction par S. Reungoat, Genève, Slatkine Érudition.
Pincus, Steve [2011)], « La révolution anglaise de 1688 : économie politique et transformation radicale », Revue d’Histoire Moderne et contemporaine, No 58-1, p. 7-52.
183Pocock, John Greville Agard [1975], Le moment machiavélien, Paris, Presses Universitaires de France, 1997.
Pocock, John Greville Agard [1977], « L’œuvre politique de Harrington », Préface à James Harrington, Océana, Paris, Belin, 1995.
Pocock, John Greville Agard [1985], Vertu, commerce et histoire, Paris, Presses Universitaires de France, 1998.
Polin, Raymond [1952], « Économie et politique au xviie siècle : l’“Océana” de James Harrington », Revue française de science politique, 2e année, No 1, p. 24-41.
Ravix, Joël Thomas [2011], « Oisiveté et luxe dans la formation de la pensée mercantiliste », Economies et Sociétés, Série PE, No 44, juillet, p. 1061-1088.
Roncaglia, Alessandro [2005], The Wealth of Ideas. A History of Economic Thought, Cambridge, Cambridge University Press.
Scott, Jonathan [1993], « The rapture of motion : James Harrington’s republicanism », in N. Phillipson & Q. Skinner (éd.), Political discourse in early modern Britain, Cambridge, Cambridge University Press, p. 139-163.
Weber, Dominique [2003], « Grandeur civique et économie dans la pensée politique de Francis Bacon », Revue de Métaphysique et de Morale, No 3, juillet-septembre, p. 323-344.
1 L’auteur remercie les deux rapporteurs anonymes de la revue pour leurs remarques et suggestions, qui ont permis d’améliorer cet article. Bien évidemment, ils ne sauraient être tenus pour responsables des erreurs ou imprécisions qui pourraient subsister.
2 Serge Audier précise que « l’histoire du républicanisme britannique est complexe et comprend deux tendances hétérogènes, l’une valorisant le conflit comme facteur potentiel de liberté (dans le sillage de Machiavel), l’autre privilégiant l’ordre et l’harmonie (dans le sillage plutôt de Guichardin) » (Audier, 2015, p. 28).
3 Harrington écrit en effet que « Machiavel [est] le seul restaurateur de l’ancienne prudence » (ibid., p. 253).
4 Machiavel attribue également cette oisiveté à la religion qui « glorifie davantage les hommes humbles et contemplatifs que les hommes d’action » (Machiavel, 1531, p. 299). Il précise cependant que cet état de fait n’incombe pas à la religion elle-même, mais « provient sans aucun doute davantage de la lâcheté de ceux qui ont interprété notre religion en termes d’oisiveté, et non en termes d’énergie » (ibid.).
5 Bien que la notion d’anatomie renvoie au concept de corps politique, Éric Marquer (2012, p. 206) suggère de la comprendre plutôt comme une « cartographie ». Petty est en effet intervenu comme arpenteur et cartographe pour la réalisation d’un cadastre de l’Irlande : le Down Survey (McCormick, 2009, ch. 3).
6 Didier Deleule précise que « Bacon transpose dans le champ moral l’anatomie comparée dont il souhaitait la systématisation dans le domaine médical » (Deleule, 2010, p. 100).
7 Cette conception n’est pas sans rappeler le rétablissement de la censure souhaité par Jean Bodin ou par Antoine de Montchrestien, elle s’appuie toutefois sur une démarche différente, qui se veut incontestable parce que plus scientifique et qui surtout écarte toute idée de contrôle des mœurs (Ravix, 2011).
8 Petty est semble-t-il le premier à mobiliser explicitement ce concept de surplus et à lui faire jouer un rôle essentiel dans son analyse. Pour plus de précision, cf. Aspromourgos (1996, ch. 3) et Roncaglia (2005, ch. 3).
9 Petty considère en effet, d’une part, que « les agriculteurs, les matelots, les soldats, les artisans et les marchands sont les véritables piliers d’un État », et d’autre part, qu’un matelot équivaut à trois d’entre eux, « car tout matelot travailleur et ingénieux n’est pas seulement navigateur, mais aussi marchand et soldat, non qu’il ait souvent l’occasion de combattre et de manier les armes, mais parce qu’il a l’habitude d’affronter les privations et les dangers, y compris au péril de sa vie. (…) Par conséquent, posséder de nombreux matelots est un grand avantage » (ibid., p. 144).
10 Cette notion renvoie bien à l’idée de surplus puisque « la superlucration [est ce] que le travailleur réalise en plus de sa subsistance » (Petty, 1691, p. 117).