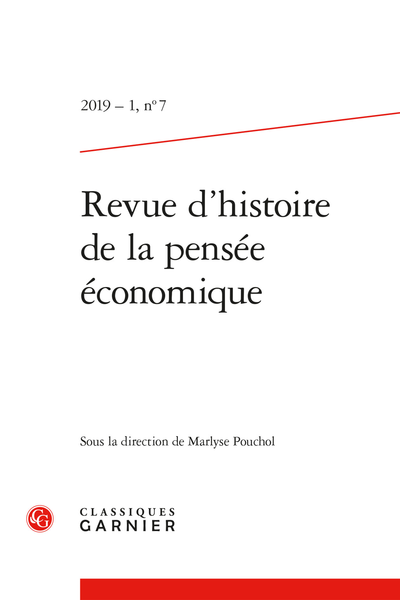
Two Kinds of Sloth at Industrial Age The Surveys of the Philanthropes of the 19th Century and the Lafargue's Refutation
- Publication type: Journal article
- Journal: Revue d’histoire de la pensée économique
2019 – 1, n° 7. varia - Author: Jorda (Henri)
- Abstract: In the nineteenth century, philanthropists rejected the laziness bonus instituted by the gift of no return, and advocated 'active charity'. Their science of indigence aims to hunt down the sloth of men and women that makes them sink into misery and hides behind the mask of poverty. This enterprise of morality is opposed by Lafargue for whom laziness is not a social crime, but the expression of class conflict.
- Pages: 195 to 225
- Journal: Journal of the History of Economic Thought
- CLIL theme: 3340 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Histoire économique
- EAN: 9782406094258
- ISBN: 978-2-406-09425-8
- ISSN: 2495-8670
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-09425-8.p.0195
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 06-27-2019
- Periodicity: Biannual
- Language: French
- Keyword: Paul Lafargue, philanthropists, sloth, surveys, men and women
DEUX GENRES DE PARESSE
À L’ÂGE INDUSTRIEL
Les enquêtes des « Philanthropes » du xixe siècle
et la réfutation de Lafargue
Henri Jorda
Université de Reims Champagne-Ardenne
INTRODUCTION
À la fin du xviiie siècle, s’opère définitivement un tournant dans la conception du souci des autres, des indigents, des malades et des invalides. L’aide n’est plus considérée comme un don miséricordieux qui associe le pauvre à la figure de Jésus, celui qui est venu annoncer « la bonne nouvelle ». En effet, alors que l’aumône était une obligation faite au riche qui, dans le geste charitable, pouvait trouver le moyen du salut, avec les Lumières, l’acte revêt une utilité sociale. Il ne s’agit plus de soulager la misère et de témoigner son amour du prochain, mais plutôt de prévenir, de conseiller et de guider afin de remettre dans le droit chemin. Et le meilleur remède à la misère réside dans le travail. Dès lors, tout ce qui peut être une entrave à l’industrie des hommes, des femmes et des enfants, doit être surmonté par des étapes successives qui conduisent au bien-être individuel, au progrès moral et matériel. Avec la philanthropie naissante, des enquêtes sont entreprises pour connaître les habitudes, les coutumes et les mœurs des pauvres, afin de lever tout soupçon sur leur volonté de bien faire pour sortir 196de leur condition malheureuse. Au discours moral, les philanthropes du xixe siècle, inspirés par les Lumières, associent des pratiques qui relèvent d’une meilleure connaissance, voire d’une science des comportements de la population misérable. Parmi les inconduites qu’ils relèvent, la paresse se révèle capitale car elle entraîne avec elle des attitudes et des mœurs qui éloignent de l’industrie et enferment les pauvres dans la misère, voire les poussent au crime. Guérir les hommes, les femmes et les enfants de leur paresse sera dès lors la voie privilégiée par les philanthropes.
Si la paresse tente aussi bien les hommes que les femmes, et qu’elle est naturelle chez les enfants, hommes et femmes ne souffrent pas précisément de la même paresse, affirment les philosophes et les moralistes du xixe siècle qui partagent la même idée : la femme est le sexe faible. Pour certains, c’est sa faiblesse d’âme qui a chassé l’humanité du paradis, pour d’autres, c’est sa faiblesse physique et intellectuelle qui entraîne la misère des familles ouvrières. Rares sont les hommes du xixe siècle défendant la cause des femmes, y compris chez les intellectuels. Parmi eux, figure Paul Lafargue dont l’œuvre marque une double réfutation féministe : d’abord, la place de la femme n’est pas au foyer et, ensuite, le travail de la femme ne vaut pas moins que celui de l’homme.
Célèbre pour son Droit à la paresse, Lafargue développe une argumentation qui renvoie dos-à-dos les philanthropes avec leur sacralisation du travail, et les socialistes français qui accusaient les femmes de faire baisser les salaires. Le droit à la paresse doit en terminer avec le double asservissement que connaît la femme, au mari et au patron.
La première partie de cet article retrace l’histoire moderne de la paresse, la manière dont les Lumières recouvrent le péché capital d’une dimension économique et sociale qui en fait un crime envers la société humaine, un crime qui connaît ses genres. La seconde partie s’intéresse aux discours et aux pratiques des philanthropes, à l’émergence d’une science de la pauvreté qui vise à remédier aux vices des classes laborieuses, notamment à la paresse des hommes et à la paresse des femmes. Enfin, la troisième partie s’efforce de remettre le monde social à l’endroit en s’appuyant sur Le Droit à la paresse de Paul Lafargue, pourfendeur des philanthropes et de leur morale. Alors que ces derniers cherchent à réformer les pauvres pour les engager dans le progrès économique, pour Lafargue, c’est le milieu social qu’il s’agit de réformer afin que tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants connaissent la joie de vivre.
197I. LA PARESSE : UN PÉCHÉ CAPITAL
ET UN CRIME SOCIAL
Jusqu’au xviiie siècle, le long Moyen Âge au sens de Jacques Le Goff envisage la paresse comme un péché capital qui concerne surtout les hommes. Après tout, c’est bien Adam qui a été condamné à travailler la terre maudite et à gagner son pain à la sueur de son front. Ève est renvoyée à ses rôles de femme obéissante et de mère enfantant dans la douleur du travail. Ainsi, lorsque les représentations de la paresse concernent des humains, ces derniers sont des hommes, la plupart du temps des moines acédieux, du nom premier de la paresse1. En effet, l’absence de volonté se traduit dans le fait de ne pas prier, de ne pas faire l’effort d’élever son âme vers Dieu. Par exemple, dans Les Sept Péchés capitaux et les Quatre Dernières Étapes humaines, Jérôme Bosch représente l’acédie par un moine endormi devant un feu de cheminée, un rosaire à la main, et c’est une femme, une religieuse, qui vient le rappeler à ses devoirs. Toujours seconde, comme subalterne, la femme est souvent envisagée comme celle qui est capable de remettre l’homme égaré dans le droit chemin, et cette fonction réservée aux femmes s’exprimera sous d’autres formes dans les temps modernes… Dans les cavalcades des vices, autres expressions des péchés capitaux, ce sont encore des moines qui figurent des paresseux. Mal fagotés, ils sont affalés sur un âne, compagnon d’infortune des paresseux, animal robuste et dur à l’ouvrage, qui piétine sur place et désobéit aux ordres du maître. Incapable d’aller droit au but, préférant les chemins de traverse, l’âne emporte sur son dos le moine qui n’a pas rempli ses devoirs de chrétien. Ici, nulle femme pour le sauver de l’enfer auquel le conduit son vice capital, en compagnie de l’orgueilleux sur son lion et du gourmand sur son ours.
198Avant le xviiie siècle, la femme apparaît surtout dans les formes allégoriques du péché, sous les traits d’une vieille en guenilles2. Avachie, la tête reposant sur un bras, lui-même soutenu par une cuisse, la paresse est un vice qui empêche de se tenir droit, d’être digne aux yeux des autres. La plupart du temps, Paresse est allongée sur un âne reposant sur le côté, animal et humain endormis, perdant le temps, ce don si précieux que Dieu a fait aux humains. Perdre son temps, c’est donc voler le temps divin. Le seul moment de répit accordé aux humains est alors celui du repos qui vient après le travail, mais cette antienne religieuse ne sera incorporée par la population que progressivement. En effet, la plupart vit selon les rythmes de la nature, et il faudra bien des sermons et des images infernales pour ne plus associer le travail à une punition, voire une torture, infligée aux humains par le Créateur. C’est avec la vie urbaine, les échanges marchands, le développement d’un artisanat exigeant savoir-faire et règles de l’art, que le travail va acquérir une valeur positive, le moyen de gagner, non seulement sa place au Paradis, mais aussi de l’argent (Le Goff, 1986, 2010 ; Fossier, 2000).
Vers la fin du Moyen Âge, celles et ceux qui ne font rien de leur temps sont perçus comme des voleurs, des êtres diaboliques qui peuvent commettre des crimes pour ne pas avoir à travailler, qui se cachent le jour et sortent la nuit pour commettre leurs méfaits. Les regards sur les pauvres, de miséricordieux, se font de plus en plus suspicieux : la femme tient-elle bien son foyer, éduque-t-elle bien ses enfants ? L’homme tient-il bien son rang de chef, n’a-t-il pas pris un mauvais chemin ? Femmes et hommes n’ont-ils pas cédé à la tentation de ne rien faire pour s’adonner à des plaisirs ? Si la sieste est bien admise, c’est qu’elle reconstitue les forces, mais vivre du travail des autres en mendiant sera de plus en plus perçu comme un signe de paresse coupable. Le message du Christ venu soulager les plus pauvres passera au second plan, et les ordres mendiants feront le tri entre les bons et les mauvais pauvres, entre ceux qui méritent des soins et une assistance, et ceux qu’il serait bon de chasser, voire de punir, pour les tenir à l’écart des honnêtes gens et les redresser pour en 199faire des travailleurs. Au cours de la même période, l’Église indique le traitement réservé à ceux qui refusent de travailler : « Qui ne travaillera pas, ne mangera pas ! », selon la formule de Jacques de Vitry, prédicateur populaire du xiiie siècle. Mort de faim, le paresseux est condamné à l’immobilité, son âme reposant sur une couche infernale, torturée par les démons pour l’éternité. Voilà qui aiguise, à la fin du Moyen Âge, le regard sur les pauvres : aux bons pauvres, compassion et charité, aux mauvais pauvres, mépris et punition. Cette contamination de la pauvreté par la paresse aura des effets secondaires qui se font encore ressentir de nos jours. Le pauvre, même s’il est invalide, est celui qui a choisi le mauvais chemin, et s’il ne peut pas travailler, c’est qu’il a été puni pour avoir fait ce mauvais choix, pour avoir conçu un projet incohérent… Ainsi, alors que le travail était vécu et présenté comme un châtiment divin, c’est l’absence de travail qui, désormais, indique le mieux ce châtiment. Le paresseux a donc sa place en Enfer, c’est un être diabolique qui refuse de sauver son âme par le travail et qui peut, ruse du Démon, se cacher derrière le masque du pauvre. Les philanthropes auront ce souci de démasquer ces êtres malfaisants, accusés d’appauvrir la Chrétienté et la nation, par leur refus du travail.
La charité vécue et pratiquée comme une obligation se transforme progressivement en une charité ordonnée. Les infirmes, les malades et les personnes trop âgées pour travailler ont droit à l’aumône, les autres font l’objet de polices à partir des xvie et xviie siècles. C’est ainsi que le Grand Bureau des pauvres cherche à supprimer la mendicité en secourant les infirmes et en imposant le travail aux valides. Les vagabonds sont marqués et expulsés des villes, et la paresse est guérie dans les hôpitaux généraux (Geremek, 1987 ; Renaut, 1998), car les paresseuses et les paresseux ne valent rien et refusent de se sauver par le travail en se dissimulant3. Cette charité bien ordonnée prépare la philanthropie des Lumières qu’illustrent les propos de Jean-Jacques Rousseau dans l’Émile : « Riche ou pauvre, puissant ou faible, le citoyen oisif est un fripon » (Rousseau, 1969, p. 306). La paresse n’est plus condamnée comme péché capital, mais parce qu’elle est une entrave à l’industrie. 200Le paresseux n’est plus un voleur du temps divin, mais un voleur de la société humaine car le devoir de tout citoyen est de contribuer, par ses efforts, à la fabrication d’un monde meilleur. Le pays de Cocagne est un leurre qui éloigne les hommes de la société et les condamne à la pauvreté et au vagabondage, alors que l’individu des Lumières est un être social, dont la vie dépend de celle des autres, plus précisément de leur travail. C’est en travaillant qu’il se rend utile à la société, sinon c’est qu’il vit aux dépens des autres, qu’il est un paresseux, un vaurien, un mauvais citoyen4.
C’est au temps des Lumières que la paresse adopte clairement ses deux genres, et le masculin l’emporte. Les hommes riches et oisifs sont « inutiles à la société » car ils ne font rien pour elle en ne remplissant pas les devoirs de tout bon citoyen « dont l’obligation est (…) en particulier de se rendre utile à la société dont il est membre », écrit de Jaucourt, dans l’article « Oisiveté » de l’Encyclopédie (vol. 11, p. 445). Pour les autres citoyens, « l’oisiveté est la mère de la pauvreté, et (…) la pauvreté est la mère des crimes » : il faut donc la punir par des lois sévères. Quant à la femme, sa nature la rend particulièrement vulnérable à l’oisiveté qui est « surtout fatale au beau sexe », précise Louis de Jaucourt (id., p. 446). Son terrain de jeu favori est la ville, et non la campagne, car c’est en ville que se donnent à voir des occupations très éloignées du travail productif, comme les arts et les spectacles. La ville, dit Rousseau, est elle-même une femme qui consomme sans rien faire la production des campagnes, et la présence des femmes y favorise le goût pour les activités artistiques et littéraires, notamment dans les salons où elles occupent une place centrale avec leur « abus de la toilette » (Rousseau, 1969, p. 550)5. En définitive, l’oisiveté est naturelle aux femmes puisqu’elles dépendent des hommes afin de pourvoir à leurs besoins. Ainsi, dès son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Rousseau affirme que « les femmes devinrent plus sédentaires et s’accoutumèrent à garder la cabane et les enfants tandis que l’homme allait chercher la substance 201commune » (Rousseau, 1971, p. 208). Ne pas travailler est comme une seconde nature chez la femme dont les conduites tendent à instaurer un climat de mollesse dans la société. Tentatrice, voire corruptrice, elle détourne l’homme de son état, allant jusqu’à l’empêcher de vaquer à ses occupations.
Mais l’homme n’a pas grand-peine à succomber à la tentation de paresse car cette dernière lui est bien naturelle, en définitive. Elle est même, dans certains cas, une vertu car c’est bien parce que les hommes sont paresseux qu’ils se sont livrés à des inventions visant à réduire leurs efforts et leurs peines6. Et, comme le reconnaît de Jaucourt, dans l’article « Paresse » de l’Encyclopédie, elle « règne souverainement dans ce qu’on appelle le beau monde » où elle est vertueuse car paisible et aimable (vol. 11, p. 939). Cette paresse aimable des philosophes s’oppose tout autant à l’oisiveté des nobles, associée à un ennui improductif et ignoble, qu’à la fainéantise lourde du peuple, fuyant tout effort intellectuel et physique pour se commettre dans des orgies collectives et bruyantes qui troublent l’ordre public. C’est cette paresse naturelle du peuple que la science des encyclopédistes vise à combattre en divisant le travail, en le mécanisant et en le rapportant au temps de l’horloge mécanique.
La division du travail devient un principe majeur pour « épargner le temps », mais aussi pour éduquer l’ouvrier car, selon Adam Smith, elle lui fait perdre « cette habitude de flâner et de travailler sans application et avec nonchalance » qui le caractérise. La division du travail a une autre propriété : elle favorise l’invention de nouvelles machines qui sont supérieures aux hommes en robustesse et en vitesse, « propres à abréger et à faciliter le travail7 ». La machine peut combattre la paresse ouvrière d’autant que « la main-d’œuvre est fort peu de chose ; la machine fait presque tout d’elle-même (…) et tout cela sans que l’ouvrier y comprenne rien, en sache rien, et même y songe seulement », précise Diderot dans l’article « Bas » de l’Encyclopédie (vol. 2, p. 98). C’est en mettant une 202multitude d’ouvriers au travail sur des machines automatiques et des tâches spécialisées, que l’industrie progresse en quantité et en qualité, lui procurant ainsi un avantage sur la concurrence. Cette mise au travail exige une mesure du temps précise afin de déterminer ce que le xxe siècle appellera la productivité. L’horloge mécanique est la machine nécessaire au travail organisé en vue de procurer à la nation la plus travailleuse « le profit le plus sûr », précise de Jaucourt dans l’article « Industrie » (vol. 8, p. 694). À partir du xviiie siècle, l’horloge sera l’emblème de la concentration industrielle, avec un travail qui ne doit plus dépendre d’un temps hasardeux et naturel, mais d’un temps linéaire et normé, un temps aux scansions précises qui permet de calculer le rendement et de programmer les activités. Son entrée dans les ateliers fait naître une « discipline du temps » en marquant le début et la fin du travail, les moments de repos, le temps à employer utilement. Avec sa cloche et son campanile, elle rappelle l’ordre industriel et combat la paresse des ouvriers en repérant les retardataires et ceux qui perdent le temps8.
Comme les ouvriers n’ont pas conscience de l’utilité du temps, il va s’agir de les mettre au travail très tôt, dès l’âge de 5 ou 6 ans, pour combattre leur indolence naturelle. C’est que le temps du travail réglé par l’horloge est nouveau pour la plus grande partie de la population, rurale, habitant un temps rythmé par les cycles naturels et orienté par la tâche9. Selon Michel Foucault, dans toute l’Europe, se dessine au xviiie siècle ce même « schéma de docilité » qui renvoie à la production d’un corps ouvrier obéissant, dont les gestes et les mouvements sont utiles : dans les fonderies Crowley où un contremaître est nommé pour « repérer les paresseux » (Thompson, 2004, p. 101), comme chez Oberkampf où il faut « toujours s’assurer que tous les bras qu’on emploie soient utiles » (Chassagne, 1980, p. 226). Cette discipline du temps s’exerce dans des 203lieux fermés et surveillés, bâtis en dehors des villes qui offrent des tentations à l’ouvrier, et l’horloge est employée par les philosophes et les employeurs comme la métaphore d’un ordre industriel auquel rien ne doit résister, surtout pas la paresse naturelle des ouvriers.
II. LA PHILANTHROPIE :
UNE SCIENCE DE L’INDIGENCE
Dans sa thèse sur le temps des philanthropes, Catherine Duprat soutient que la philanthropie ne consiste pas à assister les pauvres, mais à les engager dans une réforme de leur culture et de leurs mœurs, en favorisant notamment le patronage et la prévoyance (Duprat, 1993). Chrétiens nourris d’encyclopédisme et de saint-simonisme, les philanthropes croient dans l’industrie et ses bienfaits pour l’humanité. Selon eux, l’industrie ne peut être tenue pour responsable de la condition malheureuse des hommes, des femmes et des enfants qu’elle emploie. La misère des classes laborieuses ne peut être due qu’à leur inconduite, à leurs vices de caractère qu’il s’agit de corriger.
L’autre caractéristique de la philanthropie est de se donner les aspects d’une science, de se doter d’une méthode rigoureuse fondée sur l’observation des faits, afin d’entreprendre les réformes nécessaires. Le corps social est malade, les preuves en sont données par les poussées de fièvre qu’il connaît dans les soulèvements de la masse laborieuse. Férus d’hygiène publique10, les philanthropes participent à des campagnes de prévention et d’éradication des maladies de la pauvreté, comme la tuberculose, et cherchent à combattre les ravages de l’alcoolisme. Ces médecins du corps social proposent des remèdes à la misère ouvrière à partir d’enquêtes auprès des classes vicieuses, car ce sont bien des vices, des tares du caractère et du comportement qui conduisent à la misère. Les parents étant de mauvais exemples pour leurs enfants, ils 204envisagent même de les en séparer pour confier leur éducation à des « bonnes personnes », des femmes bien sûr.
Le premier des vices, celui auquel sont exposés les pauvres dès leur plus jeune âge, est la paresse. C’est elle qui, comme dans la théorie des péchés capitaux, ouvre la porte à tous les autres vices. Extirper le vice capital de paresse par le travail est donc le premier axe des recommandations philanthropiques. C’est pourquoi l’aumône, si elle part d’une bonne intention, est contreproductive car elle précipite les pauvres dans l’enfer des paresseux en cultivant leur goût de ne pas travailler. Si don il y a, il ne peut pas être sans retour, et le pauvre doit montrer par des actes observables la volonté de se réformer. Il s’agit alors de lui prodiguer des conseils, de l’accompagner et de le guider vers le droit chemin. C’est ce que préconise Joseph-Marie de Gérando qui peut être considéré comme le premier de ces philanthropes. Il a le souci de trouver « les remèdes qui peuvent être apportés aux maux qui accablent » le pauvre, et le remède n’est pas l’aumône du riche, mais une « charité active, vigilante, qui apporte plus que des dons, qui apporte des soins, des conseils, des encouragements », écrit-il dès l’avertissement du Visiteur du pauvre (Gérando, 1989, p. vi & p. ix-x).
Considéré comme un précurseur de l’ethnographie, Gérando applique à la population misérable les méthodes de l’observation – ou « visite » – qu’il a conçues auprès des peuples sauvages11. Indigènes et indigents ont des tares communes qu’il faut corriger pour leur permettre d’évoluer et d’accéder aux bienfaits de la civilisation industrielle. Ainsi, la charité active dont il fait la théorie doit apporter les lumières à une population qui ne perçoit pas les avantages « des efforts du travail » et du « commerce des échanges » (Gérando, 1989, p. 2). Puisque le philanthrope vise l’amélioration des espèces, il doit observer les comportements quotidiens, la vie domestique, entrer dans les demeures, partager les couverts, participer aux jeux… C’est de cette manière qu’il se rend compte de lui-même et qu’il rend compte à ceux qui veulent réellement le bien d’autrui, de ce qu’est la vraie indigence et la fausse indigence. Car les
secours détournés de leur vrai but (…) deviennent un poison. D’abord, ils créent une indigence nouvelle et factice ; l’individu sur qui ils tombent, 205contractant l’habitude de l’oisiveté, perdant les occasions du travail, éprouvera bientôt une pauvreté réelle quand le secours sera consommé (…). Une fatale émulation se communique, une prime semble offerte à l’oisiveté (Gérando, 1989, p. 16-17)12.
Seule une enquête sur les lieux de vie des pauvres peut éviter d’être joué par des comédiennes et des comédiens. Car les hommes ont tendance à se déguiser en infirmes, voire à composer des bandes de gueux qui se répartissent les rôles pour tromper les gens honnêtes. De leur côté, les femmes jouent le rôle de mères élevant seules des enfants en bas âge, mais « lui appartiennent-ils ; ne les a-t-elle pas empruntés, dérobés, peut-être à la mère véritable ? » (Gérando, 1989, p. 19)13.
Selon Gérando, la fausse indigence est due à trois causes : l’imprévoyance, la paresse et la débauche. La première est la plus excusable des trois. La paresse est la plus difficile à guérir, et la débauche y est associée. La paresse, selon lui, est une maladie dont le siège est « le fond de l’âme » :
(elle se) reconnaîtra à des symptômes presque infaillibles, à la mollesse de l’attitude et de la démarche, à la saleté des vêtements et de tout ce qui est à l’usage du pauvre. Le découragement s’annoncera par une tristesse sombre et mélancolique. La paresse naturelle et de tempérament sera quêteuse et tendra la main ; le découragement sera silencieux et réservé (Gérando, 1989, p. 26).
206Gérando reprend ici la paresse originelle, connue sous le nom d’acédie, c’est pourquoi l’homme est le premier concerné par la tentation de ne rien faire, par le chômage volontaire : « Si le chômage existe, l’ouvrier n’a-t-il point quitté le travail volontairement, et pour chercher une existence plus commode ? » (id., p. 25). Ce vice capital fait entrer d’autres vices, et conduit « le plus ordinairement à la misère », y compris celle de la femme et des enfants : « la paresse ouvre souvent l’accès à la débauche, les séductions se multipliant pour celui qui est désœuvré ». Adam, en s’éloignant de Dieu, oublie Sa parole, et multiplie les occasions de pécher : « il arrachera à son épouse, à ses enfants, le pain qui leur était destiné ». C’est un mal dont il est difficile de guérir, tant il atteint le caractère et détruit toute énergie, physique et morale, tant il ouvre la porte à d’autres tentations qui condamnent la famille ouvrière à la misère. La femme peut aussi être atteinte du mal, elle dont le devoir est de veiller à la bonne tenue du foyer. C’est ainsi, écrit Gérando, que « le malheur porte les âmes faibles au découragement : (…) on négligera les moindres soins, même ceux de l’ordre, de la propreté, dans les vêtements, dans le ménage, dans l’éducation des enfants » (Gérando, 1989, p. 119-120).
Les malades de la paresse sont à surveiller, ils sont comme des enfants auxquels il faut faire la leçon. Le visiteur du pauvre doit faire une pédagogie par l’exemple et traiter la maladie par un « aiguillon vif et perçant » auquel sera associé le « sentiment du devoir » (id., p. 125). Il faut débuter le traitement dès le plus jeune âge, avant même que n’apparaissent les premiers symptômes : « une bonne éducation physique, dans les classes inférieures, aurait déjà l’immense avantage de prévenir beaucoup de maladies, de donner plus de forces et d’aptitude pour le travail », en réunissant les enfants pauvres âgés de moins de 7 ans, dans des « asiles où ils seraient confiés à des personnes sûres » qui leur feraient des lectures morales et religieuses (id., p. 154). Quant aux hommes adultes valides, ils seraient accueillis dans des « établissements pour le travail » afin de prévenir « les vices et les désordres qui sont le fruit de la fainéantise ». Cette œuvre est d’autant plus nécessaire qu’elle prévient bien des troubles dans le pays car « les régions de l’Europe où il se commet le plus de crimes, sont celles où les denrées abondent davantage, où l’on vit à meilleur compte, mais où règne l’oisiveté » (id., p. 317-318). Comme les femmes et les filles ne sont pas destinées à travailler pour l’industrie, elles ne pourront pas bénéficier de ces mesures : 207« l’assistance, les conseils et l’appui de la bienfaisance privée (leur) seront indispensables » (p. 323).
Quelques années après Gérando, Alexandre Parent-Duchâtelet fait le portrait de la paresseuse en enquêtant dans les cloaques parisiens. Ce médecin hygiéniste qui s’est fait connaître pour ses travaux sur les égouts de la capitale, cherche à assainir la ville en expulsant les ordures. Il en prend la mesure, observe leur circulation, et cherche à endiguer la menace que constituent les déchets et leur amoncellement. Se livrant à une série d’expériences sur la circulation des fluides et des excrétions, Paris lui apparaît comme un organisme vivant dont il faut assurer l’élimination des déchets mortifères. Selon lui, la prostitution est une fonction nécessaire à l’équilibre de l’organisme parisien, à condition d’être assainie et surveillée médicalement dans les maisons de tolérance. Les bordels sont ainsi envisagés comme des égouts d’où « s’écoulerait le trop-plein séminal », écrit Alain Corbin dans sa présentation de l’ouvrage de Parent-Duchâtelet consacré à la prostitution parisienne (Parent-Duchâtelet, 1981).
Comme tous les philanthropes, Parent-Duchâtelet observe in situ le milieu à corriger pour améliorer le fonctionnement du corps social. Après avoir suivi les prostituées dans les prisons et les hôpitaux, il conclut que la prostitution est le cloaque le plus immonde de la capitale. Elle peut être définie comme « le passage d’une vie honnête à l’état d’abjection d’une classe (…) qui, par des habitudes scandaleuses, hardiment et constamment publiques, déclare abjurer (la) société et les lois communes qui la régissent ». Puisque la fille publique renonce, par son état, à la société, l’autorité publique a pour devoir de surveiller et de réprimer les excès de sa classe qui comprend plus de 12 000 femmes14. L’enquête au sein du milieu prostitutionnel conduit Parent-Duchâtelet à déterminer les causes de cette corruption. Elles résident dans un tempérament particulier qui conduit les filles à être déflorées très jeunes :
la paresse peut être mise au premier rang des causes déterminantes de la prostitution ; c’est le désir de se procurer des jouissances, sans travailler, qui fait que beaucoup de filles ne restent pas dans les places qu’elles avaient ou ne cherchent pas à en trouver ; la paresse, la nonchalance et la lâcheté des 208prostituées sont devenues pour ainsi dire proverbiales (Parent-Duchâtelet, 1981, p. 95).
Si Parent-Duchâtelet envisage bien le milieu misérable dans lequel elle est née et a été élevée, la femme connaît, selon lui, des vices particuliers qui la conduisent à la dépravation. En effet, « la vanité et le désir de briller sous des habits somptueux sont, avec la paresse, une des causes les plus actives de la prostitution, particulièrement à Paris ». C’est « l’amour de la parure » qui fait définitivement sombrer les filles dans le cloaque immonde de la prostitution, d’autant que leurs parents et les mauvais exemples dont elles sont entourées, ne peuvent en rien sauver leur âme. Alors,
est-il surprenant que la vue de leurs camarades déjà lancées dans la prostitution, que la paresse toujours compagne du vice, que le bruit venu à leurs oreilles du plaisir que procure la débauche, parce qu’elle permet de satisfaire sans travailler à tous les désirs, est-il, dis-je, surprenant qu’un tel concours de circonstances rende une jeune fille sans force contre la séduction ? (Parent-Duchâtelet, 1981, p. 98).
Comme les ouvriers paresseux chez Gérando, les prostituées sont de « véritables enfants » que la moindre chose distrait. Imprévoyantes, ne s’inquiétant pas du lendemain, « elles ont un besoin de mouvement et d’agitation qui les empêche de rester en place, et qui rend nécessaire le bruit et le tapage » (id., p. 107). Elles cherchent à jouir du moment, s’adonnent à la gourmandise, à la danse et aux jeux, elles ont aussi l’habitude du mensonge et de la colère qui relève d’un tempérament immature15. C’est pourquoi Parent-Duchâtelet préconise des prisons « spécialement consacrées à la correction des prostituées ». La première des punitions est de leur imposer le travail ; elles cesseraient ainsi de considérer les prisons comme des lieux d’asile « où elles viennent se refaire et se reposer ». Elles travailleraient dans le silence absolu, vêtues grossièrement, avec l’interdiction de chanter, et connaîtraient un régime militaire en marchant en cadence pour se rendre d’un atelier à l’autre. Parent-Duchâtelet envisage même la nature des travaux imposés pendant 209leur détention afin de les guérir de leur paresse, essentiellement des travaux d’aiguille et la confection du linge.
Quelques années plus tard, deux autres médecins du corps social reprennent les éléments du diagnostic de Parent-Duchâtelet sur la prostitution : Louis René Villermé à propos de la misère ouvrière (Villermé, 1840) et Honoré-Antoine Frégier dans son étude sur la criminalité dans les grandes villes (Frégier, 1840). Ces deux hommes, aux parcours sensiblement identiques et membres des mêmes académies, sont d’accord sur l’essentiel : l’industrie et les industriels ne sont en rien responsables de la condition ouvrière qui relève de l’inconduite des classes laborieuses. Frégier précise même qu’il est préférable de réformer les mœurs plutôt que d’augmenter les salaires, la formation de ces derniers ne dépendant que de la seule loi de l’offre et de la demande. Quand Villermé explore le milieu ouvrier en entrant dans les domiciles, Frégier enquête sur le milieu criminel qui se recrute pour l’essentiel dans la classe ouvrière : un tiers des ouvriers serait susceptible d’être vicieux pour un dixième des milieux aisés (Frégier, 1840, p. 34-36).
Selon Frégier, les femmes sont minoritaires dans la population vicieuse, et les prostituées composent cette minorité dangereuse. Il présente d’abord les femmes comme étant par nature subalternes, coupables d’assistance à des malfrats de toute sorte. Les femmes des classes aisées ne sont pas concernées par le vice, sauf les femmes galantes, mais elles non plus ne remplissent qu’un « rôle secondaire et de complaisance » (id., p. 42). Les femmes ne sont que les complices des vrais coupables, les hommes, car par nature, elles ont « une influence douce, pacifique et moralisante » sur la société (p. 11). Chez Frégier, comme chez Villermé, c’est la ville qui est « corruptrice16 ». Le problème de la ville est qu’elle rassemble une masse laborieuse dont une partie embrasse une carrière criminelle ; la ville est tentatrice et finit par pervertir les êtres faillibles, peu éduqués, qui composent la classe laborieuse : « la classe oisive, errante et vicieuse, foisonne dans les grandes villes et y afflue du dehors attirée par l’appât du gain illicite » (Frégier, 1840, p. 7). C’est l’affaiblissement des croyances 210religieuses qui livre les pauvres aux mauvaises passions et les pousse au crime. Les hommes ne recherchent plus que les plaisirs, d’autant que leur proximité avec les femmes dégrade les mœurs17. C’est alors que
le danger social s’accroît et devient de plus en plus pressant, au fur et à mesure que le pauvre détériore sa condition par le vice et, ce qui est pis, par l’oisiveté. Du moment que le pauvre, livré à de mauvaises passions, cesse de travailler, il se pose comme ennemi de la société, parce qu’il en méconnaît la loi suprême, qui est le travail (Frégier, 1840, p. 7).
Pour ces deux médecins hygiénistes, les causes du dysfonctionnement de l’organisme social résident dans les mœurs ouvrières. Le diagnostic de Villermé est établi suite au calcul des budgets : tous pourraient épargner « si leur conduite était meilleure » (Villermé, 1840, t. I, p. 47). Qu’ils soient Alsaciens ou Lillois, le problème principal réside dans cette inconduite : elle se traduit dans le goût des plaisirs coûteux, le manque de prévoyance et, surtout, l’ivrognerie. S’ils étaient sobres, même avec de modestes salaires, ils feraient des économies qui leur permettraient de traverser les phases de chômage industriel. Et, précise Villermé, « dans la classe ouvrière comme dans les autres, l’ivrognerie est le vice presque exclusif des hommes » (Villermé, 1840, t. II, p. 35). C’est elle qui fait sombrer les familles entières dans la misère, en éloignant toujours davantage l’homme de son devoir, dont le premier est de travailler. C’est l’ivrognerie qui s’oppose à l’épargne et à la bonne éducation des enfants : « elle rend l’ivrogne paresseux, joueur, querelleur, turbulent (…). C’est le plus grand fléau des classes laborieuses » (id., p. 37). Frégier partage le diagnostic de Villermé : l’ouvrier est un être inconstant, tel un enfant, et s’il rencontre un camarade sur le chemin du travail, la première idée qui lui vient est d’aller boire un verre au cabaret pour y parler de la paie, du maître et de la conduite des travaux. Quand, par prudence, l’ouvrier n’entre pas au cabaret, c’est à l’atelier qu’il commence à boire. Comme les contremaîtres ont le même caractère, les ateliers se vident de travail et d’ouvriers, tous au cabaret : « on parle d’aller se promener le reste de la journée et les plus paresseux d’applaudir » (Frégier, 1840, p. 78).
211L’ouvrier au cerveau d’enfant a un penchant naturel pour la paresse, et l’ivrognerie est un vice commun aux ouvriers qui existait bien avant l’industrie (Villermé, 1840, t. I, p. 105). C’est bien pourquoi il ne faut surtout pas augmenter les salaires car les ouvriers se livrent d’autant plus à la débauche qu’ils sont mieux payés : « la plupart des mieux rétribués ne travaillent que pendant la dernière moitié de la semaine, et passent la première dans les orgies » (id., p. 228). Gagné par la « fureur de boire », selon l’expression de Frégier, l’ouvrier cesse de travailler, ne sort plus de chez lui car il n’a même plus de vêtements. Il a tout dépensé au cabaret et s’il accumule de l’argent par son travail, il recommence à le dépenser par « la domination du vice ». Frégier fait alors le portrait d’une famille, « d’un père et d’une mère appesantis tous deux par l’ivresse, et gisants au milieu de la nuit sur le carré de leur chambre » (Frégier, 1840, p. 84). Seule la femme pourrait détourner le mari de ses projets insensés car elle sait prendre soin de sa famille, mais « par la délicatesse même de son organisation, (elle est) plus sujette à faillir que l’homme » (id., p. 89).
En définitive, le vice commun aux classes laborieuses, aux hommes, aux femmes et aux enfants18, est leur paresse. « Partout, écrit Villermé, l’homme condamné au travail gagne son pain à la sueur de son front ; mais partout aussi, la paresse, l’imprévoyance, la débauche, la corruption produisent inévitablement la misère » (Villermé, 1840, t. II, p. 350). Les vices poussent à la misère, et au crime :
les joueurs, les filles publiques, les amants et souteneurs, les maîtresses de maison de prostitution, les vagabonds, les fraudeurs, les escrocs, les filous et les voleurs, les voleuses et les receleurs. Les vices dominant chez les individus désignés sous ces diverses qualifications sont la paresse, le jeu, l’intempérance, la débauche, et en général toutes les passions basses et immorales (…). La fainéantise et l’activité vicieuse, quoique extrêmes par leur nature, se touchent dans leurs effets : elles aboutissent toutes deux au crime (Frégier, 1840, p. 45).
Pour combattre la corruption des mœurs ouvrières, Frégier et Villermé proposent de redresser les âmes et les corps par le travail. D’abord, il faut interdire le chômage du lundi, mauvaise habitude qu’ont prise les ouvriers de déserter les ateliers le lendemain du saint repos, et il faut aussi remplir les temps d’oisiveté par des activités nobles (Villermé, 2121840, t. II, p. 43-44)19. Le travail est le principal remède contre le vice et les plaisirs de Saint Lundi, précise Frégier, il « peut être employé, à l’égard de l’enfant comme à l’égard de l’adulte, à titre non seulement de moyen d’existence pour l’avenir, mais aussi à titre d’amendement et de régénération » (Frégier, 1840, p. 278). Le travail est la vertu cardinale, de laquelle dérivent les trois autres vertus que sont l’épargne, l’ordre et la modération, surtout utiles aux pauvres. Ces derniers ont des facultés de jugement limitées, et cherchent à sortir de leur triste condition par l’ivresse, alors qu’ils devraient se conformer à leur sort plutôt que de tomber dans le piège démoniaque tendu par le cabaret (id., p. 282-283). De son côté, si son Tableau est connu pour avoir inspiré la première loi sur le travail, qui interdit l’emploi des enfants de moins de 8 ans et limite la durée du travail des autres enfants, « il vaut mieux, indique Villermé, sous le rapport moral, employer les enfants dans les manufactures que de les laisser vagabonder sur la voie publique » (Villermé, 1840, t. II, p. 115).
Au travail, les relations entre patrons et ouvriers doivent être réformées selon le principe du patronage : les patrons doivent prendre soin de leurs ouvriers et ces derniers s’attacher à leur employeur, des « égards d’un côté, du dévouement de l’autre », écrit Villermé. Il serait bon que les patrons s’occupent réellement de leurs ouvriers plutôt que de les traiter comme de simples machines, en recréant une communauté de travail où la direction serait exemplaire et exercerait une action moralisatrice20. C’est de cette manière qu’en France, précise Frégier, certains industriels philanthropes traitent leurs ouvriers avec « bienveillance, une affection qui, sans affaiblir les liens de subordination, assure à cette classe (…) tout le bien être que peut comporter une vie de labeur et de peine » (Frégier, 1840, p. 296). Ainsi, en plus du salaire, le chef d’industrie peut également aider la femme dans son travail particulier : elle est « secourue en cas de grossesse ou de maladie, et les enfants sont reçus en apprentissage » (id., p. 297). Le patronage est donc le meilleur système 213d’emploi car il prévient les mauvaises influences et la corruption des mœurs, il détourne les ouvriers et leur famille des vices propres aux classes laborieuses, en employant les femmes d’ouvrier dans les ateliers et en instaurant un régime de retraite. Le patronage permet également de lutter contre l’association des ouvriers visant à augmenter les salaires ou à réduire la durée du travail. Car c’est le vice de paresse qui constitue les unions ouvrières ; c’est parce qu’ils fuient le travail que les ouvriers s’assemblent pour établir un rapport de force contre leur patron : « les ouvriers médiocres et paresseux forment la majorité de ces coalitions », écrit Frégier (p. 318). La cupidité ne doit pas régner dans l’entreprise, c’est bien plutôt la « bienveillance » et la « bienfaisance » qui doivent réunir patrons et ouvriers dans une même association, afin de redonner le goût du travail et d’éloigner la paresse.
Enfin, la famille étant la meilleure école du travail par l’exemple et l’instruction, il faut encourager le mariage des ouvriers. Villermé rend ici hommage
aux bonnes qualités des femmes d’ouvrier. On croit trop généralement qu’elles sont causes de dépenses et de consommations pour leurs maris. Loin qu’il en soit ainsi, elles se montrent généralement sobres, très laborieuses, très économes, lors même qu’elles avaient les défauts contraires avant de se marier. En entrant en ménage, elles deviennent communément rangées, et le nombre des hommes qui, sans elles, s’abrutiraient dans l’ivrognerie et la débauche, est très considérable (Villermé, 1840, t. II, p. 65).
C’est encore une fois la femme qui est capable de remettre l’ouvrier dans le droit chemin, de le rappeler à ses devoirs de père et de mari, de lui éviter les leurres du cabaret et les orgies de Saint Lundi.
III. LE DROIT À LA PARESSE :
OU COMMENT REMETTRE LE MONDE À L’ENDROIT
Paul Lafargue et son œuvre ont une place singulière dans l’histoire du socialisme. Gendre de Marx, Lafargue sera l’introducteur et le vulgarisateur du marxisme en France. Fondateur du Parti Ouvrier Français aux côtés de Jules Guesde, il en sera le principal théoricien, auteur de 214nombreux ouvrages dont le célèbre Droit à la paresse, écrit en feuilleton en 1880, et retravaillé en prison pour une édition complète en 1883.
Ce pamphlet signale les particularités de Lafargue au sein du mouvement socialiste. Son esprit libertaire, hérité d’un proudhonisme originel, agaçait Marx et Engels, mais ces derniers reconnaissaient l’énergie et le talent du gendre. En effet, alors que Lafargue ne lit pas l’allemand et n’a aucune formation philosophique, il se fait fort, avec l’aide de Laura, son épouse, de diffuser la pensée de Marx et Engels auprès de militants qui connaissent surtout Proudhon et Fourier… Et puis, contrairement à Lafargue, les socialistes français ne défendent guère la cause des femmes. À la suite de Proudhon, ils envisagent la femme comme un être inférieur à l’homme, sur tous les plans, physique, intellectuel et moral21. Sa place est au foyer, d’autant qu’elle est accusée de faire baisser les salaires en cherchant à se faire employer, elle, dont les qualités sont inférieures. Pour Lafargue, la femme n’est pas coupable ; le vrai coupable, c’est le capital. C’est l’industrie capitaliste qui met en concurrence les salariés entre eux, y compris le mari, la femme et les enfants d’une même famille ; c’est le travail capitaliste qui condamne la plus grande partie de l’humanité à la misère et qui la mène à sa perte. C’est ainsi que dans tous ses écrits, même dans ses pamphlets, Lafargue avance le résultat d’enquêtes et d’études scientifiques pour révéler les manipulations dont les pauvres sont l’objet, qu’elles viennent de l’Église, du patronat ou de la bourgeoisie. Dans la société communiste dont rêve Lafargue, l’émancipation concernera tous les hommes et toutes les femmes, et ces dernières doublement, car la société capitaliste les condamne à l’asservissement au mari et au patron.
Pour Paul Lafargue, le pays de Cocagne n’est pas un leurre, il adviendra dans une société sans capital ni propriété privée. En attendant, c’est le monde du travail qui provoque les plus grands malheurs, c’est un piège infernal dans lequel est tombée l’humanité, surtout le 215prolétariat. Le Droit à la paresse vise à secouer le prolétariat français qui réclama, au lendemain de la révolution de 1848, le droit au travail, après la fermeture des ateliers nationaux qui fournissaient du travail aux chômeurs parisiens22. « Honte au prolétariat français ! », lance Lafargue, pour s’être laissé pervertir par la morale bourgeoise, dont les philanthropes sont les représentants auxquels il livre ses attaques les plus virulentes23. En effet, pour Lafargue, loin de venir en aide aux plus misérables, les philanthropes exploitent la misère en endormant les pauvres. Qu’ils soient catholiques ou protestants, qu’ils exercent dans le Nord ou en Alsace, qu’ils s’appellent Scrive ou Dollfus, leurs bonnes actions sont des leurres destinés à tromper les familles ouvrières. Sous couvert de mots qui falsifient la réalité – une novlangue de la charité faite de « justice », « bonté », « fraternité » – et de pratiques qu’ils qualifient de « bienveillantes », les philanthropes cherchent à contrôler la population laborieuse, masse potentiellement dangereuse. Ce que veut le bourgeois, dit Lafargue, c’est que le pauvre accepte son sort, qu’il se soumette à l’autorité du patron et du curé. Et pour tromper les pauvres, il porte le « masque doucereux et cafard que doit porter la religion de la bourgeoisie exploitatrice et philanthropique » (Lafargue, 1909, p. 288).
La morale chrétienne a fait du travail l’occupation humaine la plus chère, et Lafargue déplore que les ouvriers soient prêts à accepter des salaires indécents et des conditions inhumaines pour travailler plutôt que d’être sans emploi. La philanthropie et sa charité s’appuient sur la morale du travail afin que les ouvriers aiment leur patron, qu’ils reconnaissent sa générosité quand il offre de précieux emplois. Pour nourrir cette illusion, les philanthropes sont même capables d’investir dans l’éducation des enfants d’ouvriers, leur traçant ainsi un chemin fait d’obéissance et de résignation :
216Les Dollfus, les Scherer-Kestner et les autres patrons de l’Alsace, les plus intelligents, les plus philanthropes et par conséquent les plus exploiteurs de la France d’avant la guerre, avaient fondé de leurs deniers, à Mulhouse, des écoles de dessin, de chimie, de physique, où les enfants les plus éveillés de leurs ouvriers étaient gratuitement instruits, afin qu’ils eussent toujours sous la main et à bon compte les capacités intellectuelles que réclamait le fonctionnement de leurs industries (Lafargue, 1900, p. 12-13).
Selon Lafargue, « l’amour du travail » est une folie propre aux nations capitalistes. Le travail a été « sacro-sanctifié » par les prêtres, les économistes et les moralistes, qui ont « voulu réhabiliter ce que Dieu avait maudit » (Lafargue, 1883, p. 7). Ici, le pamphlétaire fait mouche en révélant la fabrication du travail par l’Église qui s’est efforcée de valoriser une punition divine. Dans les sermons et les prédications de la fin du Moyen Âge, le travail devient sacré : travailler, c’est racheter la faute, c’est acquérir la dignité et espérer le salut de l’âme. Pour les sermonneurs, Adam n’était pas un paresseux au temps du paradis perdu, mais un travailleur de la terre d’Eden. Le travail ne peut donc pas être une punition divine puisque Dieu l’approuvait avant la Chute. D’ailleurs, si l’Architecte s’est reposé le septième jour, il ne cesse depuis de diriger l’univers, et ce dernier travaille constamment, avec un soleil qui court sans repos au-dessus d’une Terre où les créatures s’agitent en permanence. C’est également dans ce bas Moyen Âge que l’Église en termine avec le portrait d’un Jésus contemplatif, ne travaillant pas de ses mains. Jésus n’aura cessé pendant sa courte « carrière », dit le prêtre, d’œuvrer pour le salut de l’humanité. Lafargue rappelle pourtant, au début du Droit à la paresse, la parabole des lys, extraite du Discours sur la montagne où Jésus rassure son auditoire : « Contemplez la croissance des lis des champs, ils ne travaillent ni ne filent, et cependant, je vous le dis, Salomon, dans toute sa gloire, n’a pas été plus brillamment vêtu » (Lafargue, 1883, p. 10).
Au xiiie siècle, la formule du Frère prêcheur Guillaume Peyraut connaît un succès populaire : « l’oisiveté est la mère de tous les vices, la marâtre des vertus et l’occasion des tentations ». C’est alors que la paresse accède définitivement au statut de péché capital comme forme laïque de l’acédie. Elle condamne celui qui la goûte car elle ouvre la porte à tous les autres péchés, y compris capitaux, comme la gourmandise et la luxure. Elle détrône même l’orgueil, présenté jusque-là comme le 217commandant des armées peccamineuses, car elle gaspille l’un des biens les plus précieux que Dieu a donné aux humains, le temps. Lafargue a bien compris que le temps chrétien et bourgeois doit être employé à travailler, et ne doit pas être perdu en vaines occupations, comme les jeux et les fêtes, y compris pour les femmes :
où sont ces commères dont parlent nos fabliaux et nos vieux contes, hardies au propos, franches de la gueule, amantes de la dive bouteille ? Où sont ces luronnes, toujours trottant, toujours cuisinant, toujours chantant, toujours semant la vie en engendrant la joie, enfantant sans douleurs des petits sains et vigoureux ? (Lafargue, 1883, p. 14).
Dans la société capitaliste, les pauvres ont perdu le sens de la fête et la joie de vivre. C’est pourquoi le but ultime que fixe Lafargue à la révolution est « de travailler le moins possible et de jouir intellectuellement et physiquement le plus possible » (cité par Rouanet, 2007, p. 299). Le mensonge bourgeois fait de la paresse un crime pour pouvoir exploiter davantage les pauvres. La société capitaliste trompe les ouvriers en sacralisant le travail et en rendant la vie ouvrière dépendante du travail. Dans la société communiste rêvée par Lafargue, la machine sera émancipatrice : employée au service des humains et non du capital, elle rendra le travail beaucoup moins pénible et le simplifiera de telle sorte que les hommes et les femmes pourront changer facilement de métier. Et surtout, la machine réduira le temps de travail nécessaire pour subvenir à l’ensemble des besoins humains à deux ou trois heures par jour.
À rebours des philanthropes, pour Lafargue, ce n’est pas la paresse qui appauvrit et corrompt l’humanité, mais bien le travail, ce qu’ont également compris les Espagnols chez lesquels le mendiant traite d’égal à égal avec le noble, ainsi que les philosophes de l’Antiquité qui méprisaient le travail24. C’est le travail dans les fabriques qui est « la cause de toute dégénérescence intellectuelle, de toute déformation organique », voyez donc ces « servants de machines », dénonce Lafargue (Lafargue, 1883, p. 8). Plus loin :
218Nous avons aujourd’hui les filles et les femmes de fabrique, chétives fleurs aux pâles couleurs, au sang sans rutilance, à l’estomac délabré, aux membres alanguis !… Elles n’ont jamais connu le plaisir robuste et ne sauraient raconter gaillardement comment l’on cassa leur coquille ! – Et tes enfants ? Douze heures de travail aux enfants. Ô misère ! (Lafargue, 1883, p. 14).
Alors que pour les moralistes et les philanthropes, le travail rend digne et redresse les corps, pour Lafargue, ce sont ceux qui travaillent leur terre ou leur commerce qui « jamais ne se redressent pour regarder à loisir la nature ». C’est grâce à la paresse que les humains peuvent réellement lever les yeux au ciel en ne restant pas courbés sur leurs machines. C’est au contraire le travail qui corrompt l’humanité en avilissant les corps, et le prolétariat « s’est laissé pervertir par le dogme du travail (…). Toutes les misères individuelles et sociales sont nées de sa passion pour le travail » (id., p. 11).
Lafargue s’oppose aux philanthropes qui, dans le droit fil des encyclopédistes, défendent l’industrie et le travail comme fondements de la richesse des humains et des nations. Selon eux, l’industrie n’a aucun rapport avec la misère puisque cette dernière n’a qu’une seule origine, l’inconduite des femmes et des hommes qui composent la classe laborieuse, classe potentiellement dangereuse car facilement corruptible par les vices. C’est pourquoi il faut extirper dès le plus jeune âge les tentations de paresse en éduquant au travail la population laborieuse. « Douze heures de travail par jour, voilà l’idéal des philanthropes et des moralistes », dit Lafargue, et ce programme a été réalisé dès le xviiie siècle :
Les ateliers modernes sont devenus des maisons idéales de correction où l’on incarcère les masses ouvrières, où l’on condamne aux travaux forcés pendant 12 et 14 heures, non seulement les hommes, mais les femmes et les enfants ! (Lafargue, 1883, p. 13).
Qu’ils soient anglais ou français, les philanthropes encouragent le travail des enfants, aussi bien dans les workhouses que dans les asiles et refuges inspirés des pratiques d’outre-Manche. C’est ainsi que la loi du 22 mars 1841 votée après les travaux de Villermé, n’interdit que le travail des enfants de moins de 8 ans, dans les seules fabriques de plus de 20 ouvriers.
Lafargue cite un manufacturier du nom de Scrive, sans aucun doute l’un des frères Scrive, industriels du Nord connus pour leurs œuvres philanthropiques, comme la cité ouvrière de Marcq-en-Barœul. Dans 219un congrès de bienfaisance, il déclare en 1857 avoir appris aux enfants à chanter pendant leurs 12 heures de travail. Ces « bourreaux de l’enfance » que sont les philanthropes ont pourtant, comme le « Dr. Villermé », peint à leur manière « le brillant tableau des jouissances prolétariennes ». Et Lafargue reprend un passage où Villermé expose la condition des femmes et des enfants qui ont des journées de travail de 15 heures, avec des déplacements longs et éprouvants entre le foyer et la fabrique, et un autre passage où il décrit les logements, les conditions de vie, la mortalité infantile qui en dérive, et qui font du travail des enfants, selon les propres mots de Villermé, un « supplice », une « torture ».
Cependant, pour Lafargue, si l’atelier capitaliste « a arraché les ouvriers de leurs foyers pour mieux les tordre et pour mieux exprimer le travail qu’ils contenaient », les ouvriers sont responsables du sort réservé à leurs familles. En effet, ce sont les hommes qui, les premiers, sont tombés dans le piège du travail tendu par les démons capitalistes. Ce sont eux qui se révèlent encore les plus crédules devant la ruse bourgeoise et sont les plus fervents croyants dans la religion du travail. Ce sont « les fils des héros de la Terreur » qui ont entraîné dans leur déchéance les femmes et les enfants :
Ce travail, qu’en juin 1848 les ouvriers réclamaient les armes à la main, ils l’ont imposé à leurs familles ; ils ont livré, aux barons de l’industrie, leurs femmes et leurs enfants. De leurs propres mains, ils ont démoli leur foyer domestique ; de leurs propres mains, ils ont tari le lait de leurs femmes ; les malheureuses, enceintes et allaitant leurs bébés, ont dû aller dans les mines et les manufactures tendre l’échine et épuiser leurs nerfs ; de leurs propres mains, ils ont brisé la vie et la vigueur de leurs enfants (Lafargue, 1883, p. 14).
Pour Lafargue, la femme est plus encore victime du système capitaliste que l’homme. En effet, le capitaliste, en développant la production et en la mécanisant, a extrait la femme du foyer ouvrier, non pour l’émanciper de son mari, mais pour l’exploiter davantage que l’homme. Bien moins payée et devant travailler après le travail en fabrique, « l’intolérable condition de la femme est un danger pour la reproduction de l’espèce », affirme Lafargue dans La Question de la Femme (Lafargue, 1904, p. 22).
Dans Le Droit à la paresse, la femme n’est pas un être naturellement faible, c’est l’homme qui a été tenté par l’atelier capitaliste, et comme son travail ne suffisait pas à nourrir sa famille, alors il a provoqué le malheur de sa femme et de ses enfants qui ont été, à leur tour, corrompus par le 220travail industriel. Désormais, « livrés corps et âme au vice du travail, ils précipitent la société tout entière dans ces crises industrielles de surproduction qui convulsent l’organisme social » (Lafargue, 1883, p. 21). C’est le surtravail, et non la paresse, qui alimente la surproduction, d’où vient le chômage, selon un cycle infernal qu’entretiennent les prolétaires. Réclamant du travail en temps de crise, ils voient leurs salaires divisés par deux, et doivent donc travailler davantage encore. Pour continuer à fournir du travail, les fabricants sont condamnés à leur tour à écouler leurs marchandises en recherchant de nouveaux débouchés. En colonisant de nouvelles terres, ils « vont alors chez les nations heureuses qui lézardent au soleil, ériger des fabriques et importer la malédiction du travail » (id., p. 24). La « filière inversée », qui sera théorisée par Galbraith dans les années 1960, s’explique par la folie du travail, car le grand problème de la production capitaliste est de « découvrir des consommateurs, d’exciter leurs appétits et de leur en créer de factices » (id., p. 35). C’est cette même folie du travail qui détermine l’obsolescence programmée des draps et des fibres car « tous nos produits sont adultérés pour en faciliter l’écoulement et en abréger l’existence », ce que Lafargue appelle « l’âge de la falsification ». Tout ceci est destiné à « fournir du travail aux ouvriers qui ne peuvent se résigner à vivre les bras croisés » (id., p. 37).
Les misères cesseront quand le prolétariat éloignera les tentations du travail et proclamera les droits à la paresse : « qu’il se contraigne à ne travailler que trois heures par jour, à fainéanter et bombancer le reste de la journée et de la nuit » (id., p. 25). Dans la société capitaliste, le prolétariat ne peut pas compter sur la machine qui, au lieu de réduire les efforts de l’ouvrière et de l’ouvrier et d’allonger leur repos, a créé une concurrence « absurde et meurtrière » entre les humains. Comme il faut être toujours plus productif, les jours fériés disparaissent, et la classe laborieuse est contrainte de travailler toujours plus pour gagner toujours moins. Condamner les ouvriers au surtravail et à la surproduction, condamne les bourgeois « à la paresse et à la jouissance forcée, à l’improductivité et à la surconsommation » (id., p. 30). Chez Lafargue, ce sont les bourgeois qui se livrent à la débauche afin de « donner un but au labeur des ouvriers ». Dans la société capitaliste, la paresse est le reflet du conflit des classes ; elle est réservée à la bourgeoisie qui est contrainte de trop consommer en toute chose, afin de fabriquer des emplois d’ouvriers et de domestiques. Ainsi, ce sont souvent les « femmes du monde » 221qui changent continuellement de toilette pour donner du travail aux couturières. Et ces femmes philanthropes « tournaient dans les bals de charité afin de ramasser quelques sous pour le pauvre monde ». Mais pas n’importe quel pauvre monde, celui des enfants et des orphelins, celui des femmes ouvrières qui peuvent remettre leur mari dans le droit chemin.
En deux siècles, dit Lafargue, la bourgeoisie a perdu ses goûts modestes et ses habitudes laborieuses pour se « livrer au luxe effréné, aux indigestions truffées et aux débauches syphilitiques » (id., p. 31). Et comme la famille bourgeoise idéale suppose une femme domestiquée25, et un mari jouant au chef, Lafargue, avant de terminer son ouvrage par son adresse à la Paresse, « mère des arts et des nobles vertus », envisage comment une
France capitaliste, énorme femelle, velue de la face et chauve du crâne, avachie, aux chairs flasques, bouffies, blafardes, aux yeux éteints, ensommeillée et bâillant, s’allonge sur un canapé de velours ; à ses pieds, le Capitalisme industriel, gigantesque organisme de fer, à masque simiesque, dévore mécaniquement des hommes, des femmes, des enfants, dont les cris lugubres et déchirants emplissent l’air (Lafargue, 1883, p. 47).
Alors que la pauvresse est généralement représentée mal fagotée, avachie sur un siège, son foyer en désordre, le regard perdu dans le vide, ne sachant quoi faire car n’ayant envie de rien, la bourgeoise, avec ses domestiques, montre aux yeux de tous, sa capacité à ne pas travailler. Pour elle, il n’est pas question d’une paresse grossière, mais d’une douce oisiveté, d’une paresse aimable parfois en compagnie d’un animal domestique, allongée sur le ventre ou le côté, dans des draps soyeux. C’est peut-être une courtisane qui a réussi et, pour Lafargue, la prostitution n’est pas assimilée à la paresse. Au contraire, c’est un travail honorable qui permet de se libérer de l’esclavage conjugal et du bagne capitaliste. Ainsi, n’hésite-t-il pas à conclure Le Sermon de la Courtisane par cette adresse aux femmes : « Si vous avez trop de fierté dans l’âme pour accepter sans révolte le travail dégradant de l’ouvrière et la vie abêtissante de la ménagère, prostituez-vous » (Lafargue, 1887, p. 41). Mais Lafargue sait bien que ces « reines des fêtes » sont rares et que les femmes connaissent une « intolérable condition ». Et puisque 222l’ouvrier a condamné la femme et les enfants à le suivre dans les ateliers capitalistes, où ils ont vu « leur corps et leur intelligence se corrompre », Lafargue a davantage de considération pour la condition féminine, lui qui regrettait les sociétés matriarcales (Lafargue, 1886). Ainsi, dans l’esprit de Lafargue, la femme est bien plus forte que l’homme, en intelligence du moins. Ne serait-ce pas sur elle qu’il faudrait plutôt compter pour réclamer le droit à la paresse, car « comment demander à un prolétariat corrompu par la morale capitaliste une résolution virile ? » (Lafargue, 1883, p. 49).
CONCLUSION
La paresse, qu’elle soit envisagée comme un péché capital ou comme un vice social, a ceci de particulier qu’elle se cache. C’est ainsi qu’elle est associée, dès le Moyen Âge, à l’escargot qui se recroqueville dans sa coquille ou aux animaux que les humains ne voient pas la journée. Les vagabonds qui volent le bien des honnêtes gens, les noceurs qui ont du mal à se lever le matin, sont des parasites pour la société, eux qui cherchent à ne pas travailler. Pire, la paresse peut porter des masques afin de tromper l’autre et provoquer son geste bienfaisant. La charité doit donc être bien ordonnée et répondre à une utilité sociale, ce que les philanthropes s’efforceront de réaliser après avoir enquêté sur la population laborieuse, la plus susceptible de commettre des délits et des crimes ou, plus communément, soupçonnée de ne pas remplir ses devoirs. Que fait la femme dans son foyer ? Que fait l’homme pour chercher à s’employer ? Telles sont les questions que doivent se poser celles et ceux qui sont guidés par l’amour du prochain. Refusant de poser la question centrale de l’organisation industrielle et rejetant l’intervention de l’État, la philanthropie cherche à réformer la conduite des hommes, des femmes et des enfants. Redresser les corps et les esprits, les doter de force et de raison pour les rendre employables, suppose alors d’extirper le vice de paresse chez les « gens de peu ». Épargne, sobriété et travail pour celles et ceux qui ont le souci de bien faire. Enfermement, rééducation et redressement pour les autres, les plus éloignés de la vertu.
223Lafargue est l’un de ceux qui, à la fin du xixe siècle, s’insurgent contre la physique sociale qui réclame toujours plus d’effort productif, toujours plus de corps et d’âmes à pervertir au nom de l’efficacité industrielle. C’est entre 1870 et 1930 que sont édités le plus grand nombre d’éloges de la paresse cherchant à subvertir l’ordre économique établi et, après la révolution russe, la domination ne sera plus liée au seul capitalisme, mais aux fondements mêmes du travail. Ainsi, pour Bertrand Russell, le capitalisme n’est qu’une forme d’exploitation, car le dogme du travail est né avant l’industrie quand les guerriers, les prêtres et les seigneurs ont fait travailler les autres pour leur propre confort (Russell, 2002). Après la révolution, l’attitude des maîtres communistes n’a pas changé en la matière, et Russell ne croit guère qu’ils réduiront le temps du travail tant « le travailleur manuel est placé sur un piédestal ». Quant à notre siècle, la parution de nouveaux éloges de la paresse indique le malaise du travail (Maier, 2004 ; Grozdanovitch, 2009 ; Vaneigem, 2009). Celui de Raoul Vaneigem rappelle le temps où la femme était le « repos du guerrier », et comment la paresse a connu les mêmes mauvais traitements que la femme. Faire de la femme le repos du guerrier, c’est l’identifier à la paresse. Or, le droit à la paresse n’est pas le droit de ne rien faire, mais comme l’écrivait Robert Louis Stevenson, le droit de « faire beaucoup de choses qui échappent au dogme de la classe dominante », classe composée d’hommes pour l’essentiel.
224BIBLIOGRAPHIE
Casagrande, Carla & Vecchio, Silvana [2003], Histoire des péchés capitaux au Moyen Âge, Paris, Aubier.
Chartier, Roger [1982], Figures de la gueuserie, Paris, « Bibliothèque bleue », Montalba.
Chassagne, Serge [1980], Oberkampf, un entrepreneur capitaliste au siècle des Lumières, Paris, Aubier-Montaigne.
Clément, Alain [2006], « Lutter contre l’oisiveté des pauvres et aiguiser leur convoitise : les préconisations développementalistes des économistes mercantilistes et classiques », Revue Tiers Monde, No 185, p. 183-205.
Delumeau, Jean [1983], Le péché et la peur : la culpabilisation en Occident, Paris, Fayard.
Diderot, Denis & d’Alembert, Jean le Rond, [1751-1772], Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, ATILF, 1998.
Duprat, Catherine [1993], Le temps des philanthropes, Vol. I, Paris, Éditions du CTHS.
Duprat, Catherine [1997], Usage et pratiques de la philanthropie. Pauvreté, action sociale et lien social à Paris, au cours du premier xixe siècle, Paris, Comité d’Histoire de la Sécurité sociale.
Fossier, Robert [2000], Le travail au Moyen Âge, Paris, Hachette.
Foucault, Michel [1975], Surveiller et punir, Paris, Gallimard.
Frégier, Honoré-Antoine [1840], Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes et des moyens de les rendre meilleures, Paris, Librairie de l’Académie Royale de Médecine.
Gérando, Joseph-Marie de [1824], Le visiteur du pauvre, Paris, éditeur Jean-Michel Place, 1989.
Geremek, Bronislaw [1987], La Potence et la pitié. L’Europe des pauvres du Moyen Âge à nos jours, Paris, Gallimard.
Grozdanovitch, Denis [2009], L’art difficile de ne presque rien faire, Paris, Denoël.
Lafargue, Paul [1883], Le Droit à la paresse. Réfutation du « Droit au Travail » de 1848, Paris, éditeur Henry Oriol.
Lafargue, Paul [1886], Le matriarcat : études sur l’origine de la famille, https://www.marxists.org/francais/lafargue/works/1886/10/matriarcat.htm
Lafargue, Paul [1887], La Religion du Capital, Paris, Bibliothèque socialiste.
Lafargue, Paul [1900], Le socialisme et les intellectuels, Paris, éditeurs V. Giard & E. Brière.
225Lafargue, Paul [1904], La Question de la Femme, Paris, Édition de L’Œuvre Nouvelle.
Lafargue, Paul [1909], Le déterminisme économique de Karl Marx, Paris, V. Giard & E. Brière.
Landes, David [1987], L’Heure qu’il est. Les horloges, la mesure du temps et la formation du monde moderne, Paris, Gallimard.
Le Goff, Jacques [1986], La bourse et la vie. Économie et religion au Moyen Âge, Paris, Hachette.
Le Goff, Jacques [2010], Le Moyen Âge et l’argent, Paris, Éditions Perrin.
Le Play, Frédéric [1870], L’organisation du travail selon la coutume des ateliers et la loi du Décalogue, Tours, Alfred Manne & Fils.
Maier, Corinne [2004], Bonjour paresse, Paris, Michalon.
Malthus, Thomas Robert [1889], Essai sur le principe de population, Paris, Guillaumin & Cie.
Parent-Duchâtelet, Alexandre [1836], La prostitution à Paris au xixe siècle, Paris, Éditions du Seuil, 1981 ; édition abrégée de De la prostitution dans la ville de Paris considérée sous le rapport de l’hygiène publique, de la morale et de l’administration.
Renaut, Marie-Hélène [1998], « Vagabondage et mendicité : délits périmés, réalité quotidienne », Revue Historique, No 299-300, p. 287-322.
Rouanet, Yann [2007], Paul Lafargue : porte parole du socialisme scientifique ? Du « droit à la paresse » au développement des droits fondamentaux, Thèse de Droit public présentée et soutenue le 2 février 2007, Université de Reims Champagne-Ardenne.
Rousseau, Jean-Jacques [1755], Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Paris, Garnier-Flammarion, 1971.
Rousseau, Jean-Jacques [1762], Émile ou De l’éducation, Paris, « Folio-Essais », Gallimard, 1969.
Russell, Bertrand [1932], Éloge de l’oisiveté, Paris, Allia, 2002.
Smith, Adam [1776], Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Paris, « Folio », Gallimard, 1976.
Thompson, Edward [2004], Temps, discipline du travail et capitalisme industriel, Paris, La Fabrique éditions.
Vaneigem, Raoul [2009], Éloge de la paresse affinée, Vico Acitillo, Poetry Wave.
Vargas, Yves [2005], « Paresse et friponnerie », Cités, No 21, p. 115-130.
Villermé, Louis René [1840], Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie, Tomes I & II, Paris, Librairies Jules Renouard & Cie.
1 La paresse entre dans le Septénaire des péchés capitaux à la fin du Moyen Âge. Depuis le ive siècle, la liste des péchés et des sentences est destinée aux moines, et les moines ne sont pas tentés par la paresse mais par l’acédie, définie comme une tristesse de l’âme qui l’empêche d’aller vers Dieu. Ce mot aux origines grecques (akêdéia) est mal compris des laïcs. C’est après la Somme Théologique (1266-1273) de Thomas d’Aquin que l’Église inscrit la paresse au Septénaire, considérant l’acédie du corps (ou paresse) comme la manifestation de l’acédie de l’âme (ou tristesse). L’acédie n’est plus alors réservée aux seuls moines, et devient sous le nom de paresse un danger pour tout fidèle (Casagrande & Vecchio, 2003).
2 La paresse étant un péché qui ne se montre pas, de même que la femme en son foyer, certains l’envisagent comme un péché féminin, tel le prédicateur Bernardin de Sienne : « Tant que tu maintiendras ton épouse en haleine, elle ne restera pas à la fenêtre et il ne lui passera pas par la tête, tantôt une chose, tantôt une autre ». C’est donc au mari d’occuper son épouse, car les femmes sont naturellement paresseuses (Delumeau, 1983, p. 258).
3 Les vagabonds sont accusés de constituer des bandes de gueux et de gueuses, des faux mendiants qui errent aux marges de la société et vivent parfois dans une Cour des Miracles. Ils sont présentés comme formant des compagnies, à l’image des corps de métier, qui se transmettent les secrets de fabrication de leurs ruses et de leurs faussetés (Chartier, 1982).
4 Citoyen, et non citoyenne, car comme l’écrit Diderot dans l’article qu’il lui consacre dans l’Encyclopédie, « on n’accorde ce titre aux femmes, aux jeunes enfants, aux serviteurs, que comme des membres de la famille d’un citoyen proprement dit, mais ils ne sont pas vraiment citoyens » (Diderot, 1998, vol. 3, p. 488). D’ailleurs, l’ouvrière est la grande absente des articles de l’Encyclopédie traitant des arts et de l’industrie, et elle n’est présente dans les planches que dans les seules tâches subalternes et peu qualifiées.
5 Lire l’analyse d’Yves Vargas (Vargas, 2005).
6 Selon Rousseau, la société du travail est née quand les hommes ont fabriqué des machines pour soulager leurs efforts, car il faut bien des hommes pour fabriquer et conduire les machines. C’est donc la faculté même des humains à se perfectionner qui va engendrer leurs plus grands maux alors que « nous les aurions presque tous évités en conservant la manière de vivre simple, uniforme, et solitaire qui nous était prescrite par la nature » (Rousseau, 1971, p. 179).
7 Car c’est en changeant fréquemment d’ouvrage que l’ouvrier devient « presque toujours paresseux et incapable d’un travail sérieux et appliqué, même dans les occasions où il est le plus pressé d’ouvrage » (Smith, 1976, p. 44).
8 Selon Michel Foucault, la discipline du travail a hérité de la discipline monastique (Foucault, 1975, p. 151). Et, pour David Landes, le souci de ponctualité de l’Église romaine explique en partie l’invention de l’horloge dont les premières scansions ont marqué les temps de travail, de prière et de repos dans les monastères (Landes, 1987, p. 109-112).
9 Selon Edward Thompson, les communautés paysannes sont orientées par la tâche car elles font leur travail sans prendre la mesure du temps. C’est la révolution industrielle qui impose un travail mesuré par le temps et une discipline pour mieux le rentabiliser, notamment en luttant contre la paresse des ouvriers que condamnent les moralistes et les mercantilistes (Thompson, 2004). En effet, pour les économistes d’alors, la paresse est un obstacle au développement, mais un autre péché, l’envie, peut donner goût au travail (Clément, 2006).
10 C’est ainsi que Villermé, Frégier et Parent-Duchâtelet, très présents dans cette partie, appartiennent à l’Académie de Médecine. Hygiénistes, ils envisagent la ville comme le lieu d’accumulation des déchets, y compris humains et sociaux, qu’il s’agit de rendre invisibles, voire d’éliminer.
11 Gérando est l’auteur des Considérations sur les diverses méthodes à suivre dans l’observation des peuples sauvages (1800) écrites après ses expéditions scientifiques dans les terres australes.
12 Dans son avertissement au Visiteur, Gérando revient sur le « scepticisme systématique » qu’ont jeté les écrits de Malthus sur l’aide aux indigents. Si Gérando considère que le principe de population est une théorie « erronée et funeste », il reprend à son compte le raisonnement malthusien concernant la « charité volontaire et active, qui connaît en détail ceux dont elle soulage les peines ; qui sent par quels étroits liens sont unis le riche et le pauvre, et s’honore de cette alliance ; qui visite l’infortuné dans sa maison et ne s’informe pas uniquement de ses besoins, mais de ses habitudes et de ses dispositions morales. Une telle charité impose silence au mendiant effronté, qui n’a pour recommandation que les haillons dont il affecte de se couvrir ; elle encourage au contraire, soutient, console, assiste avec libéralité celui qui souffre en silence des maux non mérités » (Malthus, 1889, p. 123).
13 Le chapitre xvii du Visiteur est tout entier consacré au « faux mendiant ». Ici aussi, l’inspiration malthusienne est évidente : si notre « bienveillance ne distingue rien, si le degré de malheur apparent est la seule mesure de notre libéralité, il est clair qu’elle ne s’exercera presque que sur les mendiants de profession, tandis que le mérite modeste et malheureux, luttant contre d’inévitables difficultés, mais aimant, jusque dans la misère, la propreté et s’attachant à conserver des formes décentes, sera négligé. Nous secourrons ceux qui seront les moins dignes de secours. Nous encouragerons la fainéantise et nous laisserons périr l’homme actif et laborieux. En un mot, nous irons directement contre les vues de la nature et nous diminuerons la somme du bonheur » (Malthus, 1889, p. 118).
14 Leurs pères étant ouvriers, Parent-Duchâtelet regrette que les ateliers soient des « foyers de corruption dont on peut déplorer les pernicieux effets, tout en admirant les produits qu’ils fournissent » (Parent-Duchâtelet, 1981, p. 86).
15 Certaines prostituées font cependant l’objet d’un jugement bienveillant de la part du philanthrope : les femmes qui manquent de travail, les mères de famille obligées de se prostituer pour nourrir leurs enfants, et les jeunes filles qui ont de trop maigres salaires (Parent-Duchâtelet, 1981, p. 100).
16 Selon Villermé, les mœurs sont plus « pures » à la campagne, et certaines villes, comme Reims, sont « infectées de prostitution » (Villermé, 1840, t. I, p. 227). Selon cette même tradition, Le Play explique cette décadence par la perte de la religion qui fait perdre la culture du foyer domestique. C’est parce qu’elles ont oublié le Décalogue que « les familles de toute classe (…), lorsqu’elles ne songent plus qu’à la vie présente, préfèrent la vie sensuelle des villes à la vie plus sévère des campagnes » (Le Play, 1870, p. 198).
17 Y compris dans les ateliers (Villermé, t. I., p. 32). Cette idée sera reprise par Le Play pour qui la femme doit être dispensée des travaux de l’atelier : elle doit rester au foyer pour la préserver des vices. C’est de cette manière que les maris et les frères peuvent retrouver un bien-être en rentrant au domicile après le travail (Le Play, 1870, p. 161-164).
18 L’enfant a un naturel « indolent et paresseux, son caractère résiste au travail avec une opiniâtreté instinctive » (Frégier, 1840, p. 195).
19 Il faut occuper les ouvriers même le dimanche, par « des divertissements utiles à leur santé et par des études attrayantes dirigées de manière à les perfectionner dans leurs métiers, à leur donner, avec des idées d’ordre, d’économie, et avec le sentiment religieux, l’instruction morale et intellectuelle » (Villermé, 1840, t. II, p. 68).
20 « qu’à l’abandon complet dans lequel la plupart laissent l’ouvrier, à la pensée exclusive d’exploiter sa position, succédât de leur part une pensée plus généreuse, plus humaine, un patronage qui leur serait au moins aussi profitable que leur égoïsme. C’est ce patronage bien compris, bien exercé, qui peut le plus efficacement contribuer à l’amélioration du sort et de la morale des ouvriers », conclut Villermé (Villermé, 1840, t. II, p. 372).
21 Lire, dans ce numéro de la RHPE, l’article de Marlyse Pouchol consacré à la famille selon Proudhon. Paul Lafargue combat tous ceux qui affirment l’infériorité de la femme, y compris chez les socialistes (Rouanet, 2007, p. 240-242). En s’appuyant sur des travaux démographiques et anthropologiques, il affirme, au contraire, la supériorité de la femme : « sa vitalité plus grande lui permet de tenir son rôle de reproductrice et son intelligence supérieure de penser à long terme. C’est bien pourquoi la femme a souvent été déifiée et que Jupiter avala Métis pour assimiler sa ruse et sa sagesse… C’est par la force brutale que l’homme a finalement dompté la femme et cet asservissement est contraire au progrès humain : il le ralentit dès lors que les femmes sont privées par les hommes des moyens de leur développement » (Lafargue, 1904, p. 10-19).
22 D’où vient le sous-titre du pamphlet de Lafargue, souvent oublié, y compris des éditeurs contemporains : Réfutation du « Droit au travail » de 1848.
23 Quand Lafargue écrit son pamphlet, la philanthropie issue des Lumières décline. Elle a connu son apogée dans la première moitié du xixe siècle, et les auteurs présentés plus haut en sont des figures exemplaires. Dans la deuxième moitié du siècle, leur science de l’indigence est progressivement remplacée par une science de la société destinée à produire des réformes sociales. L’une de ces figures de réformateur est Frédéric Le Play dont Lafargue « doit reconnaître le talent d’observation, alors même que l’on rejette ses conclusions sociologiques, entachées de prudhommisme philanthropique et chrétien » (Lafargue, 1883, p. 9).
24 « l’artiste se réjouit en admirant le hardi Andalou, brun comme des castagnes, droit et flexible comme une tige d’acier ; et le cœur de l’homme tressaille en entendant le mendiant, superbement drapé dans sa capa trouée, traiter d’amigo des ducs d’Ossuna. Pour l’Espagnol, chez qui l’animal primitif n’est pas atrophié, le travail est le pire des esclavages. Les Grecs de la grande époque n’avaient, eux aussi, que du mépris pour le travail : aux esclaves seuls il était permis de travailler, l’homme libre ne connaissait que les exercices corporels et les jeux de l’intelligence » (Lafargue, 1883, p. 10).
25 Lafargue débute La Question de la Femme par la manière dont le bourgeois envisage la femme et qui se traduit par ce qu’il appelle la « domestication de la femme » : la femme « doit rester à la maison et consacrer son activité à surveiller et diriger le ménage, à soigner le mari, à fabriquer et nourrir les enfants » (Lafargue, 1904, p. 3).