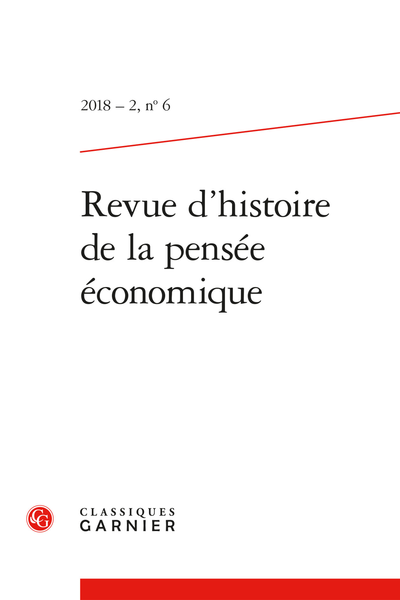
La monnaie : postulat ou résultat ? Une analyse à partir d’exemples de théories monétaires hétérodoxes
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Revue d’histoire de la pensée économique
2018 – 2, n° 6. varia - Auteur : Piluso (Nicolas)
- Résumé : Tandis qu’Orléan-Aglietta et Benetti-Cartelier jugent indispensable l’adoption d’un postulat de la monnaie comme fondement de l’analyse économique, Wray tente de faire de la monnaie un résultat de l’analyse économique. Cet article montre que toutes ces théories économiques de la monnaie, qu’elles le revendiquent ou non, doivent recourir à un postulat de la monnaie et abandonner l’idée de faire de la monnaie un résultat de la théorie économique.
- Pages : 97 à 115
- Revue : Revue d’histoire de la pensée économique
- Thème CLIL : 3340 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Histoire économique
- EAN : 9782406087595
- ISBN : 978-2-406-08759-5
- ISSN : 2495-8670
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-08759-5.p.0097
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 05/12/2018
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : Monnaie, théorie de la valeur, État, déséquilibre, règle de Cantillon
97
LA MONNAIE :POSTULAT OU RÉSULTAT ?
Une analyse à partir d'exemples
de théories monétaires hétérodoxes
Nicolas PILUSO
Université de Toulouse
INTRODUCTIONI
La prise en compte de la monnaie par l'analyse économique et la détermination de son origine sont des questions qui restent toujours d'actua.lité dans la littérature. En témoignent la sortie récente de l'ouvrage d'Aglietta (2016), La monnaie entre dettes et souveraineté et de l'ouvrage New contributions to monetary analysis (2013), qui reprend certaines des contributions présentées lors du colloque L'Analyse monétaire de l'économie qui s'est tenu à Grenoble les 15 et 16 avri12010 à propos de Marchands, salariat et capitalistes de Benetti et Cartelier.
En s'appuyant sur le postulat naturaliste de nomenclature des biens (Cartelier, 1985), la théorie néoclassique a tenté d'intégrer a posteriori la monnaie à la théorie de la valeur. Cette démarche analytique est le fruit
d'une volonté des économistes issus de l'approche standard d'extraire l'individu de toute donnée sociale prédéterminée pour déduire du seul individu rationnel toutes les relations d'interdépendances entre agents économiques. Après avoir totalement échoué sur cette problématique de l'intégration de la théorie de la monnaie à la théorie de la valeurZ, la théorie néoclassique a démontré que des équilibres généraux avec mon- naie peuvent exister (Iwai, 1988 ; Kiyotaki &Wright, 1993). Néanmoins ces modèles de prospection monétaire ne sont pas parvenus à fonder l'émergence de la monnaie sur les choix individuels. On doit à Benetti (1996, 2001), et à Cartelier (1991, 1996, 2016) une analyse critique rigoureuse de ces différentes approches standard. C'est pourquoi nous ne nous attarderons pas sur ce pan de la théorie monétaire qui n'a pas réussi à faire de la monnaie un résultat de l'analyse économique fondée sur le postulat de nomenclature.
Le débat est cependant vif dans le camp des théories «alternatives » de la monnaie. Faut-il poser un postulat monétaire à la source même de toute analyse économiques ou bien faut-il développer une théorie préalable expliquant le fondement de droit ou montrant l'origine de fait de la mon- naie, une théorie fondée sur des postulats « a- » ou «pré-monétaires » ?
La théorie des systèmes de paiement de Benetti et Cartelier ainsi consiste à postuler l'existence de la monnaie. L'idée sous-jacente est que les échanges ne peuvent avoir lieu sans monnaie et que cette dernière doit être le point de départ de l'analyse économique. Les auteurs considèrent que la monnaie ne relève pas d'une logique de choix individuels :c'est une institution, un ensemble de règles. La pensée Benetti et Cartelier fait écho à celle de Keynes (1930) développée dès les premières pages du Traité de la monnaie :l'État établit le nom de l'unité de compte (« il écrit le dictionnaire ») et instaure les formes sous lesquelles la monnaie circule (« il impose le dictionnaire »). La récente théorie néo-chartaliste émanant de certains économistes postkeynésiens (Wray, 2003) reven- dique explicitement son lien avec l'approche du postulat keynésien de la monnaie au sens où ils établissent un lien étroit entre monnaie et
décisions étatiques. Mais contrairement à Benetti et Cartelier qui se «limitent » à analyser le fonctionnement de l'économie monétaire, les néo-chartalistes cherchent à expliquer l'origine de la monnaie et donc à s'affranchir du postulat institutionnaliste de la monnaie.
La théorie d'Aglietta et Orléan (2012) est présentée par certains éco- nomistes comme une théorie de l'origine de la monnaie. Elle s'appuierait sur un postulat «pré-monétaire », celui du mimétisme, dont la monnaie serait le résultat (Cartelier, 2016). En réalité, nous montrerons qu'Aglietta et Orléan établissent la genèse des formes de la liquidité pour l'étude des systèmes monétaires et de leurs crises en s'appuyant sur un postulat monétaire. Leur démarche partage donc un point commun fondamental avec la théorie monétaire de Cartelier. Leur thèse ambitionne de fonder l'émergence d'une forme particulière de la monnaie sur la rivalité entre individus contenue dans les rapports marchands. La monnaie devient dans ce cadre l'institution médiatrice qui permet de juguler la violence sociale.
L'objet de cet article est de mettre (ou remettre) en évidence l'intérêt ou les limites propres à chaque approche et de poser la question de savoir si les résultats de la théorie économique doivent amener à considérer la monnaie comme un résultat ou un postulat. Nous considérons ici comme acquise l'idée que l'approche standard (de type néoclassique) n'est pour le moment pas parvenue à faire de la monnaie un résultat de la théorie des choix et/ou de la théorie de la valeur.
De toute évidence, l'article n'ambitionne pas d'apporter une réponse complète et définitive à cette problématique dont le traitement mériterait certainement un ou plusieurs ouvrages. L'actualité de l'ouvrage d'Aglietta, les réactions qu'il a suscitées (Cartelier, 2016) et les liens qu'il tisse avec les approches de Benetti-Cartelier et de Wray qui nous ont conduit à faire le choix (au moins partiellement arbitraire) de prendre pour base de réflexion ces trois exemples d'hétérodoxie monétaire.
L'article développe succinctement la théorie des systèmes de paie- ment (Benetti-Cartelier) dans une section I, la théorie de Wray dans une section II et enfin la théorie du mimétisme (Aglietta-Orléan) dans une troisième et dernière section. Cette présentation permettra de voir que toutes ces approches recourent ou doivent recourir à un postulat institutionnaliste de la monnaie.
100
I. LA THÉORIE DES SYSTÈMES DE PAIEMENT
MONNAIE ET DÉSÉQUILIBRE
La genèse du modèle de Benetti et Cartelier est liée au constat d'échec, dans les années 80, de l'ensemble des travaux visant à intégrer la théorie de la monnaie à la théorie de la valeur, que cette dernière soit d'obédience néoclassique ou marxiste (Marx, 1867)3. Or, les auteurs montrent que le déroulement d'échanges sans monnaie est le plus souvent impossible (Benetti, 1985 ; Cartelier, 1991). Dans la théorie de l'équilibre général d'Arrow-Debreu, par exemple, les économistes parviennent à déterminer les prix d'équilibre et démontrer l'existence de cet équilibre, mais sont incapables de montrer comment l'économie peut parvenir à cet équilibre, faute de monnaie dans l'économie4.
Leur modèle part de la formulation d'un postulat de la monnaie qui révèle que le choix des individus s'effectue dans le cadre d'une société organisée et encadrée par des institutions. Son but est de mettre en évidence que l'économie fonctionne en déséquilibre, alors que la théorie de la valeur standard n'étudie que les situations d'équilibre.
Le modèle reprend pour ce faire la règle de formation endogène des prix de Cantillon (1755). Ce dernier définit le prix comme le rapport entre la quantité de monnaie apportée au marché pour acheter les biens et la quantité de biens offerts pax les marchands. Il est possible d'écrire le prix effectif d'un bien i de la façon suivante
![]()
zh~
e a h
P; = P;
zh~
h
(1)
avec p° le prix anticipé du bien i (on suppose ici que les anticipations sont identiques pour tous les individus) et zhti la demande nette du bien i pour l'agent h, affectée d'un signe « + » lorsqu'elle est positive (h acheteur de i), ou affectée d'un signe «-» lorsqu'elle est négative (h vendeur de i)6.
Le prix anticipé du bien peut être différent du prix effectif. Si les individus font une erreur d'anticipation, ils sont en déséquilibre à la fois réel et monétaire. D'un point de vue monétaire, les vendeurs peuvent empocher plus ou moins de monnaie qu'ils ne l'avaient prévu. D'un point de vue réel, les acheteurs peuvent recevoir plus ou moins de biens) qu'ils ne l'avaient prévu.
L'un des résultats originaux de la théorie monétaire de Cartelier, et donc son intérêt fondamental, concerne la théorie des crises.
À l'échelle macroéconomique, toute la monnaie apportée au marché circule ; on pourrait donc penser que tout se passe comme si l'offre crée sa propre demande. Dans leur article de 2001, Benetti et Cartelier montrent que la «règle de Cantillon » implique le respect d'une sorte de «loi de Walras' » en vertu de laquelle la valeur des biens offerts à l'échelle globale du marché est égale à la quantité de monnaie mise en circulation pour acheter ces biens. Une simple manipulation des termes de l'équation (1) permet de le mettre en évidence
[~ Zhi
Pi = pt h ~ > Pi [~ Zhi pt [~ Zhi ~ > Pi [~ khi [~ mhi (2~
h h h h
Zhi
h
avec ~ mh~ la somme des quantités de monnaie distribuées aux agents h pour acheter le bien i.
Autrement dit, on pourrait penser qu'à l'instar de la loi de Say, le modèle de Benetti et Cartelier implique l'impossibilité des crises géné- rales de surproduction. En fait, il n'en est rien.
En vertu de la «règle de Cantillon », toutes les marchandises portées au marché sont vendues, ce qui ne signifie pas qu'il y a un équilibre général :ces prix de déséquilibre laissent tous les individus insatisfaits (sauf exception d'équilibre général). En fait, le cas général est que tous les individus connaissent deux déséquilibres, l'un monétaire (soldes monétaires positifs ou négatifs dont la somme sociale s'annule) l'autre réel (les allocations réelles effectives diffèrent de celles qui étaient dési- rées). Le fait que tous les individus soient simultanément en déséquilibre est le signe d'une «crise générale » qui est dans l'approche monétaire l'équivalent de ce que serait une crise générale de surproduction dans l'approche de la valeur. Dans la théorie des systèmes de paiement, per- sonne n'observe les marchés mais chacun connaît sa situation et sait s'il est ou non à l'équilibre. L'analyse monétaire met l'accent sur les individus et non sur les marchés.
La différence fondamentale entre cette approche et le modèle d'équilibre général est donc qu'elle permet de rendre compte du déroulement des transactions en situation de déséquilibre, et qu'elle permet donc d'intégrer la sanction du marché (validation a posteriori). Il s'agit d'une avancée analytique considérable par rapport à l'approche standard. En effet, les individus qui acceptent d'échanger ne le font plus grâce à la déter- mination préalable de l'équilibre général (cela nécessite l'introduction d'un secrétaire de marché qui n'est pas souhaitable sur un marché aux échanges décentralisés), mais grâce à la monnaie qui, pour reprendre les termes de Cartelier, «offre le mode d'accord souple qui respecte les deux principes fondamentaux de toute théorie des rapports marchands, l'échange volontaire et la recherche de l'avantage personnel » (Cartelier, 1991, p. 20)8. À paxtir de là, l'objet de la théorie des systèmes de paiement
est de préciser les hypothèses minimales qu'il faut introduire dans la théorie du marché pour que l'accord par la monnaie puisse fonctionner.
La monnaie étant définie par Cartelier comme un moyen d'exécution des transactions indépendamment de l'existence de l'équilibre général, l'économiste commence par analyser la conséquence du rejet du troc les prix des biens ne sont pas réels mais exprimés dans une unité « exté- rieure »aux biens. La monnaie constitue ainsi en premier lieu une unité de compte nominale. Le terme de «nominal »est utilisé pour souligner que l'unité de compte ne se confond pas avec un bien : « Définir le franc par un poids d'or ne signifie nullement que les paiements sont effectués par un poids d'or. Le mode de transfert des unités de compte d'un individu à un autre peut être très différent et doit faire l'objet d'une hypothèse explicite tout comme la façon dont ces moyens sont obtenus. Une économie avec unité de compte n'est pas équivalente à une économie de troc » (Cartelier, 1991, p. 22). Dans une économie walrassienne où l'équilibre général est la forme de l'accord marchand, la monnaie peut se réduire à n'être qu'une unité de compte car comme le montre Cartelier, les paiements peuvent être réalisés pax simple remise de créances et dettes individuelles :les échanges n'ayant lieu qu'à l'équilibre, tous les agents économiques sont certains de respecter leur contrainte budgétaire et donc d'être solvables. Par contre, dans une économie «à la Cartelier », le mode d'accord marchand ne suppose pas la réalisation d'un équilibre général ;les agents sont dans l'ignorance et ne savent pas si l'équilibre général est atteint ou non. Autrement dit, ils ne peuvent savoir s'ils vont pouvoir respecter leur contrainte budgétaire. Ils peuvent être en déficit ou en excédent à la clôture du marché. Le fonctionnement du marché peut alors conduire à une insolvabilité générale qui bloque le système de paiement. Dans une économie en déséquilibre, la monnaie ne peut donc se réduire à une simple unité de compte nominale.
Un système de paiement viable passe par l'existence d'un moyen de règlement des soldes. Supposons tout d'abord comme le fait Cartelier que le fonctionnement de l'économie ne s'étend que sur une seule et unique période, et supposons la mise en place d'un système métallique-or dans lequel l'unité de compte est définie par un poids d'or; le transfert des unités de compte est réalisé par la remise de pièces frappées légalement.
Les soldes non nuls doivent être réglés à la clôture du marché pour res- taurer le respect des contraintes budgétaires. Si un individu est en déficit (ses dépenses dépassent ses recettes), il puise dans sa dotation en pièces d'or frappées pour régler sa dette. Cartelier précise que « le règlement de ce solde ne peut se faire en une monnaie "privée" ». Il exprime, en effet, une contrainte sociale, une règle commune et c'est pourquoi «la définition du moyen de transférer des francs pour le règlement de tels soldes relève du collectif» (ibid., p. 26).
Ainsi, les hypothèses minimales pour construire un modèle du fonctionnement du marché (où des individus échangent des biens) sont pour le moment les suivantes :des individus, des biens, une unité de compte nominale et un moyen légal de règlement des dettes.
Nous pouvons à présent élargir l'analyse en supposant que le marché fonctionne sur plusieurs périodes et que les soldes peuvent être reportés dans le temps. Si le règlement des soldes est possible immédiatement (les débiteurs possèdent une quantité suffisante de moyens légaux de règlement pour éteindre leur dette), les créanciers ont la possibilité d'arbitrer entre liquidité (exiger le règlement immédiat du solde) ou rémunération d'un taux d'intérêt créditeur. Les débiteurs quant à eux optent soit pour l'application immédiate de la sanction du marché (le règlement du solde), soit le report de cette sanction. Pour qu'un tel arbitrage puisse être réalisé, il est nécessaire qu'une instance extérieure aux individus fixe un taux d'intérêt par rapport auquel les agents vont former leur opinion sur le futur. Les agents qui anticipent une baisse future du taux d'intérêt vont préférer la liquidité et exiger le remboursement de la dette, tandis que les «haussiers » vont accepter le report du solde dans l'espoir d'un gain futur. Ceci n'est jamais que le mécanisme envisagé Keynes dans la Théorie générale. Comme l'écrit Cartelier, « la question des soldes (règlement ou report) se résout par une procédure particulière, complémentaire de la coordination par le marché, mettant en jeu une intervention extérieure aux individus, fixant le taux d'intérêt » (ibid., p. 29).
Cartelier approfondit encore l'analyse en introduisant l'hypothèse selon laquelle les agents débiteurs n'ont pas les moyens légaux de régler leurs soldes. Dans ce cas, le niveau du taux d'intérêt fixé pax l'institution extérieure (appelée «Banque centrale ») peut entraîner l'impossibilité pour certains individus de régler leur dette. La faillite est alors évitée
105
par l'intervention d'un prêteur en dernier ressort qui se substitue aux agents privés qui ne veulent pas renoncer à la liquidité pour le taux d'intérêt en vigueur sur le marché.
Par conséquent, un système de paiement viable doit comporter a minima quaxre éléments que sont l'unité de compte nominale, un moyen légal de transférer les unités de compte, la fixation d'un taux d'intérêt et un prêteur en dernier ressort. Cartelier appelle «institution monétaire » l'ensemble de ces éléments.
L'approche dont nous procédons à la présentation dans la section suivante n'a pas le même objectif que celui de Benetti et Cartelier :elle tente d'éclaircir l'origine même de la monnaie en rejetant toute forme de postulat monétaire.
II. I:INCOMPLÉTUDE
DE LA THÉORIE NÉO-CHARTALISTE
Wray, le fondateur du paradigme néo-chartaliste de la monnaie, réac- tive la thèse de Knapp : « la monnaie est une création du droit et peut subsister sans métaux monétaires, et la raison fondamentale en est que l'unité monétaire se définit non techniquement mais juridiquement » (Knapp, 1905, p. 282). L'idée fondatrice est de rejeter la «fable du troc » de Menger et Smith, en vertu de laquelle la monnaie n'apparaît que pour fluidifier les échanges, indépendamment de toute forme d'intervention étatique. Comme Benetti et Cartelier, Wray conteste l'idée selon laquelle il est possible de rendre compte des échanges sans intégrer la monnaie dès le départ de l'analyse, et remet en cause la thèse de la neutralité de la monnaie : il n'est pas possible d'intégrer a posteriori la monnaie dans l'analyse des échanges sans en remettre en cause profondément les résultats.
L'autre point commun entre l'approche néo-chartaliste et le modèle de Benetti et Cartelier est que tous deux soulignent l'importance du rôle de l'État : il établit le nom de l'unité monétaire et unifie par là-même le système de paiement, mais aussi définit les supports par lesquels la monnaie circule (Wray, 2003, p. 64-65).
106
La divergence d'avec Cartelier émane de la recherche par Wray de l'origine de l'acceptation de la monnaie :comment se fait-il que la mon- naie instituée par l'État soit acceptée par l'ensemble de la communauté des agents économiques ?Pour répondre à cette question, l'économiste développe une théorie du circuit fiscal.
Ainsi pour l'auteur, la monnaie «n'est pas apparue comme un moyen d'échange permettant de réduire les coûts, mais comme l'unité de compte dans laquelle les dettes envers le palais (les obligations fiscales) étaient mesurées » (Wray, 2000, p. 43). «Dès le tout début les pièces furent frappées afin de fournir un financement à l'État » (ibid., p. 46). Le concept clé pour rendre intelligible l'apparition de la monnaie est donc la dette publique. Cependant, la définition légale de la monnaie n'est pas suffisante pour qu'elle soit choisie et adoptée par les agents. C'est en définissant la monnaie qu'il accepte en paiement des impôts que l'État parvient à faire accepter la monnaie qu'il a instituée dans la sphère privée :chaque agent va accepter cette monnaie pour réaliser ses transactions, sachant que celle-ci lui permettra d'éteindre ses dettes fiscales. Wray n'affirme-t-il pas en effet qu'«une fois que l'État impose à ses citoyens une taxe payable dans une monnaie qu'il crée, il n'a pas besoin de la monnaie du public afin de dépenser; c'est au contraire le public qui a besoin de la monnaie de l'État pour payer les impôts. Cela signifie que le gouvernement peut acheter tout ce qui est à vendre en termes de sa monnaie, tout simplement en fournissant sa monnaie » (Wray, 2000, p. 59). Cette affirmation a des implications en matière de politique économique :l'État réalise ses dépenses publiques en créditant simplement les comptes du secteur privé, indépendamment de tout revenu antérieur ou d'impôt perçu.
Cependant une telle thèse se prête aisément à la critique, comme ont déjà pu le montrer Desmedt et Piégay (2007). Multiples sont les exemples dans l'histoire monétaire d'un rejet par la communauté de la monnaie que l'État tente d'imposer : si l'on prend le cas de la France, on peut citer les périodes de la Régence et de la Révolution. C'est ce qu'affirment également Aglietta et Orléan (2002) :l'État peut être une source de légitimité, certes, mais la monnaie n'est en aucun cas un instrument aux seules mains des pouvoirs publics ; la confiance qu'ont les agents dans la monnaie est la condition sine qua non de son acceptation.
107
Par ailleurs, dans la thèse de Wray, l'échange ne peut pas être pensé indépendamment de la monnaie. La monnaie renvoie à l'État. Donc sans État, l'échange n'est pas pensable9.
Il est vrai que l'effondrement de l'Empire romain au ve siècle s'est accompagné de celui le système monétaire en vigueur jusque-là et de la contraction des échanges. Mais est-ce l'effondrement conjoint de l'Empire et du système monétaire qui a induit la contraction des échanges ou est-ce la contraction des échanges provoquée par les invasions, facteur de désagrégation de l'Empire, qui a fait que le système monétaire avait perdu son objet ?
L'application de la théorie de Wray au cas de figure historique pré- cédent peut être résumée comme suit
Invasions—désagrégation de l~mpire—effondrement du système monétaire—contraction des échanges
La théorie néo-chartaliste ne fournit pas une réponse acceptable à la question de l'origine de la monnaie, ce qui renforce, d'une certaine manière, la position de Benetti et Cartelier.
Qu'en est-il que la thèse de Michel Aglietta et d'André Orléan ?
III. L'ANALYSE DE LA MONNAIE COMME PRODUIT
DU MIMÉTISME :UNE NOUVELLE FORME
DE POSTULAT DE LA MONNAIE ?
Comme l'a bien montré Marx, l'échange de deux marchandises est un rapport asymétrique et conflictuel dans la mesure où chaque échan- giste tente d'imposer sa marchandise comme celle qui permet d'acquérir l'autre. Aglietta et Orléan cherchent à démontrer que la rivalité contenue dans le rapport d'échange est temporairement jugulée par l'apparition endogène d'un tiers médiateur qui est la monnaie.
Le cadre d'analyse des auteurs est celui de l'économie marchande, peuplée de producteurs indépendants les uns des autres ;chacun d'entre eux ignore ce que les autres vont produire et demander. Dans La monnaie entre violence et confiance, le premier chapitre s'intitule : «Les processus fondateurs de l'ordre marchand» et le second : «Marchandise et mon- naie :l'hypothèse mimétique ». À la page 31, Aglietta & al. (2002) écrivent : «Sur ce point aucune ambiguïté n'est possible : le chapitre II consacré à l'étude théorique de la monnaie et de ses propriétés se situe exclusivement dans le cadre d'une société marchande ». La production est donc bien aux mains de producteurs formellement indépendants.
Dans la théorie de la valeur traditionnelle, les individus qui échangent sont différenciés dans la mesure où ils ont des propriétés et des finalités qui leur sont propres. La rencontre entre deux individus aboutit à un accord et un échange si la double coïncidence des besoins est respectée. Aglietta & al. (2016) prennent le contrepied de l'hypothèse de différenciation en supposant des individus indifférenciés qui sont tous en quête de liqui- dité. Les deux co-échangistes s'observent l'un l'autre et veulent acquérir ce que l'autre désire. Le comportement mimétique des individus est la conséquence logique des hypothèses d'indifférenciation et de quête de
109
reconnaissance. Dans le monde marchand, la puissance d'agir s'identifie à la liquidité en ce que la liquidité est ce qui permet l'achat le plus large. En conséquence, la quête de liquidité est ce que recherchent prioritairement les producteurs marchands car la liquidité est la condition même de leur aptitude à produire et échanger. Alors que pour Cartelier (201, ld théorie d'Agliettd et Orlédn rejette le postulat monétaire et cherche à fonder théoriquement l'émergence de la monnaie, il n'en est en fait rien car leur thèse s'appuie sur un double postulat : le postulat monétaire selon lequel tous les individus sont en quête de ld 11qu1d1té, Gelle qu1 sera dGGeptée pdY tous, et le postulat du mlmétlsme qu1 1Jd permettre d'expliquer le processus de sélection d'une forme de liquidité particulière. Comme l'explique Orléan lui-même, l'économie marchande crée un besoin de liquidité pour tous les agents du fait que la sanction (par le marché) de leurs décisions ne se fait qu'a posterlorl. POux S'adapter aux aléas liés à l'activité économique, les agents économiques doivent détenir un pouvoir d'acheter. Orléan et Aglietta posent «postulat de la liquidité» à partir de l'analyse des caractéristiques de l'économie marchande.
La confrontation entre les deux individus qui cherchent à impo- ser leur propre définition de la liquidité est source de violences et de conflits. La généralisation de l'échange entre deux agents économiques à tous les individus engendre un état social chaotique. Chaque individu s'oppose aux autres pour imposer ses vues, ou bien suit les variations de l'opinion majoritaire. En effet, faute de norme monétaire, les individus sont incapables d'évaluer les richesses. L'incertitude pousse certains individus à copier l'opinion de leurs voisins, en supposant que ces derniers sont peut-être mieux informés. Aglietta et Orléan y voient le secret de la contradiction marchande :d'un côté, chacun se bat pour faire prévaloir la définition de la liquidité qui sert le mieux ses intérêts, mais d'un autre côté, cette définition, pour être valide, doit recevoir la reconnaissance et la confiance de tous les autres. Autrement dit, «on ne gagne jamais contre les autres car la richesse n'existe que dans leur regard » (Aglietta & Orléan, 2002).
Cette étape de la genèse des formes de la monnaie, Fl, est nommée par les auteurs «violence essentielle ». Elle débouche sur une «violence fondatrice» lors de l'étape F311. Les auteurs ajoutent une hypothèse tout
à fait acceptable :plus une opinion reçoit l'adhésion d'un grand nombre d'individus, plus la probabilité que l'activité mimétique débouche sur l'adoption générale de cette opinion est grande. La dynamique de l'imitation débouche alors sur l'unanimité. Une fois que l'ensemble de l'opinion est acquise à une évaluation particulière de la richesse, cette opinion se reproduit mécaniquement pax mimétisme : je copie l'opinion de mon voisin qui lui-même adhère à l'opinion dominante. La monnaie apparaît donc par un processus endogène de mimétisme dont le fon- dement est la violence sociale dans laquelle sont plongés les individus.
Lorsqu'une forme particulière de monnaie est élue, elle est une institution socialement reconnue et mise à distance des individus car elle possède une légitimité intrinsèque. La monnaie n'est pas ici choisie pour ses qualités naturelles ;elle est monnaie parce que tous les agents la considèrent comme monnaie.
Comme le soulignent les auteurs, la dynamique de polarisation des opinions produit un résultat aléatoire. Elle peut déboucher sur plusieurs formes possibles de liquidité pour canaliser la violence sociale. Aglietta et Orléan ne nous renseignent pas sur le processus par lequel la monnaie devient le médiateur privilégié en lieu et place d'un autre. Par exemple, à la page 74, Aglietta et Orléan (2002) écrivent :«L'indétermination radicale de la richesse est un fait fondamental qu'il faut absolument res- pecter ». De même, Orléan écrit : « La première propriété que nous livre ce modèle est l'indétermination de l'opinion sur laquelle se concentre l'unanimité» (Orléan, 1984, p. 62).
Orléan a modélisé les effets du mimétisme sur la dynamique d'opinion en 1984, puis il a adopté le cadre du marché financier pour analyser l'effet des comportements mimétiques sur le cours boursier. Selon nous, il existe donc chez Orléan un modèle formel qui peut être appliqué au choix monétaire et au cours boursier.
Le modèle de 1984 met en scène des agents économiques qui à chaque période adoptent une opinion en copiant l'opinion d'un autre agent quelconque adoptée à la période précédente. Ces agents ne copient pas à chaque période les mêmes agents. Chaque agent est doté d'une loi de probabilité de tirage au hasard au sein de la population. La ques- tion qui est posée est de savoir vers quoi converge l'ensemble des choix caractérisant chaque période. Orléan obtient le résultat suivant : «sous certaines conditions, qû on explicitera par la suite, le processus d'imitation
111
converge vers l'unanimité du groupe » (Orléan, 1984, p. 61). Pax ailleurs, «La première propriété que nous livre ce modèle est l'indétermination de l'opinion sur laquelle se concentre l'unanimité» (ibid., p. 62) ce qui signifie que rien n'assure a priori que l'opinion converge vers l'adoption d'une forme particulière de monnaie.
Dans son modèle de marché financier, Orléan (1990, 1992) suppose un marché boursier peuplé de N intervenants sur lequel est évalué un titre Z, qui peut prendre deux valeurs Vi ou VZ avec une certaine probabilité. Puisque le prix du titre en question est susceptible d'avoir l'une de ces deux valeurs, deux opinions s'affrontent au sein de la communauté l'opinion [1] est celle selon laquelle la valeur du titre sera Vi, et l'opinion [2] qui exprime l'avis inverse. L'objet du modèle d'Orléan est précisément d'étudier la dynamique du cours du titre Z sur le marché en fonction d'une variable représentative de l'opinion collective.
Pour établir son évaluation, chaque intervenant a la possibilité de se référer à un «signal fondamental » émanant de l'extérieur du marché, ou bien observer l'évolution du cours du titre Z duquel il déduit les mouvements de l'opinion collective. C'est en se référant à ce second type d'information que les individus se livrent à une activité mimétique. Le poids que les intervenants vont donner à chaque information dépend du degré de confiance qu'ils accordent à la donnée extérieure et à l'opinion collective respectivement. Ce degré de confiance est lui-même fonction de la fréquence d'opinion observée dans le cours :plus elle est élevée, plus le poids donné au mimétisme sera important.
Lorsque le degré de confiance accordé à l'opinion collective est grand, ce que traduit la situation de violence et de confusion généralisées décrite plus haut, le modèle produit des équilibres multiples :l'opinion peut se stabiliser sur telle ou telle valeur du cours boursier, sans que l'on puisse prédire dans quelle direction le marché va aller.
Le résultat de la formalisation du mimétisme est donc semblable à l'analyse plus littéraire que nous offrent Aglietta et Orléan dans leurs ouvrages de 2002 et 2016. Fondamentalement, Orléan montre que ceux qui sont sur les marchés ne décident pas tant au hasard que par des procédures selon lesquelles une information peut suffire pour cristalliser des comportements d'achat ou de vente.
L'enjeu de la théorie d'Orléan et Michel Aglietta est de déterminer quelle forme va prendre la liquidité absolue dans une économie marchande.
112
Elle fournit un fondement analytique à l'idée de Marx selon laquelle la forme équivalent général peut appartenir à n'importe quelle marchandise. Cet enjeu n'est donc pas lié à l'émergence de la monnaie elle-même, mais à la forme qû elle va prendre. Le besoin de liquidité, donc le besoin de monnaie, est un postulat qui constitue le point de départ de l'analyse. En cela, Orléan et Aglietta ont une démarche qui rejoint celle de Benetti et Cartelier.
Au final, la théorie de la monnaie comme produit du mimétisme est encadrée par un postulat en amont (l'économie marchande est nécessairement monétaire) et une indétermination en aval (la forme que va prendre la monnaie). Nous considérons donc que les points de vue d'Aglietta-Orléan d'un côté, Benetti-Cartelier de l'autre, ne sont pas divergents mais au contraire convergents :l'adoption d'un postulat de la monnaie semble incontournable. Les uns comme les autres ne cherchent pas à expliciter le passage d'une société sans monnaie à une société avec monnaie.
CONCLUSION
En cherchant à formuler une génèse du choix des formes de la mon- naie et en faisant table rase de la théorie de la valeur, Aglietta et Orléan recourent à la formulation d'un postulat sur l'existence de la monnaie. De fait, il en va de même pour la théorie néo-chartale de Wray (2000, 2003), qui ne fonde pas de façon satisfaisante l'origine de la monnaie sur la dette fiscale. Dans le camp des tenants de la théorie de la valeur, les modèles de prospection monétaire, qui exhibent la possibilité d'équilibres monétaires ou non monétaires, amènent à postuler la sélection des équi- libres monétaires par l'évocation d'un choix collectif (Cartelier, 2001). Chez Marx, le passage de l'échange entre marchandises à l'échange entre marchandises et monnaie, c'est-à-dire le passage de forme 2 à la forme 3 de la valeur, est également postulé (Piluso, 201412).
Autrement dit, tous les auteurs des théories de la monnaie que nous évoquons ici formulent un postulat de la monnaie volontairement ou non :théories de la prospection monétaire, postulat du passage de la forme 2 à la forme 3 de la valeur chez Marx (théorie de la monnaie- marchandise), postulat d'existence de l'unité de compte chez Cartelier. Cela ne manque pas d'apporter du poids à la démarche de Benetti et Cartelier. Ces derniers considèrent en effet qu'il est vain de chercher une origine à la monnaie, de la même façon qu'il est vain de chercher une origine à la société ou à l'univers. Dans son article de 2016, Cartelier expose ce point de vue très clairement
Ou bien l'on s'efforce de combler le fossé béant entre «situation avant toute relation sociale » et «société constituée » ; on recourt alors à un conte ou à un mythe :celui du «contrat social» en est un exemple remarquable tout comme sa déclinaison mineure qu'est la «fable du troc » [...], on se heurte alors à des apories diverses telles que l'indétermination [...] des individus de la «mul- titude» (contrat social de Hobbes) ou l'extension indue de la problématique des choix individuels à la sélection de l`équilibre (modèles de prospection). Ou bien l'on s'efforce de produire une théorie correctement construite en explicitant ses postulats — ce qui signifie énumérer ce que l'on renonce à expliquer et à comprendre —faisant apparaître l'impuissance dans laquelle on se trouve à rendre compte de l'existence même de ce que l'on se propose d'étudier, par exemple le langage, le marché ou la monnaie.
L'étude que nous avons réalisée de trois exemples d'approches hétéro- doxes de la monnaie montrent l'intérêt des approches issues du postulat de la monnaie et confortent ainsi le point de vue défendu par Cartelier la théorie économique doit avoir pour fondement un postulat institu- tionnaliste de la monnaie.
BIBLIOGRAPHIE
AGLIETTA, Michel & al. [2016], La monnaie entre dettes et .souveraineté, Paris, Odile Jacob.
AGLIETTA, Michel & ORLÉAN, André [2002], La monnaie entre violence et confiance, Paris, Odile Jacob.
ALARY, Pierre & al. [2016], Théories françaises de la monnaie, Paris, PUF. BENETTI, Cano [1985], «Économie monétaire et économie de troc : la question
de l'unité de compte commune », Économie appliquée, t. XXXVIII, N° 1,
p. 85-109.
BENETTI, Carlo [1996], «The ambiguity of the notion of general equilibrium with a zero price for money », in DELEPLACE, G. & NELL, E J. (éd.), Money in motion :The Post-keynesian and circulation approaches, Londres, Macmillan, p. 366-376.
BENETTI, Carlo [2001], «Monnaie, choix individuels et frictions », Cahiers d'économie politique, N° 39, automne, p. 917-931.
BENETTI, Carlo &CARTELIER, Jean [2001], «Money and price theory »,
International Journal of Applied Economics and Econometrics, N° 9, p. 203-223. CANTILLON, Richard [1755], Essai sur la nature du commerce en général, reprint,
New York, A.M. Kelley, 1964.
CARTELIER, Jean [1985], «Théorie de la valeur ou hétérodoxie monétaire
les termes d'un choix », Économie appliquée, t. XXXVIII, N° 1, p. 63-82. CARTELIER, Jean [1991], «Monnaie et systèmes de paiement : le problème de la
formation de l'équilibre », Revue française d'économie, Vol. VI, N° 3, p. 3-37. CARTELIER, Jean [1996], La monnaie, Paris, Flammarion.
CARTELIER, Jean [2001], «Monnaie et marché : un point de vue critique sur
les modèles de prospection », Revue économique, Vol. 52, N° 5, p. 993-1011. CARTELIER, Jean [2016], «Monnaie et société :une théorie économique en
perspective ? », Revue de la régulation, (mis en ligne).
DESMEDT, Ludovic & PIÉGAY, Pierre [2007], «Monnaie, État et Production apports et limites de l'approche néo-chartaliste », Cahiers d'économie Politique, N° 52, p. 115-133.
HAHN, Franck [1971], «Equilibrium with transaction costs », Econometrica, Vol. 39, N° 3, p. 417-439.
IwAI, Katsuhito [1988], «The Evolution of Money : A Search Theoretic Foundation of Monetary Economics », University of Pennsylvanie CARESS, Working Papes, N° 88-03.
KEYNE$, John Maynard [1930], Treatise on Money, in JOHNSON, E. & MOGGRIDGE,
115
D. (éd.), Collected Writtings of John Maynard Keynes, Londres, MacMillan- Cambridge University Press pour la Royal Economic Society, 1971, t. V VI.
KEYNES, John Maynard [1936], Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, traduction française de J. de Largentaye, Paris, Payot, 1969.
KNAPP, Georg Friedrich [1905], Staatliche Theorie des Geldes, Leipzig, Duncker and Humblot.
KIYOTAKI, Nobuhiro & WRIGHT, Randall [1993], «A Search Theoretic Approach to Monetary Economics », The American Economic Review, Vol. 83, N° 1, p. 63-77.
LI, Yitirig & WRIGHT, Randall [1998], « Government Transaction Policy, Media of Exchange, and Prices », Journal of Economic Theory, Vol. 81, N° 2, p. 290-319.
MARx, Karl [1867], Le Capital, Livre 1, Paris, Éditions Sociales, 1977. Oxurro, Masahiro & ZILCHA, Itzhak [1979], «The role of money in supporting
the Pareto optimality of competitive equilibrium-loan type models »,
Journal of Economic Theory, Vol. 20, N° 1, p. 40-80.
ORLÉAN, André [1984], «Monnaie et spéculation mimétique », Bulletin du Mauss, N° 12, décembre, p. 55-68.
ORLÉAN, André [1990], «Le rôle des influences interpersonnelles dans la détermination des cours boursiers », Revue économique, Vol. 41, N° 5, p. 839-868.
ORLÉAN, André [1992], «Contagion des opinions et fonctionnement des marchés », Revue économique, Vol. 43, N°4, p. 685-698.
OSTROY, Joseph & STARR, Ross [1974], «Money and the decentralization of exchange », Econometrica, Vol. 42, N° 6, p. 1993-1113.
PlLuso, Nicolas [2014], «Postulat de la monnaie et théorie de la valeur chez
Marx », Revue de la régulation, N° 15, premier semestre (numéro en ligne). ULGEN, Faruk & al., [2013], New Contributions to Monetary Analysis. The
Foundations of an Alternative Economic Paradigm, Londres, Routledge. WRAY, Randall [2000], «Modern money », in SMITHIN, John (dir), What is
Money ?, Londres, Routledge, p. 42-66.
WRAY, Randall [2003], «L'approche post-keynésienne de la monnaie », in PIEGAY, Pierre & RocxoN, Louis-Philipe (éd.), Théories Monétaires Post Keynésiennes, Paris, Économica, p. 52-65.
Une analyse à partir d'exemples
de théories monétaires hétérodoxes
Nicolas PILUSO
Université de Toulouse
La prise en compte de la monnaie par l'analyse économique et la détermination de son origine sont des questions qui restent toujours d'actua.lité dans la littérature. En témoignent la sortie récente de l'ouvrage d'Aglietta (2016), La monnaie entre dettes et souveraineté et de l'ouvrage New contributions to monetary analysis (2013), qui reprend certaines des contributions présentées lors du colloque L'Analyse monétaire de l'économie qui s'est tenu à Grenoble les 15 et 16 avri12010 à propos de Marchands, salariat et capitalistes de Benetti et Cartelier.
En s'appuyant sur le postulat naturaliste de nomenclature des biens (Cartelier, 1985), la théorie néoclassique a tenté d'intégrer a posteriori la monnaie à la théorie de la valeur. Cette démarche analytique est le fruit
1 Je tiens à remercier les trois rapporteurs sur cet atticle qui m'ont permis d'ameliorer de façon
significative sa qualité. André Orléan m'a permis de corriger une erreur d'interprétation de son approche théorique de la monnaie. Je remercie vivement mes collègues et amis qui ont pris le temps de lire et commenter longuement mon article pour m'aider à l'améliorer :Edwin Le Heron (IEP de Bordeaux), André Segura (Université de Toulon) et Alain Béraud (Université de Cergy). Je remercie enfin le Comité éditorial de la Revue pour sa relecture minutieuse et ses commentaires sur la version finale de l'article.
98significative sa qualité. André Orléan m'a permis de corriger une erreur d'interprétation de son approche théorique de la monnaie. Je remercie vivement mes collègues et amis qui ont pris le temps de lire et commenter longuement mon article pour m'aider à l'améliorer :Edwin Le Heron (IEP de Bordeaux), André Segura (Université de Toulon) et Alain Béraud (Université de Cergy). Je remercie enfin le Comité éditorial de la Revue pour sa relecture minutieuse et ses commentaires sur la version finale de l'article.
d'une volonté des économistes issus de l'approche standard d'extraire l'individu de toute donnée sociale prédéterminée pour déduire du seul individu rationnel toutes les relations d'interdépendances entre agents économiques. Après avoir totalement échoué sur cette problématique de l'intégration de la théorie de la monnaie à la théorie de la valeurZ, la théorie néoclassique a démontré que des équilibres généraux avec mon- naie peuvent exister (Iwai, 1988 ; Kiyotaki &Wright, 1993). Néanmoins ces modèles de prospection monétaire ne sont pas parvenus à fonder l'émergence de la monnaie sur les choix individuels. On doit à Benetti (1996, 2001), et à Cartelier (1991, 1996, 2016) une analyse critique rigoureuse de ces différentes approches standard. C'est pourquoi nous ne nous attarderons pas sur ce pan de la théorie monétaire qui n'a pas réussi à faire de la monnaie un résultat de l'analyse économique fondée sur le postulat de nomenclature.
Le débat est cependant vif dans le camp des théories «alternatives » de la monnaie. Faut-il poser un postulat monétaire à la source même de toute analyse économiques ou bien faut-il développer une théorie préalable expliquant le fondement de droit ou montrant l'origine de fait de la mon- naie, une théorie fondée sur des postulats « a- » ou «pré-monétaires » ?
La théorie des systèmes de paiement de Benetti et Cartelier ainsi consiste à postuler l'existence de la monnaie. L'idée sous-jacente est que les échanges ne peuvent avoir lieu sans monnaie et que cette dernière doit être le point de départ de l'analyse économique. Les auteurs considèrent que la monnaie ne relève pas d'une logique de choix individuels :c'est une institution, un ensemble de règles. La pensée Benetti et Cartelier fait écho à celle de Keynes (1930) développée dès les premières pages du Traité de la monnaie :l'État établit le nom de l'unité de compte (« il écrit le dictionnaire ») et instaure les formes sous lesquelles la monnaie circule (« il impose le dictionnaire »). La récente théorie néo-chartaliste émanant de certains économistes postkeynésiens (Wray, 2003) reven- dique explicitement son lien avec l'approche du postulat keynésien de la monnaie au sens où ils établissent un lien étroit entre monnaie et
2 Voit les modèles monétaires à horizon fini (Hahn, 1971) et les modèles monétaires à
générations imbriquées et à horizon infini (Okuno & Zilcha, 1979)• En appliquant la théorie des choix individuels à la monnaie, ces modèles parviennent à fonder l'existence d'une demande de monnaie sous des hypothèses particulièrement restrictives. La monnaie n'apparaît dans ces modèles que comme une réserve de valeur, c'est-à-dire un actif sans rendement en concurrence avec les titres financiers.
99générations imbriquées et à horizon infini (Okuno & Zilcha, 1979)• En appliquant la théorie des choix individuels à la monnaie, ces modèles parviennent à fonder l'existence d'une demande de monnaie sous des hypothèses particulièrement restrictives. La monnaie n'apparaît dans ces modèles que comme une réserve de valeur, c'est-à-dire un actif sans rendement en concurrence avec les titres financiers.
décisions étatiques. Mais contrairement à Benetti et Cartelier qui se «limitent » à analyser le fonctionnement de l'économie monétaire, les néo-chartalistes cherchent à expliquer l'origine de la monnaie et donc à s'affranchir du postulat institutionnaliste de la monnaie.
La théorie d'Aglietta et Orléan (2012) est présentée par certains éco- nomistes comme une théorie de l'origine de la monnaie. Elle s'appuierait sur un postulat «pré-monétaire », celui du mimétisme, dont la monnaie serait le résultat (Cartelier, 2016). En réalité, nous montrerons qu'Aglietta et Orléan établissent la genèse des formes de la liquidité pour l'étude des systèmes monétaires et de leurs crises en s'appuyant sur un postulat monétaire. Leur démarche partage donc un point commun fondamental avec la théorie monétaire de Cartelier. Leur thèse ambitionne de fonder l'émergence d'une forme particulière de la monnaie sur la rivalité entre individus contenue dans les rapports marchands. La monnaie devient dans ce cadre l'institution médiatrice qui permet de juguler la violence sociale.
L'objet de cet article est de mettre (ou remettre) en évidence l'intérêt ou les limites propres à chaque approche et de poser la question de savoir si les résultats de la théorie économique doivent amener à considérer la monnaie comme un résultat ou un postulat. Nous considérons ici comme acquise l'idée que l'approche standard (de type néoclassique) n'est pour le moment pas parvenue à faire de la monnaie un résultat de la théorie des choix et/ou de la théorie de la valeur.
De toute évidence, l'article n'ambitionne pas d'apporter une réponse complète et définitive à cette problématique dont le traitement mériterait certainement un ou plusieurs ouvrages. L'actualité de l'ouvrage d'Aglietta, les réactions qu'il a suscitées (Cartelier, 2016) et les liens qu'il tisse avec les approches de Benetti-Cartelier et de Wray qui nous ont conduit à faire le choix (au moins partiellement arbitraire) de prendre pour base de réflexion ces trois exemples d'hétérodoxie monétaire.
L'article développe succinctement la théorie des systèmes de paie- ment (Benetti-Cartelier) dans une section I, la théorie de Wray dans une section II et enfin la théorie du mimétisme (Aglietta-Orléan) dans une troisième et dernière section. Cette présentation permettra de voir que toutes ces approches recourent ou doivent recourir à un postulat institutionnaliste de la monnaie.
100
MONNAIE ET DÉSÉQUILIBRE
La genèse du modèle de Benetti et Cartelier est liée au constat d'échec, dans les années 80, de l'ensemble des travaux visant à intégrer la théorie de la monnaie à la théorie de la valeur, que cette dernière soit d'obédience néoclassique ou marxiste (Marx, 1867)3. Or, les auteurs montrent que le déroulement d'échanges sans monnaie est le plus souvent impossible (Benetti, 1985 ; Cartelier, 1991). Dans la théorie de l'équilibre général d'Arrow-Debreu, par exemple, les économistes parviennent à déterminer les prix d'équilibre et démontrer l'existence de cet équilibre, mais sont incapables de montrer comment l'économie peut parvenir à cet équilibre, faute de monnaie dans l'économie4.
Leur modèle part de la formulation d'un postulat de la monnaie qui révèle que le choix des individus s'effectue dans le cadre d'une société organisée et encadrée par des institutions. Son but est de mettre en évidence que l'économie fonctionne en déséquilibre, alors que la théorie de la valeur standard n'étudie que les situations d'équilibre.
Le modèle reprend pour ce faire la règle de formation endogène des prix de Cantillon (1755). Ce dernier définit le prix comme le rapport entre la quantité de monnaie apportée au marché pour acheter les biens et la quantité de biens offerts pax les marchands. Il est possible d'écrire le prix effectif d'un bien i de la façon suivante
zh~
e a h
P; = P;
zh~
h
(1)
3 Pour Benetti, cette tentative d'intégration de la théorie de la monnaie à la théorie de la valeur est un échec. Pour Marx (1867), la forme développée de la valeur ne signifie pas qu'une marchandise exprime sa valeur relative en mutes les autres, et qu'elle possède donc (n-1) équivalents particuliers dans un monde à n marchandises. En fait, il existe n(n-1) expressions des valeurs relatives et donc le même nombre d'équivalents particuliers. Il n'est pas possible de déduire la forme monnaie de la forme développée car l'inversion de la forme développée ne donne pour résultat qu'elle-même, c'est-à-dire la forme dévelop- pée. Benetti en conclut radicalement, compte tenu de ce que F3 n'est pas le résultat de l'inversion de F2, que le lien entre monnaie et valeur doit être rejeté.
4 Voir aussi Ostroy & Starr (1974).
1014 Voir aussi Ostroy & Starr (1974).
avec p° le prix anticipé du bien i (on suppose ici que les anticipations sont identiques pour tous les individus) et zhti la demande nette du bien i pour l'agent h, affectée d'un signe « + » lorsqu'elle est positive (h acheteur de i), ou affectée d'un signe «-» lorsqu'elle est négative (h vendeur de i)6.
Le prix anticipé du bien peut être différent du prix effectif. Si les individus font une erreur d'anticipation, ils sont en déséquilibre à la fois réel et monétaire. D'un point de vue monétaire, les vendeurs peuvent empocher plus ou moins de monnaie qu'ils ne l'avaient prévu. D'un point de vue réel, les acheteurs peuvent recevoir plus ou moins de biens) qu'ils ne l'avaient prévu.
L'un des résultats originaux de la théorie monétaire de Cartelier, et donc son intérêt fondamental, concerne la théorie des crises.
À l'échelle macroéconomique, toute la monnaie apportée au marché circule ; on pourrait donc penser que tout se passe comme si l'offre crée sa propre demande. Dans leur article de 2001, Benetti et Cartelier montrent que la «règle de Cantillon » implique le respect d'une sorte de «loi de Walras' » en vertu de laquelle la valeur des biens offerts à l'échelle globale du marché est égale à la quantité de monnaie mise en circulation pour acheter ces biens. Une simple manipulation des termes de l'équation (1) permet de le mettre en évidence
[~ Zhi
Pi = pt h ~ > Pi [~ Zhi pt [~ Zhi ~ > Pi [~ khi [~ mhi (2~
h h h h
Zhi
h
5 Chez Cantillon (1755), il y a plusieurs acheteurs et vendeurs. Celui qui offre le prix le plus haut se sert en premier, puis vient le second, le troisième, etc. Ainsi, celui qui ne voulait offrit qu'un prix bas peut ne tien avoir car tout a été vendu. L'intérêt de ce processus est que les offres et le demandes en monnaie conduisent à un marché où les échanges se font à des prix différents. Ces offres et ces demandes sont étrangères au mécanisme de marché que décrit la théorie tant classique que néoclassique où on a un prix unique qui ajuste les offres et les demandes.
6 La somme des z~ négatifs doit être considérée en valeur absolue.
7 Cette loi de Walras «à la Cartelier» s'applique aux individus et non directement aux marchés. Dans une économie à deux agents, elle signifie que si un individu possède un solde monétaire négatif, alors nécessairement l'autre individu aura un solde monétaire positif du même montant (en valeur absolue).
1026 La somme des z~ négatifs doit être considérée en valeur absolue.
7 Cette loi de Walras «à la Cartelier» s'applique aux individus et non directement aux marchés. Dans une économie à deux agents, elle signifie que si un individu possède un solde monétaire négatif, alors nécessairement l'autre individu aura un solde monétaire positif du même montant (en valeur absolue).
avec ~ mh~ la somme des quantités de monnaie distribuées aux agents h pour acheter le bien i.
Autrement dit, on pourrait penser qu'à l'instar de la loi de Say, le modèle de Benetti et Cartelier implique l'impossibilité des crises géné- rales de surproduction. En fait, il n'en est rien.
En vertu de la «règle de Cantillon », toutes les marchandises portées au marché sont vendues, ce qui ne signifie pas qu'il y a un équilibre général :ces prix de déséquilibre laissent tous les individus insatisfaits (sauf exception d'équilibre général). En fait, le cas général est que tous les individus connaissent deux déséquilibres, l'un monétaire (soldes monétaires positifs ou négatifs dont la somme sociale s'annule) l'autre réel (les allocations réelles effectives diffèrent de celles qui étaient dési- rées). Le fait que tous les individus soient simultanément en déséquilibre est le signe d'une «crise générale » qui est dans l'approche monétaire l'équivalent de ce que serait une crise générale de surproduction dans l'approche de la valeur. Dans la théorie des systèmes de paiement, per- sonne n'observe les marchés mais chacun connaît sa situation et sait s'il est ou non à l'équilibre. L'analyse monétaire met l'accent sur les individus et non sur les marchés.
La différence fondamentale entre cette approche et le modèle d'équilibre général est donc qu'elle permet de rendre compte du déroulement des transactions en situation de déséquilibre, et qu'elle permet donc d'intégrer la sanction du marché (validation a posteriori). Il s'agit d'une avancée analytique considérable par rapport à l'approche standard. En effet, les individus qui acceptent d'échanger ne le font plus grâce à la déter- mination préalable de l'équilibre général (cela nécessite l'introduction d'un secrétaire de marché qui n'est pas souhaitable sur un marché aux échanges décentralisés), mais grâce à la monnaie qui, pour reprendre les termes de Cartelier, «offre le mode d'accord souple qui respecte les deux principes fondamentaux de toute théorie des rapports marchands, l'échange volontaire et la recherche de l'avantage personnel » (Cartelier, 1991, p. 20)8. À paxtir de là, l'objet de la théorie des systèmes de paiement
8 Cette notion d'erreur d'anticipation et de déséquilibre, c'est-à-dire d'écart entre prix /
quantité désirés et prix /quantité effectifs, n'est intelligible que si l'on considère que la fixation des prix et quantités effectifs ne relève pas d'un processus de tâtonnement. Dans un tel processus de tâtonnement centralisé et virtuel, l'agent adapte les quantités désirées aux modifications de prix annoncés qui conduisent supposément ces derniers
103quantité désirés et prix /quantité effectifs, n'est intelligible que si l'on considère que la fixation des prix et quantités effectifs ne relève pas d'un processus de tâtonnement. Dans un tel processus de tâtonnement centralisé et virtuel, l'agent adapte les quantités désirées aux modifications de prix annoncés qui conduisent supposément ces derniers
est de préciser les hypothèses minimales qu'il faut introduire dans la théorie du marché pour que l'accord par la monnaie puisse fonctionner.
La monnaie étant définie par Cartelier comme un moyen d'exécution des transactions indépendamment de l'existence de l'équilibre général, l'économiste commence par analyser la conséquence du rejet du troc les prix des biens ne sont pas réels mais exprimés dans une unité « exté- rieure »aux biens. La monnaie constitue ainsi en premier lieu une unité de compte nominale. Le terme de «nominal »est utilisé pour souligner que l'unité de compte ne se confond pas avec un bien : « Définir le franc par un poids d'or ne signifie nullement que les paiements sont effectués par un poids d'or. Le mode de transfert des unités de compte d'un individu à un autre peut être très différent et doit faire l'objet d'une hypothèse explicite tout comme la façon dont ces moyens sont obtenus. Une économie avec unité de compte n'est pas équivalente à une économie de troc » (Cartelier, 1991, p. 22). Dans une économie walrassienne où l'équilibre général est la forme de l'accord marchand, la monnaie peut se réduire à n'être qu'une unité de compte car comme le montre Cartelier, les paiements peuvent être réalisés pax simple remise de créances et dettes individuelles :les échanges n'ayant lieu qu'à l'équilibre, tous les agents économiques sont certains de respecter leur contrainte budgétaire et donc d'être solvables. Par contre, dans une économie «à la Cartelier », le mode d'accord marchand ne suppose pas la réalisation d'un équilibre général ;les agents sont dans l'ignorance et ne savent pas si l'équilibre général est atteint ou non. Autrement dit, ils ne peuvent savoir s'ils vont pouvoir respecter leur contrainte budgétaire. Ils peuvent être en déficit ou en excédent à la clôture du marché. Le fonctionnement du marché peut alors conduire à une insolvabilité générale qui bloque le système de paiement. Dans une économie en déséquilibre, la monnaie ne peut donc se réduire à une simple unité de compte nominale.
Un système de paiement viable passe par l'existence d'un moyen de règlement des soldes. Supposons tout d'abord comme le fait Cartelier que le fonctionnement de l'économie ne s'étend que sur une seule et unique période, et supposons la mise en place d'un système métallique-or dans lequel l'unité de compte est définie par un poids d'or; le transfert des unités de compte est réalisé par la remise de pièces frappées légalement.
vers le point d'équilibre. Les notions d'erreur d'anticipation et de déséquilibre effectif n'y ont donc pas leur place.
104Les soldes non nuls doivent être réglés à la clôture du marché pour res- taurer le respect des contraintes budgétaires. Si un individu est en déficit (ses dépenses dépassent ses recettes), il puise dans sa dotation en pièces d'or frappées pour régler sa dette. Cartelier précise que « le règlement de ce solde ne peut se faire en une monnaie "privée" ». Il exprime, en effet, une contrainte sociale, une règle commune et c'est pourquoi «la définition du moyen de transférer des francs pour le règlement de tels soldes relève du collectif» (ibid., p. 26).
Ainsi, les hypothèses minimales pour construire un modèle du fonctionnement du marché (où des individus échangent des biens) sont pour le moment les suivantes :des individus, des biens, une unité de compte nominale et un moyen légal de règlement des dettes.
Nous pouvons à présent élargir l'analyse en supposant que le marché fonctionne sur plusieurs périodes et que les soldes peuvent être reportés dans le temps. Si le règlement des soldes est possible immédiatement (les débiteurs possèdent une quantité suffisante de moyens légaux de règlement pour éteindre leur dette), les créanciers ont la possibilité d'arbitrer entre liquidité (exiger le règlement immédiat du solde) ou rémunération d'un taux d'intérêt créditeur. Les débiteurs quant à eux optent soit pour l'application immédiate de la sanction du marché (le règlement du solde), soit le report de cette sanction. Pour qu'un tel arbitrage puisse être réalisé, il est nécessaire qu'une instance extérieure aux individus fixe un taux d'intérêt par rapport auquel les agents vont former leur opinion sur le futur. Les agents qui anticipent une baisse future du taux d'intérêt vont préférer la liquidité et exiger le remboursement de la dette, tandis que les «haussiers » vont accepter le report du solde dans l'espoir d'un gain futur. Ceci n'est jamais que le mécanisme envisagé Keynes dans la Théorie générale. Comme l'écrit Cartelier, « la question des soldes (règlement ou report) se résout par une procédure particulière, complémentaire de la coordination par le marché, mettant en jeu une intervention extérieure aux individus, fixant le taux d'intérêt » (ibid., p. 29).
Cartelier approfondit encore l'analyse en introduisant l'hypothèse selon laquelle les agents débiteurs n'ont pas les moyens légaux de régler leurs soldes. Dans ce cas, le niveau du taux d'intérêt fixé pax l'institution extérieure (appelée «Banque centrale ») peut entraîner l'impossibilité pour certains individus de régler leur dette. La faillite est alors évitée
105
par l'intervention d'un prêteur en dernier ressort qui se substitue aux agents privés qui ne veulent pas renoncer à la liquidité pour le taux d'intérêt en vigueur sur le marché.
Par conséquent, un système de paiement viable doit comporter a minima quaxre éléments que sont l'unité de compte nominale, un moyen légal de transférer les unités de compte, la fixation d'un taux d'intérêt et un prêteur en dernier ressort. Cartelier appelle «institution monétaire » l'ensemble de ces éléments.
L'approche dont nous procédons à la présentation dans la section suivante n'a pas le même objectif que celui de Benetti et Cartelier :elle tente d'éclaircir l'origine même de la monnaie en rejetant toute forme de postulat monétaire.
DE LA THÉORIE NÉO-CHARTALISTE
Wray, le fondateur du paradigme néo-chartaliste de la monnaie, réac- tive la thèse de Knapp : « la monnaie est une création du droit et peut subsister sans métaux monétaires, et la raison fondamentale en est que l'unité monétaire se définit non techniquement mais juridiquement » (Knapp, 1905, p. 282). L'idée fondatrice est de rejeter la «fable du troc » de Menger et Smith, en vertu de laquelle la monnaie n'apparaît que pour fluidifier les échanges, indépendamment de toute forme d'intervention étatique. Comme Benetti et Cartelier, Wray conteste l'idée selon laquelle il est possible de rendre compte des échanges sans intégrer la monnaie dès le départ de l'analyse, et remet en cause la thèse de la neutralité de la monnaie : il n'est pas possible d'intégrer a posteriori la monnaie dans l'analyse des échanges sans en remettre en cause profondément les résultats.
L'autre point commun entre l'approche néo-chartaliste et le modèle de Benetti et Cartelier est que tous deux soulignent l'importance du rôle de l'État : il établit le nom de l'unité monétaire et unifie par là-même le système de paiement, mais aussi définit les supports par lesquels la monnaie circule (Wray, 2003, p. 64-65).
106
La divergence d'avec Cartelier émane de la recherche par Wray de l'origine de l'acceptation de la monnaie :comment se fait-il que la mon- naie instituée par l'État soit acceptée par l'ensemble de la communauté des agents économiques ?Pour répondre à cette question, l'économiste développe une théorie du circuit fiscal.
Ainsi pour l'auteur, la monnaie «n'est pas apparue comme un moyen d'échange permettant de réduire les coûts, mais comme l'unité de compte dans laquelle les dettes envers le palais (les obligations fiscales) étaient mesurées » (Wray, 2000, p. 43). «Dès le tout début les pièces furent frappées afin de fournir un financement à l'État » (ibid., p. 46). Le concept clé pour rendre intelligible l'apparition de la monnaie est donc la dette publique. Cependant, la définition légale de la monnaie n'est pas suffisante pour qu'elle soit choisie et adoptée par les agents. C'est en définissant la monnaie qu'il accepte en paiement des impôts que l'État parvient à faire accepter la monnaie qu'il a instituée dans la sphère privée :chaque agent va accepter cette monnaie pour réaliser ses transactions, sachant que celle-ci lui permettra d'éteindre ses dettes fiscales. Wray n'affirme-t-il pas en effet qu'«une fois que l'État impose à ses citoyens une taxe payable dans une monnaie qu'il crée, il n'a pas besoin de la monnaie du public afin de dépenser; c'est au contraire le public qui a besoin de la monnaie de l'État pour payer les impôts. Cela signifie que le gouvernement peut acheter tout ce qui est à vendre en termes de sa monnaie, tout simplement en fournissant sa monnaie » (Wray, 2000, p. 59). Cette affirmation a des implications en matière de politique économique :l'État réalise ses dépenses publiques en créditant simplement les comptes du secteur privé, indépendamment de tout revenu antérieur ou d'impôt perçu.
Cependant une telle thèse se prête aisément à la critique, comme ont déjà pu le montrer Desmedt et Piégay (2007). Multiples sont les exemples dans l'histoire monétaire d'un rejet par la communauté de la monnaie que l'État tente d'imposer : si l'on prend le cas de la France, on peut citer les périodes de la Régence et de la Révolution. C'est ce qu'affirment également Aglietta et Orléan (2002) :l'État peut être une source de légitimité, certes, mais la monnaie n'est en aucun cas un instrument aux seules mains des pouvoirs publics ; la confiance qu'ont les agents dans la monnaie est la condition sine qua non de son acceptation.
107
Par ailleurs, dans la thèse de Wray, l'échange ne peut pas être pensé indépendamment de la monnaie. La monnaie renvoie à l'État. Donc sans État, l'échange n'est pas pensable9.
Il est vrai que l'effondrement de l'Empire romain au ve siècle s'est accompagné de celui le système monétaire en vigueur jusque-là et de la contraction des échanges. Mais est-ce l'effondrement conjoint de l'Empire et du système monétaire qui a induit la contraction des échanges ou est-ce la contraction des échanges provoquée par les invasions, facteur de désagrégation de l'Empire, qui a fait que le système monétaire avait perdu son objet ?
L'application de la théorie de Wray au cas de figure historique pré- cédent peut être résumée comme suit
Mais les faits peuvent se prêter à une autre interprétation plus complexe.
Invasions—désagrégation de l'Empire—effondrement du système monétaire—contraction des échanges
~ contraction des échanges T
Dans la Gaule mérovingienne, les ateliers qui battaient monnaie étaient légion. Évêques, propriétaires, cités produisaient les supports de la monnaie. Dans ce contexte, quelle est l'entité correspondant à la catégorie «État » de la théorie de Wray ? La même question se pose à propos de la situation prévalant après la mort de Charlemagne qui unifia le système monétaire :qu'est-ce que l'État dans un contexte marqué par le fractionnement féodal et la multiplication des ateliers féodaux d'émission des monnaies ?
Enfin, on peut s'interroger sur l'intérêt et l'acceptabilité d'une théorie qui ne rendrait pas explicites ses hypothèses et postulats, ce qui semble être le cas de l'approche Wray. Affirmer que la monnaie est une créa- tion de l'État n'a de sens que si on a une définition ou une conception précise de ce qu'est l'État ;sinon, c'est remplacer une ignorance par une autre ignorance10.
9 Il est admis que tout échange marchand est monétaire. Mais toute relation monétaire n'est pas nécessairement marchande.
10 Nous pouvons ajouter une dernière remarque : il semble que la théorie de Wray soit une version littéraire du modèle standard de prospection monétaire de Li &Wright (1998).
108Invasions—désagrégation de l'Empire—effondrement du système monétaire—contraction des échanges
~ contraction des échanges T
Dans la Gaule mérovingienne, les ateliers qui battaient monnaie étaient légion. Évêques, propriétaires, cités produisaient les supports de la monnaie. Dans ce contexte, quelle est l'entité correspondant à la catégorie «État » de la théorie de Wray ? La même question se pose à propos de la situation prévalant après la mort de Charlemagne qui unifia le système monétaire :qu'est-ce que l'État dans un contexte marqué par le fractionnement féodal et la multiplication des ateliers féodaux d'émission des monnaies ?
Enfin, on peut s'interroger sur l'intérêt et l'acceptabilité d'une théorie qui ne rendrait pas explicites ses hypothèses et postulats, ce qui semble être le cas de l'approche Wray. Affirmer que la monnaie est une créa- tion de l'État n'a de sens que si on a une définition ou une conception précise de ce qu'est l'État ;sinon, c'est remplacer une ignorance par une autre ignorance10.
9 Il est admis que tout échange marchand est monétaire. Mais toute relation monétaire n'est pas nécessairement marchande.
10 Nous pouvons ajouter une dernière remarque : il semble que la théorie de Wray soit une version littéraire du modèle standard de prospection monétaire de Li &Wright (1998).
La théorie néo-chartaliste ne fournit pas une réponse acceptable à la question de l'origine de la monnaie, ce qui renforce, d'une certaine manière, la position de Benetti et Cartelier.
Qu'en est-il que la thèse de Michel Aglietta et d'André Orléan ?
DU MIMÉTISME :UNE NOUVELLE FORME
DE POSTULAT DE LA MONNAIE ?
Comme l'a bien montré Marx, l'échange de deux marchandises est un rapport asymétrique et conflictuel dans la mesure où chaque échan- giste tente d'imposer sa marchandise comme celle qui permet d'acquérir l'autre. Aglietta et Orléan cherchent à démontrer que la rivalité contenue dans le rapport d'échange est temporairement jugulée par l'apparition endogène d'un tiers médiateur qui est la monnaie.
Le cadre d'analyse des auteurs est celui de l'économie marchande, peuplée de producteurs indépendants les uns des autres ;chacun d'entre eux ignore ce que les autres vont produire et demander. Dans La monnaie entre violence et confiance, le premier chapitre s'intitule : «Les processus fondateurs de l'ordre marchand» et le second : «Marchandise et mon- naie :l'hypothèse mimétique ». À la page 31, Aglietta & al. (2002) écrivent : «Sur ce point aucune ambiguïté n'est possible : le chapitre II consacré à l'étude théorique de la monnaie et de ses propriétés se situe exclusivement dans le cadre d'une société marchande ». La production est donc bien aux mains de producteurs formellement indépendants.
Dans la théorie de la valeur traditionnelle, les individus qui échangent sont différenciés dans la mesure où ils ont des propriétés et des finalités qui leur sont propres. La rencontre entre deux individus aboutit à un accord et un échange si la double coïncidence des besoins est respectée. Aglietta & al. (2016) prennent le contrepied de l'hypothèse de différenciation en supposant des individus indifférenciés qui sont tous en quête de liqui- dité. Les deux co-échangistes s'observent l'un l'autre et veulent acquérir ce que l'autre désire. Le comportement mimétique des individus est la conséquence logique des hypothèses d'indifférenciation et de quête de
109
reconnaissance. Dans le monde marchand, la puissance d'agir s'identifie à la liquidité en ce que la liquidité est ce qui permet l'achat le plus large. En conséquence, la quête de liquidité est ce que recherchent prioritairement les producteurs marchands car la liquidité est la condition même de leur aptitude à produire et échanger. Alors que pour Cartelier (201, ld théorie d'Agliettd et Orlédn rejette le postulat monétaire et cherche à fonder théoriquement l'émergence de la monnaie, il n'en est en fait rien car leur thèse s'appuie sur un double postulat : le postulat monétaire selon lequel tous les individus sont en quête de ld 11qu1d1té, Gelle qu1 sera dGGeptée pdY tous, et le postulat du mlmétlsme qu1 1Jd permettre d'expliquer le processus de sélection d'une forme de liquidité particulière. Comme l'explique Orléan lui-même, l'économie marchande crée un besoin de liquidité pour tous les agents du fait que la sanction (par le marché) de leurs décisions ne se fait qu'a posterlorl. POux S'adapter aux aléas liés à l'activité économique, les agents économiques doivent détenir un pouvoir d'acheter. Orléan et Aglietta posent «postulat de la liquidité» à partir de l'analyse des caractéristiques de l'économie marchande.
La confrontation entre les deux individus qui cherchent à impo- ser leur propre définition de la liquidité est source de violences et de conflits. La généralisation de l'échange entre deux agents économiques à tous les individus engendre un état social chaotique. Chaque individu s'oppose aux autres pour imposer ses vues, ou bien suit les variations de l'opinion majoritaire. En effet, faute de norme monétaire, les individus sont incapables d'évaluer les richesses. L'incertitude pousse certains individus à copier l'opinion de leurs voisins, en supposant que ces derniers sont peut-être mieux informés. Aglietta et Orléan y voient le secret de la contradiction marchande :d'un côté, chacun se bat pour faire prévaloir la définition de la liquidité qui sert le mieux ses intérêts, mais d'un autre côté, cette définition, pour être valide, doit recevoir la reconnaissance et la confiance de tous les autres. Autrement dit, «on ne gagne jamais contre les autres car la richesse n'existe que dans leur regard » (Aglietta & Orléan, 2002).
Cette étape de la genèse des formes de la monnaie, Fl, est nommée par les auteurs «violence essentielle ». Elle débouche sur une «violence fondatrice» lors de l'étape F311. Les auteurs ajoutent une hypothèse tout
11 La forme F2, qui est analysée par les auteurs après les formes Fl et F3, correspond à l'étape
de spéculation mimétique sur deux ou trois formes de ce que les auteurs appellent «mon- naies partielles» et qui sont en concurrence. C'est l'étape de la «violence réciproque ».
110de spéculation mimétique sur deux ou trois formes de ce que les auteurs appellent «mon- naies partielles» et qui sont en concurrence. C'est l'étape de la «violence réciproque ».
à fait acceptable :plus une opinion reçoit l'adhésion d'un grand nombre d'individus, plus la probabilité que l'activité mimétique débouche sur l'adoption générale de cette opinion est grande. La dynamique de l'imitation débouche alors sur l'unanimité. Une fois que l'ensemble de l'opinion est acquise à une évaluation particulière de la richesse, cette opinion se reproduit mécaniquement pax mimétisme : je copie l'opinion de mon voisin qui lui-même adhère à l'opinion dominante. La monnaie apparaît donc par un processus endogène de mimétisme dont le fon- dement est la violence sociale dans laquelle sont plongés les individus.
Lorsqu'une forme particulière de monnaie est élue, elle est une institution socialement reconnue et mise à distance des individus car elle possède une légitimité intrinsèque. La monnaie n'est pas ici choisie pour ses qualités naturelles ;elle est monnaie parce que tous les agents la considèrent comme monnaie.
Comme le soulignent les auteurs, la dynamique de polarisation des opinions produit un résultat aléatoire. Elle peut déboucher sur plusieurs formes possibles de liquidité pour canaliser la violence sociale. Aglietta et Orléan ne nous renseignent pas sur le processus par lequel la monnaie devient le médiateur privilégié en lieu et place d'un autre. Par exemple, à la page 74, Aglietta et Orléan (2002) écrivent :«L'indétermination radicale de la richesse est un fait fondamental qu'il faut absolument res- pecter ». De même, Orléan écrit : « La première propriété que nous livre ce modèle est l'indétermination de l'opinion sur laquelle se concentre l'unanimité» (Orléan, 1984, p. 62).
Orléan a modélisé les effets du mimétisme sur la dynamique d'opinion en 1984, puis il a adopté le cadre du marché financier pour analyser l'effet des comportements mimétiques sur le cours boursier. Selon nous, il existe donc chez Orléan un modèle formel qui peut être appliqué au choix monétaire et au cours boursier.
Le modèle de 1984 met en scène des agents économiques qui à chaque période adoptent une opinion en copiant l'opinion d'un autre agent quelconque adoptée à la période précédente. Ces agents ne copient pas à chaque période les mêmes agents. Chaque agent est doté d'une loi de probabilité de tirage au hasard au sein de la population. La ques- tion qui est posée est de savoir vers quoi converge l'ensemble des choix caractérisant chaque période. Orléan obtient le résultat suivant : «sous certaines conditions, qû on explicitera par la suite, le processus d'imitation
111
converge vers l'unanimité du groupe » (Orléan, 1984, p. 61). Pax ailleurs, «La première propriété que nous livre ce modèle est l'indétermination de l'opinion sur laquelle se concentre l'unanimité» (ibid., p. 62) ce qui signifie que rien n'assure a priori que l'opinion converge vers l'adoption d'une forme particulière de monnaie.
Dans son modèle de marché financier, Orléan (1990, 1992) suppose un marché boursier peuplé de N intervenants sur lequel est évalué un titre Z, qui peut prendre deux valeurs Vi ou VZ avec une certaine probabilité. Puisque le prix du titre en question est susceptible d'avoir l'une de ces deux valeurs, deux opinions s'affrontent au sein de la communauté l'opinion [1] est celle selon laquelle la valeur du titre sera Vi, et l'opinion [2] qui exprime l'avis inverse. L'objet du modèle d'Orléan est précisément d'étudier la dynamique du cours du titre Z sur le marché en fonction d'une variable représentative de l'opinion collective.
Pour établir son évaluation, chaque intervenant a la possibilité de se référer à un «signal fondamental » émanant de l'extérieur du marché, ou bien observer l'évolution du cours du titre Z duquel il déduit les mouvements de l'opinion collective. C'est en se référant à ce second type d'information que les individus se livrent à une activité mimétique. Le poids que les intervenants vont donner à chaque information dépend du degré de confiance qu'ils accordent à la donnée extérieure et à l'opinion collective respectivement. Ce degré de confiance est lui-même fonction de la fréquence d'opinion observée dans le cours :plus elle est élevée, plus le poids donné au mimétisme sera important.
Lorsque le degré de confiance accordé à l'opinion collective est grand, ce que traduit la situation de violence et de confusion généralisées décrite plus haut, le modèle produit des équilibres multiples :l'opinion peut se stabiliser sur telle ou telle valeur du cours boursier, sans que l'on puisse prédire dans quelle direction le marché va aller.
Le résultat de la formalisation du mimétisme est donc semblable à l'analyse plus littéraire que nous offrent Aglietta et Orléan dans leurs ouvrages de 2002 et 2016. Fondamentalement, Orléan montre que ceux qui sont sur les marchés ne décident pas tant au hasard que par des procédures selon lesquelles une information peut suffire pour cristalliser des comportements d'achat ou de vente.
L'enjeu de la théorie d'Orléan et Michel Aglietta est de déterminer quelle forme va prendre la liquidité absolue dans une économie marchande.
112
Elle fournit un fondement analytique à l'idée de Marx selon laquelle la forme équivalent général peut appartenir à n'importe quelle marchandise. Cet enjeu n'est donc pas lié à l'émergence de la monnaie elle-même, mais à la forme qû elle va prendre. Le besoin de liquidité, donc le besoin de monnaie, est un postulat qui constitue le point de départ de l'analyse. En cela, Orléan et Aglietta ont une démarche qui rejoint celle de Benetti et Cartelier.
Au final, la théorie de la monnaie comme produit du mimétisme est encadrée par un postulat en amont (l'économie marchande est nécessairement monétaire) et une indétermination en aval (la forme que va prendre la monnaie). Nous considérons donc que les points de vue d'Aglietta-Orléan d'un côté, Benetti-Cartelier de l'autre, ne sont pas divergents mais au contraire convergents :l'adoption d'un postulat de la monnaie semble incontournable. Les uns comme les autres ne cherchent pas à expliciter le passage d'une société sans monnaie à une société avec monnaie.
En cherchant à formuler une génèse du choix des formes de la mon- naie et en faisant table rase de la théorie de la valeur, Aglietta et Orléan recourent à la formulation d'un postulat sur l'existence de la monnaie. De fait, il en va de même pour la théorie néo-chartale de Wray (2000, 2003), qui ne fonde pas de façon satisfaisante l'origine de la monnaie sur la dette fiscale. Dans le camp des tenants de la théorie de la valeur, les modèles de prospection monétaire, qui exhibent la possibilité d'équilibres monétaires ou non monétaires, amènent à postuler la sélection des équi- libres monétaires par l'évocation d'un choix collectif (Cartelier, 2001). Chez Marx, le passage de l'échange entre marchandises à l'échange entre marchandises et monnaie, c'est-à-dire le passage de forme 2 à la forme 3 de la valeur, est également postulé (Piluso, 201412).
12 Dans cet article, il est montré que Marx ne parvient à déduire la monnaie de la mar- chandise que sur la base d'un postulat (selon lequel la monnaie tire son origine du troc entre marchandises). Néanmoins, il est souligné que le postulat marxien de la monnaie est de nature fondamentalement différente du postulat keynésien, tant par la place qu'il
113Autrement dit, tous les auteurs des théories de la monnaie que nous évoquons ici formulent un postulat de la monnaie volontairement ou non :théories de la prospection monétaire, postulat du passage de la forme 2 à la forme 3 de la valeur chez Marx (théorie de la monnaie- marchandise), postulat d'existence de l'unité de compte chez Cartelier. Cela ne manque pas d'apporter du poids à la démarche de Benetti et Cartelier. Ces derniers considèrent en effet qu'il est vain de chercher une origine à la monnaie, de la même façon qu'il est vain de chercher une origine à la société ou à l'univers. Dans son article de 2016, Cartelier expose ce point de vue très clairement
Ou bien l'on s'efforce de combler le fossé béant entre «situation avant toute relation sociale » et «société constituée » ; on recourt alors à un conte ou à un mythe :celui du «contrat social» en est un exemple remarquable tout comme sa déclinaison mineure qu'est la «fable du troc » [...], on se heurte alors à des apories diverses telles que l'indétermination [...] des individus de la «mul- titude» (contrat social de Hobbes) ou l'extension indue de la problématique des choix individuels à la sélection de l`équilibre (modèles de prospection). Ou bien l'on s'efforce de produire une théorie correctement construite en explicitant ses postulats — ce qui signifie énumérer ce que l'on renonce à expliquer et à comprendre —faisant apparaître l'impuissance dans laquelle on se trouve à rendre compte de l'existence même de ce que l'on se propose d'étudier, par exemple le langage, le marché ou la monnaie.
L'étude que nous avons réalisée de trois exemples d'approches hétéro- doxes de la monnaie montrent l'intérêt des approches issues du postulat de la monnaie et confortent ainsi le point de vue défendu par Cartelier la théorie économique doit avoir pour fondement un postulat institu- tionnaliste de la monnaie.
occupe dans la théorie que pat sa nature. Cette thèse prend appui sut la critique de Benetti (1985) de la théorie marxienne de la monnaie.
114AGLIETTA, Michel & al. [2016], La monnaie entre dettes et .souveraineté, Paris, Odile Jacob.
AGLIETTA, Michel & ORLÉAN, André [2002], La monnaie entre violence et confiance, Paris, Odile Jacob.
ALARY, Pierre & al. [2016], Théories françaises de la monnaie, Paris, PUF. BENETTI, Cano [1985], «Économie monétaire et économie de troc : la question
de l'unité de compte commune », Économie appliquée, t. XXXVIII, N° 1,
p. 85-109.
BENETTI, Carlo [1996], «The ambiguity of the notion of general equilibrium with a zero price for money », in DELEPLACE, G. & NELL, E J. (éd.), Money in motion :The Post-keynesian and circulation approaches, Londres, Macmillan, p. 366-376.
BENETTI, Carlo [2001], «Monnaie, choix individuels et frictions », Cahiers d'économie politique, N° 39, automne, p. 917-931.
BENETTI, Carlo &CARTELIER, Jean [2001], «Money and price theory »,
International Journal of Applied Economics and Econometrics, N° 9, p. 203-223. CANTILLON, Richard [1755], Essai sur la nature du commerce en général, reprint,
New York, A.M. Kelley, 1964.
les termes d'un choix », Économie appliquée, t. XXXVIII, N° 1, p. 63-82. CARTELIER, Jean [1991], «Monnaie et systèmes de paiement : le problème de la
formation de l'équilibre », Revue française d'économie, Vol. VI, N° 3, p. 3-37. CARTELIER, Jean [1996], La monnaie, Paris, Flammarion.
CARTELIER, Jean [2001], «Monnaie et marché : un point de vue critique sur
les modèles de prospection », Revue économique, Vol. 52, N° 5, p. 993-1011. CARTELIER, Jean [2016], «Monnaie et société :une théorie économique en
perspective ? », Revue de la régulation, (mis en ligne).
DESMEDT, Ludovic & PIÉGAY, Pierre [2007], «Monnaie, État et Production apports et limites de l'approche néo-chartaliste », Cahiers d'économie Politique, N° 52, p. 115-133.
HAHN, Franck [1971], «Equilibrium with transaction costs », Econometrica, Vol. 39, N° 3, p. 417-439.
IwAI, Katsuhito [1988], «The Evolution of Money : A Search Theoretic Foundation of Monetary Economics », University of Pennsylvanie CARESS, Working Papes, N° 88-03.
KEYNE$, John Maynard [1930], Treatise on Money, in JOHNSON, E. & MOGGRIDGE,
115
D. (éd.), Collected Writtings of John Maynard Keynes, Londres, MacMillan- Cambridge University Press pour la Royal Economic Society, 1971, t. V VI.
KEYNES, John Maynard [1936], Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, traduction française de J. de Largentaye, Paris, Payot, 1969.
KNAPP, Georg Friedrich [1905], Staatliche Theorie des Geldes, Leipzig, Duncker and Humblot.
KIYOTAKI, Nobuhiro & WRIGHT, Randall [1993], «A Search Theoretic Approach to Monetary Economics », The American Economic Review, Vol. 83, N° 1, p. 63-77.
LI, Yitirig & WRIGHT, Randall [1998], « Government Transaction Policy, Media of Exchange, and Prices », Journal of Economic Theory, Vol. 81, N° 2, p. 290-319.
MARx, Karl [1867], Le Capital, Livre 1, Paris, Éditions Sociales, 1977. Oxurro, Masahiro & ZILCHA, Itzhak [1979], «The role of money in supporting
the Pareto optimality of competitive equilibrium-loan type models »,
Journal of Economic Theory, Vol. 20, N° 1, p. 40-80.
ORLÉAN, André [1984], «Monnaie et spéculation mimétique », Bulletin du Mauss, N° 12, décembre, p. 55-68.
ORLÉAN, André [1990], «Le rôle des influences interpersonnelles dans la détermination des cours boursiers », Revue économique, Vol. 41, N° 5, p. 839-868.
ORLÉAN, André [1992], «Contagion des opinions et fonctionnement des marchés », Revue économique, Vol. 43, N°4, p. 685-698.
OSTROY, Joseph & STARR, Ross [1974], «Money and the decentralization of exchange », Econometrica, Vol. 42, N° 6, p. 1993-1113.
PlLuso, Nicolas [2014], «Postulat de la monnaie et théorie de la valeur chez
Marx », Revue de la régulation, N° 15, premier semestre (numéro en ligne). ULGEN, Faruk & al., [2013], New Contributions to Monetary Analysis. The
Foundations of an Alternative Economic Paradigm, Londres, Routledge. WRAY, Randall [2000], «Modern money », in SMITHIN, John (dir), What is
Money ?, Londres, Routledge, p. 42-66.
WRAY, Randall [2003], «L'approche post-keynésienne de la monnaie », in PIEGAY, Pierre & RocxoN, Louis-Philipe (éd.), Théories Monétaires Post Keynésiennes, Paris, Économica, p. 52-65.