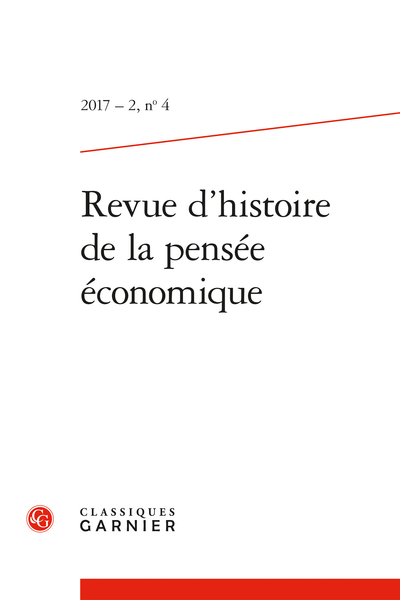
Rejeter l’hédonisme économique et croire aux miracles Les positions communes de Keynes et de Arendt
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Revue d’histoire de la pensée économique
2017 – 2, n° 4. varia - Auteur : Pouchol (Marlyse)
- Résumé : Keynes et Arendt rejettent l’un et l’autre l’hédonisme économique. Ils prennent au sérieux un besoin d’estime de soi que la religion a été pendant un temps en mesure de satisfaire et que la science moderne a ignoré. En dépit de la violence, des drames de l’histoire, ils n’entendent pas abandonner la haute idée de l’humanité qui a surgi dans la Grèce Antique. Ils comptent sur la liberté humaine pour initier un nouveau commencement, décidant de croire en la faculté humaine d’accomplir des miracles.
- Pages : 123 à 149
- Revue : Revue d’histoire de la pensée économique
- Thème CLIL : 3340 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Histoire économique
- EAN : 9782406073550
- ISBN : 978-2-406-07355-0
- ISSN : 2495-8670
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-07355-0.p.0123
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 01/12/2017
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : Keynes, Arendt, hédonisme économique, religion et économie, philosophie et économie.
Rejeter l’hédonisme économique
et croire aux miracles
Les positions communes de Keynes et de Arendt
Marlyse Pouchol1
Université de Reims Champagne Ardenne
Clersé-Université de Lille 1
Introduction
Keynes (1883-1946) et Arendt (1906-1975), un économiste anglais et une théoricienne de la politique d’origine allemande, n’ont a priori rien de commun. Ils partagent pourtant une même façon de penser qui peut être mise en évidence à partir du thème « économie et religion » proposé par ce colloque2. L’un et l’autre accordent une importance au phénomène religieux en y voyant la manifestation d’une sorte de besoin humain, qui pourrait être désigné, en première approximation, comme un besoin d’estime de soi ne pouvant pas être évacué sans dommage pour la cohésion d’une société ou la préservation de l’humanité. L’un et l’autre sont, en conséquence, critiques à l’égard de la conception 124moderne de l’homme, tel qu’elle a été présentée par Bentham (1748-1832), qui le réduit à un être économique en quête d’un bonheur individuel appréhendé par la somme arithmétique des plaisirs et des peines ressentis dans le privé de son corps. Les sensations personnelles non communicables aux autres sont ainsi le critère du bonheur de l’être benthamien. En revanche, l’estime de soi, qui suppose de se conformer à une idée de ce que l’on doit faire, passe par l’adhésion à des valeurs morales ou sociales transmises dans des discours ou dans des livres. Sa prise en compte donne de l’importance à un genre de dépendance à l’égard des autres tout à fait différente de celle qu’introduit la division du travail dans les échanges ou la production des choses, telle qu’elle a été sacralisée par la théorie économique. La prise en compte de l’estime de soi fait de la communication entre les individus, et donc du langage, un élément essentiel à l’existence d’une communauté humaine tandis que l’hédonisme économique de Bentham suggère que « le parler ensemble » relève d’un total superflu dont il serait tout à fait possible de se passer. Pour la science économique, le « produire ensemble », même sans le savoir et sans le vouloir, par le biais de la division sociale du travail, suffirait à créer un tout social unifié, comme le suggère la théorie smithienne des échanges. Les deux auteurs pensent, au contraire, que l’unité n’est jamais un fait, mais un objectif vers lequel il faut tendre, que l’humanité n’est pas un ensemble donné une fois pour toute mais désigne plutôt une qualité de la relation à l’autre qui peut tout à fait disparaître dans les temps sombres, mais aussi renaître si des efforts de conviction sont faits dans ce sens. Tous deux croient au miracle d’un nouveau commencement et cette position s’avère, en définitive, beaucoup plus sensée que celle d’une science économique qui s’imagine qu’elle dispose de connaissances certaines qui la rendent en mesure de prévoir ce qui va advenir avec un degré de probabilité acceptable.
Keynes et Arendt prennent acte des événements auxquels ils sont confrontés. Tous deux ont tiré les conséquences du bouleversement opéré par l’essor du capital financier au cours du xixe siècle en Europe avec le développement des bourses des valeurs. Comme le revenu du capital de prêt relève quasiment d’un phénomène d’auto-engendrement, notamment par le jeu des intérêts composés, il s’étend de façon tout à fait différente de celle du capital productif, de telle sorte que la vieille recommandation du laissez-faire, propre au libéralisme économique, devient, dans ce 125contexte, une exigence de soumission à une logique d’expansion pour l’expansion qui n’a aucune raison de s’arrêter d’elle-même. Ni l’un ni l’autre ne considère que, dans ces conditions, les relations économiques puissent être l’élément d’unification des individus ou des nations ; elles sont, au contraire, une source de division et de conflits, si bien que le « laissez-faire », à ce stade, équivaut à laisser monter la violence née des oppositions d’intérêts entre ceux qui s’enrichissent et ceux qui s’appauvrissent. Ils mettent tous deux en cause le capitalisme financier dont l’expansion sans limite est devenue contre-productive. Keynes considère que l’entreprise qui offre des emplois risque d’être emportée dans le tourbillon de la spéculation financière tandis qu’Arendt souligne un autre changement consistant à rendre l’activité de fabrication aussi improductive et perpétuelle qu’une activité d’entretien en raison de l’élimination systématique de la durabilité des choses produites. L’état d’esprit de l’homo faber ayant en vue de meubler le monde de ses créations disparaîtrait pour céder la place à celui de l’animal laborans échangeant ses services contre la satisfaction de ses besoins et ressemblant en tous points à l’être benthamien.
L’un et l’autre constatent un changement d’état d’esprit auquel le laissez-faire donne sa bénédiction qui conduit à décerner des prix à ceux qui s’enrichissent et qui s’approprient le monde, à valoriser l’amour de l’argent comme l’attitude conquérante et à dévaloriser tout autre préoccupation ayant une autre ambition. Le « laissez-faire » introduirait une nouvelle hiérarchie des valeurs en rupture avec celles de la morale traditionnelle que l’on trouve dans toutes les religions recommandant de considérer l’autre comme un autre soi-même. Avec cette nouvelle hiérarchie, l’estime de soi pourrait ne plus coïncider avec le respect de l’exigence morale.
Keynes et Arendt s’inquiètent l’un et l’autre d’un effondrement de la moralité caractéristique du xxe siècle, mais aucun d’eux ne l’attribue au recul de la croyance en Dieu. La source de l’attitude morale ou plutôt faudrait-il dire la source de l’humanité d’une personne se situe, pour chacun d’eux non pas dans la religion mais dans une aptitude à discerner le bien du mal, le beau du laid autrement dit dans une faculté de jugement dont tout un chacun serait pourvu mais dont la réalité ne pourrait se manifester que par la communication entre les êtres confrontés aux mêmes expériences. La logique d’expansion du capital n’est pas 126seulement anti-productive, elle fait aussi disparaître l’humanité, et le terme ne signifie pas l’espèce humaine, mais la qualité de la relation entre les êtres qui surgit lorsqu’ils parlent ensemble de choses qui les concernent tous et qu’ils font usage de leur faculté de jugement. C’est dans ce contexte que la religion fait figure de moindre mal, car malgré les distorsions qu’elle a introduites elle contient encore la trace de l’humanité des êtres, ceux qui ont inventé un Dieu exigeant d’eux une conduite morale à l’égard des autres comme à l’égard d’eux-mêmes. En définitive, ce qui fait la parenté entre Keynes et Arendt vient du fait qu’ils ont tous deux en tête l’idée d’humanité telle qu’elle a surgi dans la Grèce Antique et dont Socrate serait l’archétype.
I. LA RELIGION DISTINCTE DE L’IDÉOLOGIE
La religion étymologiquement parlant, du moins dans l’interprétation la plus courante aujourd’hui3, relie les êtres entre eux. En posant tout un chacun comme un enfant de Dieu, le christianisme a ainsi crée une fraternité amenant à considérer son prochain comme un égal et à exiger de se bien conduire envers lui. La religion suppose un état d’esprit à l’égard des autres et de soi-même contenant une idée de l’humanité qui a une histoire plus ancienne et qui, pour nos deux auteurs, ne peut pas être négligée. Mais la religion est aussi une source de division, dès lors que le lien ne repose pas sur la foi, mais s’impose comme l’obligation d’obéir à des règles de conduite et que des sanctions, figurées ou réelles, attendent ceux qui ne s’y plient pas. La religion, on l’a vu avec la Sainte Inquisition et les guerres de religions, peut aussi mener au fanatisme et à l’intolérance vis-à-vis des non-croyants où à l’égard de ceux qui n’adhèrent pas au dogme établi. Le mot religion peut donc aussi bien évoquer la tolérance que l’intolérance. Les athées ont pu penser que les débats théologiques à propos de l’immaculée conception, du sexe des anges ou du récit de la genèse, par exemple, pouvaient être dépassés 127par la connaissance scientifique apportant des certitudes sur l’origine du monde et de l’espèce humaine ; ils ont fait comme si la science pouvait apporter la preuve de l’inexistence de Dieu, ce qui place la science sur un piédestal qui ne peut pas lui convenir et réduit la religion à un subterfuge masquant l’ignorance. Keynes et Arendt, pour leur part, ont saisi ce qu’il y avait d’incongru dans cette prétention scientifique et retenu le meilleur de la religion.
Ni l’un ni l’autre ne serait d’accord pour considérer la religion comme une idéologie en reprenant à son compte la formule de Marx : « la religion est l’opium du peuple ». Arendt prend garde toutefois de préciser (Arendt, 1955, note p. 167) que, chez Marx, la formule ne sous-entend pas que la religion a été inventée pour calmer les ardeurs du peuple, mais qu’elle a été utilisée comme telle ; distinction dont l’importance a pu se perdre y compris chez les marxistes. Il reste que Marx inaugure une démarche qui s’intéresse peu au contenu des idées pour privilégier l’usage qui en est fait, ce qu’Arendt nomme le fonctionnalisme qu’elle voit en œuvre dans toutes les sciences sociales. Keynes, comme Arendt après lui, et à la différence des sciences sociales, prend au sérieux ce que disent les hommes sur eux-mêmes quand ils se déclarent croyants.
I.1 La religion comme aspiration à un idéal
Dans le vocabulaire de Keynes, le terme « religion » prend un sens particulier. Il désigne une aspiration à consacrer sa vie à des activités tout autres que celles qui servent à satisfaire les besoins de son existence personnelle. Celui ou celle qui a une religion cherche une utilité ou une raison d’être à son passage sur terre en servant une cause qui dépasse le bonheur de sa propre personne. Sous cet aspect le communisme fait figure de « nouvelle religion », tandis que le capitalisme qui impose de s’occuper de soi et dévalorise toutes les activités qui ne visent pas cet objectif détruit toute possibilité de religion.
En 1925, au retour de son voyage en URSS, Keynes a écrit trois articles, regroupés sous le titre : Un aperçu de la Russie qui traduisent ses impressions moins sur les réalisations du jeune pays des Soviets que sur l’état d’esprit des personnes qu’il a rencontrées. Il annonce d’emblée qu’il « usera fréquemment de l’épithète “religieux” pour qualifier les disciples de Lénine » (Keynes, 1925, p. 33), en ajoutant que, si les Anglais pourront entendre ce qu’il veut dire, il imagine bien qu’en Russie la 128référence sera mal comprise et paraîtra aussi incongrue que s’il avait qualifié l’archevêque de Canterbury de « bolchevique » :
Les bolcheviques eux-mêmes y verront une vulgaire injure, stupide et offensante… Religion, mysticisme, idéalisme – selon le credo léniniste, tout cela n’est que tromperie et ineptie, tandis que les bolcheviques eux-mêmes sont matérialistes, réalistes, terre-à-terre (Keynes, 1925, p. 33).
Le communisme constitue donc, selon Keynes, « une nouvelle religion » mais dont les adeptes ne la nommeraient pas ainsi parce qu’ils auraient en tête une fausse image de la religion en la considérant comme une idéologie, soit un discours fabriqué pour tromper ou du moins mal fondé. Pour sa part, le vocabulaire religieux lui apparaît comme le seul qui soit adapté pour qualifier l’espérance d’un monde meilleur qui anime ceux qui mettent en place le nouveau régime. Pour appuyer son propos, il reprend la description de la société souhaitée par Trotski en citant ce passage dans lequel celui-ci annonce que :
sous le socialisme, la solidarité sera la base de la société. Art et littérature prendront une tonalité différente. Toutes ces émotions que nous autres révolutionnaires rechignions aujourd’hui à nommer – à plus forte raison parce qu’elles sont l’apanage des hypocrites et des vulgaires – l’amitié désintéressée, l’amour du prochain, la sympathie seront les accords chantants de la poésie socialiste (Keynes, 1925, p. 35).
D’après cette présentation, il est clair que Trotski qui a en vue la création d’un paradis sur terre est « un personnage des plus religieux ». Le terme de religion convient pour une autre raison qui tient au pouvoir de mobilisation de l’idée communiste et à la capacité d’engagement qu’elle est en mesure de déclencher. Le « léninisme » tire son pouvoir « d’une petite minorité de convertis enthousiastes, dotés d’un zèle et d’une intolérance qui insufflent à chacun d’eux une force équivalente à celle d’une centaine d’indifférents » (Keynes, 1925, p. 37). La nouvelle religion semblable à la foi capable de déplacer les montagnes est dotée d’un réel pouvoir d’attraction pour « l’âme de l’homme moderne », qui, devenu incroyant, se retrouve privé d’idéal.
Keynes, contrairement aux économistes qui négligent cette dimension, prend tout à fait au sérieux un besoin de transcendance que le projet communiste est pleinement en mesure de satisfaire, tandis que 129le laissez-faire des défenseurs du capitalisme n’ouvre aucune espérance de dépassement de soi et ne propose que la jouissance individuelle de la possession et de la consommation. Sa position ouvre à un genre de critique du capitalisme qui n’est ni recevable ni crédible pour ceux qui n’admettent pas ce besoin en ne voyant dans la religion qu’un discours chargé d’enrober une exploitation des travailleurs par les propriétaires des moyens de production. Keynes qui ressent ce besoin autant que ceux qui, comme Trotski, ont en vue de faire advenir le règne de l’humanité dénonce le « capitalisme irréligieux ; dénué de solidarité interne, et sans beaucoup de civisme, et qui n’est souvent qu’un simple agglomérat de nantis et de démunis impatients de le devenir » (Keynes, 1925, p. 50). Face à la nouvelle religion communiste, le capitalisme n’a pas d’autres arguments pour sa défense que ses performances économiques, lesquelles devront être de plus en plus considérables pour que les rangs de ses défenseurs ne se réduisent pas comme une peau de chagrin.
La pauvreté spirituelle propre à la logique d’enrichissement soutenue par les défenseurs du capitalisme a pu, un temps, être masquée par la croyance en Dieu qui satisfaisait ce besoin de transcendance. Ainsi, « les protestants et les puritains s’en accommodaient puisque les affaires se déroulaient sur terre tandis que la religion se reportait au paradis, qui était ailleurs ». D’autres ont cru que « les affaires » seraient le moyen d’un progrès permettant d’installer un paradis sur terre, ce qui donnait à leurs activités privées une dimension qui dépassait leur intérêt personnel. Mais désormais, comme l’annonce Keynes : « nous doutons que l’homme d’affaires soit capable de beaucoup améliorer notre situation ». On ne peut plus croire que le « capitalisme moderne » soit en mesure de mener à « un paradis économique dans lequel nous serions, comparativement, libérés des préoccupations matérielles » (Keynes, 1925, p. 50). Loin de libérer toute la population du souci matériel, loin de dégager du temps pour d’autres occupations que celle de la satisfaction des besoins de la vie physique, le laisser-faire développe un « égotisme matérialiste » qui ne permet que « l’amour de l’argent » et déprécie toute passion qui s’en éloigne, telle que : « consacrer sa vie au service de l’État, à la religion, à l’éducation, à l’enseignement ou bien à l’art » (Keynes, 1925, p. 41).
Bien que différente quant à la formulation, on retrouve une critique du capitalisme du même ordre chez Hannah Arendt qui évoque une disparition de la vie de l’esprit. De même qu’elle voit, elle aussi, dans 130le socialisme, à distinguer du totalitarisme, ce qu’il y a de meilleur dans la tradition occidentale. Ce point, commun aux deux auteurs, est à opposer à un autre type d’approche relativement répandue qui, pour sa part, associe totalitarisme et religion.
I.2 Totalitarisme et religion
Durant les années 1930, la nature du gouvernement soviétique se modifie sous l’influence de Staline qui écarte ses anciens compagnons de route cherchant toujours, mais sans succès, à étendre la révolution à l’étranger ; dans son impatience, il choisit, pour sa part, d’imposer, à marche forcée, le socialisme dans un seul pays. On sait aussi qu’au début de cette décennie, Hitler avec son programme démentiel de purification de la race aryenne parvient sans encombre au pouvoir en Allemagne. La violence qui se déchaîne sous ces deux régimes totalitaires, peu explicable uniquement par des oppositions d’intérêts économiques entre fractions de population, a pu faire penser à des époques de guerres civiles où des dogmes religieux se combattaient sans merci. C’est une assimilation que combat Arendt, mais que l’on trouve, notamment, chez Bertrand Russell (1872-1970), de 11 ans l’aîné de Keynes avec lequel il a entretenu des relations amicales sans toutefois partager les mêmes préoccupations.
Russell effectue un voyage en Russie en 1920, avant Keynes donc et avant le tournant du régime, mais son jugement est d’emblée sévère à l’égard du socialisme. Dans Théorie et pratique du bolchévisme (1920) il appréhende de façon tout à fait négative le gouvernement des soviets en le comparant à la cité idéale de La République de Platon où le philosophe se fait roi. Il en retire avant tout une vision désenchantée de la politique. « Et finalement je commençais à me rendre compte que toute politique est inspirée par un démon ricanant, qui enseigne aux forts et aux malins à torturer des populations résignées, pour le profit du portefeuille, ou du pouvoir, ou de la théorie » (Russell, vol. 1, p. 431). Russell, à la différence de Keynes, ne souscrit pas à l’ambition du projet socialiste et adhère à une vision étroite de la politique réduite à un moyen de diriger le peuple. Son esprit scientifique s’oppose à une espérance qu’il juge inconsidérée estimant qu’elle ne pourra s’achever que dans la violence comme chaque fois que des dogmes religieux ont inspiré la ligne d’un gouvernement. Le tournant du régime soviétique des années 1930 a 131pu lui sembler une confirmation de cette vision. Dans un essai intitulé Science et religion publié en 1935, Russell saisit un conflit entre ces deux pôles opposant connaissances et croyances, esprit scientifique et esprit religieux qui a pris de l’importance à partir du xvie siècle et duquel la science aurait fini par sortir victorieuse. Mais il se pourrait bien, selon lui, que cette victoire ne soit pas définitive et que la relation s’inverse au xxe siècle. Il s’inquiète, en particulier, de « l’avènement, en Russie et en Allemagne de nouvelles religions munies de nouveaux moyens d’activité missionnaire fournis par la science » (Russell, 1935, p. 7). Il associe ainsi la violence des gouvernements totalitaires au règne de croyances, idées fausses sans fondement scientifique, en tout point semblables à une croyance en Dieu dont les zélateurs auraient une fâcheuse tendance à devenir fanatiques dès lors qu’ils veulent l’imposer comme principe de gouvernement. Russell est prêt à reconnaître qu’il y a du bon dans « l’état d’esprit religieux » qu’il voit se manifester chez « l’homme qui ressent profondément les problèmes de la destinée humaine, le désir de diminuer les souffrances de l’humanité, et l’espoir que l’avenir réalisera les meilleures possibilités de notre espèce » (Russell, 1935, p. 14), mais considère que ce n’est pas ce qui doit guider des gouvernants. Comme Russell dans son Autobiographie décrit l’attitude de Keynes en ces termes : « Dans le vaste monde, partout l’accompagnait le sentiment d’être une sorte d’évêque in partibus » (Russell, vol. 1, p. 81) il l’inclurait sans doute dans cette catégorie d’hommes à « l’état d’esprit religieux ». Là où Keynes voit un besoin d’idéal caractéristique de l’humain, Russell ne saisit qu’un trait de caractère distinctif de certains individus qui se prendraient pour des missionnaires. Russell ne partage pas le souci de Keynes et ne prend pas le message contenu dans la religion au sérieux. Religion ou idéologie sont, pour lui, des termes interchangeables et synonymes qui s’opposent à l’esprit scientifique. Ce n’est pas la position de Keynes, pas plus que celle de Arendt.
I.3 Religion et politique
Dans un texte intitulé Religion et politique, écrit en 1953 pour une revue américaine, Arendt s’insurge contre un mode de pensée qui conduit, à l’instar de ce que fait Russell, à interpréter « le conflit entre le monde libre et le monde totalitaire » « à l’aide des catégories religieuses » (Arendt, 1953, 132p. 139). Selon ce raisonnement, les idéologies au pouvoir dans les régimes totalitaires sont données pour des croyances de même nature que la foi en Dieu à l’époque où celle-ci tenait un rôle dans la politique. Cette assimilation a incidemment resitué la religion sur la scène publique alors qu’elle était devenue une affaire privée depuis la séparation de l’Église et de l’État. Arendt y voit un effet boomerang paradoxal du marxisme qui, ayant commencé à ne voir dans la religion qu’un discours utilisé pour endormir le peuple et l’empêcher de se révolter, aurait autorisé les ennemis du projet socialiste à le disqualifier en le considérant comme une croyance en un monde meilleur aussi irrationnelle que la croyance en l’existence d’un paradis après la mort. L’assimilation de la religion à une idéologie au xixe siècle devenue, en sens inverse, identification d’une idéologie à une religion au xxe siècle est à considérer comme un blocage de la pensée qui, d’une part, empêche de prendre au sérieux la haute idée de l’homme contenue dans le phénomène religieux et, d’autre part, ne permet pas de comprendre que l’apparition des régimes totalitaires au xxe siècle est révélatrice de l’effondrement complet des valeurs morales défendues par toutes les religions monothéistes, effondrement qui subsiste même après la disparition des régimes totalitaires. L’incompréhension de la nature du totalitarisme signifie que l’on se trompe de combat et d’ennemi, c’est la raison pour laquelle l’élimination des confusions importe. Comment a-t-on pu en arriver à trouver quelque chose de religieux dans des idéologies politiques qui posent des principes de gouvernement aussi radicalement contraires aux Dix commandements qui constituent le corps de la religion hébraïque et chrétienne ?
Le fait d’identifier l’idéologie en office dans les régimes totalitaires à une religion relèverait, selon Arendt, d’une incompréhension de la politique qui a une longue histoire. Elle met en cause les confusions issues d’un questionnement moderne propre à la science économique – que Marx aurait repris sans examen –, et qui a éliminé de ses préoccupations les idées, le langage et la communication comme éléments de la formation d’une communauté pour ne s’intéresser qu’à l’efficacité productive d’un ensemble économique ; ce qui a eu pour conséquence de rabaisser la politique à un moyen de servir cet objectif. Elle relève que déjà chez Platon il y avait, sans que cela ait eu des conséquences, une fonctionnalisation de la politique mais qui avait trait à une autre préoccupation. Platon a cherché un moyen de résoudre le problème de 133l’imprévisibilité des conséquences de la pluralité des actions humaines qui lui faisait dire que « les actions des hommes ressemblent à des gestes de pantins manœuvrés par une main invisible derrière le décor, de sorte que l’homme est comme le jouet d’un Dieu » (Arendt, 1958, p. 208). Pour tenter d’éviter les désastres, et croyant pourvoir dépasser l’imprévisibilité de la pluralité, il a « inventé le concept de gouvernement » chargé de mettre au pas le plus grand nombre et aurait ainsi inauguré « le lieu commun » dont nous avons hérité qui veut « qu’une communauté politique (soit) faite de ceux qui gouvernent et de ceux qui sont gouvernés » (Arendt, 1958, p. 255). Arendt relève que la peur de l’Enfer est un élément introduit par Platon pour tenter d’obtenir une rectitude de conduite de la part de ceux qui, à la différence du philosophe qui n’en a pas besoin, ne peuvent accéder au ciel lumineux des « idées ». Autrement dit, la doctrine de l’Enfer, « qui est manifestement un instrument politique, inventé pour servir des fins politiques » (Arendt, 1953, p. 160), n’est pas liée à la croyance en un Dieu créateur de l’homme et de l’univers. Elle précise que « le christianisme n’a pas eu de doctrine de l’Enfer tant qu’il est demeuré sans responsabilités ni intérêts à caractère séculier » et que ce n’est qu’au début du Moyen-Âge qu’elle a été adoptée de manière officielle.
La religion, en raison du dogme de l’enfer qu’elle a contribué à soutenir, a, certes, été utilisée comme une idéologie, mais cela ne signifie pas qu’elle soit à considérer comme une idéologie dont le message ne mériterait aucune attention. Seule la perspective des sciences sociales qui n’étudient les phénomènes que du point de vue de la fonction qu’ils remplissent au sein d’une société pouvait induire cette indifférence à l’égard du contenu de la religion. Arendt accuse ce « fonctionnalisme » qui aboutit à tout mélanger et finit par se mettre en position de suggérer que « Hitler et Jésus sont identiques parce qu’ils remplissent la même fonction sociale » (Arendt, 1953, p. 154) sous le prétexte que l’un et l’autre pourraient être représentatifs de la catégorie du « chef charismatique » définie par Max Weber : « Il est évident que seuls des gens qui refusent d’écouter le discours tenu par Jésus ou par Hitler peuvent parvenir à une telle conclusion ».
L’ennui de cette science est qu’elle suppose qu’elle est en mesure de comprendre qui nous sommes sans nous entendre, ce qui la rend inapte à saisir la source de l’humanité.
134II. LA SOURCE DE L’HUMANITÉ
Keynes et Arendt constatent que la place occupée par les activités économiques est devenue de plus en plus importante dans le monde moderne allant jusqu’à s’imposer comme le seul genre d’occupation digne de considération. Plus précisément, l’un et l’autre enregistrent le fait que, progressivement, toute occupation humaine qui ne parvient pas à se travestir en activité économique, c’est-à-dire en moyen de gagner sa vie, est vouée à la disparition, du moins si rien ne vient stopper ce processus. Ce qui est un sujet d’inquiétude pour qui considère que la qualité de la relation à l’autre vient d’une autre réalité que celle de la division du travail établie par l’échange ou installée dans l’entreprise. Keynes et Arendt ont en tête une autre vision de la source d’où peut jaillir la prise en considération de l’autre qui les amène à saisir toute la perversion de l’idée d’humanité contenue dans la conception de l’homme proposée par Bentham.
II.1 Les convictions de Keynes
Dans une conférence prononcée en 1938 devant un groupe restreint d’amis (le groupe de Bloomsberry) et qui sera publiée en 1949, – soit de façon posthume selon sa volonté –, sous le titre Mes convictions de jeunesse, Keynes condamne avec beaucoup de véhémence et de façon tout à fait radicale la vision du bonheur, – somme algébrique des plaisirs et des peines – conçue par Bentham. Désormais, il saisit la tradition benthamienne comme « le ver qui s’est introduit à l’intérieur de la civilisation moderne et qui est responsable de sa décadence morale actuelle » (Keynes, 1938-1949, p. 1825). Beaucoup plus que la religion et les chrétiens que, lui et ses amis avaient considéré, dans leur jeunesse, comme l’ennemi parce qu’ils étaient « les représentants de la tradition, des conventions et de la supercherie. En vérité, c’est le calcul benthamien, fondé sur une surévaluation du critère économique qui était en train de détruire la qualité de l’Idéal populaire ».
Cette surévaluation serait à voir comme la caractéristique de ce que Keynes avait nommé dans le passé « l’orthodoxie économique » qui englobe toute « la compagnie des économistes », marxistes inclus. Si 135Keynes applaudit, comme cela a été vu précédemment, au contenu de la « religion » socialiste qui cherche, en s’opposant au capitalisme, « à mettre les élans altruistes de l’homme au service de la société » (Keynes, 1924-1926, p. 81), il n’adhère pas à la fonction de la politique en œuvre dans « la doctrine du socialisme d’État » qui resterait, selon lui, ancrée dans la vision benthamienne de l’homme. « Le socialisme d’État du xixe siècle découle de Bentham, de la libre concurrence, etc. ; il est une version, plus claire à certains égards, et plus confuse à d’autres, de la philosophie même qui sous-tendait l’individualisme du xixe siècle » (Keynes, 1924-1926, p. 82). Le rapprochement du marxisme et de Bentham a de quoi surprendre dans la mesure où Marx n’a jamais été tendre avec le philosophe britannique qu’il traitait « d’histrion larmoyant4 ». Plus que Marx, Keynes condamne avant tout le marxisme qui n’aurait fait que pousser jusqu’à l’absurde l’idée de cet être benthamien qui n’a pas d’autres ambitions que celle de la satisfaction de ses besoins privés, en proposant d’installer la société qui pourrait lui convenir.
Il se félicite d’avoir échappé à l’orthodoxie économique et d’avoir ainsi été « protégé de la réduction finale par l’absurde que le benthamisme a connu avec le marxisme » (Keynes, 1938-1949, p. 1825). S’il a pu jeter cet « hédonisme par la fenêtre », c’est, avant tout, grâce à « sa religion de jeunesse » (youthful religion) comme il l’explique lors de cette conférence au cours de laquelle il se remémore les années d’avant la Première guerre mondiale. Dans sa jeunesse, Keynes s’est intéressé de très près à la philosophie morale, ainsi qu’à la logique des probabilités. Les deux pouvant être associées par des questions du type : qu’est-ce qu’une bonne conduite ? Et si la conduite est réputée bonne par les effets bénéfiques qu’elle entraîne, comment peut-on prévoir ses effets ? Le calcul des probabilités peut-il être une réponse à cette question ? Si l’incertitude est totale, la bonne conduite ne pourrait-elle pas se saisir en dehors de ces effets, par un état d’esprit, par exemple, qui serait bon en soi. Mais comment reconnaître un bon état d’esprit ? Dans la communication qui fait état de ses convictions de jeunesse, Keynes rappelle les titres des deux ouvrages, publiés l’un et l’autre en 1903, qui ont marqué sa formation : les Principles of Mathematics de Russell et les Principia Ethica de Moore, « le premier fournissant la méthode pour appréhender les éléments 136fournis par le second » (Keynes, 1938-1949, p. 1818-1819). Mais, dans le texte de la conférence de 1938, il est avant tout question de l’ouvrage de Moore, de l’influence que ce personnage a exercée au sein du groupe des Apôtres et de « l’intuitionnisme », comme méthode de découverte de ce que pouvait être un « bon état d’esprit ».
Moore séduit les membres du groupe et exerce un effet libérateur de la pensée de ces jeunes esprits. Son influence « était excitante, stimulante », elle offrait « le début d’une renaissance, l’ouverture de nouveaux cieux sur une terre nouvelle, nous étions les précurseurs d’une nouvelle liberté, nous n’avions peur de rien » (Keynes, 1938-1949, p. 1816). Cependant, Keynes explique que cet engouement ne signifiait pas une adhésion à l’intégralité des Principia Ethica. Dans cet ouvrage, Moore distingue l’éthique théorique qui pose la question : « qu’est-ce que le bien ? » et une éthique pratique qui s’intéresse à « ce que nous devons faire ». C’est la partie théorique qui suscite l’enthousiasme des jeunes Apôtres, notamment, le chapitre intitulé « L’idéal ». En revanche, ceux-ci rejettent les déductions pratiques contenues dans le chapitre V, « Ethic in relation to Conduct », en particulier, la recommandation de se conformer aux règles établies.
La partie qui retient l’attention des Apôtres est celle où Moore soutient que l’appréhension du bien relève du même principe que l’appréhension des couleurs. Cela signifie que le bien n’est pas plus définissable et analysable que la couleur verte dont l’existence est avérée par le fait qu’elle est reconnue par tous lorsqu’elle se présente à la vue. Il y aurait une appréhension directe intuitive du bien qui ne passe pas par le raisonnement logique et qui pourrait seulement émerger des expériences concrètes. Les conséquences que Keynes et ses condisciples retirent de cette approche du bien s’avèrent tout à fait éloignées de celles que Moore avait en vue. Ils se sentent, pour leur part, autorisés à faire confiance à leur capacité à reconnaître le bien. La faculté de juger serait à considérer comme une sorte de sixième sens, position qu’il faudrait expérimenter en comparant des jugements sur des cas de figure précis et qui impliquerait aussi d’expliquer pourquoi ceux-ci pourraient différer d’un individu à l’autre. L’interrogation de soi-même, l’expression de ce que l’on ressent, la recherche des mots pour le dire, autrement dit introspection et communication avec les autres constituent une démarche de prospection légitime dès lors que 137la faculté de jugement est reconnue comme une capacité de découverte d’idées communes. Cela prend le contre-pied d’une vision pour laquelle la connaissance du bien ne pourrait être énoncée que par des spécialistes de la pensée morale et relèverait alors d’une aptitude intellectuelle de généralisation mobilisant le raisonnement logique. Admettre l’existence d’une faculté de jugement donne la liberté de rejeter l’obéissance à des préceptes moraux tout faits :
Nous repoussions entièrement la responsabilité d’avoir à obéir à des règles générales. Nous revendiquions le droit de juger chaque cas individuel sur ses mérites (…). Nous désavouions entièrement la morale coutumière, les conventions et la sagesse traditionnelle. Nous étions au sens strict du terme des immoralistes (Keynes, 1938-1949, p. 1816).
Moore, en revanche, en restait à une position plus traditionnelle. Dans la partie pratique de son ouvrage qui pose la question des actions à mener en vue d’accomplir le bien, il en vient à soutenir qu’il vaut mieux que l’on se conforme aux règles traditionnellement acceptées par la morale du sens commun. Keynes s’oppose donc à Moore sur cette question des règles établies et de la morale coutumière qui, selon lui, pouvaient être rejetées, tandis que l’auteur des Principia Ethica voit dans leur persistance la preuve d’une sagesse ancestrale. Aux dires de Keynes, Moore avait un pied sur le seuil du nouveau paradis, mais l’autre restait encore sous l’emprise de Sidgwick et du calcul benthamien5.
Si Keynes a été constant dans son opposition à la conception de l’être humain propre à l’orthodoxie économique, en est-il de même pour le maintien de cette idée de jeunesse le dotant l’homme d’une faculté de jugement signifiant qu’il serait en mesure de se passer de règles de conduite établies ? La question se pose dans la mesure où Keynes, lui-même, évoque des changements6.
II.2 La faculté de jugement
est-elle l’apanage du philosophe
La conférence de 1938 a été suscitée par le rappel de l’aversion que D.H. Lawrence, auteur de L’amant de Lady Chatterley, avait ressentie à 138l’égard des jeunes Apôtres – dont Keynes faisait évidemment partie – lorsqu’il les avait rencontrés. Une petite vingtaine d’années plus tard, Keynes se demande s’il y avait quelque chose de juste et de mérité dans les propos peu amènes tenus, à l’époque, par le romancier et dont il vient seulement de prendre connaissance. Lawrence les décrit comme « des scarabées enfermés dans leur carapace » et les juge « irrécupérables ». Il ne supportait pas ces « moulins à parole », sûrs d’eux-mêmes et totalement irrévérencieux envers leurs aînés.
La confiance en soi tourne facilement à l’arrogance et Keynes admet qu’elle ait pu être perçue de façon négative par l’extérieur. C’est un reproche que l’on retrouve d’ailleurs chez Russell qui, dans son autobiographie, avoue qu’il appréciait peu cette attitude de la génération des cambridgiens qui avaient une dizaine d’années de moins que lui :
La génération de Keynes et de Lytton (Strachey) n’avait nul désir de garder le moindre contact avec les philistins. Ils aspiraient bien plutôt à vivre une existence marginale, parmi les pensées nuancées et les sentiments délicats, le souverain bien consistant pour eux dans l’admiration mutuelle au sein d’un petit clan d’esprits supérieurs. En cela ils se réclamaient très injustement de G.E. Moore dont ils se prétendaient les disciples. Russell termine en les accusant d’avoir ravalé l’éthique de Moore à un sentimentalisme de petite pensionnaire (Russell, vol. 1, p. 80-81).
On retrouve le fond de la divergence des positions de Keynes et de Russell lequel admet, de fait, la représentation benthamienne de l’homme n’ayant que des besoins de consommation en considérant que les aspirations plus élevées ne peuvent relever que d’un raffinement de nantis qui n’est pas accessible au peuple. Bien au contraire, il semble que la position de Keynes soit de défendre, – si on retient la critique qu’il émet à l’égard du capitalisme –, la possibilité d’accéder à ce genre de vie pour tout le monde, autrement dit la généralisation d’un mode de « vie aristocratique » où les activités permettant de gagner sa vie n’occupent qu’une place réduite dans l’existence. Le mépris à l’égard des basses besognes, dont il faut pourtant bien s’acquitter, ne peut pas être identifié à un sentiment de supériorité vis-à-vis des personnes condamnées à consacrer tout leur temps à les exécuter. Des éléments font pencher pour cette interprétation.
Le Keynes de l’âge mûr reconnaît que les jeunes Apôtres manquaient de respect à l’égard des réalisations de leurs prédécesseurs et semble 139admettre que le rejet des règles établies ne peut pas être systématique. « Nous n’avions pas conscience que la civilisation était une mince croûte fragile érigée par la personnalité et la volonté d’un très petit nombre et seulement maintenues par les règles et les conventions habilement faites et astucieusement préservées ». Il considère désormais qu’ils étaient les derniers représentants d’une utopie croyant à un progrès moral continu « en supposant que le genre humain se compose de gens fiables, rationnels, honnêtes (…) qui peuvent être libérés sans danger des contraintes extérieures de la convention, des normes traditionnelles et des règles inflexibles » (Keynes, 1938-1949, p. 1827). Mais les années qui mènent à 1914 ont transformé cet optimisme, érodé cette confiance et rendu la légèreté irresponsable. « Nous existions dans le monde des Dialogues de Platon, et nous n’avions pas encore atteint La République et encore moins les Lois » (Keynes, 1938-1949, p. 1825).
Malgré cela, on ne peut pas considérer que le revirement de Keynes soit total. Il maintient, tout de même, l’idée d’un jugement instinctif en lui donnant toutefois un autre statut. Ce que le jeune Keynes prenait pour un savoir sur l’homme pouvant être qualifié de vérité scientifique, le Keynes de l’âge mûr lui donne un statut moins assuré en l’assimilant à une croyance. C’est pourquoi il évoque désormais sa « religion de jeunesse », terme qui aurait été inacceptable pour ces jeunes persuadés du caractère scientifique de l’intuitionnisme. Le changement de statut n’a pas conduit à l’abandon de l’idée d’un bien en soi, elle est restée, tout au long de sa vie, une conviction tenace qui a guidé ses actes et orienté ses jugements. Rétrospectivement, il lui apparaît à quel point, cette religion lui a été bénéfique. Elle lui aurait permis de ne pas adopter le calcul benthamien, d’éviter le déterminisme économique et d’échapper aux questions sans pertinence. Accorder de la crédibilité au jugement, au sien et à celui des autres, apparaît plus satisfaisant que de rechercher à découvrir derrière les paroles prononcées des explications cachées que le théoricien aurait pour tâche de mettre en évidence. En évitant le soupçon systématique jeté sur la parole humaine, « l’air était plus pur et plus agréable que celui qui circulait chez Freud et chez Marx » (Keynes, 1938-1949, p. 1822).
Cela reste toujours sa religion et il persiste dans sa position : « en ce qui me concerne, il est trop tard pour changer. Je reste et je resterai toujours un immoraliste » (Keynes, 1938-1949, p. 1826).
140Keynes n’a pas renoncé totalement à l’idée qu’il existe une sorte de jugement des actes et des situations concrètes qui pourrait être identique pour tout le monde :
Il y a une petite manifestation extraordinairement folle de cette absurde idée de l’existence d’un « normal », qui est l’impulsion de protester, d’écrire une lettre au Times, de convoquer une réunion dans le Guildhall, de souscrire à un fonds quand nos présuppositions sur ce qui est normal ne sont pas remplies. Dans ce cas-là, nous dit Keynes, je me comporte comme s’il existait réellement une autorité ou une norme à laquelle je peux faire appel si je crie assez fort et il ajoute sans véritable ironie peut-être est-ce un vestige héréditaire de la croyance en l’efficacité de la prière (Keynes, 1938-1949, p. 1828).
Le fait de s’opposer à quelque chose, d’être nombreux à manifester contre quelque chose, de s’indigner de quelque chose resterait l’indice d’un fond commun de jugement. Si l’on n’admet pas la connaissance intuitive du bien, un bon sens partagé, peut-être faudrait-il, au moins, admettre un sens commun du mal.
L’intérêt de cette position est qu’elle donne une légitimité à la contestation de l’existant et élimine la nécessité de fournir une justification d’ordre scientifique à un mouvement collectif de protestation. Le statut de la théorie économique s’en trouve tout à fait modifié. Tout porte à croire que Keynes partage la conviction de Wittgenstein7 qui considère, comme l’indique Bouveresse, que
le comportement des agents historiques n’est pas déterminé par des lois de développement dont la connaissance pourrait permettre à la fois d’expliquer les événements et de les orienter de telle ou telle façon. Selon Wittgenstein : « L’homme réagit ainsi : “Pas cela” dit-il – et il entame le combat. » (…) Si tu combats, tu combats. Si tu espères, tu espères. On peut combattre, espérer, et même croire, sans croire scientifiquement (Bouveresse, 2000, p. 69).
Un rapprochement se fait ainsi avec Arendt. Elle refuse d’occuper la place du professionnel de la pensée observant d’en haut les agitations des hommes et s’imaginant qu’il peut en déduire des connaissances sur leur comportement susceptibles de constituer un savoir scientifique rendant superflue l’attention à ce qu’ils disent et autorisant, en particulier, 141à ne pas les entendre lorsqu’ils disent non. Elle distingue l’activité de penser véritable, qui relève d’une interrogation de soi-même suscitée par ce qui vous arrive, de l’activité qui utilise les facultés mentales pour produire un savoir à transmettre à d’autres. La première n’a ni début ni fin et ne laisse rien derrière elle, la seconde est semblable à une activité de production destinée à des utilisateurs. Le penseur de métier, celui qui vit de cette activité, devrait se garder de devenir un professionnel spécialiste de la pensée s’élevant vers des hauteurs qui lui font perdre pied pour, au contraire, s’efforcer de rester sur terre dans le monde réel de ses semblables en se considérant comme un être parmi d’autres.
Arendt rejette le mythe de la caverne dans lequel Platon oppose deux catégories d’individus, ceux qui restent au royaume des ombres et n’ont que des images déformées de la vérité et ceux qui, comme le philosophe, accèdent à la lumière de la connaissance. Ce mythe imaginé par Platon va de pair avec son concept de gouvernement qui fait de la peur de l’enfer un moyen d’obtenir une bonne conduite de la part de ceux qui ne seraient pas capables de la découvrir par eux-mêmes.
Arendt rejette cette partie de l’enseignement de Platon, le Platon de La République et des Lois, elle adhère, en revanche, tout à fait au Platon des Dialogues et à celui qui fait l’Apologie de Socrate. Pour elle, Socrate, ce personnage de la vie athénienne qui n’a rien écrit, qui réfléchissait sur tous les sujets et qui parlait à tout le monde figure le commun des mortels qui s’interroge et questionne les autres sans jamais aboutir à une réponse définitive. Socrate qui s’est continuellement livré à cette activité de penser, « ne peut pas avoir cru qu’il n’y a qu’une minorité qui soit capable de penser » (Arendt, 1971, p. 205).
II.3 L’activité de penser et la faculté de juger
L’activité de penser découverte par Socrate est ce que « Platon a traduit dans la langue conceptuelle comme le discours silencieux de moi avec moi » (Arendt, 1971, p. 210). Dans l’activité de penser, on est à la fois soi et un autre soi-même à qui l’on pose des questions, une sorte « de deux en un » qui réfléchit à partir des événements ou des expériences qui traversent notre vie. Cela ne renvoie à rien d’autre qu’à « l’habitude d’examiner tout ce qui vient à se produire ou attire l’attention, sans préjuger du contenu spécifique ou des conséquences » (Arendt, 1971-1992, p. 20). Elle relève d’une expérience courante et on devrait pouvoir compter 142la voir s’exercer chez « toute personne saine d’esprit, sans considération pour son érudition ou son ignorance, son intelligence ou sa stupidité » (Arendt, 1971-1996, p. 33). Contrairement à l’activité de production du spécialiste de la pensée, elle ne dépend pas d’un potentiel intellectuel, elle n’est pas liée à des compétences acquises et n’est pas évaluable par des performances. Elle est l’activité caractéristique d’un être qui se sait indéterminé ; qui n’est pas un animal parce qu’il se pose des questions, mais qui n’est pas un Dieu parce qu’il ne dispose pas de réponses. L’activité n’aboutit à aucune connaissance pouvant se traduire par des règles de conduite applicables en toutes circonstances, elle est, au contraire, la manifestation d’un embarras face à une situation ou un événement inattendu. Loin de se solder par des certitudes, l’activité renouvelle le doute. « L’occupation de penser est comme la toile de Pénélope : elle défait chaque matin ce qu’elle a achevé la nuit précédente » (Arendt, 1971-1996, p. 37). Elle ne produit rien de concret et de tangible qui pourrait durer et se transmettre. Simultanée à l’état d’étonnement qui la déclenche, l’activité est inséparable de l’individu qui s’y adonne et ne peut donc être accomplie par procuration. « Chaque génération nouvelle, chaque homme nouveau doit redécouvrir laborieusement l’activité de penser » (Arendt, 1954-1968) qui ne laisse rien derrière elle.
Arendt met encore en garde contre une interprétation erronée supposant que l’activité de penser pourrait aboutir à façonner un personnage ayant définitivement acquis des qualités qui le destineraient à être bon. Or cette activité ne peut pas être considérée comme une sorte de formation de l’esprit qui pourrait aboutir à la sagesse. Socrate sait qu’il n’est pas sage. La pensée n’implique pas seulement de « penser par soi-même » mais aussi de « penser pour soi-même ». Arendt explique que chez Socrate, l’activité est impulsée par le besoin d’être en accord avec soi-même. Il est celui qui sait qu’une fois rentré chez lui et dans la solitude, il n’est plus la personne qui s’adressait à d’autres et pouvait dire « je », mais un inconnu pour lui-même en mesure d’émettre un jugement sur ce personnage public qu’il a été pour les autres. Sachant qu’il sera confronté à ce juge qui ne le laissera pas en paix, il évitera d’en faire un ennemi. Les deux seules propositions positives de Socrate, (« que l’on trouve dans le Gorgias écrit par Platon avant qu’il ne soit maître de l’Académie » [Arendt, 1971-1996, p. 59-60]) qui pourraient paraître une règle de vie menant à la sagesse ou un guide de conduite morale doivent être 143interprétées comme la conséquence de ce besoin. La première affirmation « Mieux vaut être traité injustement que de commettre un tort » pourrait passer pour du moralisme bon marché, mais elle signifie la même chose que la seconde : « il vaut mieux qu’une multitude d’hommes soit en désaccord avec moi, plutôt que moi, étant un, sois en disharmonie avec-moi-même et me contredise » (Arendt, 1971-1996, p. 60). La pensée ainsi comprise s’impose comme un processus d’ajustement visant la cohérence entre l’être public qui se présente aux autres comme étant quelqu’un et un être privé qui s’interroge sur la valeur des actions menées par cet autre soi-même. L’absence de pensée plonge, à l’inverse, dans l’incohérence, obligeant à une sorte de schizophrénie, un dédoublement de la personnalité devenu essentiel pour faire en sorte que l’être privé et l’être public ne se rencontrent jamais pour dialoguer entre eux. Bien que formant un tout inséparable, les deux êtres sont forcément distincts car ils se livrent alternativement à deux genres d’occupation qui ne sont pas compatibles entre elles : « tantôt je suis, tantôt je pense » comme le résume Arendt en citant Paul Valéry. Elle s’oppose ainsi à la conception de l’activité de penser chez Heidegger qui considère qu’il s’agit d’un processus d’unification de l’être. L’unité n’est pas le produit de la pensée, elle détruit, au contraire, la pensée authentique fondée sur le caractère indépassable de la dualité d’un être alternativement, unique quand il est en communication avec les autres dans la sphère publique, et sans identité déterminée lorsqu’il est seul dans la sphère privée et qu’il se livre à une activité de penser.
L’habitude de s’interroger sur ses propres actions, née du besoin d’être en accord avec soi-même, s’avère extrêmement précieuse. Elle fait surgir « la faculté de juger », c’est-à-dire « l’aptitude à discerner le bien du mal, le beau du laid » (Arendt, 1971-1996, p. 73), que « l’on peut appeler la plus politique des facultés mentales », dans les moments où cela s’avère nécessaire. En menant à rechercher un ajustement entre les expériences particulières vécues dans le présent et les opinions générales qui ont été admises dans le passé, le besoin d’être en accord avec soi-même conduit à s’attaquer aux préjugés, si bien que l’activité de penser se révèle dangereuse pour toutes les croyances :
Il est dans sa nature de défaire, dégeler si l’on veut, ce que le langage, médium de la pensée, a gelé sous formes de pensées-mot (concepts, phrases, définitions, doctrines) (…). La conséquence de cette particularité est que la pensée a inévitablement un effet minant, destructeur, sur tous les critères établis, les 144valeurs et mesures du bien et du mal ; en bref, sur ces coutumes et règles de conduite dont on traite en morale et en éthique (Arendt, 1971-1996, p. 51).
Et l’effet contestataire de la faculté de juger est à considérer comme un bienfait. En tant que sous-produit de l’activité de penser, la faculté de juger est assortie de son antidote, puisque cette activité sans cesse reprise ne mène à aucune certitude nouvelle susceptible de remplacer les valeurs contestées. Ainsi, « penser est indifféremment dangereux pour toutes les croyances et, par soi, n’en crée aucune nouvelle » (Arendt, 1971-1996, p. 54).
Le manque d’opposition face à la montée en puissance des idéologies, qui a permis qu’elles finissent par être installées comme principe de gouvernement sous les régimes totalitaires stalinien et nazi, se lit comme une conséquence de la disparition de la vie de l’esprit. On ne peut réellement comprendre l’importance de l’activité de penser qui déclenche la faculté de jugement qu’en découvrant les méfaits de sa disparition. L’arrivée des régimes totalitaires révèle que les règles se remplacent aisément et que le commandement moral « Tu ne tueras pas ton prochain » s’est retourné en son contraire : un ordre de tuer qui a été suivi sans mauvaise conscience, non pas parce que les individus sont mauvais et violents mais parce qu’ils considéraient que leur devoir était de se soumettre aux ordres venant d’en haut. Le cas Eichmann est exemplaire sur ce point. Assistant au procès d’Eichmann à Jérusalem (Arendt, 1963) elle constate que rien dans les propos de ce responsable de l’organisation du transport de la population juive vers les camps d’extermination ne peut laisser entendre qu’il était antisémite. Il a la position satisfaite de celui qui a bien fait le travail qui lui était demandé. Autrement dit dénoncer l’antisémitisme, stigmatiser les propos racistes ne constituent pas une démarche susceptible de changer sa position de soumission aux ordres qui est le problème le plus profond. L’analyse ne signifie pas, évidemment, que le racisme et l’antisémitisme ne soient pas des doctrines condamnables, mais la question qui se pose est de comprendre comment des idéologies aussi ineptes, nées dans des esprits dérangés, ont pu s’installer comme principe de gouvernement auquel toute une population a consenti. Arendt considère que le problème vient de l’extinction de l’activité de penser, c’est-à-dire de la disparition du besoin d’être en accord avec soi-même qui est, selon elle, la 145véritable cause de l’effondrement de la moralité. Mais, il faut préciser qu’elle ne conçoit pas la moralité comme un comportement consistant à accomplir de bonnes actions. Il s’agit là d’une acception religieuse de la moralité qui a transformé le dialogue mental « du deux en un » de Socrate en une écoute d’une voix de Dieu à laquelle le croyant obéit consciencieusement. L’interrogation de soi-même débouche, en revanche, sur ce que l’on peut appeler une attitude morale ou plutôt « humaine » qui consiste à s’abstenir de faire le mal. Ce qui revient, sans doute, à se conformer aux Dix commandements, mais, à cette différence près, qui est de taille, non pas parce qu’ils sont imposés mais parce que l’être pensant en proie au questionnement les réactualise sans cesse. Arendt ne pense pas que l’attitude morale puisse être obtenue en imposant des règles de conduite, fussent-elles bonnes, par la menace.
Elle distingue l’obéissance et le consentement, autrement dit le fait d’être soumis à une règle de conduite sous la pression d’une contrainte, comme la peur de l’Enfer, par exemple, ou plus généralement la peur d’une sanction et le fait de s’y conformer en toute conscience parce que l’on a intégré le bien-fondé de la règle. L’autorité et le pouvoir authentique d’un gouvernement ne peuvent provenir que du consentement de la population à suivre ce qui est donné comme loi.
On retrouve, même si c’est dit autrement, la distinction de Keynes entre la morale, ensemble de règles imposées qu’il rejette, et sa religion, une relation à soi-même où il importe de ne pas se mépriser, religion qui ne peut être admise qu’en supposant la liberté d’action. Toute science qui explique ce qu’est l’homme et prétend savoir ce qui détermine sa conduite n’aboutit-elle pas à l’idée que nous ne sommes pas responsables de nos actes, que nous ne faisons qu’obéir à une loi de la nature ou encore à une loi de l’histoire à laquelle nous ne pouvons rien changer ? Dans ce cas, ne faut-il pas remettre en cause l’ambition d’explication de cette science ?
146CONCLUSION
La faculté d’accomplir des miracles
Keynes et Arendt mettent tous deux en cause une tournure d’esprit scientifique qui conduit à éliminer une évidence, celle de l’incertitude de l’avenir, incertitude radicale8 non probabilisable, ou celle du caractère imprévisible des effets de l’action d’une multitude d’individus qui n’obéissent pas à des motifs semblables et sont tout à fait différents les uns des autres. La cohérence logique du scientifique qui saisit des relations de cause à effet est certes susceptible de décrire un processus d’évolution au cours du temps mais elle est incapable de faire état du surgissement de nouveaux commencements dont l’histoire est pourtant parsemée. La fondation de Rome, la révolution américaine, la révolution française et la révolution russe font partie de ces nouveaux départs qui marquent des ruptures dont le caractère inattendu souligne à quel point le raisonnement du scientifique peut être pris en défaut. « Chaque fois qu’il se produit quelque chose de neuf, cela fait irruption à l’improviste, d’une façon non calculable et finalement inexplicable, comme un miracle dans l’enchaînement des déroulements calculables » (Arendt, 1989, p. 184). « L’infiniment improbable » est dans la nature de l’histoire ; c’est pourquoi le terme de miracle, si l’on oublie « le rôle que le miracle a joué depuis toujours dans la foi et dans la superstition, dans le religieux et le pseudo religieux » est le seul qui puisse convenir pour éviter de l’appréhender comme un processus où tout se répète et dont le futur est prévisible. Les hommes ont la faculté de créer des miracles, c’est-à-dire la liberté de commencer quelque chose de nouveau et donc d’interrompre un processus en cours et cela ne renvoie à aucune croyance en l’existence d’un surnaturel mais constitue l’essence même de la politique.
Par conséquent, ce n’est pas du tout de la superstition, c’est même une attitude réaliste que (…) de se préparer à des miracles dans le domaine politique. Et plus la balance pèse lourdement en faveur du désastre, plus miraculeux 147apparaîtra le fait accompli librement ; car c’est le désastre, et non le salut, qui se produit toujours automatiquement et doit, par conséquent, toujours paraître inéluctable (Arendt, 1954-1968, p. 221).
Keynes a appréhendé la politique de la même façon, c’est à dire comme un moyen d’arrêter l’engrenage de la violence. Tous les efforts de persuasion qu’il a déployés à partir de 1919, moment où il a dénoncé les termes du Traité de Versailles (Keynes, 1920) qui prévoyait que les Allemands vaincus paient des réparations de guerre aux nations alliées, visent à faire intervenir les gouvernements pour qu’ils initient une rupture dans un enchaînement de rivalité entre les nations et entre les catégories sociales. Après les horreurs du totalitarisme, Arendt a cherché à faire en sorte que les hommes puissent se réconcilier avec eux-mêmes. Contre l’escalade de la vengeance, processus sans fin qui suit une catastrophe où les hommes se sont entretués, il faut bien tenter de ne pas laisser les dettes de ressentiment aux nouvelles générations. Arendt évoque le pardon, qui évidemment renvoie au message de Jésus de Nazareth, mais resterait à trouver la forme politique9 qui serait susceptible de l’initier, car le pardon ne se décrète pas, une forme politique qui compterait sur la faculté de jugement de tout un chacun et ne serait pas un montage de spécialistes imaginant des règles. Quoi qu’il en soit le découragement n’est pas de mise car il n’est pas vain d’espérer un miracle et tout-à-fait sensé de croire qu’il peut se produire.
148RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Arendt, Hannah [1953], La nature du totalitarisme. Traduction de Michelle-Irène B. de Launay, Paris, Payot, 1990.
Arendt, Hannah [1954-1968], La crise de la culture. Traduction sous la direction de Patrick Lévy, Paris, Gallimard, 1989.
Arendt, Hannah [1958], Condition de l’homme moderne, Traduction de Georges Fradier, Paris, Calmann-Lévy, 1983.
Arendt, Hannah [1963], Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal. Traduction de Anne Guérin, Paris, Gallimard, 1991.
Arendt, Hannah [1971], La vie de l’esprit. La pensée. Traduction de Lucienne Lotringer, Paris, Presses Universitaires de France, 1992.
Arendt, Hannah [1971], Considérations morales. Traduction de Marc Ducassou et Didier Maes, Paris, Payot & Rivages, 1996.
Arendt, Hannah « La politique a-t-elle encore un sens ? ». Traduction de Patrick Lévy, in Politique et pensée, colloque Hannah Arendt, Paris, Payot, 1989.
Bouveresse, Jacques [2000] Essais I. Wittgenstein, la modernité, le progrès et le déclin. Marseille, Agone.
Favereau, Olivier [1985], « L’incertain dans la “révolution keynésienne” : l’hypothèse Wittgenstein », Économies et sociétés, Série PE Histoire de la pensée économique, No 3, p. 29-72.
Favereau, Olivier [2005], « Quand les parallèles se rencontrent : Keynes et Wittgenstein, l’économie et la philosophie », Revue de métaphysique et de morale, vol. 3, No 47, p 403-427.
Hilb, Claudia [2011], Comment fonder une communauté après le crime ?, novembre, disponible HannahArendt.net.
Jobin, Hélène [2000], Les fondements philosophique de la pensée morale de Keynes. Mémoire de Sciences économiques, sous la direction de Gilles Dostaler, Université du Québec à Montréal.
Keynes, John Maynard [1920], Les conséquences économiques de la paix. Traduction de Paul Franck, Paris, Nouvelle Revue française.
Keynes, John Maynard [1924-1926], « La fin du laissez-faire », (version longue). Traduction de Thierry Demals, in La Pauvreté dans l’abondance, Paris, Gallimard, 2002, p. 55-86.
Keynes, John Maynard [1925], « Un aperçu de la Russie ». Traduction de Nicolas Postel, in La pauvreté dans l’abondance Paris, Gallimard, 2002, p. 31-54.
149Keynes, John Maynard [1931], Essais sur la monnaie et l’économie. Les cris de Cassandre. Traduction de Michel Panoff, Paris, Payot, 1978.
Keynes, John Maynard [1938], « Mes convictions de jeunesse », (publication posthume 1949). Traduction de Lyse Patsouris et Marlyse Pouchol, Économies et Sociétés, Série PE Histoire de la pensée économique, No 49, 2013, p. 1805-1811.
Lavialle, Christophe [2001], « L’épistémologie de Keynes et “l’hypothèse Wittgenstein” : la cohérence logique de la Théorie Générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie », Cahiers d’économie politique, No 38, p. 25-64.
Maris, Bernard [1999], Keynes ou l’économiste citoyen. Paris, Presses de Sciences po.
Russell, Bertrand [1935], Science et religion. Traduction de Philippe-Roger Mantoux, Paris, Gallimard, 2011.
Russell, Bertrand [1967] Autobiographie (1872-1967). Traduction de Antoinette et Michel Berveiller, vol. 1, Paris, Les Belles lettres, 2012.
Shionoya, Yuichi [1991], « Sidgwick, Moore and Keynes », in Bateman, Bradley W. & Davis John B. [1991], Keynes and Philosophy. Essays on the Origin of Keynes’s Thought, Cheltenham, Edward Elgar, p. 6-29.
1 L’auteure remercie chaleureusement les rapporteurs anonymes pour leur lecture attentive, leurs commentaires et leurs suggestions.
2 Colloque international « Économie et Religion. Sources théologiques et portée religieuse de la pensée économique du début des temps modernes à nos jours » Sciences-Po Lille, 15-16 janvier 2015.
3 Comme l’indique l’un des rapporteurs anonymes de cet article, l’origine étymologique latine n’est pas fixée. En effet, le mot peut aussi bien renvoyer au verbe religare (relier) qu’au verbe relegere (relire) et admettre d’autres interprétations.
4 Note de Michel Panoff in Keynes, 1931, p. 121.
5 Voir Yuichi Shionoya, 1991.
6 Voir Hélène Jobin, 2000.
7 Le lien Keynes/Wittgenstein a été souligné, pas forcément pour les mêmes raisons, par Olivier Favereau (1985) et (2005). Par ailleurs, Christophe Lavialle (2001) a mis en évidence ce lien pour expliquer la structure de la Théorie Générale.
8 « La théorie de Keynes est fondée sur un postulat d’incertitude radicale » Bernard Maris (1999, p. 40).
9 Voir Claudia Hilb (2011) évoquant l’Argentine en1983 et l’Afrique du Sud en 1994.