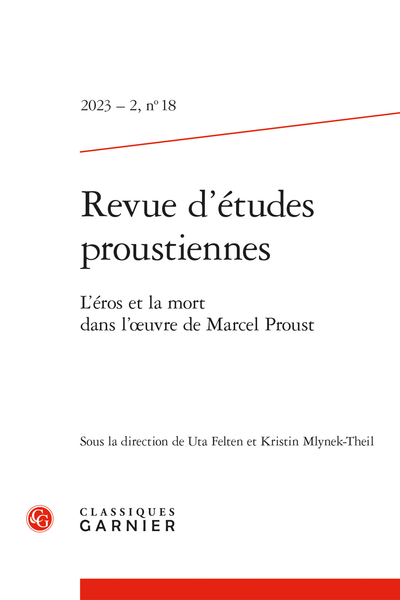
Avant-propos
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Revue d’études proustiennes
2023 – 2, n° 18. L'éros et la mort dans l'œuvre de Marcel Proust - Auteurs : Felten (Uta), Mlynek-Theil (Kristin)
- Pages : 11 à 14
- Revue : Revue d'études proustiennes
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406157908
- ISBN : 978-2-406-15790-8
- ISSN : 2430-8218
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15790-8.p.0011
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 11/10/2023
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Avant-propos
L’éros et la mort, la vulve et le tombeau sont évoqués de façon répétitive dès le premier tome de l’œuvre romanesque de Proust. Presque comme un leitmotiv, ils sont sujets à des variations et transformations et souvent mis au service des principes de sacralisation et de profanation. En témoignent, entre autres, des scènes telles que la « père-version » de la photographie du père mort dans la scène de Montjouvain, la résurrection d’Albertine dans un tableau de Carpaccio, la mort de Bergotte en lien avec la peinture de Vermeer ainsi que la mise en scène spectaculaire de la mort de la grand-mère.
Dans ce volume qui réunit les contributions du colloque « L’éros et la mort dans l’œuvre de Marcel Proust » organisé à Leipzig en novembre 2022 en hommage à Marcel Proust à l’occasion du centenaire de sa mort, nous voulons montrer que ces thèmes jouent déjà un rôle prépondérant dans les écrits de jeunesse de Proust ayant un caractère annonciateur pour les volumes suivants de la Recherche où l’éros et la mort seront étroitement liés à l’esthétique d’une écriture de la transgression, aux stratégies de la sacralisation et de la profanation et à la poétique du souvenir, aux dimensions du temps et du désir.
Pour jeter un pont entre les écrits de jeunesse et la Recherche nous allons procéder de manière plus ou moins chronologique dans la présentation des contributions, en commençant par les réflexions de Luc Fraisse qui s’inspirent de la fameuse recherche de Bernard de Fallois longtemps inédite sur Les Plaisirs et les Jours : Proust avant Proust, qui nous fait partager une vue très particulière des nouvelles connues ainsi que des récits de jeunesse jusque-là inconnus de Proust. Dans son étude « Mourir d’amour : une obsession des fictions de jeunesse », Luc Fraisse reprend des nouvelles choisies des Plaisirs et les Jours ainsi que des nouvelles écartées de l’œuvre proustienne de jeunesse qui traitent des scénarios de morts féminines et masculines pour les confronter les unes aux autres et montrer comment cet ensemble divers forme une 12« unité organique » permettant de regarder leur noyau commun, le lien établi entre l’agonie des amoureux et leur tourment, sous des angles toujours différents. Selon Luc Fraisse, ces mises en perspective laissent déjà entrevoir des réflexions qui seront également significatives pour l’œuvre future de la Recherche touchant à son essence même, l’approche du temps.
Angelika Hoffmann-Maxis se consacre elle-aussi aux Plaisirs et les Jours, en se concentrant sur la nouvelle La Mort de Baldassare Silvande qu’elle considère comme un « Prélude à une thématique de la Recherche ». Bien que le récit reprenne à première vue un topos populaire de l’époque, Angelika Hoffmann-Maxis montre qu’un regard plus approfondi révèle une trame narrative qui anticipe un concept clé de la Recherche, le discours de la mémoire : ainsi, la confrontation de Baldassare avec la mort peut être lue comme une description des mouvements de la mémoire permettant de rendre le passé présent.
Recourant d’abord à l’exemple de la nouvelle Mélancolique villégiature de Mme de Breyves, Uta Felten met en évidence le rôle de la musique wagnérienne comme filtre dans une structure triangulaire du désir entre la protagoniste et l’objet de son désir, M. de Laléande, avant de montrer comment cette structure se poursuit dans la Recherche : dans le rôle que prend la peinture de Botticelli et de Carpaccio pour la structure triangulaire du désir. C’est à l’aide des médiateurs picturaux que Swann réussira à transformer Odette en figure sacrée et que le narrateur réussira à transformer Albertine en beau garçon vénitien.
Le lien entre la musique et la peinture est également fortement mis en avant par Alessandro Zuppardo, qui s’approprie dans ses « Considérations musicales sur les Portraits de peintres de Reynaldo Hahn » une technique associative et orientée vers la pratique. Il nous montre les interactions entre la littérature, les tableaux des peintres flamands et la musique, en mettant en perspective les Portraits de peintres tirés des Portraits de peintres et de musiciens avec leur transposition musicale dans le salon de Mme Lemaire, et donc aussi avec les proportions de la relation entre Proust et Reynaldo Hahn.
Françoise Leriche se consacre à une expression retrouvée dans une lettre que Proust a écrite à Lucien Daudet – « Je suis très amoureux de blanchisseuses » – dont elle retrace les inflexions depuis Jean Santeuil jusqu’à la Recherche. Elle montre ainsi que l’imaginaire aquatique est 13très tôt lié non seulement aux connotations érotiques de l’amour lesbien, mais aussi au thème de Thanatos, et qu’il y développe également une signification pour la naissance du roman.
C’est Winfried Wehle qui nous emmène à une promenade philosophique au Bois de Boulogne, lieu d’un parricide qui a déjà des précédents. À partir d’une analyse de la citation de Michel-Ange, Winfried Wehle montre que le parricide de Proust à l’égard de Michelet, qui suit ici le parricide de Ruskin ou encore de Mallarmé, n’a pas une fin en soi, mais montre un itinéraire : celui de Proust vers sa propre théorie poétologique, vers sa propre œuvre d’art, qui se révèle être une allitération perpétuelle ; une allitération qui permet de tisser un tissu secondaire, un « univers mouvant », qui offre au lecteur un tel espace mouvant pour créer sa propre œuvre d’art.
Dans son étude « L’éros, la mort et l’oubli, stratégies intermédiales pour Albertine », Cécile Leblanc apporte un éclairage nouveau sur la mention de l’opéra Manon dans le tome Albertine disparue et montre comment le rapport entre l’éros et la mort peut être repensé à la lumière de la mort accidentelle d’Albertine. La manière dont Proust aborde cette thématique peut être conçue, selon Cécile Leblanc, comme le point de départ d’un changement épistémologique qui se fait également sentir dans le domaine de la musique, où la femme ne constitue plus seulement la victime tragique d’une mort amoureuse.
Kristin Mlynek-Theil porte son attention sur la relation entre le protagoniste de la Recherche et Albertine, afin de retracer les liens entre l’éros et la mort au niveau de leur communication réalisée par téléphone, lettre ou télégramme. En contraste avec le comportement communicatif d’un autre couple d’amoureux, Cécile et Robert du roman Cécile de Theodor Fontane, elle montre dans quelle mesure la communication amoureuse est minée justement par les efforts de la rendre plus explicite et comment la mort accidentelle d’Albertine acquiert une dimension poétologique en incitant à une nouvelle communication qui reste à jamais en suspens.
La contribution d’Anne-Marie Lachmund nous donne un aperçu des discours qui ont pris pied dans le monde de la communication analogique et digitale face au culte proustien. Au vu d’une avalanche de réactions sur le net à l’occasion du centenaire de la mort de Proust, elle suit la réception de Proust dans la littérature actuelle (comme Proust 14ist mein Leben, doch es langweilt mich sehr de Christian Rottler ou Clara lit Proust de Stéphane Carlier) ainsi que dans le monde numérique, où non seulement les expériences de lecture sont partagées, mais où même des profils fictifs digitaux de Proust sont créés, où toute une « galaxie proustienne infiniment explorable » se dessine, montrant à quel point le monde proustien s’est diversifié.
Une autre forme de diversité émerge aussi dans les réflexions de Toni Ricco Sehler qui relit des scènes clés de la Recherche, consacrées à la relation du protagoniste avec sa mère et avec Charlus, dans une perspective de la Queer Theory esquissée par Teresa De Lauretis soulignant la valence queer sous-jacente de la plante de vanille pour le discours du désir. Ainsi, il révèle à quel point des structures non binaires de la sexualité, du désir et du genre se cachent déjà dans ces scènes clés et contrecarrent les interprétations traditionnelles.
Le spectre des analyses à propos des variantes des sujets de l’éros et de la mort, de la sacralisation et de la profanation dans l’œuvre de Proust nous fait voir que ceux-ci ne déploient pas seulement leur signification pour le travail de Proust s’ils sont considérés individuellement, mais que c’est justement leur interaction qui produit la dynamique de l’œuvre, l’œuvre elle-même. L’éros et la mort deviennent ainsi les générateurs d’une écriture qui oscille constamment entre le besoin de révéler, de savoir et l’aporie de ce savoir, nous incitant à sonder les espaces entre les deux, les espaces entre l’amour et la souffrance, le désir et la jalousie, la mort et la vie, le temps perdu et le temps retrouvé.
Uta Felten
et Kristin Mlynek-Theil