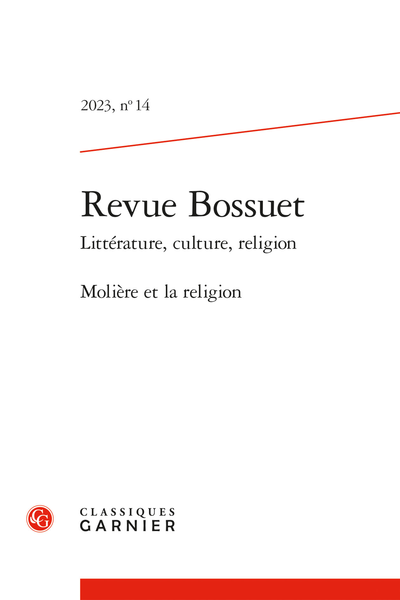
Comptes rendus
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Revue Bossuet
2023, n° 14. Molière et la religion - Auteurs : Pelleton (Nicolas), Van Hamme (Clément)
- Pages : 231 à 236
- Revue : Revue Bossuet
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406164951
- ISBN : 978-2-406-16495-1
- ISSN : 2494-5102
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16495-1.p.0231
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 31/01/2024
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
Arnaud Odier, Bossuet, la voix du Grand Siècle, éditions du Cerf, coll. « Littérature », Paris, 2017, 192 p.
Depuis quelques années, plusieurs ouvrages sur Bossuet destinés à un large public sont parus. Nous avions déjà rendu compte des volumes de Renaud Silly, respectivement publiés en 2017 chez Robert Laffont pour l’un, et en 2020 aux Belles-Lettres pour l’autre (voir notre compte rendu et celui de Clément Van Hamme, Revue Bossuet, no 12, 2021, p. 185-192). En 2017, deux biographies de Bossuet sont parues, l’une de Joël Schmidt (voir le compte rendu suivant), et l’autre d’Arnaud Odier, publiée aux éditions du Cerf. Le titre complet de ce second ouvrage, Bossuet, la voix du Grand Siècle, reprend d’emblée l’idée du caractère emblématique pour la compréhension du xviie siècle de la vie, la pensée et les œuvres de l’évêque de Meaux. La longue citation placée en épigraphe, une vingtaine de lignées tirée des Pensées de Joubert (p. 7), reprend et développe un commentaire de cette même idée fondamentale ; ce passage présente l’intérêt de proposer une vision synthétique du style, de la pensée et du caractère de Bossuet, sans toutefois tomber dans le cliché qui consisterait à faire de lui un homme sans nuances.
La biographie s’ouvre sur un préambule, qui situe brièvement l’homme dans son contexte géographique et social : « Selon toute vraisemblance, Bossuet ne vit jamais la mer. Son existence tout entière tint dans une portion du royaume de France dont Dijon, Metz et Versailles marquent les limites. » (p. 9) Le préambule n’en oublie pas moins la dimension universelle et humaniste de l’action et de œuvres de M. de Meaux, et en envisage la postérité à partir de l’essai que Valéry lui consacra, mais avec lequel Arnaud Odier prend une distance critique. La biographie, en elle-même assez courte, est divisée en treize sections, non numérotées. Celles-ci font état des origines, de la formation et du parcours de Bossuet. Sa production n’est pas réduite à ses seules œuvres oratoires : le biographe fait notamment état de ses textes de controversiste (p. 36-49), d’historien et de pédagogue (p. 62-77), de théologien et de directeur spirituel (p. 98-106).
232En annexe, Arnaud Odier propose trois ensembles de documents, instructifs pour le néophyte qui cherche des compléments d’informations sur certaines notions fondamentales d’histoire religieuse en France au Grand Siècle. Le premier ensemble de documents concerne la compagnie du Saint-Sacrement, le deuxième porte sur l’éducation du Dauphin, le troisième s’intéresse au gallicanisme, et le quatrième présente la querelle du quiétisme.
La biographie d’Arnaud Odier a le mérite d’être à la fois claire et synthétique pour qui voudrait être initié aux différents aspects d’un prélat qui « résume la France classique. » (quatrième de couverture).
Nicolas Pelleton
*
* *
Joël Schmidt, Bossuet, Salvator, Paris, 2017, 294 p.
En 2017, la même année où Arnaud Odier a fait paraître sa biographie de Bossuet aux éditions du Cerf (voir le compte rendu précédent), et où Renaud Silly a édité chez Robert Laffont ses deux volumes d’œuvres devenues peu accessibles de l’Aigle de Meaux (voir notre compte rendu et celui de Clément Van Hamme, Revue Bossuet, no 12, 2021, p. 185-192), l’historien Joël Schmidt a proposé aux éditions Salvator sa propre biographie, simplement intitulée Bossuet. On peut donc se réjouir de ces publications, qui contribuent à une meilleure connaissance du prédicateur auprès d’un large public.
L’avant-propos introduit l’ouvrage par un certain nombre d’informations d’ordre général. La biographie en elle-même est organisée en dix-neuf chapitres qui, comme dans la biographie écrite par Arnaud Odier, présente le parcours de l’Aigle de Meaux, de ses origines bourguignonnes à sa mort, sans négliger sa formation ni les différents aspects de ses œuvres et de son action, que ce soient les œuvres oratoires (chapitres, iv, v, vii, xiii), la pédagogie et l’histoire (chapitres viii), les controverses 233(chapitres iii, ix, x, xvii, xviii). L’évolution des relations de Bossuet avec les protestants est largement évoquée (chapitres iii, ix, xiv, xv, xvi). Quant à la querelle du quiétisme, elle est présentée de façon plus succincte (chapitre xvii). Chemin faisant, l’ouvrage de Joël Schmidt donne à lire un grand nombre d’extraits de textes, de Bossuet comme de ses contemporains, et permet ainsi au lecteur curieux de découvrir de façon plus concrète la pensée et l’histoire religieuses du xviie siècle. Joël Schmidt présente en fin d’ouvrage une bibliographie commentée.
La biographie de Joël Schmidt aborde le parcours de Bossuet avec clarté et détails. Les qualités de cette étude (comme les qualités de celle d’Arnaud Odier) sont destinées à mieux faire connaître l’Aigle de Meaux auprès d’un large public.
Nicolas Pelleton
*
* *
« Je ne vois qu ’ infini ». Littérature et théologie à l ’ âge classique. Mélanges en l ’ honneur de Gérard Ferreyrolles, éd. Constance Cagnat-Debœuf, Laurence Plazenet et Anne Régent-Susini, Paris, Honoré Champion, 2022, « Colloques, congrès et conférences sur le Classicisme » (24), 701 p.
Si un lecteur habitué des recueils de Mélangesfeuillette rapidement ce volume, il estimera peut-être au premier regard qu’il respecte, au même titre que tous les autres, les conventions de cette pratique éditoriale chère au monde universitaire. Qu’il se tienne sur ses gardes : les apparences sont parfois trompeuses. Les études inédites regroupées dans ces pages par Constance Cagnat-Debœuf, Laurence Plazenet et Anne-Régent Susini, précédées d’un portrait, d’un avant-propos, d’une chronologie biographique et d’une bibliographie chronologique, suivies d’une table des matières et 234d’une tabula gratulatoria, sont un bel hommage rendu à la carrière et à l’œuvre de Gérard Ferreyrolles par trente-neuf de ses amis, qui furent un temps ses collègues, ses étudiants et aussi ses maîtres. Il est sans doute superflu de présenter le dédicataire de ce livre aux amis de Bossuet, dont il fut le président pendant quatorze ans (2001-2015), comme aux fidèles de la Revue Bossuet, fondée par lui en 2010 à partir du Bulletin annuel de l’association, qu’il dirigea dès 2004 et jusqu’à la parution, en 2015, du premier des numéros de la revueaccueillis par les Classiques Garnier. Ce recueil est un heureux prolongement du florilège d’articles de Gérard Ferreyrolles lui-même, publié en 2020 chez Honoré Champion sous le titre De Pascal à Bossuet et récompensé par l’Académie française (voir le compte rendu de Laurent Thirouin dans la Revue Bossuet, no 12, 2021, p. 192-197). Tous ceux qui, comme les contributeurs de ces Mélanges, ont eu la chance de lire ses travaux, de suivre ses enseignements, de travailler sous sa direction ou de collaborer avec lui, constateront en effet que les domaines de recherche qu’il a explorés et enrichis, voire initiés, inspirent presque la totalité des textes réunis.
Le plan de l’ouvrage le montre bien et suggère, grâce au soin particulier avec lequel il a été élaboré, une première originalité dans l’approche de l’exercice. Blaise Pascal occupe avec juste raison une majeure partie du volume, mais il tient surtout une place de choix dans le cœurlittéral et figuré que constitue la troisième des cinq parties (« Pascal et l’univers des Pensées », douze articles). Rien de plus approprié à l’intention de l’un des herméneutes les plus assidus de l’œuvre pascalienne et d’un éditeur réputé des Pensées et des Provinciales. Enveloppe naturelle de ce cœur pascalien, le thème plus général de la spiritualité se déploie, au-deçà et au-delà, dans deux directions complémentaires. La deuxième partie, en amont, l’appréhende dans son rapport avec l’éloquence sacrée et plus particulièrement sa source essentielle, la Bible (« Spiritualité : Bible et littérature », sept articles). En aval, la quatrième partie analyse plusieurs conséquences qui découlent, au sein de la morale et de la politique, des interférences de l’esprit avec les réalités terrestres (« Spiritualité : morales du monde », neuf articles). À chaque extrémité de cet ensemble central, enfin, fiction et vérité se reflètent l’une dans l’autre : aux grandes œuvres fictionnelles du xviie siècle de la première partie (« Fictions de l’âge classique », six articles) répondent, dans la cinquième et dernière partie, les figures bien réelles du monastère de Port-Royal (« Au plus près de la vérité : Port-Royal », cinq articles).
235Cet ensemble d’études offertes que l’on pourrait d’abord croire conventionnel séduit donc singulièrement par son organisation, reflet mimétique et symbolique de la cohérente diversité tant thématique que générique des objets étudiés tout au long de sa carrière par Gérard Ferreyrolles. Au-delà de la variété des thèmes et des genres convoqués, cette singularité se retrouve dans la très grande largeur de l’empan chronologique couvert par les contributions. Loin de se cantonner à l’âge classique annoncé en sous-titre, elles déjouent en bien des endroits les attentes du lecteur attiré de prime abord par Pascal, Bossuet, Fénelon, Molière, Madame de Lafayette, Madeleine de Scudéry, Antoine Arnauld ou encore les abbesses de Port-Royal. Les figures royales de la littérature médiévale (xiie-xiiie siècle) l’attendent au détour du volume, où elles côtoient Michel Houellebecq, lecteur attentif des Pensées ; Pascal rassemble autour de lui tout à la fois Montaigne, Claude Yvon (1714-1789) et Henri-Frédéric Amiel (1821-1881) ; les humanistes du xvie siècle, quant à eux, précèdent Rousseau tout en suivant Cioran. Le titre lui-même du recueil, « Je ne vois qu’infini », en dépit des apparences là encore, n’est à pas chercher textuellement chez Pascal, encore moins chez Bossuet, mais dans les Fleurs du Mal de Baudelaire, dont le « Gouffre » (cii) condense en ces termes une formule similaire de la Lettre pour porter à chercher Dieu (« Je ne vois que des infinités », Pensées, éd. Sellier, § 681). Ces Mélanges rendent ainsi hommage à la personnalité fédératrice de Gérard Ferreyrolles. En dehors de ses travaux, jamais tout à fait enfermés eux-mêmes dans les bornes strictes d’une seule compétence, il s’est fait l’artisan de dialogues féconds et bienveillants entre les siècles, entre les disciplines et entre les générations de chercheurs, à l’image de son séminaire de Sorbonne. Il y donnait régulièrement la parole chaque vendredi à des invités extérieurs ou à des étudiants en fin de master et en début de thèse. L’étude des moralistes classiques, des Mémoires, du genre épistolaire, des rapports entre Bible et littérature au xviie siècle ou encore des Provinciales est redevable à ce rendez-vous hebdomadaire qui a duré près de vingt ans. On lira avec joie ici le résultat de quelques-unes de ses séances : celles de Denis Kambouchner sur La Rochefoucauld, celles de Dominique Millet-Gérard sur Ménochius ou encore celles d’Hélène Michon sur la notion de vanité. Cet art particulier du dialogue entre les chercheurs, « poli à la manière du Grand Siècle » (p. 8) et si essentiel à la production du savoir, est particulièrement honoré dans ces Mélanges : Pierre Force met par exemple en perspective la discussion nourrie par Gérard 236Ferreyrolles, Laurent Thirouin et Christian Lazzeri sur la question de la loi naturelle chez Pascal, autour du fragment 94 des Pensées (éd. Sellier). Toutes les générations de chercheurs entrent en dialogue dans ces pages, jusqu’aux regrettés Jacques Le Brun et Jean Mesnard. Le premier, dans un article posthume, tire des conclusions de la redécouverte d’un exemplaire de 1746 des lettres de Bossuet à Madame Cornuau, disparu depuis 1850 ; le second, convoqué sous la plume vivante de Laurence Plazenet, invente une archive mystérieuse relative à l’entourage de Port-Royal, contenant des informations de premier ordre dont on ne gâchera pas ici au lecteur la stupéfiante découverte.
Nous disions plus haut que le plan de l’ouvrage fait se refléter fiction et vérité l’une dans l’autre. Sans donner prématurément le nom des coupables, comme dans les bons romans policiers (eux aussi mis à l’honneur), et surtout pour ne pas trahir les effets ménagés tant par les éditrices que par certains des contributeurs, on se contentera pour terminer de relayer l’appel de l’avant-propos à « un peu de prudence dans l’appréciation du contenu » (p. 9) de quelques-unes des contributions rassemblées. Peut-être certaines ont-elles déjà été citées. La fiction s’y insinue, parfois de manière assumée, parfois sous l’aspect de la plus grande rigueur scientifique, dans des proportions souvent peu évidentes à évaluer mais toujours plaisantes à supposer. Ici, un père jésuite déchiffre les oracles du perroquet « qui essuie son bec quoiqu’il soit net » (Pascal, Pensées, éd. Sellier, § 139) ; là, Marguerite Périer, au soir de sa vie, confesse entre les lignes au père Guerrier que Descartes, Paracelse et un chat blanc ne seraient pas étrangers au miracle de la Sainte-Épine. Ailleurs, d’autres surprises attendent le lecteur. Chaque fois, l’imagination projette une lumière biaisée paradoxalement éclairante sur des zones d’ombre de l’histoire : elles ne perdent rien de leur mystère tout en étant plaisamment mises en valeur. Ce livre se présente, sur sa quatrième de couverture, comme une « extension du plaisir de lire ». On ira plus loin en disant qu’il ménage plaisir de lire et de faire lire – plaisirs également chers à Gérard Ferreyrolles et trop souvent relégués au second plan des publications scientifiques. Pari gagné !
Clément Van Hamme