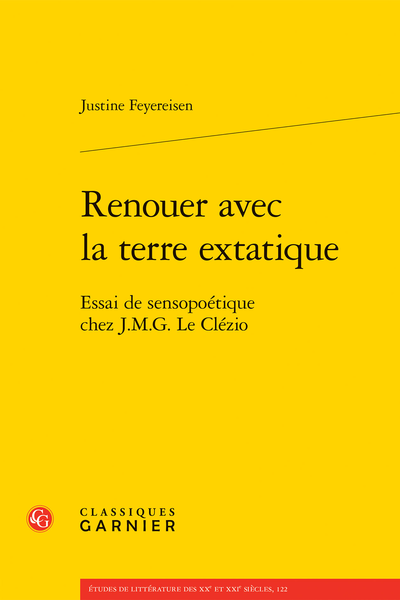
Prélude
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Renouer avec la terre extatique. Essai de sensopoétique chez J.M.G. Le Clézio
- Pages : 13 à 15
- Collection : Études de littérature des xxe et xxie siècles, n° 122
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406165231
- ISBN : 978-2-406-16523-1
- ISSN : 2260-7498
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16523-1.p.0013
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 27/03/2024
- Langue : Français
Prélude
Il faut parfois avoir le courage de tordre la langue pour rendre compte de réalités ou de gestes qui débordent les cadres de pensée habituels. C’est ce que fait Justine Feyereisen lorsqu’elle invite à relire l’œuvre de Le Clézio sous l’angle d’une « sensopoétique » : une poétique qui propose des mondes autres et d’autres façons d’être au monde via la polyphonie des sens. Tout le long de cette étude, elle jouera donc sur la corde sensible. Mais par « sensible », il ne faut pas entendre ici une sensibilité – que l’Occident moderne relègue dans la pénombre suspecte de l’intime et du subjectif – mais le mouvement commun du senti et du sentant, un mouvement d’« extase matérielle » où chair du monde et chair des corps s’enchevêtrent au point de rendre caduques les distinctions instituées par le logocentrisme (matière/esprit, nature/culture, etc.) ; cette rationalité abstraite et instrumentale qui s’arroge le monopole de la vérité et de l’intelligence.
Dans Haï (1971), un essai que l’autrice cite, Le Clézio tire cet enseignement de son expérience chez les Embaras du Panama : « Le monde n’est pas muet, n’est pas aveugle. Il a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des mains pour palper. Il a des voix pour parler, des voix qui chantent les noms et les verbes. C’est cela […] qu’il faudrait que nous sachions un jour, parce que c’est sans doute la seule vérité imaginable : le monde est, tout entier, sans exception, intelligent. » (p. 114). Ainsi, dans les cosmovisions amérindiennes, l’intelligence ne se réduit pas à une faculté humaine, elle se déploie dans la sensorialité du monde lui-même et en manifeste la divinité. C’est ce « fil rouge de la sensorialité » que Justine Feyereisen s’attache à suivre pour mettre au jour des motifs et procédés qui traversent l’ensemble de l’œuvre de Le Clézio. Une « œuvre construite comme une toile attentive à la vibration » nous prévient-elle. Elle fait ainsi un usage judicieux de la figure de l’araignée pour mettre en lumière la dimension vibratoire de la sensorialité. En effet, la toile comme le poème peuvent mettre en 14relation les éléments les plus éloignés qui soient, et cela juste par des effets de résonance. Ces vibrations sensorielles sont donc une des formes possibles que peut emprunter une sensopoétique. Jakob von Uexküll, le fondateur de l’éthologie au début du xxe siècle, recourait déjà à la figure de la toile d’araignée pour penser le vivant (qu’il s’agisse d’une tique ou d’un humain) comme un rayonnement, comme le déploiement de rayons perceptifs : « Tout sujet tisse des relations comme autant de fils d’araignée avec certaines caractéristiques des choses, et les entrelace pour faire un réseau qui porte son existence1. ». D’où le paradoxe que souligne l’autrice de l’usage des sens dans l’écriture de Le Clézio : des outils « dé-scriptifs » qui permettent de faire trembler, de déconstruire le tracé d’objets et d’un monde nous faisant face (comme un décor, un fond d’écran) pour mieux nous « réinscrire » dans un milieu ; un Umwelt dirait Jakob von Uexküll. La description apparaît ainsi comme le déchiffrement de notre appartenance au monde et de l’entrelacs des existences qui en assurent la trame.
La sensopoétique à laquelle appelle Justine Feyereisen procède aussi d’un rendre sensible qui comporte une dimension politique en ce qu’elle vise à court-circuiter l’anesthésie générale que suscite, entre autres, le déluge d’informations auquel nous sommes soumis. Il faut rappeler que la nécessité vitale de l’écriture chez Le Clézio s’enracine dans l’expérience traumatisante, enfant, de la déflagration des bombes, de la dévastation de la guerre. D’où « son incapacité à considérer la guerre – toute guerre – autrement que du point de vue des enfants qui la subissent ».
Je ne pense à rien. Je suis tout entier dans mon cri. C’est un cri si strident que j’ai l’impression, en essayant de m’en souvenir, qu’il ne sort pas de ma gorge. Il sort du monde entier. Il confond avec le bruit de la détonation qui enfonce mes tympans. Il fait un avec mon corps. C’est un corps qui crie, pas ma gorge. Je n’ai pas choisi ce cri. Je n’ai pas choisi cet instant. C’est cela la guerre pour un enfant. Il n’a rien choisi. (L’Extase matérielle, p. 66)
Justine Feyereisen pointe avec justesse le fait que Le Clézio se positionne moins comme un auteur que comme un témoin. En effet, il dissémine cette figure « aux quatre vents de la fiction » afin de faire entendre les voix les plus inaudibles. Il en ressort une polyphonie qui fait droit non 15seulement à l’altérité mais aussi à la vision des opprimés. Les trajectoires des vies minorisées ne peuvent prendre que la forme d’une fugue, de variations en mode mineur – goût de Le Clézio pour l’art de la fugue de Bach. Un des aspects les plus remarquables du travail de l’autrice réside sans doute dans sa « rythmanalyse » : l’analyse de la façon dont s’articule dans l’œuvre de Le Clézio (en particulier dans Le Procès-verbal, Révolutions, Ritournelle de la faim), par un travail sur le rythme, l’éthique, le poétique et le politique.
Dénètem Touam Bona
1 Uexküll, Jakob von, Milieu animal et milieu humain [1934], Paris, Rivages, 2010, p. 48. Auteur qui a eu une grande influence sur la phénoménologie, une des sources d’inspiration de Le Clézio.