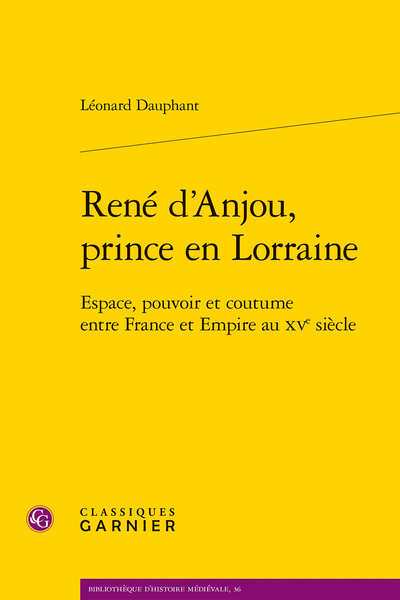
Table des matières
- Publication type: Book chapter
- Book: René d'Anjou, prince en Lorraine. Espace, pouvoir et coutume entre France et Empire au xve siècle
- Pages: 737 to 744
- Collection: Library of Medieval History, n° 36
- CLIL theme: 3386 -- HISTOIRE -- Moyen Age
- EAN: 9782406159919
- ISBN: 978-2-406-15991-9
- ISSN: 2264-4261
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-15991-9.p.0737
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 02-07-2024
- Language: French
Table des matières
Abréviations 7
Introduction
« Par le dehu de princerie et noblesse » 9
« Scrouter les papiers »
Les archives ducales de Lorraine et Barrois 35
Formation et démantèlement des archives
d’une union dynastique 38
Le trésor des chartes de Nancy vers 1632 38
Enjeux des archives et dispersion 40
Désordres et pertes 43
Les métadonnées pour une approche globale
des archives dispersées 46
Esquisse d’approche quantitative des archives lorraines 49
Esquisse d’approche typologique des archives lorraines :
aveux et dénombrements 54
Une production archivistique : les quittances
et obligations 57
L’organisation des archives sous les Angevins 60
Le trésor de Bar-le-Duc 60
La mémoire des Lorrains 66
Le trésor de Nancy 68
Copies et usage des documents 73
De la mémoire des droits à l’historique du conflit,
un dossier de travail : Châtel-sur-Moselle, 1467 79
Ce que masque la dispersion des archives,
et ce que nous apprend son histoire 83
La sélection des archives par le pouvoir ducal 83
Accès aux fonds. Les historiens du xixe siècle
n’ont pas eu accès à tous les originaux 86
Dispersion des fonds : les officiers lorrains
et le « mythe du désintérêt » 87
Dispersion des pièces : la mise en scène du principat
de René II, invisible dans les fonds 89
Destruction sélective des documents :
la disparition des acquits 91
Transferts sélectifs de documents de Bar à Nancy :
oublier la logique des dénombrements 93
Conclusion 94
« En temoignage de veritei »
L’écrit angevin en Lorraine 97
La forme des documents : style et langue, apprêt, autorité 100
Les styles 100
Les langues 101
Apprêt : la charte angevine comme œuvre d’art 109
Une typologie documentaire ducale ? 110
Rouge, jaune, vert : couleur de cire et mimétisme royal 111
L’évolution de la diplomatique angevine 117
1424-1434 : la charte angevine prend pied en Lorraine 117
1434-1442 : la diplomatique complexe d’un État royal composite 120
L’évolution du mandement 121
Les innovations de 1444 123
1445-1473, une stabilité des usages ? 125
Construire l’autorité de l’écrit ducal 127
La rhétorique de l’acte ducal 132
Le milieu d’écriture ducal 134
À la recherche d’un chancelier (et de la chancellerie) 134
Gouverner sans chancellerie ? 143
Le poids de la plume et de l’épée 147
Le pouvoir des secrétaires 151
Les secrétaires au travail sous René d’Anjou 155
739Les secrétaires au travail sous René II 160
Contrôle et hiérarchie des secrétaires 164
La fabrique de l’écrit : commandes administratives
et suppliques 167
Fixer la mémoire des actes : l’enregistrement 174
L’enregistrement dans les États angevins 174
Sous René d’Anjou, registres de la chambre de Bar
et cahiers de l’hôtel ? 178
Sous René II, registres de l’hôtel et registres
de la chambre ? 182
État-mosaïque et lacunes dans la conservation 184
Le dépôt des actes et des cahiers de registre 187
Conclusion 189
« De bien en mieux »
Servir le prince d’une monarchie composite 191
Introduction 192
Les conseillers des Angevins en Lorraine 195
Cerner le conseil par les mentions de commandement 195
Conseillers lorrains et barrois 200
Les conseillers en 1435-1436 202
Les conseillers en 1436-1440 206
Cartographier le conseil 212
La hiérarchie sociale du conseil 213
Les conseils au travail 218
Jours de conseil 218
Un pays, deux duchés, trois conseils 220
Le conseil de Lorraine en l’absence du prince 223
L’hôtel du duc de Bar et la « Seigneurie »
du duché de Lorraine 227
La Seigneurie : une population 228
La participation politique des lignages 230
Reconstituer l’hôtel du duc de Bar 232
Un hôtel pour unir les États angevins ? 235
Hôtel et gouvernement en Barrois 238
« De bien en mieux » : un idéal du service 239
740Le personnel politique angevin en Lorraine 243
Pour une histoire du conseil angevin 245
Les premières années : le temps des barons (1424-1437) 246
Puissance et chute des gouverneurs (1437-1439) 250
Le temps des réformateurs (1441-1446) 254
Après les réformateurs : le temps des Haraucourt 256
Les conseillers lorrains et la monarchie angevine 259
Présence d’Angevins au conseil du roi de France 260
Les relations entre les conseils angevins en 1475-1479 261
La présence des Lorrains en Provence 264
Faire carrière dans les autres territoires angevins 269
L’État-mosaïque en crise : 1470-1483 271
Nicolas, otage de ses conseillers ? (1471-1473) 273
La Lorraine de René II, refuge des derniers Angevins
(1480-1486) 276
Conclusion 284
Justice et « custume de pays » 285
Une souveraineté à géométrie variable 287
La « modestie du pouvoir » ducal ?
Les droits seigneuriaux de René d’Anjou 288
L’essor de la rhétorique souveraine 294
La rhétorique royale sous René II 299
René II et la monarchie lorraine 302
Grâce souveraine, grâce négociée :
un corpus des rémissions lorraines 313
Un corpus 313
Rémissions hybrides et routine de la grâce 316
Justice ducale et « anciennes coustumes et usaiges » 322
L’architecture juridictionnelle 323
Le recours à l’empereur 325
La Lorraine romane et les Assises de la chevalerie 330
Sources princières et justices seigneuriales 336
Permanence des formes et des ressorts 339
L’arbitrage : se soumettre pour rester libre 343
741Constituer un corpus : 101 arbitrages 344
Variété des formes d’arbitrage 346
Rites et mots de l’arbitrage 350
La place du duc dans l’arbitrage lorrain 353
Conclusion 363
Aimer, haïr, trahir
L’État, la violence et l’honneur 367
« Selond la loy de noblesse » : l’amour, la ruse et le serment 370
Cynisme, ruse et infamie : la Lorraine et ses traîtres 370
Diffamer le prince ? 375
Les Lorrains croyaient-ils en leurs coutumes ? 378
« Un prince aymé en un pays, on luy faict tout plaisir » 382
Serment et administration 388
L’amour du prince pour ses sujets 391
Vivre ensemble en Empire.
Formes de violence et de réconciliation 396
Otages et abstention :
les sûretés personnelles ont la vie dure 397
Les bourgfrides : la co-seigneurie au secours du prince ? 400
Journées de marche et prises de gages :
des vaches et des palabres 409
Privée, couverte, noble… les visages de la guerre en Lorraine 415
Le prince et la faide 415
Le droit de la guerre et les lettres de défi 422
Coutume et limitation de la violence 429
Petite guerre et « guerre sous le chaperon » 434
Conclusion 437
Prendre et donner
Les finances des États lorrains et de la monarchie angevine 441
La Lorraine dans les finances angevines 443
Étudier les finances lorraines 443
Crise, endettement et reconstruction 447
Comparer les pays angevins 450
« Un beau pays d’eaue salée » : la richesse du Saulnois 455
742Le profit des salines 455
Portrait du duc en marchand saunier 461
Contrebande et répression 464
Engagements et emprunts 467
La coutume de l’engagement du domaine 467
Le gouvernement de la dette 471
La pratique des gagières : les engagistes
des années 1439-1445 474
Négocier l’impôt direct 477
L’impôt direct en Barrois 477
Taxer les conduits des prévôtés 482
La négociation fiscale 486
Lever les aides dans tout le pays 490
Le cas des terres d’Église 492
Le cas des seigneurs laïcs 496
Le sens de l’impôt lorrain 500
Conclusion 504
« Bons Loherains », Messins et « Calabrois »
Le projet angevin et les identités régionales 507
L’unité en question 509
La monarchie angevine 509
Lorraine et Barrois : croire en l’union des duchés 514
Service multiple et État princier 519
Les sires du Westrich 521
Les frontières de l’Alsace 525
Les frontières sociales et partisanes de la Lorraine 528
Fidèle ou « perplex », le duc de Lorraine et ses voisins 532
Le duc de Lorraine, prince français périphérique 532
Les officiers lorrains entre le duc et le roi 536
Relations avec la principauté bourguignonne 540
L’influence bourguignonne (1445-1473) :
le mitage régional 543
L’influence bourguignonne (1445-1473) :
de l’attraction à la conquête 546
La princerie lorraine, un espace politique en Empire 551
743Le duc et marquis, prince en Lorraine 552
Penser l’espace en Empire : fragmentation et articulation 558
Co-spatialité du spirituel et du temporel 562
Un espace politique inclusif 563
La conscience territoriale en Empire 564
Metz – Nancy : voisinage et rivalité en Lorraine 570
Confrontation et mémoires conflictuelles 572
Une ville normale ? 578
Voisinage, contentieux et accommodements 584
Deux sociétés politiques séparées ? 589
Conclusion 593
Conclusion générale 597
Remerciements 609
Annexe I
Équivalences monétaires 611
Annexe II
Les officiers supérieurs
des duchés de Bar et de Lorraine (1424-1473) 615
Annexe III
Les hôtels angevins 629
Annexe IV
Les conseillers dans les mentions
de commandement de 250 chartes angevines 641
Annexe V
Les seigneurs de Lorraine 645
Sources et outils 647
Bibliographie 661
Index des noms de personnes 707
744Index des noms de lieux 721
Table des tableaux 733
Table des cartes 735