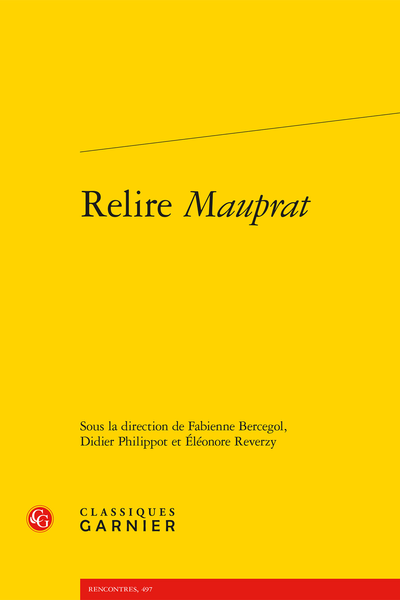
Avant-propos George Sand agrégée
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Relire Mauprat
- Auteurs : Bercegol (Fabienne), Philippot (Didier), Reverzy (Éléonore)
- Pages : 7 à 16
- Collection : Rencontres, n° 497
- Série : Études dix-neuviémistes, n° 56
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406113089
- ISBN : 978-2-406-11308-9
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11308-9.p.0007
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 09/12/2020
- Langue : Français
AVANT-PROPOS
George Sand agrégée
Banale, pour d’autres écrivains régulièrement distingués par l’institution universitaire, l’inscription d’un roman au programme de l’agrégation dans le cas de George Sand fait événement et vaut avènement. C’est en effet la première fois que George Sand a droit à cet honneur. On y verra le geste symbolique d’une canonisation académique, dont témoigne également la publication récente d’une sélection de romans dans la Bibliothèque de la Pléiade1.
Pourquoi une entrée aussi tardive dans le canon officiel ? Comment expliquer que l’œuvre de Sand ait été en grande partie éclipsée, ou reléguée dans les rayons inférieurs au mieux de la para-littérature pour la jeunesse, au pire de la « littérature bourgeoise » du Second Empire ? Les manuels scolaires sont éloquents : la place de celle qui publia soixante-dix romans, traversa les grandes crises du siècle, que les hommes de février 1848 appelèrent à eux, l’autrice d’Histoire de ma vie, presque unanimement saluée y compris et surtout par ses détracteurs (les Goncourt2 notamment), y est restreinte aux romans champêtres, ces Veillées du chanvreur qui permirent une partielle canonisation de Sand sous la Troisième République, au moment de « la fin des terroirs3 ».
8Comme le rappelle Françoise Van Rossum-Guyon4, il faut garder à l’esprit que la romancière, bientôt brocardée et caricaturée comme l’incarnation exemplaire des bas-bleus littéraires honnis, exposée à la verve féroce d’un Baudelaire5 ou d’un Barbey d’Aurevilly6, n’en a pas moins fait l’objet d’une reconnaissance immédiate par ses contemporains, au premier chef comme l’autrice d’Indiana et de Lélia (1833) : si les romans de 1830 ont été supplantés, dans la faveur collective, par les romans champêtres à partir de la fin du xixe siècle, c’est bien comme historienne des mœurs modernes dans ses fictions et comme émule de Balzac, qu’elle est acceptée et reconnue dès son premier grand succès littéraire signé de son pseudonyme, Indiana, en 1832. Reconnaissance dont témoigne le jugement rétrospectif élogieux de Taine en 1872 : « Nous avons été réalistes à outrance […]. Des deux grands créateurs en fait de nature humaine, Balzac et vous, c’est Balzac que nous avons suivi7. » Cet éloge à l’heure tardive du bilan contient à la fois un « repentir » (« Nous avons 9été réalistes à outrance ») et un appel – à revenir à la vocation « idéaliste » de la littérature, dont lui-même souhaite le retour. La réponse que George Sand lui adresse le 5 avril 1872 témoigne dans l’inquiétude d’une profonde perception des enjeux. Après avoir avoué ses doutes sur son « pouvoir d’exprimer [s]on idéal comme [elle] le sen[t] » et avoir affirmé qu’elle avait « toujours cru que l’art et la conscience c’était la même chose », elle poursuit :
Et puis l’étrange révolution, je devrais dire la réaction littéraire qui a succédé au romantisme m’a fait douter aussi parfois de la bonté de mes moyens pour en combattre le déchaînement excessif. Je trouvais que cette recherche du vrai positif avait du bon, du très bon ; qu’elle nous débarrassait de l’abus de l’à peu près en philosophie et en littérature. Je préférais une phase d’athéisme en toutes choses à l’invasion du catholicisme hypocrite et bigot. [Mais on est allé trop loin dans ce sens]. Et voilà ces bons esprits dont vous me parlez […] qui ne savent où se prendre entre le merveilleux et le réel. Ils voudraient le vrai. Le vrai est-il beau ou laid ? That is the question. Moi, je crois que le laid est transitoire, le beau éternel8.
Mais l’éloge de Taine n’en fait que mieux sentir par contraste la position en porte à faux de George Sand romancière, son étrange « déphasage » après le tournant positiviste des années 1850 – sans doute en partie imputable à l’orientation téléologique de l’histoire littéraire vers le triomphe de la formule réaliste et naturaliste du roman, et vers l’identification abusive du roman au seul roman dit « réaliste ». L’article nécrologique que consacre Zola à la romancière en 1876 vaut condamnation et profère comme définitivement l’éviction d’un modèle romanesque, dont les descendants – Cherbuliez, Feuillet – poursuivraient inlassablement, auprès de lectrices adeptes de « lectures héroïques », la même entreprise fallacieuse. Certes, Zola fait de Sand et de Balzac les deux figures de proue du début du xixe siècle qu’ont suivies les romanciers, mais il précise :
Ils m’apparaissent comme les deux types distincts qui ont engendré tous les romanciers d’aujourd’hui. De leurs poitrines ouvertes coulent deux fleuves, le fleuve du vrai, le fleuve du rêve. […] G. Sand est donc le rêve, une peinture de la vie humaine, non pas telle que l’auteur l’a observée, mais telle qu’il voudrait avoir la puissance de la créer […]. Balzac est le vrai, au contraire. […] Balzac et G. Sand, voilà les deux faces du problème, les deux éléments qui se disputent l’intelligence de tous nos jeunes écrivains, la voie du naturalisme 10exact dans ses analyses et ses peintures, la voie de l’idéalisme prêchant et consolant les lecteurs par les mensonges de l’imagination9.
Cette antithèse mythique (« le fleuve du vrai, le fleuve du rêve ») vise à travers George Sand l’héritage du romantisme – héritage que Zola n’est si soucieux de conjurer que parce qu’il ne s’en sait pas indemne lui-même10.
le roman romanesque :
romance et novel
Pour mieux apprécier l’œuvre de George Sand, sans doute convient-il de se défaire d’un certain nombre de clichés véhiculés par l’histoire littéraire et de corriger l’orientation qui lui a été donnée, et qui reste pour une très large part accréditée. C’est ce qu’ont fait, chacun à sa manière, Albert Thibaudet, Northrop Frye, Thomas Pavel, dans leur réflexion sur le roman, en inscrivant celui-ci dans une histoire longue qui remonte, non pas seulement à Don Quichotte, mais à la tradition des romans grecs. C’est du reste autour de la notion d’idéalisme, de la mise en scène d’un idéal de perfection morale, que Thomas Pavel situe la pensée du roman : l’histoire du roman lui apparaît comme « un long débat axiologique » jamais résolu, et jamais interrompu ; le roman moderne, depuis le xviiie siècle, n’a rejeté qu’en partie « l’ancienne tendance idéalisatrice », il l’a reprise et continuée « dans l’espoir de trouver au sein du monde empirique une place plausible pour la manifestation de l’idéal11 ». En ce sens, « l’idéalisme » reste la constante du roman, il s’oppose moins au réalisme qu’au scepticisme moral ; le réalisme n’est pas anti-idéaliste, il constitue une étape dans l’évolution du genre vers 11« l’enchantement de l’intériorité12 » (l’intériorisation de l’idéal avec La Nouvelle Héloïse notamment) et « la naturalisation de l’idéal13 ».
Thomas Pavel avait été précédé dans cette réflexion ouverte sur le genre romanesque par Albert Thibaudet et Northrop Frye, qui tous deux mettent l’accent, non sur l’idéalisme (même s’ils admettent l’idéalisation comme un critère définitoire), mais sur la catégorie (trans-générique) du romanesque, sur sa tradition, sa pérennité, sa continuation jusque dans le roman dit « réaliste », sous une forme renouvelée, adaptée et ironique14. L’un des grands mérites de leur approche du roman est de refuser les dichotomies tranchées (romanesque vs réalisme) et de leur préférer les modulations ou les dosages variables entre composantes ou tendances en apparence contraires. Le romanesque devient alors ce que Northrop Frye désigne comme un mode15, un ensemble d’invariants qui traversent les genres en même temps qu’une esthétique qui suppose une poétique – l’euphémisation en est une des clefs, mais non la seule, les forces d’Éros y sont motrices, l’inattendu et la surprise y figurent les aléas de l’existence, la femme, pour citer Albert Thibaudet, y « existe » et « le monde tourne autour d’elle16 ». Ainsi défini non par des critères formels mais par une topique éternelle (l’amour et l’aventure), le romanesque renvoie à un enjeu à fois littéraire et existentiel : littéraire (une logique de l’invention), existentiel (les transactions nécessaires de l’imagination avec la réalité). Ce faisant, Northrop Frye et Albert Thibaudet s’inscrivent dans le droit fil de la tradition anglaise, qui distingue, comme le fait Walter Scott, volontiers cité par Balzac et par Sand, entre deux notions, le romance, qui renvoie au romanesque éternel et au merveilleux, et le 12novel, qui ne fait pas disparaître entièrement le romanesque mais opère sa transposition ironique, parodique, dans et par le roman moderne.
Cette approche permet d’éclairer la manière dont George Sand envisage le roman, le sens du roman pour elle, lequel implique à la fois une logique de l’invention – comme le prouverait l’exemple de Corambé, à la fois vecteur, personnage et incarnation de la « vie poétique », indissociable de la « vie morale17 » – et un très fort engagement moral et existentiel. Pour elle, le romanesque se confond avec un « penchant », une pente de la rêverie et du moi, « un appétit du beau idéal18 ». Or ce besoin d’idéal (amoureux, moral, social, religieux) qu’elle ne cesse de proclamer sous-tend l’élan de l’invention et sa réalisation formelle. « Pour être romancière », ne faut-il pas, prétend-elle encore, « être romanesque19 » ? N’est-elle pas persuadée que « chacun veut trouver dans un roman une sorte d’idéal de la vie20 » ? Autant de formules décisives qui définissent un éthos littéraire (celui de l’auteur) et une éthique du roman – comme mise en forme, et mise en œuvre, d’un idéal de vie, d’un « modèle21 » offert au lecteur et poursuivi par le personnage.
Jugée périmée à l’aune du roman réaliste et naturaliste, cette adhésion de George Sand au roman romanesque, à ce fonds immémorial du romance dont Mauprat s’offre comme un compendium exemplaire, a eu de plus en plus de mal à être acceptée. C’est pourtant ainsi que Friedrich Schlegel définissait le roman en songeant, au même titre que George Sand, à l’héritage de la courtoisie et de la chevalerie, à l’Arioste et au Tasse. Dans sa Lettre sur le roman, il définit le roman comme « un livre 13romantique », et peut-être comme le livre romantique par excellence, renvoyant à l’origine romane du terme, dans une confusion entre romanesque et romantique qu’autorisent également l’allemand et l’anglais : « C’est là que je cherche et que je trouve le romantisme, chez les premiers Modernes, dans Shakespeare, Cervantès, dans la poésie italienne, dans cette époque des chevaliers, de l’amour et des contes, d’où provient la chose et le mot lui-même22 ». C’est aussi dans cette perspective qu’il faut comprendre la préférence de Sand pour le romanesque23 – laquelle, faut-il corriger aussitôt, n’est nullement exclusive de toute préoccupation sociale, politique ou historique, même si, conformément aux lois du « roman historique » depuis La Princesse de Clèves, c’est le roman, le romanesque, qui occupe le premier plan. Les deux aspects (romanesque et historique) ne s’excluent donc pas – ce que se chargent d’illustrer les études rassemblées ici. Elles montrent également combien ce fonds romanesque s’est révélé propice à une ethnopoétique ici centrée sur l’examen des rapports de l’homme à l’animalité.
La poÉtique de l’apologue
Lire Mauprat, c’est aussi accepter la fonction didactique attachée à la littérature, sa dimension figurative essentielle, chargée d’articuler le romanesque et l’histoire dans un itinéraire, celui d’une éducation, qui conduit, grosso modo, de l’obscurantisme féodal aux Lumières, non sans rechutes ni défaillances difficilement surmontables. L’omniprésence des Lumières et de la philosophie dans ce roman évoque, par le biais d’une prophétie rétrospective (post eventum), le passage d’une époque (l’Ancien Régime) à une autre (la société postrévolutionnaire) – une période de transition entre deux mondes et entre deux âges conformément à la poétique de l’histoire d’un Walter Scott.
14L’intérêt de Mauprat est de ce point de vue d’illustrer l’évolution de George Sand de ce que Isabelle Hoog Naginski a appelé son « romantisme bleu », période au cours de laquelle la quête individuelle de l’idéal se solde par l’échec et la désillusion (Lélia, et encore Spiridion en 1839), à un « romantisme rouge » caractérisé, à partir de 1840, par l’inscription de l’idéal, désormais recherché de façon collective, dans une perspective sociale et politique : la notion d’idéal « désigne dorénavant une société perfectionnée qui avance vers une meilleure organisation du travail et des ressources, une société qui se base sur de nouvelles valeurs d’égalité entre les sexes et les classes, sur la liberté de pensée et d’expression, et sur la fraternité entre les êtres24 ». Pour faire advenir cette société espérée, George Sand continue donc de miser sur les ressources propres du roman, sur l’attrait de son imaginaire, sur « le don d’émouvoir » dont Germaine de Staël avait bien vu qu’il était « la grande puissance des fictions25 ». En s’en remettant à l’efficacité polémique du romanesque, à la dimension critique que contient l’utopie qu’il déploie, elle met en avant la « teneur révolutionnaire » de l’histoire romanesque que Northrop Frye n’hésite pas à opposer à l’« élément résolument conservateur » qui reste « au cœur du réalisme » et de son « acception de la société sous sa forme présente26 ».
Aussi convient-il, à la lecture de Mauprat, d’éviter deux écueils symétriques.
Ne pas prendre au sérieux la fonction exemplaire et éthique du roman. La confession de Bernard octogénaire est portée par une interrogation philosophique (« un problème philosophique », 37) sur la perfectibilité individuelle, et peut-être aussi collective, qu’est chargée de rappeler la leçon finale, ajoutée en 1851. Il s’agit pour Bernard de raconter prioritairement « [son] histoire morale et philosophique » (219), quitte à rejeter à l’arrière-plan allusif du roman des pans entiers de l’histoire. Mauprat est une fable exemplaire et qui le dit. La situation même du conteur et de l’auditeur, la veillée tout comme le sujet de l’histoire (la transformation d’un « loup » en homme), relèvent de cet affichage éthique fort du 15roman sandien. Le lecteur est appelé à écouter l’histoire de Bernard et à en tirer une leçon. La dimension parabolique du roman, qui raconte un apprentissage singulier parallèle à celui d’une société en marche vers le changement et retrace un cheminement intérieur en même temps qu’une transformation collective, est capitale, à une époque où Sand, dans les Lettres à Marcie, affirme sa « foi en la puissance des exemples27 ». Elle qui croit, comme Michelet et Leroux, au symbole, à la fois comme signe d’un engagement et comme dualité (forme et sens)28, est toujours en quête d’une communauté, d’un accord ; elle cherche à inscrire un lien, dont Nicole Mozet a bien montré le caractère central, et pour ainsi dire originel, dans toute l’œuvre sandienne29.
La prendre trop au sérieux, en s’en tenant à la thèse apparente, au risque de raboter les aspérités de l’œuvre, de réduire les dissonances et les failles perceptibles, d’ignorer l’hybridité d’un roman travaillé souterrainement par de très fortes tensions qui ne semblent pas entièrement résorbées par le schéma optimiste et consolant de la perfectibilité. Notamment parce que, à l’instar de l’instabilité rémanente de Bernard, sujet à des retours de violence intérieure, le discours de la maîtrise est sans doute en partie suspect dans Mauprat, comme le suggère l’article d’Yvette Bozon-Scalzitti, invitant à une lecture « latérale » du roman, sensible à la violence de ses ébullitions volcaniques30. Et que dire des valeurs aristocratiques (orgueil du nom, courtoisie, loyauté, honneur, etc.) portées par le romanesque31 qui continuent de guider les personnages principaux, au risque de troubler leur ralliement à l’idéal républicain d’égalité et de remettre en cause la lecture démocratique de Mauprat ?
Un des enjeux centraux de Mauprat – comme y insiste un certain nombre d’études regroupées dans ce volume – n’est autre que le rapport de la sauvagerie et de la civilisation, des passions et du « devoir », des 16passions et de la politesse ou de leur polissage, qu’on peut envisager de diverses façons à la lumière (aux Lumières) du roman, mais aussi d’une écriture de l’histoire à distance ou en creux, tapie dans l’intériorité des personnages. Le roman visible demande à être complété par une manière de roman invisible, de sous-texte allégorique, dont le modèle pourrait nous être fourni par la lettre sanglante aux passages mutilés, et qui, d’aveu passionnel (332-333), se fait pièce à conviction accusatrice au moment du procès (381) ? Le roman, qui multiplie les épisodes de vertige, de malaise, de fièvre hallucinatoire ou onirique, évolue vers des moments de crise (au sens médical et théâtral du terme) qui dévoilent son fond sublime (la violence de l’Éros), difficilement réductible : moments de crise cathartique, que sont l’accident de chasse éminemment romanesque et la confession publique du procès où la vérité la plus intime s’expose dans la lumière suprême de la Justice. Au cœur du roman, il y aurait ainsi la violence du désir redoutée, contrainte, éduquée, secrètement souhaitée, et, à travers le portrait à demi-galant d’Edmée en Sphinx impassible et cruel, le mystère féminin difficilement pénétrable.
Fabienne Bercegol,
Didier Philippot,
et Éléonore Reverzy
1 George Sand, Romans, éd. José-Luis Diaz, avec la collaboration de Brigitte Diaz (t. I et II) et d’Olivier Bara (t. II), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2019.
2 « Nous étions, surtout l’un de nous, assez injustes pour le talent de Mme Sand. Nous avons lu les 20 volumes de l’Histoire de ma vie. Au milieu du fatras d’une publication de spéculation, il y a d’admirables tableaux, des renseignements sans prix sur la formation d’une imagination d’écrivain, des portraits de caractères saisissants, des scènes simplement dites, comme la mort dix-huitième siècle de sa grand-mère, et son héroïsme douillet, la mort de Parisienne de sa mère, qui arrachent l’admiration et les larmes ! C’est un grand document, malheureusement délayé, de psychologie et d’analyse où le talent de Mme Sand, dans le vrai, l’observation des autres et d’elle-même, sa mémoire qui peint, étonne et surprend. » (Journal des Goncourt, éd. de Jean-Louis Cabanès, Paris, Champion, 2019, t. IV, p. 444-445).
3 On renverra à ce propos à l’article de Naomi Schor : « Idealism in the Novel : Recanonizing Sand », publié dans Yale studies en 1988 (no 75, p. 56-73) et traduit par Marie Baudry dans le volume George Sand et l’idéal, Damien Zanone (dir.), Paris, Champion, 2017, p. 427-447.
4 Françoise Van Rossum-Guyon, « Puissances du roman : George Sand », Romantisme, no 85, 1994, p. 79-92.
5 Voir par exemple, Charles Baudelaire, Mon cœur mis à nu, no 26 : « La femme Sand est le Prudhomme de l’immoralité. Elle a toujours été moraliste. […] Elle a le fameux style coulant, cher aux bourgeois. Elle est bête, elle est lourde, elle est bavarde ; elle a [la morale] dans les idées morales, la même profondeur de jugement et la même délicatesse de sentiment que les concierges et les filles entretenues » ; et no 27 : « […] Voyez George Sand. Elle est surtout, et plus que toute autre chose, une grosse bête ; mais elle est possédée. C’est le Diable qui lui a persuadé de se fier à son bon cœur et à son bon sens, afin qu’elle persuadât toutes les autres grosses bêtes de se fier à leur bon cœur et à leur bon sens. Je ne puis penser à cette stupide créature sans un certain frémissement d’horreur. Si je la rencontrais, je ne pourrais m’empêcher de lui jeter un bénitier à la tête. » (éd. André Guyaux, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1975, 1976 et 1986, p. 99-100).
6 Dans « Mme George Sand jugée par elle-même » (texte qu’il écrit à l’occasion de la publication des Souvenirs et impressions littéraires en 1862), Barbey fustige la romancière pour l’« abondance » et la « facilité » de son inspiration, sa naïveté, son manque d’originalité qui lui vaut « l’affreuse fortune de plaire à tous les publics ». Il s’acharne contre « cette femme qui n’eût pour tout génie d’invention que d’être mal mariée, bohème et démocrate, et qui n’a jamais que ces trois sources d’inspiration : le mauvais ménage, le cabotinisme et la mésalliance, par haine du noble et amour de l’ouvrier ». Voir Les Bas-bleus, éd. Pascale Auraix-Jonchière, dans Œuvre critique, éd. Pierre Glaudes et Catherine Mayaux, Paris, Les Belles Lettres, 2006, p. 79-92.
7 Cité par Georges Lubin dans George Sand, Correspondance (avril 1872-mars 1874), éd. George Lubin, Paris, Classiques Garnier, 2019, t. XXIII, p. 12, n. 1. Notons que, dès 1865, dans sa Philosophie de l’art, Taine avait célébré le principe de bienfaisance du caractère – la générosité native – dans les romans de Sand, dont Mauprat.
8 George Sand, Correspondance, éd. citée, t. XXIII, p. 12-13.
9 Émile Zola, « George Sand », Le Messager de l’Europe, juillet 1876 (article repris dans Documents littéraires, 1881), dans Henri Mitterand (éd.), Écrits sur le roman, Paris, Librairie générale française, coll. « Le Livre de poche », 2004, p. 168.
10 Les enjeux de la dichotomie dans laquelle l’histoire littéraire a enfermé l’œuvre de George Sand ont été très bien résumés par Damien Zanone dans la notice « Idéalisme/Réalisme » du Dictionnaire George Sand, Simone Bernard-Griffiths et Pascale Auraix-Jonchière (dir.), Paris, Champion, 2015, t. I, p. 543-551.
11 Thomas Pavel, La Pensée du roman, Paris, Gallimard, 2003, p. 12.
12 Titre de la IIe partie, ibid.
13 Titre de la IIIe partie, ibid.
14 Cette réflexion a été poursuivie par les contributeurs du volume Le Romanesque, Gilles Declercq et Michel Murat (dir.), Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2004. Alain Schaffner conclut l’article qu’il y donne (« Le romanesque : idéal du roman ? ») en soulignant lui aussi cette permanence du romanesque jusque dans sa contestation : « Depuis Cervantès, le romanesque est donc devenu une sorte d’idéal paradoxal du roman : il en est à la fois le paradis perdu et le repoussoir » (p. 282).
15 Voir Anatomie de la critique[1957], Paris, Gallimard, 1969 (trad. fr.), L’Écriture profane. Essai sur la structure romanesque [1976], Paris, Circé, coll. « Bibliothèque critique », 1998.
16 Albert Thibaudet note dans ses Réflexions sur le roman : « un roman en français, c’est où il y a de l’amour » et il ajoute : « Le roman, c’est le genre où la femme existe, où le monde tourne autour d’elle, où l’on se passionne pour ou contre elle. » (Réflexions sur le roman, Paris, Gallimard, 1938, p. 73 et 246).
17 Voir George Sand, Histoire de ma vie, éd. Martine Reid, Paris, Gallimard, « Quarto », 2004, IIIe partie, chap. viii, p. 812 sq. Corambé est le nom que George Sand a donné (nom qui lui a été soufflé en rêve) au personnage du roman virtuel par lequel elle est entrée, enfant, dans le monde de la fiction. Dans la logique de l’invention romanesque dont il constitue à la fois le centre et l’emblème, se rejoignent les élans et les désirs de sa « vie poétique » et de sa « vie morale » (« religion et roman poussèrent de compagnie dans mon âme », ibid., p. 815).
18 Ibid., IIIe partie, chap. viii, p. 815.
19 George Sand, Monsieur Sylvestre[1864], Paris-Genève, Slatkine Reprints, coll. « Ressources », 1980, p. 17.
20 Cité par Damien Zanone, notice « Idéalisme/réalisme », op. cit., t. I, p. 550 (George Sand, Histoire de ma vie, éd. citée, IIe partie, chap. xv, p. 646).
21 Bernard Pingaud est revenu sur cette mission assignée au roman, qui se combine plus qu’elle ne s’oppose à l’ambition de se faire le « miroir » de la réalité, dans les pages suggestives de son essai La Bonne aventure. Essai sur la « vraie vie », le romanesque et le roman, Paris, Seuil, 2007 (chap. iii notamment).
22 Friedrich Schlegel, Lettre sur le roman, dans Entretien sur la poésie, texte recueilli dans L’Absolu littéraire, Ph. Lacoue-Labarthe et J.L. Nancy (dir.), Paris, Le Seuil, 1978, p. 327.
23 Avouée par exemple dans Impressions et souvenirs en 1873 : « J’ai toujours eu pour opinion que, dans un sens ou dans l’autre, événements ou sentiments, un roman devait être avant tout romanesque. »
24 Isabelle Hoog Naginski, « L’idéal sandien dans tous ses états : la rêverie, la quête, la figuration », dans George Sand et l’idéal, Damien Zanone (dir.), Paris, Champion, 2017, p. 26 et p. 29.
25 Germaine de Staël, Essai sur les fictions, dans Œuvres de jeunesse, éd. Simone Balayé et John Isbell, Paris, Desjonquères, 1997, p. 150.
26 Northrop Frye, L’Écriture profane, op. cit., p. 170-171.
27 George Sand, Lettres à Marcie[1837], deuxième lettre, dans Les Sept Cordes de la lyre, Paris, Michel Lévy frères, 1869, p. 181.
28 Voir à ce propos Michèle Hecquet : « Contrats et symboles. Essai sur l’idéalisme de George Sand », dans George Sand une œuvre multiforme. Recherches nouvelles II, Françoise Van Rossum-Guyon (dir.), CRIN 24, 1991, p. 29-41, p. 32.
29 En particulier dans George Sand écrivain de romans, Saint-Cyr-sur-Loire, Christian Pirot, 1997.
30 Yvette Bozon-Scalzitti, « Mauprat ou la Belle et la Bête », Nineteenth-Century French Studies, vol. 10, no 1/2, Fall-Winter 1981-1982, p. 1-16.
31 Sur les affinités du romanesque avec la morale aristocratique, voir Northrop Frye, L’Écriture profane, op. cit., p. 167 sq.