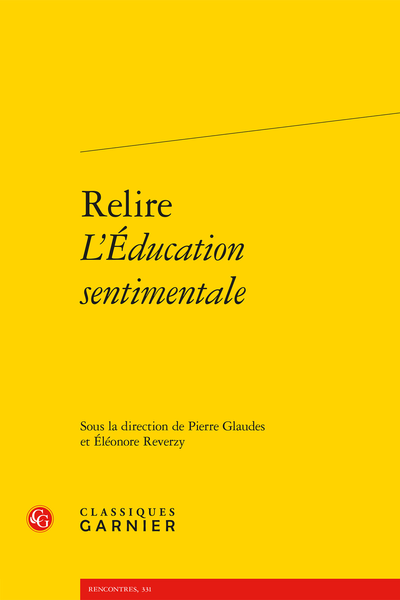
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Relire L’Éducation sentimentale
- Pages : 343 à 347
- Collection : Rencontres, n° 331
- Série : Études dix-neuviémistes, n° 39
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406074595
- ISBN : 978-2-406-07459-5
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-07459-5.p.0343
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 05/12/2017
- Langue : Français
Résumés
Yvan Leclerc, « L’Éducation sentimentale ou la “difficulté de trouver un bon titre” »
Le titre L’Éducation sentimentale, si évident pour le lecteur d’aujourd’hui, a connu une genèse compliquée. Bien que présent dès le premier scénario, Flaubert ne s’y résout que tardivement, plus qu’il ne le choisit. Ce titre paraît en effet trop restreint pour le contenu du roman, sauf si, en passant par l’héritage rousseauiste, on lui donne une extension telle qu’il convienne à toute la génération de 1848.
Éric Le Calvez, « Topographie et poétique du récit »
Flaubert a soigné ses descriptions en écrivant ses œuvres, ses manuscrits en témoignent, et L’Éducation sentimentale n’échappe pas à cette règle. Initialement basées sur des principes réalistes (l’auteur doit respecter l’espace tel qu’il est ainsi que les détails historiques des années 1840-1850), elles échappent à un simple souci de représentation, étant liées aux sensations des personnages et à l’action, où elles jouent un rôle symbolique.
Stéphanie Dord-Crouslé, « Le personnage de Madame Arnoux »
Parmi les personnages féminins de L’Éducation sentimentale, Mme Arnoux occupe une place particulière. Épouse et mère bourgeoise, elle ne paraît dotée d’aucune épaisseur psychologique propre. En outre, la dimension idéale d’abord conférée à son personnage s’estompe tandis que se manifeste au contraire, de plus en plus clairement, une médiocrité constitutive, résultant de complexes et sourds processus de dégradations physiques et morales.
344Boris Lyon-Caen, « Intérieur avec vue. Frédéric est-il un personnage de roman ? »
Flaubert prête à ses personnages les plus caractérisés un ensemble d’émotions, de croyances et d’idées. Mais il occupe leur psyché, dispose de cette vie donnée comme « intérieure » – et dépersonnalise, étrangement, Frédéric. Selon quelles stratégies ? Et à quelles fins ? Pourquoi et comment repenser, sur fond d’« extimité » (Lacan), l’hypothèse d’une psychologie romanesque ?
François Vanoosthuyse, « La narration par “plans” dans L’Éducation sentimentale »
Cet article décrit différents usages de la technique du découpage mise au point par Flaubert dans L’Éducation sentimentale.
Éléonore Reverzy, « Le romanesque dans L’Éducation sentimentale »
Le lecteur de L’Éducation sentimentale est frappé par les rencontres et coïncidences qui ponctuent le récit. Elles rappellent un romanesque ancien dont d’autres topoï (la rencontre est le plus célèbre) sont repris par Flaubert. C’est à la fonction de cette topique qu’est consacrée cette étude.
Guy Larroux, « “Il parle bien, Frédéric Moreau” »
L’Éducation sentimentale est une mine pour qui s’intéresse aux rites d’interactions. Il s’agit, dans cet article, de reconsidérer le dialogue et en particulier la parole d’un héros qui semble peu respectueux des règles de la conversation. Parmi les maximes de Grice, nous faisons un sort particulier à la règle de quantité car elle éclaire singulièrement le comportement d’un Frédéric Moreau souvent laconique mais capable à l’occasion de « bien parler ».
Gilles Philippe, « 1857-1869 : un changement de style ? »
L’Éducation sentimentale serait, dit-on, le chef-d’œuvre stylistique qu’annonçait Madame Bovary. Le roman de 1869 n’a pourtant pas totalement levé les contradictions qui s’observaient dans les choix rédactionnels du roman de 1857. C’est ce qui apparaît, si l’on étudie toute une gamme de faits grammaticaux ou énonciatifs et qu’on les rapporte aux tendances évolutives générales de la prose narrative du temps.
345Jeanne Bem, « L’Éducation sentimentale : modernité et mobilité »
L’idée de départ est que Flaubert est un romancier de la vie moderne. Modernité, urbanisation et mobilité vont de pair. Madame Bovary était déjà un roman de société et un roman de la Ville, comme le montre l’analyse d’une scène de rue, l’épisode du fiacre. L’article explore ensuite diverses modalités de la mobilité urbaine dans L’Éducation sentimentale, avec des références à Baudelaire, à Claude Monet, à Georges Perec, au cinéma et à la sociologie.
Christophe Reffait, « Logiques de l’argent et du récit dans L’Éducation sentimentale »
L’argent est omniprésent dans L’Éducation sentimentale. Il ne se présente pas seulement comme affleurement textuel des prix et salaires des années 1840-1850, mais aussi comme puissance de configuration du récit, dans la mesure où les relations de crédit et la problématique de l’érosion du patrimoine sont primordiales dans le roman. Simultanément, ce roman de la révolution laisse entendre l’ampleur des inégalités de revenus au xixe siècle.
Nicolas Bourguinat, « De Séville à Barcelone. L’Espagne dans L’Éducation sentimentale »
Rattaché à Madame Arnoux, avec son physique d’Andalouse, et plus généralement à l’imagerie costumbrista, le thème de l’Espagne prend un tour séducteur et fascinant, mais pour mieux tourner au fiasco dans la scène, trop rarement commentée, du « patriote de Barcelone », dont l’apparition ruine les ambitions politiques de Frédéric, en même temps que, incarnant l’hispanité sous les traits d’un histrion, il réduit à néant la rêverie orientalisante qu’il projetait sur l’héroïne de L’Éducation.
Gisèle Séginger, « L’histoire des sentiments et des émotions »
« 89 a démoli la royauté et la noblesse, 48 la bourgeoisie et 51 le peuple. Il n’y a plus rien, qu’une tourbe canaille et imbécile. – Nous sommes tous enfoncés au même niveau dans une médiocrité commune. L’égalité sociale a passé dans l’Esprit. » Ayant perdu ses grands sujets, l’histoire n’est plus interprétée dialectiquement. S’inspirant de la manière d’écrire l’histoire de Michelet et de celle de la penser de Tocqueville, Flaubert raconte l’histoire morale de sa génération et anticipe sur l’histoire moderne des sensibilités.
346Jacques Neefs, « Le sentiment politique dans L’Éducation sentimentale »
Flaubert, avec L’Éducation sentimentale, développe une sorte d’histoire « à rebours », créant dans la durée longue du livre et par l’intensité prosodique de l’œuvre, un état de perception sensible par fragments successifs, et l’imprégnation proprement poétique d’un « sentiment ». Ce sentiment est « politique » en ce qu’y sont impliquées les défaites d’une aspiration et la violence du pouvoir, mais aussi l’idée de liberté, dans l’inquiétude d’un temps.
Pierre Glaudes, « Avatars du religieux dans L’Éducation sentimentale »
« Histoire morale » d’une génération, L’Éducation sentimentale enregistre, parmi d’autres phénomènes, les manifestations de la sécularisation. Dans les années 1840 où il situe son récit, Flaubert n’appréhende pas ce phénomène comme une irrémédiable dégénérescence du religieux : il observe au contraire les conditions dans lesquelles, dans les domaines politique et sentimental, s’opère un « transfert de contenus, de schèmes et de modèles » élaborés à l’origine « dans le champ théologique » (G. Waterlot).
Fabrice Wilhelm, « Amitié et envie dans L’Éducation sentimentale »
La question de l’envie, au sens du second péché capital, prend une importance centrale dans L’Éducation sentimentale dont une des particularités narratives est de représenter un « héros », Frédéric, explicitement envié par son meilleur ami, Deslauriers. L’amitié et l’envie ne doivent plus être envisagées dans le seul cadre des comportements privés : leur relation engage une réflexion sociale et politique sur les possibilités de la philia dans la société moderne.
Juliette Azoulai, « “Le bonheur peut y tenir”. Conceptions du bonheur dans L’Éducation sentimentale »
Il y a un paradoxe à envisager L’Éducation sentimentale de Flaubert sous l’angle du bonheur, la réception de l’œuvre mettant généralement l’accent sur l’impression de tristesse qui se dégage du livre. Il s’agit pourtant dans cet article de saisir dans quelle mesure ce roman propose une véritable réflexion sur le bonheur – une eudémonologie en somme, selon le terme inventé par Schopenhauer pour désigner l’art d’être heureux.
347Jacques-David Ebguy, « “Quel est le sens de tout cela ?” L’Éducation sentimentale, roman du retrait »
Cet article examine les modalités et les effets de l’écriture flaubertienne du retrait, de sa singulière dramaturgie du sens. Quatre modes d’articulation entre présence et absence des significations, quatre visages de l’Être, sont plus précisément analysés – le battement, le vide, l’ouverture et l’ambiguïté. Un triangle se dessine : L’Art – malmenant la raison narrative et transfigurant l’existence – rend sensible et anime l’écart entre le Sens et la Vie.