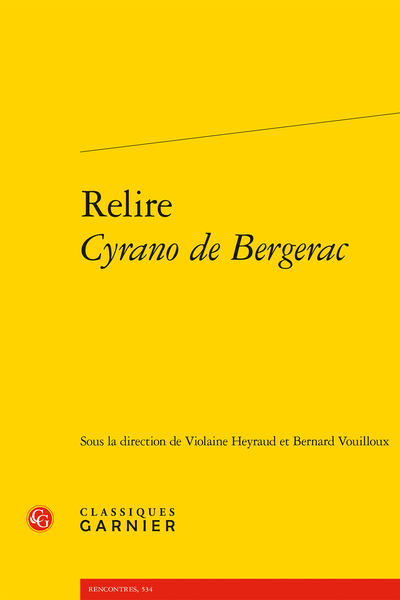
Résumés
- Publication type: Article from a collective work
- Collective work: Relire Cyrano de Bergerac
- Pages: 215 to 218
- Collection: Encounters, n° 534
- Series: Nineteenth century studies, n° 59
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406126416
- ISBN: 978-2-406-12641-6
- ISSN: 2261-1851
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-12641-6.p.0215
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 11-24-2021
- Language: French
Résumés
Bernard Vouilloux, « Introduction. Rostand en clair-obscur »
Bénéficiant de l’intérêt que l’Université, depuis une trentaine d’années, porte aux œuvres de Rostand et en particulier à Cyrano de Bergerac, l’inscription de cette pièce au programme de l’agrégation est l’occasion de dresser un bilan sur sa réception, sur ses sources historiques, sur les genres dramatiques qui l’ont nourrie, sur la figure centrale autour de laquelle elle tourne, sur ses nœuds dramaturgiques, sur ses particularités stylistiques et métriques et sur sa dimension scénographique.
Jeanyves Guérin, « “La critique aboie, Cyrano remplit les salles”. Fortune scénique de Cyrano et infortune académique de Rostand »
Depuis des décennies, des générations de spectateurs ont fait de Cyrano de Bergerac l’une des pièces françaises les plus jouées dans le monde. Pourtant sa fortune critique est étrangement étriquée en France. Les autorités de la NRF comme de l’Université se sont montrées réticentes voire franchement hostiles à une œuvre vue comme d’arrière-garde. Les stars de la scénocratie ont suivi leurs ukases. Si l’on sort de l’Hexagone, on constate l’adaptabilité de la pièce à d’autres cultures.
Clémence Caritté, « Cyrano est-il français ? »
La lecture nationale qui reste attachée à la pièce depuis sa création requiert d’être expliquée, précisée et nuancée par une recontextualisation aussi bien littéraire et historique que politique et culturelle. L’examen de la notion d’esprit français, de l’arrière-fond militariste et patriotique du théâtre de la fin du siècle, étayé largement par la presse et les critiques de l’époque, dessine un panorama qui se veut le plus juste possible.
216Hélène Laplace-Claverie, « Une pièce baroque ? »
Par l’intermédiaire de Théophile Gautier et de son ouvrage Les Grotesques (1844), Edmond Rostand découvre non seulement l’écrivain Savinien Cyrano de Bergerac, mais aussi l’esthétique baroque dont il fait une composante essentielle de sa pièce. Au-delà du personnage de Cyrano, véritable incarnation du bizarre et de la disparate, il s’agira d’analyser comment Rostand s’approprie la notion de theatrum mundi et dans quelle mesure ses choix dramaturgiques relèvent du modèle baroque.
Sylvain Ledda, « “Je l’attendrai debout, et l’épée à la main !” Réflexions sur la comédie héroïque »
Bien que sous-titré « comédie héroïque », Cyrano de Bergerac est parfois considéré comme un drame, notamment à cause de la mort des principaux personnages. Écrire une comédie héroïque en 1897, c’est aussi obéir à une logique poétique, esthétique et historique de la part de Rostand. C’est ce choix générique que le présent article propose d’interroger.
Jean Bourgeois, « Le système des personnages féminins »
Dans un univers peuplé d’hommes, la plupart des personnages féminins, inventés ou librement inspirés de modèles ayant existé, se répartissent dans différents groupes, principalement les dispensatrices de nourriture, les religieuses et les précieuses. Entre ces personnages et entre ces groupes s’établissent des rapports de similitude et d’opposition qui organisent un système dont Roxane est le centre et qui déterminent des clivages révélant une dichotomie du corps et de l’esprit.
Fabrice Wilhelm, « Nez postiche et imposture »
Les metteurs en scène font la plupart du temps jouer le personnage de Cyrano en affublant le comédien d’un nez postiche. S’agit-il d’un accessoire nécessaire pour représenter ce nez monstrueux dont il est question dans le texte ? L’utilisation d’un postiche ne désigne-t-elle pas plutôt une énigme du personnage qu’il faut analyser de concert avec l’imposture généreuse par laquelle Cyrano entreprend la séduction de Roxane ?
217Géraldine Vogel, « L’art de la pointe, ou le poème aiguisé »
Dans une tradition littéraire cherchant à rétablir l’image ternie du versificateur, Cyrano de Bergerac interroge l’engagement poétique pour fournir une alternative aux poètes « crottés » et « maudits ». La parole est l’arme qui permet au poète-bretteur de lutter contre la maladie du siècle, la neurasthénie, adversaire de l’enthousiasme. L’attitude combattive de Cyrano envahit la scène, créant un tableau dramatique illustrant la valeur fédératrice du poète en tant qu’homme et artisan.
Henri Scepi, « Poétique du souffleur »
La pièce de Rostand diffuse en l’organisant un discours sur la poésie conçue comme univers de langage, éthique du sensible et vision du monde. Le personnage éponyme incarne une exigence de coïncidence de soi à soi et de sincérité inconditionnelle où se lient en gerbe les valeurs nourricières de la poésie préclassique et les aspirations propres au renouveau poétique des années 1890-1900.
Alain Vaillant, « Le lyrisme de la versification heureuse »
L’aura dont bénéficie la pièce de Rostand depuis sa création et qui, dès l’origine, a laissé perplexe la critique reste un mystère : les circonstances historiques peuvent expliquer le succès en 1897, non pas sa permanence depuis plus d’un siècle. Car il a des racines plus profondes, qui touchent à la nature même du plaisir poétique – en l’occurrence, à l’euphorie singulière que communique Cyrano de Bergerac et au rôle qui est dévolu à la versification syllabique et à la rime pour y parvenir.
Jean-Michel Gouvard, « Un alexandrin de comédie »
Dans Cyrano de Bergerac, divers procédés comiques sont en lien avec la versification : les répétitions de mots à l’intérieur du vers et à la rime, les appariements de mots à la rime, le recours aux chevilles, les enjambements de vers à vers. Si la métrique de l’alexandrin nécessite d’être analysée précisément, en particulier les scansions ternaires et semi-ternaires, elle ne saurait omettre la dimension orale du texte non plus que les effets comiques ponctuels.
218Bertrand Degott, « Interjections et onomatopées »
Le théâtre de Rostand, comme celui de Claudel, contient nombre d’interjections. Les interjections primaires, qui sont aussi les plus fréquentes (ah, oh, hein…), ont pour origine une onomatopée, mais Rostand accueille aussi sur scène le bruit des vagues et des cris d’animaux. L’observation et l’étude de quelques-uns de ces « “parias” grammaticaux » sont l’occasion de fournir quelques instruments pour l’analyse stylistique de Cyrano de Bergerac.
Bernard Vouilloux, « Le théâtre du geste »
L’engagement de Rostand dans la mise en scène de Cyrano de Bergerac se traduit non seulement par l’inflation des didascalies, mais par la fréquence des notations descriptives ou auto-descriptives. Aux apparences normées des courtisans s’oppose constamment l’envol vers l’idéal, caractéristique du personnage de Cyrano. Loin de s’émanciper de la matérialité des décors et des corps, qui détermine le calcul des effets, Cyrano la pousse à son comble : son geste participe d’un théâtralisme exacerbé.
Jean-Marie Apostolidès, « Paradoxe sur le Cyrano »
Bien que Cyrano de Bergerac soit écrit pour Constant Coquelin, un rapprochement avec Sarah Bernhardt est fructueux, bien que paradoxal. La Divine appartenait à une autre école que Coquelin, c’était une comédienne possédée, au comportement proche de la figure traditionnelle du chamane. Ne peut-on pas découvrir dans le héros de Rostand des traits chamaniques, c’est-à-dire de guérisseur, permettant de mieux comprendre les raisons de son succès dans la société française de la fin du xixe siècle ?