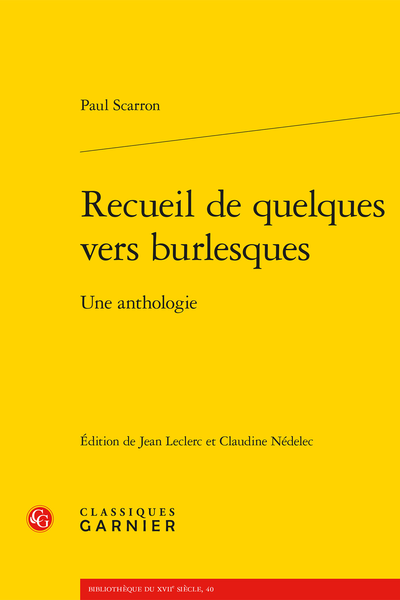
Index des personnages historiques
- Publication type: Book chapter
- Book: Recueil de quelques vers burlesques. Une anthologie
- Pages: 647 to 679
- Collection: Seventeenth-Century Library, n° 40
- Series: Voix poétiques, n° 9
- CLIL theme: 3439 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moderne (<1799)
- EAN: 9782406108818
- ISBN: 978-2-406-10881-8
- ISSN: 2258-0158
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-10881-8.p.0647
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 06-03-2021
- Language: French
Index des personnages
historiques
Achy, Gilles de Carvoisin, seigneur d’, 1602-† ap. 1651 (III, 5) : gentilhomme ordinaire de la chambre du duc d’Orléans (Gaston d’Orléans, frère de Louis XIII) depuis 1632.
Agrippa, Marcus Vipsanius, 63-12av. J.-C. (V, 7) : ami et conseiller de l’empereur Auguste, vainqueur de Pompée à Actium. Il est le père d’Agrippine et donc le grand-père de Néron.
Aiguillon, Marie-Madeleine de Vignerot, dame de Combalet, duchesse d’, 1604-1675 (V, 12 – VII, 20) : nièce d’Armand du Plessis, cardinal de Richelieu, et héritière d’une grande partie de sa fortune. Réputée dévote, elle s’investit dans plusieurs œuvres caritatives.
Albertus, Albrecht von Bollstädt, dit Albert le Grand, saint, 1200 ?-1280 (V, 7) : frère dominicain, philosophe et théologien, mais aussi naturaliste, chimiste et professeur. Saint Thomas d’Aquin fut son disciple.
Albret, César-Phébus d’, 1614-1676 (VII, 19) : comte de Miossens, maréchal de France, il est un des meilleurs amis de Scarron. Il est surtout réputé pour ses galanteries, malgré son mariage avec Madeleine de Guénégaud en février 1645.
Albuquerque, Alphonse d’, 1453-1515 (V, 7) : militaire, navigateur, explorateur et politicien portugais, gouverneur des Indes portugaises de 1509 à 1515. En 1510, il prit Goa (Inde), la pilla et en fit la capitale des possessions portugaises.
Alexandre le Grand, 356-323 av. J.-C. (V, 7 ; 11 – VI, 6 – VII, 13 – VIII, 8) : l’un des plus illustres conquérants de la Grèce antique. Son goût pour le vin a pu être cause de sa mort.
Alexandre VII, Fabio Chigi, 1599-1667 (V, 18) : l’un des représentants de la papauté lors des négociations du traité de Westphalie (1648) visant à mettre fin à la guerre de Trente Ans. Scarron espère de lui la paix entre la France et l’Espagne. Il fut élu pape en avril 1655.
Almeras, Jean (III, 5) : seigneur de Mégires, il est lieutenant des gardes suisses du duc d’Orléans.
Alzau, monsieur d’ (IV, 14) : personnage difficile à identifier : il pourrait s’agir de Jacques de Voisins, seigneurd’Alzau, mort en 1688, militaire et chambellan du duc d’Orléans.
Ambroise, saint (VII, 9) : évêque de Milan à la fin du ive siècle, l’un des docteurs et pères de l’Église, maître de saint Augustin.
Anjou, duc d’ : voir Philippe d’Orléans
Anne, Dame (III, 4) : personnage inconnu.
Anne d ’ Autriche, 1601-1666 (I-1, 67 – II, 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 11 ; 15 – III, 5 ; 6 – VII, 11 ; 13 – VIII, 7) : fille
648de Philippe III d’Espagne, mère de Louis XIV, mariée à Louis XIII en 1615 et reine régente à la mort de ce dernier. Scarron la rencontre grâce à l’intervention de sa protectrice Marie de Hautefort : se donnant le titre de « Malade de la reine » il obtient d’elle une pension. Il lui dédie des poésies et le premier livre de son Virgile travesti.
Arioste, Ludovico Ariosto, dit l’, 1474-1533 (VII, 20) : auteur italien de la Renaissance, fort en vogue pour son Roland furieux.
Armand, maître : voir Richelieu
Arnaudet, Pierre (VII, 20) : procureur de Niort.
Aub(e)ry, Louis, † 1677 (III, 2) : seigneur de Trilport ou Trillepert, fils du premier lit du Président Aubry.
Aub(e)ry, Robert, † 1674 (III, 2) : seigneur de Courcy, conseiller d’État, frère du précédent.
Aubigné, Françoise d’, 1635-1719 (IV, 17 – VII, 12 ; 21 – VIII, 6 ; 7 ; 8 ; 10) : petite fille du poète Agrippa d’Aubigné, elle épouse Scarron en avril 1652. Mlle de Scudéry en fait un long et minutieux portrait, au tome X de Clélie, histoire romaine. Après la mort de Scarron, la future Madame de Maintenon devient la gouvernante des enfants illégitimes de Louis XIV et de la marquise de Montespan, puis la femme morganatique de Louis XIV.
Aubijoux, François-Jacques d’Amboise, comte d’, 1606-1656 (III, 5) : un des chambellans du duc d’Orléans, connu pour son esprit libertin.
Auguste, 63-14av. J.-C.(I-7, 31 – II, 8 – V, 7 – VII, 16) : Gaïus Octavius, d’abord triumvir, devenu empereur après sa victoire sur Antoine. Il fut célébré comme le représentant exemplaire des vertus romaines.
Aumalle, Charles d’, † 1654 (IV, 11) : « cadet d’Haucourt », parce que fils cadet de Daniel d’Aumalle, seigneur de Haucourt (voir à ce nom son frère aîné). Scarron en parle comme d’un auteur (« que j’estime / Et pour la prose et pour la rime »), notamment d’une « ingénieuse épître » en vers, introuvable cependant.
Aumalle, Jeanne d’, † 1694 (IV, 13) : demoiselle de Haucourt, une sœur de Charles.
Aumalle, Suzanne d’, † 1688 (IV, 13) : autre sœur de Charles, une précieuse réputée qu’on appelle « Mlle d’Aumalle ».
Aumont, Antoine d’ : voir Villequier
Aumont, César d’, † 1661 (III, 2) : marquis de Clairvaux, dit « le marquis d’Aumont », gouverneur de la Touraine, conseiller du roi.
Aumont, Jean VI d’, † 1595 (V, 11) : comte de Châteauroux, maréchal de France, il contribua beaucoup à la victoire d’Henri IV à Ivry. Il est le grand-père d’Antoine, César et Roger d’Aumont.
Aumont, Roger d’, † 1653 (III, 2 – VII, 9) : frère cadet de César d’Aumont, abbé d’Uzerche et de Barzelle, puis évêque d’Avranches en 1645 ; il résigna ce sacerdoce le 5 janvier 1651.
Ausone (VIII, 3) : poète latin du ive siècle ap. J.-C.
Avaugour, Louis de Bretagne, marquis d’, † 1669 (III, 4 ; 5) : frère de la duchesse de Montbazon. « Il ne manque pas d’esprit, mais il est bizarre et aime le procès. […] C’est un grand et gros homme » (Tallemant, II, 223-224). Il a deux sœurs, voir Clisson et Montbazon. Il épousa Mlle du Lude en premières noces.
649Balesdens, Jean, † 1675 (IV, 16 – VIII, 8) : il avait choisi l’état ecclésiastique et était devenu en 1637 protonotaire apostolique et l’un des nombreux aumôniers du roi ; il fit en même temps une carrière d’avocat. Attaché au chancelier Séguier et surtout reconnu pour ses éditions d’auteurs anciens comme Ésope et saint Grégoire de Tours, il fut admis en 1647 à l’Académie, dont Séguier est « protecteur ».
Ballon, Antoine (VI, 11) : maître à danser.
Balzac, Jean-Louis Guez de, v. 1597-1654 (IV, 1 ; 17) : la polémique contre Balzac, déclenchée par son premier recueil de lettres (Lettres du sieur de Balzac, 1624), est calmée depuis bien des années lorsque Scarron écrit, en 1643, « Aux vermisseaux ». Il vit retiré à Balzac, et il est alors occupé à préparer la publication des Œuvres diverses du sieur de Balzac (1644).
Bamboche, Pierre van Laer, dit, v. 1592-1642 (IV, 17) : surnommé Bamboccio, célèbre peintre réaliste hollandais.
Barbe, sainte (III, 7) : Barbara, vierge de Nicomédie persécutée par son père Dioscure au iiie siècle. Les poètes burlesques y font souvent référence, notamment à la rime.
Barberini, Antoine, 1607-1671 (V, 18) : neveu du pape Urbain VIII (Maffeo Barberini, mort en 1644), réfugié à Paris avec ses deux frères à l’automne de 1646 pour fuir la persécution dirigée contre eux par le nouveau pape Innocent X. Il fut nommé grand aumônier de France en 1653, et il le resta jusqu’à sa mort. Reparti à Rome en 1653, il n’est en fait jamais revenu en France (sa charge n’exigeait pas la résidence).
Barberini, Taddeo, 1603-1647 (VII, 13) : préfet de Rome, autre neveu du pape Urbain VIII. Il se peut que sa mort à Paris (le 2 novembre 1647) ait donné lieu à des soupçons contre Mazarin, qui pourtant protégea les Barberini contre le pape.
Bardouillère, Louis Bardouil, seigneur de la (III, 5) : l’un des écuyers du duc d’Orléans.
Barillon, Jean-Jacques, 1601-1645 (II, 1 – VII, 13) : président de la chambre des Enquêtes du Parlement, il est exilé en même temps que le père de Scarron pour sa position contre Richelieu. Rappelé après la mort de ce ministre, il est arrêté en avril 1645 et envoyé à la prison de Pignerol. C’est là qu’il meurt de la fièvre quelques mois plus tard.
Baron (VII, 20) : il y avait, dans la région de Marennes, une famille Baron ; mais la cible de Scarron n’a pu être identifiée.
Baroni, Leonora, 1611-1670 (II, 12) : cette chanteuse a été célébrée par les gens de lettres de tous les pays. Vers 1630, à Rome, elle passait pour la maîtresse de Mazarin. Sur les instances de celui-ci, au printemps de 1644, Anne d’Autriche la fit venir à Paris ; elle lui accorda l’entrée permanente dans ses appartements, la fit chanter et la combla de présents. Elle repartit pour Rome le 10 avril 1645, après l’élection du nouveau pape.
Barrière, Henri Grimoard, dit de Taillefer, seigneur de (III, 4) : fils d’un gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, il sert comme capitaine.
Bassompierre, François de, 1579-1646 (III, 2) : maréchal de France et colonel général du régiment des Suisses, auteur de Mémoires (Cologne, 1665). Emprisonné à la Bastille par 650Richelieu pendant douze ans, il en sort en 1643, par suite de la mort de celui-ci. Il était réputé bien fait et galant.
Bassompierre, Madame de, † 1664 (III, 2) : Marie de Balzac d’Entragues, maîtresse du maréchal de Bassompierre qui n’a pas voulu l’épouser, se fit néanmoins appeler Mme de Bassompierre (Tallemant, I, 598-599).
Bautru, Guillaume, 1588-1669 (III, 4) : comte de Serrant, il est académicien, conseiller d’État et introducteur des ambassadeurs. Très dévoué à Richelieu et à Mazarin, il a été ambassadeur en Angleterre, en Espagne, aux Pays-Bas, puis en Savoie. Il s’est toujours fait admirer pour ses bons mots (Tallemant, I, 365-372). Il souffre beaucoup de la goutte : c’est pourquoi il est allé faire une cure à Bourbon l’Archambault.
Beaufort, François de Vendôme, duc de, 1616-1669 (VII, 13) : pair de France, petit-fils d’Henri IV et de Gabrielle d’Estrées. Soupçonné de vouloir tuer Mazarin, il fut emprisonné à Vincennes le 2 septembre 1643. Il s’évada le 31 mai 1648. Dès le début du blocus de Paris, en janvier 1649, il vint se joindre aux Frondeurs ; à la tête de leurs troupes, il prit part à de nombreux combats. Plus tard, pendant la seconde Fronde, il fut fidèle aux Frondeurs et participa au combat du faubourg Saint-Antoine (2 juillet 1652).
Beaumont, Roberte le Normant, fille de Charles le Normant, seigneur de, † 1661 (III, 6) : elle est dame d’atour d’Anne d’Autriche et doit cette situation à l’amitié de Mme de Hautefort. Son amie Mme de Motteville parle abondamment d’elle dans ses Mémoires.
Beauvilliers,Anne-Berthe de (III, 4) : sœur d’Anne-Marie de Beauvillier.
Beauvilliers,Anne-Marie de, † 1680 (III, 4) : femme d’Hippolyte de Béthune ; elle devint dame d’atour de la reine Marie-Thérèse.
Beauvilliers,François de : voir Saint-Aignan
Belin, Henriette Potier, comtesse de, † 1680 (III, 2) : veuve du comte de Belin, qu’elle avait épousé en 1633 et qui avait une réputation de mécène parmi les gens de lettres. Elle est la nièce de Mme de Blérancourt. Elle habite près du couvent des Minimes, c’est-à-dire à proximité de la Place Royale.
Bellièvre, Pompone II de, 1606-1657 (II, 13) : premier président au Parlement (à partir du 22 avril 1653). Il fut ambassadeur en Italie (1635), en Angleterre (1637-1640), puis de nouveau en Angleterre (1646-1647). En mai 1654, Scarron lui dédia l’édition collective de ses Œuvres. Son grand-père, Pomponne de Bellièvre (1529-1607), avait eu différentes fonctions à la cour des Valois, et avait été promu Chancelier de France en 1599.
Belloy, Hercule de (III, 5) : un des écuyers du duc d’Orléans, dont il devint capitaine des gardes du corps. En mars 1649, il fit un mariage malheureux, dont parle Tallemant (II, 165).
Belot : voir Blot
Benserade, Isaac de, 1612 ?-1691 (IV, 12 – V, 13 – VIII, 8) : vers 1650, il a déjà publié plusieurs pièces de théâtre, et les anthologies contiennent de très nombreuses poésies de lui : sa vogue est donc très grande. C’est en 1638 qu’il a écrit son fameux sonnet de Job, auquel on compare le sonnet d’Uranie par Voiture. La querelle opposa la duchesse de Longueville 651et ses amies, qui déclaraient pour Voiture, au prince de Conti son frère, qui tenait pour Benserade.
Bernard, Claude (III, 5) : dit le pauvre prêtre, est mort depuis un an en 1642 ; il prêchait dans les hôpitaux, dans les prisons, sur les places publiques (Tallemant, II, 68).
Bertillac, sans doute Étienne Jehannot, seigneur de Bartillat, 1610-1701 (II, 11) : il fut trésorier général de la maison de la reine mère.
Béthune, Hippolyte de, 1603-1665 (III, 4) : dit le comte de Béthune, neveu de Sully, très lettré, il vit loin de la cour, au milieu de ses livres, dans le Berry. À sa mort, il légua au roi plus de 2500 manuscrits, recueillis par son père et lui, la fameuse collection de Béthune.
Beuvron, Catherine-Henriette de Harcourt, Mlle de (IV, 13) : fille de François II de Harcourt, marquis de Beuvron, gouverneur du vieux palais de Rouen ; elle est cousine germaine de la comtesse de Fiesque. « Sage et vertueuse », c’est « une des plus belles personnes de la cour » (Tallemant, II, 649-650).
Beys, Charles, 1610-1659 (VIII, 3) : auteur de tragi-comédies (L’Hôpital des fous, 1634) et poète ; il publia ses Œuvres poétiques en 1652 et des Odes d’Horace en vers burlesques en 1653.
Bèze, Théodore de, 1519-1605 (VIII, 2) : grand érudit calviniste du xvie siècle, traducteur des Psaumes et auteur de nombreux pamphlets pendant les guerres de religion.
Billaut, Adam, dit Maître Adam, 1602-1662 (IV, 5) : auteur des Chevilles de Me Adam, menuisier de Nevers (1644), célébré plus ou moins ironiquement par les poètes du temps. Saint-Amant, Corneille, Boisrobert, Scarron, Tristan et Vion d’Alibray, parmi d’autres, participèrent à l’« Approbation du Parnasse ».
Biou (VII, 20) : « Je ne suis pas parvenu à identifier ce personnage : le Catalogue des partisans n’en parle pas et je n’en ai pas trouvé trace aux Archives nationales. Au Cabinet des titres, j’ai trouvé une famille de l’époque qui signe Billioud : il est probable que c’est celle du partisan dont parle ici Scarron, qui compte “Biou” pour deux syllabes » (M. C., II, p. 303). P. Morillot croit pour sa part que Scarron parle de lui-même à cet endroit (p. 126), hypothèse qui pourrait être plausible si l’implication de Scarron dans l’affaire des débets pouvait être prouvée (voir É. Magne, p. 267).
Bitaux, François, † 1646 (II, 1) : conseiller au Parlement, exilé en même temps que le père de Scarron.
Blanchardière (III, 5) : les seigneurs de la Blanchardière appartenaient à la famille des Audouin au xviie siècle, et plusieurs ont tenu des rôles importants (maires, échevins, conseillers) dans la ville d’Angers.
Blérancourt, Charlotte de Vieux Pont (III, 2) : femme de Bernard Potier, seigneur de Blérancourt, lieutenant général de la cavalerie légère de France.
Blondeau (IV, 11– VII, 16) : tenancière d’une maison de jeux. « La Blondeau, qui tient une académie de jeu à la place Royale (Tallemant, II, 750), est peut-être Jeanne Magnin, veuve de Louis Blondeau, tavernier » (M. C., I, p. 473).
Blot (Belot), Claude de Chauvigny, baron de Blot-l’Église, v. 1605-1655 (III, 5) : l’un des chambellans du duc d’Orléans, qui s’est acquis une grande renommée pour ses chansons satiriques, frondeuses et antireligieuses.
652Bocan, Jacques Cordier, dit, † 1653 (VI, 11) : maître à danser.
Boileau, Gilles, 1631-1669 (IV, 16 ; 17 – VIII, 5) : frère aîné de Nicolas Boileau-Despréaux, avocat au Parlement. Son élection à l’Académie au cours de l’année 1659 provoqua une violente querelle parmi les gens de lettres. Il a écrit quelques épigrammes qui visent Scarron, et mettent en doute la vertu de sa femme.
Bois-Dauphine, Anne-Marie de Ryantz (III, 2) : femme d’Urbain de Laval, marquis de Bois-Dauphin, fille d’un maître des requêtes.
Boisrobert, François Le Métel de, 1589-1662 (II, 8 – IV, 16 – VII, 16 – VIII, 8) : il fut comblé de bienfaits par le cardinal de Richelieu, dont il était le confident et l’amuseur, et qui lui procura l’abbaye de Châtillon-sur-Seine et plusieurs prieurés. Il fut la providence des gens de lettres, qu’il recommandait à la générosité du cardinal. Il avoue appartenir au courant du « bon burlesque » dans ses Épîtres (parues en 1647 et en 1659). Scarron se fâcha contre lui en 1655 à cause de rivalités littéraires.
Boisvinet (VI, 11) : personnage non identifié, sans doute maître à danser.
Boucher, René ? (VIII, 10) : poète et auteur dramatique, on lui attribue (d’après le catalogue de la BnF et Cioranescu) la Pompe funèbre de M. Scarron, Le Roman des oiseaux, Champagne le coiffeur, les maximes de La Rochefoucauld mises en vers.
Bouciquault, Philippe (VII, 9) : seigneur des Moulins, gendarme de la compagnie du duc d’Orléans.
Boulay, Nicolas Brulart, seigneur du (III, 5) : un des huit premiers chambellans du duc d’Orléans ; il le fait capitaine du palais de Luxembourg. C’est « un assez plaisant homme », dit de lui Tallemant des Réaux, qui cite plusieurs de ses traits d’esprit (I, 354).
Bourbon, Anne-Geneviève de, 1619-1679 (IV, 12 – V, 7) : fille d’Henri II de Bourbon-Condé, seconde femme d’Henri II d’Orléans, duc de Longueville.
Bourbon, Armand de, 1629-1666 (V, 7, 18 – VII, 13) : fils cadet d’Henri de Bourbon, frère cadet du grand Condé, prince de Conti, il est destiné depuis son enfance à l’état ecclésiastique ; dès 17 ans, il est abbé de plusieurs abbayes importantes. Il soutient sa thèse en théologie à la Sorbonne le 14 juillet 1646. Devenu militaire après la Fronde, il dirige les armées françaises avec le vicomte de Turenne, se battant souvent contre son frère Condé, passé aux Espagnols.
Bourbon, Henri II de, 1588-1646 (V, 7) : prince de Condé, premier pair et grand maître de France, époux de Charlotte Marguerite de Montmorency, dont il eut trois enfants, Anne-Geneviève, Louis et Armand. À partir de la mort de Louis XIII, il préside les divers conseils du roi ; dans ces importantes fonctions, il sait ménager les intérêts de tous ceux qui ont quelque autorité. Selon Tallemant, il avouait lui-même sa poltronnerie, mais il avait « l’âme d’un intendant de grande maison : jamais homme n’a tenu ses papiers en meilleur ordre. […] Jamais il n’y a eu maison mieux réglée : ce n’eût pas été un mauvais Roi » (I, 420).
Bourbon-Condé, Louis II de, 1621-1686 (III, 7 – V, 7 ; 9 ; 11 – VII, 7 ; 13 ; 15 – VIII, 1) : duc d’Enghien, vainqueur de Rocroi, celui que la postérité appelle le grand Condé. En collaboration 653avec le duc d’Orléans, il fit, pendant l’été de l’année 1646, une brillante campagne en Flandres, qui commença par la prise de Courtrai (juin) ; il prit ensuite Mardyck (août) et Dunkerque (octobre). En 1648, il s’empara de Lens. « À la fin de 1648, le prince de Condé “traita avec le cardinal et se livra tout entier moyennant Stenay, Clermont et Jametz, qu’on lui promit en toute souveraineté” (Goulas, Mémoires, II, 370) » (M. C., II, p. 31). Le 18 janvier 1650, le prince de Condé fut arrêté avec le prince de Conti et le duc de Longueville ; d’abord emprisonnés à Vincennes, ils furent transférés à Marcoussis en septembre, puis au Havre en novembre. Ils furent libérés le 13 février 1651. À la mort de son père, il devint prince de Condé.
Bourgoing, François, 1585-1662 (III, 5) : fils d’un érudit qui était conseiller à la cour des aides, il est, à partir de mai 1641, supérieur général de la congrégation des prêtres de l’Oratoire. Il a écrit plusieurs livres de piété ; il publia en 1644 une édition des œuvres du cardinal de Bérulle.
Bouthillier, Claude, 1581-1652 (III, 4) : seigneur de Pont, surintendant des finances à partir de 1632 ; sa femme, Marie de Bragelongne, est fille d’un conseiller au Parlement de Paris.
Bragelongne, Marie de (III, 4) : femme de Claude Bouthillier.
Brion, François-Christophe de Lévis, comte de (III, 5) : il est premier écuyer du duc d’Orléans ; frère de Charles de Lévis, duc de Ventadour.
Brisson, Barnabé (V, 2) : sieur de la Boissière, cousin germain de Scarron ; celui-ci lui offre des vers liminaires pour son ouvrage Les Douze récréations de la muse (1646).
Brogle, Francesco-Maria di Broglia, 1611-1656 (V, 18) : un des principaux commandants en chef de la Guerre de Trente ans, il s’était mis au service de la France ; il fut naturalisé français en 1643.
Brunehault, 547-613 (IV, 16) : reine des Francs.
Brunyer, Abel (III, 5) : premier médecin du duc d’Orléans.
Bruslé, Antoine (II, 13) : procureur au Parlement.
Bullion, Claude de, 1569-1640 (IV, 16) : il fut un des principaux personnages de la cour à l’époque du cardinal de Richelieu, qui le fit surintendant des finances. « Il craignait terriblement les bonnes odeurs » (Tallemant, I, 302).
Bussy, Pierre Huault, marquis de Vayre(s) et seigneur de (III, 5) : maître de camp de cavalerie, il est blessé le 4 juin 1641 au passage de la rivière de Perpignan, puis, six jours après, devant Terragone : c’est donc pour sa convalescence qu’il est venu, en mai-juin 1642, aux eaux de Bourbon.
Calvin, Jean, 1509-1564 (III, 5) : l’un des plus célèbres réformateurs de l’Église, fondateur de la doctrine protestante.
Canole, N. de (VII, 13) :officier du roi, il se trouvait à Bordeaux lorsqu’on apprit dans cette ville, le 6 août 1650, la pendaison du frondeur Richon, commandant du château de Vayres ; il fut pendu le jour même en représailles par les frondeurs de Guyenne.
Caracène, Luis de Benavides Carrillo, marquis de Caracena, 1608-1668 (V, 18) : gouverneur de Milan de 1648 à 1656.
Casaubon, Isaac, 1559-1614 (V, 7) : humaniste protestant, gendre d’Henri Estienne, il fut professeur de grec 654à Paris et garde de la bibliothèque d’Henri IV ; il mourut à la cour d’Angleterre. Ses commentaires sur les Caractères de Théophraste (1592) sont considérés au xviie siècle comme le summum de l’érudition.
Caton, Marcus Porcius Cato, dit l’Ancien ou le Censeur, 234-149 av. J.-C. (II, 1 ; 12 – IV, 8 – V, 12 – VII, 13 ; 21 – VIII, 3 ; 8) : homme politique romain reconnu pour ses mœurs sévères et sa critique du luxe et de l’influence de la culture grecque sur l’identité romaine.
Catulle, Catullus (IV, 8 – VII, 13) : poète latin du ier siècle av. J.-C., auteur notamment d’une pièce contre César dans laquelle il conclut que le débauché Mamurra et lui sont bien faits l’un pour l’autre.
Cerbelon, Gerardo de Cervellón y Mercader (V, 8 ; 10) : général espagnol qui menait le siège de Leucate (1636-1637), et qui fut vaincu par les troupes françaises, menées par le maréchal Charles de Schonberg.
César, Jules (I-1, 43 – V, 7 ; 11 – VII, 13 ; 16) : homme politique et général romain du ier siècle av. J.-C., bien connu pour ses conquêtes en Gaule et la guerre civile qu’il provoqua en dirigeant ses armées contre Rome. Élu dictateur après sa victoire contre Pompée, il est assassiné par Brutus en plein Sénat romain.
Champ-Moreau, Balthazar de La Croix, seigneur de (III, 5) : il a levé des troupes pour le service du duc d’Orléans, au temps où celui-ci était en lutte contre l’autorité royale de son frère Louis XIII.
Chapelain, Jean, 1595-1674 (VII, 21) : l’un des fondateurs de l’Académie française, poète et théoricien de ce qu’on a appelé plus tard la « doctrine classique », auteur notamment du poème épique La Pucelle dont les 12 premiers chants paraissent en 1656. Il vécut vingt-quatre ans chez le duc de Longueville dont il était généreusement pensionné.
Charmois, Joseph du (III, 5) : seigneur de Marchefoy, il est capitaine des gardes de la porte du duc d’Orléans. Au printemps de 1648, un enlèvement, auquel il participa, fit parler tout Paris (Tallemant, I, 602).
Chémeraut, Françoise de Barbesières, demoiselle de la Roche-Chémereau (III, 5) : fille d’honneur de la reine à partir de 1632 ; mais elle est, comme Mme de Hautefort, en disgrâce à partir de novembre 1639 et ne fut rappelée à la cour qu’après la mort de Richelieu.
Chigi, Mario (V, 18) : frère du pape Alexandre VII, nommé généralissime des armées de la sainte Église. Son fils, Flavio Chigi, fut créé cardinal en avril 1657.
Christine de Suède, 1626-1689 (II, 12) : elle succéda en 1632, à l’âge de 6 ans, à son père Gustave-Adolphe. Très cultivée, elle s’efforce d’attirer à Stockholm les gens de lettres et les érudits les plus fameux de l’Europe. Aussi d’innombrables écrivains lui envoient-ils leurs œuvres nouvelles, avec des dédicaces flatteuses. Elle abdique en 1654 et entreprend de longs voyages, qui l’amènent notamment à Paris en 1656.
Cicéron, Marcus Tullius Cicero (VIII, 8) : orateur, philosophe et homme d’État romain du ier siècle av. J.-C., dont les œuvres sont beaucoup lues et étudiées au xviie siècle.
Cid, Rodrigo Diaz de Vivar, dit le (V, 7) : héros qui combattit contre les Maures lors de la Reconquista655espagnole (xie siècle), et a servi de source d’inspiration à Guillén de Castro et à Pierre Corneille.
Cinq-Mars, Henri Ruzé, marquis de, 1620-1642 (VI, 6) : favori de Louis XIII, grand écuyer de France, il fut décapité à Lyon avec son complice François-Auguste de Thou, pour complot contre Richelieu.
Clinchamps, Bernardin de Bourgueville, baron de, † 1649 (III, 5) : gentilhomme ordinaire du duc d’Orléans. Tallemant dit de lui : « il n’a jamais passé pour homme de cœur et a fait en sa vie plus de cent tours de filou » (II, 488).
Clisson, Constance-Françoise de Bretagne, demoiselle de, † 1695 (III, 4) : sœur de d’Avaugour.
Clodion (II, 8) : surnommé le chevelu, chef d’un des peuples germaniques qui constituent la ligue des Francs vers 390-450, et, comme tel, considéré comme roi de France successeur de Pharamond par l’historiographie du xviie siècle.
Clovis, 466 ?-511 (II, 8) : l’un des rois francs de la lignée des Mérovingiens, il s’est converti au catholicisme et s’est fait baptiser par saint Rémi. Desmarets de Saint-Sorlin a écrit un poème épique en 1657 intitulé Clovis ou la France chrétienne.
Collard, Mathieu (III, 5) : premier chirurgien du duc d’Orléans à partir de février 1642.
Colletet, François, 1628-1680 (IV, 16 – VIII, 7) : fils de Guillaume qui n’atteindra jamais la renommée de son père, auteur du Journal contenant la relation véritable et fidèle du voyage du roi et de Son Éminence, pour le traité du mariage de Sa Majesté et de la paix générale (1659-1660) et de nombreuses relations des fêtes parisiennes célébrant le mariage de Louis XIV (août 1660). Il a aussi travesti Juvénal en vers burlesques (1657).
Colletet, Guillaume, 1598-1659 (IV, 16) : auteur de poésies, de pièces de théâtre, d’un traité de L’Art poétique et d’une histoire de la poésie française restée inachevée et manuscrite, il est un des hommes de lettres importants de la première moitié du xviie siècle.
Colonna, Girolamo, 1604-1666 (VII, 13) : ami de Mazarin en sa jeunesse, ayant fait ses études à Alcala (Espagne) avec lui. Il est créé cardinal par Urbain VIII en 1627.
Conchine, Concino Concini, 1569-1617 (VII, 13) : marquis d’Ancre, favori de Marie de Médicis ; il pilla les finances et fut tué d’un coup de pistolet par ordre du roi Louis XIII. Mazarin, censé lui ressembler, est souvent menacé de son sort (le peuple de Paris fit subir à son cadavre toutes sortes d’avanies).
Condé : voir Louis II de Bourbon-Condé
Contade, Charlotte Gandillaud (III, 5) : seconde femme d’André de Contades, fille du lieutenant général de l’Angoumois.
Conti : voir Armand de Bourbon
Conti, Natale, 1520-1582 (I-3, 158, 364 ; I-5, 326) : mythographe de la Renaissance connu aussi sous la forme latinisée de son nom, Natalis Comes, que Scarron francise en Noël Le Comte.
Corneille, Pierre, dit l’aîné, 1606-1684 (II, 11 – III, 5 – IV, 1 ; 16 – VII, 16 ; 19 – VIII, 8) : dramaturge, dont Scarron, qui dit l’admirer dans Le Roman comique, cite LeCid (1637), Cinna (1641), Héraclius (1647), ainsi que Nicomède (1651). L’échec de Pertharite, roi des Lombards (fin 1651) l’aurait décidé à renoncer au théâtre : il remplit ses charges familiales et 656d’officier à Rouen, et traduit en vers L’Imitation de Jésus-Christ. En 1659, sur les instances de Fouquet, il revient au théâtre avec sa tragédie Œdipe.
Corneille, Thomas, dit le jeune, ou le cadet, 1625-1709 (VIII, 8) : il commença par des comédies imitées d’auteurs espagnols et se trouva en compétition directe avec Scarron pour Les Illustres ennemis (1655) et Le Geôlier de soi-même (1656). Outre son chef-d’œuvre Timocrate joué en 1656, il remporte un grand succès avec son Stilicon (première représentation le 27 janvier 1660).
Corolet (VIII, 1) : sans doute imprimeur-libraire.
Cossé, Charles de (III, 7) : sixième enfant de François de Cossé, duc de Brissac. Il a 18 ans en 1646 ; il devint jésuite, puis quitta cet ordre et devint abbé de Mores en 1661.
Cossé, Marie de (III, 4) : seconde femme de Charles de La Porte, maréchal de la Meilleraye, aînée des neuf enfants du duc de Brissac ; elle « est jolie et chante bien [… et] ne manque pas d’esprit », mais se rend ridicule en prétendant descendre d’un empereur romain (Tallemant, I, 327-328).
Cotin, Charles, 1604-1681 (VIII, 8) : aumônier du roi, poète et abbé galant, il est élu académicien en 1655 après s’être illustré par ses Énigmes (1645). Ses Œuvres mêlées ont paru en avril 1659 ; au début de février 1660, a paru son pamphlet contre Ménage intitulé La Ménagerie.
Coton, Pierre, 1564-1626 (I-6, 76) : jésuite, confesseur d’Henri IV et de Louis XIII.
Courbé, Augustin (II, 11 – IV, 7) : « imprimeur-libraire » (éditeur) de nouveautés littéraires.
Courcy : voir Robert Aubery
Cugnac, Françoise de (III, 5) : fille et unique héritière de François de Cugnac, marquis de Dampierre, et épouse du comte de Nançay.
D ’ Alesme (III, 5) : aumônier et confesseur du commun (c’est-à-dire du personnel subalterne) du duc d’Orléans.
D ’ Artige, Clément Le Musnyer, seigneur de, † 1664 (VI, 12) : selon M. Cauchie, « père conscrit » serait un synonyme de conseiller au Parlement de Paris (I, p. 510). Conseiller depuis 1611, il fait partie des opposants à Mazarin.
Dassoucy, Charles Coypeau, 1605-1677 (IV, 9) : en tant que musicien, il a composé des airs de cour et a participé à la musique d’Andromède de Corneille. Il était aussi auteur de vers burlesques, notamment du Jugement de Pâris et de l’Ovide en belle humeur.
De Hally, Christophe (III, 5) : comte de la Ferrière, capitaine des gardes du duc d’Orléans.
Delfin, Benoît d’Istria, dit Delfino ou (III, 5) : gentilhomme ordinaire du duc d’Orléans et maître d’hôtel de la duchesse depuis 1627. Il était, vers cette époque, mêlé à toutes les intrigues. Comme il n’exerce plus de fonctions chez le duc d’Orléans en 1642 mais fait encore partie de son entourage, il doit être assez âgé.
Démocrite, 460-370av. J.-C. (VIII, 3) : philosophe et savant grec, père de l’atomisme en physique. Il est souvent représenté comme le philosophe rieur devant la folie du monde, par opposition à Héraclite, celui qui pleure de la condition humaine. Des Lettres attribuées à Hippocrate analysent sa prétendue folie, thème repris par La Fontaine dans « Démocrite et les Abdéritains » (VIII, 26).
657Démosthène (V, 7) : orateur et homme politique athénien du ive siècle av. J.-C., modèle de l’orateur défendant les intérêts de la cité devant la menace du tyran.
Descars, Mlle : voir Charlotte de Hautefort
Deslandes-Payen, Pierre, † 1663 (VI, 12) : conseiller au Parlement, d’allégeance frondeuse. Scarron lui dédie le cinquième livre du Virgile travesti et une épître qui commence par « Âme élevée au-dessus du vulgaire » (M. C., I, p. 462).
Des Marais, Mlle (VII, 20) : femme de Baron, qui logeait chez la duchesse d’Aiguillon avant son mariage. Sur la pauvreté de son père, voir Ruzé
Desmarets de Saint-Sorlin, Jean, 1595-1676 (IV, 1) : auteur rattaché à Richelieu dans les années 1620 et 1630, fortement impliqué dans l’Académie naissante et dans le théâtre de cette époque, entre autres par ses pièces LesVisionnaires (1637), Roxane (1639) et Europe (1643). Après avoir publié son poème épique, Clovisou la France chrétienne (1657), il se lance dans la polémique contre les jansénistes et contre les partisans du merveilleux païen, qui préfigure la Querelle des Anciens et des Modernes.
Despallais (III, 5) : personnage non identifié.
Desportes, Philippe, 1545 ?-1606 (II, 8 – VII, 16) : poète, abbé de plusieurs abbayes, qui lui rapportaient des revenus considérables. « Jamais poète n’a été si bien payé de ses vers que Philippe Desportes » (Moréri).
Dubois, Étienne (III, 5) : un des valets de chambre du duc d’Orléans.
Dufresne (VII, 6) : personnage inconnu, même si le contexte nous incite à croire qu’il s’agit d’un criminel notoire.
Égully, René Grongnet, seigneur d’, v. 1593-1638 (III, 4) : il fut tué, comme capitaine d’une galère, au combat naval de Gênes. « On l’appelait le beau d’Esguilly » (Tallemant, I, 338), et Louis XIII, dans son amour platonique pour Mme de Hautefort, était jaloux de lui. Il était, par sa mère, cousin germain du futur cardinal de Retz, qui dira de lui, dans ses Mémoires (I, 132 in Œuvres, Pléiade), qu’il fut « le plus honnête homme de son siècle ».
Elbène, Alexandre d’, † 1687 (IV, 16 – VII, 21) : seigneur de la Motte Tilly, fils du parrain de Scarron, il servit avec réputation dans les armées. C’est un des meilleurs amis de Scarron. Aimable épicurien, il est renommé pour son esprit.
Elzévire, ou Elzévier (IV, 11) : famille de typographes hollandais, actifs durant tout le xviie siècle. Le caractère qu’ils ont inventé, outre son élégance, permet d’utiliser un corps plus petit, donc d’éditer en petit format. Ils rééditaient les succès de la librairie parisienne et, à cet égard, ont publié plusieurs œuvres burlesques.
Enghien, duc d’ : voir Louis II de Bourbon-Condé
Épagny, Honoré Gouffier, abbé d’, † 1653 (V, 14) : abbé de Valsery, on l’appelle abbé d’Épagny parce que son père est seigneur d’Épagny.
Épicure, 341-270av. J.-C. (VII, 19) : philosophe grec dont la doctrine définit une sagesse marquée par la recherche de la tranquillité de l’âme (l’ataraxie) et l’évitement des peines ou des douleurs, notamment celles causées par la crainte des dieux ou de la mort.
Érasme, † 1536 (VIII, 8) : le plus grand humaniste de la Renaissance.
658Faustine (IV, 16) : femme et cousine de Marc-Aurèle dont elle eut une douzaine d’enfants.
Favoras, Jean de Favoral, seigneur de Moussardières (III, 5) : lieutenant de la porte chez le duc d’Orléans.
Ferrand, David, 1590-1660 (VII, 9) : imprimeur et poète de Rouen, auteur de La Muse normande qui paraît de 1625 à 1651.
Fiesque, Gillonne de Harcourt, comtesse de, 1619-1699 (III, 2 – IV, 13) : nièce du marquis de Beuvron, mariée en premières noces à Louis de Brouilly, marquis de Piennes, mort en 1640. Elle se remaria avec Charles-Léon de Fiesque en 1643. Les deux ont joué un rôle important pendant la Fronde, lui auprès de Condé, elle auprès de Mademoiselle. Scarron leur dédie le sixième livre du Virgile travesti en leur demandant un petit chien.
Flotte, Jean-Jacques, 1583- ? (V, 5 – VI, 12) : gentilhomme ordinaire du duc de Guise, il est né à Toulouse comme le poète François Maynard, dont il est l’ami intime et le correspondant à Paris. Sa réputation de grand buveur est établie.
Folengo, Teofilo, dit Merlin Coccaie (Merlino Coccaio), 1491-1544 (VIII, 1) : auteur du Baldus (1517), dont une traduction française sous le titre d’Histoire macaronique parut en 1610.
Fouquet, Nicolas, 1615-1680 (I-7, 6, 23, 106, 111, 805 – II, 17 ; 18 – III, 12 – IV, 17 – VII, 19 ; 21) : vicomte de Melun et seigneur de Vaux, il est procureur général du roi au Parlement à partir de 1650 ; il est nommé surintendant des finances en 1653. Dès lors, il devient, pour les gens de lettres, un mécène d’une inépuisable générosité, notamment envers Scarron. On lit en tête du Gardien de soi-même (1655) : « Vous avez prévenu les services que je vous pourrais rendre, par des bienfaits que vous ne me deviez pas ». Son secrétaire Paul Pellisson joue souvent le rôle d’intermédiaire entre le poète et le « patron ».
Foureau, Léon (V, 16) : fils d’un contrôleur général de l’ordinaire des guerres, il devint conseiller au Parlement.
France, Henriette-Marie de : voir Henriette-Marie
Franchesse, Claude Mareschal, seigneur de (III, 5) : sa femme se nomme Charlotte duChasteau. Franchesse se trouve à une lieue et demie au nord de Bourbon l’Archambault.
Francinet (IV, 8) : personnage non identifié.
François I er , 1494-1547 (II, 12) : de la dynastie des Valois,l’un des plus grands rois français de la Renaissance, bâtisseur du château de Fontainebleau, patron des arts et des lettres.
Franctot, Jacques Guillotte, dit l’abbé de Franquetot (IV, 13) : aumônier ordinaire du roi. Segrais dit de lui : « L’Abbé de Franquetot était fertile en imaginations et en pensées extraordinaires, et cela lui donnait entrée partout » (Segraisiana).
Frangipani, Pompeo (V, 4) : ce marquis était célèbre pour avoir inventé un parfum à base d’amandes. Il s’en servait pour parfumer ses gants.
Fransure, Alexandre de Fransures, seigneur de Douaurin (III, 5) : gentilhomme ordinaire de la chambre du duc d’Orléans, exempt des gardes anciens du corps dudit prince et gentilhomme ordinaire de la duchesse.
Frétoy, Antoine d’Estourmel, seigneur de (III, 5) : lieutenant des chevau-légers du duc d’Orléans.
659Furetière, Antoine, 1619-1688 (IV, 16) : rival de Scarron dans la vogue du burlesque par ses Amours d’Énée et Didon (1648) et son Voyage de Mercure (1653) ; il a publié en 1655 un recueil de ses Poésies diverses (dont des satires). Sa Nouvelle allégorique ou Histoire des derniers troubles arrivés au royaume d’Éloquence (1658) lui assure l’élection à l’Académie française.
Galien (III, 5) : médecin grec du iie siècle apr. J.-C., dont le système fondé sur l’équilibre des quatre humeurs (sang, bile, bile noire et phlegme) et les quatre qualités (chaud/froid, sec/humide) est encore enseigné dans les facultés de médecine de la France du xviie siècle.
Ganelon, Henri (VII, 3) : pseudonyme probable, formé à partir de celui qui trahit Roland, dans la Chanson de Roland, devenu symbole de la traîtrise.
Gassion, Jean de, 1609-1647 (V, 9) : maréchal de France béarnais, il est reconnu pour sa bravoure et par la hardiesse de ses entreprises militaires ; « il était fort sobre ; il n’était point joueur non plus, ni adonné aux femmes » (Tallemant, II, 84). Pendant toute la durée de la victorieuse campagne des Flandres de l’année 1646, il ne cesse de collaborer étroitement avec le duc d’Orléans, le duc d’Enghien et le maréchal von Rantzau.
Gaston de France, ducd’Orléans, 1608-1660 (III, 1 ; 5 – V, 4 – VII, 13 – VIII, 1) : frère du roi Louis XIII, il est allé soigner sa goutte aux eaux de Bourbon l’Archambault en mai-juin 1642. La relation de mécénat ne fut sans doute pas satisfaisante, puisque Scarron ne lui dédia plus aucune pièce après La Foire Saint-Germain.
Gaulmyn, Gilbert, seigneur de Montgeorges, 1585-1665 (VII, 16) : doyen des maîtres des requêtes de l’hôtel, conseiller d’État et intendant du Nivernais, il est un des plus éminents érudits orientalistes : connaissant le grec, l’hébreu, l’arabe, le turc et le persan, il a inauguré une nouvelle et fructueuse méthode d’exégèse des textes bibliques, basée sur de constants rapprochements avec les mœurs des Orientaux modernes.
Georges, saint (V, 9) : chevalier romain né en Cappadoce au ive siècle, martyrisé sous Dioclétien, représenté à cheval en armure, transperçant le dragon d’une lance.
Gondi, Jean François Paul de, 1613-1679 (VII, 13 ; 15) : coadjuteur de l’archevêque de Paris et futur cardinal de Retz, c’est un des plus actifs ennemis de Mazarin pendant la Fronde. Scarron lui dédie la première partie de son Roman comique (1651) et on dit que c’est à son instigation qu’il a composé LaMazarinade, mais Retz ne parle de Scarron à aucun endroit de ses Mémoires.
Gondras, Françoise de la Souche, veuve de Jean Desserpens, baron de (III, 5) : son mari fut tué, sans doute en duel, à en juger par l’épithète que lui applique Scarron, à Paris en 1635.
Gonnor, Charles Gouffier, comte de Gonnord, † 1671 (III, 5) : le quatrième fils de Louis Gouffier, duc de Roannais, pair de France et gouverneur de Poitiers, et de Claude-Éléonore de Lorraine, fille du duc d’Elbeuf, pair et grand veneur de France.
Goulas, Léonard, seigneur de Ferrières, 1603-1683 (III, 5) : il est conseiller d’État, conseiller privé du roi et secrétaire des commandements du duc d’Orléans.
660Gourné, Monsieur et Dame (III, 2) : il peut s’agir de Louis de Bency, seigneur de Gournay-sur-Marne, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, et de sa femme ; ou de Jean Amelot, seigneur de Gournay-sur-Aronde, président au Grand conseil, et sa femme Catherine de Creil.
Grassetière (III, 5) : personnage non identifié.
Grimaud, marquise de (III, 2) : Marie de La Baume.
Guéméné/Guéménée : voir Anne et Louis de Rohan
Guénault (III, 5) : famille de médecins et d’apothicaires parisiens. Le Guénault dont parle Scarron était médecin des eaux de Bourbon l’Archambault. Son frère est le fameux François Guénault, docteur régent de la faculté de médecine de Paris, qui a remis en vogue l’emploi thérapeutique de l’antimoine (sous forme d’émétique). Le fils du médecin de Bourbon, neveu de François Guénault, c’est Pierre Guénault, docteur régent de la faculté de médecine de Paris.
Guénégaud, Claude de, 1614-1686 (VIII, 8) : seigneur du Plessis-Belleville, il est trésorier de l’épargne à partir de 1643.
Guiche, Anne de la (III, 5) : veuve d’Henri de Schonberg, maréchal de France († 1632).
Guiche, Marie-Henriette de la, † 1682 (III, 5) : sœur aînée de la précédente, mariée en secondes noces à Louis-Emmanuel de Valois.
Guillaume d ’ Orange, 1626-1650 (II, 12) : prince d’Orange et de Nassau, il succéda le 23 janvier 1648 à son père comme gouverneur de trois provinces des Pays-Bas et amiral de la flotte de cette nation. Scarron lui a dédié sa comédie L’Héritier ridicule, ou La Dame intéressée (1650). « Son père, Henri-Frédéric de Nassau (1584 ?-1647), fut surnommé “le père des soldats” parce qu’il fit d’importantes conquêtes sans perdre beaucoup de monde. Le frère de celui-ci, Maurice de Nassau (1567 ?-1625), fut aussi un grand capitaine. Le grand-père, Guillaume de Nassau (1533-1584), fut à la fois grand capitaine et sage politique » (Moréri).
Guillaume, Jean (VII, 13) : « est, à Paris, “exécuteur des arrestz et sentences criminelles”, c’est-à-dire bourreau, conjointement avec son frère Noël » (M. C., II, p. 16).
Guise, Henri de Lorraine, duc de, 1614-1664 (VII, 13) : à la tête de la révolte des Napolitains contre les Espagnols, en 1648, il est fait prisonnier et amené en Espagne ; il ne sera libéré qu’en 1652 par Condé.
Gustave II Adolphe de Suède, 1594-1632 (II, 12) : le père de Christine de Suède, grand stratège militaire.
Hadington, comtesse d’ : voir La Suze
Hannibal (V, 11) : général carthaginois pendant la seconde guerre punique (218-202 av. J.-C.). Ses attaques ont non seulement failli entraîner la chute de Rome, mais ont surtout marqué l’imagination populaire de l’époque.
Haucourt, Philippe-Nicolas d’Aumalle, marquis d’ (IV, 13) : l’un des premiers chambellans du prince de Condé. Il s’est fixé en Hollande. Pour son frère et ses sœurs, voir Aumalle
Hautefort, Charlotte de, dite Mlle Descars (II, 3 – III, 4 ; 5 ; 6 – V, 1 ; 4) : fille de Charles de Hautefort, comte Descars, elle est fille d’honneur de la reine ; elle a séjourné au Mans, en visite chez sa sœur cadette, Marie de Hautefort, où elle a rencontré Scarron.
661Hautefort, Gilles de (III, 5) : frère de Marie de Hautefort, au service du duc de Savoie.
Hautefort, Jacques-François de, 1609-1680 (III, 5) : frère aîné de Marie de Hautefort, il devint maréchal de camp en 1650.
Hautefort, Marie de, 1616-1691 (I-1, 53 – II, 3 ; 4 ; 5 ; 8 ; 10 – III, 4 ; 5 ; 6 ; 7 – V, 1 ; 8) : fille d’honneur de Marie de Médicis, dame d’atour d’Anne d’Autriche et aimée (maîtresse platonique ?) de Louis XIII, personnalité aristocratique assez remuante, mais protectrice fidèle de Scarron, et une des destinataires privilégiées des poésies du Recueil de quelques vers burlesques (1643). Scarron s’amuse à la traiter de « sainte », ce qui n’est pas sans quelque esprit de provocation, même si elle était réputée pour sa vertu. Elle fut exilée dans le Maine (au château de La Flotte) en novembre 1639 pour avoir déplu au Roi ; rentrée en grâce, elle revint à la Cour dans la semaine du 25 au 31 mai 1643. Elle épousa Charles de Schonberg, maréchal de France, le 24 septembre 1646.
Heere, Denis de, seigneur de Vaudoy (III, 7) : conseiller au Parlement de Paris, maître des requêtes ordinaires de l’hôtel de Gaston d’Orléans et intendant en Touraine.
Heinsius, Nicolas Heins, dit, 1620-1680 (II, 12) : érudit réputé dans toute l’Europe, connu pour sa traduction latine de La Poétique d’Aristote. Sa vie n’a été qu’un voyage de capitale en capitale, à la recherche de manuscrits grecs et latins. Ayant appris en 1649 que la reine de Suède désirait voir ses poésies, il en fit faire une nouvelle édition et la lui dédia ; puis, appelé par la souveraine, il partit pour Stockholm en octobre 1649 : il y resta jusqu’au 19 février 1651, séjour coupé par un voyage qu’il fit à Leyde pour acheter pour Christine des manuscrits et des médailles.
Hélène (VII, 17) : personnage non identifié. Scarron joue sans doute sur le contraste entre la beauté du personnage mythique et la laideur de sa rieuse.
Henri IV, 1553-1610 (III, 2 ; 12 – VII, 15) : d’abord roi de Navarre, il a dû se convertir au catholicisme pour devenir roi de France en 1589. Père de Louis XIII et de Gaston d’Orléans, il meurt assassiné à Paris en 1610. Sa statue équestre orne le Pont-Neuf.
Henriette-Marie de France, 1609-1669 (VII, 13) : fille d’Henri IV, femme de Charles Ier d’Angleterre, décapité en 1649, elle s’est réfugiée en France en 1644. C’est une des tantes du jeune roi de France Louis XIV. Malgré la pension que lui sert le roi, elle vit dans la gêne.
Hilaire, HilaireDupuy, dite (VII, 19) : fille d’un cabaretier, cette chanteuse est la sœur de la femme du compositeur Michel Lambert, maître de la musique de la chambre du roi. Tallemant dit qu’elle « n’a rien de beau que la voix et les dents » (II, 526).
Hippocrate (VIII, 3) : médecin grec né au ve siècle av. J.-C., mais les Lettres d’Hippocrate constituent une œuvre anonyme de l’époque romaine, fictivement attribuée au médecin.
Horace (II, 8 – IV, 8 – VII, 19) : poète latin du ier siècle av. J.-C. ; outre son Art poétique, il est connu pour ses épîtres et ses satires.
Hurelière, le Sieur de Hurlière (III, 5) : un des gentilshommes ordinaires de la vènerie du duc d’Orléans.
662Jacqueline, mademoiselle (IV, 13) : personnage non identifié.
Jacques, saint (III, 5) : l’un des douze apôtres de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. On célèbre sa fête le 25 juillet. L’emblème de saint Jacques est traditionnellement le coquillage, symbole des pèlerins.
Jacquinot, Jean (III, 5) : jésuite dijonnais, qui, après sept ans d’enseignement et quelque temps de prédications, fut recteur de divers collèges.
Jean, saint (VII, 16) : l’un des quatre évangélistes qui a raconté la vie de Jésus-Christ après en avoir été l’apôtre. Il est associé à l’aigle. On lui attribuait aussi le livre de l’Apocalypse.
Joannines (III, 4) : personnages non identifiés.
Jodelet, Julien Bedeau, dit, † 1660 (IV, 6– VIII, 2) : farceur dont la carrière va de 1620 environ à sa mort en 1660, rattaché au Théâtre du Marais dans les années 1640 quand Scarron écrit pour lui plusieurs rôles-titres comme Jodelet, ou le maître valet, et Jodelet duelliste.Il termine sa carrière dans la troupe de Molière.
Jolly, Pierre (II, 13) : procureur au Parlement.
Jude, saint(VIII, 9) : l’un des apôtres de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament et les Actes des Apôtres. On célèbre sa fête le 28 octobre, en même temps que saint Simon.
Julie, 39av. J.-C.-14ap. J.-C. (V, 7) : Julia, fille d’Auguste et de Scribonia, mariée d’abord à Marcellus et ensuite à Agrippa dont elle eut Gaius, Lucius Caesar, Julia, Agrippina et Agrippa Posthumus. Elle est donc la grand-mère de Caligula et l’arrière-grand-mère de Néron. Elle épouse Tibère en troisièmes noces mais est exilée une douzaine d’années plus tard.
Jurandon, Pierre (II, 13) : procureur au Parlement.
Juvénal, Decimus Junius Juvenalis (VII, 6 ; 19) : poète latin du iie siècle ap. J.-C., auteur de seize satires.
La Calprenède, Gautier de Costes, sieur de, 1609-1663 (II, 11 – IV, 16) : il a débuté sa carrière littéraire au théâtre, mais il est davantage connu pour ses romans-fleuves, notamment Cassandre (1642-1645) et Cléopâtre (1646-1658), pour lesquels il était perçu comme l’égal de Madeleine de Scudéry.
La Chaume (III, 4) : laquais de Marie de Hautefort, personnage autrement inconnu.
La Feuillade : voir Montaigut
La Forest, Henri de (III, 5) : enseigne des Suisses du duc d’Orléans.
L ’ Aisné, Jean, v. 1603-1672 (II, 1) : conseiller au Parlement de Paris, exilé en même temps que le père de Scarron.
La Ménardière, Hippolyte Jules Pilet de, 1610-1663 (III, 2 – IV, 16) : médecin du duc d’Orléans, il s’est fait connaître par un Traité de la mélancolie (1635) à propos des possédées de Loudun. Les anciens biographes de Scarron l’identifient comme ce « charlatan » dont parle Tallemant (II, 680) qui aurait prescrit à Scarron des remèdes qui auraient empiré son état de santé. Sa carrière littéraire a été couronnée de succès : une Poétique (1640), une tragédie, Alinde (1642), et un recueil de Poésies (1656) lui ont valu un siège à l’Académie.
La Porte, Charles de, seigneur de la Meilleraie, 1602-1664 (III, 4) : il est maréchal de France et grand maître de l’artillerie, cousin germain du 663cardinal de Richelieu. « C’est un grand assiégeur de villes ; mais il n’entend rien à la guerre de campagne. Il est brave, mais fanfaron, violent à un point étrange » (Tallemant, I, 326). En 1640, il a pris Arras aux Espagnols ; et en 1641, après une cure à Bourbon l’Archambault, il s’empare d’Aire-sur-la-Lys le 17 juillet et fait lever le siège de La Bassée le 20 septembre.
Larcher, Michel (III, 4) : marquis d’Esternay, il est président de la Chambre des comptes, ainsi que conseiller au conseil d’État et au conseil privé du roi.
La Rivière, Louis Barbier, dit abbé de, 1595-1670 (III, 5) : fils de tailleur, il fut d’abord professeur de philosophie au collège du Plessis, puis aumônier de l’évêque de Cahors. Introduit comme sous-précepteur chez le duc d’Orléans enfant, il est en 1642 son « maître de l’oratoire ». Il joua un certain rôle pendant la Fronde, mais sut ménager habilement ses entrées à la cour. Il fut nommé en 1655 évêque de Langres, ce qui le fit duc et pair.
La Suze, Henriette de Coligny, comtesse de, 1618-1673 (VIII, 7, 10) : elle fut d’abord comtesse d’Hadington à la suite de son premier mariage avec Thomas Hamilton (1643-1644), puis comtesse de La Suze (1653), mariage cassé en 1661. Poétesse appréciée de son temps pour ses élégies.
L ’ Aubespine, Charles de, marquis de Châteauneuf (II, 12) : successeur de Pierre Séguier à la Garde des sceaux (mars 1650-avril 1651).
L ’ Auné (VII, 20) : personnage non identifié. Il pourrait s’agir du partisan Jean Gravé, sieur de Launay, mais il faudrait alors prendre l’expression « pauvre écuyer » comme une antiphrase.
Lecomte, Denis (III, 4) : le « Scholastique » selon H. Chardon, un des chanoines du Mans avec lequel Scarron a eu querelle.
Le Gendre (III, 5) : personnage non identifié.
Legrand, Claude (III, 5) : l’un des valets de chambre du duc d’Orléans.
Lélie (VIII, 3) : Caïus Lælius Sapiens, réputé pour sa prudence, mort vers 170 av. J.-C. : Cicéron lui rendit un hommage posthume en le figurant comme interlocuteur dans plusieurs traités philosophiques (De Republica, Cato major, De senectute, Laelius, De amicitia).
Le Meignet (III, 5) : personnage non identifié.
Lenclos, Ninon de, 1620-1705 (III, 2 – V, 3) : célèbre courtisane, musicienne et lettrée, elle a habité dans le Marais, près de chez Scarron.
Lénoncourt (III, 5) : « Dans l’immense famille de Lénoncourt, je n’ai pu découvrir quel personnage est au service du duc d’Orléans : aucun ne figure sur l’État de 1641 » (M. C., I, p. 157).
Léopold, dit l’archiduc, 1614-1662 (VII, 13) : il s’agit de Leopold Wilhelm de Habsbourg, évêque de Passau et gouverneur des Pays-Bas de 1647 à 1656, frère de l’empereur Ferdinand III.
Lesdiguières, Anne de la Madeleine, seconde femme de François de Blanchefort, dit de Créquy, duc de (III, 5) : son mari est pair de France et gouverneur du Dauphiné. Elle a été « malade à la mort » au début de février 1642 : c’est sans doute pour hâter sa convalescence qu’elle est venue à Bourbon.
664Lignières, ou Linières, François Payot, seigneur de, 1626-1704 (IV, 16) : fils d’un conseiller au Grand Conseil, c’est un aimable débauché ; il a beaucoup d’esprit et une grande facilité pour la poésie : ses épigrammes sont très redoutées. Sa Lettre d’Éraste à Philis sur le poème de la Pucelle (1656, en vers et prose) l’a brouillé avec Chapelain.
Lionne, Hugues de, 1611-1671 (II, 11) : diplomate et ministre d’État, il est le neveu d’Abel Servien. Il semble avoir apprécié la poésie burlesque (il est le dédicataire du Jugement de Pâris, 1648, de Dassoucy).
Livet, de (III, 5) : personnage non identifié.
Lizières, François de la Gastine, seigneur de (III, 5) : un des gentilshommes de la chambre du duc d’Orléans.
Longueville, Anne-Geneviève de Bourbon, duchesse de, 1619-1679 (IV, 12) : sœur du grand Condé, seconde femme d’Henri de Longueville (voir Bourbon).
Longueville, Henri II d’Orléans, duc de, 1595-1663 (III, 4 – V, 7 – VII, 19) : pair de France, époux en secondes noces d’Anne-Geneviève de Bourbon. Il avait fait rassembler ses troupes à Saint-Dizier, à la fin de mai 1641, pour franchir le Rhin à Brisach ; mais le mauvais état de sa santé lui a fait remettre de semaine en semaine l’ouverture de cette campagne. Finalement, il a obtenu du roi la permission d’aller se soigner aux eaux de Bourbon, de septembre à début octobre 1641.
Longueville, Marie d’Orléans, dite Mademoiselle de (V, notice) : elle épouse son cousin, Henri II de Savoie, duc de Nemours, en 1657, mais devient veuve deux ans plus tard. C’est la destinataire de La Muse historique de Loret.
Lope de Vega, Félix, 1562-1635 (III, notice) : prolifique poète et dramaturge espagnol du « Siglo de Oro ».
Lope, Lopes, Alonso, † 1649 (III, 1 – V, 4) : juif portugais installé à Paris, tenant boutique d’orfèvre.
Loret, Jean, † 1666 (VII, 12 – VIII, 6 ; 7 ; 8) : après avoir publié en 1647, en le dédiant à Mlle Descars, un volume de Poésies burlesques, contenant plusieurs épîtres à diverses personnes de la Cour. Et autres œuvres en ce genre d’écrire, il se mit, vers 1650, à écrire chaque semaine une lettre en vers à Mademoiselle de Longueville (plus tard duchesse de Nemours) pour l’informer des nouvelles. Bientôt, cette relation hebdomadaire ayant obtenu un grand succès à la cour, il la fit imprimer chaque semaine et vendre au public (on l’appelle couramment LaMuse historique).
Lorme, Marie ou Marion de Lon, fille de Jean de Lon, seigneur de Lorme, 1613-1650 (III, 2 – VI, 4) : courtisane de l’époque, résidant au Marais. De 1642 à 1643, elle est la maîtresse de Gaspard IV de Coligny, marquis d’Andelot.
Lorraine, Charles IV, duc de, 1604-1675 (IV, 13) : « En 1652, le maréchal de Turenne, qui assiégeait Étampes, apprend que l’armée du duc de Lorraine, appelé par le prince de Condé, vient d’arriver à Villeneuve-Saint-Georges. Il lève aussitôt le siège d’Étampes et se dirige vers Villeneuve-Saint-Georges, en même temps qu’il sollicite des ordres de la cour pour attaquer les Lorrains. “Les ordres de la Cour arrivés, M. le 665Duc de Lorraine, qui en eut avis, s’offrit de sortir de France moyennant une grosse somme d’argent qu’il demanda, et la Cour y consentit” (Quincy, I, 155-156). Cela se passait un ou deux jours avant le fameux combat du faubourg Saint-Antoine, c’est-à-dire le 30 juin ou le 1er juillet 1652 » (M. C., II, p. 107-108).
Louis XIII, 1601-1643 (II, 2 ; 13 ; 14 ; 15 – III, 1 ; 2 ; 5 – V, 2 – VII, 15) : roi de France de 1610 à 1643. Sa statue équestre, détruite à la Révolution, fut érigée en 1639 au milieu de la Place Royale (actuelle place des Vosges).
Louis XIV, 1638-1715 (I-1, 68, 69 – I-7, 33 – II, 3 ; 7 ; 15 ; 17 – III, 5 – IV, 15 ; 16 – V, 11 ; 16 ; 18 – VII, 12 ; 13 ; 15 ; 20 ; 21 – VIII, 6 ; 7 ; 8 ; 11) : fils d’Anne d’Autriche et de Louis XIII, roi de France de 1643 à 1715.
Louvigny, Henri de (III, 5) : petit-fils d’un marchand de soie et fils d’un maître-orfèvre devenu valet de chambre du roi ; il a perdu la vue. Il est à Bourbon avec sa femme, Antoinette Bigot, fille de Nicolas Bigot, seigneur de la Honville.
Luc, saint (VII, 16) : l’un des quatre évangélistes, à qui l’on attribue aussi les Actes des Apôtres.
Lucrèce (VII, 19) : épouse de Tarquinius Collatinus ayant vécu dans les débuts légendaires de Rome (vie av. J.-C.) ; violée par Sextus, fils de Tarquin le Superbe, elle se suicida, devenant un emblème du sens féminin de l’honneur.
Lude, Françoise de Daillon, Mlle du (III, 5) : fille de la suivante ; son mariage avec le marquis d’Avaugour fut célébré au cours de l’année 1642.
Lude, Marie Feydeau, comtesse de (III, 2) : femme du comte de Lude.
Mademoiselle : voir Montpensier
Maillé, Jean Armand de, 1619-1646 (III, 2) : duc de Fronsac, amiral, c’est-à-dire « grand maître, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France » (M. C., I, p. 45), fils d’une sœur du cardinal de Richelieu. Il a succédé à celui-ci comme duc de Fronsac et pair de France. Il donne beaucoup aux gens de lettres (Tallemant, I, 323).
Maillé, Urbain de, 1597-1650 (III, 2) : marquis puis maréchal de Brézé, vice-roi de Catalogne.
Mairet, Jean, 1604-1686 (IV, 1) : il fut l’un des dramaturges à l’origine de la naissance du théâtre régulier dans les années 1630 ; il a touché à tous les genres en vogue à l’époque : la pastorale dans La Sylvie (1626) et La Silvanire (1629), la comédie dans Les Galanteries du duc d’Ossonne (1632) et la tragédie dans Sophonisbe (1635). Son animosité contre Corneille l’a incité à participer à la Querelle du Cid.
Malherbe, François de, 1555-1628 (IV, 8 – V, 12 ; 13 ; 18 – VII, 16 ; 21) : célèbre poète normand prônant la rigueur dans la langue et le style, il est qualifié de « regratteur de papier » par Théophile de Viau. Scarron le cite assez volontiers.
Mamurra (VII, 13) : ingénieur et ami intime de Jules César, du moins selon les accusations de Catulle dans le poème évoqué par Scarron.
Mantoue, Charles II de, 1629-1665 (V, 18) : ce prince est en train de vendre ses possessions françaises à Mazarin dans les années 1654-1659.
Marc-Aurèle (IV, 16) : empereur romain du iie siècle ap. J.-C., auteur de Pensées qui s’inscrivent dans la doctrine stoïcienne. Il épousa Faustine en 145.
666Marcial (IV, 16) : gantier parisien.
Marcigny, Jean-Jacques de Hotman, seigneur de (III, 5) : avocat au Parlement puis lieutenant d’infanterie, il est devenu l’un des gentilshommes servants du duc d’Orléans.
Marie, dame (III, 4) : personnage non identifié de l’entourage de Marie de Hautefort.
Marie-Thérèse d ’ Autriche, 1638-1683 (VII, 12 – VIII, 6 ; 7) : fille de Philippe IV d’Espagne, femme de Louis XIV, devenue reine de France en 1659.
Marigny, Jacques Carpentier de, 1615-1670 ? (VII, 13) : fils d’un marchand de fer de Nevers, il fut un des poètes les plus frondeurs ; attaché à Paul de Gondi, il l’aida activement de sa plume dans sa lutte contre Mazarin. Ses ballades (1649, 1651 et 1652) furent particulièrement réputées. Plus tard attaché à Condé, il l’accompagna en exil après la Fronde.
Marot, Clément, 1496-1544 (IV, 8 – VIII, 2) : poète de la Renaissance, traducteur de Psaumes et d’une Histoire de Leander et Hero, mais aussi considéré comme l’une des sources de l’esthétique burlesque par ses épîtres du coq-à-l’âne et son « badinage ».
Martinosse, Laure Martinozzi, 1635-1687 (V, 18) : Scarron, tout comme Loret dans sa gazette du 29 mai 1655, fait référence à une célébration soulignant les noces de cette nièce de Mazarin avec Alfonso IV d’Este, fils du duc de Modène, absent à cette occasion. Les époux se rencontrèrent l’année suivante. Sa sœur, Anne Marie Martinozzi (1637-1672) a épousé en 1654 Armand de Bourbon, prince de Conti.
Mathurin, saint(VI, 3) : prêtre du iiie siècle qu’on invoque pour guérir la folie, célébré début novembre.
Maugiron, Henriette du Mortier (III, 2) : Claude de Maugiron, son mari, maître de camp du régiment de cavalerie d’Anne d’Autriche, appartient à une très importante famille du Dauphiné.
Maulévrier, Cosme Savary, marquis de (III, 5 – VI, 5) : maître de la garde-robe du duc d’Orléans, fils d’un conseiller d’État.
Maynard, François, 1582-1646 (IV, 7) : président au présidial d’Aurillac et plus tard conseiller d’État, poète, disciple de Malherbe, il se distingue surtout par ses épigrammes et ses poésies bachiques ou libertines, dont un recueil de Priapées resté manuscrit. Il publie un choix de ses Poésies en 1646 et des Lettres paraissent de manière posthume.
Mazarin, Jules, 1602-1661 (I-1, 35, 43 – II, 14 – IV, 11 – VII, 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 15 – VIII, 1 ; 5) : forme francisée de Giulio Mazarini, selon sa signature, cardinal et ministre d’État. Son lieu de naissance (souvent prétendu) donne lieu à toutes sortes de fables pendant la Fronde.
Mécénas, Mécène, vers 70-8 av. J.-C. (I-7, 23 – II, 8 ; 12 – IV, 10 – VII, 16) : homme politique romain, ami d’Auguste, qui protégeait les poètes les plus en vue de son époque comme Virgile et Horace. Son nom est passé dans le langage courant.
Ménage, Gilles, 1613-1692 (II, 12 – IV, 8 ; 11 – V, 2 – VII, 16 ; 21) : il vit à partir de la fin de 1643 chez Paul de Gondi, coadjuteur de l’archevêque de Paris, à qui Chapelain le présenta. Ayant rompu avec le coadjuteur en 1649, il se mit au service d’Abel 667Servien, financier fidèle à Mazarin. Il a publié (1er mars 1650) un recueil de poésies latines et de lettres de Balzac, qu’il a dédié et envoyé à la reine de Suède ; la souveraine lui a fait présent, en échange, d’une chaîne d’or. Son ouvrage sur Les Origines de la langue française sortit des presses de l’imprimeur le 31 octobre 1650. Après la mort d’Abel Servien (1659), il passa au service de Fouquet.
Mercure, Louis de Bourbon-Vendôme, duc de Mercœur, 1612-1669 (III, 4) : il vient à Bourbon l’Archambault pour se remettre de la blessure qu’il a reçue en 1640 au siège d’Arras.
Merlin Coccaie : voir Folengo, Teofilo
Miossens : voir d’Albret
Molière d ’ Essertines, François-Hugues de, 1599-1624 (III, 5) : écrivain, ami de Théophile de Viau, connu pour son roman pastoral, La Polyxène (1623).
Molière, Jean-Baptiste Poquelin, dit, 1622-1673 (VIII, 8) : l’auteur du Testament de Monsieur Scarron fait probablement allusion à Sganarelle, ou le cocu imaginaire (mai 1660). Les liens entre les deux écrivains sont difficiles à établir : Scarron est à Paris quand Molière fonde l’Illustre Théâtre, mais Molière doit rapidement partir pour tenter de réussir en province (1644-1645). À son retour en 1658, Scarron est très malade et déjà en fin de vie.
Mondin, Andrea Mondino (VII, 13) : Piémontais, aumônier du duc de Savoie et son agent d’affaires à la cour de France, il fut un confident de Mazarin et son auxiliaire dans les achats de pierreries et de meubles. Le 13 janvier 1649, le Parlement avait fait saisir chez lui les registres et papiers du banquier Cantarini.
Mondory, Guillaume Desgilberts, dit, 1594-1651 (III, 2) : il fut longtemps le principal acteur de la troupe du théâtre du Marais, créateur des rôles d’Hérode dans la Mariane de Tristan et de Rodrigue dans LeCid de Corneille ; il se retira en 1637, ayant été atteint d’une paralysie de la langue. Tous les écrivains des xviie et xviiie siècles sont unanimes à reconnaître son très grand talent.
Montaigne, ou Montagne, Michel de, 1533-1592 (IV, 17 – VII, 19) : auteur des Essais.
Montaigut, Gabriel d’Aubusson-Brachet, baron (et non marquis) de Montaigut, † 1644 (III, 4, 5) : fils du comte de La Feuillade, il fut un des « premiers chambellans d’affaires » du duc d’Orléans.
Montauron, Pierre, † 1670 (II, 1 ; 12 – III, 5) : receveur général de Guyenne. Sa fastueuse richesse est alors proverbiale. Il fut, en janvier 1643, le dédicataire de la première édition de Cinna, ou la clémence d’Auguste de Corneille, mais il fit faillite l’année suivante.
Montbazon, Marie de Bretagne, duchesse de, 1612-1657 (III, 4) : sœur du marquis d’Avaugour, et épouse d’Hercule de Rohan, duc de Montbazon.
Montéclere, Montécler, Louis de (III, 4) : commandeur de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem (dit ordre de Malte), dans lequel il est entré à l’âge de 10 ans, il s’est distingué, tout jeune, dans plusieurs combats contre les Turcs, puis au siège de La Rochelle.
Montmaur, Pierre de, 1576-1650 (IV, 2 ; 3 ; 4) : professeur de grec au Collège royal et intendant des devises et inscriptions pour les bâtiments royaux de 668France. Par les saillies caustiques qu’il lançait contre les érudits anciens et contemporains, à la table des grands où il aimait à faire bonne chère, il a suscité une coalition générale des beaux esprits : pendant plus de dix ans à partir de 1636, d’innombrables épigrammes, satires, pamphlets, en français et en latin, l’ont peint comme le type du parasite et du faux savant (Albert-Henri de Sallengre, Histoire de Pierre de Montmaur).
Montmorency, Charlotte Marguerite de (V, 7) : femme d’Henri II de Bourbon et donc mère du grand Condé.
Montpensier, Mademoiselle de, 1627-1693 (V, 4) : Anne-MarieLouised’Orléans, dite la Grande Mademoiselle, fille du duc d’Orléanset de Marie de Bourbon-Montpensier. Pendant la Fronde, elle adopta le parti des princes, et dirigea les canons de la Bastille sur l’armée royale, pour sauver Condé pris au piège. En représailles, Louis XIV l’exila pour cinq ans dans son château de Saint-Fargeau (Yonne).
Monts, Antoine de Villeneufve, seigneur de (III, 5) : premier maître d’hôtel du duc d’Orléans ; celui-ci le fit nommer gouverneur de Honfleur en 1643.
Morel, Jean (VII, 16) : ce marchand cabaretier, « suivant la cour », tenait boutique, en 1629, rue de la Huchette, à l’enseigne de la Bastille.
Mothe, Philippe de la, seigneur de Houdancourt, duc de Cardona, connu sous le nom de « la Mothe Houdancourt », 1605-1657 (VII, 13) : il avait été promu maréchal de France au printemps de 1642 en récompense d’une série de victoires qu’il avait remportées, en 1641 et 1642, non pas à Barcelone même, mais en divers endroits de Catalogne.
Moussardière, la (II, 3 – III, 4) : une des dames de Marie de Hautefort, d’une vieille famille du Maine.
Musée (I-7, 189, 436) : poète grec ayant vécu vers la fin du ve siècle av. J.-C., auteur d’un poème sur les amours d’Héro et de Léandre.
Naillart (II, 3– III, 4) : cocher de Marie de Hautefort, autrement inconnu.
Nançay, Edme de La Chastre, dit le marquis de la Chastre, comte de, † 1645 (III, 5) : maître de la garde-robe du roi et époux de Charlotte Louise d’Hardoncourt. Il a laissé des mémoires.
Nassau, Guillaume X de : voir Guillaume d’Orange
Navarra, Augustin de Navarre (V, 18) : secrétaire d’État de Philippe IV d’Espagne.
Nicolas, saint (III, 5) : probablement Nicolas de Myre, ayant vécu au ive siècle et qui est célébré le 6 décembre. Ce personnage étant patron de la Lorraine, il se peut que ledit Fransure jure par son saint patron.
Nivelle, Jean de, 1422-1477 (I-6) : dit communément ce « chien qui fuit quand on l’appelle », car il fut méprisé pour avoir refusé de répondre à l’appel du roi Louis XI ; le « chien de Jean de Nivelle » a été pris au sens propre dans la chanson populaire.
Nostradamus, Michel de Nostre-Dame, 1503-1566 (I-3, 263) : astrologue français connu pour ses Centuries astrologiques (1555), suite de sonnets ésotériques prédisant l’avenir de la France.
Noyers : voir Sublet
Nublé, Louis (VII, 16) : avocat au Parlement, « homme d’esprit et de probité », grand ami de Scarron et de 669Ménage, qui a vanté sa vaste érudition en matière de droit et son extrême modestie.
Ordugneau (VIII, 9) : personnage non identifié.
Ornano, Joseph-Charles d’ (III, 5) : dernier fils du maréchal d’Ornano, il quitta l’état ecclésiastique en 1624 pour devenir l’un des deux maîtres de la garde-robe du duc d’Orléans.
Orsini, ou des Ursins (VII, 13) : la famille Orsini, l’une des plus puissantes d’Italie à la Renaissance, comptait des papes et des princes, de même que des capitaines réputés.
Orval, François de Béthune, comte d’ (III, 6) : conseiller d’État, maître de camp et premier écuyer d’Anne d’Autriche. Il est fils de Maximilien de Béthune, duc de Sully, le ministre d’Henri IV. En 1652, il devint duc et pair, lieutenant général des armées et gouverneur du pays chartrain.
Ouches, Gabriel de Haramberg, dit de la Béraudière, du nom de sa mère, baron des (III, 5) : un des premiers chambellans du duc d’Orléans.
Outrelaize, Madeleine Blondel, fille de Jean Blondel, seigneur de Tilly et d’ (IV, 13) : comme parente et intime amie de Mme de Frontenac, elle est l’une des compagnes de la Grande Mademoiselle. Elle fut célèbre par sa beauté.
Ouville, Antoine Le Métel, seigneur d’, 1590-v. 1655 (IV, 16) : frère de Boisrobert, auteur de comédies dont un Jodelet astrologue (1646) et de contes (première édition en 1643).
Ovide (I-7, 636 – IV, 8 ; 10) : Publius Ovidius Naso, poète latin du ier siècle av. J.-C., l’auteur des Métamorphoses, des Amours et d’un Art d’aimer, banni de Rome par Auguste en 8 ap. J.-C.
Pasquier, Jean (II, 13) : « Dans son Factum, Scarron, exposant les péripéties de son procès, s’exprime ainsi : “l’ingénieux Sigoigne [un des beaux-frères] fit intervenir […] un nommé Pannier, Pagerier, ou Pasquier, ou comme il vous plaira ; car on n’a jamais bien su ni comme il s’appelait, ni d’où il était, ni qui il était, ni même s’il était […]. » (M. C., I, p. 485). Ce factum se trouve au début des Œuvres burlesques de M. Scarron. IIIe partie (1651).
Patrix, Pierre, 1583-1671 (III, 5) : poète normand, il ne quitta Caen, sa ville natale, que vers 40 ans, pour entrer, en qualité de gentilhomme ordinaire, au service du duc d’Orléans, qui le nomma gouverneur de son château de Limours.
Paul, saint (II, 1 – III, 2) : l’apôtre de Jésus-Christ, ayant voyagé dans toute l’Asie et l’Europe pour prêcher aux juifs et aux gentils. Ses épîtres étaient souvent citées par le père de Scarron, conseiller au Parlement, ce qui lui a valu le surnom de « l’Apôtre ».
Pellisson, Paul, 1624-1693 (III, 12 – VII, 21 – VIII, 8) : d’abord conseiller à la cour des comptes de Montpellier, il entre au service de Nicolas Fouquet vers 1652 en tant que premier commis. La même année, son Histoire de l’Académie lui vaut d’être élu académicien surnuméraire. Ami de Madeleine de Scudéry, il joue un rôle important dans le salon que tient cette dernière (voir les Chroniques du samedi) et dans la définition d’une esthétique galante (Discours sur les œuvres de M. Sarasin).
Perrault, Charles, 1628-1703 (VIII, 4) : l’auteur des Contes commença sa carrière littéraire par des travestissements 670burlesques, celui du sixième livre de l’Énéide et Les Murs de Troie.
Perrault, Claude, 1613-1688(VIII, 4) : médecin, architecte et biologiste à l’Académie des sciences, il participe avec son frère cadet à la rédaction d’œuvres burlesques au début des années 1650.
Perrault, Nicolas, 1624-1662(VIII, 4) : théologien, docteur en Sorbonne exclu pour avoir défendu les thèses jansénistes d’Antoine Arnauld, il rédige aussi des poèmes burlesques avec ses frères.
Perse (VIII, 2) : Aulus Persius Flaccus, poète satirique romain du ier siècle ap. J.-C.
Phalaris (V, 6) : tyran d’Agrigente (Sicile) au vie siècle av. J.-C., il rôtissait ses ennemis dans un taureau d’airain.
Philippe d ’ Orléans, 1640-1701 (II, 3 ; 16 – III, 5 – V, 18) : duc d’Anjou, frère de Louis XIV.
Philippe IV d ’ Espagne, 1605-1665(II, 1 – V, 7) : roi d’Espagne, frère d’Anne d’Autriche et père de Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV.
Picard, Dame (VI, 12) : personnage non identifié.
Piennes, marquise de : voir Fiesque
Pierre, saint (III, 2) : le premier des apôtres de Jésus-Christ, passant pour avoir fondé la papauté à Rome.
Platon, 427-348av. J.-C. (I-7, 139) : philosophe grec de l’Antiquité, disciple de Socrate qu’il met souvent en scène dans ses œuvres, et maître d’Aristote.
Plesse, Guy-Urbain de Laval, baron de la (III, 5) : un des chambellans d’affaires du duc d’Orléans.
Pons, Judith de, † 1688 (III, 6) : fille de Jean-Jacques de Pons, marquis de Lacaze, maître de camp et conseiller d’État, elle est une des filles d’honneur d’Anne d’Autriche.
Potel, Louis, seigneur du Parquet (IV, 15 – VI, 13) : il a mené une vie fort débauchée. Après la mort de sa mère (février 1644), il partit pour Rome, où il fit un assez long séjour. À son retour, on l’appelle Potel-Romain et il se met à faire des chansons. C’est « un gros garçon noir et plein de rougeurs, la bouche enfoncée et les yeux de travers » (Tallemant, II, 770).
Preudhom (III, 7) : Claude Preudhomme, « barbier tenant bains et étuves », installé dans la rue d’Orléans, c’est-à-dire dans les environs immédiats du Louvre.
Puits, Anne de Brouilly, veuve de Frédéric de Rouvroy, seigneur du Puits-la-Vallée (III, 6) : elle est gouvernante des filles d’honneur d’Anne d’Autriche à partir de janvier 1642 ; elle a marié son fils aîné à la fille du « général » des postes du duc de Savoie. Tallemant a raconté les « malices » que lui font les filles d’honneur de la reine (II, 370).
Pythagore (VIII, 2) : philosophe et mathématicien grec du vie siècle av. J.-C. Sa doctrine aborde des phénomènes comme la métempsychose, le végétarisme, l’harmonie des nombres, notamment dans la musique et l’astronomie.
Quinault, Philippe, 1635-1688 (IV, 16 – VIII, 8) : avocat au Parlement, fils d’un boulanger du duc de Retz, il compose pour le théâtre dès 1653. Il eut la réputation d’écrire des vers fort « galants », et fut attaqué pour cette raison par les tenants de la tragédie « à la Corneille ». Il remporta de grands succès dans ce genre nouveau qu’est l’opéra grâce à ses collaborations avec Lully.
671Quinet, Toussaint (II, 8 ; 11 – IV, 1 ; 9) : « imprimeur-libraire » de nouveautés littéraires, il fut l’éditeur attitré de Scarron.
Rabelais, François, 1494 ?-1553 (IV, 8) : le plus important romancier comique de la Renaissance française, auteur du Pantagruel et du Gargantua, où la « substantifique moelle » se trouve enveloppée d’histoires ridicules de Géants.
Raincy, Jacques Bordier, seigneur du, † 1666 (VII, 21) : c’est un ami de Boisrobert, de Scudéry, de Pellisson, etc. Sur ses extravagances à Rome et à Paris, voir Tallemant (II, 179-184). Il a laissé quelques vers publiés dans les recueils du temps.
Rantzau, Edwige-Marguerite von (III, 4) : cousine germaine et épouse de Josias von Rantzau.
Rantzau, Josias von, 1609-1650 (III, 4) : Danois du Holstein, il sert dans les armées françaises à partir de 1635. Il est gouverneur de Dunkerque, bon soldat, mais toujours ivre. On l’appelle « le beau Rantzau » (M. C., I, p. 135) : il est très aimé des femmes, qui fournissent à ses dépenses. Il a perdu un œil au siège de Dôle (1646). L’année qui précède celle où Scarron le rencontre, il prit part au siège d’Arras (1640), où il perdit une jambe et fut estropié d’une main ; après de longs mois passés à soigner ces grandes blessures et une courte reprise de service au siège d’Aire-sur-la-Lys (mai 1641), il vint à Bourbon l’Archambault pour hâter sa convalescence.
Raray, Henri de Lancy, baron de (III, 5) : il fut élevé comme enfant d’honneur du duc d’Orléans et devint en 1624 gentilhomme ordinaire de sa chambre ; il est en 1642 capitaine de ses gendarmes. Il fut un des premiers amants de Ninon de Lenclos.
Ravaillac, François, 1577-1610(IV, 16) : assassin d’Henri IV.
Renaudot, Théophraste, 1586-1653 (VIII, 7) : médecin par ses études à la Faculté de Montpellier, Renaudot est surtout connu pour avoir fondé LaGazette (1631), un des premiers hebdomadaires d’informations français. Il ouvre à Paris en 1630 un Bureau d’adresse où il organise, parmi bien d’autres activités, des conférences de vulgarisation scientifique qui seront publiées jusqu’en 1641. Ses fils prennent la relève de LaGazette après sa mort.
Retz, Cardinal de : voir Gondi
Revel, Jeanne de la Croix, Madame de (V, 17) : veuve de Félicien Boffin, seigneur de Revel, avocat général au parlement de Dauphiné. « Mme de Revel “a toujours sceu mesler les affaires de son salut avec celles du monde” : elle a fondé à Grenoble un groupement pour la propagation de la foi et elle s’occupe des nouveaux convertis ; Tallemant dit qu’elle “a beaucoup d’esprit et fait fort joliment des vers” (II, 397) » (M. C., II, p. 167). On trouve dans les recueils du temps cinq pièces de vers de Mme de Revel.
Ribodon (III, 4) : femme de Claude Ribodon, trésorier de France à Bourges ; le duc d’Orléans, frère du roi, est amoureux d’elle (Tallemant, I, 355).
Richelieu, Armand Jean du Plessis de, 1585-1642 (II, 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 12 – III, 5 ; 7 – IV, 17 – V, 12 – VII, 13 ; 15 ; 16) : cardinal et ministre d’État sous Louis XIII.
672Richelieu, Emmanuel-Joseph Vuignerod, abbé de (VII, 20) : petit-neveu du cardinal de Richelieu, abbé de l’abbaye Saint-Ouen de Rouen, prieur de Saint-Martin-des-Champs (à Paris) et abbé de Marmoutier.
Richer, Louis (IV, 10) : auteur de l’Ovide bouffon et de plusieurs mazarinades plaisantes, notamment des Agréables conférences des deux paysans de Saint-Ouen et de Montmorency sur les affaires du temps.
Richon (VII, 13) : parent d’Étienne Richon, trésorier de France en Guyenne. Il défendait contre les troupes du roi le château de Vayres, sur la basse Dordogne, pendant la Fronde de Guyenne. Obligé de se rendre le 4 août 1650, il fut pendu.
Rivière, chevalier de (VIII, 1) : gentilhomme de la chambre du prince de Condé, actif à ses côtés pendant la Fronde.
Robert, le Prince (V, 18) : sans doute Robert (Rupert) de Bavière, capitaine anglais réfugié à Paris en 1654, auprès de Charles II d’Angleterre en exil.
Roch (IV, 7) : probablement saint Roch, pèlerin et thaumaturge français, patron des pèlerins et de nombreuses corporations.
Rochambaut, René de Vimeur, seigneur de (III, 5) : après avoir servi aux armées jusqu’en 1637, il vit retiré dans son fief.
Rodrigue (III, 1) : marchand portugais de la foire Saint-Germain.
Rohan, Anne de, 1604-1685 (III, 2) : princesse de Guéméné, cousine germaine de son mari, Louis de Rohan ; elle est réputée pour sa beauté.
Rohan, Louis de, 1599-1667 (III, 2) : comte de Rochefort et de Montauban-de-Bretagne, est devenu prince de Guéméné en 1617 par son mariage avec sa cousine germaine, héritière de cette principauté. Il est fils du duc de Montbazon. En 1643, il est sénéchal d’Anjou et demeure à Paris dans son hôtel de la Place Royale. Il a de l’esprit et dit les choses plaisamment (Tallemant, II, 225).
Rohan, Marguerite, duchesse de (III, 2) : Marguerite de Béthune, fille de Sully, épouse d’Henri de Rohan(1579-1638), duc de Rohan et pair de France, lequel, de 1621 à 1629, fut à la tête des troupes huguenotes luttant contre celles du roi.
Rohan, Marguerite de, 1617-1684 (III, 2) : fille de la précédente ; « jamais personne n’a eu de la réputation à meilleur marché ; car elle a l’esprit grossier » (Tallemant, I, 629).
Roquelaure, Gaston-Jean-Baptiste, duc de, v. 1615-1683(IV, 16) : en 1653, Scarron lui a dédié le livre VII de son Virgile travesti. Tallemant, qui a raconté ses amusantes impertinences, dit en outre : « On n’a jamais vu un homme plus gascon » (II, 375) ; et Scarron lui-même, dans une de ses gazettes en vers de 1655 où il rappelle les liens d’amitié qui l’unissent à lui, dit : « Nul ne porte si loin que lui / La hauteur gasconne aujourd’hui » (9 février 1655).
Rose, Conrad de Rosen, dit, 1628-1715 (V, 18) : chef militaire au service de Louis XIV à partir de 1651.
Rosteau, Charles (VII, 16) : fils d’un chirurgien attaché à la famille de Beaumanoir, au Mans, chirurgien lui-même, il y devint l’ami de Scarron. Il se fixa ensuite à Paris, comme secrétaire du comte de Tresme.
Roussillon, Jean de Lescours, seigneur de (III, 5) : un des gentilshommes servants du duc d’Orléans.
673Ruzé, Henri, marquis de Longué et seigneur des Marais (VII, 20) : c’est un parent éloigné des marquis d’Effiat. « Ce que racontent les vers suivants sur la pauvreté de ce gentilhomme n’est sans doute pas exagéré, car, dans un acte passé à Saumur le 23 mai 1664, lui et sa femme exposeront qu’ils “sont chargez de plusieurs enfants et qu’ils ont esté saisis dans leurs biens et terres, de sorte qu’il ne leur reste aucuns biens suffisans ni facultez pour subvenir à leursditz enfants et les faire subsister selon leur condition” » (M. C., II, p. 296).
Ryer, Pierre du, 1600 ?-1658 (IV, 1) : dramaturge important des années 1630, dont la pièce Alcionée (1640) a connu le plus de succès. Élu à l’Académie en 1646, il a publié de nombreuses traductions qu’on nommerait aujourd’hui des « belles infidèles » (Ovide, Cicéron, Sénèque, Tite-Live).
Sacchetti, Giulio, 1587-1663 (VII, 13) : ancien nonce en Espagne, évêque de Frascati.
Sageot, Louis(III, 5) : porte-arquebuse et garde du cabinet des armes du duc d’Orléans.
Saint-Aignan, François de Beauvilliers, comte puis duc de, 1607-1687 (III, 4 – IV, 10 – V, 15) : il a, aux armées, donné plus d’une preuve de sa valeur, et il est maître de camp de cavalerie ; il est aussi cultivé que son beau-frère le comte de Béthune. En 1644, il devint capitaine des gardes du corps du duc d’Orléans, puis premier gentilhomme de la chambre du roi (1649), gouverneur de Touraine (1661), académicien (1663), duc de Saint-Aignan et pair de France (1663), enfin directeur de l’Académie française (1685). Il était amateur de vers burlesques : L’Ovide bouffon de Richer et L’Ovide en belle humeur de Dassoucy lui sont dédiés.
Saint-Amant, Marc Antoine Girard, sieur de, 1594-1661 (IV, 1 ; 16 – VII, 16 – VIII, 8) : poète et voyageur ayant une réputation de bon vivant. Ses poésies se caractérisent par son goût pour le caprice et les descriptions détaillées, souvent tirées de la vie courante. Il publie notamment sa Rome ridicule en 1643 et son Moïse sauvé en 1653.
Saint-Gelais, Mellin de, 1491-1558 (IV, 8) : poète de cour de la première moitié du xvie siècle.
Saint-Louis, Anne Grimoard, demoiselle de (III, 4 ; 6) : fille d’honneur d’Anne d’Autriche ; tous les contemporains font l’éloge de sa beauté, de son esprit et de sa vertu. Elle est sœur de M. de Barrière, dont a parlé Scarron dans la première Légende de Bourbon. Elle épousa en septembre 1643 Charles de Fouilleuzes, marquis de Flavacourt, bailli et gouverneur de Gisors.
Saint-Luc, François des Hayes, dit d’Espinay, seigneur de (III, 5) : second fils du maréchal de Saint-Luc. Au cours de 1641, LaGazette a plusieurs fois parlé de sa bravoure aux armées, et en particulier au siège de Bapaume, où on le crut tué. À la mort de son père (1644), il lui succéda comme lieutenant général en Guyenne et devint marquis de Saint-Luc.
Saint-Maigrin, Marie Stuer, fille de Jacques Stuer, comte de la Vauguyon et marquis de (V, 13) : une des filles d’honneur d’Anne d’Autriche. Elle fut courtisée par le duc d’Orléans, puis à l’automne de 1650, par Nicolas de Castille et le marquis de Richelieu. En 1653, elle épousa Barthélemy de 674Quélen, comte du Broutay, colonel du régiment de Navarre.
Saint-Michel, Marguerite de Pluviers, fille de Jacques de Pluviers, baron de (III, 6) : elle est la doyenne des filles d’honneur d’Anne d’Autriche ; elle n’est déjà plus en fonctions en 1649. Son père, dont quatre frères aînés furent tués au service d’Henri IV, fut gentilhomme ordinaire de la chambre de ce roi puis de Louis XIII ; il fut aussi successivement gouverneur de diverses villes.
Saint-Pavin, Denis Sanguin, seigneur de, 1595-1670 (V, 15) : fils d’un président aux enquêtes, poète grivois et parfait épicurien malgré son état ecclésiastique. Ses nombreux amis apprécient sa franchise et sa bonne humeur. « Il est bossu devant et derrière » (Tallemant, II, 8) ; dans une longue pièce de vers, il a fait de lui-même un portrait peu flatté.
Saint-Pont (III, 5) : personnage non identifié.
Salo, Jacques (II, 1) :conseiller au Parlement, exilé en même temps que le père de Scarron.
Sapho (IV, 17) : poétesse grecque née au viie siècle av. J.-C. sur l’île de Lesbos ; il s’agit aussi du surnom précieux de Mlle de Scudéry.
Sarasin, Jean-François, 1614-1654 (III, 2 – IV, 8 ; 11 – V, 6) : un des poètes en vogue de l’époque. D’abord au service de Léon Bouthillier, comte de Chavigny, secrétaire d’État, vers 1643-1644, il devint ensuite « comme le courtisan » de Paul de Gondi, futur cardinal de Retz. Ayant été en 1647 menacé de la Bastille sur le soupçon d’avoir composé des vers satiriques au sujet de l’opéra Orfeo (représenté sur l’ordre de Mazarin), il avait juré de renoncer à la poésie ; son ami Ménage l’a décidé à reprendre la plume après un an d’abstention. Il est l’auteur de LaPompe funèbre de Voiture, ainsi que de l’Ode de Calliope sur la bataille de Lens, qu’il a présentée au prince de Condé (1648). Il devint ensuite secrétaire du prince de Conti.
Sardanapale ou Assurbanipal, roi d’Assyrie, 669-627 av. J.-C. (VII, 13 ; 16) : les Grecs l’ont érigé en symbole de la débauche (luxe et voluptés, bisexualité).
Saumaise, Claude, 1588-1653 (II, 12) : il est connu dans toute l’Europe pour son érudition. Il arrive à Stockholm en juillet 1650, appelé par la reine Christine ; il n’y fit qu’un court séjour et quitta la Suède dans les premiers mois de l’année suivante.
Sauvage (III, 5) : Tallemant lui consacre une de ses Historiettes (I, 361-362) : c’est « un goinfre fort agréable » et un mystificateur très spirituel. Il est l’auteur de gazettes imaginaires et parodiques, ainsi que de vers de ballets.
Sauvat, François (III, 5) : fils de la gouvernante du duc d’Orléans, il est un des maîtres d’hôtel de celui-ci et gouverneur de son château de Champigny.
Scarron, Anne (II, 13) : sœur de Scarron issue du premier mariage de son père avec Gabrielle Goguet.
Scarron, Catherine,† 1691 (V, 11) : parente de Scarron, femme d’Antoine d’Aumont, sieur de Villequier.
Scarron, Françoise (II, 8 ; 13) : l’autre de ses deux sœurs issues du premier mariage de Paul Scarron père, avec laquelle il entretient de bonnes relations (il logea chez elle de 1644 à 1649).
675Scarron, Paul, † 1643 (II, 1 ; 2 ; 4 ; 11 ; 13 – III, 1 ; 5 ; 12 – V, 7 ; 15 – VII, 21 – VIII, 1 ; 10) : conseiller au Parlement, père du poète, surnommé l’Apôtre parce qu’il citait souvent saint Paul. Paul Scarron le fils est issu de son premier mariage avec Gabrielle Goguet (morte en 1613) ; le père se remaria en 1617 avec Françoise de Plaix, qui en eut trois enfants. Le Parlement de Paris ayant refusé d’enregistrer un édit du roi créant seize nouvelles charges de maîtres des requêtes, les plus séditieux de ses membres furent exilés ; parmi eux, se trouvait le père de Scarron. Un an après, en février 1641, une ordonnance supprimait les charges dont étaient pourvus Jean-Jacques Barillon, Paul Scarron, et d’autres conseillers. Le père rentra en grâce après la mort de Richelieu, mais n’eut pas le temps d’en profiter (il meurt en 1643). Les relations de Scarron avec sa belle-mère et ses enfants (Madeleine, II, 13 ; Claude, II, 13 ; Nicolas, II, 13) ne furent pas bonnes, notamment lors de l’héritage de son père. Il eut un long procès avec ses beaux-frères Charles Robin, seigneur de Cigogné, ou Sigoigne, trésorier de France à Tours (II, 13), mari de Madeleine, et Daniel Boileau (II, 13), seigneur du Plessis, gentilhomme ordinaire du duc d’Orléans, mari de Claude.
Scarron, Pierre (III, 7) : évêque de Grenoble, cousin germain du père du poète, activement mêlé à la politique.
Scarron, Urbain (III, 2 ; 5 – VII, 6) : oncle de Scarron, seigneur de Saint-Trys ; il demeure dans la rue des Tournelles, c’est-à-dire à proximité de la Place Royale.
Schonberg, Charles de, 1601-1656 (III, 5 – V, 8 ; 10 ; 18) : duc d’Halluin, maréchal de France comme son père Henri, devenu veuf en novembre 1641. Le 24 septembre 1646, il se remaria avec Marie de Hautefort, la protectrice de Scarron. Il a permis la résistance de Leucate (1636-1637) au siège des Espagnols et la prise de Tortose (Espagne) en juillet 1648.
Schonberg, Henri de (III, 5) : mari d’Anne de la Guiche, mort en 1632.
Schonberg, Jeanne-Armande de (III, 5) : fille d’Anne de la Guiche et d’Henri de Schonberg.
Schonberg, maréchale de : voir Marie de Hautefort
Scipion (VIII, 3) : Publius Cornelius Scipio, dit Scipion Émilien, homme politique et général romain ayant vécu au iie siècle av. J.-C. C’est dans le De amicitia de Cicéron que son amitié avec Lélie est décrite.
Scudéry, Georges de, 1601-1667 (III, 2 ; 5– IV, 1) : d’abord auteur dramatique qui participe à la régularisation du théâtre dans les années 1630 et à la querelle du Cid, il se consacre ensuite au roman en compagnie de sa sœur Madeleine et à la poésie lyrique et épique (Poésies diverses, 1649 ; Alaric, ou Rome vaincue, 1654). Il est nommé gouverneur du fort de Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille en juin 1642 mais perd cette charge pour sa conduite pendant la Fronde. Il a donné à Scarron, en février 1648, une très belle ode liminaire pour le premier livre du Virgile travesti.
Scudéry, Madeleine de, 1607-1701 (III, 2 ; 5 – IV, 16 ; 17) : auteur probable d’Ibrahim ou l’illustre Bassa (1641), roman publié sous le nom de son frère Georges, et dédié à Mlle de Rohan, 676puis de Artamène, ou le grand Cyrus (1649-1653) également signé de son frère. Elle est, à partir de 1653, très liée d’amitié avec Pellisson, qui est le premier commis de Fouquet, et fait paraître entre 1654 et 1660 Clélie, histoire romaine. Tous ses contemporains l’appellent Sapho. Chaque samedi, se tient chez elle une assemblée littéraire.
Segrais, Jean Regnault, seigneur de, 1624-1701 (IV, 13) : né à Caen, il y avait écrit un poème pastoral intitulé Athys, resté manuscrit ; le comte de Fiesque, au cours d’une disgrâce pendant laquelle il vécut à Caen, le reçut, puis l’emmena à Paris (sans doute en 1647). C’est chez lui que Segrais écrivit son roman Bérénice, dédié à la comtesse de Fiesque (1648-1649). La comtesse le fit alors entrer comme secrétaire chez la Grande Mademoiselle, dont il devint ensuite gentilhomme ordinaire. Il lui dédia Athys (édité en juin 1653) et ses Diverses poésies (1658), et écrivit pour elle un recueil de nouvelles, Les Divertissements de la princesse Aurélie (1657). Il entra à l’Académie française en 1662. Ses Segraisiana (1721) parlent beaucoup de Scarron, dont il était l’ami.
Séguier, Pierre, 1588-1672 (II, 12 – III, 4 – IV, 17 – VII, 13 ; 16) : garde des sceaux de 1633 à 1650, puis de 1656 à sa mort, chancelier de France en 1635. Avide de louanges, le chancelier pensionne plusieurs écrivains pour être glorifié par eux en vers et en prose. Mais les pensions qu’il leur donne sont prises sur les fonds du Sceau. Il devient le protecteur de l’Académie à la mort de Richelieu.
Ségur, Françoise de Pérusse, Mlle de (III, 6) : c’est la vice-doyenne des filles d’honneur d’Anne d’Autriche. Elle épousa en 1652 Pierre de Bonneval, vicomte de Château-Rocher.
Servien, Abel, 1593-1659 (V, 18) : l’un des artisans de la paix de Münster et du traité de Westphalie, il fut fait ministre d’État en 1648, surintendant des finances en 1653, en compagnie de Fouquet. C’est aussi un mécène à qui l’on dédie des œuvres burlesques, notamment Dassoucy son Ravissement de Proserpine (1653).
Simon, saint (VIII, 9) : fêté le 28 Octobre, en même temps que saint Jude. Ces deux apôtres ont leur fête le même jour parce qu’ils ont travaillé ensemble à la conversion des païens.
Socrate (VII, 16 – VIII, 3) : modèle des philosophes antiques ayant vécu au ve siècle av. J.-C. qui n’a laissé aucune œuvre mais qui a inspiré la naissance de plusieurs écoles de pensée comme le cynisme, l’épicurisme et le platonisme ; il est surtout connu grâce aux dialogues de Platon où il figure en fin dialecticien.
Soisy (III, 2) : Marguerite de Lugolly, femme de Josias du Mortier, seigneur de Soisy, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, mère de Mme de Maugiron.
Sommaville, Antoine de (II, 11) : « imprimeur-libraire » (éditeur) de nouveautés littéraires.
Souart, Claude (III, 5) : apothicaire du duc d’Orléans et huissier de son conseil des finances.
Souvré, Jacques de, 1600-1670 (II, 8) : commandeur de Malte et bailli de la Morée en 1663. Scarron lui dédie sa première comédie : Jodelet, ou le maître valet.
Sublet, François, 1588-1645 (II, 7 – III, 4) : seigneur de Noyers, secrétaire d’État à partir de 1636, il est congédié en 1643. 677Il a, selon Tallemant, « une vraie âme de valet » (I, 298), et il est dévot.
Suze, comtesse de (III, 2 – VIII, 7) : Françoise Apronne, femme de Jacques-Honorat de La Baume, comte de Suze. À ne pas confondre avec la Comtesse de La Suze, poétesse.
Tabarin, 1584-1626 (VI, 3 – VII, 13 – VIII, 2) : de son vrai nom Antoine Girard, il était bateleur, magicien-prestidigitateur et comédien sur les tréteaux du Pont-Neuf et de la Place Dauphine. De nombreuses facéties portent son nom d’auteur (Recueil général des rencontres, questions […] et autres œuvres tabariniques ; Inventaire universel des œuvres de Tabarin, 1622). Le nom est passé dans la langue courante dans des expressions comme « faire le tabarin ».
Tambonneau, Marie Boyer, Mme, † 1700 (V, 2) : sœur de la duchesse de Noailles, femme de Jean Tambonneau, président à la Cour des Comptes. Mondaine, elle écrivit un sonnet sur la mort du perroquet de Mme de Plessis-Bellière, la maîtresse de Fouquet, qui donna lieu à diverses joutes poétiques.
Targas, Noël (II, 13) : procureur au Parlement.
Tarquin (I-6, 145) : il s’agit probablement de Sextus, fils de Tarquin le superbe (vie s. av. J.-C.), qui, selon la légende racontée par Tite-Live, viola la chaste Lucrèce.
Testu, Jacques, v. 1626-1706 (VIII, 8) : aumônier du roi, abbé galant et mondain, bel esprit, auteur de Stances chrétiennes reçu à l’Académie française en 1665.
Thomas, Thomas-François de Carignan, prince de Savoie (V, 18) : il se mit au service de la France après avoir servi l’Espagne ; en 1655, il marcha au secours du duc de Modène, fit lever le siège de Reggio, assiégea Pavie. Il mourut en Italie en 1656.
Thomas d ’ Aquin, saint, 1224-1274 (V, 7) : un des plus grands théologiens de la catholicité, maître à penser des jésuites.
Tibulle (IV, 8) : poète élégiaque du ier siècle av. J.-C., ami d’Ovide et d’Horace.
Tristan l ’ Hermite, François L’Hermite, sieur du Solier, dit, 1601-1655 (IV, 1 – V, 15 – VII, 16) : l’auteur de La Mariane (joué en 1636, publié en 1637) a pris pour pseudonyme tantôt « Tristan », tantôt « Tristan l’Hermite ». Après avoir appartenu au duc d’Orléans (de 1623 à 1644), il devient en 1646 gentilhomme de la maison du duc de Guise. En 1648, il dédie ses Vers héroïques au comte de Saint-Aignan ; ils contiennent onze pièces de vers à sa louange. À partir de 1649, il fait partie de l’Académie française. Au début de 1652, il fit représenter avec grand succès son remaniement de La Célimène de Rotrou, sous le titre d’Amaryllis, puis il publia en 1654 son Parasite (comédie).
Tubeuf, Jacques, † 1670 (II, 11) : président de la chambre des comptes, intendant des finances de France et surintendant des finances d’Anne d’Autriche.
Turenne, Henri de la Tour d’Auvergne, vicomte de, 1611-1675 (VII, 19) : maréchal de France, l’un des plus célèbres généraux français.
Urfé, Honoré d’, 1567-1625 (I-7 – IV, n) : ligueur dans le parti du duc de Nemours, la défaite l’entraîne dans 678une retraite studieuse. Il se met alors à écrire des Épîtres morales à partir de 1598 et surtout son roman pastoral L’Astrée (première partie en 1607), l’un des plus importants du xviie siècle.
Ursins : voir Orsini
Uzès, Emmanuel Bastet, dit de Crussol, duc d’ (III, 6) : pair de France et chevalier d’honneur d’Anne d’Autriche.
Valois, Louis-Emmanuel de Valois-Angoulême, 1596-1653 (III, 5) : gouverneur de Provence et colonel général de la cavalerie légère en 1643, époux de Marie-Henriette de la Guiche.
Valon (III, 5) : un des nombreux aumôniers sans gages qui figurent, à titre honorifique, sur l’État de la maison du duc d’Orléans.
Varin, Jean, v. 1607-1672 (II, 11) : graveur de monnaies et de médailles français, devenu « contrôleur et graveur général » des monnaies de France en 1647.
Vassé, Henri-François Grongnet, marquis de, † 1684 (III, 4) : sa grand-mère paternelle était fille d’Albert de Gondi, duc de Retz, pair et maréchal de France. Tallemant, qui lui consacra une historiette, dit de lui : « Vassé était si décrié qu’on le surnomma Son Impertinence, et plus il va en avant, plus on trouve qu’il est bien nommé » (II, 255).
Vendôme, César de, 1594-1665 (V, 18) : fils légitimé d’Henri IV et de Gabrielle d’Estrées, nommé grand amiral de France en 1651.
Ventadour, Charles de Lévis, duc de (III, 6) : pair de France, il est frère aîné du comte de Brion que Scarron rencontra aux eaux de Bourbon en 1642. Aucun autre texte ne fait mention de son amour pour Marie de Hautefort.
Verderonne, Claude de L’Aubespine, seigneur de (III, 5) : maître des requêtes et président des Comptes, homme de confiance du duc d’Orléans. On lui attribue une célèbre mazarinade (Agréable récit de ce qui s’est passé aux dernières barricades de Paris, 1648).
Verger, du (III, 4) : ami de Scarron au Mans.
Viantais, André de Bourseault, marquis de (III, 5) : il devint conseiller au conseil d’État et au conseil privé et maréchal de camp.
Viau, Théophile de, 1590-1626 (III, 5) : poète, courtisan et libertin, notoire pour le long procès qui l’a opposé au père Garasse et à son emprisonnement qui l’a laissé affaibli. Scarron le cite à plusieurs reprises dans Le Roman comique.
Villaine, Hubert de Champaigne, marquis de Villaines (III, 4) : il s’est marié au mois de juillet de l’année 1641.
Villegagnon, Nicolas Durand, seigneur de (III, 5) : un des gentilshommes de la chambre du duc d’Orléans.
Villequier, Antoine d’Aumont de Rochebaron, marquis de, 1601-1669 (III, 2 – V, 11 ; 18) : petit-fils du maréchal Charles VI d’Aumont, comme lui militaire de renom qui porte tour à tour les titres de garde du corps du roi, capitaine d’une compagnie de chevau-légers. Il est promu au grade de maréchal en janvier 1651. Il débute sa carrière au siège de Montauban en 1621, est blessé à l’île de Ré, participe au siège de Corbie (1636) et à la bataille de Lens (1648). Il s’est marié en 1629 avec une parente de Scarron, Catherine Scarron. Voir ses deux frères, César et Roger d’Aumont
Villequier, Louis Marie Victor d’Aumont de Rochebaron, marquis 679de (V, 18) : le fils du précédent, qui devint capitaine des gardes du corps du roi. Le mariage évoqué par Scarron dans LaGazette du 26 mai 1655 ne se fit pas ; il épousa Madeleine Le Tellier en 1660 (voir Villeroy).
Villeroy, Catherine de Neufville de, 1639-1707 (V, 18) : elle épousa en fait Louis de Lorraine en 1660.
Villon, François, 1431-1463 ? (IV, 8) : poète français.
Virgile (II, 8 – VII, 16 – VIII, 2 ; 3) : poète latin du ier siècle av. J.-C., auteur de l’Énéide.
Voiture, Vincent, 1598-1648 (IV, 8 ; 11 ; 12) : « l’âme du rond » des habitués de l’hôtel de Mme de Rambouillet, type de l’amuseur qui sait plaire par ses vers, ses bons mots et son art de la conversation. Il n’a rien publié de ses œuvres de son vivant, laissant le soin à son neveu Martin de Pinchesne de recueillir ses poésies et sa correspondance. Il est l’auteur du sonnet d’Uranie, qu’on a opposé au sonnet de Job par Benserade dans une importante querelle littéraire et mondaine. Il fut enterré le 26 mai 1648.
Werth, Jean de, ou Jan van Weert, 1595-1652 (I-2, 407 – V, 7 ; 11 – VII, 15) : capitaine de cavalerie mercenaire, qui, au service de l’Espagne, saccagea, en 1635 et 1636, la Lorraine, la Picardie et le Luxembourg ; après quoi il projeta une expédition au cœur de la France. À Compiègne, une armée de cinquante mille hommes força les envahisseurs à se retirer. La mémoire de cette incursion persista dans les chants populaires, et le nom de Jean de Werth (souvent écrit de Vert) en est venu à signifier un ennemi sanguinaire.