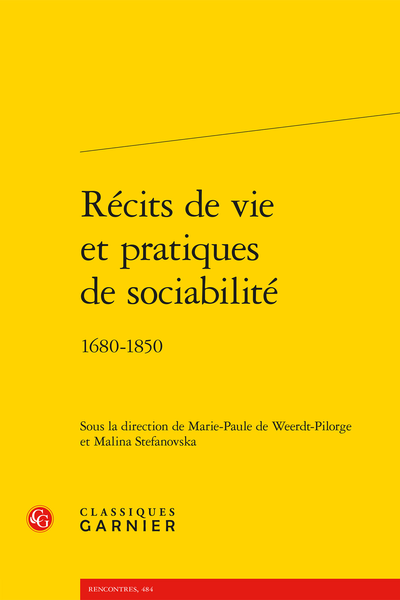
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Récits de vie et pratiques de sociabilité. 1680-1850
- Pages : 165 à 167
- Collection : Rencontres, n° 484
- Série : Le dix-huitième siècle, n° 35
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406109358
- ISBN : 978-2-406-10935-8
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-10935-8.p.0165
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 05/05/2021
- Langue : Français
Résumés
Marie-Paule de Weerdt-Pilorge et Malina Stefanovska, « Introduction »
L’émergence de l’individu entre les années 1680 et 1850 consacre, au sein de l’écriture factuelle, de nouvelles pratiques de sociabilité, qu’elles soient intimes, familiales, mémoriales ou idéales. Bien plus que les réseaux de sociabilité établis et reconnus, ces pratiques de sociabilité sont liées aux fluctuations de l’écriture et du discours sur soi en fonction des circonstances et des destinataires.
Adrien Paschoud, « “C’est la vérité pure”. écriture factuelle et mise en récit dans la Correspondance de Diderot »
Denis Diderot, on le sait, a fait grand usage de la fiction narrative pour explorer le monde des passions. On abordera dans cette perspective la correspondance du philosophe qui s’étend des débuts de la vie littéraire aux années de vieillesse marquées par le stoïcisme. Relevant a priori de l’écriture factuelle, ce massif documentaire constitue par endroits un remarquable laboratoire formel où s’énoncent un discours des passions et un discours sur les passions, ces deux niveaux étant étroitement liés.
Sophie Rothé, « La correspondance amoureuse sous contrainte. Gabriel de Mirabeau et Sophie de Monnier enfermés »
Au xviiie siècle, le courrier du détenu d’une prison d’état subit une surveillance étroite le privant de son réseau habituel de sociabilité. Dans cette perspective, la correspondance carcérale de Gabriel de Mirabeau et de son amante, représentative de la topique amoureuse, révèle le lien fondamental qui existe entre l’écriture passionnée voire érotique et la claustration : la représentation épistolaire de soi en amoureux transi contribue à l’image du martyr politique.
166Yohann Deguin, « Les lettres de Madame Palatine. Formes, enjeux et réinventions d’un réseau épistolaire »
Les lettres de Madame Palatine, sont un riche observatoire des réseaux de sociabilité, entre xviie et xviiie siècle. Mariée en France, Madame engage une vaste correspondance avec sa famille. Ses lettres réinventent la pratique épistolaire, contaminée par les topoï de l’écriture autobiographique. Cet article propose de voir comment s’invente une langue du réseau familial, soit un ensemble de signes qui représentent l’épistolière au cœur d’un groupe qu’elle construit avec une image d’elle-même.
Ryan Hilliard, « Célibataires mais pas solitaires. Les réseaux de filles majeures à Paris au xviiie siècle »
Cet article porte sur la manière dont les femmes célibataires à Paris au xviiie siècle ont noué des alliances communautaires et sur l’impact de ces associations dans leur vie quotidienne et dans les moments de crise. En déplaçant l’attention de leurs relations manquantes avec leur famille vers leurs liens de sociabilité avec voisins et amis, l’étude des réseaux des filles majeures montre comment les femmes célibataires pouvaient surmonter des obstacles et réaliser l’inclusion sociale.
Malina Stefanovska, « Casanova et ses réseaux »
Cette étude de quatre réseaux de sociabilité dans l’Histoire de ma vie de Giacomo Casanova (les banquiers et grands financiers ; le monde du théâtre avec ses actrices, cantatrices, et danseuses ; la République des Lettres ; le monde des aventuriers et escrocs) dégage la communication parfois intra-familiale à l’intérieur de chaque réseau, ainsi que leur imbrication mutuelle et internationale, donnant ainsi un aperçu riche du monde européen du xviiie siècle et de la complexité de ses liens sociaux.
Jean-Jacques Tatin-Gourier, « La genèse d’un sentiment d’étrangeté à la cour de Napoléon dans les Mémoires de Madame de Rémusat »
Madame de Rémusat, marquée par la sociabilité des élites d’Ancien Régime, relate la dégradation de ses sentiments à l’égard de Napoléon, de son ralliement au Premier Consul à une désillusion dans laquelle se conjuguent 167le sentiment d’une ingratitude du monarque et la conscience croissante d’une perversion politique. Analyste de la vie de cour et des émotions ambiguës que cette vie suscite, elle montre comment son désenchantement croissant la conduit à une véritable lucidité politique et historique.
Julie Billaud, « L’écriture de l’artiste dans les écrits non fictionnels de George Sand de 1834 à 1849 »
Entre 1834 et 1847 George Sand s’établit en artiste dans la vie sociale, du salon de la rue Pigalle à sa maison familiale de Nohant. L’écrivain rassemble autour d’elle des figures telles que Delacroix, Franz Liszt, Chopin, ou encore la future Pauline Viardot. En nous appuyant sur ses correspondances de 1834 à 1847, des écrits intimes et quelques extraits de son autobiographie Histoire de ma vie, nous montrerons comment l’auteur engage ce que nous nommerons une « écriture de l’artiste ».
Juliette Douillet, « De l’influence romantique à l’impersonnalité. Représentations de Flaubert dans sa correspondance de jeunesse »
La correspondance de jeunesse d’un auteur est souvent le lieu privilégié de l’évolution du sujet. Elle joue un rôle central puisque l’écrivain en herbe y exerce sa plume et y exprime ses positions. C’est avec Gustave Flaubert – de janvier 1830 à juin 1851 – que ce rapport ainsi que ses incidences seront étudiés. La correspondance constitue le médium par lequel l’écrivain élabore son point de vue littéraire, et ce par ses échanges avec ses correspondants à travers une représentation de soi-même.
Mohamed Yosri Ben Hemdene, « Barbey poète. L’individu et son réseau imaginaire »
Cet article étudie les représentations de soi d’un Barbey multiple, dans Omnia, son cahier de notes. Une œuvre mineure de l’écrivain qui apporte, toutefois, des éclaircissements majeurs sur la manière dont Barbey appréhende les champs du savoir, à la lumière des jugements souvent sévères que l’écrivain porte tant sur les grandes figures littéraires de son temps que sur les écrivains du passé, les historiens et les hommes de sciences.