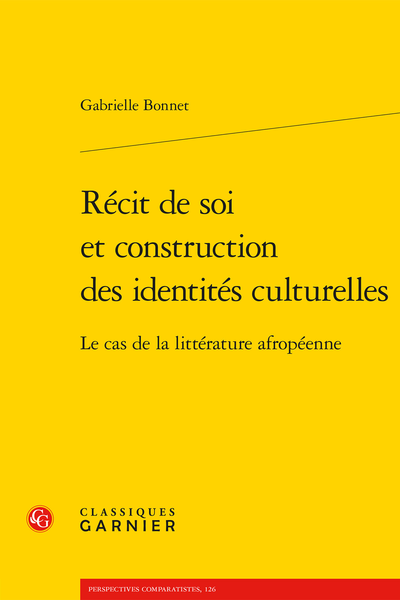
Table des matières
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Récit de soi et construction des identités culturelles. Le cas de la littérature afropéenne
- Pages : 499 à 504
- Collection : Perspectives comparatistes, n° 126
- Thème CLIL : 4028 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes de littérature comparée
- EAN : 9782406141457
- ISBN : 978-2-406-14145-7
- ISSN : 2261-5709
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14145-7.p.0499
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 15/02/2023
- Langue : Français
Table des matières
Note sur les traductions 9
Introduction générale 11
Autour de la notion d’identité 12
Littérature postcoloniale et littérature de migration 16
Récit de soi, fable de soi 19
Afrique et Europe : la littérature afropéenne 21
Choix des œuvres étudiées et présentation des auteurs 24
Intérêt des études postcoloniales comparatistes 31
La créolisation à l’œuvre 35
Parcours proposé 37
PREMIÈRE PARTIE
L’ERRANCE AU CŒUR
DE LA CONSTRUCTION IDENTITAIRE
AFROPÉENNE
Introduction à la première partie 41
D’un lieu à d’autres 47
La ville comme territoire 47
La mélancolie du chauffeur de taxi (Awumey, Scego) 47
Déambulations historiques (Scego) 50
Être vu, être vue (Mabanckou, Miano) 52
500La ville traversée (Komla-Ebri) 63
Le quartier comme foyer de rayonnement (Otoo) 66
Retours au pays 69
Retour volontaire et temporaire au présent
(Komla-Ebri, Oji) 69
Retour volontaire et temporaire au passé (Scego) 75
Retour contraint et temporaire (Gaye) 77
Le désir de retour (Miano, Mabanckou) 81
Figures du nomadisme 84
Le nomadisme comme origine perdue (Scego) 85
Le nomadisme douloureux (Awumey) 88
La construction identitaire face à l’autre 93
Double appartenance et double conscience 93
Éléments de définition 94
L’autre en soi : la dualité face à l’identité-racine 97
« The color line » 110
Le motif omniprésent de la peau noire 110
Des situations d’inconfort
à l’épreuve du racisme le plus violent 118
Étrangers de l’intérieur 134
Les « pieds sales », une représentation de l’errance
comme destinée (Scego, Awumey) 134
La marginalité du centre (Awumey, Mabanckou, Scego) 137
Identités de genre 140
Le récit-rhizome
Écrire en présence du monde 149
L’identité narrative comme herméneutique de soi 149
L’identité narrative selon Ricœur 149
Praxis de l’identité narrative 153
La production du récit de soi comme « stratégie identitaire » 168
Stratégies identitaires et interculturalité paradoxale 168
De l’identité prescrite à l’identité construite (par le récit) 176
Le lieu de l’écriture 188
501DEUXIÈME PARTIE
ÉCRIRE AU CARREFOUR
DES LANGUES
LA LANGUE
COMME TÉMOIGNAGE
ET MANIFESTE
Introduction à la deuxième partie 193
D’une langue à l’autre
Choisir sa langue d’écriture 195
Raisons économiques et de pouvoir.
Tableau synthétique du système éditorial africain 196
Choix de la langue d’écriture et traduction 196
L’envahissante présence des éditeurs européens
sur le continent africain 200
Des difficultés persistantes à se faire éditer en Europe 203
Raisons historiques et culturelles 207
Remarques sur les langues en présence 208
Auteurs écrivant dans une langue première 212
Auteurs écrivant dans une langue adoptée 219
Pour une décolonisation de la langue 225
Retour sur la notion de « surconscience linguistique » 225
Enjeux politiques du choix de la langue d’écriture
dans la littérature postcoloniale 227
Refus ou subversion de la langue coloniale ? 228
Les risques d’un imaginaire monolingue 231
Des auteurs engagés sur les plans politique et social 234
Des imaginaires hétérolingues. La créolisation au travail 239
Des œuvres transgressives
(de la langue et de la linéarité de l’écriture) 240
La vocalité en partage : l’alliance de l’écrit et de l’oral 255
502L’hybridité linguistique comme reflet
d’appartenances culturelles multiples 279
L’hétérolinguisme comme témoin du processus
de créolisation linguistique 280
Définition 280
Une poétique hétérolingue 282
Entre hermétisme et recherche d’une universalité de la langue.
L’usage des notes et glossaires 299
La traduction dans le corps du texte :
appositions et gloses 300
Les outils péri-textuels (1) : la note de bas de page
(Miano, Komla-Ebri, Gaye, Scego) 310
Les outils péritextuels (2) : l’usage du glossaire
(Otoo, Miano, Oji, Komla-Ebri) 316
TROISIÈME PARTIE
RECONFIGURATIONS TEXTUELLES
D’UN GENRE À L’AUTRE,
D’UN ART À L’AUTRE,
DES ROMANS-MONDE
Introduction à la troisième partie 325
Une hybridité générique
Au-delà des frontières des genres occidentaux 327
Le récit de soi dans la littérature postcoloniale africaine 328
Les différentes phases de la littérature postcoloniale 328
Formes africaines de l’écriture de soi 330
De l’autobiographie au roman à la troisième personne.
Nouvelles postures de l’écrivain postcolonial 336
L’autobiographie (Oji) 336
Le récit autobiographique (Scego) 337
L’autofiction (Otoo) 339
503Narrations à la première personne 341
Narration à la troisième personne (Miano, Awumey) 344
Révision des canons de la littérature occidentale 346
Remises en cause du canon occidental 347
La transgression de la répartition en genres littéraires :
romans ou récits ? 353
L’éclatement du roman :
du « mélange des genres » au « roman marron » 356
Une intertextualité vivante
Variations et fugues 371
Retour sur la notion d’intertextualité 371
Un jeu d’érudit.
De la citation explicite à l’allusion énigmatique 374
Les citations 375
Les références 380
Les allusions 389
Le cas particulier des épigraphes 395
Le moi-mosaïque.
Cohérence et continuité par-delà le morcellement référentiel 401
Des œuvres totales
D’un art à l’autre 405
La notion d’intermédialité 405
Une intermédialité multiple et omniprésente 409
Références cinématographiques 409
Références picturales et photographiques 413
Références architecturales et sculpturales 417
De la musique avant toute chose.
La musique comme socle identitaire 419
La musique comme élément identitaire fondamental
pour les Afrodescendants 419
La musique dans nos œuvres : rhapsodies afropéennes 423
Une « écriture-jazz » ? 457
Jeux et enjeux de l’antiphonie 466
504Conclusion 471
Bibliographie 479
Index 495