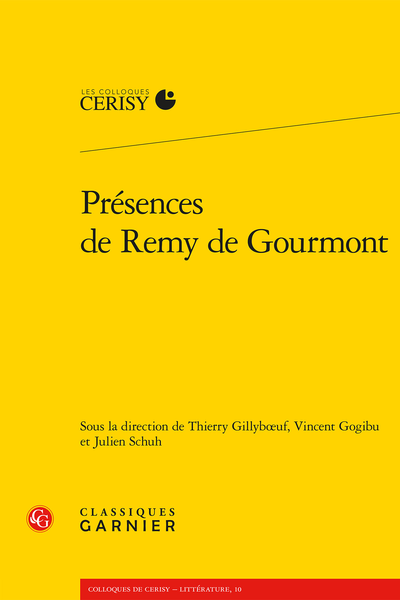
Résumés
- Publication type: Article from a collective work
- Collective work: Présences de Remy de Gourmont
- Pages: 879 to 889
- Collection: Cerisy Colloquia - Literature, n° 10
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406106760
- ISBN: 978-2-406-10676-0
- ISSN: 2495-2788
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-10676-0.p.0879
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 03-24-2021
- Language: French
Résumés
Marie Kawthar Daouda, « La Féminité gourmontienne au fil des allusions liturgiques. L’esthétique de la transsubstantiation au service du texte »
L’article propose de mettre en évidence la manière dont Gourmont aborde l’écriture de la nouvelle et du roman comme un champ privilégié pour la mise en scène des points de rupture entre idée et idéal. L’allégorie féminine, la « femme-idée » en qui les deux définitions se synthétiseraient, est au cœur des enjeux d’écriture de l’auteur à qui le pétrarquisme fin-de-siècle et le lexique et la narratologie symbolistes doivent énormément.
Jean-Paul Morel, « Remy de Gourmont et le cinématographe. Le premier “intellectuel cinéphile” »
Remy de Gourmont, considéré comme le premier « intellectuel cinéphile », attache au cinématographe une importance paradoxale : Gourmont conserve une vision élitiste de l’Art et ne goûte guère que le cinéma constitue un divertissement pour le peuple, sans oublier qu’il ne considère celui-ci que comme un simple « moyen de reproduction mécanique ».
Alexia Kalantzis, « Remy de Gourmont “journaliste”. La chronique laboratoire des idées et des formes »
L’activité journalistique de Remy de Gourmont s’inscrit dans le contexte particulier de la fin du xixe siècle, avec le développement des « petites revues » dont le modèle éditorial oscille entre le journal et le livre. Dans ses chroniques, Gourmont joue sur le brouillage des genres et se livre à une expérimentation des idées et des formes. Il crée ainsi une esthétique originale, fondée sur le principe de la fragmentation.
880Marc Décimo, « Marcel Duchamp, lecteur de Remy de Gourmont »
Comprendre Duchamp n’est guère possible sans passer par Gourmont. Son influence est directe et diffuse : que ce soit sur l’érotisme ou bien sur Lautréamont. L’article étudie cet intérêt intellectuel de Duchamp pour l’érotisme et le met en relation avec la notion de « dissociation ». Enfin, il y aurait sans doute une limite à poser. Gourmont et Duchamp ne se font certainement pas la même idée de la littérature.
Julien Schuh, « Gourmont et l’art populaire »
Cet article expose les liens de « Gourmont et l’art populaire » au travers d’une série de paradoxes (dans la droite ligne de la dissociation d’idées très gourmontienne) mettant aux prises les notions de culture de masse et de culture populaire, d’élitisme nietzschéen et de culture communautaire, de promotion de la singularité de cette culture tout en éprouvant ses limites.
André Cariou, « Charles Filiger le Fidèle »
Filiger établit des relations étroites avec Gourmont qui se concrétisent par l’illustration de la couverture du Latin mystique, le frontispice de L’Idéalisme, une présentation dans le Mercure, des illustrations dans L’Ymagier ou la dédicace en hommage des Saintes du paradis. Malgré la disparition de la plupart des échanges épistolaires, le propos sera de tenter, à travers d’autres correspondances et sources, d’imaginer les relations entre les deux hommes.
Thierry Gillybœuf, « Comment écrire la biographie de Remy de Gourmont »
Ce bilan de dix années de recherches sur Gourmont offre une réflexion méthodologique et pratique sur le travail d’un biographe, confronté au manque de sources, aux redécouvertes inattendues, aux rencontres humaines qui tissent l’aventure de l’écriture d’une vie, celle de Gourmont étant au centre d’une époque qui revit avec lui.
881Patrick Thériault, « Lire et vivre selon l’Idéal. Économie de la lecture et de la culture dans le prologue de D’un pays lointain »
Comme l’y prédispose son inscription liminaire, le texte éponyme servant de prologue au recueil de contes D’un pays lointain (1898) est surdéterminé sur le plan herméneutique. Il livre aussi les termes cardinaux de sa conception de la lecture littéraire. C’est cette conception de la lecture, véritable programme d’économie pulsionnelle et existentielle, et qui ouvre par là même à une réflexion d’envergure proprement herméneutique, que l’article propose d’exposer.
Gaël Prigent, « Huysmans, (re)lecteur de Gourmont »
Les points de divergence entre Huysmans et Gourmont sont nombreux, en particulier à partir de la publication du Latin mystique, de la préface de l’ouvrage signée par l’auteur d’À rebours, et de la brouille qui s’en suivit en 1892. Huysmans doit beaucoup à Gourmont, présent en filigrane dans une partie de son œuvre. La dette n’est pas toujours reconnue, mais elle est indéniable.
Gérard Poulouin, « Remy de Gourmont et la sainteté »
Gourmont s’est intéressé à de nombreux saints et à quelques saintes sous un angle académique dans Le Latin mystique. Il s’est alors agi de faire entendre des voix singulières, catholiques, sur quelques siècles. Gourmont adhère à des convictions qui l’amènent à s’opposer au protestantisme, et en particulier à Luther. Plus largement c’est l’école de la Troisième République qu’il convient de dénoncer, hostile à la culture du peuple des champs.
Thierry Gillybœuf, « Remy de Gourmont ou l’anarchisme à particule »
Thierry Gillybœuf démontre comment Gourmont, s’il se laisse volontiers lire tel un contempteur tous azimuts de toute forme d’autorité incarnée par l’État, la société ou la religion, demeure cependant à l’opposé du mouvement anarchiste dont il peut partager certaines idées mais réprouve le modus operandi.
Alexis Tchoudnowsky, « Remy de Gourmont, philosophe du désarroi ? »
De quel « désarroi » peut-il s’agir en ce titre, en ce concept répété nulle part ailleurs que dans le texte ainsi désigné ? L’enjeu de cette intervention sera 882d’envisager Gourmont du point de vue de la singularité stylistique et théorique du roman inédit, Le Désarroi, en avançant certaines pistes de réflexion sur les influences et congruences philosophiques dont ce texte pourrait être le révélateur, notamment en rapport à Nietzsche, Kierkegaard et Chestov.
Philippe Geinoz, « La Place du Commun. Penser la fonction de la Poésie après Gourmont »
Les poètes de la génération moderniste ont le plus souvent salué en Gourmont l’extraordinaire passeur, curieux de tout ce qui peut nourrir la pensée, occultant par là même le rôle joué par les réflexions de l’écrivain dans l’élaboration de poétiques cherchant à se détacher du symbolisme. Il est pourtant possible et intéressant de suivre la présence de Gourmont dans les propositions successives qui, de 1908 à 1918, s’attachent à redéfinir « l’image » poétique.
Stéphanie Smadja, « Remy de Gourmont et l’imaginaire du style »
À partir de 1850, la littérature s’écarte à la fois de la rhétorique et de la langue commune. Accédant à une forme d’autonomie, elle se redéfinit à partir du primat de l’esthétique. La notion de style joue un rôle majeur dans ce bouleversement des hiérarchies esthétiques et des frontières génériques. Quelle est la représentation du style proposée par Remy de Gourmont ? Quels sont son rôle et sa place dans l’imaginaire de la langue littéraire ?
Cyril Barde, « Remy de Gourmont et l’Art nouveau. Des arts décoratifs au vers libre »
L’article propose d’interroger les spécificités et les enjeux de la réception gourmontienne de l’Art nouveau, entre critique d’art et critique littéraire. Il tente de montrer en quoi l’Art nouveau s’invite dans la réflexion et l’évolution littéraires de Remy de Gourmont, qu’il s’agisse de penser – dans le sillage de Francis Jammes – une nouvelle poésie de la nature ou de redéfinir les contours du vers libre au sein d’une théorie de la stylisation.
Clément Dessy, « Quels illustrateurs pour Remy de Gourmont ? »
L’investissement de domaines et genres multiples caractérise l’œuvre de Gourmont, du roman à l’essai, de la critique d’art au conte. Il prend également 883son parti en peinture en faisant illustrer un grand nombre de ses ouvrages par de multiples artistes anciens ou contemporains, révélant indirectement ses prédilections. À travers ses illustrateurs et la place occupée par chacun d’eux dans le champ culturel, c’est aussi le positionnement et la trajectoire d’un écrivain que nous retracerons.
Colette Camelin, « Remy de Gourmont et Victor Segalen. Convergences et divergences »
Gourmont a témoigné de l’intérêt pour Les Cliniciens ès Lettres qui « tend à unir la littérature et la science ». Il s’en est suivi des échanges intellectuels marqués par des convergences esthétiques et philosophiques, en relation avec Nietzsche et Jules de Gaultier. Mais des divergences sont aussi significatives, autour de Gauguin et des Immémoriaux par exemple, à l’égard de certains textes de Gourmont qu’il juge « pailletés de journalisme ».
Vincent Gogibu, « “Un regard d’enfant avec l’expérience des siècles”. Remy de Gourmont par Francis de Miomandre »
Considérer l’approche critique de Gourmont par Miomandre revient à en considérer évidemment l’impact, mais aussi à appréhender tout un prisme de revues littéraires, françaises et européennes, dans lesquelles Miomandre écrit et qui révèle l’importance de son réseau. Examiner la critique de Miomandre sur Gourmont implique immanquablement de revenir sur l’importance des réseaux et revues de cette époque.
Franck Javourez, « Remy de Gourmont et Henri de Régnier. Entre baveux hystérique et dahlia mélancolique »
« Je songe à ce dahlia, songeant à la poésie d’Henri de Régnier » : le texte des Promenades littéraires fait ainsi l’éloge de Tel qu’en songe. Vielé-Griffin, écrivant à Régnier, avait alors traité l’auteur des Fleurs de jadis de « baveux hystérique ». Derrière les anecdotes, nous devinons les relations complexes de ceux qui se sont côtoyés durant des années au Mercure de France. Nous esquisserons quelques réflexions sur les thèmes qui seraient communs à nos deux écrivains, en croisant leur poétique respective.
884Christian Buat, « Français régional et patois ciz Remy de Gourmont »
Gourmont n’a laissé d’affirmer sa normannité. Après avoir rappelé ce qui s’entend par ces deux faces de la langue normande que sont le français régional et le patois, l’article examine la façon dont cette langue s’est introduite dans l’œuvre de celui qui, avant de reposer au Père-Lachaise, hanta quelques lieux privilégiés par lui de la Normandie.
René Le Texier, « À propos d’un buste. Coutances 1922 »
Retour sur « Sur les fêtes autour de l’inauguration du buste et le Pou qui grimpe » où comment la postérité régionale de Gourmont a pris la figure d’un buste dans le jardin public de Coutances et l’allure d’un regroupement d’amis sous le nom de Pou qui grimpe.
Sandrine Schiano, « Remy de Gourmont et les sciences de la nature. Digressions, réflexions et rêveries »
L’évolutionnisme scientifique est un domaine d’études qui a toujours fasciné Gourmont. Il assiste au triomphe du mutationnisme avec, sans doute, l’intention d’enrayer l’optique darwinienne faisant de l’homme la « dernière œuvre de la force créatrice ». Nous nous interrogerons sur l’actualité de cette réception en revenant sur quelques-uns de ses essais dont Physique de l’amour, Le Chemin de velours ou de ses Promenades philosophiques.
Alexia Kalantzis, « Remy de Gourmont médiateur culturel. Les petites revues et la littérature étrangère »
Les périodiques fin-de-siècle se présentent comme des espaces ouverts sur l’international, et plus particulièrement sur l’Europe : un réseau européen de revues se crée à partir de grandes figures de médiateurs, comme celle de Remy de Gourmont. Par ses articles et ses liens avec les écrivains étrangers, il a joué un rôle important dans la constitution d’une avant-garde européenne, et notamment entre l’Italie et la France.
885Julien Schuh, « Gourmont et les masques. Symbolisme et journalisme »
Le Livre des Masques est souvent présenté comme une sorte de Panthéon symboliste. Pourtant, l’ouvrage est issu d’un projet dont les ambitions étaient très différentes. En reconstruisant la genèse du Livre des Masques, on peut redéfinir la relation de Gourmont au monde du journalisme et expliquer par quels types de déplacements esthétiques et théoriques il configure un espace pour le discours des avant-gardes de son époque dans le champ médiatique fin-de-siècle.
Thierry Gillybœuf, « Le petit frisson esthétique »
La découverte du symbolisme à travers la lecture du premier numéro de La Vogue a eu un effet cathartique sur l’écriture comme sur la pensée gourmontiennes. Nourri de l’idéalisme allemand, Gourmont explore les possibilités que lui offre cette esthétique nouvelle, en rupture avec le romantisme dont il procède, et le naturalisme dont il se veut l’antidote. Avant de s’éloigner sans jamais renier d’un mouvement littéraire auquel, aujourd’hui encore, son nom reste étroitement associé.
Alain Goulet, « Remy de Gourmont vu par André Gide »
Le dialogue entre Remy de Gourmont et André Gide – « le reclus et le retors », selon André Rouveyre – a été rude et orageux, et il s’est rapidement tari. Pour Gide, qui a cultivé tant d’amitiés, il y a eu dès le départ incompatibilité d’humeurs. La communication exposera les pièces de ce dossier.
Christian Buat, « Remy de Gourmont et l’idée de gloire »
« Les grenouilles chantent dans les roseaux du soir. On n’entend plus la douce nuit qui marche. Les grenouilles sont devenues la seule gloire et la tyrannie de la terre : l’âme des morts illustres a passé dans le ventre des grenouilles ». La gloire a hanté Gourmont. L’article questionne les différentes manifestations de cette hantise, la récurrence de réflexions sur l’érection de statues et bustes, sa conception de la gloire et sur sa gloire elle-même.
Anne Boyer, « Gourmont et la dissociation des idées »
Sur quoi se fonde cette méthode de « dissociation des idées » dont Gourmont fait parfois la forme emblématique de son œuvre ? L’article s’intéresse au 886mécanisme dissociatif, aux cibles qu’il se donne mais aussi et surtout à la métaphorique par laquelle Gourmont évoque cette quête de sens. Il montre ainsi comment la dissociation prend place dans la tension entre le sentiment et l’intelligence qui traverse l’œuvre gourmontienne.
Paul Gorceix, « Remy de Gourmont et la littérature française de Belgique »
L’intérêt de Gourmont pour la Belgique s’exprime dans les deux séries du Livre des Masques où il accorde une place de premier plan aux écrivains belges. L’invasion de la Belgique en 1914 lui permet de faire découvrir en France la richesse de la littérature et de l’art en Belgique. Dans La Belgique littéraire (1915), il brosse une histoire de la littérature des lettres françaises de Belgique surprenante par l’intuition, la qualité de ses jugements littéraires et par la fraîcheur de ses portraits d’écrivains.
Bernard Jahier, « Remy de Gourmont, auteur de livres didactiques pour la jeunesse »
En 1890 Gourmont a publié un ouvrage de vulgarisation, Chez les lapons, mœurs, coutumes et légendes de la Laponie norvégienne. De 1882 à 1890, il a publié sept autres ouvrages de ce type, généralement destinés à la jeunesse. Il y a donc un Gourmont avant Gourmont dont la production coïncide très précisément avec la période où il est employé à la Bibliothèque nationale. C’est ce Gourmont qu’on se proposera de découvrir.
Anne-Marie Fixot, « Remy de Gourmont, lieux et paysages »
Le paysage est la traduction d’interactions mobiles incessantes entre les hommes, les sociétés et leurs espaces par rapport à leurs milieux de vie. Ces enjeux apparaissent chez Gourmont, dont l’œuvre est étudiée à travers les lieux et paysages privilégiés et préférés ; les repères de sa conception du monde : de la valorisation de l’énergie vitale au scepticisme à l’égard du monde ; son approche de la nature et des hommes.
Karl D. Uitti, « Remarques sur Le Latin mystique (1892) »
Le Latin mystique constitue le livre-clé de l’imagination littéraire de Gourmont par les liens reliant les poètes de son temps à ceux d’une vieille 887latinité chrétienne, et, en le faisant, il se donne comme le nouveau Sainte-Beuve des « décadents » et des « symbolistes » de son temps. En même temps, Gourmont entre dans la pleine possession de sa propre voix poétique incarnant la liberté absolue et opérant une véritable révolution linguistico-poétique.
Valérie Michelet, « Remy de Gourmont et le roman »
« Le roman ne relève pas d’une autre esthétique que le poème. Le roman est un poème ; tout roman qui n’est pas un poème n’existe pas ». Le roman-poème est pressenti par Gourmont comme l’alternative la plus féconde à l’impasse naturaliste. Sa « théorie » est à reconstituer à travers la lecture croisée d’écrits théoriques et de romans de la fin du siècle. De cette analyse émerge une formidable utopie esthétique qui trouve son origine dans la réflexion poétique entamée par les romanciers du symbolisme.
Sophie Lucet, « Le “Joujou” théâtre »
Le rapport de Remy de Gourmont au théâtre et à son théâtre fut des plus ambivalents. Cet article analyse cette attitude paradoxale, par un parcours chronologique de l’œuvre théâtrale de Gourmont et de son devenir critique et par l’étude de ses conceptions littéraires et esthétiques en matière de théâtre.
Thomas Carino, « Remy de Gourmont et ses premiers illustrateurs. Henry de Groux et Charles Filiger »
Au lieu d’envisager les expériences successives de Gourmont avec ses divers peintres-graveurs, cet article étudie sa relation avec ses deux premiers collaborateurs, deux artistes singuliers, les peintres symbolistes Henry de Groux et Charles Filiger, auteurs l’un et l’autre d’un portrait peint de l’écrivain.
Gérard Foucher, « Gourmont et le monde anglo-saxon »
Gourmont, parfaitement anglophone, a manifesté son intérêt pour la littérature en langue anglaise par toute une série d’articles. Le point commun entre maints écrivains, essayistes et poètes anglo-saxons contemporains évoqués par Gourmont touche aux relations entre le corps physique et les productions de l’esprit. Cette approche, déjà comparatiste, visait à montrer que le fait littéraire pouvait relever de procédures apparentées à la science.
888Tiziana Goruppi, « Maître à penser, maître à dissocier. Remy de Gourmont dans la culture italienne au début xxe siècle »
G. Papini commentant la nouvelle de la mort de Gourmont le définissait comme « l’homme le plus intelligent de France ». Auteur très apprécié par l’élite culturelle italienne pour avoir su libérer son écriture des carcans du naturalisme et imposer avant tout la liberté intellectuelle. La preuve de son succès en Italie fut l’attention de la presse à sa production littéraire et les nombreuses traductions de ses œuvres en Italie.
Francesco Viriat, « Portrait de Remy de Gourmont en anarchiste »
Quand le « Joujou patriotisme » paraît en avril 1891 dans le Mercure de France, la presse chauviniste jette l’anathème sur un « dangereux anarchiste » qui n’hésite pas à renier l’idée de patrie. L’affaire du « Joujou patriotisme » va contribuer à enfermer l’anarchisme gourmontien dans une image réductrice dont l’histoire littéraire se satisfera aisément.
Gérard Poulouin, « Gourmont et la libre pensée »
Contre le christianisme Gourmont fait entendre la parole de divers penseurs qui ont recouru, par méthode ou par conviction profonde, au scepticisme. Revisitant le passé, il valorise les penseurs qui ont ouvert des brèches dans la citadelle du christianisme, parce qu’ils ont promu le libre examen et la méthode expérimentale, parce qu’ils ont réactualisé certaines philosophies antiques, et en particulier l’épicurisme, contre les pesanteurs du dogme et les cloaques du conformisme.
Olivier Boileau, « Remy de Gourmont et Victor Segalen »
Comme beaucoup de jeunes écrivains, Segalen fit acte d’allégeance à Gourmont au début de sa carrière, en 1901. Son parcours d’écrivain croise en effet à plusieurs reprises les thématiques de l’œuvre gourmontienne, comme la dissociation des idées ou l’individualisme.
Jean-Claude Larrat, « Lautréamont entre Gourmont et Malraux »
Dans les quelques pages consacrées à Lautréamont, sous le titre La littérature Maldoror, Remy de Gourmont pose le problème dont les surréalistes 889allaient s’emparer : celui des rapports entre la poésie et la folie. Gourmont instruit ainsi le procès qui, avant que ne triomphe l’extraordinaire entreprise de canonisation lancée par Breton, Aragon et Soupault, donna lieu à de violentes controverses – dont témoigne par exemple, en 1925, le numéro du Disque Vert.
Thierry Gillybœuf, « In Memoriam Karl D. Uitti »
Véritable initiateur des études gourmontiennes, Karl D. Uitti a longtemps gardé par-devers soi cette passion de jeunesse. Il est devenu un éminent médiéviste, apprécié tant par ses collègues que par ses élèves. Depuis quelques années, sollicité par les gourmontiens de France, il avait pu renouer avec cet auteur qui lui est toujours resté cher.
Gérard Poulouin, « Karl D. Uitti à Cerisy »
Quarante ans après avoir consacré sa thèse à Gourmont, à une époque où il était l’un des seuls à s’y intéresser, Karl D. Uitti venait pour la première fois dans la patrie de cet écrivain qui avait été sa première passion. Ce fut l’occasion de rencontrer ce maître disponible, qui disparaissait un an après le colloque, après avoir bouclé la boucle de sa passion gourmontienne.
Thierry Gillybœuf, « Tiziana Goruppi (1947-2015). In memoriam
La Triestine Tiziana Goruppi, à qui l’on doit de nombreux essais sur Gourmont, était elle aussi une figure des études gourmontiennes. Fine spécialiste de littérature française du xixe siècle, traductrice et professeur respectée et appréciée, elle laisse à ceux qui l’ont connue le souvenir d’une femme brillante et enthousiaste.