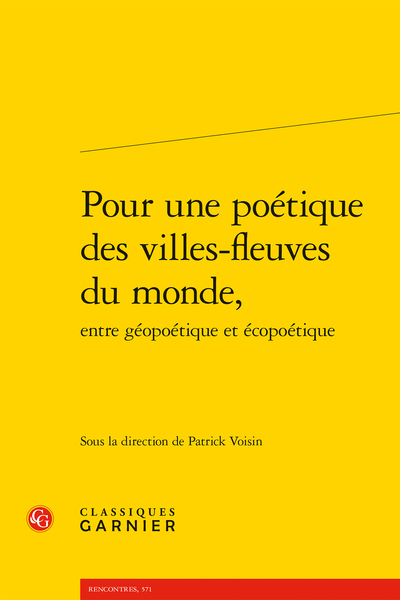
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Pour une poétique des villes-fleuves du monde, entre géopoétique et écopoétique
- Pages : 589 à 596
- Collection : Rencontres, n° 571
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406144823
- ISBN : 978-2-406-14482-3
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14482-3.p.0589
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 03/05/2023
- Langue : Français
Résumés
Patrick Voisin, « Prolégomènes à l’étude des villes-fleuves du monde sous le signe de Zeugma »
L’étude des villes-fleuves du monde occupe la recherche chez les historiens, les géographes et les urbanistes, en lien avec les questions écologiques : comment envisager la relation entre ville et fleuve ? Or, dans le carrefour d’études des humanités environnementales, il y a aussi la littérature avec des courants tels que la géopoétique et l’écopoétique. Mais y a-t-il unité d’objectifs et de moyens entre ces discours, ou ces derniers sont-ils sous le signe de zeugma ?
Pierre Schoentjes, « Petite écopoétique du fleuve chez Pierre Gascar »
L’étude transversale de l’œuvre de Gascar à partir de l’image du fleuve, appuyée par certains rapprochements avec des événements biographiques majeurs, montre que, lorsqu’il s’agit de penser un rapport à la nature, c’est toujours contre un imaginaire de l’enracinement qu’il écrit. Alors que l’attachement excessif à une terre ouvre la porte aux dérives du nationalisme, l’œuvre de Gascar adopte une perspective cosmopolite et privilégie le réseau de la mobilité et du mouvement.
Fatouma Quintin, « Beaucaire au fil de l’eau, au fil des lignes »
Par sa situation stratégique sur le trajet du Grand Rhône, la petite bourgade de Beaucaire, entre fleuve et mer, a acquis un grand destin de ville-fleuve. Les amours du fleuve et de la terre se traduisent par leurs liens intrinsèques et dans leurs échanges ; aussi se mesurent-ils, d’une part, par ce qu’ils s’apportent mutuellement, de l’autre, par leur disparition simultanée, sous la poussée industrielle, fossoyeuse d’un monde naturel.
590Annie Rizk, « Paris au miroir de la Seine chez Balzac. Une mythologie sociale ? »
Dans le roman balzacien, la Seine acquiert une géographie symbolique, entre image de la conquête des ambitieux et gouffre où d’autres tournent le dos à la ville et à la vie. Dès lors, la Seine est-elle au cœur de la mythologie sociale balzacienne ou bien a-t-elle une existence plus poétique et imaginaire étrangère à l’urbanité ? Comment le mythe de l’Inconnue de la Seine a-t-il pu émerger et se perpétuer pour représenter les traces mystérieuses de l’histoire de cette ville-fleuve ?
Frédéric Picco, « La Seine ou Ponge à l’épreuve de l’informe »
Dans La Seine, Ponge rencontre à un double niveau la difficulté de donner une forme satisfaisante au fleuve. Premièrement, l’existence de clichés fait obstacle à la perception, il faut donc les liquider. Vient alors le malaise : le fleuve résiste à toute représentation et à toute domestication et renvoie à une réalité crue. Ponge recourt enfin à des actes de métrise/maîtrise du fleuve, en conjuguant science et poésie, sous le patronage de Lucrèce, son modèle depuis Le parti pris des choses.
Valérie Bordua, « Contre vents et marées… Bordeaux et son fleuve durant la guerre de Cent Ans »
La ville de Bordeaux a toujours suscité la convoitise des couronnes anglaise et française durant la longue guerre de Cent Ans. Le fleuve de la capitale bordelaise s’avère donc indéniablement être le centre de bien des enjeux par son triple intérêt militaire, économique et social.
Mayi Vincent, « Amsterdam ou la “nostalgie du présent”. Traversée-lecture de la ville qui avait canalisé son fleuve »
Cosmopolite, cannelée d’eau et d’histoire, Amsterdam est l’archétype de la ville-fleuve pour les écrivains qui s’immergent dans l’expérience thaumaturgique de son mouvement perpétuel, selon des itinéraires littéraires à la fois singuliers et jumeaux, sondant l’image spéculaire d’une ville d’architecture, d’eau, de lumière et de vent dont les reflets démultipliés entrelacent à l’infini l’intime et l’universel, ricochant d’un miroir à l’autre à la recherche de la gémellité perdue avec son double.
591Pierre Lavielle, « Londres et la Tamise. Théâtre de fictions contemporaines »
Un corpus d’œuvres contemporaines, comprenant une bande dessinée, un manga ainsi que plusieurs films et séries télévisées, nous offre des conceptions singulières et variées des relations qu’entretiennent Londres et la Tamise. Le fleuve y est représenté comme un champ de bataille stratégique, un lieu propice au mystère et au crime, ainsi qu’une frontière ambivalente permettant l’évasion ou favorisant au contraire l’enfermement dans la ville.
Caterina Da Lisca, « Les villes aquatiques dans la littérature fin-de-siècle. Bruges, une topographie de l’âme »
La cité sur l’eau occupe une place centrale dans la production littéraire fin-de-siècle. Bien plus qu’une toile de fond ou un élément descriptif, elle concrétise l’exploitation d’un thème spécifique à la sensibilité décadente et elle témoigne de la fascination pour un espace qui suscite la rêverie et la communication entre le sujet et l’univers. Or, les petites provinces flamandes, sous les brumes du Nord, constituent la géographie privilégiée de l’âme et de l’imaginaire fin-de-siècle.
Marc Suttor, « Vivre la ville avec le fleuve. L’exemple des villes mosanes »
L’étude des multiples liens unissant les villes aux fleuves nécessite de s’affranchir des cloisonnements chronologiques, spatiaux, disciplinaires. Il faut observer le temps long, respecter les espaces de la nature, proposer des critères d’analyse opératoires. Ensuite, on considérera les bateaux, les techniques de navigation, les infrastructures. On abordera enfin la vie urbaine en relation avec la rivière, par la pratique de l’histoire connectée, en s’appuyant sur l’archéologie et la géographie.
Simona Modreanu, « Lettres de “mon Danube” »
Panaït Istrati, Braïla, le Danube : la conjugaison heureuse de ces trois éléments configure un espace-temps particulier, aux saveurs multiples, à la musicalité sensuelle, aux contours estompés dans les limbes de la rêverie. Les récits de Panaït Istrati structurent un univers vertigineux, riche et dangereux, captivant et inquiétant, se forgeant une langue d’expression, le français, qui, tout en gardant son identité, se laisse malmener et vivifier par des sonorités étrangères.
592Farah Zaïem, « Danube de Claudio Magris. L’Histoire et les histoires d’un fleuve »
Danube, œuvre hautement littéraire, se lit aussicomme une élégie en hommage au fleuve centre-européen et à la diversité naturelle, ethnique, linguistique, culturelle et politique de la Mitteleuropa, « potamologie » ou « atlas » où le fleuve a un statut multisémiotique et fonctionne comme une référence prismatique. Initialement voie et itinéraire de voyage, il se résout en une poétique de la vie qui transmue le factuel géographique et humain en un objet hautement philosophique.
Gérard Chalaye, « Une Oum-Rbia littéraire. De Khénifra à Azemmour »
L’Oum-Rbia, second fleuve du Maroc par sa longueur, a inspiré des œuvres littéraires francophones, au cours des périodes coloniale et postcoloniale, dont la plus célèbre est peut-être La Mère du printemps de Driss Chraïbi. Il en est de même pour les villes et les sites que le cours d’eau traverse ou côtoie sur son parcours sinueux : Khénifra, la Kasbah de Boulaouane, Azemmour… dont les charmes et les rêves, historiques, religieux et philosophiques, peuvent nourrir un article de géopoésie.
Anna Madœuf, « Le Caire et le Nil. Diptyque d’un paysage »
La géographie de l’Égypte a été façonnée par le Nil, figure synecdoque de l’espace égyptien. Les représentations du Caire se sont également nourries de ce modelé singulier, où le fleuve s’avère être le déterminant du dispositif narratif. Partie prenante du récit de voyage, la description panoramique du paysage cairote, élaborée depuis le Nil, pose la trame d’une image exogène convenue de la capitale et le cadre d’un exercice littéraire et stylistique en vogue tout au long du xixe siècle.
Marcel Brou Bangah et Théodore Kanga Konan, « Le fleuve Bia. Une trajectoire de ville-fleuve »
Le fleuve, avant tout réalité géographique, revêt généralement une dimension littéraire, car il travaille l’imaginaire des peuples dont il charrie l’histoire et l’idéologie. Ainsi la Bia offre-t-elle des particularismes tant dans son géopositionnement que dans l’enrichissement du limon pour la création littéraire. 593L’onomastique est en mesure de révéler la poéticité des noms des lieux pour dévoiler, dans une approche géopoétique, la symbolique des espaces et leurs liens avec les hommes.
Patrick Voisin, « Un chassé-croisé entre villes et fleuves. Les Soleils des Indépendances d’Ahmadou Kourouma »
Le roman se déroule dans une triple spatialité : la capitale du pays, Bindia et Togobala. Il s’agit de questionner les rapports que ville et fleuve entretiennent : ville-fleuve, ville sans fleuve, fleuve sans ville. Le fleuve apparaît comme ce qui semble toujours séparer les humains, même et surtout dans une ville, mais il peut être également, loin de la ville, l’actant des retrouvailles d’un individu avec lui-même. La géographie des lieux se prolonge dans une géographie du personnage.
Inès Lounda Kihindou, « L’image du fleuve africain par temps de guerre. La Traversée d’Henri Djombo et Le Cri du fleuve de Katia Mounthault »
Le Congo, frontière ou pont entre ces deux villes fluviales que sont Brazzaville et Kinshasa, représente une garantie de survie pour les populations menacées, un moyen d’échapper à la mort. Cependant, il apparaît également comme le complice idéal pour les belligérants, puisqu’ils peuvent utiliser le fleuve comme moyen d’extermination ou de dissimulation de leurs forfaits. Voie de passage, complice, témoin, tombeau… le fleuve donne lieu à différentes représentations, parfois contradictoires.
Esther Laso y León, « Manaus sur l’Amazone, ville d’aventures »
Comment des écrivains et un illustrateur s’emparent-ils d’un lieu réel pour en faire la scène d’un récit fictionnel ? C’est ce que Manaus permet de vérifier, en observant les relations ville-fleuve, fleuve-transport/commerce, ville-nature, et la place de l’histoire de cette ville dans les romans, sans oublier d’esquisser le profil littéraire de la ville de Manaus, fondée par les Portugais en 1669 près du lieu où le Rio Negro et le Rio Solimões deviennent l’Amazone, ville-fleuve par antonomase.
594Lisa Romain et Nicolas Chrétien, « Eddy L. Harris ou la réinvention de la ville-fleuve. Le Mississippi et le “patelin” postindustriel »
À trente ans d’intervalle, l’écrivain noir américain Eddy L. Harris descend le Mississippi en canoë. Chacun de ces voyages fait l’objet d’un récit : Mississippi Solo (1988) et River to the Heart (2021). Dans l’un comme dans l’autre, l’auteur en arrive à une célébration inattendue des « patelins » fluviaux sinistrés par la désindustrialisation. Ces deux cartographies littéraires du fleuve mettent alors en évidence l’imbrication des questionnements identitaires, urbanistiques et environnementaux.
Lamia Mecheri, « New York, une ville-fleuve vue du ciel »
Le film américain Sully du réalisateur Clint Eastwood retrace l’incroyable amerrissage forcé et réussi du vol 1549 de l’US Airways, le 15 janvier 2009. Comment, à partir d’une vue en surplomb, le réalisateur fictionnalise-t-il et représente-t-il de façon verticale et inédite l’une des plus grandes villes-fleuves du monde dans son récit filmique ? Comment l’avion devient-il un élément symbolique permettant de faire l’expérience des frontières territoriales, fluviales, et fictionnelles ?
Leyla Khelalfa, « Splendeurs et misères de Bagdad, une capitale au bord du Tigre »
Les relations d’affinité qu’entretiennent la ville de Bagdad et ses deux fleuves, Tigre et Euphrate, est un sujet complexe. À l’aune de la géopoétique et de la mythanalyse, il apparaît que la relation entre la ville et ses fleuves fut de nature cosmogonique, l’eau étant le fondement sacré sur lequel la ville fut construite. Mais l’analyse écocritique d’un texte d’É. Malfatto expose la situation désastreuse actuelle à la fois de la ville et des fleuves dans une Bagdad livrée à la guerre et au chaos.
Manon Serrano, « L’interdépendance de Saïgon, Sadec et du Mékong dans L’Amant de Marguerite Duras »
Alors que tout semble opposer Sadec et Saïgon dans L’Amant de Marguerite Duras, le traversée du Mékong se revèle unificatrice. L’auteure pense cette vallée comme un nouvel espace romanesque : le fleuve est d’abord une passerelle 595physique qui relie Sadec à Saïgon, mais celles-ci ne peuvent subsister sans le Mékong et la narratrice. Impétueux, menaçants, séduisants, c’est ainsi que Marguerite Duras décrit les flots de ce fleuve ouvert vers le monde et l’ailleurs.
Johan Krieg et Émilie Crémin, « Le Gange à Varanasi. Controverses autour de la pollution d’un fleuve “sacré” »
L’incapacité des autorités étatiques à faire face à la pollution croissante du Gange a conduit le chef d’un des temples les plus importants de Varanasi (Inde du Nord) à créer l’O.N.G. Sankat Mochan Foundation. Il convient d’examiner les solutions envisagées par ce responsable religieux pour protéger le fleuve, les légitimations qu’il tire de l’enseignement de l’hindouisme sur la nature et la façon dont il harmonise les premières et les secondes au nom de son autorité religieuse.
Claude Tuduri, « La part du fleuve à Chongqing. Une approche poétique de l’espace urbain »
La part du fleuve, celle du Yangtsé et du Jialing, à Chongqing (Chine), ville-montagne, permet d’interroger les enjeux et les significations de son développement spectaculaire depuis 40 ans : les effets de ses ponts uniques au monde et du Barrage des Trois Gorges sur la vie des Chongqinois, la symbolique de l’eau, du commerce et des rêves d’harmonie face à la nature indomptable, et, enfin, la présence déclinante mais tutélaire des « hommes du fleuve », les bang-bang, au cœur de la ville.
Hélène Moreau, « Des villes, des fleuves et des îles à Rome et dans le monde romain »
Les îlots qui ponctuent les cours d’eau sont une composante singulière du paysage des villes-fleuves. Situés au milieu des eaux, ils n’appartiennent à aucune rive, mais, en dépit des contraintes techniques, les Romains n’ont cessé de tenter d’aménager, structurer, maîtriser ces lambeaux de terres fragiles au statut incertain. Les villes qui, comme Rome, Lutèce, Antioche, ou encore Augusta Emerita, ont pris possession de ces îlots, leur ont offert des rôles multiples et contrastés.
596Isabelle Bernard, « Patrick Deville et les villes-fleuves du monde. Une histoire d’art et d’eau »
Les villes-fleuves devilliennes sont des points d’ancrage et d’encrage pour l’auteur, le dépaysement étant une donnée cardinale de son écriture. C’est une histoire d’art et d’eau qui fonde sa littérature voyageuse, Deville s’adonnant à la contemplation des paysages fluviaux avec son carnet de route tel le peintre avec ses couleurs. Mais l’écrivain-voyageur envisage de plus en plus les enjeux environnementaux dans ses romans à la fois autobiographiques, poétiques et foncièrement écologiques.
Laëtitia Deudon, « Villes-fleuve de l’Escaut et du Saint-Laurent. Les temps de l’eau entre métamorphose et imaginaire »
Les villes-fleuve de la vallée de l’Escaut (France et Belgique) et de la vallée laurentienne (Canada) sont-elles représentatives des villes-fleuve du monde ? L’approche géo-historique comparée permet de voir comment leurs dynamiques d’évolution sont caractéristiques de grands temps de l’eau. Et, entre géocritique et écocritique, l’enjeu est de cerner l’évolution des rapports ville/fleuve à travers l’analyse des métamorphoses paysagères mais aussi des représentations culturelles du fleuve.
Marinella Termite, « Filets d’eau pour des villes “durables”. Les hypothèses de Salim Bachi et Pierre Patrolin »
Élément naturel capable de détruire et/ou de bâtir un écosystème, l’eau configure une déclinaison possible de la ville dans l’écriture de l’extrême contemporain où la notion de liquide en amplifie les conditions d’instabilité. Il s’agit d’étudier les mécanismes de flux et de reflux – qui recréent l’urbain – pour mettre à l’épreuve du littéraire la notion de ville-fleuve et saisir ainsi la spécificité d’une écriture fluviale qui se ferait fractale pour dire la quête d’un espace durable.
Aimé Eyengué, « Épilogue aux villes-fleuves du monde. La ville est comme le fleuve »
L’eau c’est la vie. Et l’eau a donné de la vie à la ville. C’est cette réalité vivante et fluviatile qui peut recevoir le nom de « fleuvitude », concept pouvant être défini comme étant l’art de l’équilibre dans l’ordre des choses : l’équilibre entre l’homme et son environnement par la symétrie de l’eau. Ne pouvant pas avoir un fleuve à tout coin de rue, l’homme moderne s’est représenté le fleuve à sa manière. Or, la France n’est-elle pas le territoire par excellence de la « fleuvitude » ?