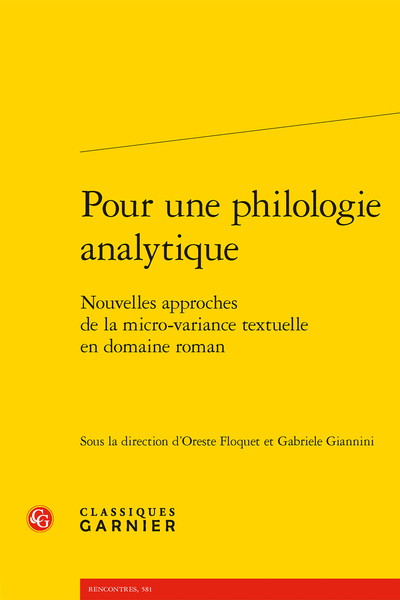
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Pour une philologie analytique. Nouvelles approches de la micro-variance textuelle en domaine roman
- Pages : 225 à 227
- Collection : Rencontres, n° 581
- Série : Civilisation médiévale, n° 54
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406146209
- ISBN : 978-2-406-14620-9
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14620-9.p.0225
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 16/08/2023
- Langue : Français
Résumés
Oreste Floquet et Gabriele Giannini, « Avant-propos »
L’éditeur de textes médiévaux est toujours confronté à des questions qui relèvent de niveaux d’analyse disparates et ne dispose que rarement d’études dégageant des lignes de force qui lui permettraient de s’orienter dans la multiplicité des variables. Peut-on dépasser une méthode forgée sur le cas par caspour atteindre un degré de généralisation comparable à celui des autres sciences humaines ? C’est l’effort de fournir une réponse à ces questions qui anime les contributions de ce volume.
Laura Minervini, « Riflessioni sul lessico nel processo di copia dei manoscritti medievali »
La contribution s’interroge sur les raisons qui font que dans les traditions manuscrites médiévales la variation lexicale est généralement assez modeste, alors que le lexique est considéré représenter l’élément le plus exposé au changement linguistique. Dans le but d’expliquer cette apparente anomalie, trois solutions – d’ordre linguistique, sociolinguistique et matériel – sont envisagées.
Oreste Floquet et Maria Teresa Rachetta, « Stabilité et instabilité des grammèmes. Sondages sur la variation textuelle en ancien français »
À travers l’analyse de différentes traditions textuelles en langue d’oïl (Charrette, Partonopeus de Blois et Lanval), la variance libre (adiaphore, polygénétique, etc.) est interrogée suivant une méthode horizontale, qui privilégie la récurrence de certains faits. Ainsi, il est possible de constater que la variation, lorsqu’elle atteint le niveau grammatical, ne se déploie pas avec la même intensité sur tous les morphèmes.
226Sergio Vatteroni, « Raretés morphologiques et lexicales en tant que facteur dynamique dans la tradition manuscrite de Peire Cardenal »
L’examen d’une particularité de l’œuvre de Peire Cardenal, à savoir la tendance à employer des formes rares tant au niveau morphologique que lexical, permet de formuler des considérations générales sur le rôle de la lectio difficilior lors de l’établissement du texte critique et, plus en général, sur la validité de la méthode reconstructionniste en philologie occitane.
Marcello Barbato, « Apocope e regolarità sillabica nella poesia spagnola medievale (s. XIII-XIV) »
La question de l’apocope est examinée à nouveaux frais, à l’aune des problèmes de régularité syllabique soulevés par la poésie castillane des xiiie-xive siècles. L’hypothèse est que les poètes de la première moitié du xiiie siècle ont eu souvent recours à l’apocopation extrême, en mettant ainsi à contribution une possibilité offerte par leur langue, alors que les copistes postérieurs ont eu tendance à réintroduire des formes non apocopées, même si ces dernières ne sont rentrées dans l’usage que par la suite.
Isabella Tomassetti, « Varianti e intertestualità. Note sulla poesia castigliana del XV secolo »
La contribution montre que dans la tradition indirecte de la poésie castillane du xve siècle, deux tendances coexistent : d’une part, celle qui tend à reproduire fidèlement les matériaux interpolés ; d’autre part, celle qui procède à une manipulation ciblée des matériaux mis à profit. De ce constat émane une mise en garde vis-à-vis de la pratique éditoriale, qui doit soupeser soigneusement les motivations divergentes dont la tradition indirecte est porteuse.
Yan Greub, « Les lettrines comme lieu et comme facteur de perturbation des traditions manuscrites »
Est ici envisagée la possibilité que les lettrines qui rehaussent les copies manuscrites soient parfois une source de perturbation dans la transmission des textes du Moyen Âge. À l’aide d’exemples tirés de la tradition de l’Ovide moralisé et de celle de la Première continuation du Conte du Graal, l’auteur illustre 227plusieurs cas, dont le plus typique serait celui où la lettrine, placée au milieu d’un couplet, finit par brouiller les copistes.
Craig Baker, « Examinatio codicum descriptorum. Observations préliminaires »
Le but de cette contribution est de reprendre la réflexion au sujet des codices descripti et d’en souligner l’importance aussi bien pour le philologue que pour le linguiste. Ces copies représentent en effet un champ d’enquête privilégié pour étudier aussi bien les phénomènes de variation linguistique que les techniques et pratiques de remaniement et de contamination.
Gabriele Giannini et Giovanni Palumbo, « Arrière, copiste ! L’édition casse-tête de la Mort Charlemagne »
Malgré son charme et l’intérêt littéraire qu’il dégage, le court poème épique dénommé Mort Charlemagne demeure inédit, du fait de son état lamentable dans le seul témoin (acéphale) qui le conserve (Oxford, BL, Canonici it. 54). Démêler les facteurs de trouble et essayer de les situer sur l’axe vertical qui aboutit au manuscrit d’Oxford est le défrichage indispensable permettant d’amorcer la démarche éditoriale.