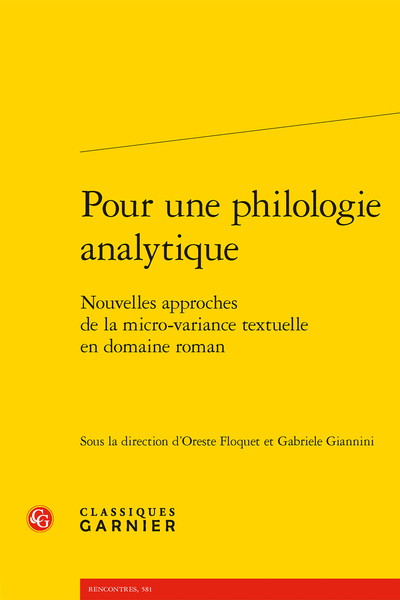
Avant-propos
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Pour une philologie analytique. Nouvelles approches de la micro-variance textuelle en domaine roman
- Auteurs : Floquet (Oreste), Giannini (Gabriele)
- Résumé : L’éditeur de textes médiévaux est toujours confronté à des questions qui relèvent de niveaux d’analyse disparates et ne dispose que rarement d’études dégageant des lignes de force qui lui permettraient de s’orienter dans la multiplicité des variables. Peut-on dépasser une méthode forgée sur le cas par cas pour atteindre un degré de généralisation comparable à celui des autres sciences humaines ? C’est l’effort de fournir une réponse à ces questions qui anime les contributions de ce volume.
- Pages : 7 à 8
- Collection : Rencontres, n° 581
- Série : Civilisation médiévale, n° 54
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406146209
- ISBN : 978-2-406-14620-9
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14620-9.p.0007
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 16/08/2023
- Langue : Français
- Mots-clés : Philologie romane, linguistique romane, édition critique, littérature française, littérature espagnole, littérature occitane
Avant-propos
On ne peut que souscrire à cette constatation du regretté David Trotter : « Faire une (bonne) édition, signifie aborder d’un coup et incontournablement la quasi-totalité des grandes questions que pose la langue médiévale, et l’histoire de la langue, que ce soit au niveau du lexique, ou en matière de paléographie/codicologie, ou encore en analyse littéraire1 ». De fait, dans l’approche reconstructionniste classique, l’éditeur de textes médiévaux est confronté simultanément à une multiplicité de questions qui relèvent de niveaux d’analyse disparates : matériels, linguistiques, formels, génériques et historico-littéraires.
Intrinsèquement locale – dans la mesure où l’enquête concerne toujours la tradition manuscrite d’une seule œuvre – et holistique – puisque l’éditeur est confronté à l’hétérogénéité extrême des types de données (paléographiques, linguistiques, littéraires, etc.) qu’il est censé organiser en un système cohérent dont le produit final est l’édition et son commentaire –, l’approche traditionnelle, que l’on pourrait qualifier de ponctuelle (quant à son objet)et de synthétique (quant à sa méthode), ne peut que rarement viser à une quelconque généralité. Ce fait la rend davantage l’application d’un savoir-faire complexe mais empirique qu’une démarche de type scientifique articulant induction, deduction et abduction et sériant les problèmes pour les aborder séparément. Essayons d’être plus clairs sur ce point, qui touche à l’épistémologie de l’ecdotique. Lors de son travail, l’éditeur de textes anciens ne dispose que rarement d’études dégageant des lignes de force plus ou moins intenses qui lui permettraient de s’orienter dans la multiplicité des variables. Les informations qu’il cherche – par exemple, sur la fréquence et les variantes d’une forme graphique, grammaticale ou stylistique au sein d’autres traditions, sur les néologismes des auteurs ou des copistes, sur la disposition des lettrines et sa fonction, etc. –, si elles sont disponibles, se trouvent le plus souvent sous une forme non organisée, tantôt noyées dans 8d’autres éditions où il faut les repérer et dont il convient de les extraire, tantôt dispersées dans des études historiques, linguistiques ou littéraires qui poursuivent d’autres objectifs. Or, il existe bel et bien une spécificité du travail de classement et d’interprétation des données présentes dans une tradition manuscrite qui n’a rien à voir avec une analyse paléographique, linguistique ou littéraire. Les recherches en métrique nous le prouvent, qui peuvent aborder des phénomèmes propres à la versification (synalèphe, dialèphe, diérèse, anisosyllabisme, etc.) – et qui ne sont à proprement parler ni exclusivement linguistiques ni exclusivement littéraires – en prenant en considération de grands corpus analysés minutieusement.
D’où la question : en dehors, à la marge ou aux fondements de tout projet éditorial précis, est-il possible d’envisager une approche complémentaire de type aussi bien comparatif qu’analytique ? Comparative, dans la mesure où elle essaiera de donner une structure, et donc une régularité, au trésor d’informations éparpillées au sein des différentes traditions manuscrites, éditions et recherches transversales. Analytique, puisqu’amenée à aborder séparément (et non « d’un coup et incontournablement ») les multiples niveaux d’analyse de plusieurs textes. Par là, sera-t-il légitime de ne prendre tour à tour en considération que la variation de certaines catégories afin d’en dégager les régularités, oppositions ou combinaisons, s’il y en a ? Pourrait-on ainsi dépasser une méthode forgée sur le cas par caspour viser, voire atteindre un degré de généralisation comparable à celui des autres sciences humaines ?
C’est l’effort généreux de fournir une réponse à ces questions qui anime les contributions réunies dans ce volume. Elles portent sur la logique de la variation au sein d’objets, de milieux et de domaines culturels différents, dans le but de vérifier s’il est possible de faire émerger des tendances significatives dans le domaine de la micro-variance textuelle affectant les textes du Moyen Âge roman.
Oreste Floquet
Sapienza Università di Roma
Gabriele Giannini
Université de Montréal
1 David Trotter, « Introduction : état de la question », Manuel de la philologie de l’édition, éd. par Id., Berlin/Boston MA, de Gruyter, 2015, p. 1-18, en part. p. 7.