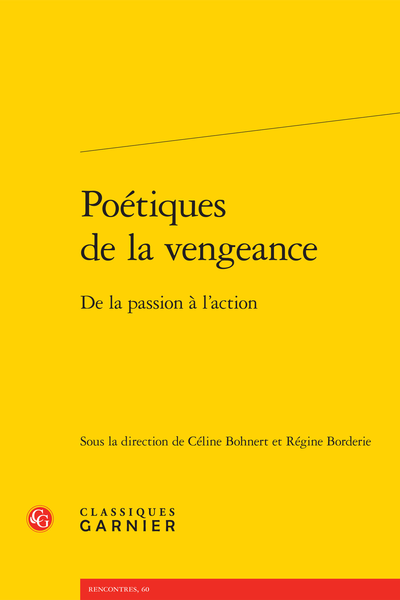
Postface
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Poétiques de la vengeance. De la passion à l’action
- Auteur : Bohnert (Céline)
- Pages : 217 à 236
- Collection : Rencontres, n° 60
- Série : Littérature générale et comparée, n° 4
- Thème CLIL : 4028 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes de littérature comparée
- EAN : 9782812412820
- ISBN : 978-2-8124-1282-0
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-1282-0.p.0217
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 22/11/2013
- Langue : Français
Postface
« De la passion à l’action » : les articles recueillis dans ce volume présentent un panorama varié et des réponses parfois inattendues à l’interrogation de départ sur l’articulation de ces deux faces de la vengeance. Malgré leurs différences, il faut souligner qu’ils portent sur un objet commun : non pas la vengeance, mais sa représentation. Ils l’ont parfois envisagée comme un thème, mais, plus profondément, ils l’ont comprise comme une matrice narrative, un schème dynamique organisant des œuvres et des corpus, un scénario définissant des genres, voire comme une réalité modélisable et capable de rendre compte non seulement de l’organisation des œuvres, mais aussi, en-dehors d’elles, de la structure de l’expérience.
Les articles ont été réunis suivant une logique du coup de sonde, comme une exploration discontinue de différents corpus. Bien d’autres choix auraient pu être faits. Pour la poésie, pensons à l’élaboration de schèmes vengeurs ou aux allusions aux mythes de vengeance dans la poésie pétrarquiste, dans la poésie satirique ou pamphlétaire, à la dynamique vengeresse dans l’apologue, ou encore, entre autres possibilités, au devenir de la vengeance dans les avatars modernes de l’épopée. Nécessairement incomplet, ce tour d’horizon nous semble cependant dessiner des lignes de force et des points de dialogue sur lesquels nous voudrions revenir.
Définitions et lignes de partage :
vengeance, revanche et châtiment
La première question soulevée par la majorité des articles concerne la définition même de la vengeance et des notions proches que sont la revanche et le châtiment.
La définition de la vengeance telle qu’elle apparaît dans les analyses proposées se décline elle-même suivant deux axes majeurs qui pourraient sembler complémentaires, mais qui s’avèrent souvent contradictoires. Le premier associe la vengeance au désir passionné, furieux, de rendre le mal pour le mal, « en lui-même ou pour ce qu’il apporte en gloire et en puissance », précise Roxane Martin (p. 89). Ce désir peut aller jusqu’à la volonté d’anéantir le rival, voire jusqu’à une soif destructrice prête à s’exercer au détriment de l’ordre cosmique. Définition intéressante en ce qu’elle met en lumière une forme de jouissance indissociable de l’action vengeresse et qui pourrait être le fond sur lequel se détachent les passions du vengeur. Ces délices, escomptés ou effectifs, travaillent la « guerre des sexes » libertine aussi bien que les sévices hyperboliques infligés par les personnages hollywoodiens aux bourreaux d’hier devenus victimes de la vengeance. Le plaisir ou la douceur de la vengeance, hérités des raffinements pétrarquistes passés au filtre de la galanterie, sont également un motif récurrent des tragédies lullystes. S’ils tendent plutôt à valoriser les héroïnes vengeresses, ils sont au contraire tenus à distance des premiers drames de Pixerécourt, qui voit dans la vengeance « le plaisir des âmes viles » (p. 84).
Quoiqu’il puisse être mesuré, ce désir ne connaît souvent pas de frein. C’est pourquoi il entre en tension avec le second trait définitoire de la vengeance, reposant sur la compensation attendue. Le vengeur cherche à punir. Action menée en réaction à un affront, la vengeance a pour fonction de contrebalancer une perte, un dommage. Elle s’inscrit en cela dans un système d’échange : elle est « un dû, il faut répondre à l’offense par une offense équivalente » (p. 143). L’échange est à la fois d’ordre symbolique et passionnel, le mal causé devant effacer l’outrage reçu et le plaisir de la vengeance la douleur de l’offense. Mais cette équivocité est justement mise à mal par l’intervention des passions, qui tirent l’action vengeresse hors de tout équilibre et de toute mesure. La vengeance suscite parfois une violence ordonnée et ciblée. Mais la volonté de détruire ce ou celui qui a causé la souffrance, voire tous ceux qui lui ressemblent, peut l’emporter sur l’idée de réparation et la vengeance apparaît alors ou comme un acte autotélique ou comme une finalité impossible à réaliser, quel que soit le degré de violence atteint : pour le second cas de figure, on peut penser à Azucena dans Il trovatore [Le Trouvère] de Verdi.
C’est pourquoi la distinction entre vengeance, revanche et châtiment, claire en théorie, s’estompe dans certains corpus. Suivant Aristote, le châtiment se distingue de la vengeance parce qu’il vise l’intérêt du « patient » corrigé, alors que le vengeur cherche sa propre satisfaction, trouvée au prix de la souffrance d’autrui. La revanche, quant à elle, « question de place à occuper plutôt que de mal à rendre » (p. 14), peut être comprise comme la « reprise de l’avantage sur un concurrent » (p. 172), ce qui suppose un équilibre premier mis à mal puis retrouvé, parfois conquis de haute lutte, une lutte qui donne son prix à l’action et son aura au vainqueur. La revanche, associée à la conquête, apparaîtrait ainsi comme la version positive de la vengeance, qui, même lorsqu’elle se donne pour juste, est souvent liée à la violence et aux passions obscures et se trouve souvent en sympathie avec le mal : parmi les œuvres étudiées, seuls les derniers drames de Pixerécourt subliment de façon univoque cette part sombre de la vengeance. « Remède curatif » (p. 89), la vengeance y devient un acte de justice déterminé par le sentiment de la vertu, arme des cœurs outragés. Selon Pixerécourt, la loi doit juguler les passions individuelles et sauvages ; mais si la loi fait défaut, ses mélodrames en appellent à des sentiments premiers, qui forment le fonds commun de l’humanité : la compassion et le sentiment de la justice, affects vertueux qui arrachent la vengeance, même commise dans la rage, à l’inhumanité qui était la sienne lorsqu’elle relevait de la seule satisfaction individuelle – celle du tyran par exemple.
Faisant lui aussi émerger l’image d’une juste vengeance, Sébastien Hubier montre comment le cinéma hollywoodien déplace les lignes entre vengeance, revanche et châtiment. Revanche et vengeance y sont définies par rapport aux valeurs de l’american dream. Parce que les États-Unis sont tenus pour une terre promise où chacun peut prendre sa revanche sur le sort et parce que cette possibilité relève d’une mission providentielle de la nation, les violences commises contre le citoyen américain contreviennent à ce qui est compris comme une loi fondamentale et sacrée, celle de la réussite et du bonheur. Tout crime est aussi une injure faite à un idéal transcendant et appelle non seulement la sanction prévue par la loi, mais aussi et surtout la vengeance de l’offensé. Contrevenant à l’idéal de la revanche sociale, le crime appelle la vengeance. Plus encore : la lutte contre le Mal dans laquelle le puritanisme américain enrôle tout citoyen des États-Unis amène à confondre vengeance personnelle et châtiment
divin. En se vengeant, l’individu répond aussi au devoir qui est le sien de lutter contre les forces du mal, il devient le bras vengeur de Dieu, l’incarnation de la nemesis. La vengeance personnelle est aussi une forme de punition ou de vengeance divine. Elle sacralise le vengeur dont la juste mission prime sur les formes humaines de la justice, qui n’en sont que le double insuffisant voire dégradé. La vengeance transfigure l’individu, fût-il au départ un hors-la-loi : la violence juste rédime le vengeur, et ce d’autant mieux qu’elle est sans mesure. Analysant les codes de la « culture de la violence » hollywoodienne (p. 174), S. Hubier montre comment la purification par la vengeance, remotivant l’étymologie, suppose un passage par le feu des passions et des actions violentes.
De même, la difficulté que l’on peut éprouver à distinguer les mobiles des libertins, ainsi que l’ambiguïté des dénouements des contes du Sopha de Crébillon, font hésiter entre vengeance personnelle et châtiment réparateur. Françoise Gevrey montre que le « grand événement » qu’était la vengeance tragique est dégradé par le libertinage en une multitude de versions burlesques. Jeu tactique, qui donne le plaisir de régler le comportement et les passions d’autrui à sa guise, la vengeance prend place dans une guerre des sexes généralisée. Les libertins prétendent agir sinon pour défendre la vertu, du moins pour attaquer le vice dans l’autre sexe, pour l’y démasquer et l’y confondre, comme si le plaisir de démasquer la femme sensuelle sous l’apparence de la pieuse dévote était habité par un souci de l’intérêt collectif – il faut entendre là l’intérêt de la société dans son ensemble, ou, de façon plus restreinte, l’intérêt d’un sexe contre l’autre. Mais, inefficace, impossible ou dérisoire, la vengeance perd surtout toute dimension rédemptrice et exemplaire : il n’y a rien à attendre de la punition, sinon la satisfaction momentanée de « pulsions agressives ». Les personnages qui écoutent les récits d’Amanzéi infirment l’idée que le spectacle de la vengeance pourrait servir à l’édification du lecteur ; le petit théâtre libertin, même développé dans une œuvre qui se donne pour « morale », ne châtie plus les mœurs, il satisfait un amour pour la violence des rapports sociaux, violence rentrée certes, mais non moins cruelle. Aussi les modifications que Crébillon fait subir à son modèle explicite, Les Mille et une nuits, créent-elle une forme d’ambiguïté. À la violence exacerbée et systématique de Schah-Riar contre ses épouses, que Schéhérazade détourne en éveillant sa passion pour les récits, répondent dans Le Sopha la mollesse de leur petit-fils,
plus capricieux qu’offensif, et la punition infligée par le dieu Brama à Amanzéi, le conteur qui succède à Shéhérazade. Cette punition, qui a consisté en la métamorphose d’Amanzéi en sopha pour l’une de ses vies sur terre, aurait dû garantir la portée morale des récits du jeune homme délivré et redevenu courtisan, mais elle ne fait que souligner l’absence de l’élément moral dans les vengeances contées, qui se réclament pourtant de la justice ou de la vertu. Une série de décalages entre les finalités de l’action et le discours de justification qu’elle suscite dessine des lignes de partage mouvantes et ambigües.
En revanche, les définitions de départ permettent de comprendre en quoi l’écriture, dans les poétiques analysées par Lucie Campos, apparaît comme une forme de revanche sur l’événement traumatique : refusant l’oubli, l’anéantissement symbolique des causes de la souffrance, ce qui se rapprocherait de la vengeance, ces romans répondent notamment à l’interrogation de leurs auteurs sur la place qui est la leur dans un monde de l’après.
Les études ici rassemblées invitent donc à nuancer les distinctions entre vengeance, revanche et châtiment : elles amènent à réfléchir à leurs points de contact. Ces réalités semblent parfois se mêler. Ainsi le traitement de la vengeance soulève-t-il implicitement le problème du juste châtiment : le châtiment n’est-il pas toujours menacé de devenir une forme de vengeance, ne comporte-t-il pas toujours une part de satisfaction personnelle, narcissique, violente, alors même que celui qui punit prétend agir pour le bien d’autrui ? Si le châtiment doit être proportionné à la faute commise, en théorie, comment pourrait-il l’être en pratique ? En ce sens, l’analyse du corpus hollywoodien par S. Hubier peut éclairer d’un jour particulier les derniers mélodrames de Pixerécourt analysés par R. Martin : on pourrait rapprocher la violence de la nature, cette forme de vengeance immanente qui détruit finalement bons et méchants dans La Tête de mort, ou les Ruines de Pompéïa (1827) du genre hollywoodien du doomsday. Mais dans le second cas, la violence est assumée, elle fait partie d’une culture qui la glorifie et en fait un ressort du plaisir esthétique ; dans le premier, la représentation hyperbolique de la violence naturelle exprime une incertitude chargée d’angoisse sur le devenir historique et sur les valeurs communes. Bonifier, punir, satisfaire un impératif d’honneur ou ses propres pulsions violentes : le brouillage des finalités estompe les démarcations trop strictes entre vengeance et châtiment.
Les relations de ces deux notions peuvent également être comprises en termes de perspective : le même acte évalué sur le plan individuel ou collectif, humain ou divin, prend des significations différentes. C’est ce que montrent S. Hubier, Fr. Gevrey, Bruno Méniel et Christiane Louette. Ainsi la vengeance de Panurge contre Dindenault, analysée par Chr. Louette, est répercutée dans Le Quart Livre sur deux plans distincts et successifs. Dans le cadre du récit de vengeance lui-même, l’action de Panurge n’est jamais interrogée dans ses fondements ou sa légitimité. Elle ne semble évaluée que suivant des critères d’efficacité et de maestria spectaculaires, récompensées par le rire du spectateur qu’est frère Jan. Mais l’intervention de Pantagruel, le « prince évangélique », amène à relire l’épisode sous un tout autre angle. La radicalité comique de la vengeance devient alors une forme de péché, une manifestation d’hubris. Le principe d’une double lecture du même acte est posé différemment dans le texte de Bruno Méniel. Analysant le corpus des épopées renaissantes, B. Méniel souligne une tension entre l’éthique propre au genre, l’epos, qui valorise la vengeance comme composante de l’héroïsme, et les valeurs qui se mettent en place après les guerres de religion. Les politiques, comme les auteurs qui défendent les valeurs de magnanimité et de constance, tentent de christianiser le genre, sans y parvenir tout à fait. Le récit de la vengeance est alors pris en tension entre le discours explicite, celui des paratextes et des vers sentencieux, et les structures profondes du genre.
Économie des passions,
typologie des vengeances
Si l’on cherche à dresser une typologie des rôles que jouent les passions dans la vengeance, une frontière claire se dessine entre les vengeances passionnelles et les vengeances froides. Alors que les premières naissent d’une passion outragée, comme dans l’opéra lullyste, les secondes peuvent être dictées par différents impératifs. Le respect dû aux ascendants et aux proches est le plus fréquent : il détermine l’action d’Énée tuant Turnus, la destinée d’Hamlet et la fureur de Laertes chez Shakespeare, la
cruauté d’Azucena dans Il trovatore, la conduite de Nishi dans Les salauds dorment en paix. Encore faut-il souligner que ces vengeances par devoir et souvent par procuration peuvent être vécues sur un mode passionné ou faire intervenir les passions. Dans les cas de Nishi et de Turandot, on remarquera qu’une passion en efface une autre : la tendresse du vengeur japonais pour sa jeune épouse et celle de la princesse légendaire pour Calaf ont raison de leur projet – le premier pour sa perte, la seconde pour sa délivrance. Olivier Bara parle à ce propos de « conversion du désir vengeur en désir érotique et amoureux » (p. 105). Sans dresser une typologie exhaustive de la façon dont les passions entrent en ligne de compte dans les vengeances analysées par les contributeurs, nous aimerions nous concentrer sur quelques cas limite.
Deux études font état de vengeances dépassionnées. B. Méniel mentionne que les miroirs du prince renaissants, redessinant les contours de la vengeance épique, façonnent l’image de la juste vengeance du souverain. Pour le prince, la justice est à la fois une fonction, une prérogative et un impératif qui l’engage personnellement, que son intérêt propre soit en jeu dans le cas examiné ou non. Le souverain est non seulement juge, mais aussi justicier. Sa vengeance apparaît ainsi comme une face de la justice distributive, le châtiment se situant du côté de la justice corrective. Exemplaire, radicale et sans appel, sa vengeance se passe des passions, qui la dénatureraient (p. 38). Par ailleurs le personnage de Panurge, selon Chr. Louette, offre l’exemple intéressant d’une vengeance déterminée par un habitus, une règle de conduite. Tout comme Achille en colère ne combat plus, Panurge n’agit qu’une fois la colère passée. Sa vengeance contre Dindenault, comme celle de Villon contre Tappecoue, est faite de calme et de patience : cet « homme des passions » n’en prend pas moins le temps d’organiser une pièce savamment montée et efficacement menée.
Il faut relever deux cas qui se situent à la frontière entre vengeance froide et vengeance passionnée, de deux façons différentes. Dans le cas du Sopha de Crébillon, on parlerait volontiers de transfert et d’évidement : Crébillon relativise la vengeance comme passion, même si Le Sopha porte le souvenir estompé de la vengeance à l’orientale, avec son lot de fureurs et de sang. Mais dans le cadre du libertinage, l’action est réduite au persiflage ou à la séduction. Dans la plupart des cas l’amour est joué, loin de toute passion. De façon corollaire, la vengeance, aussi
implacable soit-elle, relève d’une conduite codifiée et maîtrisée. À amour de tête, vengeance de théâtre. Ne restent alors que l’amour-propre, le mépris – et cet appétit intellectuel qu’est la curiosité déplacée de la fausse prude envers les choses de l’amour, une forme de libido sciendi laïcisée, moralement et socialement réprouvée. Mais ce vide des passions contraste fortement avec les tendresses et les émois des véritables amants évoqués par le conteur, dont les libertins ne sont qu’une copie. Le modèle de la vengeance passionnelle reste donc en arrière-fond des contes : elle fournit un langage et des modèles de comportement, mais pour mieux faire sentir les déplacements éthiques, sociaux, esthétiques propres au jeu libertin.
Un second exemple mêle passion et vengeance froide, celui d’Hamlet tel que l’analyse Thomas Pavel. Les révélations du spectre font peser sur les épaules du prince un devoir de vengeance qui relève de l’ordre que R. Verdier appelle « vindicatoire ». Mais cet impératif, qu’Hamlet ne peut accepter comme sien, provoque son affolement. Le devoir de vengeance livre Hamlet à la colère, une colère dirigée contre son sort et contre les vicissitudes de la destinée humaine bien plus que contre son ennemi. Lorsqu’il tue Polonius, lorsqu’il tourne l’épée empoisonnée contre son oncle, Hamlet agit sous le coup de la rage : au moment même où il accomplit les actions que lui dicte le devoir, Hamlet agit aussi, peut-être d’abord, pour d’autres motifs, en partie d’ordre passionnel, mélange de réactions exacerbées, de pulsions violentes et désordonnées. Ainsi dans le premier cas, les passions désertent des comportements qui n’en sont plus que le mime. Dans le second, elles brouillent les ressorts de l’action et interrogent sa signification pour le sujet.
Enfin, l’exemple des tragédies lullystes retient l’attention comme un cas intéressant de disjonction entre l’action et les passions. Judith Leblanc signale les vengeances lullystes comme des vengeances empêchées : elles le sont paradoxalement par la passion même qui déclenche et habite le désir de vengeance. Les héroïnes lyriques hésitent à se venger, peinent à accomplir leur vengeance ou y renoncent. Il semble que la vengeance soit dans ce corpus une modalité ou une nuance de la passion amoureuse. Le désir de vengeance serait l’envers de l’amour passionné, son retournement négatif, comme l’attestent les cas de métamorphose inachevée de l’amour en désir de vengeance (p. 69, p. 71-72). À tel point que l’expression des passions, dans la tragédie en musique, est presque détachée de toute
action. C’est elle qui constitue l’action au sens de drama, l’intrigue tout entière qui, contrairement à ce qui se passe dans la tragédie parlée, se passe éventuellement de l’acte – l’expression des passions l’emportant sur leur mise en œuvre effective. On pourrait suggérer que, dans le théâtre parlé, les passions sont toujours prises dans l’action, là où la scène lyrique se constitue de situations : la parole lyrique exprime et libère les passions, exposées dans leur pureté, attachées par un lien minimum à une action – c’est ce que confirme l’évolution des héroïnes vers une irrésolution de plus en plus marquée d’une pièce à l’autre. D’où les jeux auxquels se livrent les parodistes. La Rimaille, poète lyrique à la mode burlesque, cité en exergue par J. Leblanc, offre ses vers au musicien comme il lui ouvrirait un magasin d’expressions passionnées. La fabrique de l’œuvre lyrique apparaît ici comme un agencement d’éléments tout faits : économie des passions et mécanique créative vont de pair. D’où l’impression que ce théâtre glorifie les passions. L’action empêchée, suspendue, permet au personnage – et à travers lui au spectateur – de mieux goûter les passions contradictoires qui l’animent.
Composantes du scénario de vengeance
Avec l’exemple des tragédies de Lully, on en vient ainsi à préciser la distinction entre l’action entendue comme l’« opération d’un agent […] envisagée dans son déroulement1 » et comme drama, c’est-à-dire comme action représentée – deux plans qui ne sont pas toujours sécants et qui se trouvent ici quasiment disjoints. C’est plus précisément sous cet angle, celui de l’efficacité fonctionnelle, poétique, que nous voudrions maintenant envisager la vengeance. Matrice narrative, scénario, elle enrichit le contenu thématique, travaille la poétique et détermine une forme particulière d’expressivité des œuvres. Les études réunies dans ce volume trouvent autour de cette question leur plus forte unité. En effet, comment comprendre l’omniprésence de la vengeance dans les arts ? Le phénomène ne saurait être expliqué par l’histoire de la vengeance, qui a eu une importance et un sens variables, même s’il est vrai
qu’aucun système judiciaire n’a pu en venir à bout. Dans les sociétés qui l’excluent, la vengeance semble un fantasme archaïque relevant du refoulé. Les passions vengeresses s’engouffrent dans les failles du système politique, social, juridique. Mais la vengeance est surtout un ressort extraordinairement efficace pour le drame. Schéma dramatique, scénario, matrice narrative, elle structure et dynamise la représentation, lui fournit ses composantes, son mouvement, ses limites et son sens. O. Bara le souligne pour le théâtre chanté : « [l]a vengeance serait ce kaléidoscope d’intrigues dont le tournoiement assure le renouvellement dans la permanence des éléments premiers. » (p. 96).
Parmi les éléments qui constituent cette topique, on peut en relever quatre. La vengeance fournit d’abord un personnel multiforme mais fortement structuré, polarisé en fonction de la place que chacun occupe de part et d’autre de l’offense et de la vengeance. J. Leblanc signale ainsi le trio fondateur des tragédies lullystes, constitué d’un couple persécuté par un jaloux doté de pouvoirs surnaturels et secondé par un amoureux mal-aimé. Les tableaux analysés par Laure Piel et Françoise Audoueineix en montrent des exemples clairs : qu’il s’agisse de vengeance mythologique, biblique ou historique, les liens qui unissent les personnages en viennent à structurer visuellement l’espace de la toile, lui fournissant ses lignes dynamiques. La définition du personnage par la fonction est confirmée à plusieurs reprises dans le volume par des échanges de rôles au cours de l’action. On pense à La Juive et aux contes de Crébillon. Ces redistributions attestent la puissance de la vengeance comme schéma dynamique organisateur du drame.
La vengeance fournit aussi une figure forte, dans laquelle se polarisent ses enjeux, celle du vengeur, qui pourrait faire l’objet d’une étude à part entière. S. Hubier note par exemple que, dans le cinéma hollywoodien, la vengeance resémantise « la figure de l’élu, du triomphateur ou de l’homme providentiel et miraculeux que Lincoln, assimilé au Christ, a représenté dans bien des films d’avant-guerre » (p. 178). Cette figure où s’incarnent les valeurs nationales, narrativisées dans des scénarios type, éveille une véritable fascination chez le public. Le vengeur hollywoodien accède à une forme de surhumanité, destinée, paradoxalement, à renforcer le modèle commun. Le héros vengeur est une heureuse (quoique, aussi, tragique) et indispensable exception. Ailleurs, le père (ou la mère) offensé(e), le fils ou la fille d’un parent
sacrifié, le héros défié par l’assassin de son ami, le juste persécuté, le roi vertueux, le revenant silencieux, l’amant outragé, le roué libertin offrent quelques-unes des mille facettes du vengeur. Comme le signalent L. Piel et Fr. Audoueineix, la figure du vengeur a partie liée avec celle du justicier, ce qui crée une ambiguïté parfois féconde : Médée, ce personnage potentiellement monstrueux, en vient à être glorifiée par Charles-Edouard Chaise (p. 203). Dans cet ensemble, soulignons que la passion est rejetée du côté des faibles dès que la vengeance apparaît comme une action blâmable : les femmes ou le peuple – c’est le cas dans les épopées renaissantes, les drames pixerécourtiens, dans La Juive. Et la vengeance des femmes chez Lully pourrait être comprise comme l’envers de l’action héroïque, encore représentée en 1673 dans Cadmus et Hermione : l’héroïsme dans la vengeance passionnée est le lot d’Armide, dont le jardin est l’envers du champ d’honneur. L’articulation de l’action et des passions dans la vengeance est ainsi tributaire du personnage du vengeur – homme, femme, personnage collectif, chevalier ou plébéien. Ces personnages agissants sont relayés parfois par des allégories, celles de la haine, des furies ou de la vengeance même, qui synthétisent en une image frappante le spectacle des passions vengeresses.
La vengeance s’accompagne également d’une scénographie, conforme à son aspect rituel, ainsi que d’accessoires. Guidés par leurs passions, les personnages obéissent souvent à une forme de fétichisme. L’instrument de la vengeance prend alors une très grande importance, il peut être sacralisé, de même, souvent, qu’un objet qui aura pour rôle d’aiguiser et d’entretenir les passions. C’est ce que montre Anne-Élisabeth Halpern pour Les salauds dorment en paix d’Akira Kurosawa. Dans ce cas précis, le catalyseur de la vengeance – que l’on rangerait du reste du côté des vengeances par devoir – est une photographie du père acculé au suicide par ses supérieurs véreux. L’objet trouve parfaitement sa place dans l’ensemble plus vaste de la vengeance, qui consiste moins cette fois en un scénario qu’en un dispositif. La structure du film, ses principes de composition sont comparables aux principes organisateurs de la vengeance de Nishi. Ailleurs une chaise, un mouchoir, un baudrier catalysent ou même déclenchent la colère vengeresse : c’est le cas pour Énée devant Turnus. Guidé par sa magnanimité, Énée s’apprête à pardonner à son ennemi à terre ; mais la vue des armes de Pallas sur le corps de son meurtrier éveille en lui une rage incontrôlable qui le
pousse immédiatement à tuer Turnus. Dans Charles le Téméraire, ou le Siège de Nancy, de Pixerécourt, un panneau sacralise l’arbre auquel il est suspendu : « Là périt Cifron. Vengeance ! »
L’existence de ces objets signale l’importance de la vue dans la vengeance, comme le montre A.-É. Halpern pour Les salauds dorment en paix. Kurosawa forge une vengeance tout entière fondée sur la vue, sous ses différentes modalités, la contemplation, le souvenir, l’apparition, l’occultation. Les plans se relaient ou se superposent pour créer d’étonnants effets de présence ou de distance : le spectateur, comme parfois les personnages, sont amenés à voir de plusieurs manières ce qu’ils regardent. On a l’impression que Kurosawa fait reposer la vengeance sur la vue comme pour mieux remonter en-deçà de tout récit. Comme s’il fallait cela pour dépasser le tabou qui frappait la réalité de la corruption dans le Japon de l’après-guerre. Le film montre à plusieurs reprises à quel point les explications et les récits forgés à propos de choses vues peuvent être erronés, faussés ou manipulés. La vengeance de Nishi est finalement occultée par son beau-père dans une conférence de presse qui impose un mensonge sinon aux esprits, du moins aux yeux des journalistes, pour ainsi dire obligés de relayer l’image du beau-père éploré auprès du public. Le dispositif scopique de la vengeance donne littéralement à voir le lien paradoxal des différents éléments de la vengeance : passé, présent et avenir, fait et récit des faits y trouvent une forme de coprésence tout à fait particulière.
Le rôle dynamique de la vue dans la vengeance est l’un des aspects de l’importance que prend le corps, lieu des passions et scène où elles se donnent à voir, souvent dans des formes topiques (rougeur, larmes, fièvre, changements de physionomie…). Exhibé ou simplement mentionné, le corps peut revêtir la vengeance d’une charge sensuelle voire érotique et ce d’autant plus facilement, semble-t-il, si le vengeur est une femme. Comme si la disjonction entre le rôle que les sociétés occidentales réservent aux hommes et l’agent faisait ressortir la portée sexuée voire sexuelle de l’acte. Il ne saurait être question de dégager de loi générale ni d’invariant concernant la représentation du corps, qui prend sens en fonction de systèmes culturels donnés. Mais il est frappant de constater la récurrence de ce qui tient au corps dans la vengeance, et que l’on peut comprendre précisément, nous semble-t-il, par l’articulation de la passion et de l’action : le corps se situe à l’intersection des deux. Gestes,
mémoire du corps, signes physiques de la passion, caractères traduits en termes de physiognonomie, plaies et pathologies, souffle et sang, voix (« matière vocale », p. 64), cette dimension matérielle, parfois charnelle, de la vengeance, apparaît comme cruciale, même si la vengeance n’est jamais tout entière inscrite du côté du corps – elle se transformerait alors, le cas échéant, en simple meurtre. La place du corps dans la vengeance contrebalance ou complète ainsi l’aspect abstrait et intellectuel de celle-ci, sur lequel nous allons maintenant nous arrêter.
Fécondité poétique de la vengeance
En effet, Claudie Husson montre que la vengeance est une action « qui est toute dans l’esprit » (p. 140). Elle analyse ses structures et permet ainsi de comprendre l’affinité profonde que la vengeance entretient avec la narration comme avec le spectacle.
Avec la narration d’abord : « C’est l’anticipation qui loge l’action au cœur de l’idée, c’est elle qui fait courir l’idée vers sa réalisation, en elle la jointure entre les deux ordres ne se voit plus. Et c’est bien un cas où, de façon éclatante, le temps vécu offre à toute narration une articulation et une dynamique antérieures. » (p. 141) Parce que cette réalité composite repose sur un montage de l’idée et de l’action, de l’anticipation et de l’interprétation polarisés les uns vers les autres, en un mot parce qu’elle est mouvement, la vengeance est fortement structurée. Sa logique propre, antérieure à toute narration, est capable d’organiser un récit, voire d’éclairer en quoi consiste la dynamique narrative : « D’abord, étant un projet, étant par nature projection vers l’avenir, elle se présente comme une quintessence de puissance narrative, elle offre ce ressort de l’intérêt inépuisable qu’il y a à suivre une succession d’aventures, elle éveille dans la conscience une fascination toujours renouvelée pour ce qui va ad-venir. » (p. 150) « Matériau romanesque exemplaire », les vengeances dans La Chartreuse de Parme marchent « de ce pas qui donne du bonheur, parce qu’elles sont cette quintessence du mouvement de la vie, vie successive, vie aimantée par un dénouement, et que leur forme est naturellement narrative, avant la narration. » (p. 154)
Les études du recueil illustrent et prolongent cette analyse en déployant différents aspects du temps de la vengeance. Elles en font ainsi apparaître le paradoxe : si l’action de la vengeance est porteuse d’une dynamique propre, le désir qui l’habite, lui, peut entraîner une forme d’arrêt du temps. À propos de La Juive, O. Bara oppose le déroulement de l’Histoire à celui des histoires individuelles, dominées par la passion. Lorsque le désir vengeur devient une loi historique, l’Histoire ne peut plus progresser. « Schéma traumatique » dans Turandot, la vengeance naît « d’une crispation mémorielle, d’une possession par le passé autant que d’une dépossession identitaire » (p. 98). La voix de son aïeule parle en Turandot et « son cri traverse le temps et les corps » (idem). On ne s’étonne pas, dès lors, de voir apparaître des images de cette circularité, traduite sur la scène lyrique en terme de formes musicales, chez Lully comme dans l’opéra du xixe siècle : rondeaux, refrains et leitmotive expriment cette « involution du temps » (p. 102) de la vengeance, bouclée sur elle-même. Cette boucle est une véritable prison : elle prend le sujet dans une contradiction insoluble. Pour devenir effective, la vengeance doit détruire son objet. Mais elle doit aussi conserver le souvenir de ce qui lui a donné naissance. En ce sens elle consacre aussi l’offense première, elle en conserve pieusement le souvenir, pour sans cesse le haïr. Tout en cherchant à effacer l’affront, elle en perpétue passionnément la trace, souvent dans des objets, comme nous l’avons signalé, tiraillée entre hâte, précipitation, anticipation d’un côté, ressouvenance et retour au passé de l’autre. L. Piel et Fr. Audoueineix signalent que les œuvres d’art consacrées à la vengeance présentent presque toujours « un instant suspendu et dramatique permettant de condenser le processus » (p. 202).
Il est vrai que les œuvres étudiées représentent parfois une sortie de cette logique. C’est le cas pour Turandot ou, de façon plus originale, pour La Chartreuse de Parme, où se défait le « tressage » temporel de la vengeance, car la narration s’ouvre sur un plan supérieur et laisse entrevoir sa propre disparition. Ce travail du temps devient crucial dans les poétiques de l’après analysées par L. Campos. Leur temporalité, comme celle de la vengeance, est tendue entre le souvenir d’une « expérience fondatrice », un « après-coup », et « l’anticipation d’un changement d’équilibre et d’une réparation » (p. 155). Refusant de tenir à distance, et a fortiori d’oublier l’expérience traumatique, les auteurs comme Kertész en revendiquent l’héritage et se définissent par elle, comme s’ils assumaient telle quelle la
part de fatalité des voies toutes tracées qu’ils ont dû emprunter. Ici, c’est l’écriture qui est action. Elle transforme l’expérience – ou ce qui a été vécu comme une non-expérience, car l’individu n’en était d’aucune manière le sujet – de l’intérieur, par le récit. En réalité, la Shoah, l’apartheid ou la dictature communiste abolissent le temps, de même qu’ils abolissent toute idée de destin. Repartant de ce temps sans devenir, l’écriture, dans le mouvement du ressassement, de l’avancée pas à pas, prolonge et métamorphose cet « éternel présent », lui donne enfin une autre polarité. Kertész superpose « le “pas à pas” du déporté » et « le “jusqu’au bout” du survivant », explique L. Campos (p. 164). Selon elle, « [c]es revanches de l’écriture, vengeance sans véritable action, signalent un renoncement aux fonctions de mise en ordre de l’expérience et de réparation traditionnellement associées au récit, et le refus d’une réparation trop facile ou d’une évacuation de la violence par une clôture consolante. » (p. 165) Se trouvent ainsi superposées de nouveau la structure de la vengeance et celle du récit, ici reconfigurées ensemble dans l’idée du ressentiment.
La structure narrative de la vengeance (« narrative » entendue dans un sens large et pouvant renvoyer aux genres narratifs proprement dit, mais aussi au théâtre ou au cinéma) se reflète en outre dans le retour d’épisodes types, qu’on ne saurait rattacher à une simple topique. Le traitement de la vengeance suppose le passage par ces épisodes, qui reçoivent un traitement différencié selon les genres, en un jeu de recomposition indéfini. Les jeux de coup et contre-coup épiques (une mort entraînant une réaction immédiate dans le camp touché, et ainsi de suite) donnent un exemple net de cette dynamique narrative, concentrée et poussée jusqu’au schématisme dans l’épopée. On en trouvera des exemples dans tous les corpus étudiés. Mais nous voudrions revenir sur le cas de la scène lullyste. L’alternance entre la décision et l’hésitation y suspend l’acte, voire le décompose en ses différents moments. Se produit ainsi un déplacement décisif : l’action dramatique consiste précisément dans cette décomposition de l’acte entre intention, résolution et réalisation – ou non. Une dynamique passionnelle est substituée à la dynamique propre à l’acte et constitue le drame à elle seule. Soulignons d’ailleurs la nature de l’offense qui éveille la soif de vengeance : l’outrage n’est pas un acte, mais une absence de réponse à l’élan passionné de l’amoureuse. L’être lyrique est tout élan, effusion, passion. C’est la passion repoussée qui est à l’origine du désir de vengeance. Voilà pourquoi, nous semble-t-il, l’acte
proprement dit constitue l’horizon des pièces, leur cadre de référence, mais non leur ressort. J. Leblanc souligne que les héroïnes lyriques sortent victorieuses « non pas de l’action mais de la représentation » (p. 75).
C’est aussi que la vengeance, structurellement et intrinsèquement, entretient des affinités avec le spectaculaire. Cl. Husson le souligne : dans la vengeance, « à peine évoquée, l’action est déjà là, elle impose une représentation anticipée d’elle-même » (p. 139). Le personnage qui se venge anticipe son action dès qu’il la conçoit, en une sorte de dédoublement. Il se la représente. Il serait tentant, en ce sens, de comparer tout vengeur à la figure d’un auteur ourdissant une action imaginaire et la donnant à voir. L’usage du verbe « inventer », chez Lully, va dans ce sens. Cette anticipation procure à ses héroïnes une forme supérieure de jouissance de soi, de leur puissance. D’autre part, pour exister, la vengeance a besoin de publicité, elle nécessite un auditoire. Autre trait qui la projette immédiatement en spectacle. Plus l’auditoire sera frappé, captivé, fasciné, mieux la vengeance sera accomplie. Ce spectateur est souvent la victime, comme dans le cas de Pyrrhus, dans Andromaque. Mais il peut prendre des formes variées : il s’agit par exemple de la société dans l’œuvre de Pixerécourt, de frère Jan dans Le Quart Livre. Car on parle bien ici de spectacle et non de théâtre. Et il est remarquable que la vengeance soit représentée à plusieurs reprises dans des contes ou des romans comme une performance, une action dramatique. Outre le dispositif dramatique analysé par Chr. Louette pour Rabelais, on pense au Sopha de Crébillon, dont les vengeances portent le souvenir de la tragédie classique. Dans le cas de la vengeance, il semble que les références romanesques au théâtre soient structurelles au moins autant qu’intertextuelles, qu’elles soient suscitées par la nature même de l’acte vengeur : c’est dans ce sens que s’expliquent les nombreuses références à la tragédie comme genre paradigmatique de la vengeance. Outre la fascination pour le monde de la scène et des acteurs, outre l’anglomanie triomphante, c’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles les peintres romantiques que sont Delacroix et Chassériau s’intéressent à la vengeance via le filtre du théâtre shakespearien, comme le montre Fr. Audoueineix. Il semble à ces peintres, comme à leur contemporain qu’est Dumas, que la scène représente la quintessence des passions.
Efficacité expressive de la vengeance
Enfin, comme le note O. Bara, « La vengeance est toujours un débord, le franchissement d’une limite, un excès théâtralement riche, musicalement fécond, moralement et politiquement signifiant. » (p. 100) La vengeance, prise par nature entre narration et spectacle, offre aux artistes la possibilité d’une expressivité accrue. Parce qu’elle est du côté de l’excès, de la disproportion, de la monstruosité, du débordement, elle pousse les situations et les êtres aux limites du représentable et devient précisément pour cela un parfait objet de représentation. Sans insister sur les multiples formes de la violence (dans les actes, les mots…), on peut souligner avec Chr. Louette que les œuvres qui représentent la vengeance font fréquemment violence au langage. Dans la tragédie en musique, lorsque l’action n’est pas empêchée, elle s’affole et rejoint alors le modèle sénéquien, en une surenchère d’actions et de réactions exacerbées. On peut ainsi opposer l’action empêchée qui domine le modèle lullyste, et qui confère au spectacle des passions une forme d’innocuité permettant de s’en délecter, et la Médée de Charpentier, donnant à voir cette fois le spectacle effrayant des passions déchaînées. On peut se demander si ce trait n’a pas contribué à l’échec de la pièce de Charpentier. Dans les mélodrames où Pixerécourt suggère que la vengeance déstabilise l’édifice social, les personnages de vengeurs sont, logiquement, des monstres. L’imaginaire monstrueux est partie prenante des représentations de la vengeance.
Poussant les moyens d’expression à leur limite, elle permet d’« explorer les zones obscures du déchaînement passionnel », la « brutalité quintessenciée des affects » (p. 93) et entretient des affinité avec le « monde occulte, celui de la mort et de la folie » (p. 203). Les exemples analysés par S. Hubier en donnent des exemples frappants. L’hubris du vengeur est une donnée récurrente (p. 97, p. 119). La vengeance rejette le sujet dans les marges de la société, voire de l’humanité. Elle est une forme de régression et de transgression tout à la fois et peut entraîner une dénaturation, une aliénation du sujet vindicatif. On comprend ainsi que, quel que soit le genre, « la vengeance est toujours susceptible de faire éclater les cadres de la représentation » (p. 106).
L’effet de la représentation :
catharsis et mise à distance
Enfin il faut insister sur l’effet escompté de la représentation. Celle-ci est un acte, elle vise à produire un effet sur le lecteur ou le spectateur : la question de l’économie des passions concerne aussi la réception. Dans le cas de Pixerécourt, la représentation, dans un premier temps du moins, vise à domestiquer les passions populaires, à transmuer le spectacle des émotions (p. 84), afin d’éloigner le spectre de la vengeance, cet « acte asocial ». L’exhibition des passions néfastes joue alors un rôle cathartique. Mais les pièces d’une deuxième période créatrice mettent plutôt l’accent sur la tendresse et les émotions publiques : Pixerécourt souligne qu’un roi prouve qu’il est juste s’il sait se faire aimer. Horreur puis identification, le rapport de la salle au spectacle semble s’inverser, mais toujours dans l’idée d’une bonification morale du public. La question de la catharsis est également abordée par L. Campos et S. Hubier. Selon L. Campos, tout en rejetant l’idée d’une réparation, les auteurs de l’après renouent avec la théorie ancienne des passions pour interroger l’idée d’une catharsis par l’écriture, alors même qu’ils excluent le pathos. S. Hubier, quant à lui, insiste sur les pouvoirs cathartiques de l’esthétique hollywoodienne fondée sur l’excès : « La sombre figure du vengeur, à la fois idéale et tragique, est mise au service de la cité et, selon le modèle d’une catharsis nouvelle, purge le spectateur de ses passions tristes, au sens où l’entendait Deleuze après Spinoza : une ardeur qui mène moins à l’action qu’à l’indifférence, sinon à l’apathie. » (p. 179) Peur, désir et jouissance doivent permettre la purgation des « pulsions antisociales ».
Mais il arrive que la mise à distance de la vengeance et de ses passions se réalise dans l’œuvre même. Elle est représentée dans La Chartreuse de Parme : Cl. Husson analyse la « détente » ou l’« éclipse » que connaît la dynamique de la vengeance comme un « passage hors champ du désir de vengeance » (p. 154). Derrière le récit des passions vengeresses, est suggéré en transparence un autre plan, dépassionné, celui de l’indifférence, forte de sa propre temporalité, épanouie dans la contemplation.
Comme le fait remarquer Th. Pavel, il est rare que les œuvres fassent l’apologie de la vengeance. Plus encore, il est frappant de constater que
la représentation de la vengeance est un vecteur de mise à distance de la réalité de celle-ci. B. Méniel montre dans l’épopée le refoulement des passions sous la pression de l’idéal stoïcien et des valeurs chrétiennes. Dans Le Quart Livre, on observe une reductio ad comicum : la médiation du modèle dramatique, qui structure le récit, permet de tenir la vengeance à distance, tout en donnant au spectateur (frère Jan et à travers lui le lecteur) le plaisir de goûter ce spectacle, rendu tout aussi inoffensif pour lui que radical pour la victime : le jeu « dédramatise la violence tout en l’exhibant » (p. 117). Mais cette distanciation est ambiguë : tout en tenant la violence et les passions à distance par le rire, elle enrôle de force le lecteur dans le combat satirique que Rabelais mène contre les marchands et les hommes d’Église. Dans Le Sopha, il semble que les jeux intertextuels et la médiation des narrataires, ironiques, critiques ou naïfs produisent cette même distance et déplace l’intérêt de la vengeance à la narration elle-même et à ses effets. Les interventions de Shah-Baham et de la Sultane montrent que ceux-ci se situent loin des passions : on discute morale ou intérêt narratif et si l’on s’enflamme, c’est généralement pour défendre un point de vue critique, plus que pour réagir au récit. Les exclamations intempestives de Shah-Baham rejettent les réactions passionnelles du côté de la naïveté enfantine tout en s’interposant entre les récits et le lecteur, comme pour neutraliser leur possible effet. Les hésitations d’Hamlet, enfin, tiennent la vengeance à distance, le prince ne pouvant accepter cette réalité comme sienne. Cette dissociation entre le rôle et les désirs du vengeur interroge la vengeance de l’intérieur.
Une forme héritée, des modèles communs
Si la vengeance charrie ses propres lieux communs, on ne saurait donc la réduire à une topique commode. Elle nous apparaît finalement comme une structure héritée et sans cesse recomposée. À tel point que L. Campos peut l’utiliser comme un modèle critique permettant de comprendre le fonctionnement d’œuvres où la vengeance n’est pas thématisée et de faire émerger leur modèle propre, qui en est une reformulation : le ressentiment.
D’où les liens que les œuvres entretiennent les unes avec les autres. Alors que nous n’ambitionnions pas d’établir une histoire de la vengeance en littérature, des continuités se sont révélées, de façon parfois inattendue. Des inflexions, aussi : B. Méniel et R. Martin analysent l’évolution de leurs corpus respectifs dans leur contexte propre. Les césures que sont la fin des guerres de religion et la chute de l’Empire amènent des reconfigurations de fond pour la représentation de la vengeance. De même, l’apparition de la deep ecology pour les films hollywoodiens. L’évolution des mentalités amène des éclairages différents sur les acteurs ou la légitimité de la vengeance, modifications qui se traduisent par l’apparition de nouvelles formes, elles-mêmes porteuses de suggestions, de fantasmes renouvelés pouvant agir en effet retour sur la société. Ces éléments de continuité et d’évolution historique vont de pair avec des références à des modèles fondateurs. Nous avons vu revenir Hamlet comme une œuvre paradigmatique, retrouvée en peinture, revisitée dans Les salauds dorment en paix. Alors que la tragédie antique n’apparaît que très peu dans les études, la tragédie classique sert aussi de modèle : la tragédie en musique se pense par rapport à elle, mais c’est aussi le cas des contes libertins, tragédies pour rire – fût-ce d’un rire grinçant. La colère d’Achille, enfin, et plus généralement le souvenir des épopées antiques, est également en arrière-fond de plusieurs œuvres – les épopées renaissantes, évidemment, mais aussi Le Quart Livre. La liste de ces modèles récurrents dans le présent volume ne prétend pas être parfaitement représentative : il faudrait pour cela élargir le corpus.
Quelles œuvres structurent l’histoire de la représentation de la vengeance, quelles sont leurs spécificités et comment ont-elle influencé la création ? Tout comme l’image du vengeur et ses inflexions, ou comme le rôle du corps, les modèles fondateurs pourraient être en soi un sujet de recherche en prolongement de ce travail, notamment dans le rapport entre passion et action.
Céline Bohnert
Université de Reims Champagne-Ardenne
1 Trésor de la langue française Informatisé (atilf.atilf.fr [consulté le 30 mai 2012]).