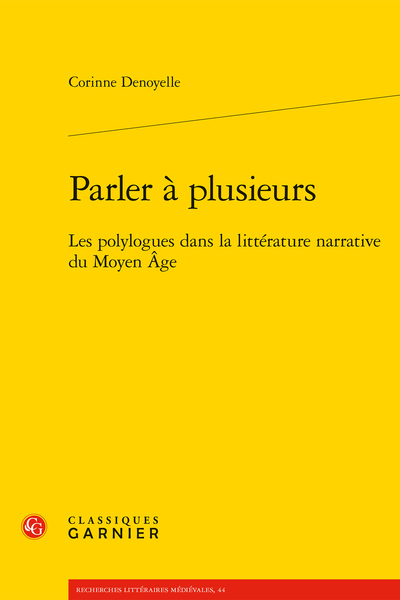
Conclusion de la deuxième partie
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Parler à plusieurs. Les polylogues dans la littérature narrative du Moyen Âge
- Pages : 481 à 482
- Collection : Recherches littéraires médiévales, n° 44
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406166184
- ISBN : 978-2-406-16618-4
- ISSN : 2261-0367
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16618-4.p.0481
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 17/04/2024
- Langue : Français
Conclusion
de la deuxième partie
Le Moyen Âge ne craignait pas que le groupe soit la réduplication du même, éventuellement dissimulée sous la diversité apparente des noms et des identités. Notre sensibilité contemporaine semble avoir de plus en plus de mal à admettre les personnages sériels et préfère voir dans le concept de groupe un rassemblement forcément hétérogène de personnalités singulières1.
Mon hypothèse de départ était que les polylogues étaient un moyen utilisé par les auteurs pour représenter justement cette hétérogénéité et donner à chaque figure singulière une voix qui lui soit propre, une importance réelle. Mais les analyses, malgré l’effet de loupe que peut produire l’observation de chaque cas particulier, montrent surtout que le polylogue est un moyen de créer une diversité superficielle qui met d’abord en scène l’ancienneté de son personnel romanesque ou son exotisme plus que sa diversité intrinsèque. Les polylogues créent de la sociabilité dans l’univers diégétique plus que de l’individuation.
La chanson de geste donne une plus grande agentivité discursive à ses personnages en développant les scènes d’opposition. Cette valorisation du dissensus fait partie de son esthétique et du mode de raisonnement épique qui incarne la « pensée sans concepts » dans des figures en opposition. Cette agentivité semble aussi se renforcer de la nomination quasi généralisée des personnages. Toutefois, le dissensus est souvent vain voire factice et les oppositions mettent moins en scène des individus aptes à s’exprimer que des seigneurs faibles ou des groupes aveuglés, les conflits sont passagers et se résolvent sans laisser de traces dans l’euphorie des 482victoires ou le chagrin des défaites. Le polylogue est essentiel pour donner à voir ces oppositions. En revanche, à la frontière de l’épopée et du roman en train de s’inventer, le Roman d’Alexandre efface tout dissensus pour valoriser la force de son seigneur.
Les romans arthuriens qui jouent d’un personnel abondant utilisent le polylogue moins pour renforcer l’effet-personne ou pour développer la spécificité de chaque opinion que pour mettre en scène un monde « possible », exhaustif, riche de héros dont les positions semblent toutefois rester interchangeables. Les polylogues donnent à voir cette abondance de noms mais leurs voix, quoiqu’individualisées, se ressemblent beaucoup. Le roman de Perceforest, à côté de personnalités très développées, joue de la sérialité pour représenter la fraternité chevaleresque. Plus que le développement de l’individu, ces polylogues arthuriens permettent de valoriser une sociabilité aristocratique, qui s’exprime dans des groupes : celui de la cour, entité qui crée un environnement valorisant, la Table Ronde, référence morale mais pas forcément assez active pour réguler les conflits ou contraindre les itinéraires singuliers, le lignage qui crée le plus fort sentiment d’appartenance par la mise en concurrence inévitable qui s’opère avec les autres, ou les regroupements de hasard sur les chemins de l’aventure, première cellule où s’expriment les apories d’un monde complexe.
Le polylogue est donc un outil performant pour interroger la représentation de l’individu dans le texte littéraire, et partant celle du personnage, tel qu’il est inventé au sein d’un réseau. Il permet d’appréhender ce réseau, qui ne se limite pas au schéma actanciel, mais est lié à une idée de la sociabilité humaine. Quelle sociabilité est inventée pour quel type de société ? Comment les différents groupes sociaux décrits se définissent-ils, se reconnaissent-ils ? Comment interagissent-ils les uns avec les autres ? Quelle part d’individuation est donnée à chacun ? Qui y joue le rôle de leader ? Autant de questions qui, grâce à ce nouvel outil d’analyse, ouvrent des perspectives de recherche du Roman Comique de Scarron à la Saga Malaussène de Daniel Pennac et aux Furtifs d’Alain Damasio.
1 Entre les films d’Akira Kurosawa, les Sept Samouraïs, les Sept mercenaires de John Sturges (1960) et leur remake par Antoine Fuqua (2016), l’hétérogénéité des personnages, au départ ne se distinguant que par leur caractère ou leur classe sociale, a été renforcée sur le plan ethnique : désormais un noir, un Comanche, un Chinois, un Mexicain, un Québécois participent à la mission en plus de l’aventurier et du tireur d’élite. De même, si je puis me permettre un autre exemple, incongru certes dans un travail universitaire, on trouve aujourd’hui la même recherche de l’individuation dans les personnages actuels des Schtroumpfs !