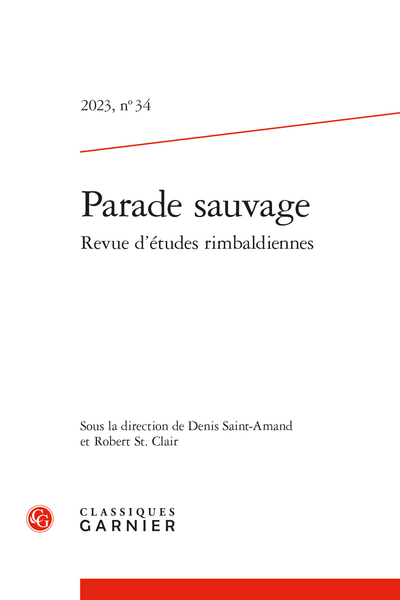
Comptes rendus
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Parade sauvage Revue d’études rimbaldiennes
2023, n° 34. varia - Auteurs : Illouz (Jean-Nicolas), Hureaux (Anton), Saint-Amand (Denis), Bardel (Alain), Bataillé (Christophe), Péladeau-Houle (Mendel)
- Pages : 433 à 461
- Revue : Parade sauvage
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406165996
- ISBN : 978-2-406-16599-6
- ISSN : 2262-2268
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16599-6.p.0433
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 10/04/2024
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
Dictionnaire Rimbaud, sous la direction d’Adrien Cavallaro, Yann Frémy et Alain Vaillant, Paris, Classiques Garnier, 2021, 888 p.
Le genre du dictionnaire d’auteur demande qu’on l’aborde avec la bonne distance critique. Il connaît depuis quelques années une vogue éditoriale certaine, qui en fait une des formes médiatiques de la patrimonialisation de la littérature, en même temps qu’un outil obligé de l’histoire littéraire. Mais cette vogue, portée d’ailleurs davantage par les éditeurs que par les professeurs eux-mêmes, est en réalité suspecte. Elle témoigne d’un retour, mal assumé, au positivisme, qui se manifeste, conjointement, par le reflux de l’effervescence théorique dans les études littéraires, et par la mise en retrait de la part la plus libre, et la plus créatrice, de l’interprétation. Il ne s’agirait plus de produire, ou de rêver, des savoirs nouveaux, ni d’explorer des territoires inconnus, mais d’emmagasiner des savoirs acquis, sur des auteurs en réalité déjà canonisés. En outre, la forme même du dictionnaire serait doublement défaillante : d’un côté, elle manquerait la visée d’une synthèse (« encyclopédique »), qui dépasserait l’éparpillement des notices et le poudroiement des éclairages hétérogènes ; de l’autre, elle ne satisferait pas davantage à la curiosité de l’amateur des listes hétéroclites ou des objets singuliers, tant le genre est en lui-même contraint, obligeant les auteurs de dictionnaires à repasser par des voies déjà frayées et à redire ce qui a été dit déjà maintes fois. Finalement, le dictionnaire priverait la connaissance de la relation dialectique qui la fonde : il n’aurait ni véritable « auteur », au nom de l’impersonnalité requise dans les notices, ni véritable lecteur, étant adressé à tous et à personne.
Bref, quelque chose de la littérature résiste à sa mise en dictionnaire, – comme, on le sait par ailleurs, quelque chose de Rimbaud résiste à la littérature.
Mais précisément : les responsables de ce nouveau Dictionnaire Rimbaud – Adrien Cavallaro, Yann Frémy et Alain Vaillant – ont conscience de telles résistances, et travaillent, empiriquement, au sein du dictionnaire, contre, autant qu’avec, le genre du dictionnaire lui-même.
434Il en résulte ici, selon nous, une réussite : ce nouveau Dictionnaire Rimbaud tend à faire converger, serait-ce en horizon ou en ligne de fuite, l’objectivité des connaissances factuelles, et la subjectivé (personnelle ou historique) de la lecture et des interprétations, constitutive du jeu littéraire comme tel et constitutive de la vie des œuvres dans le temps. L’érudition, la minutie, la perspicacité sont poussées jusqu’au point où, par-delà des savoirs positifs, elles invitent « à prendre la mesure de ce que l’on ignorera toujours », lit-on dans la préface. Le dictionnaire joue avec et contre lui-même, pour mieux retrouver alors le principe dynamique qui en vérité est le sien : faire de l’état des connaissances le plus actuel et le plus réfléchi le catalyseur de connaissances à venir, plus libres et plus savantes, plus conscientes. C’est à ce prix que le dictionnaire retrouve son lecteur, – dédié qu’il est maintenant aux mains habiles qui le feuilleront et aux esprits curieux qui le continueront.
Relevons donc, pour notre part, quelques-unes des lignes de force qui nous semblent structurer l’ouvrage, appelé à devenir une référence fondamentale des études rimbaldiennes.
1. Ce qui renouvelle ici notre connaissance est d’abord la mesure, plus ample, que ce dictionnaire donne à l’historicité de l’œuvre de Rimbaud. Au-delà de l’œuvre, il s’agit, en vérité, du « nom » même de Rimbaud, car au fil du temps, à travers les relais des réceptions et recréations, le nom de Rimbaud est devenu le signifiant d’un désir : un désir plus ardent de poésie, relayé d’horizon d’attente en horizon d’attente, et porté par un « principe espérance », dirait Ernst Bloch, qui, ressourcé à l’utopie du poétique, est en vérité un principe révolutionnaire des plus concrets.
Le nœud de cette thèse se trouve dans l’entrée « Rimbaldisme », laquelle découle du livre récent d’Adrien Cavallaro1. Dans le discours critique, que récapitule donc le dictionnaire et qu’il diffuse à travers diverses notices, la notion de « rimbaldisme » intègre, en même temps qu’elle critique et dépasse, la notion de « mythe » : comme le voulait Étiemble, le nom de Rimbaud est un effet de paroles, générateur de mythes ; mais, contrairement à ce que voulait Étiemble, il ne s’agit pas ici de dissocier le mythe littéraire de quelque vérité philologique, puisque l’œuvre, en elle-même, ne se soutient précisément que de s’inventer hors 435d’elle-même, dans les discours qu’elle suscite, dès sa première réception jusqu’aux réceptions les plus contemporaines. Au fil des générations, selon des considérations d’époque ou des captations imaginaires plus personnelles, à travers des discours critiques ou des fictions poétiques, se façonnent, diversement, un Rimbaud « maudit », un Rimbaud « parnassien », un Rimbaud « symboliste », un Rimbaud « voyant », un Rimbaud « voyou », un Rimbaud « catholique », un Rimbaud « surréaliste », un Rimbaud selon René Char ou selon Yves Bonnefoy, etc., – c’est-à-dire finalement – et à travers toutes ces entrées qui se répondent implicitement dans le dictionnaire – un Millénaire Rimbaud, dirait Michel Deguy, s’il est vrai que Rimbaud, dans la brisure de sa trajectoire et le silence où finalement il se tient, aura été toujours déjà lui-même une fable, – afin que la poésie se continue au-delà de la poésie, jusque dans nos vies. De ce point de vue, l’entrée « Mallarmé » touche juste : car Mallarmé, lit-on dans le dictionnaire, est le premier à percevoir la dimension de fictionnalité qui sous-tend l’existence littéraire de Rimbaud, dès lors que le nom de Rimbaud, prononcé dans telle assemblée des mardis, instaure du « vague », un « silence », en même temps que de la « rêverie » ou de l’« admiration inachevée ». Le mythe n’est pas dissociable de l’œuvre, puisque l’œuvre même étaie le mythe, qui découle d’un fait de structure constitutif de la textualité de l’écriture rimbaldienne : que l’on songe, notamment, aux effets de certaines « formules », quand elles ont la capacité de « se dégager » de leur premier contexte, pour « essaimer », tels des grains de pollen (dirait Novalis), dans d’autres contextes, et féconder alors l’avenir, de réceptions en recréations. Le dictionnaire consacre d’ailleurs plusieurs entrées à quelques-unes des formules rimbaldiennes les plus célèbres, comme si elles étaient détachables du texte : « il faut être absolument moderne », ou le terme « moderne » est ambivalent, pouvant supporter deux interprétations contraires ; ou « changer la vie », que Breton associe au mot d’ordre de Marx, « transformer le monde ». On remarquera aussi la part faite, non seulement aux réceptions critiques, mais aux réceptions créatrices (voir par exemple les entrées « Mise en chanson », « Léo Ferré » ou « Patti Smith »), comme si, dans cet excès où l’œuvre se tient, seule une autre œuvre pouvait répondre à l’œuvre, selon un processus de création continuée, constitutif de l’œuvre moderne : inachevée, inachevable, dans le déséquilibre de son propre présent, elle s’actualise, sans fin, dans d’autres présents que le sien.
4362. Un autre apport du dictionnaire, tout à l’acquis de la critique la plus récente (et particulièrement des travaux immenses de Steve Murphy), est la meilleure compréhension de la portée politique de la poésie de Rimbaud.
Il faut ouvrir ici l’entrée « Commune de Paris ». Rimbaud est un poète communard. La Commune s’écrit obliquement dans maints poèmes, par allusions, jeux de mots, parodies intertextuelles, incorporation de matériaux lexicaux ou d’imageries populaires. Mais plus encore peut-être, parce que son événement sidère la possibilité de la représentation, la Commune se déplace du signifié vers le signifiant : et elle s’entend alors dans le phrasé d’une parole bouleversé et bouleversante, qui encrypte en elle la voix des « vaincus de l’histoire », prolongeant l’utopie révolutionnaire dans l’utopie du poétique.
On notera que, sur ce point encore, le dictionnaire fait « rebondir » dans le temps l’événement historiquement situé, pour inviter à le reprendre selon une historicité plus ample. On se reportera par exemple à l’entrée « Mai 68 », à l’entrée « Soir historique », à l’entrée « Misère », ou à l’entrée « Liberté » (on regrette l’absence d’une entrée « Anarchie »). Et, à nouveau, cette écoute des échos politiques du texte de Rimbaud se nourrit d’un de ses principes formels structurants, s’il est vrai que les formules rimbaldiennes, d’emblée désarrimées de leur contexte, ont cette capacité àfuser hors du texte, pour devenir autant de « slogans » actifs dans nos vies.
3. Une autre piste de lecture apparaît quand on ouvre les entrées « Sexualité », « homosexualité », « Corps », « scatologie » : du réel politique, on passe au réel sexuel, unis qu’ils sont dans une même impossibilité (s’il est vrai, dit Lacan, que « le Réel, c’est l’impossible, tout simplement »).
Le moment Rimbaud de la poésie (son moment Rimbaud / Verlaine) est celui où le corps, dans sa réalité tout organique en même temps que dans sa jouissance inassignable, est envisagé comme le foyer nouveau de l’expérience créatrice. On pourrait dire que le sexuel est reconnu comme l’ombilic du poème, bien avant que Freud n’en fasse « l’ombilic du rêve ». D’où tant de textes qui font jouer un double sens érotique – scabreux ou émerveillé –, et qui semblent replier le travail de l’écriture sur le travail du rêve, celui-ci opérant par condensation ou déplacement comme celui-là opère par paronomase, métaphore ou métonymie. Il y a une « obscénité » de Rimbaud, comme il y a une « obscénité » de L’Origine du monde de Courbet, 437s’il est vrai que le corps érotique, en venant au-devant de la scène, aveugle la toile comme il défait l’ancien jeu, trop bien réglé, de la représentation.
Sur ce point, on aurait aimé qu’il y eût une entrée « Paysage ». Non que les entrées thématiques soient absentes (« Nature », « Nuit », « Couleurs », « Fleurs », etc.) ; mais elles sont un peu décevantes, sans doute parce que la forme de la notice leur donne une objectivité, ou une inertie, qui ne convient pas au mode de lecture de la critique thématique. Une entrée plus générale portant sur le « Paysage » aurait mieux dit les formes de l’imaginaire rimbaldien. Il s’agirait alors de montrer comment Rimbaud met fin à l’idée occidentale du paysage, lequel s’est constitué progressivement comme un espace perspectivé, dépendant du point de vue d’un sujet individuel ; or le paysage rimbaldien, parallèlement à ce qui se joue au même moment dans la peinture, défait la perspective : les choses vues sont soustraites à un point de vue focal unifié ; comme chez Gauguin, elles se présentent sans être représentées, surgissant par touches, intensités ou éclats.
On pourra donc se reporter à l’entrée « Hallucination » ou à l’entrée « Dérèglement de tous les sens », qui, parallèlement à la critique thématique (voir l’entrée « Bachelard ») ou à la critique issue de l’antipsychiatrie (voir l’entrée « Deleuze »), indiquent en outre une autre forme de lecture de l’imaginaire, en invitant à comprendre les délires de Rimbaud dans un dialogue critique avec les catégories nosologiques des aliénistes et les représentations d’époque de la folie.
4. Autre piste qui traverse le dictionnaire : nombre de notices dessinent, en pointillés, une poétique historique de l’œuvre de Rimbaud, qui compose avec des études de lexicologie, de rhétorique, de stylistique, de l’histoire des genres et des formes poétiques, au moment où Rimbaud précipite le devenir-moderne de la poésie.
On le sait, pour le poète des « lettres dites du voyant » (voir l’entrée correspondante), il ne s’agit pas seulement de renouveler les formes anciennes (voir l’entrée « Vieillerie poétique »), mais, plus radicalement, de « trouver une langue ». Les entrées « Langue » ou « Lexique » donnent à cette formule rimbaldienne son arrière-plan historique, en permettant de comprendre le socle linguistique à partir duquel Rimbaud projette son « départ ». Si Mallarmé est un poète « syntaxier », Rimbaud est un poète « lexical ». Ses phrases débordent les structures préformées du langage, et apparaissent comme autant d’événements : à ce moment 438de l’histoire de la langue où la langue semble la plus contrainte par l’institution scolaire et la plus normée par les académies, lire Rimbaud revient à surprendre « l’éclat insoutenable du mot soudain dégainé », écrit Julien Gracq (voir l’entrée « Julien Gracq »).
Les entrées « Rhétorique » ou « Style » touchent juste quand elles invitent à penser les « figures » autrement qu’en termes d’« écart ». Le texte de Rimbaud est tout entier « figural » parce qu’il est tout entier « littéral » : il se donne à lire « littéralement et dans tous les sens » dès lors que les jeux du signifiant, sans jamais se résoudre dans un signifié dernier, se soutiennent d’une sorte de paronomase généralisée, avec glissements allitératifs, assonances approximatives, ou calembours (voir l’entrée « Calembour »). Cela se fait à même le texte, sans qu’il n’y aille de personne, en toute objectivité.
Du côté du vers, les entrées « Rime » ou « Métrique » rappellent comment l’évolution prosodique de Rimbaud récapitule l’histoire du vers français, la change dans l’invention d’« espèces de romances », et finalement la « solde ».
Du côté de la prose, on trouvera une entrée « Poème en prose », mais on regrettera qu’il n’y ait pas une entrée « Prose » tout court : car le poème en prose lui-même n’est qu’une étape dans la quête rimbaldienne d’une nouvelle « formule » poétique ; il peut sans doute un instant se déduire du legs de Baudelaire (voir l’entrée « Baudelaire ») ; mais, au sein même des Illuminations, il est très vite dépassé pour autre chose. Le poème en prose, chez Rimbaud, ne vaut pas en tant que « genre », quelque « moderne » qu’il soit, mais en tant qu’il ouvre dans le poème le champ d’une expérimentation toujours plus libre des possibles de la langue.
Quant au vers libre, l’entrée correspondante rappelle qu’il est une dénomination proposée a posteriori pour « Marine » et « Mouvement », quand il s’agit pour les poètes symbolistes d’enrôler Rimbaud, rétrospectivement, dans leur propre combat. En réalité, comme le poème en prose, le vers libre rimbaldien n’est pas une forme préalable, mais une performance : il se trouve sur le motif, dans un geste poétique en acte, qui ne découle d’aucune antériorité ni ne prétend à aucune postérité. Rimbaud, comme Ponge, réclame une poétique par poème.
Cette « révolution du langage poétique » va de pair avec une crise du lyrisme et de la subjectivité romantiques (voir l’entrée « Romantisme »). On lira à ce sujet l’entrée « Poésie subjective et poésie objective », ou 439encore l’entrée « Je est un autre », qui invitent à penser un lyrisme « désoriginé » et une modalité énonciative disséminée dans la textualité comme telle. Mais on regrettera l’absence d’une entrée « Lyrisme », ou d’une entrée « Idylle », aussi bien que d’une entrée « Impersonnalité » ou « Poésie impersonnelle », qui auraient relancé la réflexion. Peut-être aurait-il fallu ajouter une entrée « Notation », car il semble que la « notation » soit la formule vers laquelle tend en effet tout un pan de la recherche de Rimbaud, en quête du réel même, sans sujet, dans l’invention d’une poésie qui ne peut plus être bientôt que « la fin du monde, en avançant ».
5. Le dictionnaire tire également le meilleur parti des lectures intertextuelles qui sont devenues très majoritaires dans les études rimbaldiennes récentes. Il ne s’agit pas, pour la critique la plus novatrice, de trouver de nouvelles « sources » aux textes de Rimbaud, encore que ces sources réservent souvent de belles surprises (voir par exemple l’entrée « Bateau ivre ») ; mais il s’agit d’évaluer une des caractéristiques majeures de la textualité moderne, quand la littérature renvoie toujours déjà à la littérature, et trouve, dans ces relations intertextuelles multipliées, le catalyseur d’une signifiance accrue.
La conscience du « jeu littéraire » en tant que tel est sensible dès les premiers textes de Rimbaud, où même la naïveté est feinte, dans un art très savant et plein de roueries (voir, par exemple, l’entrée « Dormeur du val »). Mais elle tend vite à faire de tout poème une « parodie », qui diffère toujours déjà en elle l’« ode » première. On se reportera aux entrées « Parodies et pastiches », ou « Satire », qui, au-delà de genres rhétoriques constitués ou encore au-delà du rire « zutique » (voir l’entrée correspondante), désignent finalement une marque fondamentale des écritures modernes : comme le Baudelaire d’Alain Vaillant2, Rimbaud est un « poète comique », en ce sens que l’ironie est, dans ses textes, à la fois omniprésente et inassignable, partout et nulle part, – « aussi simple qu’une phrase musicale ».
Chemin faisant, d’une entrée l’autre, mêlant des voix nombreuses, dont quelques-unes disparues récemment, le dictionnaire fait sa preuve. Il met l’œuvre de Rimbaud « en ordre de fonctionnement3 », la rendant 440plus aisément « mobilisable » pour la réflexion. Mais lui-même emporte son lecteur dans son jeu propre : de notices en bibliographies, de bibliographies ponctuelles à une très ample bibliographie générale, le lecteur est lui-même emporté de livre en livre, de livres en bibliothèques, et de bibliothèques en mondes.
Jean-Nicolas Illouz
Université Paris VIII
Équipe de recherche « Fabrique du littéraire »
*
* *
Revue d ’ Histoire Littéraire de la France,vol. 122, no 1, « Les Illuminations à “tous les airs” », Adrien Cavallaro (dir.), Classiques Garnier, mars 2022.
Paru lors du premier trimestre de l’année dernière, le dossier de la RHLF consacré aux « Illuminations à “tous les airs” » peut à de nombreux égards apparaître comme un nouveau départ dans l’étude du dernier Rimbaud. Les neuf contributions qui le composent, issues de grands noms des études rimbaldiennes, participent en effet d’une même entreprise de déplacement des questionnements traditionnels, qui entend libérer la lecture des Illuminations de ce qu’Adrien Cavallaro, maître d’œuvre du dossier et spécialiste de l’archive métacritique du rimbaldisme, identifie dans son introduction comme une « tyrannie de la glose » (p. 8). Si cette dernière a, certes, permis durant les années 1980 et 1990 des avancées indéniables dans la compréhension de textes souvent perçus comme hermétiques, elle a cependant corrélativement conduit à les isoler les uns des autres et à les enfermer dans une alternative entre lisible 441et illisible qui a pu pousser certaines analyses à substituer aux textes de prétendues clefs interprétatives. « Les Illuminations à “tous les airs” » propose de recentrer la question sur la poétique de la poésie en prose rimbaldienne dans une perspective « d’exploration globale du recueil » (p. 9), de manière à ressaisir la, ou plutôt les significations des poèmes non plus dans une extranéité transcendante (le réel, le biographique, l’idéologique) ainsi que le suppose le modèle de la glose herméneutique, mais bien, comme l’écrit A. Cavallaro dans son article, dans « ce que fait le poème » (p. 127). On ne s’étonnera donc pas voir ce dossier s’organiser selon ce que Derrida appelait des « paléonymes » (des vieux noms qui servent de repères heuristiques susceptibles de recouvrir des concepts nouveaux), à savoir le « monde » et la représentation, le « sujet » et l’énonciation, la « pensée » et la discursivité, aborder à chaque fois comme des « points de résistance » (H. Scepi, p. 85) qui ne sont nullement les lieux d’une obscurité autocentrée, mais les nœuds où s’élaborent une poétique complexe de la prose.
Les trois premiers articles interrogent ainsi la relation des poèmes des Illuminations au monde en déplaçant les termes d’un débat qui s’est souvent focalisé sur la question de la référentialité dans une perspective tantôt formaliste, tantôt métaphysique. Dès le premier article, « Représenter l’irreprésentable », Olivier Bivort dégage le paradoxe de la mimesis dans le recueil : les Illuminations exploitent tous les ressorts de la représentation dite « réaliste », notamment l’organisation géographique précise de la description au service de l’ekphrasis (« Mystique ») ou d’une peinture rationnelle de l’espace (« Villes I »), tout en rendant impossible la « reconstitution graphique » (p. 15) du tableau, de la scène ou du lieu. Chaque poème configure de la sorte un « conflit entre forme et contenu (celui-ci obscur, explicite celle-là) » (p. 14) qui a pour conséquence moins de produire un effet d’intransitivité que d’invalider le principe d’exogénéité propre à la « situation réaliste traditionnelle », qui suppose a minima une réalité extérieure au texte. Dans les Illuminations, la représentation est pour ainsi dire sans référence, produisant ce qu’O. Bivort appelle une « mimesis de l’irréel » qui entend « représenter l’inconnu » (p. 18). Or, – c’est là le point capital – une telle représentation n’est ni un délire subjectif ni quelque projection messianique inscrite dans une poétique de la voyance romantique, mais un aplanissement de la vision à la surface du langage, une « objectivité de la vision » (p. 18) au sens 442où celle-ci est faite objet de langage, pure « présence textuelle » (p. 13). Dans « Scènes » et en particulier avec la clausule qui rend définitivement invraisemblable l’ingénierie du théâtre décrit, O. Bivort souligne qu’en dernier ressort « le représentant fait sens plus que le représenté » (p. 16), de manière à produire la vision d’un ailleurs dont les composants sont générés par les éléments rhétoriques et langagiers : « la machinerie du poème s’impose peu à peu sur le spectacle lui-même » (p. 16).
Cette « machine » à spectacle s’incarne, comme le remarque Virginie Yvernault, dans le motif dramatique qui traverse les Illuminations. « Le théâtre de Rimbaud ou la machinerie spectaculaire des Illuminations » analyse ce motif qui a déjà fait l’objet de remarques éparses dans l’histoire du rimbaldisme, mais jamais de lecture systématique approfondie. Le théâtre n’est pas perçu ici comme la simple métaphore d’une écriture qui se veut productrice de visions enchanteresses : comme le souligne V. Yvernault, les différents paradigmes des arts de la scène convoqués par Rimbaud (le théâtre shakespearien, l’opéra-comique, la féérie moderne, auxquels elle ajoute les spectacles de lanterne magique déjà analysés par J.-L. Steinmetz4) mettent en avant une véritable « théâtralité » de l’écriture poétique (p. 20, terme emprunté à Barthes), c’est-à-dire à la fois une « dynamique spectaculaire » des scènes et visions décrites et une « exhibition signifiante de certains aspects du spectacle » (p. 21), à la fois une scénographie merveilleuse et la désignation de son artificialité rhétorique, une énonciation ressortissant d’un poète « spectateur muet » et en même temps « metteur en scène tapageur » (p. 34). À propos d’« Antique », V. Yvernault remarque que la superposition d’images sur la même statue mobile (« celle du silène, du mime latin et de l’hermaphrodite ») ne permettant jamais de trancher sur une représentation signifiante plutôt qu’une autre, l’unité de la vision se divise et déporte « de l’objet du spectacle vers le foyer, c’est-à-dire le locuteur, qui se fait ici chorégraphe ou scénographe » (p. 26). Cette « énonciation “double” », qui fait bien entendu écho au phénomène de double énonciation au théâtre, repose sur un mouvement « d’adhésion au spectacle en même temps que sa dénégation » (p. 31) corrélé par ailleurs à une figuration qui assume, dans sa spectacularité, un excès propre à la production scénique de la seconde moitié du xixe siècle. C’est en 443particulier le genre de la « féérie » qui est ici visé, terme explicitement présent dans plusieurs poèmes des Illuminations, jusque dans le jeu de mots avec l’anglais fairy, qui donne son titre à un poème inspiré, selon V. Yvernault, d’un opéra de Weber, Sylvana.
Pour désigner cet excès procédant autant des effets rhéto-poétiques que de la dimension figurative des textes, Andrea Schellino propose de parler, en reprenant un terme d’André Guyaux pour l’investir d’un sens nouveau, d’un « superlativisme des Illuminations » aux divers modes de manifestation. Parmi ces modes, A. Schellino relève les adverbes intensifs (« très » dans « Phrases »), les « séries de courtes phrases verbales » (p. 43, dans « Parade »), les énumérations, les adjectifs évaluatifs (« atroce », présent dans six poèmes), la « diffusion des pluriels rares » (p. 45, « les Sodomes, – et les Solymes », dans « Nocturne vulgaire »), et les adjectifs quantifiant et totalisant (tout et ses déclinaisons, déjà repérés par J.-P. Richard à propos de la « passion rimbaldienne de la totalité5 »). Cette hyperbolisation généralisée du discours contribue à requalifier la perception du réel, mais aussi les conditions de sa saisie poétique, voire l’écriture poétique. Comme le souligne A. Schellino, « l’excès consiste dans un débordement du Moi poétique et dans un débordement de la poésie elle-même » (p. 41), et notamment de l’illusion d’un absolu poétique héritée du surnaturalisme romantique qui a réorienté la rhétorique de l’amplification vers « une démesure émotive et sentimentale » (p. 40). Le superlativisme des Illuminations est ainsi affecté d’un coefficient de déconstruction critique, qui exhibe ses effets rhétoriques et défait la poétique de la vision grandiose attendue dans l’illumination conçue comme révélation concomitante de l’intériorité du sujet et des structures intimes de l’univers. Ce serait notamment le cas de « Promontoire », où l’accumulation qui compose la seconde phrase correspond à un « dérèglement de l’énumération et des mécanismes d’expansion contrariés par de soudaines restrictions référentielles et par un “trompe-l’œil” syntaxique » (p. 46), au bénéfice « d’un va-et-vient rythmique, une instabilité de l’expression qui ne se résout pas dans une intention parodique » (p. 47), mais témoigne plutôt d’une écriture qui s’essaye.
Cette alternance de fascination et de mise à distance critique des modalités référentielles du langage ne favorise pas pour autant l’instauration 444d’un sujet lyrique fort et unifié qui aurait « seul la clef » du recueil. La deuxième partie du dossier s’efforce en effet de souligner la multiplicité des facettes et voix de l’instance énonciative, qui contribue à éclater le sujet en plusieurs figures parfois contradictoires. Yoshikazu Nakaji analyse trois de ces figures à travers les multiples « Autoportraits du poète dans les Illuminations », à savoir l’enfant, l’artiste et le génie rattachés aux trois cycles dits autobiographiques : « Enfance », « Vies » et « Jeunesse ». À ces diverses représentations du « je » répondent autant de paradigmes énonciatifs qui sont autant d’agencements poétiques de la prose : le cycle « Enfance », caractérisé par des phénomènes d’ellipses et par un jeu d’« objectivation des émotions ou subjectivation du monde inanimé » (p. 53), reproduit la perception enfantine de la réalité extérieure, tandis que les poèmes de « Vies », mettant en scène l’artiste frustré de l’insuccès de sa poésie, ont une dimension métapoétique, voire didactique, où « le poète réfléchit sur le sort de ses propres productions » (p. 60), et que « Jeunesse » intègre à son cycle cette variabilité poétique en instaurant une dynamique de l’« intermittence » (p. 63) entre énonciation exaltée qui tend vers une reconnaissance du poète en Génie (textes II et IV) et perspective déceptive, si ce n’est découragée (textes I et III). Une telle oscillation inscrit de fait la prose dans une aporie pragmatique, un « dilemme » (p. 61) comme l’écrit encore Y. Nakaji, dont chacun des termes est exacerbé dans les deux poèmes que la tradition éditoriale situe en clôture du recueil. Tantôt « Solde », à travers la voix d’un vendeur au rabais, dramatise l’impuissance d’une poésie qui ne peut être que « hors de portée des autres » (p. 61) car sublime, tantôt « Génie » maintient le « rêve de la force performative du poète et de la poésie » (p. 51), en affirmant la possibilité d’une approbation généralisée du public devant la poésie sublime. Entre l’un et l’autre, il ne s’agit pas de trancher, mais de reconnaître la coprésence de virtualités lyriques contradictoires qui engagent différentes poétiques de la prose.
Seth Whidden, à partir des notions d’« Inharmonie et enharmonie dans la poésie en prose de Rimbaud », interroge lui aussi le rapport entre l’expression subjective et la poétique de la prose, mais en déplaçant la question au niveau de la forme prose et, pour ainsi dire, de la matérialité du langage poétique. Ici, un point de philologie est nécessaire : S. Whidden emprunte la notion d’« enharmonie », qui désigne en musique la double notation d’un même son (fa dièse et sol bémol, par exemple), à 445la lettre de Rimbaud à Jules Andrieu datée du 16 avril 18746. Par-là, il entend saisir un type bien particulier d’inharmonie de la prose, à savoir une « tension fondamentale dans l’œil-oreille » (p. 69), une rupture concertée entre l’expérience visuelle du poème et son expérience auditive, entre la vue et l’ouïe, entre le son et les signifiants arbitraires qui le produisent. L’exemple canonique en serait le texte « Phrases » qui, parce qu’il apparaît à la fois, et de manière indécidable, comme « une série de phrases poétiques et un poème [en prose alinéaire] intitulé “Phrases” », ramène au premier plan sa matérialité formelle et langagière au point de se reconnaître avant tout comme « une représentation visuelle de la notion même de phrase » (p. 80), l’unité grammaticale, sémantique et phonique. Mais S. Whidden ne limite pas cette réflexion aux textes des Illuminations dont l’organisation visuelle sur la page est remarquable (« Jeunesse II – Sonnet », « Marine » et « Mouvement »). La « rupture dans l’enharmonie » (p. 75) est le propre de la poésie en prose rimbaldienne comme point où la prose, demeurée prose dans sa manifestation visuelle, devient musicalement différente d’elle-même, ce « point où la prose décolle », selon une expression heureuse empruntée à Fargue.
Les remarques de Y. Nakaji et de S. Whidden portent la prose des Illuminations au-delà du genre rhétoriquement stable du petit poème en prose. Le second semble d’ailleurs éviter l’expression « poème en prose », et parle plutôt de « poésie en prose » ou de « texte poétique rédigé en prose » (p. 79), extérieur à tout « système raisonné à partir duquel Rimbaud aurait bâti une poétique de la prose » (p. 80). Avec la prose, comme le montre Henri Scepi dans son article « “Après le Déluge” : retour sur quelques points de résistance », Rimbaud s’engage en effet dans un « recommencement de la poésie » (p. 86) tâtonnant et expérimentant diverses virtualités poétiques. Dans ce contexte, « Après le Déluge », situé en ouverture, se présente comme l’annonce de ce recommencement, qui opère un retour « aux conditions de possibilités de la littérature, dont il reprend le processus à la source » (p. 86). H. Scepi y 446repère notamment l’intertexte du « Déluge » de Vigny, convoqué moins comme un pôle signifiant que comme un point de départ pour une « réorientation de l’économie de la parole » (p. 88) : la prose de Rimbaud se situe « après » ce poème en vers des Destinées, comme dépassement de la poésie romantique de « l’Idée », dont la perspective théologico-philosophique est soutenue par une poétique du symbole et de l’image, incarnation visuelle de cette Idée. Par un travail de « reprise fantaisiste et capricieuse de certains motifs étrangement réagencés » (p. 88) et d’un « agencement en mosaïque » (p. 92) de la vision, Rimbaud s’attache à produire une écriture « désymbolisée » (p. 88) et une poésie de la naïveté libérée de l’application niaise et aliénante des procédures de signification traditionnelles, qui soumettent l’opsis à un ensemble de coordonnées rationnelles définies par avance. Il s’agit, en somme, de dégager la possibilité d’un nouveau « prisme optique », une « requalification de la relation du sujet au monde » (p. 96), qui demeure malgré tout à l’état de puissance, comme une « soif d’émancipation » (p. 98) qui fait suite à celle évoquée dans le cycle en vers de 1872 : « Comédie de la soif ».
Si la prose des Illuminations n’est plus une poésie de l’Idée, alors comment aborder la pensée de ce recueil, et en particulier la pensée politique qui habite le désir souvent réitérer d’une « nouvelle harmonie » ? Reprenant, en le réduisant, un article paru il y a cinquante ans dans Littérature7, Jean-Luc Steinmetz propose de relancer la question de la politique des Illuminations dans une perspective freudo-marxiste mettant l’accent sur la place de l’économie politique et celle de l’inscription sociale du désir dans quelques poèmes : « Après le Déluge », « Solde », « Royauté », « Démocratie », « Soir historique », « Conte », « Being Beautous » et « Génie ». L’intérêt de ces micro-lectures réside, cependant, non pas dans quelque clef interprétative qu’elles livreraient pour l’ensemble de ces textes, ni même pour chacun d’entre eux, mais dans le déplacement qu’elles opèrent dans ce que nous sommes tentés d’appeler la politicité de ces textes, c’est-à-dire leur capacité à développer, selon leurs propres modalités, un discours sur le commun et la communauté. Comme le précise J.-L. Steinmetz, « il n’est pas question de faire des Illuminations une profession de foi politique », comme « il n’est pas davantage question de rendre ce texte à une prétendue “neutralité” qu’il n’a pas » (p. 107) : il s’agit plutôt de reconnaître que la politique se joue 447ici hors des cadres discursifs du logos de la philosophie, des idéologies ou de la rhétorique politicienne, voire hors du logos lui-même, dans les formes poétiques. C’est en effet ce que laissent entendre toute la seconde partie de l’article et ses réflexions sur l’idéal harmonieux de la musique et sur le rêve d’un retour à un état primitif (celui de l’enfant ou du barbare), qui apparaissent tous deux comme un retour en amont du langage élaborant « une science d’avant la signification, non pas une linguistique ni une sémiotique, mais un art produit par des pulsions et producteur de sensations (nouvel amour) et qui sorte radicalement de l’espace représentatif » (p. 108). Une politique qui soit l’invention au présent de formes inédites, dans cet « Ici, maintenant » du poème qui donne son titre à l’article de Steinmetz.
En envisageant une « Physique des idées » dans les Illuminations, Adrien Cavallaro élargit cette intuition d’une matérialité formelle et musicale de la pensée politique à l’ensemble des énoncés « ayant trait au monde des idées » (114), qu’elles soient politiques, philosophiques, esthétiques, morales, scientifiques, etc. Il faut bien cerner l’ambition de cette proposition : A. Cavallaro entend dégager une pensée qui soit proprement poétique, c’est-à-dire une pensée qui ne se résume pas à un ensemble de propositions discursives paraphrasables dans l’économie du commentaire, mais qui relève du faire du poème. Pour cela, il met en avant les phénomènes de « figuration dynamique, toute sensorielle, de l’activité réflexive en cours » (p. 118) dont font preuve nombre de poèmes, à l’instar de « Vies I » où le sujet s’exclame : « Un envol de pigeon écarlate tonne autour de ma pensée8 ». Ces phénomènes définissent des sauts ou écarts énonciatifs, ce qu’A. Cavallaro a identifié ailleurs comme des « différences de hauteurs9 » de tons et de niveaux d’énonciations, qui participent d’un double effet. D’une part, la saisie poétique des énoncés réflexifs est inséparable d’un effet d’« anamorphose » (p. 126) du sujet, si bien que l’appréhension des idées dans les Illuminations « dépend de la compréhension des phénomènes d’adhésion et d’éloignement du locuteur » (p. 123) par rapport à ce qu’il dit. D’autre part, ces énoncés sont eux-mêmes inscrits dans le mouvement de la prose : « La pensée elle-même est en mouvement », de sorte que leurs 448propositions définissent moins la philosophie d’ensemble du sujet ou du recueil, que des « fanaux idéologiques » (p. 124) qui orientent plus qu’ils ne stabilisent la pensée. A. Cavallaro se propose ainsi de relire « Génie », poème qui, plus que tous les autres, met en scène « la mobilité d’une vertu d’incantation des utopies révolutionnaires, leur reprise oblique, plutôt que réprobatrice, et en instance de dérèglement » (p. 126).
C’est cette logique de l’obliquité, au-delà de la trop simple alternative entre adhésion naïve et distance ironique, que Steve Murphy exploite à propos de la question des utopies et dystopies. Dans son article « Rimbaud et la prose d’avenirs possibles » qui clôt le dossier, S. Murphy propose de voir dans les Illuminations et leur tendance à la futurition des évocations des « devenirs possibles » de l’humanité, des virtualités de destins appartenant au régime du « pas encore réel » (p. 133). Oblique, la prose des Illuminations l’est dans sa manière de renverser les discours utopiques en pressentiments dystopiques. Ainsi, l’idéal révolutionnaire du progrès connaît-il avec le cycle des « Ville(s) » et de leur urbanisme un retournement idéologique au service de « l’embellissement stratégique » haussmannien, du capitalisme et de la lutte des classes généralisés ou encore de l’impérialisme colonial. S. Murphy montre bien comment les images des utopies futures sont traversées et transformées par un défaitisme post-Commune, qui déjoue les polarisations binaires des luttes idéologiques. Ces phénomènes de « glissement » (p. 145) sont perceptibles par exemple dans ce qui fut longtemps identifié comme un fouriérisme et un saint-simonisme de Rimbaud, respectivement dans les invocations d’une « nouvelle harmonie » et d’un « nouveau corps » : S. Murphy rappelle en effet qu’à la même époque, le saint-simonisme ayant pris une dimension plus pratique est devenu « indissociable de la révolution bourgeoise, économique et scientiste, avec ses manifestations bancaires et industrielles », devenir que mettent en scène les Illuminations, comme dans le navire de « Mouvement » qui, de l’incarnation du rêve de progrès social, se renverse en « arche de la bourgeoisie technocrate » (p. 145). Précisons que, pour S. Murphy, le pessimisme, même s’il est omniprésent, n’est pas le dernier mot : la prose des Illuminations s’inscrit dans une oscillation constante entre espoir utopique et contestation dystopique, qui définit plutôt une « théorie du mouvement » qui informe la pensée politique du recueil.
On a sans doute trop peu insisté sur les nouveaux jalons posés par l’ensemble de ce dossier dans la critique rimbaldienne. De manière 449générale, ces neuf contributions sortent l’étude des Illuminations de clivages anciens qui avaient constitué jusqu’alors des apories interprétatives. Pour dépasser la contradiction entre recueil construit ou fragments isolés, elles proposent une herméneutique accueillant le divers et le changeant, qui se refuse d’assigner des valeurs immuables et de figer par avance une lisibilité à des schèmes formels remotivés à l’échelle de chaque poème. Pour évacuer l’opposition entre genre poème en prose et expérimentations de formes nouvelles, elles proposent la reconnaissance de proses, au pluriel, procédant d’une poétique complexe, sans fixité, ouverte à des tentatives réitérées dans chaque texte. Et pour franchir l’alternative entre énonciation sérieuse et ironie ou parodie, elles soulignent une polyphonie faite de sauts, d’écarts et de renversements jamais définitifs, une pragmatique au sens où les énoncés ne peuvent être reçus en faisant abstraction du dire et du faire dans lesquels ils prennent forme. Ce sont là des balises nouvelles pour les lectures à venir des Illuminations, qui font de ce dossier un incontournable pour la critique rimbaldienne.
Anton Hureaux
Paris 3 – CRP19
*
* *
Nathalie Diot et David Truillard, Rimbaud. Poste restante, Éditions Noires Terres, 2021.
Rassemblant photographies, documents et entretiens, ce livre prolonge le court-métrage réalisé en 2019 par Nathalie Diot et Raphaël Audaire, Poste restante – à travers l’amour de Rimbaud. À l’entrée du cimetière de Charleville, on trouve une boîte aux lettres recouverte de feuilles d’or accueillant le courrier qui continue à être envoyé à Arthur Rimbaud d’un 450peu partout dans le monde. Longtemps délivré par Michel Pion, ancien « facteur de Rimbaud », et recueilli par Bernard Colin, le gardien du cimetière, ce courrier est désormais acheminé vers le musée Rimbaud. Ce petit livre révèle l’hétéroclisme de ces lettres : on trouve des bribes de poésie, des demandes de reconnaissance ou de coup de main (durant la seconde moitié du xixe siècle, comme on le sait, les aspirants poètes avaient tendance à adresser des vers à Victor Hugo pour lui demander son approbation – que ce dernier leur accordait bien volontiers ; d’après ce que l’on sait, Rimbaud n’a pas joué le jeu de cette façon, préférant écrire à certains acteurs de la mêlée parnassienne plutôt qu’à Hugo, toujours exilé quand l’auteur de « Credoinunam » cherchait à se faire coopter : il est intrigant d’observer que de jeunes poètes confient aujourd’hui à Rimbaud cette fonction évaluatrice, ce rôle de « maître », depuis sa tombe…), des démarches médiatrices (ainsi de cette lettre d’une jeune femme homosexuelle qui n’a jamais eu l’occasion de faire son coming-out auprès de sa mère, désormais décédée, et qui écrit au poète pour le charger de transmettre un message, pour lui demander d’expliquer à la défunte qu’elle a rencontré quelqu’un et qu’elle est heureuse), des exercices bâclés par des élèves auxquels leurs professeurs de français ont imposé un devoir (du genre « écrivez à Arthur Rimbaud pour lui dire ce que vous pensez de son œuvre »), des petits mots inquiets à l’approche des épreuves du bac, des recherches de complicité (« Depuis toute jeune, ta plume et la sensibilité vive qui en découle [sic] sont des éléments d’inspiration évidents pour moi »), du mail-art, une facture d’abonnement à Télé 7 jours, un appel à contribution de l’UMP pour soutenir la candidature de Nicolas Sarkozy aux élections présidentielles, des déclarations d’amour parfois brèves (« I love you Arthur, you are the best ») et parfois suspectes (« Mon Arthur, j’ai reçu tes lettres, elles sont si belles que j’en perds mes mots. Comment puis-je te remercier d’être le centre de tes poèmes ? »).
L’ouvrage fait écho au travail mené par Adrianna Wallis et Arlette Farge sur les « lettres ordinaires » qui, faute d’adresse exacte, sont redirigées vers le centre de Libourne10. De façon générale, au vu de 451l’échantillon ici dévoilé, ce qui saute aux yeux, c’est que les auteurs et autrices de ces lettres ne connaissent pas bien les textes de Rimbaud : ils les citent peu ou de façon approximative, assument parfois ne pas les comprendre (« Je pense que ta poésie et bizarre et belle. […] Je ne comprends pas tout »), préfèrent mentionner sa « liberté » (« J’admire ta liberté, ton courage, ce que tu as pu faire sans te soucier des représailles »), sa relation avec Verlaine, sa révolte, sa jeunesse, sa beauté. Ces représentations rejoignent largement celles qui ont contribué à la transformation du poète en icône : de la BeatGeneration à Patti Smith, Rimbaud a été volontiers naturalisé en « jeune poète rebelle ». On pourrait pourtant croire que cette figure s’est aujourd’hui estompée : s’il était un passant considérable de l’univers du rock, souvent cité ou évoqué, le poète n’a plus exactement la même aura pour la scène rap, qui a pris le dessus en matière d’espace culturel insurrectionnel de la jeunesse et où il n’est que rarement mentionné (quasiment toujours en tant que classique). Si les lettres donnent à voir une certaine survivance de cet imaginaire de la révolte, elles montrent aussi que la découverte du poète est liée à l’école : certaines évoquent des souvenirs d’un cours marquant qui avait éclairé l’horizon, d’autres soulignent que le portrait étudié en classe était trompeur et bien aseptisé. C’est un florilège éloquent en termes de réceptions et d’usages de Rimbaud, de métamorphoses de ce qu’Etiemble appelait son « mythe » : le travail précurseur d’Etiemble était consacré aux récupérations de Rimbaud, aux positions qu’on lui faisait prendre en particulier sur les plans politique et spirituel, mais ce qui se donne à voir ici, c’est une mosaïque des rôles imaginaires qui sont associés au poète aujourd’hui. Des milliers de personnes n’envoient pas de lettres à Arthur Rimbaud, mais il faut convenir que celles et ceux qui le 452font sont plus nombreux que les spécialistes qui étudient son œuvre. De même, sur un célèbre réseau social, il existe désormais un groupe d’admirateurs de Rimbaud qui rassemble plus de 2500 membres et sur lequel des gens postent des photos de leurs dessins du poète, de leurs promenades à Charleville, de statues du poète ou des couvertures de fanfictions publiées à compte d’auteur, et sur lequel ils donnent aussi leur interprétation très personnelle de tel extrait, soulèvent des problèmes existentiels que Rimbaud les aurait aidé à résoudre, débattent des qualités de telle biographie, se disputent parce que tel membre a reposté un montage ou une image générée par une intelligence artificielle en pensant qu’il s’agissait d’un document original, etc. Ces témoignages d’admiration peuvent sembler triviaux : il me semble qu’il serait pourtant bon de les appréhender de façon plus systématique, d’interroger ce qu’ils impliquent et produisent d’un point de vue anthropologique, parce que ces réceptions, usages et pratiques révèlent l’imaginaire social associé au poète et, au-delà de son cas, sont significatifs en ce qui concerne les rôles et valeurs qu’on attribue aujourd’hui à la littérature.
Denis Saint-Amand
FNRS – UNamur, NaLTT
*
* *
Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, préface de Yannick Haenel, postface de Grégoire Beurier, Paris, éditions Gallimard, coll. « Poésie », 2023.
Cette nouveauté, estampillée « Édition Anniversaire », propose un texte sans notes. On ne souhaite pas au lecteur ouvrant pour la première fois Une saison en enfer, si tel est bien le public visé, de le lire dans une de ces éditions bardées de notes, aussi utiles soient-elles pour le lecteur en quête d’approfondissements. Quelle meilleure expérience initiale 453de lecture, probablement, qu’un affrontement à mains nues avec le texte de Rimbaud ! Quelques notes auraient cependant été nécessaires, notamment lorsque le texte de l’édition originale n’est pas sûr et que l’éditeur a dû choisir entre plusieurs options possibles.
La mise en page rigoureusement conforme à celle de la plaquette de 1873, la séparation des diverses proses par une à trois pages blanches, comme dans l’originale, distinguent plus qu’honorablement cette Saison en enfer, au sein d’une offre éditoriale pléthorique. C’est dans la « Postface » confiée à Grégoire Beurier (troisième partie intitulée « Les pages blanches ») qu’on trouve, pédagogiquement exposée et impeccablement argumentée, la justification de cette heureuse initiative : « Les éditions modernes d’Une saison en enfer devraient garder ces pages blanches comme autant d’espaces où respire Rimbaud ». On ne peut qu’approuver. Pour cette fidélité à l’édition originale, comme pour l’analyse précise de ses particularités, ce volume fera date et il faut l’avoir dans sa bibliothèque.
Grégoire Beurier défend de façon assez convaincante l’hypothèse faisant de Rimbaud l’instigateur des pages blanches. Certaines étrangetés de la plaquette de 1873, explique-t-il, donnent l’impression d’une réalisation à moindre coût : aucune page de garde ni de titre ni de faux titre n’a été ménagée en tête d’ouvrage, une « construction en cahiers inégaux, de six ou de huit feuillets, par encartage », l’obligation d’adjoindre en fin de volume un feuillet orphelin, « collé sur le feuillet précédent par sa marge inférieure ». Mais la présence des dix-sept pages blanches intercalaires (pour trente-six pages imprimées) plaide dans le sens opposé. La seule explication possible, selon lui, c’est une demande expresse de Rimbaud destinée à introduire des pauses dans son ouvrage, une respiration « face à cette “peur de l’étouffement” qu’a relevée Yves Bonnefoy ».
La première partie de cette « Postface » offre les éléments de base sur le peu que nous savons en ce qui concerne la genèse de l’œuvre, mais sans pousser la réflexion sur les différentes étapes possibles de sa rédaction, ce qui réduit à peu de choses l’idée de progression exhibée par le titre « Du Livre païen à Une saison en enfer ».
Autre réserve. On ne peut plus guère écrire aujourd’hui des phrases comme celle-ci, page 76 : « Il achève d’écrire dans le bruit et la fureur le “livre païen” commencé cinq mois plus tôt dans le même grenier […] ». Ce genre d’évocation, fondé sur le seul témoignage d’Isabelle, dont on sait jusqu’où elle a été capable d’aller pour reconstruire à son goût moralisateur 454l’itinéraire de son frère, met beaucoup trop en valeur dans Une saison en enfer son aspect de journal de crise noté sur le vif au détriment du travail proprement littéraire, commencé bien avant la tragique dispute de juillet 1873.
La seconde partie, « Les brouillons d’Une saison en enfer », offre une information substantielle. Ces ébauches, souligne l’auteur, sont un des rares témoignages que nous ayons du travail de Rimbaud sur ses textes. Il en mentionne les traces (ajouts, ratures, plus de soixante-dix surcharges) et conclut à un mouvement de condensation suivi par l’écriture, entre ces brouillons et le texte imprimé. Trop conventionnellement, cependant, l’auteur attribue l’impression de chaos intérieur se dégageant de ces pages à l’intensité de la « crise spirituelle » vécue par Rimbaud. L’exposé aurait gagné à mentionner, par souci d’objectivité, l’autre explication possible du style propre à la Saison : la recherche littéraire d’expressivité, au service d’une fiction infernale. Car Une saison en enfer n’est pas seulement un témoignage intime, Rimbaud y fait aussi œuvre de « conteur », comme il se désigne lui-même dans « Adieu ».
Écrivain lui-même, l’essayiste et romancier Yannick Haenel, auteur de la préface, date de sa lecture de Rimbaud la naissance de sa vocation. Ce sont les mots « en feu » de Rimbaud, découverts à seize ans, qu’il cherche à rejoindre en écrivant des livres : « en vivant la littérature comme une aventure passionnée –, je cherche à rester fidèle à ce feu. » Il avertit le jeune lecteur du danger qu’il y a à ouvrir ce livre, sa vie va s’enflammer, il va « rouler dans un feu d’extases ». Il lui promet « une expérience initiatique ».
C’est donc sous le signe du feu, mais aussi sous l’angle de la magie et de l’absolu, que Yannick Haenel vit sa passion pour Rimbaud. Son « texte ardent relève de la magie ». « Alchimie du verbe » contient les plus belles phrases jamais écrites en français : « ce qui s’y déploie, avec la limpidité d’un feu clair, c’est le programme de l’aventure absolue, celle de la “magique étude” qui fait de vous un poète dans l’âme ».
Tel son modèle, le préfacier aime à prophétiser. Des apocalypses politiques et spirituelles. Le feu Rimbaud fait voler en éclats « tous les carcans » de la société. « Sa férocité considère comme minable et périmé ce qui n’est pas à la hauteur de l’absolu qui l’anime ». « Le langage va s’éteindre comme les autres espèces car la société s’emploie à le détruire, comme elle s’emploie à détruire notre âme. » Cependant, il nous rassure, en imaginant un Rimbaud « pas exactement » chrétien, mais qui a trouvé avec « la charité » la clef de « l’amour absolu ».
455Faut-il vraiment, pour répondre à l’appel de Rimbaud, tant d’« absolu », tant de « métaphysique », tant de « magie » et tant d’« expérience initiatique », tant d’« âme » et tant de « charité »… tant de surnaturel, en somme ? « La nature pourrait s’ennuyer peut-être ! », plaisante le narrateur d’Une saison en enfer dans « L’Impossible ». Cette préface montre un goût prononcé pour la métaphysique et oriente vraiment à sens unique la lecture d’Une saison en enfer : « Le langage est le seul lieu qui peut échapper au ravage parce que, comme l’amour, il est métaphysique. »
Alain Bardel
*
* *
Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, 1873, et autres poèmes. Photographies, écrits, dessins de Patti Smith, Gallimard, 2023.
Si c’était un « dictionnaire amoureux », ce serait une encyclopédie. Tout y est. Une saison en enfer, vingt poèmes, neuf lettres de Rimbaud aux siens. Six textes de l’autrice, fort bien tournés. De beaux dessins de Rimbaud par Patti Smith. Un choix de glanes parmi les reliques traditionnelles et les lieux de pèlerinage. En vis-à-vis des textes, des illustrations, parfois naïves, mais souvent porteuses de sens. On ne peut pas aimer Rimbaud et rester insensible à cet exercice d’admiration, au fond modeste.
Ce n’est pas un monument, ce sont des photos qu’on accroche, des cartes postales gardées dans un tiroir, un souvenir de Roche dans les Ardennes, de simples associations d’idées. Un musée imaginaire et intime… Qu’on livre au grand public, bien sûr, parce qu’on est Patti Smith. Mais Patti Smith n’a pas attendu d’être ce qu’elle est pour aimer Rimbaud et marcher sur ses traces, quitter la maison familiale, partir, les poches vides, vers la très grande ville, avec Une saison en enfer comme 456viatique pour s’orienter dans l’underground new-yorkais des années soixante-dix, écrire des poèmes, chanter.
Son texte « Anniversary » raconte son premier voyage à Charleville-Mézières, à 26 ans, à l’approche du centenaire de la publication d’Une saison en enfer : les hôtels bon marché, les buveurs de bière du Rimbaud bar, l’indifférence à l’anniversaire, la tombe à l’abandon, le sentiment d’avoir accompli malgré tout sa « mission solitaire » en glissant au fond de l’urne des perles bleues du Harar.
« The Gun » (tous les titres ont été conservés en anglais) narre par le menu les événements du 16 juillet 1873. « La providence a voulu », dit Patti Smith, qu’elle assiste à la présentation du révolver de Verlaine, le 8 août 2014, à la Bibliothèque royale de Bruxelles. Suivent, en vis-à-vis des vers correspondants de « Voyelles », cinq reproductions de la même photo du fameux révolver, sur des fonds successivement gris, blanc, rouge, vert et violet.
« Black Book », le livre noir, c’est, bien sûr, Une saison en enfer. Trois pages sur la genèse du livre, fort bien informées, mais un peu trop marquées par l’approche mythique traditionnelle.PattiSmith a placé sur la page de gauche, en face du début du texte, la représentation photographique d’un œuf, symbole choisi pour évoquer, en grand style lyrique, l’éclosion de l’œuvre géniale :
Il s’enferme dans le grenier. La fine coquille qui recouvre son lobe introspectif se fend, laissant jaillir des ruisseaux de magma rouge et or, qui refroidit et durcit dans la noirceur de messages cryptés. Alors que ses frères et sœurs récoltent le maïs, Arthur récolte son essence même, pénètre dans sa cage thoracique et en extrait son cœur brûlant.
Suivent la gravure connue représentant la maison familiale de Roche, les fac-similés BnF des trois ébauches connues, puis le texte d’Une saison en enfer, illustré par de nombreuses croix latines, avec ou sans crucifié ; une statue de Jeanne d’Arc, lorsque le narrateur de « Mauvais sang » pardonne à ses bourreaux, comme la Sainte ; une photo de microscope quand il est question de la science dans le texte et, en vis-à-vis de la dernière page : le révolver, de nouveau.
Le texte « Tom Thumb’s Blues Revisited » introduit le choix de poèmes offert dans l’ouvrage, en tête desquels Patti Smith a placé « Ma Bohême ». Il existe entre plusieurs de sa génération et Rimbaud, dit 457Patti Smith, « une sorte de filiation spirituelle » sous le signe de « Ma Bohême », influence qui se reconnaît notamment dans « l’amertume ironique » de la chanson de Bob Dylan « Just like Tom Thumb’s Blues ». Les poèmes ne sont pas classés par ordre chronologique. Certaines illustrations sont particulièrement parlantes : « Soleil et Chair », par exemple, fait face à une photo du cimetière du Montparnasse, probablement dû à l’autrice elle-même (elle affectionne ce sujet). On y voit, au premier plan, une réplique de la statue de Canova « Psyché ranimée par le baiser de l’Amour » et, au second, dominant la scène, une gigantesque croix latine. « Les Premières Communions » sont illustrées successivement par la fameuse photo d’Arthur et Frédéric en premiers communiants, très symboliquement déchirée de haut en bas entre les deux frères, et par une beaucoup moins surprenante couronne de marguerites, old fashion.
Les deux derniers textes, « Mortal shoes » et « À Venir », évoquent respectivement les voyages de Rimbaud et son legs spirituel. Les premiers sont évoqués dans les termes les plus épiques. On apprend, entre autres choses, que Rimbaud « s’engagea dans une bande carliste avant de déserter », qu’au printemps de 1876, revenant de Vienne jusqu’à Charleville en passant par Strasbourg, il « couvrit près de trois cents kilomètres à pied », qu’embarqué dans un navire mouillé près de Sainte-Hélène, « il tenta de rejoindre à la nage l’île rocailleuse ». Avec Rimbaud, on n’a pas fini de s’étonner. Enfin, après avoir parcouru « quarante-huit mille kilomètres », Rimbaud mourra à Marseille et « les cendres de son expérience seront dispersées sur le littoral marseillais. » Quant au legs spirituel de Rimbaud, Patti Smith nous invite à le trouver dans « Génie », ce poème des Illuminations dans lequel il imagina « un messie séculier, prince de la polyvalence, “toutes choses pour tous” ». Citons entièrement sa belle conclusion :
Avec un langage quasi prophétique, le poète y exposait sa vision pour l’Humanité, main tendue vers le futur. Il offrait ce « Génie » comme une ouverture spirituelle englobant l’Histoire, son présent et ce qui reste à venir.
Alain Bardel
458*
* *
Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, fac-similé, Alain Oriol, Toulouse, 2023 (pour toutes informations sur ce livre, voir à l’adresse : http://abardel.free.fr/la_saison_a_150_ans.htm).
S’il est un livre qui a fait couler beaucoup d’encre, à commencer par celle de son auteur au vu des trois brouillons de travail très raturés qui nous restent, c’est bien Une saison en enfer. Outre l’interprétation d’un texte difficile qui est toujours un défi lancé à son lecteur, et avant même d’entrer dans sa lecture, les problèmes engendrés par la Saison commencent dès son support textuel. Le livre publié par un imprimeur bruxellois du nom de Poot en 1873 n’est pas, en effet, sans étonner voire déconcerter sur plusieurs points : absence des habituelles pages préliminaires après la couverture, pages blanches en nombre intercalées dans le texte, quelques coquilles grossières, absence de table des matières, etc. Une plaquette de 54 pages qui avant même de se lire, se regarde, s’observe, se scrute, pose une foule de questions, questions d’autant plus importantes que leurs réponses déterminent en partie la compréhension du texte. Seul livre jamais fait imprimer par Rimbaud lui-même, l’édition originale d’Une saison en enfer est incontournable puisque le Manuscrit définitif à partir duquel a été réalisée cette plaquette pas plus que d’éventuelles épreuves d’imprimerie ne nous sont parvenus.
Une édition fac-similaire avait déjà été tentée dans les années 1990 par les éditions Arléa, entreprise tout à fait louable mais qui comportait encore quelques inexactitudes – nous n’étions pas alors encore entrés dans l’ère numérique… L’essor des nouvelles technologies à l’aube du xxie siècle a permis de mettre en ligne, sur le site internet Gallica, une version numérisée de l’exemplaire de l’édition originale détenu par la BnF. Mais cette édition « dématérialisée » n’est pas toujours très pratique à étudier. Avec l’édition fac-similaire publiée par Alain Bardel et Alain Oriol, assistés de deux professionnels de l’édition, c’est bien la sensation d’avoir entre les mains « l’originale » d’Une saison en enfer qu’on éprouve, livre qu’on n’ouvre pas, de fait, sans une certaine émotion. Là encore, 459c’est un exemplaire de l’édition originale de 1873 qui a été numérisé, reproduction qui a ensuite fait l’objet d’un travail spécifique répondant au souhait des éditeurs de réaliser un livre « papier » identique à « l’originale ». Il a fallu toiletter les reproductions des pages (taches, etc.), mettre en pages le volume – travail beaucoup plus délicat qu’on ne le pense, notamment concernant la première de couverture (ou premier plat) – et trouver un papier le plus proche possible de celui choisi par Poot à l’époque (grammage et teinte).
Excellente initiative et impeccable réussite, cette édition fac-similaire, qu’on pourrait presque considérer comme une réimpression d’Une saison en enfer, ravira les aficionados de l’écrivain tout comme elle sera très utile aux chercheurs qui analysent au plus près son œuvre. Il s’agit assurément de l’un des plus beaux hommages rendus à Rimbaud et à sa légendaire plaquette pour la célébration du 150e anniversaire de sa publication.
Christophe Bataillé
*
* *
Alain Bardel, Une saison en enfer, ou Rimbaud l’introuvable, Presses Universitaires du Midi, 2023.
Alain Bardel est connu des rimbaldiens avant tout pour « Arthur Rimbaud, le poète », un site sur lequel des ressources portant sur les poèmes de Rimbaud sont publiées depuis 2001, dont une anthologie commentée et réactualisée de ses poèmes. L’essai, paru à la fin de l’année 2023, est un commentaire suivi d’Une Saison en enfer, proche dans la forme des ouvrages de référence de Yoshikazu Nakaji et de Yann Frémy. L’explication des neuf séquences du recueil est augmentée d’une double 460ouverture sur la vie de Rimbaud et sur le statut générique de la Saison ainsi que d’une conclusion sur sa postérité, des prémices du « mythe » au « rimbaldisme ». Ce qui en ressort est un panorama des enjeux du texte, intéressant comme premier contact.
Bardel réduit au maximum le nombre de renvois, adoptant le parti pris de la lecture personnelle. À côté des quelques mentions, des voix « les plus autorisées », on comprend que l’auteur connaît la critique. Il signale par exemple dans une analyse du mutisme de « Matin » l’émergence de traités de psychiatrie au xixe siècle, qui semble évoquer les travaux de Renaud Lejosne-Guigon sur la constitution d’une poétique de la folie médiatisée par le discours médical. Bardel veut « lire pour ce qu’elle est » une Saison dont on sait la réception pavée d’idéologies et d’appropriations : le soupçon depuis la grande étude d’Étiemble se répercute dans l’essai sur tout cadre d’analyse. De l’ensemble se laisse pourtant déduire qu’une certaine sociocritique et le biographisme sont ses principales tendances théoriques.
Le close-reading suivant « pas-à-pas » les séquences du récit met à l’avant-plan la dimension narrative du texte et permet de s’arrêter à sa fabrique. Mais Bardel se demande si la déroute de la lecture dans « Mauvais sang » ne vient pas de l’absence de linéarité, ses sept sections prenant « l’apparence de fondus enchaînés narratifs ». Si certains fragments sont réfractaires au cadre narratif, c’est dire que la méthode généralement acceptée du commentaire linéaire n’est pas sans conséquence sur la compréhension du recueil, voire qu’elle pourrait interférer avec la conception présupposée de sa lisibilité.
Cette méthode n’empêche pas l’auteur d’établir des parallèles avec d’autres textes tirés du recueil, de ce qu’on pourrait appeler l’« œuvre » de Rimbaud ou du discours social, ou encore de situer les séquences dans la biographie. Bardel s’interroge sur la légitimité du biographisme, critiqué non seulement en théorie mais aussi chez des rimbaldiens tels Steve Murphy. Il découpe dans le recueil des séquences qu’il situe sur un spectre en fonction de leur nature plus ou moins autobiographique pour légitimer in texto son usage ; « Nuit de l’enfer » marquerait le passage à la fiction. D’un point de vue général, cette approche pseudo-mimétique est taillée sur mesure : « La Saison n’est pas une autobiographie. Mais elle contient beaucoup d’autobiographique. »
461Au moins deux idées ont une force structurante. La première est que la révolution poétique de Rimbaud n’est pas seulement formelle, mais aussi épistémologique (« la poésie est un instrument de connaissance ») et pragmatique (elle permettrait de « vivre en poète »). La seconde est que le texte est souvent tiraillé entre le « pôle dysphorique caractérisé par la religion » et le « pôle euphorique, marqué par la présence heureuse de la nature, l’innocence, l’exaltation de la vitalité physique ».
L’essai de Bardel est une lecture personnelle et suivie d’Une Saison en enfer, mais dont le « corps-à-corps herméneutique avec le texte » embrasse la société d’après la guerre franco-prussienne, la production et la vie de Rimbaud. Son but n’est manifestement pas d’examiner des approches à la mode ou des thèmes inédits, même si une atmosphère théorique le baigne. L’élargissement du principe des micro-lectures à des chapitres de contextualisation assez généraux témoigne du désir d’en faire un livre d’introduction à l’usage du plus grand nombre.
Mendel Péladeau-Houle
1 Adrien Cavallaro, Rimbaud et le rimbaldisme. xixe-xxe siècles, Paris, Hermann, 2019.
2 Alain Vaillant, Baudelaire poète comique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007.
3 Pourrait-on dire en inversant une formule de Francis Ponge, dans Pour un Malherbe : « C’est [Malherbe] le dictionnaire en ordre de fonctionnement » (Francis Ponge, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, t. 2, 2002, p. 18).
4 Jean-Luc Steinmetz, « La lanterne magique de Rimbaud », dans Rimbaud ou « la liberté libre », Parade sauvage, Colloque no 1, 1987, p. 97-108.
5 Jean-Pierre Richard, « Rimbaud ou la poésie du devenir », dans Poésie et profondeur, Paris, Seuil, « Points », 2015, p. 289.
6 Rimbaud y évoque « l’enharmonie des fatalités populaires ». Sur cette lettre retrouvée récemment, voir l’article de Frédéric Thomas dans Parade sauvage : Frédéric Thomas, « “Je serai libre d’aller mystiquement, ou vulgairement, ou savamment”. Découverte d’une lettre d’Arthur Rimbaud », Parade sauvage, no 29, 2018, p. 321-346. Voir aussi la lecture qu’en propose Adrien Cavallaro dans : Adrien Cavallaro, « L’histoire en morceaux. Sur la lettre du 16 avril 1874 de Rimbaud à Jules Andrieu », Revue de langue et littérature française, no 55, 2022, p. 511-527.
7 Jean-Luc Steinmetz, « Ici, maintenant, les Illuminations », Littérature, no 11, 1973, p. 22-45.
8 Arthur Rimbaud, Œuvres complètes, éd. André Guyaux, Paris, Gallimard, « La Pléiade », p. 295.
9 Adrien Cavallaro, « Les Illuminations en hauteur », dans Les Saisons de Rimbaud (collectif), Paris, Hermann, 2021, p. 281-302.
10 Adriana Wallis et Arlette Farge, Lettres ordinaires, Manuella éditions, 2023. Au sein de ce corpus, on trouve des lettres de détenus, d’enfants, d’amants éconduits, de personnes souhaitant se défouler et d’autres imaginant une possible réconciliation ; les adresses sont tantôt manquantes, tantôt incorrectes, parfois fantaisistes, parfois métaphoriques. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le signaler (voir « Rumeur latérale et griffonnages », dans Les Écrits sauvages de la contestation, Fabula – Le fond de l’air, 2023, URL : https://www.fabula.org/colloques/document9556.php, consulté le 15 août 2023), je ne suis pas certain que l’adjectif ordinaire permette de désigner ce qui se joue dans ces dispositifs d’écriture si hétérogènes : l’opposition « écritures ordinaires » vs « écritures littéraires » a été théorisée par Daniel Fabre, dont il faut par ailleurs souligner l’apport majeur dans le domaine des études sur la littératie, mais elle me paraît dessiner une opposition trop nette, en sous-estimant la capacité des premières à exploiter des procédés poético-rhétoriques et à organiser des dispositifs de lecture complexes et en surestimant « l’exercice scrupuleux du “bon usage” » dont feraient preuve les secondes et « la sacralisation qui, peu ou prou, accompagne depuis deux siècles la mise à distance littéraire » (Daniel Fabre (dir.), Écritures ordinaires, Paris, P.O.L, 1993, p. 11).