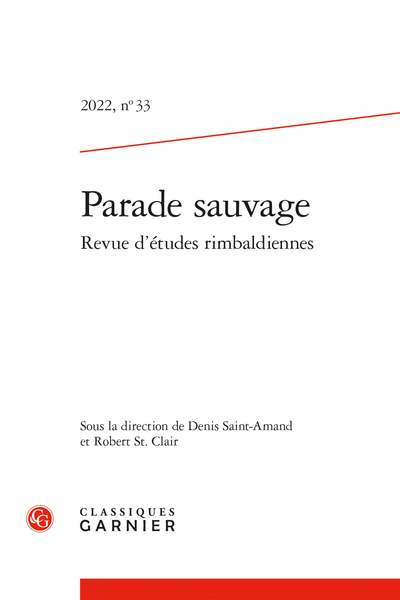
Book reviews
- Publication type: Journal article
- Journal: Parade sauvage Revue d’études rimbaldiennes
2022, n° 33. varia - Author: Ascione (Marc)
- Pages: 363 to 368
- Journal: Parade sauvage (Wild Parade)
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406146322
- ISBN: 978-2-406-14632-2
- ISSN: 2262-2268
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-14632-2.p.0363
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 03-15-2023
- Periodicity: Annual
- Language: French
Michel Arouimi, Rimbaud rusalème ou le Nombre décrypté (Hermann, 2021).
Michel Arouimi, dont on sait la place tenue par Rimbaud dans son œuvre (de critique comme d’écrivain), a marqué d’un nouveau jalon sa réflexion sur le « Voyant » de Charleville. Après Rimbaud sur d’autres horizons, Claudel et Maeterlinck dramaturges voyants (L’Harmattan, septembre 2020), où il se penchait sur les productions de ces « autres horribles travailleurs » (dont la « lettre du Voyant » prédisait : « Ils commenceront par les horizons où l’autre s’est affaissé »), l’auteur s’appuie cette fois sur un passage de la même lettre : « Toujours pleins du Nombre et de l’Harmonie, ces poèmes seront faits pour rester. – Au fond, ce serait encore un peu la Poésie grecque. »
Le livre prend au sérieux cette expression numérique (traditionnelle, mais revigorée dans un contexte qui oppose les « versificateurs » pour lesquels « musique et rimes sont jeux » à la prestigieuse Grèce) des qualités de rythme, de mesure, bref de musicalité propres à la parole poétique. Pour Michel Arouimi, le Nombre n’est pas seulement à ressentir subjectivement dans la prosodie, mais encore à « décrypter », donc à extraire objectivement des textes, leurs caractéristiques formelles constituant aussi un message. Inscrit en filigrane, ce message indiquerait l’attraction exercée sur le Voyant, malgré toute son ironie irréligieuse, par le sacré et sa révélation par ce qui, dans les Écritures, est révélation par excellence. L’auteur est depuis longtemps familier de l’Apocalypse, de sa résonance chez les créateurs (L’Apocalypse sur scène, L’Harmattan, 2002, Les Apocalypses secrètes, L’Harmattan, 2007) et de ses « anamorphoses » dans leurs œuvres.
Comment passe-t-on de la recherche prométhéenne (certes non dépourvue de messianisme) du « voleur de feu », à une intériorisation de ce que l’auteur appelle « mythe biblique », à une absorption par celui-ci du poète-prophète ? Pour entrer dans la logique (métaphysique) de l’auteur, on peut se représenter les choses ainsi : émotions et sensations étant formulables par le découpage de leur continuum en unités, pour ainsi dire leur numérisation linguistique, « résumant tout » à « de la 364pensée », (et transposables d’un système à un autre par la traduction : l’auteur mentionne le poète et théoricien du langage Henri Meschonnic), alors la mesure de ces unités elles-mêmes (de ces Uns) et de leurs caractéristiques (on pense aux caractères de Leibniz), devrait nous conduire non à l’unité du sensible (déjà donné avec ses nuances par les modulations du « Nombre »), mais à l’Un de l’intelligible, au Nombre des nombres, monade des monades numérisées, Mesure et Raison uniques.
On devine que Michel Arouimi doit s’attarder spécialement sur À une raison au troublant article indéfini, inattendu, voire ir-rationnel. L’analyse de ce poème (p. 119-150) est en effet la plus fouillée, parmi une vingtaine de textes examinés. On devine aussi, aux références claudéliennes ou maeterlinckiennes, que pour l’auteur (qui renvoie également à André Thisse, cf.Rimbaud devant Dieu Corti, 1975) le produit de la distillation des nombres et des mesures, « le Nombre », ne peut être que d’essence religieuse. C’est également le cas : l’intrigant « rusalème », issu d’un calembour de Rimbaud, dans sa lettre à Ilg du 20 décembre 1889 (où, évoquant les pérégrinations d’un neveu rusé de Ménélik attendu de pied ferme et « factures déployées », le toujours malicieux « voyant » écrit : « […] il doit se trouver à présent à Jérusalem. Je rusalème à le croire »), est pour le commentateur un déclencheur et une confirmation de l’intuition qui lui fait rechercher dans les textes de Rimbaud « un thème caché dans le thème », selon le mot d’Aragon, – et, se dégageant de l’usage poétique du Nombre, surplombant « les applications de calcul et les sauts d’harmonie inouïs » (Solde) de la virtuosité littéraire, « le Nombre » révélé.
Comme le « Voyant » se plaît à en imaginer l’accident pour les « rimes » et « hémistiches » de Racine, le jeu de mots « brouille » les catégories linguistiques et « souffle » sur la segmentation et ses mesures. C’est justement dans cette réorganisation impromptue du verbe que le critique voit (p. 214) « un reflet spontané […] du schéma qui inspire l’esprit et les formes » du texte, final (et tardivement admis dans le « canon »), du Nouveau Testament, L’Apocalypse de Jean, où il est notoirement question de Jérusalem, la Jérusalem céleste opposée à la Rome de « la bête », présente à plus d’une reprise chez Rimbaud dans la période littéraire. Et la permanence d’un projet. La résurgence, dans une lettre tardive, de Jérusalem, est pour Michel Arouimi l’indice, mis en avant dans le titre de son ouvrage, « non pas du rejet du sacré chez Rimbaud mais de son rapport passionnel avec lui » (p. 10) :
365Deux niveaux, donc, d’opérations numériques : le premier relevant de la magie des mots, l’alchimie du verbe ; le second se rapportant au sacré, au Verbe. Michel Arouimi, dans les premiers chapitres (« La Tranche de la Bible », « Autres couleurs du “Voyant” »), s’attache aux « détails chromatiques », à l’emploi des couleurs, si typique de l’auteur de « Voyelles »(et à la source d’une systématisation célèbre, celle de Jacques Gengoux…), avant d’en venir progressivement au chiffre, qu’il soit explicite et en toutes lettres ou implicite dans la forme du texte : la répartition des répétitions, du lexique, des catégories grammaticales, la disposition typographique, et jusqu’à la ponctuation (« la ligne de vingt-quatre points avant le dernier alinéa de “Veillées III” », p. 46). Le « comptage », la « mesure », l’« arpentage » du texte, selon le terme de l’auteur, fait signe vers le Nombre de L’Apocalypse. En fait vers ses nombres : car si le chiffre de la Bête est 666, six, mais sept aussi (et les nombres construits sur eux), ont un statut particulier. Dans son analyse de « Nocturnevulgaire », l’auteur précise, devant ce qui paraît une hésitation du système : « Cette ambiguïté évoque le rapport symbolique des nombres 6 et 7 dans l’Apocalypse : 7 exprime une plénitude […] ; de même pour les multiples de 6 (avec les “vingt-quatre vieillards” […] et les douze portes de la Jérusalem sainte [ou les 144 coudées de sa muraille]. Mais la dualité la moins pacifique trouve son chiffre dans le nombre de la bête, 666… » (p. 60) Limites de l’identification numérique stricte ? On songe à la prise en compte in extremis dans une lecture apocalyptique de Voyelles par le poète et joueur d’échecs émérite Cosme Olvera (lecture relatée dans le livre de Guillaume Meurice Cosme, Flammarion, 2018) d’un ultime tiret, et non précédé d’espace, pour obtenir les 666 caractères fatidiques pour le sonnet… manuscrit.
Mais l’exactitude peut-elle être davantage attendue de la numérologie que de la graphologie, qui incluent une marge, le lapsus (calami : Michel Arouimi emploie pour sa part « la plume de Rimbaud »), – lapsus immanquablement révélateur ou rusalème ? Et il n’en est pas moins vrai que Rimbaud compte beaucoup (voir le chapitre « Compter sans compter ») : les « dix mois de la nuit rouge », les « trois prières à Demeny », les « cent ou cent cinquante hexamètres », sans compter les « trente-six millions de caniches nouveau-nés » rapportés par Delahaye ou les « soixante-treize administrations à casquette de plomb », bien sûr son âge (à une unité par excès), et « à commencer par le temps » (« À 366une raison ») : de « la suite à six minutes » ou des « sept mois » sans « un seul rond de bronze » le 15 mai 1871… ramenés « six mois » le 10 juin, au même destinataire ! Après avoir observé les « doublets lexicaux » dans « Veillées », l’auteur note aussi : « Cette fluctuation entre douze en quatorze termes […] renouvelle un phénomène […] dont l’existence dans le texte de l’Apocalypse […] est révélée par le fréquence du nombre sept et par quelques multiples de six », poursuivant : « Le problème, chez Rimbaud (comme dans l’Apocalypse ?) est moins l’existence de ce phénomène que ses limites, difficiles à situer ». Attribuer une valeur propre au nombre, n’est-ce pas élargir au maximum le rapport symbolique, qualitatif, puisque tout se compte (même le dieu unique), mais en sacrifiant la fixité de sa valeur quantitative de repère sur une échelle uniforme ?
Dans son « travail […] obstiné, mystérieux » (pour paraphraser la lettre à Demeny d’août 1871) d’« arpentage », Michel Arouimi répond-il autrement que « par le silence aux questions, aux apostrophes grossières et méchantes » qui pourraient le trouver « infâme, inepte » ? Oui, et les attentes du lecteur, son possible scepticisme, restent bien présents à l’esprit de l’auteur : « Un lecteur […] pourrait me soupçonner de ne pratiquer que les pistes favorables […] » (p. 60) ; « Le lecteur risque de grimacer[…] » (p. 212) ; citons encore « l’analyse lasserait le lecteur » (p. 169), ou dans le comptage du son [O] dans « À une raison » : « Tirons les “hommes” par les cheveux : l’assonance de ce mot avec […] “commence[r]” permet d’isoler six mots dans cette série de douze. » (p. 144) Et Michel Arouimi de se référer par deux fois (p. 49 et 169) à la savoureuse mise en garde du Voyant, qui suit la moquerie de l’académicien « fossile » voulant « parfaire un dictionnaire » : « Des faibles se mettraient à penser sur la première lettre de l’alphabet, qui pourraient vite ruer dans la folie1 ! »
367Outre la vaste culture de l’auteur (l’Annexe consacrée au Sylphe et maintes références pertinentes à Hugo, p. 87-101 ; la mention, bien sûr, de La Poésie des nombres de Vigny, p. 51 ; la connaissance de textes de la kabbale comme le Sefer Yestra, p. 138-148, entre autres), et au-delà des certitudes, plus nuancées que le sous-titre le Nombre décrypté peut le faire croire (l’auteur dit n’avoir « jamais adhéré » aux « approches inspirées par un credo occultiste supposé être celui de Rimbaud » et trouve la « méfiance » du « goguenard Étiemble2 » « parfois justifiée », p. 151 ; « [s]a conclusion » d’une étude envisagée des « lettres du Rimbaud trafiquant » « n’aurait pas été que Rimbaud ait tardivement penché vers le sacré », p. 218), l’apport de Rimbaud rusalème nous semble être le rappel de « l’analogie de l’écriture de Rimbaud avec les écrits sacrés » (p. 32) L’arpentage auquel l’auteur se livre à la recherche d’anamorphoses possibles fait apparaître (par exemple, pour le motif, lancinant dans les Illuminations, des « bêtes » : « féroces », « de songe », « fabuleuses », « de luxe », « les plus étonnantes », « belles bêtes »), les éléments disséminés d’un puzzle que les multiples défis lancés par Rimbaud à la sagacité du lecteur invitent à tenter de reconstituer. Or parmi ces éléments, qui restent à mettre en relation, figurent, notamment à partir de « Voyelles », quantité de métaphores et de motifs architecturaux, théâtraux, picturaux, musicaux, scientifiques (calculs, rythmes, harmonie, inharmonie, élévations harmoniques et sauts d’harmonie, etc.), mais aussi d’allusions mythologiques, bibliques, philosophiques, théologiques, – sans oublier les « voyages métaphysiques » de « Dévotion ». Le livre de Michel Arouimi, empreint d’une profonde connaissance de Rimbaud, et animé d’un souffle herméneutique peu commun, nous incite à (re ?)368prendre en compte la dimension spéculative, sinon religieuse, qui paraît dynamiser, depuis la lettre du Voyant, et pourrait bien organiser, le système toujours clos sur lui-même du poète.
Marc Ascione
1 Il enchaîne, trop vite à notre avis : « Ce risque a d’ailleurs trouvé un garde-fou dans les formes nouvelles de l’antisémitisme chez les intellectuels, notamment français, hostiles à tout ce qui témoigne de l’existence des principes sur lesquels repose une tradition dont l’Apocalypse reste un rejeton littéraire. » Or le livre de Guillaume Meurice, Cosme, a eu en 2018 un grand succès : il présentait une lecture de « Voyelles », fondée sur la couleur des chevaux de l’Apocalypse, qui réjouissait d’autant plus qu’elle déconsidérait, celle, érotique, qui lança Faurisson (en 1961). – Une eau nationaliste coule bien sous les ponts, mais c’est avec le général Delawarde, signataire de la « Tribune » des « Vingt généraux et plus d’un millier d’officiers » de Valeurs actuelles, et ses émules de la pancarte « Qui ? » Et nous avons appris par Libération du 10 décembre 2021 (hélas seulement après les violences subies par les courageux militants de SOS-racisme, le 5 décembre à Villepinte, au meeting d’un candidat d’extrême droite), que ce candidat, Éric Zemmour, comptait dans son équipe de campagne le neveu de Faurisson, Philippe Schleiter. Ajoutons que le père de celui-ci, beau-frère et collaborateur très actif de Faurisson pour la propagande vers l’Allemagne, René Schleiter, fut, aux législatives de 2002, le suppléant de Nicolas Bay, actif antérieurement dans le syndicalisme étudiant d’extrême droite (« Renouveau étudiant ») avec les frères Schleiter Philippe et Xavier : depuis numéro 2 du FN-RN sous Marine Le Pen.
2 Une confusion s’est glissée dans la rédaction, p. 103 : la découverte du vaudeville de Scribe et Dupin Michel et Christine (1821) est bien due à Étiemble et Yassu Gauclère dans leur article « À propos de Michel et Christine » dans les Cahiers du Sud, p. 927-931, déc. 1936. La découverte de Pierre Brunel (« La Fin de l’idylle », RHLF, mars-avril 1987, no 2, p. 200-212), concerne, elle, la piécette Sur la lisière d’un bois recueillie dans Le Théâtre en liberté de Hugo (posthume, 1886) et le commentaire d’un satyre : « Fin de l’idylle : un mioche ».