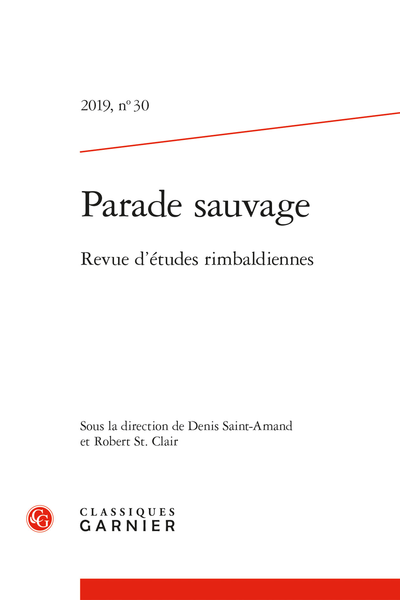
Résumés
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Parade sauvage
2019, n° 30. Revue d’études rimbaldiennes - Pages : 309 à 317
- Revue : Parade sauvage
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406099192
- ISBN : 978-2-406-09919-2
- ISSN : 2262-2268
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-09919-2.p.0309
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 27/01/2020
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
Résumés/Abstracts
Denis Saint-Amand et Robert St. Clair, « Trente. Avant-propos »
Introduction générale de cette 30e livraison, qui marque un cap dans l’histoire de la revue.
Mots-clés : Arthur Rimbaud, interprétation, exégèse, commentaire, rimbaldisme.
Denis Saint-Amand et Robert St. Clair, “Foreword”
A general introduction to the landmark 30th issue of Parade sauvage.
Keywords: Arthur Rimbaud, hermeneutics, exegesis, textual commentary, Rimbaud studies.
Steve Murphy, « Au-delà de l’illusion intimiste. Vers une scato-idéo-logique des “Effarés” »
Poème composé en 1870, « Les Effarés » restera important pour Rimbaud en 1871, ce qui suffit presque à révoquer en doute la vision mièvrement misérabiliste que la tradition a cru y voir. Par sa poétique politique de la suggestion, le poème est solidaire des écrits critiques et provocateurs de 1871. Le présent article s’efforce d’en explorer les implications sociales et sexuelles, en lien avec d’autres poèmes portant sur l’exploitation des pauvres, des femmes et des enfants.
Mots-clés : Charles Baudelaire, Victor Hugo, Paul Verlaine, intertextualité, sociologie, ramoneurs, travail des enfants, pédophilie
Steve Murphy, “Beyond the intimist illusion. Towards a scato-ideo-logy of ‘Les Effarés’”
Composed in 1870, « Les Effarés » remained for Rimbaud an important poem well into 1871. This philological detail alone is nearly enough to call into question an exegetical tradition that sees in the text little more than a sappy mix of miserablist clichés. Yet at the level of its poetic politics of suggestion, the poem fits every 310bit as coherently into the 1871 corpus as any of the other celebrated critical and provocative texts that the poet later goes on to write. This article seeks to explore some of the social and erotic implications of « Les Effarés », linking it to a larger body of other poems that take up and interrogate themes of exploitation of the poor, of women, and of children.
Keywords: Charles Baudelaire, Victor Hugo, Paul Verlaine, intertextuality, sociology, chimney sweeps, child labor, pedophilia.
Marc Dominicy, « “Entends comme brame…”. Stratégies et enjeux d’un poème énigmatique »
Cet article offre une analyse détaillée de « Entends comme brame… » Au niveau formel, le poème possède une structure assez régulière qui met en œuvre, cependant, des traits inattendus comme la rime « androgyne » et la récupération de syllabes « féminines » au début du vers. Au niveau sémantico-pragmatique, on remarque, en particulier, un usage intense de connecteurs qui sont généralement évités dans le discours lyrique. Ces observations confirment chaque fois la dimension intertextuelle de la pièce.
Mots-clés : derniers vers, rime androgyne, compensation, connecteurs pragmatiques, intertextualité.
Marc Dominicy, “‘Entends comme brame…’ The strategies and stakes of an enigmatic poem”
This paper provides a detailed analysis of “Entends comme brame…” On the formal level, the poem exhibits a quite regular structure that involves, however, unexpected features like “mixed” rhyme and the recuperation of “feminine” syllables in verse-initial position. On the semantic-pragmatic level, one notices, in particular, that intensive use is made of connectives that are generally avoided in lyric discourse. In both cases, the results obtained confirm the intertextual dimension of the poem.
Keywords: last verses, mixed rhyme, prosodic recuperation, pragmatic connectives, intertextuality.
Alain Vaillant, « Le Phénomène Rimbaud »
Rimbaud a longtemps été le prétexte à d’âpres conflits, qui faisaient obstacle à la lecture des textes. Le temps semble venir d’une interprétation, sinon plus consensuelle, du moins plus attentive à la lettre et au contexte des œuvres. Cependant, demeure une question élémentaire mais primordiale. En 311quoi l’œuvre de Rimbaud constitue-t-elle historiquement un tel phénomène littéraire ? Et, en corollaire : quelles circonstances, individuelles et collectives, expliquent son apparition ?
Mots-clés : poésie, anticléricalisme, herméneutique, guerre de 1870, obscurité.
Alain Vaillant, “The Rimbaud phenomenon”
Rimbaud has long been a pretext for intellectual conflicts whose end result is to eclipse or foreclose readings of his texts. It might just be time to put forward an interpretative framework more attentive to their strict textuality. Yet, we might first need to tarry with a more fundamental question: what is it that makes this œuvre such an historically important literary phenomenon? What individual and collective circumstances make the emergence of this literary phenomenon possible?
Keywords: poetry, anticlericalism, hermeneutics, the War of 1870, opacity.
Liesl Yamaguchi, « Correspondances. La couleur des voyelles chez Lévi-Strauss, Jakobson, Rimbaud et Banville »
Dans sa lecture de « Voyelles » (1991), Claude Lévi-Strauss note que les timbres colorés des voyelles du sonnet s’opposent à dessein aux couleurs qui leur sont attribuées. Se pose ainsi la question de savoir si l’hypothèse selon laquelle Rimbaud concevait les timbres vocaliques comme étant doués de couleurs est attestée dans son œuvre. Cet article suggère que « Ce qu’on dit au poète … » nous en fournirait un indice, et que « Voyelles » s’inscrirait ainsi dans un débat sur la rime avec Banville.
Mots-clés : structuralisme, voyelles, timbre, audition colorée, rime.
Liesl Yamaguchi, “Correspondences. The color of vowels in Lévi-Strauss, Jakobson, Rimbaud, and Banville”
In his 1991 reading of “Voyelles,” Claude Lévi-Strauss observes that the colored timbres of the sonnet’s vowels deliberately oppose the colors they are assigned. Investigating whether Rimbaud’s œuvre supports the assumption that Rimbaud conceived of vowel timbres as colored, this article finds that “Ce qu’on dit au poète à propos de fleurs” might well do so, and that “Voyelles” might thus form part of Rimbaud’s debate on rhyme with Théodore de Banville.
Keywords: structuralism, vowels, timbre, synesthetic audition, rhyme.
312Paul Claes, « “Paris”, une connerie rimbaldienne »
Cette contribution propose une lecture inédite du sonnet « Paris ». C’est l’ambiance gaillarde des réunions des zutistes parisiens qui forme l’horizon d’attente de cette « connerie » rimbaldienne. Le texte est une accumulation de noms propres aptes à présenter des connotations grivoises pour un public friand de calembours obscènes. Dès lors, la clé du poème se trouve dans les dictionnaires érotiques du dix-neuvième siècle qui révèlent le sens indécent des noms apparemment anodins.
Mots-clés : parodie, dictionnaires, lexicographie, érotisme, subversion.
Paul Claes, “‘Paris’, A Rimbaldian obscenity”
This article proposes a new reading of Rimbaud’s sonnet “Paris”. It is the ribald atmosphere of the meetings of the Parisian Zutistes which forms the horizon of expectation of this so-called “connerie” (bullshit, a [fucking] joke, nonsense). The text appears to be an accumulation of proper nouns capable of evoking sexual connotations to a public fond of obscene puns. So the key of the poem may be found in nineteenth-century erotic dictionaries that reveal the indecent meaning of the apparently innocuous names.
Keywords: parody, dictionaries, lexicography, eroticism, subversion.
Benoît de Cornulier, « Le sens du rythme dans “Les Corbeaux” »
La formule rimique des « Corbeaux » est ambiguë. Or il parait peu naturel de traiter tous ces sixains uniformément, soit en ab-ba cc, soit en abb-acc. La première interprétation paraît pourtant plausible à condition de reconnaître dans les trois premiers vers une inscription métrique mimant la sonnerie de l’angélus chrétien.
Mots-clés : inscription métrique, angelus, corbeaux, sixain, poésie.
Benoît de Cornulier, “The sense of rhythm in ‘Les Corbeaux’”
The ambiguous construction and function of the rhymes in « Les Corbeaux » calls for further analysis. For, in our view, it seems questionable to consider all of the text’s sestets as consistently patterned in either a ab-ba cc, or abb-acc structure. The former of the two, however, could be seen as plausible, provided we hear in the first three verses something on the order of an imitatively metrical inscription of the sound of church bells peeling the angelus.
Keywords: metrical inscription, angelus, “Crows”, sestets, poetry.
313Thomas C. Connolly, « Fleurs arctiques. “Barbare” à la lumière d’Ovide »
Bien que Rimbaud ait beaucoup lu parmi les auteurs grecs et latins, il y a peu de traces de sa lecture d’Ovide. Nous lisons le poème en prose « Barbare » à la lumière de Tristia, œuvre tardive dans laquelle le poète latin se plaint de son exil au Pont-Euxin. Sans pour autant proposer Tristia (ou sa traduction) comme une source intertextuelle, nous démontrons comment la juxtaposition de ce texte nous permet de mieux comprendre un des poèmes les plus obscurs dans Illuminations.
Mots-clés : Tristia, latin, exil, monde, pavillon.
Thomas C. Connolly, “Arctic flowers. ‘Barbare’ in the light of Ovid”
Though Rimbaud was an avid reader of Latin and Greek poetry, there are few traces of Ovid in his opus. This essay proposes a reading of the prose poem “Barbare” in parallel with Ovid’s late work, written in exile, Tristia. Without going so far as to see in the latter an intertexual source for the former, we aim to show how reading the one with the other sheds new light on some of the darkest corners of the Illuminations.
Keywords: Tristia, Latin, etymology, exile, worlds, pavilion.
Jean-Michel Gouvard, « Rimbaud, Brecht, Benjamin. Une “histoire splendide” »
Cette étude s’appuie sur les conversations que W. Benjamin eut avec B. Brecht à propos de Rimbaud et du Bateau ivre. Elle vise à comprendre pourquoi le poète français a retenu l’attention du philosophe allemand, par la mission qu’il assignait à l’artiste et la vision de l’histoire qui était la sienne. À l’instar de la critique du surréalisme, la poésie de Rimbaud constitua pour Benjamin une étape importante pour penser la société de son époque, tout en confortant ses thèses sur l’histoire.
Mots-clés : Le Bateau ivre, poésie, représentations culturelles, philosophie de l’histoire, poétique, littérature du dix-neuvième siècle.
Jean-Michel Gouvard, “Rimbaud, Brecht, Benjamin. An ‘histoire splendide’”
This article draws on the talks between Walter Benjamin and Bertold Brecht on Rimbaud’s Bateau ivre in the aim to better understand why the French poet raises the interest of the German philosopher. Benjamin focuses on the nature of Rimbaud’s poetical images, the place he gives to the artist in the society, and his conception of history. As his criticism on surrealism, Rimbaud’s poetry has been for Benjamin a 314significant step in the way he thought the society he lived in, with its never-ending threats, and his own conception of history.
Keywords: Le Bateau ivre, poetry, cultural studies, philosophy of history, poetics, nineteenth-century literature.
Frédéric Thomas, « Jules Andrieu, situation d’un “frère d’esprit” »
En 1872, Rimbaud rencontre à Londres un ami de Verlaine, ancien dirigeant communard en exil : Jules Andrieu (le destinataire de la lettre inédite de Rimbaud de 1874). Il existait, selon Ernest Delahaye, entre les deux hommes, une fraternité d’esprit. Cet article tente d’en éclairer le noyau et les contours, à partir de l’analyse de la situation historique, du micro-réseau politico-culturel au sein duquel ils se meuvent, ainsi que des enjeux et pratiques d’une écriture « poético-historique ».
Mots-clés : cercle d’études sociales, Commune de Paris, contre-enquête, histoire, Londres.
Frédéric Thomas, “Jules Andrieu, the situation of a ‘frère d’esprit’”
In 1872, Rimbaud meets Jules Andrieu – a friend of Verlaine and former communard leader to whom, in 1874, Rimbaud would also address a previously unpublished missive. According to Ernest Delahaye, there was between the two men something like an “intellectual brotherhood”. The present paper seeks to explore and shed light on how we might understand the implications of such an assertion by taking into account historical situation, the micro-political and cultural network in which Rimbaud and Andrieu found themselves in London, as well as the issues at stake in – and the practices of – what we might call a « poetic-historical » form of writing.
Keywords: Centre for Social Studies, Paris Commune, counter-discursive histories, London.
Simon Rogghe, « Le cri du papillon. The Doors et Rimbaud »
Cet article propose de considérer la musicalité dans l’œuvre de Rimbaud en relation avec le projet musical du groupe The Doors ainsi que par rapport à la poésie de Jim Morrison, profondément influencé par Rimbaud. Ainsi, nous tenterons de démontrer que la musicalité chez Rimbaud pourrait bien être tellement « en avant » qu’elle se laisserait mieux comprendre, non pas par 315rapport aux musiques existantes au xixe siècle, mais en relation aux projets ultérieurs dont elle a été l’inspiratrice.
Mots-clés : musique, voyance, Jim Morrison, contre-culture, rock.
Simon Rogghe, “The scream of the butterfly. The Doors and Rimbaud”
This article will consider musicality in the work of Rimbaud in relation to the musical project of the group The Doors as well as with regard to Jim Morrison’s poetry, strongly influenced by Rimbaud. This article, then, will aim to show that this musicality in Rimbaud is perhaps so far « ahead » that it might be better understood, not in terms of existing music in the XIXth century, but in relation to ulterior projects for which Rimbaud’s work was a source of inspiration.
Keywords: music, voyance, Jim Morrison, counterculture, rock.
Geneviève Hodin, « Le paradis du lit, l’enfer des fleurs »
La relecture du « Dormeur du val » de Rimbaud à partir de documents iconographiques oubliés permet de donner un éclairage nouveau au poème.
Mots-clés : ekphrasis, Alexandre Protais, peinture, iconographie.
Geneviève Hodin, “The paradise of the bed, the hell of flowers”
A re-reading of Rimbaud’s “Dormeur du val” based on newly unearthed iconographic documentation.
Keywords: ekphrasis, Alexandre Protais, painting, iconography.
Daniel Sangsue, « Le fantôme de Rimbaud »
Extraits d’un manuscrit inédit qui fait suite au Journal d’un amateur de fantômes, ces fragments évoquent une visite de Charleville sur les traces de Rimbaud, de ses spectres et de ses souvenirs.
Mots-clés : Charleville, Musée Rimbaud, fantômes, spectres, présences.
Daniel Sangsue, “Rimbaud’s ghost”
This piece is excerpted from an unpublished manuscript that follows up on Journal d’un amateur de fantômes. The fragmentary entries recall a visit to Charleville, encounters with traces, spectres, and memories of Rimbaud.
Keywords: Charleville, Rimbaud Museum, ghosts, spectres, presences.
316Christophe Bataillé, « Cinq notules »
Notules portant sur des jeux polysémiques engagés dans « Soleil et chair », « Roman », « Un cœur sous une soutane », « Rages de Césars » et la lettre à Delahaye du 14 octobre 1875.
Mots-clés : polysémie, calembour, lexique, humour, poèmes.
Christophe Bataillé, “Five brief notes”
A series of notes on the play of polysemia in « Soleil et chair », « Roman », « Un cœur sous une soutane », « Rages de Césars », as well as the poet’s letter to Delahaye dated from 14 October, 1875.
Keywords: polysemia, puns, lexicality, humour, poems.
Philippe Rocher, « “Mémoire”, le blanc, l’eau et la lessive »
Et si « Mémoire » engageait une isotopie de la lessive ?
Mots-clés : mémoire, isotopie, lessive, lexique, calembour.
Philippe Rocher, “‘Mémoire,’ the blank, the water, and the laundry”
A short intervention that takes seriously the following hypothesis: what if « Mémoire » were an extended isotopic play on the theme of washing laundry?
Keywords: Mémoire, isotopia, washing, lexicality, puns.
Seth Whidden, « Le sieur Rimbaud, marinier »
Et si Rimbaud était devenu marinier ? Un entrefilet du Figaro du 9 octobre 1878 permet de poser la question.
Mots-clés : biographie, trajectoire, Le Figaro, exposition universelle, onomastique.
Seth Whidden, “Sir Rimbaud, mariner”
Could Rimbaud have been a sailor at some point? A snippet from Le Figaro dated 09 October 1878 might hold some answers.
Keywords: biography, trajectory, Le Figaro, Universal Expo, onomastics.
317Denis Saint-Amand, « Dire je »
Dans le sillage de la célèbre sentence rimbaldienne selon laquelle « Je est un autre », les membres du collectif Wu Ming évoquent la pratique du « jejoiement ».
Mots-clés : Wu Ming, énonciation, sujet, dissipation, groupes littéraires.
Denis Saint-Amand, “Saying ‘I’”
Following Rimbaud’s infamous maxim, “Je est un autre”, the members of the literary collective Wu Ming raise the possibility of thinking the aesthetic subject otherwise via a practice “jejoiement”.
Keywords: Wu Ming, enunciation and signification, subject, dissipation, literary collectives.