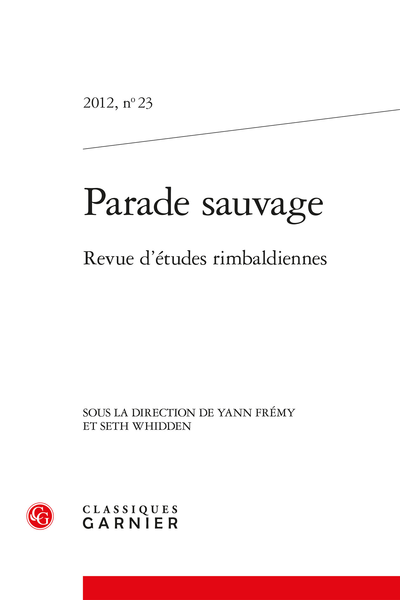
Comptes rendus
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Parade sauvage
2012, n° 23. Revue d’études rimbaldiennes - Auteurs : Degott (Bertrand), Lhermelier (Cyrille), Bobillot (Jean-Pierre)
- Pages : 263 à 287
- Revue : Parade sauvage
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812445422
- ISBN : 978-2-8124-4542-2
- ISSN : 2262-2268
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-4542-2.p.0263
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 11/12/2012
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
Magazine littéraire no 489, septembre 2009, dossier « Rimbaud, les règles de l’exception » sous la direction de Maxime Rovère.
Sous le titre « Rimbaud, les règles de l’exception », ce numéro consacre au poète une trentaine de pages richement illustrées. Nous les parcourons, il s’en faut de peu, « après trois ans ». Le dossier, destiné à un large public, n’en rassemble pas moins des contributions de la plupart des spécialistes du poète, à commencer par ses éditeurs successifs, Jean-Luc Steinmetz, Steve Murphy et André Guyaux. C’est à ce dernier, en tant qu’éditeur de Rimbaud pour la Pléiade, qu’est laissé le soin d’ouvrir le dossier : il explique notamment pourquoi il n’a pas tenu compte des projets de recueils, dont l’existence pourtant faisait consensus parmi les philologues, reprenant à sa note éditoriale l’argument du malentendu : il serait fâcheux en effet qu’on pût croire Rimbaud l’auteur d’un « Recueil Demeny ». Le dossier témoigne surtout d’un souci louable d’aborder l’œuvre dans sa diversité, en variant les approches. Seth Whidden voit dans les contributions à l’Album zutique « un refus de l’autorité qui se manifeste déjà dans les lettres dites “du Voyant” ». Après quoi Steve Murphy dégage l’implicite du Châtiment de Tartufe, à savoir sa portée érotique et politique mais aussi l’écho qu’il donne au César Borgia de Verlaine. D’Une saison en enfer, dont il propose une lecture anthropologique, Yann Frémy écrit que « les poèmes, comme la prose, participent… d’un dynamisme généralisé ». À propos des Illuminations, Jacques Bienvenu se demande chiffres en main sous quelle forme le manuscrit de l’œuvre a pu circuler. La correspondance n’est pas oubliée. Resserrant l’attention sur les quelque vingt lettres de la période littéraire (celles qui l’incarnent et donnent sens à son entreprise), Jean-Luc Steinmetz nous laisse rêver à celles dont l’existence est attestée mais qui ont été perdues. Jusqu’aux essais scolaires attirent les commentaires de Denis Hüe et d’Alain Kerlan. Sur la base de témoignages et des lettres d’Abyssinie, Claude Jeancolas campe un Rimbaud fasciné par l’Afrique. L’approche linguistique est, elle, représentée par Olivier Bivort et par Georges Kliebenstein, qui expose notamment les trois régimes ou modèles de circulation du sens
utilisés selon lui par Rimbaud (1. l’oracle, 2. la théologie, 3. le dictionnaire ou l’encyclopédie). Quant à la « subversification » ou « perversification » de Rimbaud – pour reprendre les valises souvent mentionnées de Philippe Rocher et Steve Murphy –, il revenait à Benoît de Cornulier d’en commenter quelques exemples bien choisis. À tout prendre, c’est le grand mérite de ce dossier ouvert à un large public, que d’être même accessible au néophyte. Le spécialiste saura trouver ailleurs des développements plus fournis si ce n’est plus convaincants. Le généticien pourra même confronter aux contributions présentes leurs réécritures ailleurs publiées, et tâcher de les ordonner. À l’intention du néophyte encore ou du lecteur soucieux d’approfondir le dossier, trois pages de bibliographie raisonnée et commentée donnent un aperçu des études les plus récentes, en annoncent même trois parues entre-temps (aux éditions Classiques Garnier) Rimbaud et la Commune de Steve Murphy, De la métrique à l’interprétation de Benoît de Cornulier, « Te voilà, c’est la force », de Yann Frémy ; mais elles rappellent aussi quelques essais qui, tel le Rimbaud par lui-même de Bonnefoy, ont scandé l’histoire de la critique. Cette bibliographie est due au pertinent Alain Bardel, dont le site consacré à Rimbaud vaut bien qu’on s’égare sur la toile. Que d’efforts d’attention critique ! que de pédagogie ! S’il est malgré tout peu probable qu’on plie jamais l’exception à la règle, du moins tâchons d’entendre sa colère. C’est ce que suggère le coordonnateur Maxime Rovere : « il hait quelque chose que notre quotidien cautionne… mais sa colère se trempe en autre chose, que nous savons et que nous aimons comme lui ». Et de conclure, en écho sans doute à « Je est un autre », « l’ailleurs est à trouver ici ».
Bertrand Degott
Arthur Rimbaud, Europe no 966, sous la direction de Steve Murphy, octobre 2009.
L’un des axes privilégiés ici est d’ordre historique : il s’agit non seulement de fournir des lectures de textes dont la charge idéologique est lourde, mais aussi d’aborder des phénomènes qui ont été et restent aujourd’hui mythogènes : la question du patriotisme, le rapport au « communalisme » et à l’anticléricalisme de Rimbaud, la question de motivations politiques perdurant jusque dans Les Illuminations ainsi que d’autres formes de « dérèglements » entrepris sur les plans formel et sémantique.
Il s’agit en somme de démythifier Rimbaud. Dans son préambule Steve Murphy propose de rendre à l’œuvre du poète la part de transitivité qui lui revient : « Rimbaud et Verlaine, écrit-il, sont de ceux, minoritaires, qui reprendront le combat abandonné par la plupart des poètes qui s’étaient engagés en 1848 ». Après avoir stigmatisé les réticences de la critique (celles d’un Riffaterre notamment) devant l’historicité de l’œuvre, il prône « l’importance d’un retour au contexte, à la pensée rimbaldienne ». Cependant une « pragmatique de Rimbaud », qui interrogerait les « rapports de cette pensée à l’idéologie et au déjà-écrit », ne saurait s’en contenter sans s’« adjoindre comme dimensions capitales les analyses de style, de l’énonciation et des inscriptions génériques complexes de Rimbaud, ainsi que de la versification du poète ». C’est en quelques mots dessiner les lignes de force de ce très foisonnant et stimulant dossier : contextualisation historique, mais aussi génétique, et poétique au sens large. L’on sait ainsi gré au même Murphy de contextualiser les pages de Tristan Tzara placées en exergue, même si à notre sens elles témoignent surtout, au même titre que celles qui suivent de Volker Braun et de Claudio Rodriguez, d’une lecture existentielle de Rimbaud et que cette dimension – pour daté qu’apparaisse le détail de certaines analyses – perdure, elle (mais il est vrai qu’on a tôt fait de confondre l’existentiel et l’essentiel). Tandis que seul Alain Vaillant s’attache à l’anticléricalisme, la question du communalisme est abordé par Jean-Pierre Bobillot, par Steve Murphy et par Alain Bardel. Contre Éric Marty pour qui la parole des Illuminations est une parole « post-politique », Bardel défend la fidélité du poète aux combats de la Commune. Jusqu’en sa dernière œuvre Rimbaud questionne la modernité et « maintient la perspective d’une émancipation profane, individuelle et
collective, qu’il oppose à la promesse chrétienne ». En creux, ce numéro d’Europe rend également hommage à Henri Meschonnic décédé en avril de la même année : deux articles lui sont dédiés, son analyse de l’aphorisme d’Adieu plusieurs fois mentionnée. Gérard Dessons, tout en convenant qu’on ne peut à moins de contresens faire du poète un tenant de la modernité, problématise les rapports entre mode et modernité : son Rimbaud est un « démodeur », quelqu’un qui a su « voir, au delà de la mode, la modernité ». Bruno Claisse quant à lui propose de lire Une saison en enfer, sans solution de continuité entre les lettres de mai 1871 et les Illuminations, comme le maillon central d’une « utopie du poétique » articulée avec une « éthique de l’altérité ». Dans une perspective poétique, Henri Scepi questionne le genre du poème en prose tel que Rimbaud le pratique dans ses Illuminations : quel rapport entretient-il avec le caprice et la fantaisie romantique ? quelle place y prend l’image ? L’approche génétique est représentée notamment par Yann Frémy sur les Proses évangéliques. Nourries par la lecture d’Holbach, celles-ci sont loin d’avoir la transparence qu’on leur prête parfois… Signalons encore l’article de Christine Planté sur « Les poètes et la femme dans les lettres du voyant » ; celui de Benoît de Cornulier qui montre que notre lecture amétrique insouciante des manipulations métriques de Rimbaud « réduit en bouillie l’architecture du Rimbaud poète métrique » ; ceux de Yoshikazu Nakaji, de Ross Chambers et d’Olivier Bivort. Des études singulières sont consacrées aux poèmes suivants : Les Mains de Jeanne-Marie (Seth Whidden), Mémoire (Marc Dominicy), « Entends comme brame… » (Philippe Rocher), Aube (Christophe Bataillé), Solde (Bruno Claisse, encore). On apprécie également l’éclairage indirect de Daniel Sangsue, qui nous révèle un Rimbaud « encore plus parodiste qu’il ne le paraît » – et l’apport ambivalent du comparatisme. Voulant éclairer Rimbaud grâce à Nietzsche, Pierre Brunel en grand costume de généticien ne parle quasi que de Nietzsche. Dans un contexte aussi brillant même le décalage a du charme ! Ce n’est pas le moindre des mérites de l’œuvre rimbaldienne que d’inspirer autant de savants « décodeurs ». À des degrés divers pourtant, et sans le vouloir sans doute, deux articles pourraient désigner au moins l’une des limites de la pragmatique ambitionnée. Il s’agit d’une part des deux pages qui ferment le dossier : d’« un alexandrin retrouvé de Rimbaud », José Encinas propose deux variantes, trois même puisqu’une coquille dans son commentaire lui fait remplacer de
par des. Il s’agit d’autre part de la contribution de Jean-Luc Steinmetz, décidément préoccupé des œuvres perdues : signalé par Verlaine, le manuscrit de La Chasse spirituelle n’a pas été retrouvé. Au long de douze pages haletantes, Steinmetz étudie la résonance de ce titre dans l’œuvre dont nous disposons, pour finalement en imaginer le texte en palimpseste diffus dans Une saison en enfer. Il est vrai que Rimbaud, autant du fait de l’état de jachère où il laissa son œuvre que des proportions prises par l’épitexte déjà de son vivant, ne cesse d’ébranler la critique. Ainsi commentons-nous jusqu’à des objets incertains : le mythe évacué par la porte, n’est-ce pas un peu lui proposer de revenir par la fenêtre ?
Bertrand Degott
Rimbaud, l’invisible et l’inouï, Poésies, Une saison en enfer (1869-1873), ouvrage coordonné par Arnaud Bernadet, série « xixe siècle français », CNED/puf, 2010.
Arnaud Bernadet expose en avertissement la difficulté d’envisager l’« œuvre » de Rimbaud en tant que telle, celui-ci n’ayant, excepté Une saison en enfer, publié que trois textes en revue. Cette absence de « totalité stable » implique un regard propre à toute édition des vers du poète, et l’impossibilité d’une « édition idéale » : quel Rimbaud, sous quel angle, et dans quel ordre ? C’est l’édition de Louis Forestier de 1999 (tirage 2009) qui servira de référence à cet ouvrage collectif destiné aux candidats à l’agrégation 2010.
Son coordonnateur consacre ensuite une importante introduction1 au rapport entre sens, corps et goût chez Rimbaud. Confondant manières sociales et manière artistique, valeurs sociales et valeur littéraire, le jugement de Bruxelles est prétexte à une analyse des rapports complexes qui unissent sens et valeur, illisibilité et herméneutique. Cette réflexion aboutit à l’émergence d’un « corps-sujet », qui est la « manière Rimbaud », et qui met en valeur la portée individuelle (esthétique) et collective (politique) du goût, et donc du dégoût, dont a bien parlé Anne-Emmanuelle Berger2. Rimbaud destine ce « corps du dire » à l’invisible, à l’inouï, à l’obscurité (« Obscur et froncé comme… »), à tout ce qui prend à revers, voire « par derrière », les manières poétiques, sociales et morales de son temps.
La première partie de l’étude, « De “l’école, dite Parnassienne” à la “poésie objective” », met en exergue cette phrase de la lettre du 15 mai 1871 : « J’ai résolu de vous donner une heure de littérature nouvelle ».
Steve Murphy3 s’intéresse à l’ordre et à la datation des poèmes en vers de l’édition de référence, avant de s’attarder sur quelques « problèmes d’édition ponctuels », qui ne contestent en rien la qualité du travail de Louis Forestier. Pour 1870, les dates inscrites par Rimbaud au bas de poèmes transcrits sur les feuilles laissées à Demeny sont probablement des dates « approximatives » de composition, plus que de transcription ; l’auteur légitime par ailleurs les appellations « Recueil Demeny » ou
« Recueil de Douai », pour « l’ensemble » de ces poèmes violemment républicains. M. Murphy regrette ensuite la traditionnelle « bipartition » de l’œuvre en vers, qui induit un supposé vide de composition poétique de Rimbaud, entre Le Bateau ivre et ce qu’on appelle les « poèmes de 72 ». Or, la datation par Verlaine de « Fév. 72 » pour Les Mains de Jeanne-Marie, sur une liste qui semble indiquer une velléité de publication bruxelloise simultanée avec les Vaincus, désigne certainement sa composition…
Les frontières entre les poèmes de 70-71 et ceux de 72, entre les textes « sérieux » et para-zutiques, sont au contraire plus que poreuses ; qu’on pense en particulier à Tête de Faune, ou bien aux Corbeaux… Les « poèmes de 72 » témoignent parfois d’une évidente proximité esthétique avec les Romances sans paroles, et semblent également avoir été destinés à la publication en recueil, si l’on en croit leur regroupement en « Fêtes… », ainsi que le calcul par Rimbaud du nombre de vers des « Fêtes de la faim ». La composition de quelques textes à la datation incertaine peut en outre être postérieure à 1872.
Jean-Pierre Bertrand consacre sa première intervention, « Une belle gloire d’artiste et de conteur emportée4 » aux « débuts » Parnassiens de Rimbaud. Après avoir présenté le rapport dialectique du poète au Parnasse, qui, dans ses envois à Banville, déclare vouloir« en être », alors qu’il rêve d’en faire imploser la poésie, le critique redonne au Parnasse quelques lettres de noblesse dont on le déleste trop souvent : sa novation poétique, sa contribution à l’émergence d’une « autonomie de la littérature ». L’indomptable personnalité de Rimbaud, l’engagement politique de ses textes, mais surtout la radicale nouveauté de sa langue ont éloigné son « œuvre » de toute conciliation avec la poésie dominante, lui conférant ce que J. P Bertrand appelle une « non-position ».
Avec « Se faire voyant5 », Jean-Pierre Bertrand insiste sur la valeur antiphrastique de la sentence « Il faut être absolument moderne » d’Alchimie du verbe, rappelant que matériellement, politiquement ou esthétiquement, Rimbaud n’associe jamais de bienfaits à la modernité. « Poésie objective », « littérature nouvelle », vision de l’avenir, langage neuf et pouvoir sur le monde : ces fulgurances jetées dans les deux « Lettres du Voyant », de mai et juin 1871, annoncent l’« hallucination simple » et établissent la cohérence jusqu’aux Illuminations du parcours poétique rimbaldien.
Dans l’article « Poésie et subversion. Rimbaud mauvaise manière », Denis Saint-Amand souligne l’importance, aux yeux du jeune homme de Charleville et de Douai, de l’idéologie, de la politique ; son violent rejet de l’Empire, sa profonde imprégnation par la guerre et la Commune de Paris, son anticléricalisme, son viscéral mépris du bourgeois de province. Après une présentation du Cercle zutique et de ses membres, si l’on ose dire, l’auteur évoque la force parodique créative des poèmes de Ribaud dans l’Album, et dresse un panorama de leurs nombreuses cibles, qu’elles soient littéraires ou idéologiques.
Gérald Purnelle6 s’intéresse à la versification rimbaldienne, et à sa progression, de l’agression mesurée envers les conventions poétiques (portant sur la rime et la césure) des années 1870-1871 à « l’amétricité » et au fortes transgressions qui traversent les poèmes de 1872, multiplications de « tentatives uniques ». Les poèmes en prose Marine et Mouvement sont ensuite étudiés sous leurs aspects formels : segmentation, typographie. Alchimie du verbe est convoqué pour illustrer dans sa dimension métapoétique, la constante recherche d’« une langue », via une forme (« rythme, syntaxe, phrase, lexique »), très au-delà d’aspects purement techniques ou métriques.
La deuxième partie de l’ouvrage s’intitule « Arriver à l’inconnu. Expérimentations et innovations ».
Henri Scepi7 livre d’emblée un captivant article concernant les vers de 1870-71 : « Les états critiques de la poésie » (p. 93-106). On peut y lire comment Rimbaud, après sa double assimilation d’une formation classique, rhétorique, et de la tradition romantico-parnassienne, va, dans un paradoxal mouvement « d’imitation » et de « dissidence », et suite à la rupture que représente la Commune, « ausculter la poésie », la tissant de désir de liberté et de révolte contre tout pouvoir, qu’il soit religieux, familial ou politique. Émerge alors le projet de « trouver une langue », qui « déplace la poésie du pôle expressif-descriptif vers le pôle analytique-objectif ». Innovations lexicales, opacité sémantique, satires et déformations s’allient à une entreprise de démolition polémique qui n’a plus pour unique but la contestation idéologique, mais l’établissement d’un « autre de la poésie ».
Dans un second article, « Une poétique du dessaisissement », Henri Scepi s’intéresse aux « vers de 18728 », dont la composition déborde sans doute sur l’année 1873. Après avoir contextualisé cette période de création (retour à Paris, errance et liberté libre en compagnie de Verlaine, complicité amoureuse et poétique avec celui-ci), l’auteur montre la novatrice force des outrages que Rimbaud inflige à la forme (strophes, rimes, mètre). La finesse de l’agencement des « suites », Comédie de la soif et Fêtes de la patience, où « fièvre de l’inconnu » et « torpeur paralysante du vide » sont en perpétuel balancement, le recours aux formes populaires de la chanson, de la romance, de « l’étude » au sens pictural (notamment dans Mémoire) font de ces poèmes « sans attache » les jalons d’une « limite au-delà de laquelle, peut-être, la poésie risque de se renverser ou de s’abolir ». Entre « dessaisissement et réappropriation », des poèmes comme L’éternité, Larme, Michel et Christine, semblent porter une dimension métapoétique, dans laquelle c’est l’aventure de l’écriture elle-même, à travers l’évocation voilée du parcours du Voyant et son douloureux échec expérimental, qui est convoquée.
Une saison en enfer est l’objet de l’étude de Yoshikazu Nakaji : « Une vie fictionnelle pour demain9 ». Récit mythique s’inspirant du vécu du locuteur, mais qui endosse une portée universelle, la Saison comporte quatre éléments constitutifs dont il convient d’apprécier l’ambiguïté : l’enfer, la saison, la conversion, la charité. L’auteur décortique ensuite la logique à l’œuvre, respectivement dans les avant-textes, Mauvais sang, le prologue et Nuit de l’enfer, puis dans les quatre derniers récits. La forme narrative des Délires est enfin analysée, « appareil théâtral » pour Vierge folle, alternance de passages en prose et de citations de vers « hautement stylisée » en ce qui concerne Alchimie du verbe. Une conclusion fait correspondre le « monologue dialogique » de la parole d’Une saison en enfer aux voix déjà en présence dans les vers de 1872.
La troisième partie de l’ouvrage, « Trouver une langue. Approche “matérialiste” du poème », détaille les épreuves proprement dites qui attendent les candidats à l’Agrégation, et débute par une dissertation de Bruno Claisse10. Le question porte sur la fameuse maxime d’Adieu : « Il faut être absolument moderne », et sur la citation d’un critique
selon lequel Rimbaud y exprime « [s]a haine de tout ce qui est ancien ». Après une introduction qui tente, convoquant notamment Baudelaire, de définir cette ambiguë notion de modernité, Bruno Claisse annonce un travail en trois temps. Dans le premier, intitulé « Tabula rasa, une poétique de la rupture », il admet avec le critique que les Poésies, les vers de 1872 et la Saison s’attaquent fermement aux « vieilleries poétiques », maltraitent l’alexandrin et la rime, et inventent un « réel nouveau et artistique ». Il est évident que l’ancienne société dégoûte fort le poète, et que selon lui, « la science ne va pas assez vite ».
L’auteur prend toutefois, dans un second temps, ses distances : « Un poète antimoderne : en haine de l’académisme », déclarant réducteur « le postulat d’une haine de l’ancien » chez Rimbaud, alors que celui-ci s’est appuyé sur une solide culture classique, et que les occurrences de l’adjectif « moderne » dans Une saison en enfer n’expriment aucun enthousiasme rimbaldien ; au contraire, on y décèle plutôt de la répulsion : « […] toute modernité se recommandant de “l’absolument moderne” est “absolument” haïssable ». Le critique serait donc « resté sourd à l’ironie » du poète. La modernité chez Rimbaud est tout autre, « ni rupture avec l’ancien, ni surenchère du renouveau » ; c’est l’objet de la troisième partie, « La modernité Rimbaud, ou l’utopie du sujet ». Rejetant la poésie subjective « horriblement fadasse », Rimbaud cherche le « dégagement de l’altérité », l’inconnu, des façons inédites pour le « sujet-poète, comme [pour le] sujet-lecteur » d’être au monde. Le moderne contemporain doit être dépassé, vers une modernité poétique qui engendrerait « un je devenant un autre. » C’est la répétition de l’ancien pour un actuel aliénant que « hait » Rimbaud. Sa modernité n’est pas modernisme, elle est émergence poétique d’un nouveau sujet, toujours en mouvement.
Henri Scepi11 revient donner une explication du texte Larme : « Fragment pour un nouveau Narcisse ». Après la mise en place d’un cadre pastoral, tout en fusion et dilution, le poète en supprime les silhouettes descriptives familières, laissant un sujet altéré hanter un espace presque vide. Un nouveau Narcisse, dérisoirement « accroupi » au bord de l’eau, y souffre d’une soif commune qui va bientôt se transformer en un désir d’inconnu, dont il ressort plus altéré encore. L’auteur insiste sur les syntagmes « liqueur d’or » et « gourde de colocase », dans une perspective réflexive du sujet face aux « déceptions de la poésie et du réel ». Puis le paysage change, devient
indécis, mouvant ; géographie, conditions atmosphériques et chromatisme installent un univers aquatique irréel, source d’illuminations. Nouvelle expérience de l’identité et de l’altérité, Larme rapporte la quête de l’inconnu chère au Voyant à une esthétique du « fugitif », de « l’insaisissable ».
Bertrand Degott s’attelle ensuite à l’étude des temps verbaux dans le même poème, Larme, « question de syntaxe » pour un commentaire grammatical12. Y sont passées au crible les formes impersonnelles, infinitif et participe, puis les formes personnelles, passé simple, imparfait. Sont ensuite analysés les « écarts par rapport aux temps de référence ».
C’est à Steve Murphy que nous devons l’étude littéraire « Le naïf et le malin13 », consacrée aux difficiles et « très faiblement métriques » poèmes de 1872 Jeune ménage, Michel et Christine et Juillet.
Composé de décasyllabes « étranges », Jeune ménage regorge d’énigmes lexicologiques qui peuvent évoquer les Évangiles (Marie et Joseph, les Rois mages), met en scène une lune « bien-malveillante » qui pourrait bien provoquer puis moquer un ratage sexuel du jeune mari, par référence à Musset et sa Ballade à la lune. Les probables intertextes verlainiens favorisent une lecture biographique : une « intervention extérieure » empêche des mariés de savourer une légitime satisfaction conjugale.
Difficile exégèse également que celle Michel et Christine, subversion de l’idylle romantique, dans lequel le quiet Malines de Verlaine semble subir une « parodie amicale ». Mais des considérations politiques se dessinent obliquement dans ce poème « où l’espoir, fragile, s’accompagne de l’ombre du doute ».
Quant à Juillet, c’est un poème de « l’arbitraire », au niveau de sa vertigineuse versification décasyllabique, rythme et rimes, qui rend possibles plusieurs choix de lecture. « Dilemmes interprétatifs » se posent ensuite au lecteur de ce texte qui refuse « l’accès référentiel et symbolique ». Postulat d’une indépendance voulue et ironique de l’auteur, Juillet illustre l’inscription esthétique unique du Rimbaud de 1872, au regard de la poésie de son temps.
Nous retrouvons Bertrand Degott pour une étude grammaticale et un commentaire stylistique de Chant de guerre parisien14. La question de lexicologie s’intéresse aux mots « vol », « Éros », « héliotropes »,
« accroupissements ». La réflexion morphosyntaxique porte sur les constructions attributives, et amène quelques remarques complémentaires ; puis c’est la valeur du comique dans le poème qui est l’objet de l’étude stylistique, convoquant calembours, versification parodique et satire politique.
Steve Murphy présente enfin une bibliographie rimbaldienne commentée, et structurée selon les nombreux angles de recherche que peut suggérer cette œuvre sans pareille.
Cet ouvrage collectif, s’il est particulièrement destiné aux candidats à l’agrégation 2010, ravira les amateurs de poésie du xixe siècle désireux de mettre à jour leur connaissance d’Arthur Rimbaud. La contribution de brillants spécialistes du « passant considérable », qui ont su allier à une grande précision des commentaires une appréciable accessibilité, permettra en outre à chacun de faire le point sur la dynamique recherche rimbaldienne actuelle.
Cahiers Germain Nouveau, bibliographie 2011, no 3, Rouen, 2011. Contact : cahiersgn@yahoo.fr.
« […] nous pensons être au plus près, non de la réalité exhaustive, mais de nos ignorances. La bibliographie complète de Germain Nouveau n’existera jamais. »
C’est avec modestie que les inlassables chercheurs et éditeurs des Cahiers Germain Nouveau – Pascale Vandegeerde, Jean-Philippe de Wind et Guillaume Zeller – présentent leur toute récente bibliographie du poète, peintre et vagabond méridional.
Cet impressionnant outil de recherche constitue le troisième numéro des Cahiers ; il est accompagné d’un CD rom facilitant l’accès aux références, et réactualise avec bonheur « l’affaire Germain Nouveau », affaire qui voit se croiser dans ses méandres des personnages ayant pour noms Verlaine, Cros, Richepin, Delahaye… et Rimbaud.
Cyril Lhermelier
La Poésie jubilatoire. Rimbaud, Verlaine et l’Album zutique, éd. Seth Whidden, Paris, Classiques Garnier 2010, 376 p. ; Bernard Teyssèdre, Arthur Rimbaud et le foutoir zutique, Paris, Léo Scheer, 2011, 784 p.
Double pavé, lancé sans remords et même, non sans une affichée jubilation, dans la flache noire et froide de « la nocivité de Claudel » (fou zu p. 21) et de ses continuateurs de tout poil : histoire de rejouer en quelque sorte – sur le plan critique, cette fois – le coup de l’inaugural Sonnet du Trou du Cul considéré, emblématiquement (ce qui s’impose, s’agissant de pousser jusqu’en ses derniers retranchements l’art de blasonner !) comme « un acte de guerre sociopolitique » (p. 147).
Loin, en effet, de considérer l’entreprise « zutique » et le contenu de l’Album comme une simple curiosité d’époque (à laquelle on ne prêterait attention qu’en considération de quelques-uns de ses illustres participants) ou, plus positiv(ist)ement, des seuls points de vue historique et sociologique (qu’il n’est pas question de négliger pour autant) ; loin, plus spécifiquement, de ne voir dans les textes que Rimbaud a laissés dans ledit Album, « que gamineries et calembredaines » (comme trancha jadis Marcel Ruff, cf. Whidden, Po ju p. 225) ou que les blasphématoires éclats d’un « trésor bizarre » relevant « d’une paralittérature de la farce et du divertissement » et qui, par ce témoignage tardif, viendrait indûment supplanter à nos yeux une conjecturale « œuvre haute » (comme l’argua naguère Jean-Luc Steinmetz15), – il s’agit, dans ces deux publications, de mettre en lumière, le plus précisément possible et dans leur surgissement plus ou moins concerté, chaotique ou cahoteux, les effets de sens surgissant aux moindres détails, obscurités, amphibologies, clins d’œil, sous-entendus, bizarreries, embûches en tous genres, d’écrits inextricablement mêlés au reste de l’œuvre de ceux qui y contribuèrent et, en particulier, de Rimbaud qui y occupe une place, quantitativement et qualitativement, éminente.
Au bout du compte, il n’est pas exagéré d’affirmer, comme Arnaud Bernadet (p. 119) :
En 1871, l’Album zutique témoigne d’une crise manifeste de la poésie, au moins dans sa version parnassienne, et anticipe un changement de paradigme
dans l’expression dite lyrique, qui intervient peu de temps après avec les publications rapprochées des Amours jaunes, Le Coffret de santal, Une saison en enfer ou Romances sans paroles.
C’est l’objet, dans le fou zu, de maintes analyses plus ou moins poussées, poème par poème (sans oublier les dessins), se succédant tout au long d’une bonne moitié de l’ouvrage (p. 134-490 et passim). C’est également l’objet, dans La Po ju, d’une série d’articles dus à :
– David Ducoffre, qui poursuit ici ses travaux d’Hercule d’infatigable fouilleur hypo-, hyper- et intertextuel, trouvant chez Ratisbonne, Silvestre ou Coppée, d’encore insoupçonnés matériaux rimbaldiens ; – Alain Viala, qui met son expertise de la galanterie au service d’un éclairage à orientation et modulation variables de la Fête galante de Rimbaud ; – Seth Whidden, qui à propos de la même Fête galante et de Vu à Rome, montre qu’à rebours d’une idée reçue, il y a, fût-ce sous la plume d’un même auteur, parodie et parodie, et propose la notion de « parodie en expansion » englobant de toute sa dynamique stratifiée celle de « polyparodie », due à Georges Kliebenstein, ou en termes plus fleuris, de « sous-bois des intertextes », selon Steve Murphy à propos de Tête de faune16 ;
– Steve Murphy, qui à propos de L’angelot maudit et de son « caca », sorte de « zut » soft aux « vers profondément nuls » de Louis Ratisbonne (auquel s’en prend également Ponchon), s’attache lui aussi, une fois de plus, à extirper et à exhiber les modes plus ou moins cryptés de cette joyeuse « éviscération du discours édifiant », et volontiers bêtifiant, que s’avère être, d’un bout à l’autre, l’entreprise parodiste de l’Album ; – Benoît de Cornulier, qui confirme l’hypothèse, avancée par Murphy, selon laquelle « [l]’angelot maudit sort peut-être de l’Inferno de Dante », à travers la traduction qu’en avait faite, et dont était si fier, Ratisbonne ;
– Jean-Louis Aroui, qui savamment s’attache à situer le Pantoum négligé de Verlaine, non seulement dans l’histoire du pantun (ou « pantoun ») javano-malais et du « pantoum » français, et parmi les variations esthétiques plus ou moins conformes ou… négligées, auxquelles elle a donné lieu, mais par rapport à sa « source déclarée » qu’il faut chercher, comme c’est souvent le cas, non pas dans un poème précis de Daudet
(qui d’ailleurs « n’a jamais pratiqué la forme pantoum »), mais éparse dans son œuvre d’alors, ainsi qu’à maintes « comptines et chansons enfantines » auxquels il s’abreuve explicitement ; – Alain Chevrier, qui justement tente de recenser le plus exhaustivement possible les occurrences de termes, de thèmes ou de formes relevant de la musique ou des chansons à travers l’ensemble de l’Album, et montre par exemple que ledit Pantoum négligé est un véritable « patchwork » composé pour une bonne part au moins (compte tenu des vers répétés) de formules ou de schémas empruntés à diverses chansons enfantines et folkloriques bien connues à cette époque ;
– Robert St. Clair, qui après Reboul et Murphy, réarpente politiquement Paris pour y trouver, dans l’injonction finale : « Soyons chrétiens ! » l’espoir d’un retour ou d’une pérennité collective des idéaux de la Commune17 ; – Bruno Claisse, qui débusque ce que ne cachait point (telle « la lettre volée ») le « zut » en un seul alexandrin de Rimbaud au « blabla » en beaucoup d’alexandrins de Louis-Xavier de Ricard, dont l’idéalisme progressiste qui lui faisait prendre ses désirs pour des réalités sort anéanti de l’opération, quand le poète des Illuminations saura bien, à l’inverse, désigner ses « fantaisies » comme telles ;
– Philippe Rocher, qui sonde sous toutes ses scriptures le Sonnet du Trou du Cul et met ainsi en lumière une « poétique de l’obscène » plus sérieuse et complexe qu’il n’y paraît ; – Cyril Lhermelier enfin, qui établit sans conteste la double stratégie mimétique à laquelle se livre Germain Nouveau dans le Sonnet de la langue, à la fois « complément » connivent à ce « complément » inconvenant à L’Idole de Mérat qu’était celui du Trou du Cul, et régurgitation par contaminatio de nombreux passages de ladite Idole mais aussi des Chimères dudit Mérat, cherchant en leur absence à s’attirer la sympathie de Verlaine et Rimbaud, et y réussissant…
Si l’Album, à bien des égards, offre un aspect irréductiblement disparate, les écrits divers qui s’y rencontrent n’en sont pas moins inextricablement liés, non seulement au reste de l’œuvre de chacun des
participants, mais les uns aux autres, au point de constituer une œuvre à part entière – une œuvre, de part en part, collective ou du moins, comme y insiste d’emblée S. Whidden dans son introduction à La Po ju (p. 8), « fortement collaborati[ve] » : paramètre de poids, dont il serait dommageable, pour l’interprétation elle-même, de ne pas tenir suffisamment compte. Plus précisément, Bernadet distingue chez les Zutistes, d’une part, une communauté de manières, relevant de « critères externes, sociaux et biographiques », de l’autre, une communauté de manière, reposant sur « le collectif [comme] lieu d’invention de la valeur dans le langage », en l’occurrence à travers « une entreprise régulière de délégitimation et de disqualification des modèles littéraires » et, simultanément, « un mode pluriel de l’individuation, qui déborde l’identité des auteurs et la formalité des styles » au point d’y susciter quelque chose comme « un trans-sujet » qui est l’autre face ou l’autre nom du « désordre », même : scriptural autant que politique (p. 122-126).
Liés, également, aux faits – historiques et « divers » – contemporains de la conception et de la rédaction de ces textes, et des faits et gestes de leurs auteurs. Ce qui permet à B. Teyssèdre, exposant les principes de sa démarche, d’y insister à son tour, fort utilement (fou zu p. 495-496) :
On fait souvent comme si la poésie était autosuffisante. À l’époque où il écrivait dans l’Album zutique, Rimbaud était très attentif aux événements politiques, aux dangers d’une restauration royaliste et d’un putsch bonapartiste, à la répression contre les Communards, à la campagne de Mgr Dupanloup contre le projet de loi de Jules Simon sur l’enseignement primaire obligatoire, gratuit et laïque. Quand on aborde l’analyse d’un texte zutique de Rimbaud, il faut bien sûr lire les poètes de son temps qu’il avait lui-même lus […]. Mais il faut en même temps, ou plutôt avant tout, lire la presse quotidienne durant l’automne 1871.
Ou en d’autres termes, comme le résume Michael Pakenham (Po ju p. 25) : « le Cercle zutique fut la cristallisation, à l’arrivée de Rimbaud à Paris, d’un groupement – la faction Verlaine, Valade, Cros et Cabaner, née de la dissolution du Parnasse et de la Commune ». Autre pavé dans une autre mare, aujourd’hui – on veut croire – largement tarie – mais, il faut bien en convenir, pas pour tout le monde18…
Les faits, et ce qu’ils peuvent comporter d’intrigant, et de tenace, occupent donc une large place dans l’imposant ouvrage de Teyssèdre, qui se présente d’emblée comme une véritable enquête, voire comme une contre-enquête, inlassablement menée par quelque détective qui, un jour, en a fait son affaire personnelle, sur un crime en son temps inexpiable (perpétré, sous couleur de consonnes et de voyelles, contre les bases les plus sacrées de la Société), aujourd’hui – pensons-nous – largement prescrit (et bénéficiant de l’indulgence plus ou moins complice que leur vaut, selon le point de vue, un libertarisme fondamentalement progressiste ou un potachisme somme tout anodin…) – mais, il faut bien en rabattre, pas pour tout le monde !
Les faits : ce qui s’est passé, en amont, dont l’existence de l’Album est le résultat plus ou moins direct, ou accidentel ; ce qui s’est passé, durant la brève existence du groupe et celle dudit Album, dont les textes, inscriptions et graphismes divers qu’il recèle sont la trace et quelquefois, même, le commentaire plus ou moins direct, et explicite ; mais aussi bien (c’est par là que l’enquête commence), ce qui a mené, de 1873 à 1932, à sa parfaite occultation – qui tend à nous apparaître, a posteriori, comme le seul véritable crime, ou délit, commis en cette affaire – puis à partir de 1932, à son progressif dévoilement : ce qui ne scellait pas de facto (justement) sa reconnaissance, sa légitimation comme objet poétique
enfin identifié (cela commence, mais en ordre dispersé, au cours des années 60), et digne d’être accessiblement publié, étudié et commenté, au même titre que les autres œuvres de ses auteurs.
Tels, respectivement : l’importance, trop volontiers sous-estimée par les commentateurs, du rôle joué – sans qu’on sache, pour autant, en quoi il consista exactement – par ce « personnage de haut relief » que fut Charles-Auguste Bretagne, « sans lequel la vie de Rimbaud aurait suivi un tout autre cours » (p. 36-44) ; ou le scrupuleux historique des « Vilains Bonshommes » et de « feu (c’est le mot) l’Album » desdits – auxquels il faudrait ajouter le salon de Nina de Villard (Denis Saint-Amand, Po ju p. 76-78) –, avec la double série des défections pré- et post-communardes, celles-ci « précipité[es] » par l’arrivée inopinée de Rimbaud et menant droit, conformément à la stratégie de Verlaine désireux de reprendre la main, à la fondation du groupe plus radical, et restreint, des « Zutistes » (fou zu p. 73-96) ;
tels, non moins, l’historique, minutieusement reconstitué, du « Cercle » lui-même19 et de la composition de son Album (p. 102-490), et en particulier, la très convaincante tentative d’établissement d’une chronique des « 14-18 octobre 1871 : cinq jours dans la vie d’Arthur Rimbaud » ; mais également, bien sûr, le très précieux « Essai de chronologie des textes de Rimbaud dans l’Album zutique » (p. 495-506, et Po ju p. 33-52) mettant en lumière la brièveté et l’intensité de la contribution de l’auteur célébré du Bateau ivre (du 15 ou 16 octobre au 17 ou 18 novembre) et qui, s’il s’avoue explicitement et humblement « hypothétique », n’en demeure pas moins, grâce à une démarche extrêmement scrupuleuse, le plus « fiable » (c’est le défi que l’auteur relève, liminairement) dont on ait jamais pu rêver de disposer :
historique, par ailleurs, quasi indémêlable de maintes contributions, plus ou moins lumineuses, à l’exégèse des textes eux-mêmes avec, notamment, une analyse de « L’Humanité chaussait… » (p. 199-202) idéologiquement plus nuancée que celle de Jean-Pierre Chambon20, et
surtout une lecture quasiment calligrammatique de Paris (p. 233-262) que, surclassant à la fois Yves Reboul et Steve Murphy, il décrit comme une « pissotière-colonne-d’affiches » couverte, dans un apparent désordre (c’est le « constat ») ou « bric-à-brac sociologique » par là-même accusateur, de réclames qui au fil de l’énumération, composent une véritable « Nomenklatura » du capitalisme Second-Empire virant au jeu de massacre et mettant en lumière textuelle la véritable nature du système social et politique que venait de sauver, par les armes, M. Thiers avec l’aide ou l’assentiment de ladite « Nomenklatura » (c’est le « réquisitoire21 ») ;
tel, enfin, l’historique du manuscrit de l’Album une fois constitué (et ses auteurs22 dispersés), qui ne va pas aujourd’hui encore sans lacunes et incertitudes (p. 17-24, 489-490, cf. Pakenham, Po ju p. 14-20), depuis le départ de Paris de Charles Cros en septembre 1872 – voire, la publication non autorisée de Pantoum négligé dans la Renaissance du 10 août de la même année, puis celle du sonnet liminaire, dans Combat, le 28 mars 1947, par Maurice Saillet – jusqu’à sa révélation et publication partielle, par Pierre Petitfils et Henri Matarasso, dans le Mercure de France de mai 1961, et l’édition intégrale princeps qui s’ensuivit, chez Jean-Jacques Pauvert, aux bons soins de Pascal Pia, début 1962 ; sans oublier son acquisition, en 1940, par Pierre-Georges Latécoère, le célèbre pionnier de l’aviation, reliant ainsi (tangentiellement) deux aventures typiques de la modernité, qui n’avaient par ailleurs aucune raison particulière de se rejoindre !…
Quel livre est sans défauts ? Pas même, celui de Teyssèdre dont, à propos de quelques singularités, la loupe s’avère particulière…
Passons, d’abord, sur ces désolantes interpolations fictionnelles et autres délayages un peu vains qu’il s’est cru obligé de – ou autorisé à – nous infliger, croyant sans doute par là compenser le manque de documents qui permettraient de reconstituer avec quelque certitude les faits : ainsi, de l’arrivée d’Arthur chez les Mauté (p. 51-57) ou de la conversation de Paul et Arthur lors d’« une soirée de poésie dans le bureau » du premier (p. 63-65), ponctuée de la ligne-paragraphe : « Berk ! (ou si vous préférez : beurk !) », dont on eût vraiment préféré se passer !
« On peut supposer », écrit-il p. 62 ; « J’imagine », p. 63 ; « On imagine », p. 68, etc. : « Tout cela, concède-t-il p. 502, fait la part trop belle aux suppositions » et autres extrapolations emboîtées, qui risquent fort de se retrouver au bout du compte implicitement homologuées, du seul fait de figurer dans un ouvrage qui par ailleurs semble offrir toutes les garanties de sérieux scientifique – à moins qu’elles n’aient pour effet d’ébranler quelque peu lesdites garanties…
Certaines de ses observations m’ont paru surprenantes, et quelquefois fort contestables.
Je me bornerai, ici, à son analyse bien peu amène de Cocher ivre – qu’il a, bien entendu, le droit de n’aimer pas. Mais fallait-il une fois de plus céder à la manie étiemblesque, naguère encore assez largement partagée, de prendre en faute le petit génie arrogant (et sans doute, trop unanimement admiré), notamment sur le plan de la maîtrise linguistique : de la correction morpho-syntaxique à la pertinence sémantique ?
Ainsi, se demande-t-il (p. 272-273) : « peut-on dire d’une loi qu’elle est “âcre” ? Et en quel sens l’accident d’un fiacre qui se renverse pourrait-il être l’effet d’une “âcre loi” ? » Pourtant, l’incontestable interprétation vaginale qu’il vient lui-même de proposer, du mot (et du vers) « Nacre23 », aurait pu le mettre sur la voie ; de même, la récurrence de l’adjectif âcre chez Rimbaud (comme dans « l’âcre besoin » d’Oraison du soir), dans des contextes où la caractérisation ou la connotation génitale / excrémentielle ne fait aucun doute : si, réalité ou fantasme, le cocher dans son ivresse « Voit » soudain un vagin accueillant s’ouvrir devant lui, nul doute qu’il ne cède aussitôt à l’« Âcre / Loi » de l’attraction sexuelle – et en l’occurrence à celle, plus « âcre » encore, du… fiasco,
qui est à l’accident de fiacre (on sait, par ailleurs, le potentiel érotique de ce moyen de transport…) ce que le vagin ouvert est à la « nacre » : pourquoi, dans cet unique poème, Rimbaud n’aurait-il pas filé le double (au moins) sens, alors que l’auteur lui-même ne cesse de démontrer qu’il le fait partout ailleurs ?
Puis, s’agissant du dernier vers (et du dernier mot) du sonnet, il énonce (p. 273) : « À la troisième personne du présent de l’indicatif […] il faut écrire : geint. La forme geigne ne devrait s’employer qu’au subjonctif. Ainsi Rimbaud s’est permis une licence (dont il n’est pas coutumier) aux dépens de la grammaire pour trouver une rime à “saigne”. » Raisonnement typique de ce qu’en philologie, l’on nomme lectio facilior, et auquel justement il blâmait Pascal Pia de sacrifier, à propos de la rime « Enghiens / chrétiens » dans Paris (p. 256), ou le même Pia et André Guyaux à propos de la signature « Francis Coppée », au bas de « Les soirs d’été… » (p. 374). Essayons donc d’abord, en bonne méthode, la lectio difficilior : pourquoi, en effet, ce conclusif « Geigne » ne serait-il pas un subjonctif (dont en bon latiniste, le poète, quoique zutiste, connaît toutes les nuances) ? Ne parvenant pas à ses fins, le cocher frustré désirerait tant24 entendre la femme au vagin de nacre geindre de plaisir sous ses assauts (si violents qu’elle en « Saigne ») : qu’elle geigne, qu’elle geigne donc ! mais rien n’y fait… – Ou, solution moins extravagante : l’incident et la victime étant somme toute d’une égale (et coppéenne) banalité, laissons-là cette affaire : eh bien ! qu’elle tombe, qu’elle saigne, qu’elle geigne ! que nous importe ?…
Plus généralement enfin, je voudrais insister sur deux points d’histoire et de théorie poétiques et littéraires qui, me semble-t-il, abordés ici et là (au passage) comme autant d’évidences, demeurent au bout du compte dans un flou quelque peu dommageable :
– Que l’Album zutique ait été, « avant toute chose » (par exemple, avant que Verlaine ou Cros ne reprissent telles de leurs contributions dans leurs propres recueils respectifs… et, censément, plus respectables), une entreprise collective, que caractérisaient l’innovation et l’insolence aussi
bien formelles que thématiques, et un goût certain de la transgression et de la provocation morales et, au moins chez quelques-uns, politiques : il est maintenant pour le moins hasardeux de le contester ; et tel est bien, précisément, l’apport le plus décisif de ces deux volumes. Mais, cela ne saurait pour autant suffire à le considérer comme l’émanation d’un groupe relevant de la notion, un tant soit peu stricte, d’« avant-garde » : pas plus, d’ailleurs, que tel « cénacle » romantique ou tel « cercle » bohême, que l’hétéroclite cohorte des auteurs du Parnasse contemporain ou que l’indéfinissable cohue « symboliste » ; et il en va de même, a fortiori, des Vilains Bonshommes, ou encore de la revue d’Émile Blémont, La Renaissance littéraire et artistique…
C’est pourtant, par exemple, ce que laisse entendre Yoan Vérilhac dans son ouvrage, La Jeune Critique des petites revues symbolistes, affirmant sans autre justification que25 cette « critique périodique […] imposa une certaine conception de l’avant-garde » ; c’est, non moins, ce que font Lionel Cuillé et Michael Pakenham dans leurs contributions respectives à La Po ju, notamment p. 13 : la Renaissance, « revue d’avant-garde », et p. 92-94 : les zutistes, « artistes d’avant-garde ». Il est vrai qu’ils n’avancent aucun critère à l’appui d’une telle caractérisation, qui reste largement empirique et se ramène au sentiment assez vague que tel groupement d’artistes, plus ou moins en rupture avec la société bourgeoise, s’avère plus ou moins propice à l’innovation…
Cuillé pourtant va jusqu’à écrire : « Pour entrer dans le champ il faut surtout s’imposer par ses œuvres, et si possible par un appareil théorique qui confère à la pratique une théorie d’ensemble ». Et l’ombre du dogmatisme telquelien plane sur le libertarisme zutique ! Anachronisme ? Par bonheur, il n’en souscrit pas pour autant à l’idée, à vrai dire fantaisiste,
que la lettre dite « du Voyant » [qui dormait oubliée au fond d’un tiroir, chez l’insoucieux Paul Demeny] ait pu se lire comme un manifeste théorique ou comme un texte susceptible de donner une direction au groupe zutique dont il [Rimbaud] aurait pu prétendre au statut de « chef de file ».
Il en ira tout autrement, dès les années 1887 à 1892, avec René Ghil, sa revue Les Écrits pour l’Art, et son groupe « Symbolique et Instrumentiste », rebaptisé école « Philosophique-Instrumentiste », puis
« Évolutive-Instrumentiste » : groupe constitué autour d’un leader – souvent loué, mais point toujours incontesté –, d’une revue, de manifestes ; théorie esthétique articulée à un système philosophique et à des positions politiques et morales, non sans dogmatisme, polémiques et exclusions ; constant souci d’auto-légitimation, conjuguant l’affirmation de la table rase (revendication de priorité et d’innovation absolue, disqualification des adversaires, voire des réticents) et l’établissement d’une généalogie alternative (réfutation, explicite ou non, de l’historiographie officielle ou reçue), – ne reconnaît-on pas là, cette fois, tous les ingrédients qui en font, historiquement, la première avant-garde poétique et, plus généralement, artistique, en France et en Europe ?
Que Charles Cros, contrairement à Ghil, n’ait jamais été un chef (d’« École » ou de quoi que ce fût d’autre) – ce qui revient à dire, en particulier : que, contrairement aux Écrits pour l’Art, l’Album zutique n’ait en aucun cas été l’organe ou l’émanation d’un groupe d’avant-garde –, c’est ce que laisse clairement entendre, bien sûr par antiphrase parodiquement caricaturale, la réplique qui lui est prêtée, aux vers 11-12 de Propos du Cercle, le sonnet inaugural dudit Album : « […] En vérité, / L’autorité, c’est moi ! c’est moi l’autorité… ».
Inversement, s’il est vrai que l’Album fut une entreprise collective rigoureusement manuscrite, et à destination interne, du « Cercle » ainsi épithété26, cela n’implique aucunement qu’il n’y ait, comme l’affirme imprudemment le même Pakenham, « entre Zutistes et Hirsutes ou Hydropathes […], aucun lien de parenté directe » (Po ju p. 16).
Car, il s’agit bien de la même histoire ou, pour reprendre le terme-titre de Marc Partouche, de la même « lignée27 » ; et c’est là, en particulier, faire bien peu de cas de la présence activement récurrente d’un Charles Cros qui, ayant fait ses premières armes avec son frère Henry, mais aussi avec Valade et Mérat, dans le Groupisme (1868), fut des Vilains-Bonshommes et du Cercle zutiste, pour devenir bientôt l’une
des principales figures des Hydropathes (1878-1880) et du Chat noir (1881-1897 : ce n’est donc pas en 1876 que Coquelin cadet put l’y entendre réciter son Hareng saur, comme l’écrit Teyssèdre, p. 19 !) – sans parler de son éphémère résurrection du Zutisme (1883), qu’il ne faut évidemment pas confondre avec le « Cercle » de 1871-73, ou de la participation de son frère Antoine au recueil parodique des Dizains réalistes (1876), auquel contribua également Maurice Rollinat, future vedette des mêmes Hydropathes et du même Chat noir…
(Inversement encore, p. 663 n.2, l’évocation plaisante, dans « [l]e no du 15 avril 1870 du Monde du Rire », d’« une Joconde noircie […] avec ce commentaire : “La femme à barbe […]” » ne saurait justifier cette conclusion expéditivement obscurantiste : « Ainsi Picabia et Duchamp n’ont rien inventé », auquel Daniel Grojnowski avait répondu d’avance28. Il était beaucoup mieux inspiré, p. 262, lorsqu’il voyait Paris comme « une séquence de clusters verbaux » et, par là-même, comme le lieu d’« une innovation structurale inouïe » qui en fait « ce monolithe pré-dadaïste bâti d’un discours éclaté » : telle ou telle anticipation, si fulgurante fût-elle, par Rimbaud ou quelque autre, d’inventions dues, quelques décennies plus tard, à Apollinaire, Duchamp ou Picabia, suffit-elle à leur dénier le statut d’inventions ? Ou, p. 405-406, lorsqu’il soulignait le caractère novateur de Paris, de Vieux de la vieille et des Hypotyposes saturniennes, dû notamment à une technique de « collage » ou, plutôt, de « détournement » conçue comme « stratégie poétique-politique », proche de celle d’Isidore Ducasse ; mais, pourquoi s’entêter à l’appeler « Lautréamont », vingt ans après le livre définitif de Sylvain-Christian David29 ?…)
Même histoire, donc : celle d’une poésie par trop « jubilatoire » (et joculatoire) en ces temps de répression et d’expiation – consécutifs à la Semaine sanglante – et, pour cela, marginalisée, mais qu’une certaine libéralisation de l’espace public – marquant les premiers pas d’une République enfin stabilisée – et surtout, un événement majeur (quoique généralement inaperçu comme tel, voire inaperçu tout court) allaient, subitement, mettre en pleine lumière (au risque, bien sûr, de l’édulcorer) : celle d’une poésie résolument jaculatoire (et, bien souvent, joculatoire elle
aussi). Cet événement fut – indissolublement liée à la création même des Hydropathes – la décision d’Émile Goudeau, de faire réciter des poèmes, sauf exceptions, par leurs auteurs eux-mêmes, ainsi exposés aux réactions (et à la demande) d’un public mêlé, et non choisi : on basculait ainsi, en matière de réalisations orales, d’une poésie cénaculaire en voie d’essoufflement, à une poésie scénique, promise à quelque bruit…
Jean-Pierre Bobillot