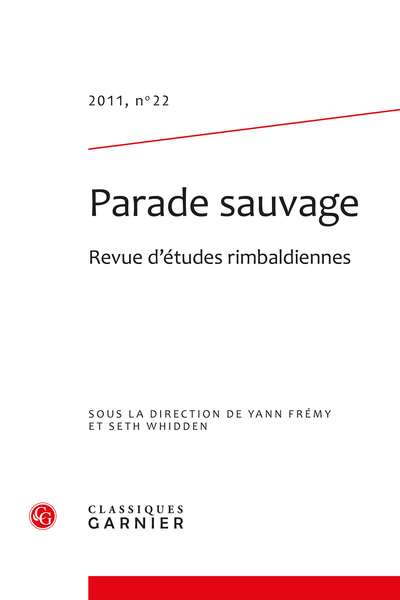
Comptes rendus
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Parade sauvage
2011, n° 22. Revue d’études rimbaldiennes - Auteurs : Bobillot (Jean-Pierre), Rocher (Philippe), Whitaker (Marie-Joséphine), Bardel (Alain), Vaillant (Alain), Whidden (Seth)
- Pages : 211 à 276
- Revue : Parade sauvage
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812445415
- ISBN : 978-2-8124-4541-5
- ISSN : 2262-2268
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-4541-5.p.0211
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 01/12/2011
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
Jean-Louis Baudry, Le Texte de Rimbaud [avec une préface de Laurent Zimmermann, et en postface, un entretien entre J.-L. Baudry et L. Zimmermann], Cécile Defaut, 2009, 144 p.
Écrire, discourir à propos de Rimbaud, est quasi immanquablement le prétexte, délibéré ou ingénu, à parler de tout autre chose : un rorschach idéologique. On me pardonnera, peut-être, de reprendre ici cette phrase que j’inscrivais à l’incipit d’un récent article consacré à la question politique, chez Rimbaud : c’est qu’elle me semble, exemplairement, s’appliquer tant à la parution, en 1968 et 1969, dans la revue Tel Quel, du long et foisonnant article de Baudry – lequel par ailleurs n’élude pas, on s’en doute, les implications politiques de son objet ni du traitement (de choc) qu’il en propose –, qu’à sa réédition, en volume, 40 ans plus tard – dans un tout autre contexte politique et intellectuel. Il faudrait seulement préciser, en l’occurrence : délibéré, plus qu’ingénu ; non dénué, cependant, d’une certaine dose d’ingénuité, qu’oblitérait alors un non moins certain dogmatisme, bien dans l’air du temps…
1968. En ce temps-là, en effet, la Rimbald(olog)ie n’était pas encore ce qu’elle ne serait plus qu’elle sera : bouffie de mythe(s) et de biographi(sm)e – pardon ! –, elle dut, à la fois, faire face à la « mort du sujet » (consentant ou non) et à l’« individualisme révolutionnaire » (ou pas). Et l’on s’efforçait vers une « science de la littérature » …tout en déclarant morte et enterrée ladite littérature (censément bourgeoise), à laquelle se substituaient « l’écriture », et « le texte » (forcément révolutionnaires). C’était, pour le moins, la quadrature du cercle vicieux !
Le texte de Baudry tentait, brillamment, d’arracher Rimbaud à ce biomythographisme alors régnant, et de tenir d’une même donne argumentative tous les bouts du paradoxe : or ce faisant, bien sûr, il péchait par l’excès contraire, également d’époque.
Lourde tâche, donc ! car il fallait pour cela, à l’encontre de toutes les approches et appropriations critiques antérieures (pour ne pas parler des hagiographiques), évacuer l’encombrant individu Rimbaud – supposé imaginaire – au profit d’un texte dont le sujet, « qui s’en croyait l’auteur »,
enfin déniaisé par la conscience qu’il en prend (« la pensée chantée et comprise du chanteur »), s’avère être l’« effet », le produit et non le producteur, et dont le caractère océanique s’impose à lui au point qu’il y disparaît (« dans le Poème / De la Mer »), au profit d’un pur scripteur anonyme immanent à son écriture, même – de l’ordre du symbolique : « un texte sans sujet ».
Véritable processus de « destitution du sujet » (souligne Zimmermann), qu’il conviendrait sans doute – à supposer, un peu vite, l’identification du « poète » au « sujet » (et vice versa) – de rapporter à la mallarméenne « disparition élocutoire du poète, qui cède l’initiative aux mots ». Mais, avec toutes les précautions exigibles, car : loin de tout idéalisme, c’est un matérialisme poétique absolu, s’adossant à un matérialisme philosophique tout aussi absolu, issu des Lumières, qui sous-tend la version rimbaldienne (de loin, la plus abrupte) de la « révolution du langage poétique », passée ici au crible d’un matérialisme textuel d’obédience freudo-marxiste autant que déconstructionniste – lequel y (r)établit ainsi, le mettant en lumière, un maillon particulièrement crucial de sa propre généalogie (arraché, au même titre que Ducasse, à la généalogie surréaliste : « texte » contre « poésie », « travail » contre « automatisme »).
Ainsi avait fait, en amont, Marcelin Pleynet en publiant son recueil inaugural, Provisoires amants des nègres (1962, sorte de continuation en même temps que de commentaire de la Saison), puis surtout, son Lautréamont (1967, initialement dédié à Ponge, première figure tutélaire de la revue), bientôt suivi de « La science de Lautréamont » de Philippe Sollers (Critique no 245, 1967). Or, sans pointer explicitement l’inconfortable situation de concurrence où il se trouva ainsi placé, vis-à-vis du tandem directeur de la revue et du groupe, Baudry lui-même fait cependant remarquer – et c’est déjà dire beaucoup – à son interlocuteur et préfacier, qu’après la parution des deux études de Pleynet et Sollers sur Ducasse :
l’évocation de Rimbaud fait de l’ombre à la position « littéraire », symbolique et bibliographique de Lautréamont […]. C’est pourquoi avec cette étude je parais m’opposer à un engouement partagé, je brise un silence qu’il convenait d’accepter, que je trouve injuste, qu’il serait lâche à mon sens de prolonger. (p. 118)
Logique des avant-gardes : il n’aurait bientôt plus d’autre choix que de s’exclure lui-même…
Curieusement, Zimmermann (p. 13) ne juge « pas utile d’insister sur ce contexte », qu’il n’effleure que du point de vue des références théoriques (Derrida, Foucault, Barthes) – ce qui l’incline, non sans quelque optimisme à notre époque d’oubli galopant (et organisé), à le tenir pour « relativement évident » –, évacuant ainsi polémiques et rapports de force, lesquels pourtant ne sauraient être sans incidences sur les écrits qu’ils suscitent ou dont ils informent, peu ou prou, les visées ou les effets de sens, non seulement sur le plan idéologique, mais, de proche en proche, à tous égards : tant Rimbaud, plus encore que Ducasse, y apparaît comme un enjeu déterminant dans les luttes et les stratégies, y compris de pouvoir, opposant les diverses composantes du champ littéraire et intellectuel d’alors (voire, différents auteurs rassemblés dans une même composante).
Dans un préalable article, au titre suffisamment explicite : « Écriture, fiction, idéologie » (Tel Quel no 31, 1967, repris dans Théorie d’ensemble, 1968), Baudry n’évoquait-il pas « une écriture a-causale caractérisée d’abord par la disparition d’un signifié qui en serait à la fois l’origine (l’auteur comme cause) et le but (la vérité, la loi, l’expressivité) » ? Bien qu’il s’y référât davantage à Ducasse (et à Mallarmé), c’était là, clairement, établir les fondements conceptuels qui allaient être repris, l’année d’après, dans le « versant théorique » du « Texte de Rimbaud », à l’appui de l’« application » que ce nouvel article en proposait, à la manière d’un décisif défi, en présentant « dans des termes et selon une orientation de pensée qui ont pu servir pour Lautréamont » – sur l’existence et la personnalité duquel on savait si peu – l’œuvre poétique (censément) la plus saturée de subjectivité, et de substrats biographiques, qui fût : et la validation de ses propres postulats, que l’auteur en espérait (même s’il ne le dit pas ainsi), en serait d’autant plus éclatante !
– Processus, d’une part, strictement textuel ou scriptural : « l’écriture » (poursuit le préfacier, p. 11) étant chez Baudry, c’est-à-dire à Tel Quel et chez un certain nombre de satellites et de sympathisants, « le nom d’un retour du texte sur lui-même » participant, tout à la fois, de quelque chose comme la jakobsonienne « fonction poétique du langage » (à ne pas rabattre sur un prétendu « langage poétique ») et sa « fonction métalinguistique » (métatextuelle, donc, ou métapoétique), et, en
– termes lacaniens, d’un « glissement métonymique des signifiants » que ne viendrait ancrer aucun « point de capiton ».
– Processus, d’autre part, éminemment historique en ce qu’il intervient à un moment aussi crucial que le maillon formé par le « texte que recouvre le nom de Rimbaud ». Or, chose étrange chez cet auteur imprégné de marxisme, ce moment, s’il est défini (p. 63) comme « moment symbolique – […] épreuve de la rupture pren[ant], entre autres, le nom de Rimbaud comme elle peut aussi s’appeler Lautréamont et Mallarmé », est fort peu explicitement, et encore moins argumentativement rapporté à ce moment réel – épreuve de la rupture prenant, entre autres, le nom de Commune de Paris comme elle peut aussi s’appeler Proudhon, Marx, etc. : phase d’accélération et de récapitulation du long processus de « désenchantement du monde » (Weber, Gauchet) et de destitution, non seulement du sujet, mais de toutes les « tutelles » maintenant l’humanité et, en particulier, la civilisation occidentale, dans l’« enfance » (Kant). C’est, pourtant, ce que semble réclamer le statut, fût-il symbolique, d’Une saison comme « dernier texte de l’Occident », c’est-à-dire, comme pratique textuelle révolutionnaire opérant une radicale réécriture / relecture du « texte idéologique de l’Occident » dont l’effet majeur est, précisément, de l’exhiber comme tel : ce que, par définition, il n’aura eu de cesse – se présentant « comme expression et recherche d’un sens ultime, d’une origine, d’un signifié transcendantal » – de dénier.
Symptôme, avançons-le, d’une difficulté à établir clairement, en théorie comme en pratique, l’articulation entre « matérialisme textuel » et « matérialisme historique », entre révolution du langage poétique (s’attaquant à tel champ superstructurel) et révolution tout court (ébranlant toute l’infrastructure) : sans parler du rôle des individus en cette affaire. – Mallarmé ne pointait-il pas, d’un côté, une troublante autonomie de l’histoire des formes poétiques : « Les gouvernements changent ; toujours la prosodie reste intacte. » (La Musique et les Lettres.) À l’inverse cependant, observant l’éclosion de ce vers qu’il préfère nommer, « comme il sied, polymorphe » (le « vers libre »), il esquissait une interprétation très précise de la concomitance – impliquant, donc,
une articulation historique – des « récentes innovations » apparues dans le champ poétique avec un certain désarroi s’immisçant dans le champ culturel en général ainsi que dans les consciences individuelles, et avec les profondes mutations en cours dans la société : « dans une société sans stabilité, sans unité, il ne peut se créer d’art stable, d’art définitif. De cette organisation sociale inachevée, qui explique en même temps l’inquiétude des esprits, naît l’inexpliqué besoin d’individualité dont les manifestations littéraires présentes sont le reflet direct. » (Réponse à Jules Huret, Enquête sur l’Évolution littéraire)
Or il n’en fallait pas moins valoriser, dans le même temps (d’un même geste théorique), la singularité extrême des procédures textuelles ainsi mises en œuvre et leur caractère d’inouïe radicalité – tout en esquivant l’insistante et insidieuse question de savoir comment (sans parler de : pourquoi) ce procès scriptural d’« exception » s’incarna, précisément, à travers cet ensemble de textes, censément hétérogène, mais tout de même signé, l’auteur s’en avise, de l’unique nom de Rimbaud (et, on s’étonne qu’il en fasse si peu de cas, de quelques autres dont ceux d’Alcide Bava ou de … Jean Baudry !)
L’« expérience des limites » requiert, impérieusement et sans limites, l’implication de qui s’y livre et donc, par présupposé, un qui s’y livre : même le « Bateau ivre » dit je, ce qui n’est pas toujours le cas chez celui qui a constaté que « Je est un autre » (dans Les Poètes de sept ans, contre toute attente, il écrit il). Car enfin, si l’on ne peut que souscrire, au terme d’une implacable et éblouissante analyse, à cette idée (p. 68) « qu’Une saison en enfer [et il faudrait y ajouter, au fil des différentes “séquences textuelles” qui le composent, tout ce qui, de l’entier “texte de Rimbaud”, s’y rattache] soit bien la relation de toutes les tentatives faites pour échapper à l’espace clos de la pensée occidentale », il faut bien admettre, pour autant, que ces « tentatives » n’y sont pas seulement « relatées », de l’extérieur, froidement, mais assumées, sans en excepter les plus fâcheuses conséquences, par un « je », – certes, multiplement « clivé », opaque à soi dans sa cruelle lucidité, flottant, – mais qui, « rendu au sol », envisage encore, à la ferveur d’un nouveau « départ », de « posséder la vérité dans une âme et un corps »…
C’est que, je le suggérais plus haut, l’identification du « poète » – ou de l’auteur, ou de l’individu biographique – au « sujet », à laquelle se livre Baudry – pour mieux les déclarer, d’un même effet textuel, tout
uniment, déchus (intempestive équivalence à l’œuvre, aussi bien, dans la barthienne « mort de l’auteur ») –, relève plus sûrement d’une décision idéologique (d’une passion politique) que d’une argumentation (d’une rationalisation) basée sur l’observation des écrits et des faits. Commentant (p. 56) le fameux « Je est un autre », rapproché du non moins fameux « On me pense », il passe même aveuglément à côté de l’explicite topique qu’y esquissait, non sans lucidité, Rimbaud : celle d’une subjectivité instable, décentrée, indéfiniment prise aux pièges du réel, entre aliénation – par quoi un au-delà (« on », c’est-à-dire, non pas : « le texte […] pensant celui qui le lit », mais, précisément : « le texte idéologique de l’Occident », l’impérieux discours des « tutelles ») la « pense », lui imposant « la signification fausse […] du moi » (quelque chose comme le surmoi ou l’idéal du moi freudiens) – et altération – par quoi un en deçà (« je » qui « est un autre » : ce qui pense en moi sans moi : quelque chose, donc, comme l’inconscient, du subconscient au ça) se manifeste, la traverse, se rappelle à elle, en « fai[san]t son remuement dans les profondeurs » ou en « v[ena]nt d’un bond sur la scène » : autant d’appels (venus de l’autre scène), entendus ou ignorés, suivis d’effets ou refoulés, à lever les censures – au profit, n’excluant ni pertes ni fracas, de « la liberté libre »…
Certes, Baudry glose à juste titre : « “Je” est donc un autre et non le sujet personnel que la langue nous a appris à désigner. » Mais s’ensuit-il inéluctablement qu’il soit exhaustivement réductible au « texte » ? Or, chose étrange chez cet auteur imprégné de freudisme, il ne semble pourtant concevoir la subjectivité que comme un continuum intégrant aussi bien l’être biographique (l’individu, l’auteur, la personne ?) que l’instance énonciative ou toute autre instance, écrivante, parlante ou pensante (le psychisme ? le sujet ?) : déclarant l’un déchu, ou irrecevable, il englobait l’ensemble dans une seule et même déchéance, ou irrecevabilité de principe. C’était aller vite en besogne, et ignorer une précieuse distinction qu’en d’autres termes, allait clairement formuler Henri Meschonnic (« Mallarmé au-delà du silence » dans Écrits sur le Livre, éd. de l’Éclat, 1985) : « le travail du poème dans le sujet est dit en termes de dépersonnalisation […]. Le paradoxe de cette découverte de l’impersonnalité est qu’elle est celle de la poésie elle-même. Et peut-être justement, par là, celle de la subjectivité. Non psychologique, mais langagière, poétique. La découverte de la différence entre l’individu et le sujet. » Soit, en termes mallarméens : entre « auteur, poète, signataire »
et « âme, nœud rythmique, ouïe individuelle » ; ou, en termes rimbaldiens : entre « la signification fausse […] du moi », ce « me » qu’« on pense » (moi-même), et « je » qui « est un autre », « la symphonie » elle-même (je-autre) ou « je » qui, ayant « lanc[é] un coup d’archet », « assiste à l’éclosion de [s]a pensée » (moi-autre).
Plus simplement, et d’un autre point de vue, on se souvient que Pierre Brunel, dans « Ce sans-cœur de Rimbaud », son désormais classique « essai de biographie intérieure » (L’Herne, 1999), avait écrit ceci, qui devrait permettre de (re)penser sur des bases enfin démythifiées et dépolémiquées l’articulation, toujours pendante, du poétique au biographique :
La liaison de Verlaine et de Rimbaud a été la rencontre occasionnelle et prolongée quelque temps d’un sentimental et d’un sans-cœur. L’aîné s’abandonnait aux élans du cœur […]. Le cadet […] était défiant à l’égard du cœur. Il lui préférait en poésie l’intelligence, et dans la vie ce qu’il a parfois appelé la Force.
Or, le « sentimental » chez Verlaine est, dans son meilleur, de l’ordre du senti / mental : ce qu’a su reconnaître, n’en doutons pas, Rimbaud – qui avait résolument élu, dans la vie comme en poésie, le senti contre l’Idéal, le mental face au Spirituel. Sans doute, aura-t-il tôt décelé, chez le futur « Loyola », le Spirituel aux aguets sous le senti, l’Idéal tapi sous le mental…
Congédiant biographie et histoire littéraire – proclamées « réactionnaires » en vertu d’un anti-saintebeuvisme et d’un anti-lansonisme expéditifs, opportunément marxisés –, l’air du temps interdisait tout net à Baudry ce genre d’observations ; il n’en recourait pas moins (p. 28) pour les besoins de sa cause, avec une quasi scolaire naïveté, et suivant une chronologie quelque peu élastique, à la notion elle-même incertaine de « symbolisme » – qu’il donnait, fallacieusement, comme une des « théories littéraires » du temps ! Misère des idéologies : à trop vouloir faire table rase des discours convenus, et des édulcorations (censément) propres à la « culture bourgeoise », c’était retomber dans les vieilles lunes, prêter foi à des assimilations dignes des pires simplifications journalistiques, ou traînant dans les manuels les plus ringards !…
De même, a-t-il exagéré jusqu’à l’hypostase, toujours pour servir son propos, de prétendues « coupures » entre les grands blocs textuels constituant, là encore selon une chronologie plus ou moins défaillante, « le texte de Rimbaud ». Ainsi, affirme-t-il sans avancer le moindre commencement d’une preuve :
Contrairement à ce qui apparaît avec Lautréamont et Mallarmé dont les différentes séquences textuelles renvoient à une stratégie d’ensemble […], le texte qui nous est parvenu signé par le nom de Rimbaud, considéré dans sa totalité, est fait de parties hétérogènes entre lesquelles il ne semble pas possible d’établir une continuité. Loin de renvoyer les unes aux autres et de s’éclairer par leurs places mutuelles comme c’est le cas dans le rapport Chants de Maldoror – Lautréamont / Poésies de Ducasse, elles paraissent plutôt déterminées par des ruptures successives, et appartenir chacune à un espace textuel différent et irréductible. Poésies, Derniers Vers, Une saison en enfer, les Illuminations. (p. 25)
Ingénuité nominaliste : de ces « parties hétérogènes », on sait depuis longtemps qu’au moins les deux premières sont de purs artefacts d’édition, qui ont varié au fil du temps ; et, de ces « ruptures », outre qu’il serait aisé d’en trouver d’au moins aussi flagrantes dans « le texte de Mallarmé » (et chez beaucoup d’autres auteurs), des recherches plus récentes – en particulier, celles de Steve Murphy – en ont montré le caractère largement illusoire.
Mais les notions, qu’il avance (p. 33) et illustre, de « texte social » (contenu et sens du contenu : effets répressifs et de reproduction des rapports de production et de l’ordre social) et de « texte culturel » (forme et sens de la forme : effets de dissimulation et de dénégation des procès de production et de la fonction idéologique du texte social, comme de sa propre complicité en cette affaire), bref : son insistance sur la mise en évidence et la déconstruction polémiques, dans la Saison et ailleurs, du « texte idéologique de l’Occident », anticipe sans conteste bien des analyses actuelles – en particulier, justement, chez le même Murphy.
Le texte de Baudry n’avait jamais été réédité ; et, dans son Histoire de Tel Quel (1995), si fouillée en bien des pages, Philippe Forest n’en fait aucun cas. C’est qu’entre temps (1973), l’auteur, très en pointe à l’époque lacano-mao-textualiste, avait dû quitter le groupe, par suite d’un désaccord qui, à vrai dire, couvait depuis longtemps entre lui et Sollers…
L’actuelle et salutaire republication offre le double avantage [1o] de le restituer tel qu’en lui-même, dans toute la ruptive virulence de sa prime apparition, et [2o] de le resituer dans le contexte récemment renouvelé et redynamisé des études rimbaldiennes – auquel la présente revue n’est point étrangère. L’entretien avec Zimmermann, fort stimulant, permet à Baudry, non seulement de remettre sa propre approche en perspective – historique, et même autobiographique ! –, mais de revenir hardiment sur quelques dogmes d’époque – tel, justement, l’interdit de principe
pesant, en vertu d’une supposée « science du texte », sur le recours à tout élément d’ordre biographique ou relevant de l’histoire littéraire. Ainsi, doit-il admettre (p. 121-122) « que dans Une saison en enfer se superposent deux dimensions de l’histoire » : l’une, « générale » ; l’autre, « singulière », dont « on n[e] pouvait mener l’analyse sans en appeler à la biographie, à ce qu’on sait de l’existence de Rimbaud durant ces années. » D’où, la proposition générico-généalogique, bien peu telquelienne (mais que dire du Sollers d’aujourd’hui ?…), selon laquelle
cette histoire qu’alors je disais être « l’histoire d’un texte, d’une production textuelle qui comprend le sujet qui s’en croyait l’auteur comme son propre effet », on pourrait aussi la ranger parmi les Confessions. Elles rappellent d’ailleurs moins celles de Rousseau que, par leur contenu et leur adresse, par l’intensité des mouvements subjectifs, par le rythme haletant de la respiration, par le sentiment des abîmes côtoyés, par l’appel à une conversion, par une pensée du temps qui traverse l’ensemble narratif, celles d’Augustin.
Mais surtout – s’engouffrant dans cette brèche théorique et renvoyant, dos à dos, « matérialisme textuel » façon Tel Quel et « automatisme psychique » d’obédience surréaliste –, d’y adjoindre (p. 125 sq.) une très-belle et féconde hypothèse de lecture, touchant à ce que Rimbaud nommait « ses visions, ses enchantements » : cette « indéfinissable apparition mentale dont [le souvenir] est fait », et dont l’« extrême mobilité » détermine une écriture (exemplairement, celle de Mémoire) qui ne reçoit « comme matériau de poésie que ce qui est déjà passé par l’esprit, ce que l’esprit y a déposé, qu’il a transformé » – du senti / mental, justement !
Jean-Pierre Bobillot,
université Stendhal – Grenoble 3
Benoît de Cornulier, De la métrique à l’interprétation. Essais sur Rimbaud, Classiques Garnier, collection « Études rimbaldiennes », 2009, 560 p.
Le premier volume de la collection « Études rimbaldiennes » de Classiques Garnier rassemble l’essentiel des études que Benoît de Cornulier a consacrées aux poésies de Rimbaud depuis plus d’une vingtaine d’années, soit treize articles, tous déjà publiés dans diverses revues (dont Parade sauvage) ou recueils, et dont chacun est autant une contribution majeure à la lecture et à la compréhension de l’œuvre en vers de Rimbaud, qu’une illustration exemplaire de la pertinence des principes et de la méthode exposés dans Théorie du vers : Rimbaud, Verlaine, Mallarmé (Seuil, 1982) et dans Art Poëtique. Notions et problèmes de métriques (Presses Universitaires de Lyon, 1995).
S’il est « à lire absolument » non seulement par les « littéraires », mais aussi par les linguistes concernés par la métrique et plus généralement par la poétique, c’est d’abord qu’il contient, à n’en pas douter, quelques-uns des meilleurs articles qui aient jamais été écrits sur des poèmes de Rimbaud, et qui au moment de leur publication avaient déjà impressionné les rimbaldiens « canal historique » par leur richesse, leur perspicacité et leur érudition. Mais c’est aussi que ces articles, connus des spécialistes, souvent commentés et cités, (à cet égard, le récent volume de La Pléiade ne leur rend pas vraiment justice), ou à l’origine d’importants débats exégétiques, ont été remaniés et augmentés parfois de manière conséquente. Celui sur Mes premières communions, est ainsi complété de trois annexes, « La conception de Jésus selon l’évangile de Saint-Luc », « Les souvenirs de première Communion de Thérèse de l’Enfant Jésus » et « Petit essai de stylistique métrique. À propos des mots conclusifs de sizains ». Celui sur Jeune ménage se termine par une étude comparative, « Des Premières communions à Jeune ménage », les deux poèmes étant concernés par « le lien de l’homme et du sacré marqué par la descente du divin (Dieu, Esprit Saint, Jésus Christ…) du Ciel sur la Terre », et par une discussion avec Bernard Meyer sur le sens de la prière finale de Jeune Ménage. Et enfin l’article sur « Qu’est-ce pour nous… », désormais de plus de cent pages et constituant à lui seul une monographie qui mériterait une recension pour elle-même, tient compte
de ce qui s’est écrit depuis sa première publication et contient un développement supplémentaire comparatif avec Mémoire et Famille maudite.
La réécriture concerne l’ensemble des articles en présence, et l’on a d’autant moins affaire à une simple compilation que l’ensemble est par ailleurs très unifié par une démarche de lecture constamment soucieuse de l’articulation de la métrique et du sens, et que le sous-titre « essai sur Rimbaud », au singulier, conviendrait parfaitement à cet ouvrage homogène.
La première partie, « analyses », regroupe des études consacrées à un poème particulier : « Une césure particulière » (à propos de « Morts de Quatre-vingt-douze… »), « Sur Ma bohème. Fantaisie », « Fête de la guerre : Le Chant de guerre parisien », « Le rimeur étourdi des Premières communions », « La chambre ouverte d’un Jeune ménage », « Chanson de la plus haute tour », « “Qu’est-ce pour nous…” comme dialogue dramatique de l’esprit et du cœur ». On peut regretter, seul défaut de l’ouvrage à mes yeux, l’absence de l’article important consacré à Mes Petites amoureuses, « Le violon enragé d’Arthur pour ses Petites amoureuses », paru dans le no 15 de Parade sauvage en 1998. La seconde partie, sous le titre « métrique », réunit les articles traitant d’un point de métrique plus générale et concernant un corpus de poèmes sur une période donnée : « L’alexandrin », « La métrique de Rimbaud avant 1872 », « Bizarreries métriques du jeune Rimbaud », « Illuminations métriques : des vers dans la prose », « Le mètre impair et l’insaisissable dans les derniers vers » et « Style métrique de chant : exemples chez Baudelaire et Rimbaud ». L’ensemble est complété par un glossaire où, d’« alexandrin » à « voyelle », sont définis ou redéfinis tous les termes techniques et les notions réputées rugueuses utilisées, et souvent forgées, par Cornulier, d’une bibliographie et d’un index des textes cités, donnant un net aperçu de l’ampleur du corpus examiné.
Le titre, De la métrique à l’interprétation, n’indique donc pas l’organisation du volume, qui s’ouvre sur les interprétations, mais il résume en revanche assez bien la méthode de lecture consistant à prendre en compte sérieusement le fait que la plupart des poèmes de Rimbaud, qui avait « la mécanique des vers comme personne », sont écrits en vers, et que pour le lecteur « l’accès au rythme peut conditionner l’accès au sens ». Comme le dit l’auteur dans son introduction, « les “analyses” de poèmes s’appuient largement sur les conclusions des études métriques et laissent parfois apparaître une démarche qui m’a conduit, comme naturellement et parfois presque méthodiquement, de l’étude d’une particularité rythmique à l’étude du sens ».
Les deux premières études sont exemplaires de ce point de vue, où les hypothèses sur la lecture 6-6 de vers tels que « Morts de Valmy, Morts de Fleurus, Morts d’Italie », et « Comme des lyres, je tirais les élastiques », généralement lus comme des 4-4-4 exclusifs, convergent de façon convaincante avec l’interprétation d’ensemble de chacun des deux sonnets. La césure doublement particulière sur « de » anoblit les « Morts de Quatre-vingt-douze » en les dotant d’une particule, et celle sur « je » succédant immédiatement à « lyres » et accompagnée d’une « mimétique de l’élasticité », manifeste une expressivité anti-lyrique qui subvertit opportunément l’image du poète à la lyre. Or, pour apprécier pleinement l’importance de tels phénomènes, Cornulier combine heureusement ses « microlectures » et ses études d’ensemble. Les mises en perspective historiques et la prise en compte des usages du vers à cette période nous apprennent ainsi d’une part que ces deux types de césure sur proclitique sont loin d’être une banalité et d’autre part que les vers du premier Rimbaud, bien que majoritairement réguliers, sont déjà « piégés » par endroit. On a donc tout intérêt à croiser la lecture des analyses et celle, complémentaire, des études de corpus de la seconde partie, celle sur l’alexandrin en particulier, qui expose très utilement la méthode et les critères d’analyse du vers, et propose de surcroît en annexe des listes de vers 12-syllabiques classés selon leur type de césure.
L’articulation de la métrique, du rythme et du sens est constante dans les analyses, et la focalisation non exclusive et ponctuelle sur tel ou tel phénomène métrique (césure irrégulière, rejet remarquable, rimes problématiques, changement de rythme strophique…) s’inscrit dans une lecture méthodique de préférence littérale et suivie (du début à la fin) des poèmes où les dimensions morphologiques, syntaxiques et lexicales sont tout aussi rigoureusement examinées. Le souci du détail métrique est à prendre ici comme une composante d’un souci plus fondamental, systématique et méthodiquement fructueux pour l’interprétation, du détail linguistique et textuel. Ce qui devrait aller de soi si l’on considère que l’interprétation des énoncés en général s’appuie sur un premier niveau de signification qu’il s’agit de « décoder » à partir des données linguistiques, et que les poèmes versifiés, doublement structurés, intègrent à ce premier niveau l’organisation métrique (vers et strophes) de leurs unités linguistiques. L’accès au sens du texte, a fortiori à son interprétation « symbolique » et aux intentions de l’auteur, devrait donc
supposer que soient d’abord traités conjointement tous ces niveaux de surface, métrique comprise. Or il y a loin du consensus de principe et d’une pratique effective pas toujours soucieuse du texte, et pour cette raison même, parfois spéculative, voire divinatoire. Sous cet angle les lectures de Cornulier sont de véritables leçons de rigueur où rien n’est avancé pour l’interprétation, aussi audacieuse et inattendue soit-elle, qui ne soit sérieusement argumenté et « autorisé » par le texte. Ce qui n’exclut pas, bien au contraire, en appui de ses hypothèses, le recours à l’intertextualité, aux exemples d’époque en usage et la mobilisation de connaissances extratextuelles parfois impressionnantes, par exemple concernant l’église, sa liturgie, son histoire et ses textes, ou encore relatives à l’étymologie et aux latinismes dont on connait l’importance chez Rimbaud. Il importe aussi d’ajouter que si, en bon linguiste, Cornulier use d’un vocabulaire précis et de notions pointues aussi bien en sémantique, en syntaxe et en phonologie, c’est pour mieux servir l’analyse du texte, et qu’il ne tombe jamais dans le piège de certaines études « stylistiques » où le matériel verbal est parfois noyé et oublié dans de longs développements techniques à propos de faits de langues et de grammaire.
De ce point de vue, on appréciera les argumentations métriques et sémantiques au sujet de la rime « catéchistes : : Catéchistes » et du changement strophique des Premières communions, et on lira ou relira avec intérêt l’analyse convaincante de Chant de guerre parisien comme transfiguration du tragique en festif, celle de la Chanson de la plus haute tour où la transformation d’une chanson populaire de travail ou d’une ronde enfantine en poème n’engage pas seulement la forme et le style métrique de chant, celle de Jeune ménage, où, entre autres pépites, est réévaluée la pertinence métrique et sémantique de la virgule du vers « Le marié, a le vent qui le floue », arbitrairement supprimée dans les éditions. Et pour « Qu’est-ce pour nous… », si important pour la métrique et son histoire, on remarquera qu’il n’est en rien paradoxal pour Cornulier de considérer qu’une attention exclusive à la métrique peut parfois conduire à une lecture approximative. Il montre en effet combien est fructueuse en revanche la combinaison de l’analyse métrique et de l’examen des détails énonciatifs et syntaxiques et des registres de langue.
L’apport de Cornulier à l’étude de l’œuvre de Rimbaud est connu dans le champ, passionné s’il en est, de l’exégèse rimbaldienne. Un
de ses grands mérites, au-delà des brillantes analyses de poèmes, est d’avoir contribué à mieux cerner les étapes, les tendances et les enjeux de l’écriture de Rimbaud du point de vue de la versification, et de mieux préciser la place et le rôle du poète ardennais dans l’histoire du vers français. Par ses clarifications rigoureuses et argumentées réunies dans la deuxième partie, il a ainsi permis de toucher à un mythe-Rimbaud tous azimuts qui n’avait pas épargné le vers, soit parce que le vers ne comptait pas, étant données les Illuminations, soit qu’il était, sans discernement, jugé subversif ou « insaisissable » à chaque période de l’œuvre, étant donné Rimbaud… Il est donc heureux, pour qui cherche aussi bien à apprécier la portée d’un poème particulier que celle de l’œuvre entière, que ces études soient enfin rassemblées en un seul ouvrage qui constitue certainement à ce jour l’un des plus importants de l’histoire de la critique rimbaldienne.
Philippe Rocher
Seth Whidden, Leaving Parnassus : The Lyric Subject in Verlaine and Rimbaud, Amsterdam / New York, Rodopi, 2007, 230 p.
Le titre de l’ouvrage de M. Seth Whidden, professeur à Villanova University, Pennsylvanie, pourrait se traduire comme suit : Verlaine et Rimbaud se détournent du Parnasse et optent pour le moi lyrique. « Se détournent » est-il dit ici, car il ne s’agit point, strictement parlant, de rupture ou de rejet, mais plutôt de prise de distance et de recherche, pour chacun des deux poètes d’« une voix propre » (p. 51). Tout en s’éloignant du Parnasse comme du Romantisme, Verlaine et Rimbaud, plutôt que de les renier1, auraient transformé l’apport de ces mouvements qui précèdent le Symbolisme, le Parnasse ayant tenu le haut du pavé jusqu’en 18902. La continuité avec les prises de position de ce dernier groupe se perçoit au seul paganisme hérité de celui-ci, dont Baudelaire notait sans indulgence les excès sous le titre d’« École païenne ». Dans ce contexte on se reportera aux pages consacrées par M. Whidden à Soleil et chair, Credo in unam, (p. 120) au rôle de Vénus dans Villes de Rimbaud ou encore à la femme statue chez Verlaine (p. 46).
Le plan du livre est des plus simples, au sens de logique et clair : encadrés par une introduction et une brève conclusion, trois chapitres, dont le premier expose fort savamment, de manière nuancée – comme nous voudrions le montrer – la théorie parnassienne et examine la dette de chacun des deux poètes, contractée dans les deux cas, qu’ils le veuillent ou non, à l’égard du modèle régnant. Qu’il y ait eu un certain degré de participation est un fait incontournable, vu le jeu des influences à l’époque, et étant donné les dates de publication des premières œuvres de l’un et de l’autre3. Mais quelle qu’ait été leur adhésion, il reste que
les choses bougent dans les dernières décennies du xixe, et l’exposé en tient compte. Les sections subséquentes accompagnent et observent Verlaine et Rimbaud dans leur parcours à travers les terres nouvelles qui s’ouvrent au regard poétique vers 1886, en fin de siècle. Évolution des deux écrivains vers un autre horizon poétique et en même temps impact sur un paysage auquel ils impriment chacun à leur tour leur marque créatrice. Faut-il évoquer Verlaine auteur de l’Art poétique4 ? Ainsi M. Whidden fait-il apparaître les éléments constitutifs de ce qui portera plus tard le nom de Symbolisme : acte de naissance, nous est-il rappelé, dressé en 1886 par Moréas ; ensuite, pratiqué à sa manière dans son écriture sinon reconnu dans ses théories, par Valéry5.
Mais ici une observation essentielle s’impose à qui veut accorder tout son mérite au travail de M. Whidden. Parnasse, Symbolisme, ces dénominations ne se réduisent jamais à de simples étiquettes sous sa plume. Toujours fidèle à la vision d’une réalité hétérogène et complexe, ainsi qu’à l’individuel qui défie les systèmes, ce n’est pas ainsi qu’il procède. Aussi bien, à l’intérieur du chapitre qui présente l’esthétique parnassienne, – à côté et en contradiction apparente avec les analyses précises et systématiques qui s’y lisent – on trouvera l’affirmation que le Parnasse ne fut jamais une doctrine unifiée, un mouvement homogène ni une « école6 ». Pas d’illogisme ici, ni incohérence, mais doigté dans le traitement des catégories de l’histoire littéraire ; ces catégories dont un article récent de Michel Autrand7 disait avec humour qu’elles satisfont en premier lieu « les journalistes, les critiques et les professeurs » mais non pas les poètes. (Ce que nul ne démontre mieux, on l’a vu, que Valéry.) Sans qu’elle soit nommée dans ces pages, l’autre figure qui se profile parmi ceux qui secouent les « idées reçues » est celle, illustre, de Benedetto Croce. Ses écrits sur l’esthétique, remettant en question les formulations simplistes des critiques de métier, s’insurgeaient en par
ticulier, dès 1902 comme on sait, contre la classification par « genre », apte à effacer la spécificité de l’œuvre, ainsi qu’à déposséder l’artiste de son identité. (Dans cet ordre d’idées on entendra M. Seth Whidden insister à la p. 132, pour que chaque poème soit lu selon son mérite.) Il convenait, nous a-t-il semblé, avant de pénétrer dans l’ouvrage, de jeter un coup d’œil sur la lignée dans laquelle s’inscrit la recherche de l’auteur.
« Les identités de Verlaine » : rien que le pluriel « identités » du titre attribué au Chapitre 2 (p. 45-118), annonce le chemin suivi par l’enquête8. Tout dix-neuviémiste connaît les inconséquences, les détours, discontinuités de la démarche souvent titubante du poète. Elle apparaît ici dans une perspective différente, qui, se voulant plus moderne, non biographique, choisit de lire l’œuvre dans l’éclairage de la linguistique des années 1980 et sq., alors que plus d’une fois elle passe tel poème au crible de la sémiotique. Récusant l’interprétation traditionnelle9, l’auteur se penche sur la relation du sujet à l’objet, formule qui recouvre dans son langage le rapport du moi à l’autre, s’étend à toute forme de désir amoureux – ainsi lirons-nous à la p. 99 qu’il « arrive au sujet poétique de présenter son moi à travers ses appétits » – mais essentiellement il s’agira pour M. Whidden d’étudier la quête par Verlaine d’une sienne identité esthétique (p. 53)… insaisissable. Ceci en raison du choix de base déterminant et caractéristique du poète, qui consiste à ne pas choisir (p. 81). Ce qui intéresse Verlaine par-dessus tout, selon son interprète, c’est le sujet lui-même dans sa relation à un être susceptible de définir, de réaliser et protéger, voire prendre en charge son moi indécis, fragile et fuyant – donc de choisir et décider à sa place. Que tel est le fil qui relie La Bonne Chanson à Sagesse, le poète lui-même l’indique en insérant « la chanson bien douce / sage » dans le recueil plus tardif10, la continuité ne s’arrêtant point là. Les textes de 1873-4 ne reprennent-ils pas le thème de l’être idéal amorcé dans Mon rêve familier ? Les incarnations successives
– Muse, bonne fée (de seize ans !) figure féminine « que rien n’étonne », c’est-à-dire personnification de la compréhension absolue, qui dépose un baiser sur le front de l’enfant11 – ces avatars cèdent la place, dans Sagesse III12, à une présence tutélaire, plus que bienveillante, tendre, voix qui parle à la première personne, s’engage à « bercer » et « dorloter » l’« âme pâle » et s’active dans le cachot où Verlaine, rappelons-le, fut incarcéré de 1873 à 187513.
Plutôt que de s’attarder sur de tels moments – la voix que nous venons d’écouter parle à Verlaine plus qu’à M. Whidden lecteur de Sagesse – fasciné, quant à lui, par les tons discordants de l’écriture plutôt que ses accents mystiques ou pacifiques. Rien d’étonnant dès lors qu’il s’attaque p. 95 au poème amer et traversé d’inquiétudes du recueil qu’est « Je ne sais pourquoi… », composition qui s’inscrit dans le sillage d’Angoisse (1866), dont le dernier vers annonce la catastrophe finale : « Mon âme pour d’affreux naufrages appareille14 ».
En 1873, l’âme-mouette à l’aile « meurtrie », figure du moi du poète dans le poème plus tardif, se maintient dans le texte, il est vrai, « au ras des flots » sans y sombrer : le « sujet » évite donc de justesse les « affreux naufrages » annoncés en 1866. Il reste que cet écrit représente pour l’auteur l’une des étapes sur la route semée de « crises15 », autrement dit, le chemin de la débâcle pour Verlaine, défaite sur laquelle se focalise la conclusion de la partie du livre consacrée au poète.
Qu’on ne s’y trompe pas cependant : débâcle et défaite, dans les termes de l’essai, concernent spécifiquement le moi ou « sujet lyrique » verlainien (p. 117-118) qui disparaît après 1885, non pas l’écrivain ni l’homme : il conviendrait d’invoquer ici la formule de M. Whidden : « capacité que possède Verlaine de construire des sujets poétiques fictifs » (p. 71). Elle revient à l’esprit lorsqu’on songe aux dernières années de Verlaine, où l’on voit le chef de l’École « décadente » partir, entre deux séjours à
l’hôpital, en tournée de conférences en Belgique, puis en Angleterre16. Quoi qu’il en soit, avant de quitter Verlaine, l’auteur nous surprend en niant, dans deux passages successifs, (p. 94 et 97) la faiblesse du sujet « fracturé, troublé ou divisé » (p. 116). Le premier des deux paragraphes où se lit cette opinion (p. 94) paraît camper le Pauvre Lélian, tel un Gide se faisant fort de garder ouvertes toutes ses options17. Ce qui donnerait à penser (avec Jacques Borel18) que la réception de Langueur – texte de 1883, poème ici considéré sous l’intertitre Vers une Esthétique de la Décomposition – (p. 115), pourrait reposer sur un malentendu19.
« Rimbaud au-delà du temps et de l’espace » : de même longueur, à quelques pages près que le précédent, le second essai constitutif de l’ouvrage de M. Seth Whidden (p. 119-205) adapte l’approche à la personnalité poétique qui va être étudiée. S’agissant de celui qui conçoit la poésie comme « action20 », le chapitre 3, de structure plus thématique et d’un style plus ramassé, veut saisir l’élan du jeune poète dans sa vigueur et dans son unité. Ceci globalement parlant, mais non pas dans le détail ni à chaque articulation – on le verra en lisant Sensation avec l’auteur.
Telle une épigraphe, une citation qui « tombe à pic », pose dès la p. 119 le cadre de l’exposé : « Change nos lots, crible les fléaux, à commencer par le temps » (À une Raison). Ainsi Rimbaud reproduit-il le chant des enfants poètes, chant où on distingue sa propre voix. Temps et espace : le titre réunit ces deux notions ; un deuxième texte sur la spatialité, relatif à l’autre partie du sujet, figure lui aussi « en exergue », mais, problématique, il sera commenté ailleurs21.
L’analyse textuelle des écrits de Rimbaud – en ceci la méthode de M. Whidden reste constante22 – commencée loin du but, part de Sensation, poème considéré par Etiemble comme étant celui qui, le
premier, fait entendre l’accent rimbaldien authentique (mais qui peut se dire en quelque sorte verlainien avant la lettre23). Le temps humain n’y est pas contesté (voir p. 133) et l’espace à parcourir « j’irai loin, bien loin… par la Nature » témoigne surtout de l’étendue du règne de celle-ci24. Aussi bien l’auteur élargit et déplace ailleurs le terrain de son investigation : aux p. 135-140 nous suivons l’entreprise de déstabilisation du lecteur (p. 130) et l’anéantissement des normes du monde par nous habité – dirigée en premier lieu contre le Parnasse (p. 120) – à travers le scatologique d’Accroupissements, ensuite, dans les textes « dramatiques » (p. 138) inspirés par la Commune. (Inutile d’ajouter que le bourgeois rangé y trouve lui aussi son compte, pour ne pas dire son « paquet ».)
Mais il ne s’agit plus d’offenser ni de scandaliser qui que ce soit dans Patience, ce groupe de poèmes d’un intérêt tout particulier dans le livre de M. Whidden, en ce qu’il reprend la plainte contre le temps, ce « fléau », nous plaçant par là dans le droit fil des préoccupations à la fois plus intérieures et plus vastes du jeune poète. Le nombre de pages consacré aux textes (p. 140-167) ne peut étonner, étant donné qu’il y va de la vocation poétique de Rimbaud. M. Whidden, ici critique thématicien, notons-le, associe « l’ardente patience », celle qui rendra « loisible » la possession de « la Vérité dans une âme et un corps » (fin d’Une Saison en enfer, 1873) avec celle, vécue par le poète en juin 1872 (p. 142). Présentée sous des jours divers, la patience apparaît en relation avec L’Éternité, comme épreuve essentielle liée à notre condition. Patienter ou capituler, se rendre à la Nature (Bannières de mai) ; ou se résoudre à attendre que se réalise la promesse « de plus hautes joies » ; accepter « le supplice » ? Au travers des choix qui sollicitent Rimbaud, impossible d’ignorer la résonance religieuse. Aussi bien, toujours souple et prêt à explorer des plans divers, le commentateur ne se fait pas faute de citer, à propos de la conscience humaine cherchant à surmonter le morcellement du temps, des philosophes ouverts au spirituel tels que Merleau-Ponty, Ricoeur, ensuite Bergson lui-même et jusqu’à Saint Augustin en personne.
On n’oublie pas, pour revenir au thème de la « promesse », que ce terme, en liaison avec celui de « torture » (synonyme de « supplice ») reparaît en toutes lettres dans Matinée d’ivresse, poème en prose qui succède aux derniers poèmes versifiés : texte qui fait sentir l’effort de l’esprit pour conserver, réunir les éléments d’une expérience vécue à la lisière du temps et menacée par celui-ci : « O maintenant, nous si digne de ces tortures ! rassemblons fervemment cette promesse surhumaine faite à notre corps et à notre âme crées : cette promesse, cette démence ! »
Les Illuminations : c’est vers cette œuvre que nous conduit l’auteur, en tant que lieu où s’accomplit à proprement parler25 la sortie du temps et de l’espace. Il était impératif, au préalable, de visiter les Lettres du Voyant, donc de commenter le trop célèbre « Je est un autre26 ». La formule ? elle équivaut à « une remise en question de la source d’énonciation » nous dit excellemment l’interprète (p. 124) en termes qui cernent l’essentiel. Plus qu’instructif lorsqu’il exerce son propre jugement – notamment là encore où il analyse la métaphore musicale rimbaldienne (le moi agi et éveillé par « l’autre » ; le cuivre qui résonne tel un clairon, le bois qui se découvre violon, p. 123) – M. Whidden s’avère moins heureux lorsqu’il se fie à des commentateurs insuffisamment imbus des textes rimbaldiens, soit insoucieux de la grammaire27.
Dans les sections finales nous retiendrons Barbare et Mouvement28, le premier texte présenté sous l’intertitre parlant « Temps et espace illuminés », et assorti de deux observations : « réalisation du projet poétique de
Rimbaud » ensuite « poème qui illustre le mieux les éléments majeurs de cette étude » (p. 180). Synthétisme qui nous invite à reproduire sans plus quelques propositions d’un remarquable commentaire :
Le titre de Barbare pose problème en ce qu’il suggère un temps éloigné dans l’histoire, notion à laquelle s’oppose tout de suite l’indication temporelle « après » du début : « Bien après les jours et les saisons, et les êtres et les pays ». Impossible de concevoir le temps dans les termes habituels passé, présent, futur. L’écriture place des embûches sur la voie d’une compréhension traditionnelle de la poésie. Tout espoir d’établir un système rythmique s’évanouit devant le fait que le poème consiste… en unités verbales juxtaposées. Rimbaud en tant que sujet poétique, crée, change d’avis, nie l’existence des éléments représentés dans le texte telles « les fleurs arctiques ». Le lecteur, déstabilisé sent que le poème peut cesser d’exister à tout moment. Il semble que certaines expressions viennent d’un ailleurs sans que le sujet poétique l’ait voulu ou y ait consciemment participé29.
Nous voici indéniablement à l’un des sommets de l’exposé. Qu’il suffise d’ajouter, pour boucler la boucle, que la saisissante assertion ultime rejoint, achève et complète la formule déjà citée plus haut : « Je est un autre », ce dire rimbaldien qui nous interroge sur l’origine de la parole poétique. Comme si, au xxie siècle il nous était donné de retrouver, avec des termes tels qu’« un ailleurs » ou de par la notion d’un moi créateur placé sous la dépendance d’un autre Être, l’idée condamnée, bafouée par le Parnasse, l’idée d’inspiration…
Les douze dernières pages du Chapitre 3 (p. 194-205) qui lisent Mouvement et Marine, y reviennent à leur manière, d’abord au plan de la versification, axant la démonstration sur le vers libre, en tant que forme poétique ou, disons mieux, en tant que tentative de reproduire cet « informe » que Rimbaud aurait ramené de « là-bas » (lettre du 15 mai 71). Mais parallèlement M. Whidden discerne, dans cette situation consécutive à l’abandon du vers régulier, vers réglé sur le temps et l’espace connaissable, un nouveau mode d’apparition du « sujet », défavorable au lyrisme.
« La voix lyrique peut-elle se faire entendre au-delà et en dehors de cette ancienne existence si profondément perturbée par le mouvement de l’écriture rimbaldienne ? » (p. 204). Telle est la question que nous pose l’auteur, au terme d’une lecture de Mouvement (p. 200-203) analyse menée loin des chemins battus : il s’agit pour lui d’un moi « problématisé » (p. 200), non pas libéré, mais délivré de son poids, enlevé comme
« un fétu de paille » ou une « particule », emporté par le rythme puissant et interrompu du poème, mais du fait même appauvri, perdant son humanité et jusqu’à sa substance (p. 200). Alors qu’est indéniable la violence des forces réunies dans le texte, les plus diverses, en outre, imprévisibles, tels les « accidents atmosphériques » (voir p. 203-204) qui convergent sur le couple voyageur de Mouvement, on hésite à suivre le commentateur dans cette spoliation radicale du moi poétique. Ou encore dans la dépersonnalisation qu’il y déchiffre, là où la quête d’une « fortune personnelle » paraît définir l’objectif du voyage30. Par contre, on reconnaîtra sans difficulté la posture surréaliste dans cet instantané (photographique) du poète futur que nous propose la p. 205 : « À l’avenir, l’écriture poétique, sa matière même, s’intéressera davantage aux objets et au contexte qui entourent le sujet lyrique qu’à ce sujet lui-même ». Pourtant, au terme de la lecture de Mouvement, au bas de la p. 204, M. Whidden ne revient-il pas au motif du chant, qui ouvrait le chapitre 3 (p. 119) ; chant des « enfants », auquel répond ici le chant31 du « couple de jeunesse » ? Modulé dans un registre différent, il prédit un autre avenir au langage poétique. Ainsi un contrepoint naît dans le texte, et on peut penser qu’avec cette note d’espoir la reprise du motif initial signale une victoire sur le temps « fléau ». Ce qui pourrait advenir, à regarder en avant – ou plutôt, si l’on écoute les voix du xxe siècle – laquelle nous
le dira mieux que celle de Claudel, qui cite la poésie rimbaldienne, et examine son effet sur le vers, cet effet étant de l’immortaliser ?
Le chant raisonnable des anges s’élève du navire sauveur.
Sur la mer, que j’aimais comme si elle eût dû me laver d’une souillure, je voyais se lever la croix consolatrice32
« Quand cette portée fut écrite », prononce le plus grand poète lyrique de notre époque, partisan résolu et praticien du vers libre, « quelque chose est né qui échappait pour toujours à la rime et au numéro, et qui n’avait plus pour séjour que l’âme directement atteinte… »
Avant de quitter le livre original et vivant de M. Seth Whidden, quelques remarques encore se suggèrent au recenseur. En se plaçant sous le patronage de Benveniste linguiste (p. 16) pour ce qui est de l’expression du temps et de l’espace, l’auteur ne se rendait pas la partie facile. Le danger du mode de lecture suivi, surtout là où il s’agissait de quelqu’un d’aussi sensible que Verlaine, c’était que la lecture du poème prît la forme d’un exercice stylistique, au lieu de le présenter comme une expérience du « sujet ». Or qui se pense sujet dit subjectivité : la formule « subjectivité masculine » apparaît d’ailleurs dans le texte (p. 71). En même temps l’adjectif « lyrique » qui qualifie d’entrée le moi des deux poètes étudiés, évoque une figure qui se départit malaisément de son vécu. Ici encore nous avons constaté que la méthode impersonnelle mais flexible de l’auteur dévie quand il le faut. Ainsi, dans les p. 200-205, où le lecteur sent par moments comme une corde trop tendue prête à casser, le texte de M. Seth Whidden plie et ne rompt pas. Mais au-delà des questions techniques, cet ouvrage écrit en anglais, qui traduit mot par mot chaque texte français cité, soit poésie soit prose de la plume d’autorités diverses, d’évidence rend un grand service aux étudiants américains.
Marie-Joséphine Whitaker
Yves Reboul, Rimbaud dans son temps, Classiques Garnier, « Études rimbaldiennes », 2009, 440 p.
Yves Reboul a publié en 2009, précédé d’une substantielle introduction, un recueil de treize études de textes intitulé Rimbaud dans son temps33. L’ouvrage devrait s’imposer comme une référence de premier plan au sein de la bibliographie rimbaldienne. Il y a là, d’abord, plusieurs commentaires qui font accomplir un pas décisif à l’élucidation de textes difficiles. Bien des lecteurs, aussi, seront reconnaissants à l’auteur d’avoir opté pour des articles brefs, au style clair, non jargonnant. Enfin – c’est peut-être ce qui apportera le plus à l’amateur en quête de stratégies pour lire Rimbaud – une réflexion s’y poursuit de chapitre en chapitre sur ce qui fait échouer depuis si longtemps le commentaire rimbaldien et sur les manières d’y remédier, sorte de discours de la méthode qui sert de fil rouge au recueil et qui intéresse toujours, même lorsque l’exégèse déçoit (ce qui arrive aussi, bien entendu).
Le recours au contexte
La manière de Rimbaud, explique Reboul, se caractérise par « la combinaison entre [des] zones qu’on dit d’énigme et un discours organisé » (p. 146). Et pour s’ouvrir un chemin parmi ces énigmes, le lecteur a besoin de certaines clés, certaines connaissances tout au moins, dont la principale est celle du contexte.
La méthode de l’ouvrage est représentative d’un courant critique qui a su défendre une approche historique de l’œuvre de Rimbaud en se
battant sur deux fronts. Dans le champ propre des études rimbaldiennes, contre l’influence de « cette mythification de Rimbaud […] traité comme une sorte d’aérolithe venu de nulle part alors que c’est à la lumière d’un ancrage, qui fut en réalité profond, dans son époque qu’on peut véritablement le comprendre » (p. 13). Dans le champ plus large de la critique littéraire, contre l’influence d’un certain formalisme post-structuraliste qui affichait le plus grand mépris pour « l’historicisme » et qui, concernant Rimbaud, se montrait enclin à proclamer l’illisibilité pure et simple d’une partie de l’œuvre. Au contraire, l’auteur de Rimbaud dans son temps préconise d’observer ce qui se reflète dans l’œuvre de son contexte, aussi bien littéraire que socio-historique, au prix de quoi seulement les difficultés du texte pourront être (en partie au moins) surmontées.
La production poétique de Rimbaud dans les années 70-71, explique Reboul, s’inscrit dans la lignée directe de Hugo, « sa véritable patrie » (p. 13), même si, dans ces mêmes années, il adopte certains usages parnassiens (pratique du sonnet, par exemple). Cette première partie de l’œuvre aborde souvent des thèmes politiques : anti-bonapartisme, anticléricalisme, dénonciation d’un ordre moral et / ou social qui rend l’amour impossible, expression de sympathies communardes. Il y a donc bien concordance entre l’univers personnel du poète et le moment de l’Histoire où sa vision du monde s’est forgée. Rimbaud, nul ne s’en étonnera, véhicule l’idéologie du temps :
[…] cette grande mythologie du Progrès, de l’avènement d’un monde nouveau à laquelle toute une part de la poésie s’était identifiée depuis le romantisme. Or le moment où il commence à écrire est précisément celui de la dernière flambée de ce romantisme politique, visionnaire et teinté d’eschatologie, lequel fut en 1871 l’un des visages de la Commune. (p. 13-14)
Mais même lorsque son œuvre commence à échapper aux modèles de la poésie discursive (forme brève du sonnet, grande forme hugolienne …) pour approfondir cette poétique de l’énigme qui culminera dans Les Illuminations, Rimbaud continue d’exploiter bien souvent un matériau issu du discours politique. On repère en effet dans cette production plus tardive tout un travail allégorique fondé sur les « représentations collectives et les mythes mobilisateurs » de l’époque (p. 222), sur la transposition poétique de poncifs contemporains : les hordes barbares (communardes) de Michel et Christine, la sorcière selon Michelet dans Les Mains de Jeanne-Marie, le drapeau de sang dans Barbare…
Ces stéréotypes, c’est d’abord à travers ses lectures que Rimbaud s’en est imprégné. D’où l’intérêt de rechercher les sources (au sens large) et notamment, comme le fait Reboul, de mettre en relief l’existence d’un Rimbaud parodiste (Voyelles, Mystique). Mais il faut surtout prendre en considération les préoccupations de l’adolescent Arthur Rimbaud et tout montre que ces préoccupations furent notamment politiques et érotiques. Évidence souvent niée ou affadie par la vulgate du mythe (Rimbaud l’enfant, Rimbaud le voyant, etc.) et par les interprétations biographiques réductrices qui y sont liées. Les équipées transfrontalières en compagnie de Delahaye, plaide Reboul, ne suffisent pas plus à rendre compte, dans leur portée politique, des Douaniers que les sœurs Gindre (tantes du professeur Izambard) à expliquer l’émoi érotique de « l’enfant » dans Les Chercheuses de poux.
Corrélativement, Reboul entreprend d’expliquer pourquoi des générations d’exégètes rimbaldiens n’ont pas su deviner ce Rimbaud parodique, politique, ancré dans son temps, qu’il se donne pour objectif de promouvoir. Cette méconnaissance, selon lui, trouve sa principale explication dans le fait que les poèmes ont été découverts plusieurs dizaines d’années après leur rédaction, et lus, par voie de conséquence, dans un climat intellectuel qui n’était plus celui de leur moment d’origine, en fonction de critères anachroniques.
Les Symbolistes, par exemple, s’emparent de Voyelles lorsque Verlaine le porte à la connaissance du public, dans Les Poètes maudits (1883), pour en faire leur étendard. De ce fait, le poème a été interprété dans l’optique spéculative qui était celle de ce mouvement (métaphysiques du langage et de la Poésie, théories de l’audition colorée) alors que c’est fondamentalement, selon l’interprétation de l’auteur, un « texte rempli d’allusions satiriques », un « répertoire ironique de thèmes à la mode, une sorte d’à la manière de … répartie sur l’ensemble du sonnet », prenant pour cible Baudelaire (A noir), l’esthétisme parnassien (E blanc), les stéréotypes romantiques (I rouge) et hugoliens (dans les tercets).
Ce sont les surréalistes qui ont publié pour la première fois en 1919 Les Mains de Jeanne-Marie. Or, prisonniers qu’ils étaient, à leur manière et tout en le dénonçant sous sa variante claudélienne, du mythe rimbaldien (Reboul rappelle que Breton, dans les années qui suivirent le second conflit mondial, est allé jusqu’à parler du « caractère sacré du message rimbaldien », p. 342), ces derniers ne pouvaient pas percevoir
clairement la dimension politique et contemporaine de certaines allusions du texte. Reboul juge qu’on peut en dire autant d’Étiemble, « du temps où il suivait Breton », face à un poème comme Michel et Christine (p. 18).
Les Douaniers n’ont été connus que tardivement, en 1906, et ont été publiés en volume pour la première fois en 1912. Ce qui explique sans doute que l’on n’ait vu dans ce sonnet qu’« une fantaisie sans conséquence » et qu’on l’ait analysé (sur les indications de Delahaye) comme la transposition burlesque d’un souvenir personnel, sans percevoir son caractère d’allégorie politique.
Aujourd’hui encore, dit Reboul, les représentations mythiques de Rimbaud continuent à s’interposer entre le lecteur et le texte. Venant d’un poète voyant, Après le Déluge sera senti comme « un poème où se devine la nostalgie, fondamentalement mystique bien sûr, de la fraîcheur édénique » [Suzanne Bernard], à moins qu’on n’invoque à son propos l’archaïsme métaphysique d’un « cycle cosmogonique » [Brunel] (p. 19).
Voici encore L’Homme juste, où Rimbaud règle ses comptes avec un Hugo dont il pense qu’il a joué les Ponce Pilate au temps de l’insurrection communaliste ; mais combien mieux conforme à l’idée à la fois prométhéenne et satanique qu’on se fait de l’époux infernal est de croire que c’est au Christ que s’adressent les invectives dont regorge le texte ! Les impossibilités, voire les absurdités, ont beau s’accumuler dans cette voie, rien n’y fait : c’est Jésus qui passera pendant des années pour être la cible de Rimbaud dans ce poème. (ibid.)
Si nous voulons désormais éviter de reproduire le même genre de déformations, par le fait de nos propres préjugés ou déterminismes contemporains, il convient donc de faire appel aux méthodes de ce qu’on appelle parfois la « critique contextuelle », qui consiste à reconstruire par le travail historique (littéraire et extra-littéraire) le contexte qui fut celui de la création.
Un autre représentant de ce courant critique est Steve Murphy. Ce dernier a d’ailleurs publié en 2010, dans la même collection des Classiques Garnier (Études rimbaldiennes), un important essai dédié au Rimbaud politique : Rimbaud et la Commune34, qui étudie en partie les mêmes textes que le livre de Reboul et entre bien souvent en résonance avec lui, d’où les nombreuses allusions que nous serons amenés à y faire. Et on va voir, pour commencer, que dès son premier article l’auteur de Rimbaud dans son temps s’attache à discuter, concernant un passage crucial du poème Les
Mains de Jeanne-Marie, le principe d’exégèse proposé par Steve Murphy (dans sa thèse, en 1986)35. Celui-ci, de son côté, dans son récent ouvrage, réfute la méthode suivie par Reboul dans « Jeanne-Marie la Sorcière » (1991, remanié en 2009) pour la résolution de ce problème de lecture. Confrontation évidemment fort enrichissante.
Le recours à l’intertexte et ses incertitudes :
conflit de lecture autour de Jeanne-Marie
Le « contexte » de l’œuvre, pour partie, ce sont d’autres textes, ceux que l’auteur a lus, où il a appris la littérature et le monde, et avec lesquels, plus ou moins consciemment, parce qu’il y adhère ou parce qu’il les rejette, dans l’admiration ou la raillerie, il dialogue. Ainsi, l’une des méthodes utilisées par la critique contextuelle pour éclairer les zones d’énigme faisant obstacle à la lecture pourrait être résumée de la façon suivante :
Premier temps : repérer ce qui dans le texte constitue une incongruité, une incohérence, un écart par rapport à ce que le bon sens attendrait (Steve Murphy fait appel, pour désigner cette opération, à la notion d’« agrammaticalité » théorisée par Michael Riffaterre36). Il y a de fortes chances pour que cet élément décalé soit l’indice de la présence sous le texte d’un autre « texte », d’un « intertexte », dont l’identification facilitera la compréhension du passage.
Deuxième temps, donc : repérer cet intertexte, soit dans la littérature, soit dans le contexte culturel (Steve Murphy, par exemple, a souvent recours aux caricatures des journaux républicains, à des sens argotiques répandus dans la langue populaire…).
Troisième temps, enfin : ce qu’on pourrait appeler la construction de l’allégorie. C’est-à-dire l’extension de la lecture à double sens à l’ensemble du passage concerné (par un processus analogue à celui de la métaphore filée).
Appliquons cette méthode, avec Yves Reboul, aux fameuses strophes 4-5-6 des Mains de Jeanne-Marie :
Sur les pieds ardents des Madones
Ont-elles fané des fleurs d’or ?
C’est le sang noir des belladones
Qui dans leur paume éclate et dort.
Mains chasseresses des diptères
Dont bombinent les bleuisons
Aurorales, vers les nectaires ?
Mains décanteuses de poisons ?
Oh ! quel Rêve les a saisies
Dans les pandiculations ?
Un rêve inouï des Asies,
Des Khenghavars ou des Sions ?
Le passage est assez opaque. Les éléments d’incohérence se concentrent sur certains mots. Comment la Pétroleuse, qui est le personnage positif du texte (le modèle de la femme libérée, de la révolutionnaire), peut-elle être affligée de « pandiculations », mot qui désigne, d’après le dictionnaire, les étirements des bras vers le haut accompagnant les bâillements mais qui constituaient aussi (selon la théorie médicale de l’époque) les symptômes annonciateurs de la crise hystérique ? La Communarde serait-elle décrite par le poète comme une sorte d’hystérique (vision qu’en donnaient plutôt les détracteurs de l’insurrection), une droguée ayant goûté à la belladone ? Pourquoi son sang noirci par le suc de cette plante vénéneuse éclaterait-il ou aurait-il de l’éclat ? Il y a là des contradictions, des paradoxes, qui imposent la recherche d’un sens caché, et d’abord de l’intertexte pouvant nous y conduire. Cet intertexte, dit Reboul, c’est La Sorcière de Michelet. Ou, tout simplement, car la source littéraire n’est pas absolument nécessaire (Reboul le suggère et il a sans doute raison), le stéréotype culturel qui commande la logique du passage : l’assimilation de la femme libre à une sorcière. Le lecteur pouvait à la rigueur repérer ce stéréotype en se laissant guider par les mots clés du texte : « belladone » (plante médicinale, poison, breuvage magique jadis utilisé par les sorcières) ; « mains
décanteuses de poison » (les mains de Jeanne-Marie sont celles d’une magicienne qui prépare elle-même ses philtres) ; « diptères » (ceux que les mains « chasseresses » de Jeanne-Marie écartent lorsqu’elles cueillent les belladones, à l’aurore) ; « pandiculations » (gestes désordonnés effectués sous l’emprise des philtres, pendant la danse du sabbat par exemple37). Ainsi, en filant la métaphore, il pouvait parvenir à restituer le discours second du texte, dans les trois strophes concernées.
Mais la référence à Michelet reste cependant d’une grande utilité pour dévoiler dans toute leur portée les connotations politiques de l’allégorie. Reboul résume la chose ainsi :
Que ce livre ait été une des grandes lectures de Rimbaud, je ne crois pas qu’on puisse sérieusement en douter. Or c’est un fait que la belladone y joue un grand rôle : on la rencontre dès les premières pages et le mot prend sous la plume de Michelet une multiplicité de sens qui pourrait bien être la clé de sa présence dans Les Mains de Jeanne-Marie […] Pour Michelet, la sorcière est l’héritière du naturalisme païen durant les temps obscurs du Moyen Age. À ce titre, elle résume en elle toutes les figures d’opprimés et singulièrement celle de l’opprimée entre toutes, la Femme […]
Si, donc, « C’est le sang noir des belladones / Qui dans leur paume éclate et dort », c’est que les mains de Jeanne-Marie sont irriguées par « le poison guérisseur de l’esprit de subversion » métaphorisé par le suc de la belladone qui fut, selon Michelet, entre les mains de ces véritables médecins du peuple qu’étaient les sorcières, l’un des « poisons salutaires » ayant servi d’antidote aux « fléaux du Moyen Age ». Il « dort » quand l’esprit de subversion est assoupi et « éclate » quand sonne l’heure de la revanche (p. 138-139).
Comme on peut le constater, la médiation de l’intertexte a permis de donner du sens à ce qui paraissait en manquer, de transformer en traits positifs (connaissance des médecines naturelles, dévouement aux pauvres, révolte sociale) les caractéristiques dépréciatives (recours aux
drogues, sang noir, pandiculations, rêves d’Orient) qui nous avaient semblé paradoxales dans un éloge de la Pétroleuse : « En Jeanne-Marie, écrivait Reboul dans son article de 1991, le sang noir des belladones ne se distingue pas du mauvais sang de la révolte et il ne l’entraîne pas vers quelque misérable miracle ni ne la pousse au départ vers un Orient de rêve ». Il n’est « rien d’autre que symbolique » (p. 142).
La mise en place d’un dispositif de lecture allégorique comme celui que nous venons de détailler laisse une large marge de liberté à l’interprétation et c’est pourquoi ce genre de passages obscurs dans la poésie de Rimbaud génère d’innombrables conflits de lecture. Même lorsqu’ils ont des méthodes et des grilles d’analyse très proches, les exégètes se divisent souvent dans leur façon de résoudre ces énigmes. Ainsi, dans l’étude du même poème qu’il a récemment procurée38, Steve Murphy propose une interprétation tout à fait différente des strophes que nous venons de commenter en suivant Yves Reboul. L’élément d’agrammaticalité décisif réside selon lui dans les « diptères » (« Dont bombinent les bleuisons / Aurorales, vers les nectaires »). À l’aube, butinant les fleurs, on attendrait plutôt des abeilles (qui sont des hyménoptères). Si, donc, Rimbaud déjoue notre attente en évoquant des « diptères », c’est-à-dire des mouches, c’est qu’il veut nous guider vers un sens second, qui correspond à un intertexte déterminé : « Chant de guerre parisien » et, plus largement, vers ce que Murphy appelle une « isotopie transtextuelle », c’est-à-dire une image revenant avec insistance dans plusieurs textes de Rimbaud : celle des mouches bleues (cf. « bleuisons39 »), des « sales mouches » (Chanson de la plus haute tour), « qui bombinent autour des puanteurs cruelles » (Voyelles). Pour lui, ces « mouches bleues » sont « à la fois des insectes et des ennemis de la révolution » que l’on doit « chasser » non pas seulement pour les faire fuir mais aussi pour les tuer. Elles représentent la « vermine réactionnaire » de Versailles cherchant à s’emparer du « nectar précieux de la République ». Elles constituent « un prolongement de la folie bourdonnante des hannetons de Chant de guerre parisien » (op. cit., p. 682-695).
Murphy construit donc une interprétation tout à fait personnelle en s’appuyant d’abord sur l’intertextualité interne (ou autotextualité) mais aussi sur la caricature politique de l’époque dont il montre qu’elle raille souvent les ennemis de la République en les animalisant sous la forme d’insectes. Reboul, dans son article tente de réfuter cette interprétation alternative en l’accusant de contenir des éléments contradictoires (p. 136-137). La question n’est pas là : l’exposé de Murphy est logique. Celui-ci, de son côté, tout en acceptant l’idée d’un souvenir de Michelet dans l’image des diptères (op. cit., p. 678-679), critique la solution proposée par Reboul. Il estime que :
l’interprétation de ces diptères ne peut se cantonner à l’identification plausible d’une situation « naturelle » (en cueillant des plantes le matin, la femme en question serait entourée d’insectes qu’elle chasse de la main). L’écriture rimbaldienne n’est généralement pas simplement descriptive, mais fortement axée sur l’implicite, les connotations et valeurs symboliques […] la lecture « réaliste » de l’image de ces mains qui chassent les diptères confie à ces insectes une place trop étroitement circonstancielle. (op. cit., p. 687)
Ce reproche, lui non plus, ne me semble pas justifié. Le cadre d’interprétation proposé par Reboul pour les strophes 4-5-6 des Mains de Jeanne-Marie n’est pas si dépourvu d’« implicite » et de « symbolique » ! Tout ce qu’on peut dire est qu’il ne s’agit pas d’une lecture intégralement symbolique comme peut l’être celle de Murphy, où chacun des mots clefs est investi d’un sens autre (« diptères » = Versaillais, « nectaires » = nectar précieux de la République, etc.). Elle émane directement des réseaux lexicaux présents dans le passage, ceux des drogues et de l’Orient, qui connotent l’idée de sorcellerie. Il est vrai que le texte rimbaldien exige, parfois, de véritables opérations de décodage, quand l’énoncé résiste à l’interprétation et paraît totalement crypté. Mais, ici, ce ne paraît pas être le cas. La preuve en est que la lecture fournie par Reboul, bien que plus littérale, en effet, et plus simple que celle de Murphy, suffit à donner un sens satisfaisant au passage. Elle s’articule bien au mouvement du texte : le motif de la sorcière s’inscrit naturellement dans la suite de types féminins évoqués depuis le début du poème (sont-ce les mains d’une don-juane, d’une précieuse, d’une aventurière, d’une bigote … ? – Ce sont des mains de sorcière !). Et, sur le plan politique, elle est cohérente avec le message communard – et surtout féministe – du poème. Toutes raisons pour lesquelles elle est fort convaincante.
Sens ou Extrapolation ?
L’étoile a pleuré rose, Les Douaniers
Mais le recours au contexte, à l’Histoire, peut avoir ses facilités et ses excès. Le poème intitulé Les Douaniers, nous dit par exemple Yves Reboul, « reflète à sa façon l’état de l’Europe en cette cruciale année 1871 » (p. 129). Sans doute ! Mais est-ce une raison pour rejeter la « doxa » qui présente ce poème comme la transposition d’une anecdote vécue (dans l’esprit des sonnets du cycle belge de l’automne 70), refusant même d’y déceler des équivoques sexuelles, pourtant évidentes (p. 198) ? Les allusions historiques explicitées par le critique sont, de façon générale, utiles et convaincantes. Mais tout lecteur sent aussi, dans cette histoire de traversée nocturne des frontières (« Quand l’ombre bave aux bois comme un mufle le vache »), l’expression (burlesque) de dégoûts et de peurs, l’évocation de transgressions qui ne se limitent pas à celles des frontières taillées à coups de sabre par le vainqueur prussien, la présence d’une fantasmatique personnelle.
Reboul croit magnifier le texte en le traitant comme un document historique :
Ce qui s’inscrit dans Les Douaniers, loin de toute anecdote et de tout pittoresque, c’est donc un moment d’Histoire ou plutôt c’est une conjoncture historique : la déroute de toutes les formes d’illusion lyrique dont avait si largement vécu le siècle, le constat désabusé de leur néant face à ces monstres froids que sont les Etats et à leur incarnation aussi dérisoire que sinistrement réelle que sont les douaniers. (p. 197)
Cette philosophie de l’Histoire (aux accents quasi orwelliens) peut-elle vraiment passer pour le sens du texte ? Et peut-on sérieusement reprocher à la tradition critique d’avoir manqué un tel sens, quand ce qui nous est présenté comme sens véritable du poème excède, à bien des égards, ce que l’on peut attribuer à l’intention de l’auteur ? On peut douter que le projet de Rimbaud ait été de faire de son poème le condensé d’une « conjoncture historique ». Une telle interprétation, j’en ai peur, nous renseigne davantage sur les préoccupations (historiennes) du critique que sur celles du poète.
Autre exemple. Reboul montre la présence, dans le quatrième et dernier vers de « L’étoile a pleuré rose… », d’une image christique renversant en épigramme un apparent madrigal. Le poète, dit-il, par cette allégorie, dénonce « l’aliénation de la femme » et déplore la perte (avec l’écrasement de la Commune) de cette espérance utopique exposée notamment dans Soleil et Chair : celle d’un monde régénéré où la femme serait « la sœur de charité, le ‘ventre où dort une ombre rousse’ et où s’accomplirait le destin naturel de l’Homme » (p. 260). Soit ! Mais cela l’autorise-t-il à dire que Rimbaud, en peignant l’Homme saignant au flanc de l’éternelle Idole, fait une « allusion transparente à la semaine sanglante » et qu’il est ahurissant que personne ne s’en soit aperçu ? (262)
Comme l’auteur ne le cache pas (voir son développement des pages 260-261), c’est l’impression (d’ailleurs contestable : cf. Vénus Anadyomène, poème de 1870) d’un assombrissement de la thématique érotique au cours de cette année 1871, ce sont des considérations sur la place du quatrain au sein du dossier Verlaine de 1871-1872, parmi des poèmes abordant de façon beaucoup plus explicite les thèmes de la frustration érotique et de la déception politique (Les Sœurs de Charité, L’Orgie parisienne, …) qui le poussent à accorder un sens aussi sophistiqué à « L’étoile a pleuré rose… ». On a donc manifestement affaire, avec cette exégèse, à une tentative d’enrichissement thématique du sens d’un texte par référence à son environnement autotextuel, allant bien au-delà de sa signification première. « L’étoile a pleuré rose… » est une œuvre forte, sans doute, et non pas charmante, mais son sens manifeste ne dépasse guère le thème traditionnel des souffrances de l’Homme sur l’autel de Vénus.
La survalorisation de la dimension politico-historique de la pièce s’accompagne, comme il se doit, d’une dépréciation de son sens immédiat et de son intérêt poétique. Or, à mon sentiment, Reboul a tort de tenir pour négligeable l’intérêt que Rimbaud pourrait avoir trouvé à renouveler le poncif constituant le sujet au poème. Il le renouvelle idéologiquement par la puissante chute satirique qu’il donne au texte, d’une part (cela, Reboul le voit évidemment très bien), mais aussi, dans les trois premiers vers, en se donnant pour but de pulvériser ses modèles érotiques parnassiens. C’est pour atteindre cet objectif plus esthétique qu’idéologique qu’il adopte une forme énumérative-répétitive lui permettant de faire l’économie de toute rhétorique narrative (lot habituel du genre mythologique) et de renforcer la densité métaphorique du
poème. Grande réussite formelle que Reboul traite par le mépris en parlant d’un « blason quelque peu appliqué » (p. 262).
On a donc l’impression très nette, devant des commentaires de ce genre, que le critique prête au texte un sens allant plus loin que ce qu’il dit vraiment, un sens élargi. Un tel élargissement de la problématique interprétative n’est pas en soi illégitime. Il se justifie lorsqu’il nous guide vers un impensé du poème ouvrant sur l’arrière plan implicite ou sur les couches profondes de la sensibilité dont il est issu. Mais il nous heurte quand il force la signification du texte pour la faire coïncider avec des thèmes obsessionnels qui sont moins ceux de l’auteur que ceux du commentateur. Dans ce cas, ce n’est plus de sens élargi qu’il faudrait parler mais d’une véritable extrapolation. Plus qu’à rechercher ce qui fait la spécificité du projet poétique, on s’applique à enrichir artificiellement la thématique du texte à l’aide de ce qu’on sait (son contexte, son co-texte…), dans le but de formuler des aperçus pénétrants de caractère politique et / ou psychologique. C’est le piège tendu à toute lecture fondée sur l’exploitation allégorique du contexte historique.
On devrait tout au moins être conscient, lorsqu’on procède ainsi, qu’on sort du domaine de l’explication (ou de l’explicitation) pour entrer dans celui de l’exégèse et en tirer certaines conséquences. L’objet du travail n’est plus le sens du poème stricto sensu mais une évaluation plus générale de sa portée au regard d’un savoir spécifique, évaluation dépendante des instruments et des objectifs scientifiques de celui qui commente le texte, du recul historique dont il bénéficie, de son degré d’érudition, voire de sa subjectivité. Le fait qu’en l’espèce (je veux dire, dans le cas de Reboul) ces objectifs scientifiques soient essentiellement de nature historique ne change rien à l’affaire et ne différencie pas fondamentalement la démarche utilisée de celle qu’on pourrait trouver, par exemple, chez un psychanalyste analysant le cas Rimbaud à la lumière de son savoir particulier, avec l’ambition de mieux comprendre l’auteur qu’il ne s’est lui-même compris. En vertu de quoi l’exégète devrait s’interdire de reprocher aux autres lecteurs, comme Reboul le fait trop volontiers, de n’avoir pas aperçu les significations concernées, abusivement présentées comme des évidences qui ont échappé à tout le monde. Libre à lui de proposer des interprétations élargies et nouvelles, mais sans les opposer à certaines interprétations habituelles, en fait incontournables.
Steve Murphy, conscient de cette difficulté, prend généralement soin de ne pas opposer ses exégèses contextuelles aux lectures naïves mais légitimes des textes qu’il étudie. Ses commentaires documentent plusieurs niveaux d’interprétation. Dans son remarquable article sur Le Bateau ivre40, par exemple, il articule sa lecture communarde avec les interprétations courantes de type psychologique ou méta-poétique. Mais cette attitude ouverte ne suffit pas toujours à déjouer ce que j’ai appelé ci-dessus « le piège » (des lectures allégoriques). Ainsi, lorsqu’il commente Les Corbeaux dans son dernier opus41, Steve Murphy n’oppose pas formellement son exégèse anticléricale (fondée sur le sens argotique du mot corbeau et la valeur symbolique du volatile dans la caricature politique contemporaine) à la lecture habituelle du texte (hymne funèbre d’inspiration patriotique et secrètement communarde). Mais, comme la première tire le poème vers la satire et donc, peu ou prou, vers le registre comique alors que la seconde relève d’une inspiration élégiaque, le lecteur savant en vient malgré tout à contredire la réception spontanée (et légitime) du texte.
Ces réserves faites, les approches contextuelles restent les plus efficaces pour affronter les complexités du texte rimbaldien. Les succès herméneutiques obtenus par ce courant critique, que ce soit par l’auteur de Rimbaud et la Commune ou par celui de Rimbaud dans son temps le démontrent avec évidence. On va en découvrir ci-après quelques nouveaux exemples.
La pratique rimbaldienne du double sens
Mystique, Being Beauteous, Barbare
« Le double sens est son langage », écrit André Guyaux, parlant de Rimbaud42. C’est particulièrement vrai dans Les Illuminations. Rien n’est plus éclairant à ce propos que les chapitres de Reboul sur Mystique et Being Beauteous. À qui voudrait mesurer ce que la méthode suivie par
l’auteur apporte de neuf, je suggèrerais de confronter ces deux articles à tant d’autres commentaires qui ne parviennent à déceler dans ces poèmes qu’un lyrisme au premier degré débouchant sur un sens confus (vaguement idéaliste, esthétisant, voire mystique). Dans les deux cas, Reboul montre avec brio comment un discours manifeste, compatible avec les canons de la haute poésie, abrite un sens second, d’intention satirique ou licencieuse.
Dans Mystique, explique-t-il, une apparence d’image pieuse cache une charge contre l’illuminisme romantique. Le tableau construit par le poème est un « paysage allégorique » (p. 319). Rimbaud y tourne en dérision ces panoramas romantiques devant lesquels un contemplateur médite religieusement sur le sens de l’Histoire et le destin des hommes. Les herbages sont « d’acier et d’émeraude » (dans La Maison du berger, Lamartine contemple le crépuscule qui s’endort « Sur l’herbe d’émeraude et sur l’or du gazon », v. 37). Ici, par contre, il s’agit probablement (comme dans Aube, qui suit immédiatement Mystique dans le manuscrit des Illuminations) d’une évocation du jour naissant, d’où la vision du mamelon « en flammes » sous les premiers rayons du soleil, provenant de « la ligne des orients ». Mais ces éléments du paysage sont « signifiants » (p. 311), comme l’est souvent le motif de l’aube dans la poésie romantique. La présence du mot « progrès » à la fin du second alinéa confirme cette lecture « politique ». Toute l’organisation si sophistiquée de la description s’en trouve éclairée : en contemplant l’aube qui se lève, c’est l’humanité en marche qui passe sous les yeux du poète : à gauche, le passé (les « désastres », les « batailles ») ; à droite, l’avenir (les « orients », les progrès). Le principe est à peu près le même dans les deux derniers versets qui évoquent le spectacle du ciel et de la mer (« en haut du tableau », c’est-à-dire : au loin). Comme le mage hugolien dans plus d’un poème, le contemplateur de Mystique entend la voix tragique des hommes (la « rumeur » des « nuits humaines », dit Rimbaud), qui lui parle à travers la « rumeur » des flots. Sombre évocation à quoi le dernier alinéa oppose, bien entendu, « la grande paix d’en haut » (Hugo, Éclaircie43). Car il faut bien finir par « le ciel étoilé d’où l’extase descend » (Lamartine, dans Bénédiction de Dieu dans la solitude), ou encore, tel
l’auteur des Contemplations, se pencher dans l’« abîme des cieux » (Un jour je vis…), voûte étoilée que Rimbaud (puisque les étoiles ne sont après tout que « les fleurs de l’ombre », cf. Booz endormi) compare à « un panier fleuri appliqué contre notre face » (p. 321). Inutile de commenter encore, n’est-ce pas, les anges en robe de laine faisant leur ronde sur « la pente du talus » ! « L’ambition romantique, conclut Reboul, avec sa volonté de réenchanter le monde, avec sa prétention surtout d’assumer la totalité de l’Homme et de l’Histoire (le fameux progrès), aboutit en fait à ce mysticisme cosmique dérisoire » (p. 321).
Rimbaud chercherait donc à se déprendre par l’ironie de cette « ambition romantique », qu’il a partagée… Et pour laquelle il conserve une certaine tendresse : la beauté du texte, avec sa virtuosité rhétorique sur le plan de la construction et ce que Reboul appelle son « isotopie dynamique », obtenue par la multiplication des verbes de mouvement, en est le témoignage.
Dans l’étude consacrée à Being Beauteous, Y. Reboul explicite la signification érotique du poème en nous épargnant les circonvolutions qui sont de règle chez tant de critiques. Mais il nuance son propos de considérations très éclairantes sur la pratique rimbaldienne du double sens. Il met en évidence le jeu du poète consistant à tresser l’évocation érotique à un développement allégorique, de portée philosophique ou morale, qui sert à la dissimuler mais n’en appartient pas moins lui aussi au sens du texte.
Je suis frappé, par contre, de la facilité avec laquelle Reboul oublie les principes méthodologiques qu’il a énoncés à propos de Being Beauteous lorsqu’il s’attaque à la métaphore polysémique du « pavillon en viande saignante » dans Barbare : « ce pavillon en viande saignante, écrit-il, c’est bien entendu le drapeau rouge », interprétation dont il est « stupéfiant qu’elle ne soit pas unanimement reçue depuis longtemps (mais il est vrai qu’on a l’habitude avec Rimbaud) ». Et il ajoute quelques lignes plus loin : « Qu’on ait négligé cette interprétation (quand on ne la refusait pas explicitement), ce n’est après tout qu’une des manifestations d’un déni assez courant dans la critique rimbaldienne. L’assimilation du drapeau rouge à un drapeau de sang était pourtant fréquente au xixe siècle […]. » (p. 367-368).
L’auteur suggère donc que personne avant lui n’a perçu l’allusion au drapeau des révolutionnaires dans cette métaphore ou que, du moins, si
on l’a pressentie, on a refusé de l’admettre par « déni » de la dimension politique dans l’inspiration du poète ! La vérité est toute autre. Steve Murphy, par exemple, dans un article de 1988, développe explicitement cette interprétation de la métaphore du pavillon et il la fait remonter jusqu’à Georges Izambard44. Certains commentateurs de Barbare ont donc très bien enregistré la connotation politique de l’image. Mais ils ont perçu simultanément tout le travail textuel réalisé par Rimbaud pour mobiliser d’autres réseaux sémantiques, d’autres connotations possibles dans d’autres domaines de sens, et ils ont tâché d’éviter la réduction monosémique dénoncée à juste titre par Reboul à propos de Being Beauteous. Steve Murphy écrit : « Beaucoup de la force de ce pavillon disparaît lorsqu’on n’adopte qu’une lecture : matrice, soleil, drapeau, sans envisager une lecture moins plurielle que synthétique » (ibid., p. 28).
Personnellement, j’insisterais notamment pour qu’on ne néglige pas l’un des sens les plus immédiats du mot « pavillon », celui qu’il possède dans le vocabulaire de la marine. Je considère en effet comme une piste très fertile, s’agissant d’un texte aux allusions arctiques récurrentes, l’hypothèse d’une référence conjointe à l’héroïsme sacrificiel des communards et à celui des navigateurs polaires britanniques du xixe siècle dont Michelet (La Mer) et Jules Verne (Aventures du Capitaine Hatteras) ont évoqué l’abnégation. Barbare semble convoquer divers domaines de l’héroïsme contemporain pour célébrer l’ivresse (mais comme une addiction dont le sujet chercherait en vain à se délivrer) de cette marche au supplice qu’est pour Rimbaud toute quête de l’Inconnu. C’est en effet sous cet aspect tragique que le poète la représente régulièrement, dans la lettre dite du Voyant, dans le prologue de la Saison, dans les Illuminations (cf. notamment Matinée d’ivresse, l’épilogue d’Angoisse…)45.
Pour en revenir à Reboul, c’est vraisemblablement dans le but de justifier une certaine lecture du texte, très différente de celle que je viens d’ébaucher, que ce critique soumet la métaphore du pavillon à
une interprétation si radicalement monosémique. Barbare, selon lui, se divise en deux parties opposant deux visions distinctes. L’une renvoie à la fois à un passé qui s’éloigne (« Bien après… », « loin de… ») et à un horizon inaccessible (« … sur la soie des mers et des fleurs arctiques ; (elles n’existent pas) »). L’autre est un rêve qui prend son essor et paraît à portée de main (« Et là, les formes, les sueurs, les chevelures, … etc. ») : « L’opposition d’un lointain inaccessible et d’un proche investi par l’affectif tend à structurer l’ensemble de Barbare » (p. 365).
La première partie du poème, dédiée à la vision du « pavillon en viande saignante » (du drapeau rouge, donc) évoque le rêve inaccessible dont le locuteur se sent de plus en plus distant, dont il se déclare « remis » comme on le dirait d’une maladie. Il s’agit du rêve de la révolution.
La seconde partie, celle qui s’ouvre au cinquième alinéa avec le mot « Douceurs ! », infléchit radicalement le ton et le sens du texte parce qu’elle substitue à la mélancolie de la perte (le « congé » signifié par Rimbaud à son ancien moi) l’euphorie liée à la révélation d’une nouvelle raison de vivre et d’espérer, d’un nouvel espace ouvert à son désir : le monde réel, « l’immensité de l’univers » dont parle Génie, célébrés à travers la figure christique du « cœur terrestre éternellement carbonisé pour nous ». Cette figure n’a rien de religieux mais fonctionnerait dans le poème comme « une allégorie de la Vie et de l’Univers lui-même » (p. 373), bientôt relayée par une imagerie sexuelle, sorte d’épanouissement orgastique, qui a la même signification : « car le sexe est partie prenante de cette générosité, de cette vie infinie (Génie) du monde que symbolise le cœur terrestre » (p. 374).
Barbare serait donc pour Rimbaud une sorte d’adieu au drapeau, et plus généralement à l’ensemble de ses croyances de naguère, à « ce nouvel évangile en tous points opposé à celui du Christ et dont Rimbaud s’était fait l’annonciateur. Ce nouvel Évangile, dont l’hétérodoxie sexuelle était au moins l’un des sacrements, tendait bien entendu à se lier à la révolte politique, mais ne se confondait en aucune façon avec elle : à lui aussi Rimbaud donnait désormais congé ». (p. 370)
L’analyste construit là un schéma allégorique d’allure très rimbaldienne, c’est indéniable. Mais cette interprétation nouvelle de Barbare paraît très contestable. N’est-ce pas l’apparition du « pavillon en viande saignante » qui suscite peu à peu dans l’esprit du sujet lyrique un sentiment d’euphorie, avant même que ne se déclenchent les rafales de givre et les éruptions
volcaniques ? Il n’y a donc pas, d’un côté, une vision sinistre et désabusée (le « pavillon ») et de l’autre, une vision délicieuse et attirante (le fantasme érotique). Ce schéma en antithèse ne correspond pas au scénario réel du texte46. Dans un cas comme celui-ci, on a le sentiment que la volonté de prouver suspend la vigilance méthodologique du commentateur.
Récupérations politiques
L’effondrement du rêve communard a laissé Rimbaud dans un grand désarroi. Et l’un des mérites du travail de Reboul, notamment dans son introduction (chapitres intitulés : « La Commune », « Assassins ? ») est de montrer que les échos de l’événement, tant affectifs que réflexifs, se propagent dans l’œuvre entière du poète, et jusque dans Les Illuminations. Citons, parmi d’autres, cette appréciation sans équivoque :
Rimbaud fut donc partisan de la Commune, demeura fidèle à ses idées longtemps après qu’elle ait échoué et son œuvre en porte largement la marque. Que tout le monde ne soit pas prêt à l’admettre, il faudrait, encore une fois, être atteint de cécité volontaire pour en douter. Seulement, voilà, ce n’est pas une hypothèse : c’est un fait. (p. 307)47
Mais qu’aura retenu Rimbaud de cet échec, de ce naufrage où, comme il le déclare dans Génie : « c’est cette époque-ci qui a sombré » ? Que
d’autres « époques » viendront, et d’autres « horribles travailleurs48 » qui devront se montrer plus radicaux encore et plus forts face à la réaction (c’est à peu près la thèse développée par Eugène Vermersch dans son poème Les Incendiaires) ? Des textes comme Après le Déluge, Métropolitain ou Soir historique pourraient le faire penser (cf. aussi la formule de Guerre : « Je songe à une guerre, de droit ou de force […] », qui peut être interprétée dans un sens socio-politique). A-t-il conclu au contraire qu’avec la Commune, c’était toute cette foi naïve de son siècle dans le Progrès et dans l’Histoire qui était morte ? Que cette foi elle-même, peut-être (le radicalisme social des Communards, leurs objectifs utopiques), avait été responsable de la défaite ? Ce fut apparemment la conclusion d’Andrieu, un ami de Verlaine que les deux poètes ont côtoyé à Londres au moins autant que Vermersch et sur qui Reboul nous informe longuement dans son chapitre « Commune49 ». Telle formule de Mauvais sang ou de Nuit de l’enfer (« Je ne crois plus à l’histoire ») semble l’indiquer. Face à cette alternative, on est en droit de conclure à un Rimbaud hésitant et contradictoire, arbitrage prudent que, personnellement, je crois difficile de dépasser. Ainsi, Reboul définit correctement, me semble-t-il, le poète des Illuminations comme une conscience divisée, « un observateur sarcastique, mais non pas désabusé » (p. 125).
Mais si le Rimbaud de Reboul n’est pas « désabusé », il l’est tout de même passablement en ce qui concerne la révolution. Sur ce plan, le critique semble enclin à trancher : « On peut seulement douter qu’il attende désormais l’issue qu’annonçait l’eschatologie révolutionnaire, bien qu’une certaine représentation bourgeoise du monde lui semble toujours dérisoire et qu’il lui arrive plusieurs fois de prédire à ses contemporains une suite qui les stupéfiera » (p. 124).
Le balancement de la phrase entre continuité et palinodie paraît pencher plutôt du côté de la seconde. Malgré la prudence que lui recommande sa lucidité sur les textes, Reboul suggère que l’année 1871 a marqué pour Rimbaud l’« apogée » (c’est son mot) de son engagement
politique, c’est-à-dire si les mots ont un sens l’amorce d’une prise de distance, voire d’un retour à la raison après l’« abandon » (encore un mot significatif) à de regrettables erreurs de jeunesse :
Reste que la Commune est demeurée pour la création rimbaldienne un moment fondateur : apogée d’abord d’un engagement de l’auteur dans ce qui se voulait, sur le modèle hugolien, une véritable intervention dans le champ politique, apogée aussi d’un abandon à l’interprétation du monde en termes d’eschatologie séculière. Et même quand cette illusion se dissipa – et aussi sans doute la foi révolutionnaire dans sa radicalité – on peut croire que ce fut cette expérience d’un an (de l’été 1870, où éclata la guerre impériale, à celui de 1871) qui fit que Rimbaud demeura cet observateur sans complaisance de la société industrielle moderne dont, avant son expérience anglaise, il n’avait sans doute mesuré ni la force ni les accomplissements, mais à laquelle il lui arrive encore de prédire de futures stupeurs. (p. 113-114)
Étrange déclaration, en vérité, car, pour ce qui est de « l’eschatologie séculière », nulle part il n’en est autant question que dans les derniers textes de Rimbaud : Génie (« Sachons […] suivre ses vues, – ses souffles, son corps, – son jour »), Adieu (« nous entrerons aux splendides villes »), Après le Déluge (« montez et relevez les Déluges »), Soir historique (« Le moment de l’étuve, des mers enlevées, des embrasements souterrains, de la planète emportée, […] cependant, ce ne sera point un effet de légende »). Reboul resterait-il solidaire de cette tradition critique qui voit dans Rimbaud, passée l’année de la Commune, un poète aux yeux décillés, revenu de ses illusions révolutionnaires ? Ce serait cohérent, par certains côtés, avec le jugement « historique » que le critique semble porter sur la Commune. Il ne voit guère dans cet épisode et dans l’idéologie de ses protagonistes (il le répète avec insistance) que les derniers feux du romantisme révolutionnaire (passim) alors qu’une autre tradition historique et politique, qu’il n’ignore pas, l’analyse plus volontiers comme la première manifestation (après juin 48) d’une forme nouvelle de la lutte des classes, marquant le début d’une nouvelle ère révolutionnaire, celle des révolutions prolétariennes.
Aussi n’est-il pas étonnant que Reboul consacre une bonne partie du chapitre de son introduction intitulé « Commune » (p. 81-93) à une réfutation en règle de ce qu’il appelle la « vulgate marxienne » : « La vulgate marxienne, en faisant délibérément des événements de 1871 une anticipation de la révolution socialiste à venir, a largement contribué à en gauchir le sens, autant peut-être que les publicistes versaillais qui, eux, avaient intérêt à faire peur » (p. 89 n. 3).
À cette occasion, l’auteur me reproche (p. 87) d’avoir écrit je ne sais où (et son lecteur ne le saura pas davantage puisqu’il ne cite pas la source) que la Commune avait été, dans le projet de ses partisans, « une république ouvrière d’inspiration socialiste ». Si j’ai écrit cela, il s’agit certes d’une formule un peu rapide pour rendre compte d’un processus historique complexe. Mais qu’est-ce qui choque tant Reboul dans cette formule ? Le mot de « république ouvrière » ? Populaire, en tous cas, et même ouvrière, l’assemblée communale élue le 26 mars l’est à coup sûr par sa composition : « trente-trois ouvriers, cinq petits patrons – dont Eugène Pottier [l’auteur de L’Internationale] qui possède la meilleure entreprise parisienne de dessin sur étoffes –, quatorze employés, commis et comptables, douze journalistes, une douzaine encore d’avocats, instituteurs, artistes, médecins », selon l’historien Jacques Rougerie50. Le mot « socialiste » alors ? Blanquistes, Proudhoniens, Jacobins, membres de l’Association internationale des travailleurs et autres courants de ce mouvement essentiellement pluraliste que fut la Commune n’étaient certes pas « socialistes » dans le même sens, mais ils l’étaient chacun à leur manière. Ceux qui voulaient l’instauration immédiate d’une République Sociale n’étaient sans doute pas majoritaires parmi les dirigeants du mouvement mais, la révolution s’approfondissant, ils devinrent progressivement les plus influents. « Socialiste, la Commune voulut l’être », conclut Rougerie au terme de son examen de la question51. Elle le voulut sans guère y parvenir, il est vrai, dans le bref sursis de 72 jours que lui accordèrent ses massacreurs (républicains d’ordre et monarchistes confondus). Et aussi à cause de son incroyable degré d’improvisation, à cause de ses divisions, à cause de ses erreurs que personne ne nie, Marx moins que quiconque.
Pour ce qui est du procès fait à Marx, il faut bien comprendre que celui-ci s’intéresse moins à l’Histoire en historien qu’en stratège politique.
Ce que l’auteur du Manifeste communiste retient de la Commune pour l’avenir c’est moins ce qu’elle put réaliser (qui est en effet assez maigre) que ce à quoi elle tendait par son mouvement naturel. C’est l’apparition quasi spontanée, malgré l’impréparation des acteurs à la tâche qui leur incombait, d’une dynamique inséparablement démocratique et sociale, de caractère potentiellement communiste, perceptible dans les choix qui furent ceux de Paris insurgé : dissolution de l’armée de métier et de la police, mise en place d’une sorte d’appareil d’état alternatif fondé sur l’organisation à la base des classes inférieures de la société (comités de vigilance par arrondissements, bataillons fédérés de la Garde nationale …), refus a priori de soumettre les lois que se donnerait librement la capitale à celles édictées par une Assemblée nationale pourtant élue au suffrage universel (ce qui revenait à construire délibérément une situation de double pouvoir), élection directe à tous les postes, même militaires, révocabilité à tous moments des élus, mandat impératif, nivellement égalitaire des salaires, projet de réquisitionner les fabriques abandonnées et de les remettre en fonctionnement sous forme de coopératives ouvrières (en les favorisant par un accès préférentiel aux commandes de l’administration communale), etc. Dans cette dynamique spontanée, il décèle une tendance foncière des luttes d’émancipation dans les sociétés « de classes » modernes, tendance appelée à se manifester à nouveau dans les révolutions à venir. On peut ne pas être d’accord avec cette analyse et ne pas voir ce qui a confirmé ce pronostic, à des degrés divers, dans vingt ou trente crises révolutionnaires qui se sont ouvertes depuis lors de par le vaste monde. Mais c’est affaire d’appréciation politique, me semble-t-il, plus que de jugement historique.
Reboul, donc, croit corriger une grossière déformation idéologique de l’Histoire mais il ne fait qu’exprimer un rejet personnel, tout aussi idéologique, de ce qu’il considère comme la récupération marxienne de la Commune. Le lecteur pourra lire par exemple que, contrairement à l’opinion de « ceux qui ne veulent imaginer la Commune qu’à la lumière des interprétations postérieures – à commencer par celle de Marx », l’insurrection communaliste « prolongeait avant tout 1848 » (p. 272). Il veut dire, sans doute, Février 48, la phase unanimiste du processus, avant qu’en juin de la même année l’unité imaginaire du peuple ne se déchire et que le prolétariat de Paris se dresse contre ces libéraux bourgeois qui prétendaient usurper le nom de la République. Or, comme l’a montré
Marx dans La Guerre civile en France, c’est Juin 48 qui se prolonge dans la Commune et c’est la République sociale revendiquée de façon encore abstraite par les manifestants de Juin qui commence à se concrétiser à travers la forme inédite de gouvernement « à partir d’en bas » (Rougerie) instituée par les insurgés de 187152. Vallès, dans l’Insurgé, témoigne de cet affrontement entre deux conceptions irréconciliables de la République : « – Ah ! jeune homme ! ce n’est pas la Marianne qui est tout, c’est la Sociale ! Quand nous l’aurons, on fera de la charpie avec les bannières ; la Sociale, la Marianne, – deux ennemies53 ! ».
« Deux ennemies » ? Le mot est fort54. Mais c’est si vrai que les Républicains modérés, tous ces Justes (que Rimbaud conspue à la fin de L’Homme juste), et même les plus progressistes, « les Robinets » (qu’il raille dans « Paris » : lire, p. 265-287, le très intéressant article de Reboul sur ce poème de l’Album zutique), retirèrent leur soutien au processus lorsqu’il devint trop radical
à leur goût. Preuve s’il en fallait qu’on ne peut réduire la Commune à un contenu patriotique et républicain, essentiellement motivé par la défense de la République contre la menace d’une restauration monarchique.
Mais refermons cette parenthèse politique55. Il est difficile de commenter les idées politiques de Rimbaud sans laisser transparaître les siennes propres. D’où le risque très réel de faire du poète l’enjeu de récupérations idéologico-politiques. Persuadons-nous pourtant d’une chose : s’il est certes impossible de faire de Rimbaud un marxiste, même « à l’état sauvage », et de s’appuyer sur son œuvre pour valider l’interprétation marxienne de la Commune, il n’est pas davantage possible, sur la base des textes, d’analyser son désarroi post-communard comme un congé donné à la révolution et de s’appuyer sur son œuvre (éventuellement éclairée par celle d’un Andrieu) pour dénoncer l’« usurpation d’héritage » (p. 88) dont Marx et les marxistes se seraient rendus coupables à l’égard du mouvement communaliste.
Confrontations / Coopérations
(Michel et Christine)
La compréhension des textes de Rimbaud progresse à travers la confrontation des points de vue. C’est logique, c’est normal. Toute lecture nouvelle suppose la remise en cause des précédentes, si ce n’est dans tous leurs aspects du moins sur quelques points essentiels. Cette ambition de renouvellement est précisément ce qui la justifie. Il ne faut donc pas s’étonner, même si c’est un peu déplaisant, que certains chercheurs se croient tenus, pour justifier leur entrée en scène, de proclamer la totale nullité des interprétations antérieures et / ou de prétendre à la nouveauté absolue dans toutes leurs idées. L’auteur de Rimbaud dans son temps n’échappe pas toujours à ces défauts.
Ainsi lui arrive-t-il d’affirmer être le premier à énoncer telle solution (le drapeau rouge pour le « pavillon » de Barbare, par exemple) alors
qu’il sait fort bien que l’idée en a été déjà avancée (cf. supra). Il brocarde durement une interprétation communément admise et difficilement contestable (la présence d’un paysage polaire dans Barbare, par exemple, ou celle d’un blason du corps féminin dans « L’étoile a pleuré rose… »), ce qui ne l’empêche pas de la reprendre à son compte quelques pages plus loin…
Les commentaires rassemblés dans ce volume, de façon générale, ne croulent pas sous les références et les citations. C’est sans doute pour ne pas alourdir l’exposé, mais on le regrette parfois car la tradition est déjà longue, qui nous précède et qui nous aide à mieux lire les textes. Quand tel est le cas, n’est-il pas juste de le reconnaître et de le signaler, pour permettre au lecteur de se reporter à ces travaux antérieurs, s’il le souhaite ? Or, pour prendre quelques exemples, l’auteur de Rimbaud dans son temps ne juge pas utile de citer Sausy quand, commentant Voyelles, il compare à une mouche le dessin du A56, Étiemble lorsqu’il note que le « i » prolifère dans le tercet consacré au « U57 », Michel Courtois58 et Isabelle Rimbaud elle-même59 quand il propose d’accorder un sens révolutionnaire au poème Michel et Christine… Cependant, ce n’est pas là un comportement constant et Reboul ne manque pas, dans plus d’une occasion, de citer les confrères à l’égard de qui il se sent redevable : Fongaro pour avoir signalé la source Michelet (La Sorcière) de Vierge folle, Murphy pour avoir éclairé l’allusion cachée derrière les « becs de canne » de L’Homme juste ou encore pour avoir attiré son attention sur Paris (poème rarement commenté et pourtant fort intéressant de l’Album zutique), Zissmann pour la glose Forain de « Louise Vanaen de Voringhem » dans Dévotion, etc., etc.
Le travail de recherche est par nature un travail coopératif. Rien ne le montre mieux, en réalité, que la saga du rimbaldisme et j’aimerais en illustrer l’idée, au terme de ce compte rendu (et pour rendre justice à l’auteur de Rimbaud dans son temps) en m’appuyant sur le remarquable article que Reboul consacre à Michel et Christine.
Reboul rappelle que l’histoire de l’interprétation du poème commence avec « un article d’Étiemble et Yassu Gauclère, datant de 193660, entièrement gouverné par le mythe surréaliste » et dans lequel les auteurs concluaient à une expérience hallucinatoire « ne s’insér[ant] pas dans le cadre de nos concepts » (208). Il fallut donc attendre un article de Pierre Brunel, en 1987, pour qu’il soit question de trouver un sens au poème, sens que Brunel pensa déceler dans la satire du genre conventionnel de l’idylle. L’auteur de Rimbaud dans son temps le reconnaît volontiers : « Pierre Brunel, en l’occurrence, est convaincant et tout porte à croire qu’il a effectivement découvert là une des clés du poème, qu’il faudrait tenir en somme pour une manière d’allégorie. Seulement si tel est bien le cas, l’allégorie ne se limite pas à ces seuls éléments et là est toute la difficulté » (ibid.).
Car, outre sa signification parodique, le poème recèle un discours politique, ce que Brunel a bien senti, explique Reboul, mais qu’il a eu tort d’interpréter comme l’expression d’un espoir de régénération nationale sous le fouet de l’invasion prussienne, dont les hordes barbares du poème auraient constitué le symbole. Or, « une autre hypothèse a de meilleures chances d’être la bonne : celle qui voit dans ces Barbares chevauchant à travers l’Europe ancienne une représentation allégorique, classique au xixe siècle, de la subversion sociale et d’un futur bouleversement du monde contemporain » (p. 210).
C’est cette piste que Reboul développe brillamment dans son article et qui l’amène à déceler dans l’espèce d’idylle gauloise sur laquelle s’achève (et s’effondre) la vision du poème « l’Idylle messianique de l’Amour réinventé » (p. 220). Michel et Christine aurait donc été, dans le projet de Rimbaud, une allégorie du « Nouvel Amour » : l’« affection » (Génie), le couple, la (sainte) famille, redevenus possibles grâce à la révolution. « Un titre de vaudeville61 » aurait pu représenter aux yeux du poète ce rêve naïf avant
de « dresser », comme il le dit dans Alchimie du verbe, « des épouvantes devant [lui] », au moment où il s’avise que cette résurrection de l’Amour, décrite par le poème comme une sorte de retour aux sources barbares et païennes, porte déjà en germe sa négation chrétienne inscrite dans le nom de l’héroïne : « – Michel et Christine, – et Christ ! – fin de l’Idylle. »
Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car Steve Murphy, sur ces entrefaites, fait deux trouvailles savoureuses qui ne remettent pas en cause les résultats auxquels sont parvenus Brunel et Reboul mais au contraire les confirment et les complètent62. Il remarque une leçon biffée du manuscrit de Malines, pièce probablement contemporaine, appartenant à la section Paysages belges des Romances sans paroles, qui présente un mot rare également utilisé dans Michel et Christine (« railway »). Il fait observer que plusieurs mots ou expressions du texte de Verlaine, « Sahara de prairies », « plaine immense », « horizons », trouvent un écho dans le vers rimbaldien : « Fuyez ! Plaine, déserts, prairies, horizons ». Il note enfin tout ce qui rattache un poème comme Malines (et bien d’autres pièces de La Bonne Chanson ou des Romances sans paroles) à l’esthétique de l’églogue et tout ce qui pouvait exciter la verve de Rimbaud dans cette évocation d’un paysage « calme et fécond » faisant explicitement référence au quiétisme de Fénelon. Il en déduit qu’il ne faut pas seulement voir dans Michel et Christine la satire de l’idylle en général (comme le disait Brunel) mais la parodie d’une certaine « vieillerie poétique » à la Verlaine (que Rimbaud égratignera de nouveau au début d’Alchimie du verbe).
Reprenant en 2009 son article de 1990, Reboul ajoute donc une note (p. 321) mentionnant cette découverte mais l’accompagne de réserves et juge « incertaine », dans ce cas, la notion de « parodie ». Je ne vois pas la raison, pour ma part, d’être aussi réticent. Du moment que Reboul admet la thèse de Brunel (Michel et Christine comme satire du genre désuet de l’idylle), il devrait convenir que Murphy, lorsqu’il propose de considérer Michel et Christine comme une réplique rimbaldienne au quiétisme de Malines, ne fait qu’appliquer la thèse de Brunel à un cas particulier de mièvrerie poétique que Rimbaud avait précisément sous les yeux au moment où il écrivait son poème. Quoi de plus vraisemblable ? Et pourquoi refuser le terme de « parodie » ?
Mais j’ai parlé de deux trouvailles. En effet, Murphy a remarqué aussi dans certaines versions imprimées du vaudeville de Scribe que le nom de l’héroïne y est systématiquement abrégé, par commodité typographique, en « Christ63. ». D’où l’hypothèse, assez plausible après tout, que c’est en lisant un de ces exemplaires que Rimbaud pourrait avoir remarqué la présence épouvantable d’un incube christique au sein même du prénom de l’amoureuse et imaginé la spirituelle pirouette sur laquelle s’achève le texte.
Il serait certes excessif d’affirmer que le dernier mot a été dit sur ce mystérieux poème. Mais une lecture riche et cohérente est en voie de construction, grâce à la collaboration de trois éminents rimbaldiens de ce temps. J’y vois comme un symbole, et une belle illustration de ce qui personnellement me fascine dans cette aventure collective inachevée qu’est la recherche rimbaldienne.
Ce compte rendu est loin d’épuiser les richesses (et les possibles sujets de discussion) que recèle Rimbaud dans son temps. Il néglige plusieurs parties de l’ouvrage. Par exemple, je ne me suis pas attardé sur la célèbre exégèse de L’Homme juste, en raison même de sa notoriété auprès des rimbaldiens pour avoir éclairé de façon décisive ce texte important. Je n’ai guère commenté non plus cette partie de l’introduction (« Le Mythe ») et cet appendice (le « Traité des trois imposteurs ») qui analysent avec minutie les déformations successives imposées à la perception de l’œuvre de Rimbaud par les présupposés esthétiques de ses premiers commentateurs (décadents, symbolistes, surréalistes), leurs soucis de respectabilité (Isabelle, Verlaine), leurs motivations idéologiques (Claudel) ou leurs stratégies de notoriété (Berrichon, Delahaye). Je me suis attaché surtout aux études de textes, persuadé que je suis depuis longtemps qu’on peut faire sur Rimbaud toutes les théories les plus pénétrantes mais que c’est ce qu’on dit sur les textes, jusque dans leur détail, qui constitue, in fine, l’épreuve de vérité. Or, cette épreuve des textes, Yves Reboul la franchit avec une rare sagacité herméneutique, qui mérite la gratitude des lecteurs rimbaldiens.
Alain Bardel
Steve Murphy, Rimbaud et la Commune, 1871-1872. Microlectures et perspectives, Classiques Garnier, « Études rimbaldiennes », 2010, 916 p.
Vingt ans après Rimbaud et la ménagerie impériale (1991) et douze après son édition magistrale des Poésies de Rimbaud (Champion, 1999), Steve Murphy livre ici un ouvrage capital. Constitué d’analyses en grande partie inédites ou récrites pour l’occasion, celui-ci offre d’une part un bilan (provisoire !) d’une vie de chercheur consacrée à l’exégèse textuelle et à la compréhension historique des grands poètes maudits du deuxième dix-neuvième siècle (Rimbaud, mais aussi Baudelaire et Verlaine), d’autre part une somme rimbaldienne qui, modestement présentée comme une succession de « microlectures » portant principalement sur une quinzaine de poèmes64, suggère en réalité une vision globale de l’œuvre, saisie à la fois dans sa cohérence et dans sa dynamique. Il n’est donc pas question, dans le cadre restreint d’un compte rendu, de revenir sur tous les aspects d’un livre de plus de neuf cents pages : sans entrer, sauf exceptions, dans le détail des gloses et des propositions herméneutiques, je privilégierai ici les questions qui me paraissent essentielles, touchant à la fois à l’interprétation de Rimbaud et à la méthode critique.
Tout d’abord, il vaut la peine de noter que le temps a parfois du bon et a fait son œuvre. Naguère, la double orientation des recherches menées par Steve Murphy (la forte contextualisation des poèmes et la restitution de leur portée satirique ou parodique) pouvait paraître prendre à rebrousse-poil la tradition critique française, qui a fait de Rimbaud (comme de Baudelaire et de Mallarmé d’ailleurs) une figure tutélaire de toute modernité poétique, au prix d’une forte déshistoricisation et, plus généralement, du rejet de tout ce qui pouvait porter atteinte au sérieux, voire à la solennité de l’entreprise poétique (que ce sérieux soit esthétique, religieux, philosophique ou biographique). Or, au sortir d’une année agrégative où, en France, l’inscription des Poésies au programme du concours a entraîné une multitude de publications rimbaldiennes et surtout, a permis de sortir Rimbaud du cercle étroit des spécialistes pour
devenir un objet partagé par la communauté des dix-neuviémistes, il est clair que la vulgate critique a parfaitement assimilé, de façon paisible et comme une sorte d’évidence, les acquis principaux des travaux de Steve Murphy, et que la cause paraît désormais entendue.
Non pas que la thèse à laquelle on les réduit parfois abusivement (celle d’un Rimbaud militant engagé avant que poète) l’ait emporté ; mais le vain débat auquel ils ont donné lieu, établi sur des bases fausses, s’est éteint de lui-même. Indépendamment de la qualité et de l’érudition impeccable de ses exégèses, Murphy a eu l’immense mérite de corriger, de redresser la perspective critique de façon décisive, qu’une rapide comparaison permettra, je l’espère, de mesurer. Quel lecteur, en effet, imaginerait un seul instant de comprendre Céline sans intégrer à sa réflexion critique le traumatisme de la Grande Guerre, Pérec sans garder à l’esprit la tragédie de la Shoah ? Il ne s’agit même pas de contextualiser les œuvres, mais de prendre spontanément en compte le réel dont celles-ci sont tissées et qui détermine, pour une part sans doute essentielle, leur poétique. Il devrait aller de même pour Rimbaud. Mais, après deux guerres mondiales et le long chapelet des cataclysmes politiques qu’a connus le monde au xxe siècle, on ne parvient plus à ressentir avec sa pleine intensité l’exaspération des esprits sous le Second Empire, l’effet de sidération produit par le désastre de 1870 et la guerre (en particulier à l’Est de la France), la brutalité et la violence des actions liées à la Commune (notamment sa répression). Se rappeler les événements et pouvoir les dater est une chose ; les éprouver concrètement, émotionnellement, en est une autre. Murphy ne requiert pas du lecteur de Rimbaud une âme de communard, mais il restitue à l’histoire sa force concrète, son poids de réalité dans l’œuvre d’un poète qui a vécu son adolescence au moment de la plus grande crise nationale qu’ait connue la France depuis la Révolution française, alliant la guerre extérieure (et, alors, la plus expéditive défaite de la France moderne) et l’insurrection politique.
D’un point de vue purement littéraire, l’essentiel est donc de comprendre que l’intensité poétique de l’œuvre rimbaldienne n’est pleinement perceptible et analysable qu’à la condition d’y inclure la violence politique dont elle se nourrit – sauf pour ceux, note Steve Murphy, qui refusent d’admettre « qu’une poésie “lyrique” puisse aussi exiger une telle archéologie de la suggestion politique, en partie parce qu’on a fétichisé le lyrisme visionnaire de Rimbaud sans vouloir assez tenir
compte de ce que cette poésie tire d’autres traditions poétiques, de la poésie épique et, surtout, de la poésie satirique et combative » (p. 11). Ce détour par le politique est indispensable pour deux raisons au moins. Tout d’abord, parce qu’il s’impose pour celui qui prétend saisir ce que poète veut signifier. Je n’ose dire la « lettre » du texte, pour éviter d’oiseuses discussions théoriques. Mais restons au plus près des réalités concrètes : on est parfaitement en droit de lire Les Corbeaux autrement que comme un texte anticlérical et communard, mais il n’empêche que ce poème est un texte anticlérical et communard, comme Murphy en fait la démonstration (p. 771-841). De même, il faut sa magnifique analyse du Forgeron pour percevoir la réponse précise et polémique que Rimbaud adresse, à travers ce pastiche de la Légende des siècles, au progressisme jugé trop consensuel de Hugo (p. 115-119). Ensuite et surtout, parce que la force poétique de l’écriture rimbaldienne, qui intéresse tout amateur de poésie, est en proportion directe de sa puissance de suggestion, d’implicitation. Or, ainsi que dirait M. de La Palice, comment apprécier esthétiquement cette puissance d’implicitation sans décrypter, au préalable, ce qui est implicité par les textes ? Par exemple, il est impossible de repérer l’effet de chute dans le Bateau ivre sans le jeu sur le sens évidemment politique du mot « ponton » (p. 548) – ce qui ne signifie pas, bien entendu, que tout le poème doive se ramener à l’évocation de la Commune. De même, le recours au concret, à la suggestion sensorielle, à la violence organique (comme dans Le Cœur supplicié ou L’orgie parisienne ou Paris se repeuple), doit être interprété et estimé en liaison avec le sous-texte violemment contestataire qui parcourt souterrainement les poèmes.
L’exemple le plus vertigineux est donné par l’extraordinaire exercice de décryptage auquel se livre Steve Murphy à propos du frère Milotus d’Accroupissements (p. 317-366). Après l’examen attentif du faisceau d’éléments qu’il réunit, je suis totalement convaincu, à mon tour, que ce curé guère ragoûtant est une caricature poétique de Louis Veuillot, concentré de toutes les caricatures de presse représentant le redoutable directeur du journal catholique L’Univers. Et pourtant, le texte ne contient aucun indice réellement probant, et cette identification n’interfère absolument pas avec l’interprétation du texte, par ailleurs très grossièrement anticlérical. Il s’agit, en somme, d’un malin plaisir supplémentaire, tranquillement enfoui dans les épaisseurs du poème, que Rimbaud apportait à son lecteur complice, habitué à ce genre de manipulations. Ce point
mérite d’être souligné, et le constat étendu à l’ensemble des analyses de Steve Murphy : en l’espèce, le repérage des allusions implicites apprend moins sur le sens idéologique du texte (parfaitement clair, par ailleurs) que sur le geste artistique auquel procède Rimbaud, entretissant son texte avec les images qu’il convoque secrètement, et à la force de figuration poético-comique de ses compositions.
Or, pour faire affleurer ces significations cachées, il n’est nul besoin de tordre les mots, de se livrer à d’improbables acrobaties herméneutiques. Les épais dossiers intertextuels que réunit Steve Murphy montrent au contraire, avec une précision concrète peut-être jamais égalée, ce que savent ou devraient savoir tous les dix-neuviémistes, mais que les spécialistes exclusifs de poésie négligent parfois : que, sous le Second Empire, l’implicitation, l’ambiguïté, le détour ironique, l’« allusionisme » selon le mot employé pour qualifier le journaliste d’opposition Prévost-Paradol, constituent un code de communication parfaitement partagé et maîtrisé, une culture si banale qu’elle s’impose à tout auteur ou lecteur comme une seconde nature. Rimbaud n’invente rien avec ses jeux de cryptage, mais il radicalise une pratique d’époque ; et Steve Murphy ne fait à son tour, avec beaucoup de patience et de perspicacité, que ressusciter l’ensemble du « co-texte » (Claude Duchet) ou du « discours social » (Marc Angenot) où baignent les poèmes. D’où le parfum de déjà lu qu’on éprouve si souvent en lisant Rimbaud et auquel il est toujours difficile d’assigner une source précise ; d’ailleurs, celle-ci est à vrai dire beaucoup plus souvent dans l’air du temps que dans tel ou tel hypotexte, qui s’impose à nous pour cette seule raison que son auteur est connu : à ce propos, Steve Murphy a parfaitement raison de préférer la notion de « parodique » à celle, trop restrictive, de « parodie », qui laisse en outre accroire, dans une visée postmoderne si courante aujourd’hui, que la parodie aurait, en tant que telle, des vertus poétiques.
Cet intertexte est très souvent iconique, constitué de caricatures. Car le xixe siècle est le moment où la culture occidentale entre dans la civilisation de l’image et plus précisément, en ces temps de censure, de l’image caricaturale, qui est la plus efficace machine à impliciter qui soit – puisque, littéralement, elle ne dit rien, à l’exception de légendes lapidaires. Associer des caricatures à des poèmes énigmatiques, comme le fait systématiquement Murphy avec beaucoup de pertinence, n’offre pas seulement d’opportunes clés de lecture (ce qui n’est déjà pas négligeable),
mais rappelle que l’imaginaire poétique est, au xixe siècle, littéralement saturé d’images concrètes et que tout poème, illustré ou non, mêle par nature le visible et le lisible. Et, puisque ces images sont des caricatures, il s’agit aussi d’une poésie qui laisse la meilleure place au rire, mais à un rire artistique, alliant indissolublement la fantaisie, la dénonciation réaliste, la démesure carnavalesque : « Si réalisme il y a dans la fantaisie rimbaldienne, c’est dans un sens vaste, non exclusif, réalisme du miroir déformant des foires, de l’ordre du réalisme grotesque, carnavalesque, suggéré par Bakhtine, si ce n’est que ce réalisme s’avère résolument polémique » (p. 314). Ce qui se lit en creux de l’herméneutique pratiquée par Steve Murphy, c’est donc une authentique poétique rimbaldienne, bien plus proche de l’authentique émotion littéraire ou artistique que celle qu’on trouve dans tant d’entreprises critiques pourtant explicitement menées sous la bannière de l’Esthétique.
À condition, bien entendu, que le plaisir (parfois pervers) de l’herméneutique n’amène pas à faire dire à peu près n’importe quoi aux textes, à se laisser entraîner dans un délire interprétatif en renonçant à tout garde-fou : j’en viens ici aux deux principales qualités de méthode que possède Steve Murphy, et qui lui permettent de se prémunir de ce travers.
En France, sans doute par déformation scolaire (la sacro-sainte dissertation ?), on ne cesse de passer du général au particulier, ou du particulier au général, si bien qu’une microlecture ne semble avoir d’autre utilité que de justifier une thèse générale que dix autres microlectures, pour le même texte ou pour d’autres textes de l’auteur, auraient tôt fait d’invalider, si bien encore qu’il suffit souvent qu’une interprétation paraisse astucieuse ou élégante (voire encore obscurément profonde) pour qu’elle soit jugée valide et recevable. Aux antipodes de cette tradition critique, la pratique de Steve Murphy me paraît absolument unique. Par une sorte d’ascèse herméneutique, il se refuse absolument à toute sorte d’extrapolation généralisante, mais reste constamment au plus près du texte, examinant mot après mot, vers après vers, poème après poème, toutes les interprétations possibles, les mettant à l’épreuve, les comparant patiemment, évaluant sans a priori leur degré de probabilité, mettant son érudition littéraire, biographique ou historique au service de ce travail d’élucidation. Labeur long, immense et raisonné, mais très productif. Il m’est arrivé bien des fois d’être d’abord un peu sceptique
à la lecture de telle glose, puis de rendre les armes devant la précision des analyses, la rigueur logique des analyses textuelles, cette manière méticuleuse de repérer les indices et de les confronter, comme le ferait une enquête policière.
Or, on sait bien qu’un bon policier ne doit pas se laisser aveugler par le premier soupçon qu’il peut concevoir en cours d’enquête. L’une des qualités qui me frappe le plus, à la lecture de Rimbaud et la Commune, est justement que l’attention suraiguë portée au détail, la subtilité arachnéenne des argumentations ne développent jamais cette obsession monomaniaque et cette fermeture au débat contradictoire qui sont si fréquentes chez les herméneutes passionnés (je ne suis pas le dernier, je le crains, à pécher parfois par un tel aveuglement). Or, bien au contraire, il y a chez Murphy une aptitude exceptionnelle à rester à l’écoute de toute interprétation autre, sans parti pris, pourvu qu’elle s’appuie sur des arguments convaincants : on sent en le lisant, avec un bonheur incrédule, que les notions de travail collectif, de résultats cumulatifs, ne sont pas ici des formules creuses. On rêve, sur ce modèle, d’une communauté des chercheurs en poésie où telle obscurité textuelle puisse être considérée comme éclaircie, après examen et débat réellement approfondis, de telle sorte qu’on progresse réellement dans l’interprétation des poèmes, sans devoir recommencer constamment à partir de rien et dans toutes les directions, comme si rien n’était jamais acquis : on aura compris qu’il s’agit bien là d’un rêve.
À ce goût du partage et de la collaboration scientifiques s’ajoute, chez Steve Murphy, le sens du concret qui est absolument indispensable pour lire Rimbaud. Ainsi dans ce commentaire lumineux de l’expression « pâlir au soleil » dans Les Mains de Jeanne-Marie – expression énigmatique mais qui paraît relever de l’évidence une fois qu’on a lu ceci : « Que des mains hâlées puissent pâlir au soleil n’est pas un paralogisme, mais une constatation que peut faire tout lecteur qui regarde des mains bronzées s’agrippant de toute leur force à un objet et ici, l’objet est désigné clairement : “le bronze des mitrailleuses” qu’il s’agit d’arracher aux soldats envoyés par Thiers » (p. 655). Bien sûr, ce travail de fourmi herméneute n’est recevable qu’en tenant pour vraie une thèse méthodologique forte, qui est posée dès l’introduction et à laquelle je souscris entièrement. La diversité légitime des lectures – légitime puisqu’elle découle de la complexité des textes et de la subjectivité inhérente à l’acte
de lecture – ne doit pas conduire à un relativisme absolu et à l’idée paresseuse et désinvolte que toutes les interprétations se valent (autre manière de dire qu’aucune ne vaut grand-chose et qu’on aurait affaire qu’à des constructions fantasmatiques ou, selon le mot d’Étiemble, mythiques) :
[…] l’effet de l’ubiquité du Mythe, s’essaimant en mythes spécifiques : Rimbaud communard, Rimbaud bourgeois, Rimbaud catholique, etc., a débouché, dans l’idée de beaucoup de commentateurs, sur une mythophobie qui a fini par évacuer non seulement toute nuance, mais toute différenciation, quantitative et qualitative, entre les différentes visions d’ensemble, parfois fondatrices, de la rimbaldologie. (p. 17)
Au contraire, Steve Murphy a toujours à cœur, quelle que soit sa propre inclination, d’évaluer posément, de façon aussi objective ou, du moins, dépassionnée que possible, le degré de probabilité de chaque interprétation, de séparer le bon grain de l’ivraie.
Or l’ivraie prolifère – et j’en viens ici à la deuxième grande leçon que donne Steve Murphy, par la vertu de l’exemple – lorsque l’on se livre à des extrapolations sémantiques sans prendre en compte les contraintes syntagmatiques qui restreignent la polysémie du mot :
« Mais tous les mots sont polysémiques », observait M. Riffaterre […] La syntaxe et le contexte sémantico-référentiel permettent cependant de « filtrer » les données (selon la métaphore adoptée par M. Riffaterre) pour « annuler » des significations rendues illogiques, conditions de production du sens qui peuvent être mises en péril par des difficultés présentées par cette syntaxe ou par un contexte opaque, ainsi que par des opérations d’interprétation hasardeuses du lecteur. (p. 638)
D’où, par exemple, l’impeccable glose de l’énigmatique « je verrai dans votre principe la poésie objective » de la lettre du 13 mai (p. 180-181), le principe renvoyant, dans l’hypothèse d’un monde politiquement transformé, au « On se doit à la Société » en début de lettre ; ou du « Tas de chiennes en rut mangeant des cataplasmes » de L’Orgie parisienne, pour désigner les Versaillais et non les prostituées (p. 388). L’autre travers interprétatif consiste à confondre systématiquement le plan de la dénotation – ce que le mot signifie, en fonction des contextes argumentatif et référentiel – et celui de la connotation – les significations que chaque lecteur peut associer au mot, en fonction de son univers psychique et de son bagage culturel. Au contraire, Steve Murphy prend toujours soin de
distinguer le co-texte général, la masse d’images, de stéréotypes ou de lieux communs qu’on devine en arrière-plan, et les éléments qui sont effectivement mobilisés par l’auteur, en fonction de la logique propre à chaque poème : il consacre par exemple le temps qu’il faut, à propos du Châtiment de Tartufe, à montrer que le mot de « châtiment » laisse entrevoir la silhouette de Victor Hugo (donc celle de Napoléon III, derrière Tartufe), mais la démonstration paraît presque irréfutable (p. 86-95).
Est-il alors utile de relever, pour l’acquis de ma conscience de recenseur, les questions de détail où il m’arrive de résister, d’être exceptionnellement moins convaincu ? Ainsi, même si je perçois la difficulté idéologique que soulève Le Dormeur du val, qui peut difficilement être un sonnet pacifiste au moment de sa publication en novembre 1870, il m’est difficile de voir dans ce mort endormi « une paradoxale promesse d’avenir » (p. 111), alors qu’il est plus simple d’imaginer, comme la chose est d’ailleurs presque suggérée deux lignes plus bas, que ce soldat est peut-être un soldat régulier prussien, donc tué soit par un tireur isolé soit par des corps francs, les seuls à s’opposer militairement à l’occupation ennemie, à ce moment. J’ai aussi du mal à associer le vert des « Propriétés vertes » du Chant de guerre parisien à celui de la Vénus anadyomène, avec son ulcère à l’anus (p. 220). Malgré l’abondance de preuves à l’appui, je ne vois toujours pas ce que vient faire dans ce même poème, à propos de la très mystérieuse « boîte à bougies », La Lanterne de Rochefort (p. 238-249), même si j’y vois aussi une lanterne ou un chandelier bricolé. Un peu plus bas, je pense également que l’hannetonnage désigne le bombardement à coup d’obus, mais les « tropes » ne peuvent donc désigner les « troupes », sinon dans un très vague arrière-plan calembourdesque, surtout à une époque où il n’existe pas encore de troupes aéroportées… J’ajoute d’ailleurs aussitôt que, ayant moi-même dépensé beaucoup d’énergie herméneutique sur ce poème65, mes réticences risquent d’être de parti pris. Je crois par ailleurs à la vertu lyrique des « fumiers chauds » des Reparties de Nina, qui ne contredit pas, selon moi, la tonalité parodique (voir p. 530).
Mais j’en arrête là avec mes impressions personnelles de lecteur de Rimbaud, dont je pourrais continuer la liste mais qui n’ont pas leur place dans ce compte rendu. Quant au problème très controversé des
derniers poèmes en vers, je ne saurais en dire beaucoup puisque, Steve Murphy nous l’annonce dès son avant-propos, il se réserve « de revenir sur d’autres textes de 1872 que ceux abordés ici et sur Les Illuminations » (p. 10). On attend donc avec impatience ce troisième opus, qui est annoncé par quelques phrases très suggestives :
Que Rimbaud ait eu, après la Semaine sanglante, de sérieux doutes sur l’imminence d’une nouvelle révolution est une évidence ; que son utopisme ait pris un coup sévère en est une autre. Mais le rêve demeure, ainsi que l’amertume devant une terreur blanche dont on peine encore à imaginer l’envergure et l’impact sur le monde de la poésie entre 1871 et 1875. (p. 12)
Tout cela est parfaitement juste. Mais il est vrai aussi que, jusque là, le politique était intriqué au poétique parce que Rimbaud menait un combat politique, tenait un discours de lutte (même sous la forme la plus elliptique et la plus déréglée). La conscience que, désormais, l’engagement du poète n’a plus aucune effectivité ne change sans doute pas les convictions de l’homme. Pourtant, on sent bien que quelque chose se délie dans l’écriture, qu’un nœud de violence se défait, laissant affleurer d’autres mots, d’autres manières d’écrire et de versifier (sans qu’il soit nécessaire de toujours convoquer l’influence de Verlaine), qu’un nouvel imaginaire s’épanouit à la surface des textes, comme les fleurs japonaises de papier évoquées par Proust – en un mot, que se pose désormais en des termes nécessairement nouveaux (jusqu’à quel point ?) la question du rapport entre le politique et le poétique, qui est l’objet même de l’œuvre critique de Steve Murphy : raison de plus pour attendre maintenant impatiemment, dans le prolongement de la remarquable analyse déjà publiée de Mémoire66, le futur livre annoncé, qui parachèvera l’édifice herméneutique.
Alain Vaillant,
université Paris Ouest
(Nanterre la Défense)
Rimbaud. Des Poésies à la Saison, études réunies par André Guyaux, Classiques Garnier, « Rencontres » 4, 2009.
Avec comme objectif de déployer une « diversité des méthodes et des points de vue » (p. 8) au sein des études sur Rimbaud, André Guyaux rassemble, dans cet ouvrage collectif issu de la journée d’étude de la Sorbonne du 12 décembre 2009, quinze articles très différents qui témoignent de la richesse des études rimbaldiennes actuelles. Versification, stylistique, influences politiques ou bibliques, approches tantôt théoriques tantôt thématiques : tout s’y trouve, en des perspectives variées à l’image des poèmes dont il est question dans ces analyses.
C’est à Éric Marty d’ouvrir le premier volet, avec une discussion sur « Rimbaud, nature et poème » qui tente de situer les premières scènes poétiques et pastorales (Sensation et Première soirée) dans une plus vaste discussion autour de l’idée de la nature au dix-neuvième siècle ; en ceci il s’agit d’un prolongement de ce que l’auteur a développé dans son étude antérieure de Sensation67. Ici la nature n’est pas seulement l’arrière-plan du poème : « Subjective, existentielle, métaphysique, elle est le Poème lui-même qui ne se donne que dans un futur qui est commencement, imminence et qui n’a pas de fin » (p. 12). L’analyse qui suit, érudite et convaincante, tire sa force du contexte historique, tantôt littéraire tantôt artistique plus généralement ; aussi est-il question de situer Les Reparties de Nina par rapport à Madame Bovary, Première soirée vis-à-vis du Déjeuner sur l’herbe de Manet. Si parfois il s’opère dans ces comparaisons un léger déni historique – « un espace inaliénable et inaliéné par l’histoire » (p. 17) dans les trois poèmes dits « historiaux » (Le Mal, Le Dormeur du val, Les Corbeaux) – l’ensemble est néanmoins convaincant.
La dimension politique de l’œuvre en vers de Rimbaud prend le dessus dans les articles suivants, de Jean-Marc Hovasse (« Les Châtiments de Rimbaud », p. 33-51) et de Hermann H. Wetzel (« La poésie politique de Rimbaud », p. 53-66). Impossible d’éluder la figure de Victor Hugo, soit dans le modèle qui aurait tant inspiré le jeune Rimbaud lecteur des Châtiments (résultant en de riches intertextes selon Hovasse), soit dans la période d’imitation du premier Rimbaud, avant la phase de la caricature et de la parodie – tant étudiée par la critique rimbaldienne ces
dernières années – et, l’étape ultime, ce que Wetzel appelle « La phase des modèles poétiques complexes » (p. 65-66), comme dans Ville, Villes et Après le Déluge des Illuminations. Il s’agit de comprendre, de parodier avant de faire du nouveau, certes, mais cette évolution, qui figure, selon Wetzel, dans de trop hâtives présentations du vers de Rimbaud, en allant du vers jusqu’aux Illuminations, sont à prendre en compte simultanément dans la trajectoire de la pensée politique rimbaldienne.
Les lectures suivantes – de James Lawler sur Le Bateau ivre, de Laurent Zimmermann sur Larme et de Jean-Luc Steinmetz sur le poète en mai 187268 – montrent, chacune à leur manière, la grande et étonnante diversité non seulement de l’œuvre en vers rimbaldienne mais également des approches critiques qui s’y sont vouées. L’éminent auteur de Rimbaud’s Theatre of the Self69, l’une des études sur Rimbaud les plus importantes venant du Nouveau Monde, élucide Le Bateau ivre, chacune des cinq parties qu’il identifie apportant une dimension tout rimbaldienne au voyage et proposant respectivement une réponse au Voyage baudelairien. Aussi Rimbaud aurait-il « choisi de composer une somme qui accuse les ambiguïtés ainsi que l’espace de liberté qu’elles créent » (p. 75). La dette envers Baudelaire devient encore plus importante chez Laurent Zimmermann, qui offre comme lecture possible de Larme une réponse rimbaldienne à Élévation, « intertexte qui a une valeur explicative plus importante pour l’ensemble du poème » ; il s’agirait d’« une forme de polémique, de débat violent au cours duquel Baudelaire est appelé de manière fantomale pour permettre la formulation d’une position qui se démarque de lui et qui insiste sur la différence » (p. 81). Pour sa part, Jean-Luc Steinmetz montre que, même à travers leur réimpression, certaines de ses analyses n’ont perdu en rien de leur perspicacité70. Quel plaisir pour nous, lecteurs, de constater que le bonheur est pour Rimbaud « un pivot de sa détermination poétique » qui lui permet de faire en sorte que « [s]on encrapulement prodigieux transforme la misère en signe d’élection » (p. 102) !
Ces études sur les poèmes en vers sont complétées par les deux analyses suivantes, sur la versification : cours magistral, et majestueux, de Dominique Billy des innovations rimbaldiennes portées à l’alexandrin (63 pages, soit le cinquième de l’ouvrage)71, et un survol de la versification rimbaldienne par Brigitte Buffard-Moret, bien plus modeste que l’étude imposante qui la précède72. Ces deux chapitres, qui considèrent le vers de Rimbaud dans une évolution linéaire, notant entre autres que « L’affaiblissement progressif de la césure qui marque l’histoire de l’alexandrin trouve un reflet dans l’évolution de Rimbaud entre 1870 et 1871 », « jusqu’à la déconstruction à laquelle il soumettra ce mètre dans les derniers vers73 », s’inscrivent parmi les récentes études importantes sur le vers rimbaldien, notamment celles de Jean-Pierre Bobillot, Benoît de Cornulier, Marc Dominicy, Jean-Michel Gouvard et Michel Murat, cités, ainsi que celles de Jean-Louis Aroui (celui-ci cité, quoique sous le nom « Arouimi », p. 77) et Philippe Rocher, passé sous silence. Dans une étude remarquable, notamment pour son analyse de Mémoire et de « Qu’est-ce pour nous, mon Cœur… », Billy nous montre comment Rimbaud « s’ingénie, en 1872 sans doute, à s’affranchir de la contrainte de la césure dans l’alexandrin : les mètres déviants en sont plus des exceptions dans le cadre de vers souvent sages, à la césure bien marquée, auxquels une utilisation audacieuse du rejet peut donner une vie intense74 ». Il s’agit d’« une incontestable audace dans le traitement de la césure, avec laquelle il prend des libertés nouvelles75 ». Buffard-Moret propose un survol bien plus modeste, mais tout aussi lucide, qui tente de « faire le point sur la versification de Rimbaud » en soulignant « les liens que le vers entretient avec le propos et […] le goût de Rimbaud pour la chanson » (p. 183), ce dernier sujet lui permettant de souligner des aspects importants de son essai intitulé Chanson poétique du xixe siècle76, même s’il lui n’aurait pas été inapproprié de faire appel aux études des Aroui, Chevrier et Cornulier dans ce même domaine.
Puis c’est au tour de Michel Murat d’intervenir, ce qu’il fait avec brio77, nous rappelant non seulement que « Le “reniement” d’Alchimie du verbe ressortit à la fiction » mais aussi, à propos des vers qui y sont cités, que « la fiction d’un reniement ou d’une crise est nécessaire pour attirer l’attention sur ces textes et les rendre, au moins sur un certain plan (en tant que symptômes d’une “folie” poétique) admissibles » (p. 198). Dans cette nouvelle approche des deux premiers chapitres de son Art de Rimbaud78, Murat rappelle au lecteur non seulement que « Les remaniements formels d’Alchimie du verbe apportent des écarts vivants, et […] cohérents » (p. 211), mais également la place importante qu’occupe son œuvre critique au sein des études rimbaldiennes.
Les trois études suivantes sont consacrées elles aussi à Une saison en enfer. Aurélia Cervoni consacre ses connaissances de l’édition de Rimbaud79 à une discussion des différences entre les brouillons de la Saison et la version imprimée80 ; dans celle-ci « la phrase gagne en concision, en densité » (p. 214), on assiste à « une dramatisation de l’écriture » ou à « une recherche d’expressivité » (p. 218) évidente au niveau de la ponctuation aussi bien que sur le plan d’un rythme syntaxique « mieux dessiné » (p. 219). Le style qui en résulte, « le reflet d’un exorcisme », signale une fin qui n’est qu’un début : « Une saison en enfer représente l’aboutissement d’un cycle de création en même temps que le début d’une résurrection » (p. 231). Si l’Annexe qui suit son analyse (p. 232-238) – la reproduction des « brouillons » de la Saison – serait en elle-même une bonne idée, la transcription du texte ne permettant pas d’espaces entre lignes (mots dans l’interligne mis entre soufflets) montre à quel point il est parfois hasardeux de proposer une reproduction dactylographique d’une page manuscrite ; aussi aurait-il été préférable d’y glisser des images des fac-similés à côté des transcriptions, préservant leur espacements, angles et polices différents.
Ensuite Yoshikazu Nakaji rappelle aux lecteurs le rôle central que jouent ses analyses de la Saison81, dans une discussion convaincante de Nuit de l’enfer selon les axes poétiques déjà établis dans les deux lettres
célèbres de mai 187182. En constatant que, dans ce poème, « le locuteur se présente comme un halluciné talentueux », Nakaji focalise son attention sur ce que ce locuteur « voit ou entend dans ses hallucinations, et ce que Rimbaud entendait par “ l’inconnu”, érigé en objectif de la recherche de mai 1871 » (p. 247) ; sa conclusion – selon laquelle « la poésie de Rimbaud emprunte la voie d’une nouvelle subjectivation malgré tout son mépris pour la “poésie subjective” » (p. 257) – montre la finesse avec laquelle l’auteur déploie son analyse de l’« itinéraire touffu » (idem.) qu’est Nuit de l’enfer. La « goutte de pluie » que Dominique Millet-Gérard se propose d’apporter aux études de la Saison83, en puisant dans la richesse biblique et évangélique des poèmes, élucidant des intertextes possibles, est, comme le chapitre suivant par Romain Jalabert sur « Le latin dans l’œuvre de Rimbaud » (p. 281-292), riche en possibles et suggère plusieurs champs de recherches sur ces aspects de l’œuvre de Rimbaud. C’est également le cas dans les deux derniers articles ; dans le premier, théorique, Atle Kittang84 se propose une lecture de Rimbaud à travers la notion bachelardienne de l’espace85. L’incontournable Dominique Combe présente les différents degrés de bruits et de silences à travers l’œuvre poétique de Rimbaud86 : voix, fanfares, rumeurs, sons, tout ce qui est entendu (et inouï) dans cet « univers sonore » (p. 322) s’y trouve, dans une analyse dont la richesse est à la hauteur de l’œuvre rimbaldienne qu’elle interroge.
La quatrième de couverture constate, non sans raison, que « les quinze études recueillies dans ce volume n’ont d’autre principe que l’attention soutenue au texte de Rimbaud ». C’est précisément de quoi il s’agit, et, en mettant l’accent sur les textes eux-mêmes, les contributeurs à l’ouvrage et leur éditeur ont contribué de manière fort utile à notre connaissance de l’œuvre en vers de Rimbaud, ainsi que d’une Une saison en enfer.
Seth Whidden,
Villanova University