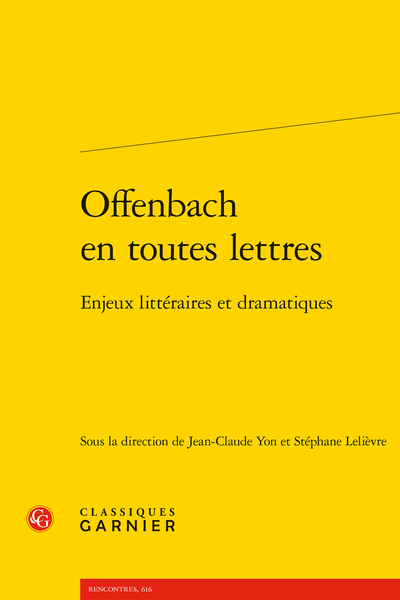
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Offenbach en toutes lettres. Enjeux littéraires et dramatiques
- Pages : 365 à 370
- Collection : Rencontres, n° 616
- Série : Littérature générale et comparée, n° 40
- Thème CLIL : 4028 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes de littérature comparée
- EAN : 9782406161042
- ISBN : 978-2-406-16104-2
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16104-2.p.0365
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 19/06/2024
- Langue : Français
Résumés
Jean-Claude Yon et Stéphane Lelièvre, « Introduction »
Cet ouvrage collectif aborde l’œuvre de Jacques Offenbach sous des angles originaux et souvent inédits : questionnements dramaturgiques, librettologie, fortune des œuvres au-delà des frontières spatiales et temporelles, ou encore étude de mises en scène et d’adaptations diverses, scéniques ou télévisées.
Stéphane Lelièvre, « Quand George Sand inspire les librettistes d’Offenbach à son insu… »
Le Secrétaire intime (1834) de George Sand est-il la source cachée du livret de La Grande-Duchesse de Gérolstein (1867) écrit par Henri Meilhac et Ludovic Halévy ? C’est l’hypothèse savamment développée par cet article qui, en procédant ainsi, rappelle que les livrets d’Offenbach sont – pour les meilleurs – d’authentiques textes littéraires qui doivent être traités comme tels.
Carlota Vicens-Pujol, « Les notes de voyage de Jacques Offenbach ou la tentation des avant-gardes »
Offenbach n’a publié qu’un seul livre, en 1877, à savoir les Notes d’un musicien en voyage où il fait le récit de sa tournée américaine de 1876. Appliquer à ce texte très personnel la grille de lecture des récits de voyage permet de comprendre encore mieux Offenbach, son rapport à l’Autre et sa fascination pour la modernité.
Laurent Fraison, « La genèse de La Fille du tambour-major. Correspondance de Jacques Offenbach à Henri Chivot et Alfred Duru »
Est réunie ici la correspondance échangée entre Offenbach et ses librettistes Henri Chivot et Alfred Duru à propos de La Fille du tambour-major (1879), 366intégralement préservée et restituée pour la première fois – un ensemble apportant de précieux témoignages sur la façon de travailler du compositeur (lequel fait notamment mention de plusieurs morceaux qui seront par la suite abandonnés), et d’autant plus intéressant que les lettres concernent la quasi-totalité de l’opéra-comique en question.
Alain Galliari, « À propos de Jules, frère de Jacques »
En 1833, Offenbach et son frère s’installent à Paris. Si le premier connut un destin brillant, l’histoire du second reste beaucoup plus obscure. À partir des quelques (rares) documents faisant mention de la figure de Jules est ici retracée l’existence de celui que la postérité n’évoquera guère que comme « le frère de Jacques ». Une existence marquée par l’impossibilité à faire reconnaître pleinement son talent, et qui s’achèvera tristement dans un hospice dont Jacques réglait les frais…
Florence Fabre, « Nietzsche et les Grecs d’Offenbach »
L’intérêt de Nietzsche pour Offenbach est ancien, et ne se limite pas à l’opposition fameuse avec Wagner : Offenbach permet aussi au philosophe de prendre ses distances avec certains excès du romantisme (en particulier le grand opéra historique meyerbeerien), et lui offre tout à la fois une satire de la société contemporaine, un antidote au dégoût et à la mélancolie, une gaîté en forme de pied-de-nez et un allégement momentané qui ouvrent tous la voie vers le grand style à venir.
Matthieu Cailliez, « Le succès des ouvrages d’Offenbach en Allemagne et en Italie dans la deuxième moitié du xixe siècle. Analyse comparée de la diffusion et de la réception des ouvrages »
Grâce à un vaste dépouillement de sources de différents pays, et grâce à des comparaisons avec d’autres compositeurs, le succès international d’Offenbach au xixe siècle fait ici l’objet d’une évaluation précise, les données quantitatives étant prolongées par une approche plus qualitative pour les cas allemand et italien – laquelle révèle notamment un hiatus entre succès populaire et réticence de la critique.
367Elena Oliva, « Na bella Elena imbastarduta, Offenbach à Naples dans la deuxième moitié du xixe siècle »
L’arrivée de l’opérette en Italie, phénomène très mal connu jusqu’à il y a peu, nécessite une approche régionale pour être parfaitement comprise. Le cas de Naples est particulièrement riche, les représentations en français et celles en italien étant complétées par l’écriture de parodies en napolitain – ouvrages où le génie local se mêle à celui d’Offenbach avec une extraordinaire efficacité.
Évelyne Ricci, « Du livret au libreto. Traductions, adaptations et parodies de Jacques Offenbach en Espagne »
Si l’auteur de La Périchole a multiplié les hispanismes dans ses partitions, on a oublié combien l’Espagne du xixe siècle s’est passionnée pour les ouvrages d’Offenbach. En franchissant les Pyrénées, toutefois, ceux-ci doivent s’adapter à une autre société et à un autre public. C’est ce travail d’adaptation qui est ici analysé, un intérêt spécial étant porté au langage théâtral dans toutes ses composantes.
Tania Brandão, « Offenbach et Artur Azevedo, le cancan tropical »
L’influence d’Offenbach au Brésil a été profonde au xixe siècle. Après avoir tracé les contours du processus d’acculturation de ses ouvrages, la réflexion se concentre ici sur le cas d’Arthur Azevedo (1855-1908), dramaturge, poète et homme de théâtre qui, dans ses écrits sur Offenbach comme dans ses livrets d’opérette, a été l’un de ses continuateurs les plus doués.
Laurent Bury, « De Taken from the Greek à Troy Boy, avatars anglophones de La Belle Hélène »
En envisageant la façon dont le monde théâtral anglophone s’est emparé de La Belle Hélène, entre 1866 et 2011, le panorama dressé par cet article montre combien est délicate la transposition du répertoire offenbachien dans un monde qui n’est pas le sien et quels sont les procédés, plus ou moins pertinents, auxquels eurent recours les adaptateurs, en particulier dans les parties chantées.
368Alexander Flores, « Offenbach en Égypte »
Offenbach n’est pas un inconnu sur les bords du Nil. C’est avec La Belle Hélène qu’est inauguré en 1869 le Théâtre de la Comédie au Caire. Encore plus passionnante est la deuxième réception d’Offenbach en Égypte, dans les années 1920, quand le chanteur et compositeur Sayyid Darwiche (1892-1923) s’inspire de son répertoire pour peindre la société égyptienne contemporaine, avec la même force satirique.
Tom Mébarki, « Comment l’opéra-bouffe d’Offenbach peut-il résoudre l’équation Musique-Texte ? Du texte théâtral au pré-texte musical »
Prima la musica, e poi le parole. L’étude de la relation entre signe musical et signe verbal se résume souvent à une forme de dualité : qui, du texte ou de la musique, « modèle » l’autre ? Or l’œuvre d’Offenbach permet de dépasser cette dualité, grâce notamment au rôle dévolu à la situation, qui autorise le passage des événements sonores (texte comme musique), et désamorce tout rapport d’ascendance entre le mot et la note, les deux participant d’une destruction de la prosodie traditionnelle.
Emmanuelle Cordoliani, « “Pour 30 francs par mois”. Essais d’une dramaturgie féministe et prolétarienne d’Offenbach »
L’air avec lequel Catherine, dans Pomme d’Api, se présente – aussi bien à Rabastens qu’au public – est en apparence bien anodin… En apparence seulement, car à y regarder de plus près – et notamment à la lumière de l’ouvrage d’Anne Martin-Fugier, La Place des bonnes : la domesticité féminine à Paris en 1900 –, on constate qu’il est on ne peut plus révélateur de la condition qui était, en France, celle des femmes et des domestiques en cette fin de xixe siècle.
Jérôme Collomb, « Les Contes d’Hoffmann, une dramaturgie impossible ? »
Toute personne souhaitant monter Les Contes d’Hoffmann se voit confronté à un problème fort complexe : la mort ayant emporté le musicien avant qu’il ait pu mettre un point final à sa partition, il faut composer à la fois avec les sources manuscrites, les multiples arrangements et adaptations existants et les découvertes musicologiques du xxe siècle. Quels choix dramaturgiques 369peut-on proposer, dans ces conditions, qui ne dénaturent ni l’esprit de l’œuvre, ni celui du compositeur lui-même ?
Dominik Pensel, « “Cette ardente flamme”, discours sur la créativité, d’Hoffmann à Offenbach »
Le héros d’Offenbach ne serait-il qu’un buveur incapable de reconnaître les limites entre « poésie et vérité », condamné à inventer le « récit de ses folles amours » ? L’opéra pose de manière autoréflexive la question du statut de l’art et des conditions de la création artistique. Hoffmann y est tout à la fois une figure de l’art et une figure de réflexion sur l’art, questionnée ici à partir du modèle « Art-Éros » appliqué aussi bien aux récits de l’auteur allemand qu’à l’opéra d’Offenbach.
Peter Hawig, « Jacques Offenbach et Thomas Mann, quelques informations et une théorie osée »
Le nom de Thomas Mann est bien plus souvent associé à ceux de Nietzsche, Wagner, Goethe ou Schiller qu’à celui d’Offenbach. Pourtant, ce dernier n’est pas absent de son œuvre : il est cité à la fin de La Montagne magique et certaines musiques d’Adrian Leverkühn (Le Docteur Faustus), dans leur volonté de faire disparaître les contrastes entre haut et bas, entre érudit et populaire, ne portent-elles pas l’empreinte d’Offenbach, quand bien même celui-ci n’est jamais explicitement mentionné ?
Péter Bozó, « Offenbach est mort, vive Várady. Une étude de cas sur la réception d’Offenbach en Hongrie dans les années 1950 »
En Hongrie, entre 1949 et 1956, l’opérette est mise au service de l’idéologie communiste, les œuvres étant largement réécrites. Particulièrement intéressant est le cas de Monsieur Choufleuri restera chez lui le… qui fait l’objet d’une adaptation au Théâtre municipal de la Gaîté à Budapest en 1953 sous le titre Egy Marék boldogság. Les transformations sont si profondes que c’est l’essence même de l’opérette-bouffe d’Offenbach qui est perdue.
370Miryana Yanakieva, « Offenbach en Bulgarie »
On trouvera ici une présentation de la réception des opéra-bouffes d’Offenbach en Bulgarie, en tenant compte des conditions nationales spécifiques. Après un bref aperçu de l’histoire de l’opérette dans le pays, le propos est essentiellement consacré aux mises en scène de La Belle Hélène – l’œuvre d’Offenbach la plus jouée dans les théâtres d’opéra bulgares. Une attention particulière est portée à l’adaptation et à la traduction des livrets.
Laurent Bihl, « “Offenbach aux enfers ?” Retour sur la “médiocrité” de la minisérie télévisée de Michel Boisrond, Les Folies Offenbach (Antenne 2, 1977) »
En 1977, la télévision française programme LesFolies Offenbach, une série qui connaît alors un vrai succès. Avec le recul, on ne peut que constater sa médiocrité, ses inexactitudes, le manque de moyens qui lui furent alloués. Elle constitue pourtant l’une des rarissimes tentatives d’incarnations narratives du musicien (interprété par un Michel Serrault brillant) et, si la réalité y est malmenée, du moins ne peut-on lui dénier une belle mise en valeur de la musique et de la verve d’Offenbach.
Hélène Routier, « Cinq adaptations offenbachiennes de Laurent Pelly et d’Agathe Mélinand »
À partir de l’étude de cinq mises en scène offenbachiennes de Laurent Pelly est ici proposée une analyse de l’art de ce metteur en scène et de sa dramaturge Agathe Mélinand, notamment à partir de la notion de métakitsch qui sous-tend leur travail. L’œuvre d’Offenbach apparaît ici particulièrement propice aux actualisations et réécritures permettant de revisiter certains traits dramaturgiques majeurs propres au compositeur.
Jean-Claude Yon, « Une plaque pour Offenbach »
Discours prononcé par Jean-Claude Yon à l’occasion de l’inauguration de la plaque apposée au 25 rue Saulnier (Paris 9e arr) où Offenbach vécut de 1844 à 1856.