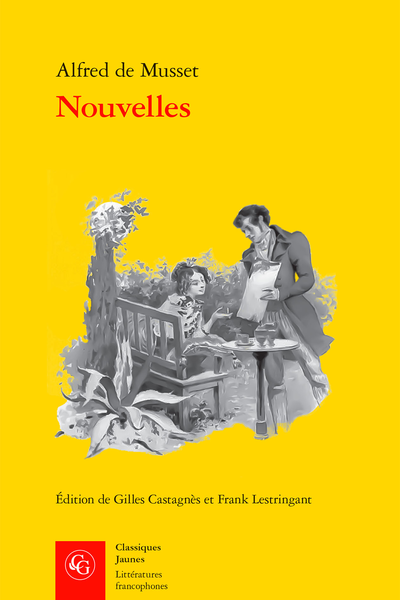
Notice sur Margot
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Nouvelles
- Pages : 321 à 322
- Collection : Classiques Jaunes, n° 759
- Série : Littératures francophones
- Thème CLIL : 3440 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- XIXe siècle
- EAN : 9782406143062
- ISBN : 978-2-406-14306-2
- ISSN : 2417-6400
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14306-2.p.0321
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 08/02/2023
- Langue : Français
Notice sur Margot
Margot, qui paraît le 1er octobre 1838 dans la Revue des Deux Mondes, confirme l’orientation prise dès Le Fils du Titien. Après les trois premiers récits, que l’on pourrait qualifier de « nouvelles contemporaines », les trois derniers relèvent davantage du conte : éloignement dans le temps et dans l’espace, et, dans les deux dernières nouvelles, construction d’une intrigue qui entretient peu de liens avec la vie de l’auteur.
Musset présente ainsi le texte à Buloz : « Si vous jugiez à propos d’annoncer la nouvelle, elle a pour titre : Margot. (C’est l’histoire d’une fille de la campagne1). » Celle-ci se déroule sous l’Empire, mais elle est imprégnée de l’atmosphère du xviiie siècle, par l’intermédiaire du personnage de Mme Doradour. Elle fait aussi appel à des souvenirs d’enfance. La famille Musset passa les vacances de 1818 près de Viarmes au nord de Paris, et les habitants de la ferme des Clignets, les Piédeleu, nom qui a été conservé dans Margot, auraient frappé l’imagination d’Alfred enfant. Un deuxième événement, une vingtaine d’années plus tard, aurait déclenché l’écriture : la rencontre chez un voisin médecin d’une jeune servante de la campagne, que Musset se serait plu à faire parler de son pays et de sa famille. Pierre Odoul suppose que cette servante était au service des Musset – mais il s’agit là d’une simple hypothèse –, et que l’auteur se serait peint sous les traits de Gaston2. La ressemblance physique avec ce garçon aux « beaux cheveux blonds qui frisaient naturellement3 », et certaines anecdotes iraient en ce sens, comme celle des grisettes de Strasbourg, où Musset est passé lors de son voyage à Baden en 1834.
C’est l’imaginaire proche du merveilleux qui frappe, comme l’épisode de la résurrection qui fait songer à La Belle au bois dormant4. Plongée 322dans un monde de rêves, l’histoire convoque de nombreuses figures littéraires ou mythologiques, voire bibliques : Margot évoque tour à tour les nymphes, Diane, Ève, Ophélie, ou encore la princesse des contes de fée5. Le récit nous fait pénétrer dans l’imaginaire de la jeune paysanne amoureuse : l’épisode du retour en voiture de nuit à la Honville est sur ce point remarquable. L’évanouissement brutal du rêve de Margot rappelle la triste fin de Rosette dans On ne badine pas avec l’amour et annonce l’écroulement du monde illusoire où vit Emma Bovary.
L’ultime chapitre nous replonge dans l’histoire en évoquant les batailles de la campagne de France aux derniers jours de l’Empire. C’est ce mélange des genres que Balzac n’appréciait pas, et qui lui fit déclarer qu’il n’aimait pas Margot6. Tout rentre dans l’ordre pour la jeune fille : la petite fermière n’a pas épousé le prince charmant, qu’elle finit par oublier. Comme dans Louison (1849), où Lisette décide de devenir la femme de Berthaud, fils d’un des fermiers du Duc, l’ordre social reprend ses droits.
1 Correspondance I, [mi-août 1838], p. 272 (fonds Lovenjoul, Correspondance Musset-Buloz, F 982 bis, f. 27).
2 Pierre Odoul, op. cit., 1976, p. 394.
3 Ch. iv, p. 339.
4 Paul de Musset qualifie cette histoire de « fable »(Bio., p. 202). Musset s’est inspiré d’une nouvelle de Bandello, la quarante et unième de la deuxième partie, où il est question de la résurrection d’une femme aimée (Bandello, Nouvelles, Paris, Imprimerie Nationale, 2002, II, 41, p. 399). Il avait adapté l’une de ses nouvelles pour composer La Quenouille de Barberine (1835).
5 Pour les références à Ève et au jardin d’Éden, voir Esther Pinon, « Écrire le sacré : Musset et ses modèles », Poétique de Musset, PURH, 2013, p. 69.
6 « Je n’aime ni Croisilles, ni Margot. » Ce jugement de Balzac était connu de Musset, qui écrit dans le poème « À Madame O. qui avait fait des dessins pour les nouvelles de l’auteur » : « Ma brunette Margot, que Balzac n’aime pas / Est là, le cœur battant, prête à mordre à sa pêche » (PCp, p. 638). « Mme O. » est Mathilde Odier, qui avait illustré les Nouvelles, et dont les dessins n’ont pas été retrouvés. Voir annexe III, p. 384.