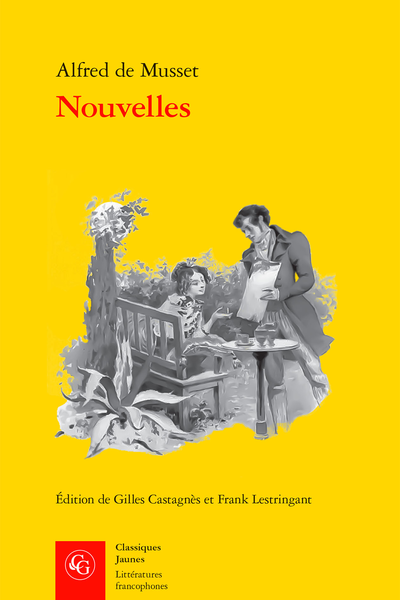
Notice sur Le Fils du Titien
- Publication type: Book chapter
- Book: Nouvelles
- Pages: 173 to 175
- Collection: Classiques Jaunes (The 'Yellow' Collection), n° 759
- Series: Littératures francophones
- CLIL theme: 3440 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- XIXe siècle
- EAN: 9782406143062
- ISBN: 978-2-406-14306-2
- ISSN: 2417-6400
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-14306-2.p.0173
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 02-08-2023
- Language: French
Notice sur Le Fils du Titien
Avec Le Fils du Titien, qui paraît dans la Revue des Deux Mondes le 1er mai 1838, Musset quitte le Paris de la Restauration. Pour le compte rendu du « Salon de 1836 », publié dans la Revue des Deux Mondes le 15 avril, il s’est plongé dans des ouvrages sur les peintres italiens de la Renaissance1, et notamment dans La Vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes de Vasari. Passant au Fils du Titien, il complète ses connaissances par l’Histoire de la République de Venise de Pierre Daru2.
La cité des doges a souvent inspiré l’auteur : deux poèmes des Contes d’Espagne et d’Italie, fin 1829, peignent « Venise la rouge3 », la « perfide cité / À qui le ciel donna la fatale beauté4 ». Le poème « Octave », dans les Premières Poésies, a pour cadre cette ville. La première pièce qu’il fait jouer, en 1830, s’intitule La Nuit vénitienne, et le dernier acte de Lorenzaccio se déroule à Venise. C’est d’abord une Venise littéraire et picturale qui hante Musset, celle de Casanova, de Byron, mais aussi de Canaletto et de Guardi, peintres de vedute, ces vues de Venise encore très en vogue au début du xixe siècle. Le voyage en Italie avec George Sand à l’hiver 1833-1834 ne change rien à la vision qu’il a de Venise, et il « n’en tire aucun matériau nouveau5 ».
Si la réalité ne parvient pas à détruire l’image qu’il s’est forgée de la Sérénissime, c’est qu’en elle se superposent plusieurs époques : la Venise du xviiie siècle, carte postale pittoresque diffusée par les peintres et les 174écrivains, émerge à peine de la période la plus florissante, la Renaissance, qui sert de cadre au Fils du Titien. C’est à la fin du xvie siècle, très exactement en 1580, que Musset nous conduit. Fidèle à son habitude, il va y transporter beaucoup de lui-même, de ses amours et de son époque. L’épisode de la bourse offerte anonymement par Aimée d’Alton à l’auteur constitue le point de départ de la nouvelle6 et le récit de l’idylle qui suit est romancé. Cependant, l’élément déclencheur se trouve pris dans un contexte qui le dépasse largement.
Comme l’écrit Frank Lestringant, « Le Fils du Titien est la transposition dans un autre décor et dans un autre temps des amours d’Alfred avec Aimée d’Alton. Une sorte d’autobiographie en costumes. Dans le rôle de l’entremetteuse, on retrouve la Marraine, déguisée en Vénitienne de la Renaissance, “la signora Dorothée, femme de l’avogador Pasqualigo”, une dame “des plus riches et des plus spirituelles de la République7”. Tout est dans le conte comme dans la vie, parce que celle-ci d’emblée ressemble à un conte : la bourse brodée, l’arrivée matinale, quand tout dort, de la maîtresse adorée, les siestes tardives, les incitations de l’amante à reprendre le travail, son échec final et définitif à remettre l’artiste à l’œuvre8. »
Au moment où Musset commence l’histoire, Michel-Ange et le Titien sont morts, le premier en 1564, le second en 1576, tous deux presque centenaires ; avec eux, les grands maîtres de la Renaissance ont disparu. La jeune génération se révèle incapable de prendre la relève. Comme André del Sarto, cette nouvelle traite de la décadence de l’art. Les fils sont inférieurs aux pères et doivent vivre dans la mémoire d’un passé glorieux qu’ils ne peuvent ni perpétuer, ni assumer : le fils du Titien sera le peintre d’un unique tableau.
À travers l’intrigue amoureuse, la nouvelle pose le rapport entre l’art et la vie. L’art demande un don entier de soi, dans un travail acharné, au bout duquel la réussite est aléatoire : les réflexions sur le travail de l’artiste, qui peuvent s’appliquer au peintre comme au poète, en disent long sur l’esthétique de Musset et sur sa conception de la création, faite d’un labeur ingrat. L’image de l’artiste créant sous l’inspiration des Muses est anéantie, comme elle le sera dans le Poète déchu, roman que Musset 175ébauchera l’année suivante. Que celui qui n’a pas la force de supporter ce travail de tous les instants retourne au silence ; telle serait la morale de l’histoire. « On ne fait jamais bien deux choses à la fois », dit Pippo, le héros de la nouvelle, qui choisit la vie et l’amour, plutôt que l’art et la solitude. Un amour parfait, idéal, celui qui le lie à la belle Béatrice Donato. En cela cette nouvelle occupe une place exceptionnelle chez Musset : c’est l’unique fois où l’amour réalise la fusion de deux êtres dans la durée. Pur fantasme que cette idylle où la femme, créée d’abord par l’imagination de l’artiste, entre un beau matin dans le monde réel par l’intermédiaire d’une messagère noire. Tout ce qui fait obstacle au bonheur est ensuite écarté : le mariage et l’art, incompatibles avec la passion.
On peut ne retenir de cette nouvelle qu’un aveu d’impuissance de l’artiste, un rejet de la gloire et de ses contraintes : Le Fils du Titien se présente alors comme une métaphore filée de la mort – dont les signes sont présents tout au long de l’intrigue – un enterrement volontaire de la création artistique ; on peut y lire aussi la concrétisation d’un fantasme de l’écrivain, la réunion mythique de l’androgyne, ces deux moitiés qui se cherchent perpétuellement, thème récurrent chez Musset, et finalement la supériorité de la vie et de l’amour sur l’art : « J’aime, et pour un baiser je donne mon génie », disait le poète dans « La Nuit d’août9 ».
« Ceux de ses écrits qu’il estimait le plus sont le second volume de ses poésies, Le Fils du Titien, Lorenzaccio et Carmosine », écrit Paul de Musset dans la Biographie10, qui précise ailleurs : « De tous ses petits romans, le Fils du Titien est assurément celui que l’auteur a écrit avec le plus d’entrain et de plaisir11 ». C’est aussi celui dont le charme mystérieux opère encore le mieux sur le lecteur.
1 Selon son frère Paul, l’auteur conservait dans ses brouillons le sujet de cette histoire depuis 1833, à l’époque d’André del Sarto : « Encouragé à continuer ses petits romans par le directeur de la Revue, il rechercha dans ses notes l’historiette du Tizianello. » (Bio., p. 195.)
2 Comme l’indique une note de sa main : voir n. 75, p. 211.
3 « Venise », PCp, p. 157.
4 « Portia », PCp, p. 145.
5 Frank Lestringant, « Venise, de la littérature à la peinture : Musset, Sand et Léopold Robert », dans Venise en France. Du romantisme au symbolisme, Paris, Rencontres de l’École du Louvre, 2006, p. 40.
6 Voir notre préface, p. 15.
7 Le Fils du Titien, II,p. 183.
8 Frank Lestringant, Alfred de Musset, op. cit., ch. xi, « La Marraine et la cousine », p. 385-386.
9 Pour les motivations qui sont à l’origine de cette nouvelle, voir Gilles Castagnès, « L’élaboration d’un fantasme, ou la création mise à nu. LeFils du Titien », Alfred de Musset, auteur « tout nu », Gilles Castagnès et Christian Chelebourg (dir.), La Revue des lettres modernes, Lettres Modernes Minard, « Écritures XIX », 7, 2019-1, p. 85-100.
10 Bio., p. 375.
11 Ibid.,p. 196.