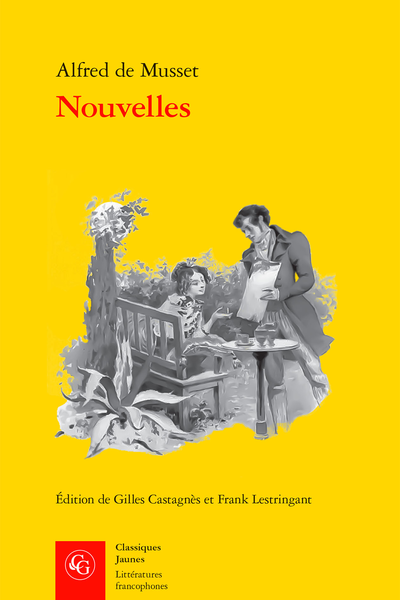
Notice sur Frédéric et Bernerette
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Nouvelles
- Pages : 231 à 233
- Collection : Classiques Jaunes, n° 759
- Série : Littératures francophones
- Thème CLIL : 3440 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- XIXe siècle
- EAN : 9782406143062
- ISBN : 978-2-406-14306-2
- ISSN : 2417-6400
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14306-2.p.0231
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 08/02/2023
- Langue : Français
Notice sur Frédéric et Bernerette
À l’origine de cette nouvelle, qui parut le 15 janvier 1838 dans la Revue des Deux Mondes, se trouve la brève liaison de l’auteur avec une certaine Louise Lebrun, grisette ou actrice de théâtre dont on ne sait à peu près rien. Ils s’aimèrent tout l’été 1836, et leur relation s’acheva en décembre ou peut-être un peu plus tôt1. Louise Lebrun prend donc place entre Caroline Jaubert et Aimée d’Alton. Mme Martellet, qui entra au service de Musset en 1847, affirme que les amants se seraient revus et résume ainsi leur idylle :
Voici comment je l’ai entendu raconter par M. de Musset. De sa fenêtre, il voyait dans une chambre en face de l’autre côté de la cour (nous dirons Bernerette) qui était là entretenue. – Je ne sais pas lequel des deux remarqua l’autre. Ils finirent par s’écrire en allumant deux bougies, et en mettant un papier sur lequel ils établirent une correspondance – leur intrigue fut rapportée par une bonne à M. de Bastard, qui dans un moment de folie se suicida au Bois de Boulogne, M. de Musset en fut épouvanté – plusieurs années se passèrent et un soir, assis devant le café de Paris, M. de Musset vit se planter devant lui, Bernerette qui lui fit signe qu’elle reviendrait après avoir déposé un fusil qu’elle portait dans une gare. Revenue devant le café, M. de Musset l’emmena, leur liaison dura un temps, après la rupture elle ne mourut pas, car j’ai entendu assurer longtemps après elle chantait dans un théâtre à Lyon2.
232Pour composer la plus tragique de ses nouvelles, Musset change de ton et de technique : rigueur de la construction, maîtrise et efficacité dans la conduite de l’intrigue, linéarité de la narration qui aboutit à un dénouement implacable, et utilisation parcimonieuse des interventions de l’auteur3. Cette façon de raconter ne variera plus, y compris dans les Contes qu’il composera à partir de 1842. Le narrateur omniscient des premiers récits s’efface et adopte le point de vue du personnage principal, avec qui le lecteur découvre les événements. Cette technique, dans Frédéric et Bernerette, permet d’entretenir le mystère concernant la vie de l’héroïne et ses sentiments qui se font jour dans ses lettres.
Si cette nouvelle se place encore sous le signe de l’amour, elle diffère des autres par son dénouement. Bien que le titre porte le nom des deux personnages, et que nous suivions constamment Frédéric, c’est la jeune femme qui est au centre de l’intrigue. Comme dans la plupart des autres récits, le héros masculin subit les événements, tergiverse, tandis que les valeurs romantiques sont ici portées par l’héroïne : insouciance, mépris des barrières sociales, sacrifice de soi, et impossibilité de vivre sans l’être aimé. Frédéric, au contraire, se soumet à l’autorité paternelle et à la société. Le divorce entre les valeurs bourgeoises, incarnées par les hommes, et les restes du romantisme qui survivent avec les héroïnes, se révèle dans toute sa cruauté.
Balzac, qui a pu s’inspirer de cette histoire pour écrire La Torpille4, considérait Frédéric et Bernerette comme
la plus remarquable des nouvelles de M. Alfred de Musset […]. Frédéric et Bernerette est un petit roman délicieux, plein de naturel, de goût, de tristesse, digne des trois premières nouvelles5, et même infiniment supérieur6.
Dans la dernière lettre de Bernerette, mise parfois sur le même pied que certains passages de La Nouvelle Héloïse ou de la Religieuse portugaise7, 233on perçoit ce mélange de tragique et de gai : l’écriture de Bernerette, véritable héroïne de l’histoire, donne le ton de l’ensemble.
Il serait superflu de commenter les termes utilisés par Balzac : histoire « pleine de faits », d’« observations », d’un « dramatique horrible », d’une « épouvantable vérité » et d’un « sens cruel » : n’a-t-on pas en germe, dans Frédéric et Bernerette, au-delà de ce que le récit doit au mélodrame, certains des thèmes qui feront les beaux jours de la littérature réaliste et naturaliste de la seconde moitié du siècle ?
1 Pour le début de cette liaison, Pierre Odoul propose la datation suivante : « Musset devint l’amant de “Bernerette” au mois de juin 1836. »(Op. cit., n. 1, p. 350.) Paul de Musset écrit que les premiers regards échangés datent du moment où son frère corrigeait les épreuves du compte rendu du « Salon de 1836 » pour la Revue des Deux Mondes du 15 avril.
2 Fonds Spoelberch de Lovenjoul, F 987 quater, Correspondance relative à Alfred de Musset, réunie par Maurice Clouard, f. 199, lettre non datée de Mme Martellet à Maurice Clouard. Mme Martellet, née Adèle Colin, consigna ses souvenirs dans Dix ans chez Alfred de Musset, Paris, Chamuel, 1899. La vicomtesse de Janzé écrit quant à elle que « Bernerette », « après avoir circulé dans le monde galant et essayé à plusieurs reprises la carrière théâtrale, avait fini par se fixer à Marseille auprès d’un riche négociant qui avait assuré son sort en lui faisant quitter le théâtre » (Alix de Choiseul-Gouffier, vicomtesse de Janzé, Étude et récits sur Alfred de Musset, Paris, Plon, Nourrit, 1891, p. 221-222). Elle résume en fait une nouvelle de Félix Mornand intitulée Bernerette, qui prétend révéler ce qu’est devenue la véritable Louise Lebrun (Paris, Michel Lévy Frères, 1858, p. 51). Nous remercions Sylvain Ledda de nous avoir indiqué cette « suite ».
3 On n’en compte qu’une dizaine sur l’ensemble de la nouvelle.
4 Jean Pommier, « Balzac et Musset, Balzac et Hugo, Balzac et… lui-même », RHLF, oct.-déc. 1956, p. 548-561.
5 Frédéric et Bernerette est, chronologiquement, la troisième nouvelle de Musset ; mais pour Balzac, qui lit les Nouvelles dans l’édition Dumont de 1840, c’est la quatrième, la première du deuxième volume.
6 Voir le jugement complet, annexe III, p. 384.
7 Anatole Claveau, Alfred de Musset, Lecène, Oudin et Cie, Paris, 1894, p. 82-83.