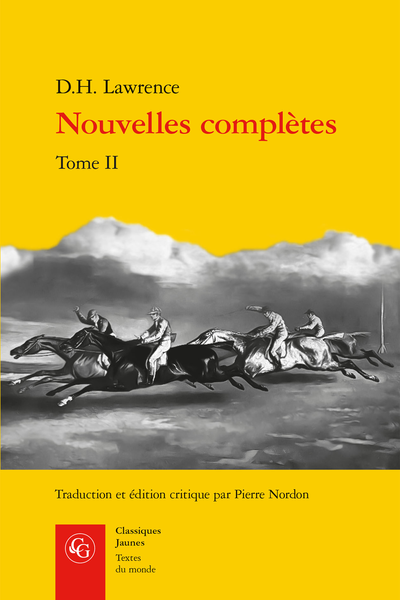
Table des matières Tome II
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Nouvelles complètes. Tome II
- Pages : 811 à 812
- Réimpression de l’édition de : 1987
- Collection : Classiques Jaunes, n° 571
- Série : Textes du monde
- Thème CLIL : 4033 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Langues étrangères
- EAN : 9782812415333
- ISBN : 978-2-8124-1533-3
- ISSN : 2417-6400
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-1533-3.p.0791
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 08/04/2014
- Langue : Français
Mère et fille*
A la fin de 1928 les Lawrence s'installèrent à Bandol, à l'Hôtel Beau Rivage. Cest là que fut écrite cette nouvelle, publiée dans le numéro d'avril 1929 de la revue Criterion. Le personnage de la mère abusive y est l'objet d'un ult'tme et définitif règlement de comptes.
IRGINIA Bodoin avait une bonne situation. Elle était chef
de bureau dans une administration ministérielle, exerçait d'importantes responsabilités et, pour être d'une précision bal¬ zacienne b elle gagnait sept cent cinquante livres par an. Ce n'est pas rien. Sa mère, Rachel Bodoin, avait des revenus s'élevant à environ six cents livres pat an, ce qui lui" avait permis de vivre dans différentes capitales européennes après la disparition d'un mari qui n'avait jamais été très important. Après quelques années d'éloignement et de < liberté > mutuelle, la mère et la fille avaient résolu de reprendre une vie commune. A la longue, elles étaient devenues comme deux conjoints plutôt que comme une mère et une fille. Elles se comprenaient parfaitement, et chacune se méfiait un petit peu de l'autre. Elles avaient vécu ensemble à plusieurs reprises et elles s'étaient séparées en plusieurs occasions. "Virginia avait atteint la trentaine et il devenait de plus en plus douteux qu'elle finisse par se marier. Pendant quatre ans, pourtant, elle avait été pratiquement mariée à Henry Lubbock. C'était un
* Titre original : Mother and Daughter. 1, De ce romancier Lawrence connaissait notamment La peau de cha¬ grin et Eugénie Grandet. Il avait confié à Jessie Chambers son enthou¬ siasme pour le premier roman lorsqu'il se trouvait en vacances à Haggs Farm.
P. N.
752NOUVELLES COMPLÈTES II
vieil enfant gâté amateur de musique. Mais Henry l'avait quittée, pour deux raisons. La première était qu'il ne pouvait pas souffrir la mère de Virginia et la seconde était que celle-ci ne pouvait pas le souffrir. Et quand Mrs Bodoin ne pouvait pas souffrir quelqu'un, elle s'arrangeait pour le faire sentir sans la moindre équivoque possible. Henry avait donc subi, non sans affres, l'antipathie déclarée de sa belle-mère. En fm de compte, mue par une espèce de fidélité familiale irréfléchie, Virginia avait modelé son attitude sur celle de sa mère. Ce n'était pas qu'elle désirât humilier Henry. Mais quand sa mère se mêlait de l'influencer, elle ne pouvait pas résister. Car elle subissait cette influence. C'était un ascendant qui n'avait rien à voir avec l'autorité maternelle, mais qui était de nature exclusivement féminine. Car il y avait belle lurette que Vir¬ ginia s'était débarrassée de l'autorité parentale. Mais sa mère continuait d'exercer sur elle une forme d'influence plus sub¬ tile, plus féminine et plus agréablement perverse. Si Rachel disait : < Rivons-lui son clou >, Virginia se lançait dans cette entreprise avec un plaisir quelque peu malveillant. Henry sen¬ tait fort bien quand on cherchait à lui river son clou, et ses griefs retombaient sur Vinny. Car — suprême cause du déplaisir de Mrs Bodoin — c'est ainsi qu'il désignait celle que sa mère appelait ostensiblement < ma fille Virginia >. Une autre raison du mécontentement de Henry était le fait que — pour être balzacien une fois de plus — Virginia n'avait pas un sou de fortune personnelle. Henry touchait une maigre rente de deux cent cinquante livres. A vingt-quatre ans Vir¬ ginia recevait déjà un traitement de quatre cent cinquante livres. Mais c'était le fruit de son travail. Henry, de son côté, arrivait tout juste à gagner douze livres par an grâce à ses talents de musicien. Il s'était rendu compte de la difficulté d'accroître ses gains de cette façon. Il n'était donc pas question pour lui de se marier, à moins d'épouser une femme en mesure de le faire vivre. Le jour viendrait où Vinny hériterait de la fortune de sa mère. Mais pour l'heure, Mrs Bodoin se portait comme un charme et elle avait la force d'un Sphinx '. Elle vivrait des siècles, toujours à la recherche de chair humaine, dont elle se repaissait. Henry et Vinny avaient vécu en concubinage pendant deux ans. Pour celle-ci, c'était tout comme s'ils avaient été mariés. Mais sa mère faisait toujours
1. Ce monstre fabuleux à corps de lion fut emprunté à la mythologie égyptienne par la mythologie grecque.
753771
partie de son univers. Même si elle se trouvait à Paris ou à Biarritz, une lettre pouvait l'atteindre. Et Vinny ne savait pas qu'un petit sourire éclairait son visage malicieux chaque fois que — même par lettre — sa mère se payait carrément la tête de Henry. Elle ne savait pas non plus qu'intérieurement elle en faisait autant. C'était un réflexe aussi mécanique que le mouvement de la marée. Il ne lui venait absolument pas à l'esprit que Henry pût s'en rendre compte, et la morgue mas¬ culine qu'elle lui artribuait l'exaspérait au plus haut point. C'est ainsi que, fréquemment, les femmes se montent le coup entre elles et en viennent insidieusement à détruire celui qu'elles s'imaginent aimer de tout leur cœur. Et, le jour où le chéri se défend, elles le taxent de cruauté. Elles prétendent alors qu'il rejette leur indéfectible attachement. Car elles se sont aveuglées. Les femmes s'aveuglent mutuellement sans s'en rendre compte. Henry finit donc par se lasser. Il constata que ces deux femmes l'avaient réduit à néant : l'une était une vieille sor¬ cière, aussi redoutable que le Sphinx, et l'autre une jeune sor¬ cière faible et influençable, qui le gâtait du mieux qu'elle pouvait, mais qui le dévorait en douceur. Rachel avait envoyé de Paris une lettre qui commençait ainsi : < Ma chère Virginia, comme je viens d'avoir une heu¬ reuse suφrise avec mes actions, je veux t'en faire profiter. Ci-joint un chèque de vingt livres. Tu en auras sûrement besoin pour acheter un costume neuf à Henry. Nous voici au printemps, et, au soleil, il risque de se montrer sous son vrai jour. Je n'ai pas envie que ma fille s'exhibe avec un chanteur de rues — si, comme je l'ai compris, telle est sa profession —, mais je préférerais que tu payes le tailleur directement, autre¬ ment tu risques d'avoir à le payer deux fois. > C'est ainsi que Henry eut un costume neuf, mais il lui collait à la peau comme une tunique de Nessus ' et infectait ses veines d'un invisible poison. Aussi abandonna-t-il Virginia. Ce ne fut pas un abandon brutal, ni spectaculaire, ni sanglant. Henry s'estompa petit à petit et son départ dura en quelque sorte une année entière et même davantage. Il aimait bien Vinny, et c'est à peine s'il
1. Pour regagner l'amour d'Héraklès son épouse lui tissa une tunique donr elle ignorait qu'elle avait été empoisonnée par le Centaure Nessus. L'ayant revêtue, le héros fut alors en proie à des douleurs si insupportables qu'il se suicida sur un bûcher enflammé.
754NOUVELLES COMPLÈTES II
pouvait se passer d'elle. Il avait pitié d'elle. Mais les choses en étaient arrivées au point où il finissait par l'identifier à sa mère. C'était une jeune sorcière écervelée et dépensière, qui était devenue la complice de sa redoutable sorcière de mère. Henry eut d'autres fréquentations, trouva ailleurs un terrain plus propice et s'affranchit peu à peu de Vinny. Il s'en tira sain et sauf, mais non sans avoir épuisé une bonne partie de sa jeunesse et de son énergie. L'obésité le guettait et il avait perdu son apparence et séduisante beauté d'antan. Sa disparition provoqua les pleurs et les récriminations de nos deux sorcières. La pauvre Virginia faillit en perdre la raison et elle était complètement désemparée. Elle eut une violente réaction de rejet vis-à-vis de sa mère. Quant à Mrs Bodoin, elle n'était que mépris et fureur envers sa fille : comment celle-ci avait-elle pu laisser échapper un poisson si bien ferré ! Laisser à pareil individu la possibilité de la pla¬ quer. <J'ai du mal à imaginer que ma fille a été séduite puis abandonnée par un parasite tel que Henry Lubbock, écrivait- elle. Mais c'est ainsi, et ce doit bien être de la faute de quel¬ qu'un... > Pendant près de cinq ans, les deux femmes demeurèrent en froid, sans que le charme fût rompu pour autant. Mrs Bodoin pensait continuellement à sa fille, et Virginia sentait bien que, quelque part dans l'univers, sa mère continuait d'exister. Elles correspondaient et elles se voyaient de façon sporadique, mais elles gardaient leurs distances. Cependant le charme subsistait et, petit à petit, il fit son œuvre. Les relations devinrent plus amicales. Mrs Bodoin se rendit à Londres. Elle descendit dans le petit hôtel discret où depuis trois ans Virginia occupait deux chambres. Elles en vinrent à envisager de partager un studio. Virginia avait maintenant plus de trente ans. Elle était restée mince, et elle avait gardé son allure de gracieuse petire fée, une façon attachante de vous fixer de ses yeux bruns, un sourire mutin et, surtout, cette voix un peu grave qui faisait vibrer une oreille masculine à la façon d'une caresse à peine appuyée. Sa chevelure abondante se répandait en une masse de boucles naturelles, un peu désordonnées. Elle savait s'habiller avec une certaine élégance, mais avec un goût qui lui donnait parfois l'allure d'une cocotte. Il lui arrivait de porter des bas coûteux et tout neufs avec un trou, ou bien d'ôter ses souliers dans un salon où elle avait été invitée à prendre le thé et de rester assise en montrant ses pieds à travers ses bas de soie.
755773
Elle avait lieu d'être fière de ses pieds, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agissait. Ce n'était de sa part ni coquetterie ni vanité. Mais c'est tout simplement qu'elle s'était adressée à un bon chausseur et lui avait commandé une paire de souliers sur mesure du modèle le plus dépouillé. Elle les avait payés cinq guinées et, après avoir marché avec pendant quelques centaines de mètres, voilà que ses souliers lui faisaient horriblement mal, qu'elle devait absolument les retirer, même s'il lui fallait s'asseoir sur le rebord du trottoir. C'était comme un destin. Elle avait dans les pieds un je-ne-sais-quoi de primesautier et d'indiscipliné qui les poussait à fuir une belle paire de souliers comme il faut. La plupart du temps elle mettait les vieilles chaussures de sa mère ; < Je ne suis bien que dans les vieilles chaussures de maman, confiait-elle volontiers. Le jour où elle mourra, si elle n'a pas pris soin de me laisser une provision suffisante, je serai probablement obligée de me déplacer dans une chaise roulante. > Virginia tenait ces propos avec un sou¬ rire un peu coquin. Elle était à la fois distinguée et mauvais genre. C'est ce qui faisait son charme. C'était tout le contraire de sa mère. Elles pouvaient poner les mêmes souliers et les mêmes vêtements, ce qui était sur¬ prenant au premier abord, parce que Mrs Bodoin avait l'air plus corpulente. Mais Virginia était large d'épaules et en dépit de sa minceur et de son allure fragile elle était fortement charpentée. Mrs Bodoin était de ces sexagénaires pourvues d'une énergie physique terrifiante et d'une vitalité éclatante. Mais elle savait n'en rien montrer. En la voyant assise sagement, les mains croisées, on se disait : < Quel calme ! > Mais c'était comme si, contemplant au coucher du soleil le sommet neigeux d'un volcan assoupi, on s'était laissé aller à se dire ; Quelle paix ! L'énergie dont était possédée Mrs Bodoin était particulière¬ ment musclée, ce qui est fréquemment le cas de certaines femmes ayant dépassé la cinquantaine. Cette énergie s'exprime généralement d'une façon assez désagréable, et elle aboutit souvent à éloigner les jeunes gens. Or, Mrs Bodoin voyait bien ce qu'il y avait de déplaisant dans les manifestations d'énergie auxquelles s'abandonnaient les femmes de son âge. Elle s'appliquait donc à paraître calme. La façon même qu'elle avait de prononcer < calme >, en faisant traîner la voyelle pour souligner le concept même exprimé par le mot, soulignait encore son trop-plein d'énergie.
756NOUVELLES COMPLÈTES II
Le contraste entre ses sourcils noits et ses cheveux grisonnants ne L'avait pas inquiétée. Elle avait bien trop d'esprit pour vouloir se rajeunir avec une teinture. C'est à son visage et à sa silhouette qu'elle s'était attaquée et, pensait-elle, non sans succès. Elle n'avait pas laissé se former sur sa personne ni trop de pleins ni trop de déliés et, sans être corpulente, sa sil¬ houette avait gardé plénitude et cambré^. Quant au visage, il avait conservé l'allure aristocratique que confère un nez un peu busqué, l'expression hautaine exprimée par un regard auda¬ cieux, et la séduction de joues encore rebondies sous des pom¬ mettes un peu saillantes. Pourtant il n'y avait dans ce visage-là ni souci de séduire ni frivolité juvénile. En femme indépendante, elle s'en remettait à son esprit et avait résolu fermement de n'être ni juvénile, ni séduisante ni frivole. Seule sa dignité lui importait. Elle aimait ce qui res¬ pire le bon sens. Elle était habituée à en faire preuve. Elle se contenterait donc de suivre cette voie. Elle se modela sur le siècle du bon sens : le X"VIIP, celui de Voltaire, de Ninon de Lenclos, de la Pompadour, de Madame la Duchesse et de Monsieur le Marquis. Il lui sembla que, si le modèle de la Pompadour ou de la Duchesse ne lui convenait pas vraiment, celui de Monsieur le Marquis lui allait comme un gant. Elle voyait juste. Avec ses cheveux argentés bien tirés en arrière et dégageant avec bon sens le front et les tempes, son visage au teint fleuri, ses minces sour¬ cils noirs pareils à deux petits croissants finement tracés, son nez hautain et ses yeux au regard plein d'insolence, elle faisait tout à fait XVIII' siècle, première moitié du siècle. Et en même temps, son choix de s'incarner en Monsieur le Marquis plutôt qu'en Madame la Marquise faisait d'elle une femme vraiment à la page. Sa mise était irréprochable. Elle savait allier avec subtilité le gris et le rose, les assortissant parfois d'une touche de vert-de- gris, et ses bijoux étaient toujours dans des tons anciens et patinés. Elle se mouvait avec une calme alacrité dont l'assu¬ rance vous en imposait. En un mot, c'était une personne dont la présence ne pouvait passer inaperçue. Elle avait toujours à sa disposition pour deux mille livres environ de liquidités. Virginia, bien entendu, était toujours à court d'argent. Mais Virginia n'en était pas pour autant
1. En français dans le texte.
757775
indigne d'intérêt, car elle gagnait sept cent cinquante livres par an. Virginia était un curieux mélange d'intelligence et d'inintel¬ ligence, A dire vrai, elle ne connaissait rien, parce qu'elle s'in¬ téressait à tout et à n'importe quoi de façon éphémère. Elle s'essayait à toutes sortes de choses, se mettait à l'étude des langues étrangères avec une aisance extraordinaire et se débrouillait couramment au bout de quinze jours. Cette faci¬ lité l'aidait considérablement dans son travail. Elle arrivait à converser avec des chefs d'industrie venus de tous les horizons. Mais elle ne comprenait pas vraiment les langues qu'elle employait, pas même sa langue maternelle. Elle collectionnait certaines notions, presque en dormant, eût-il semblé, mais sans en comprendre les tenants et les aboutissants. Cette versatilité plaisait aux hommes. Les facilités qu'elle déployait ne les intimidaient pas, car elle était un peu comme un instrument. Il fallait lui donner une partition. A partir du moment où un homme lui donnait la marche à suivre, elle exécutait les instructions avec la plus grande intelligence. Elle était capable de recueillir des renseignements précieux, et se rendait extrêmement utile. Elle travaillait avec des hommes, passait la plupart de son temps avec des hommes, et presque tous ses amis étaient des hommes. Elle n'était pas à son aise avec des femmes. Et pourtant, il n'y avait pas d'homme dans sa vie, aucun n'avait l'air de vouloir l'épouser ni même de lui faire la cour. Mrs Bodoin disait d'elle ; < Malheureusement Virginia est la femme d'un seul homme. Je suis ainsi moi-même et c'est ainsi qu'étaient ma mère et ma grand-mère. Le père de Vir¬ ginia est le seul homme que j'aie eu dans ma vie. J'ai l'im¬ pression que c'est pareil pour Virginia, c'est une fidèle. Mal¬ heureusement son homme était ce qu'il était, et la vie de Virginia s'est arrêtée avec lui. > Dans le temps, Henry avait coutume de dire que Mrs Bodoin n'était pas la femme d'un seul homme, mais au contraire qu'elle n'était la femme d'aucun homme. Il ajoutait que, s'il ne tenait qu'à elle, il n'y aurait plus un seul homme vivant sur terre, et qu'il ne resterait que des femmes. Quoi qu'il en soit, Mrs Bodoin s'avisa que le moment était venu d'agir, et Virginia et elle s'installèrent dans un apparte¬ ment très confortable donnant sur l'une des petites places du vieux Bloomsbury. Elles le firent tapisser avec le plus grand soin, le garnirent de beaux meubles et d'objets d'art. Elles
758NOUVELLES COMPLÈTES II
trouvèrent un excellent cuisinier autrichien et s'établirent ainsi, mère et fille, dans une existence conjugale. Elles étaient enchantées de leur installation. Les deux pièces de réception, avec vue sur les vieux arbres souillés de la petite place, étaient extrêmement spacieuses. Les trois fenêtres, presque entièrement vitrées, procuraient une grande lumino¬ sité. La cheminée était une authentique cheminée de la fin du XVIIL siècle, et l'ameublement choisi par Mrs Bodoin avait un cachet Louis XVI ou Empire sans recherche excessive de pureté de style. De son précédent ménage elle avait gardé un superbe tapis d'Aubusson. Il avait l'air d'être dans son neuf. On eût dit qu'il avait deux ans à peine. Il étalait sur le sol ses parterres de roses et de fleurs aux nuances allant du gris argenté à des tons modérés, parsemés de lis, de cygnes majes¬ tueux et de volutes triomphales. Certains connaisseurs le trou¬ vaient un peu tapageur et ils lui préféraient l'Aubusson plus ancien, aux teintes jaunies, qui ornait le parquet de la grande chambre à coucher. Mais Mrs Bodoin avait une prédilection p>our celui du salon. Elle lui trouvait du bon sens et aucune vulgarité. Sa décoration florale lui donnait très grande allure et il était très bien assorti à ses commodes de bois peint, à ses fauteuils tendus de brocart gris et or et à ses grands vases chinois qu'elle aimait remplir de grosses fleurs : pivoines de Chine, roses, tulipes, ou lis rouges. Cette vaste pièce londo¬ nienne à l'atmosphère quelque peu grisâtre appelait la pré¬ sence de grandes fleurs aux tiges élancées et aux couleurs voyantes. Pour la première fois de sa vie Virginia connut le plaisir de s'installer chez elle. Elle était retombée complètement sous la coupe de sa mère et elle était débordante d'enthousiasme. Elle n'avait jamais vu les trésors que constituaient les tapis, les commodes décorées et les fauteuils de tapisserie. La plupart de ces objets étaient des reliques familiales d'origine irlandaise, car Mrs Bodoin était une Fitzpatrick. Comme une enfant ou comme une jeune mariée, Virginia s'était lancée dans l'ameu¬ blement et la décoration de l'appartement. «Je considère cet appartement comme le tien, avait dit Mrs Bodoin. Je ne suis pas ta dame de compagnie et je ne ferai qu'exécuter tes désirs, dans la mesure où il te plaira de m'en faire part. > Virginia avait fait part de quelques désirs, avec modération. Elle introduisit dans l'appartement un certain nombre de tableaux excentriques achetés à des peintres indigents qu'elle s'efforçait d'aider. Mrs Bodoin approuvait le style, mais désap-
759777
prouvait les sujets. Elle s'en accommodait comme on s'accom¬ mode des inévitables inconvénients du modernisme. Du moins permettaient-ils de mesurer l'apport de Virginia à la décora¬ tion de l'appartement. Rien n'est peut-être aussi exaltant que de s'installer dans une nouvelle demeure. Cela vous monte vraiment à la tête, car vous avez le sentiment de créer quelque chose. De nos jours il ne s'agit plus d'installer un <: foyer >, un nid familial. On apprête < sa chambre », < sa maison >, la parure qui, en quelque sorte, enrobe et met en valeur votre personnalité. Mrs Bodoin s'activait en faveur de Virginia et gardait un calme relatif, mais elle était quand même grisée par ses entre¬ tiens avec les décorateurs et les ensembliers. C'était un phéno¬ mène surprenant, et Virginia elle-même se prenait au jeu. C'était comme si elle avait découvert quelque bouton magique sur la grise muraille de l'existence. Sous l'effet d'un < Sésame ouvre-toi ' ! > les pièces de cet appartement semblaient sortir d'un pays merveilleux, toutes neuves et brillamment colorées. Elle vivait un rêve bien plus ensorcelant pour elle que si on lui avait légué un duché en héritage. La mère et la fille, l'une dans des robes dans les teintes vieux rose et l'autre dans des nuances argentées, se mirent à donner des réceptions. La plupart de leurs invités étaient des hommes. Chaque fois qu'elle recevait des femmes Mrs Bodoin bouillait d'exaspération. Pat bonheur, la plupart des fréquen¬ tations de Virginia étaient masculines. On organisa donc des dîners et des soirées fort agréables. Tout allait pour le mieux, mais pourtant quelque chose allait de travers. Mrs Bodoin s'appliquait de son mieux à ne pas trop se mettre en avant. Elle restait à quelque distance, calme, détendue, XVIIL siècle, décidée à servir de faire-valoir à l'intelligente et aérienne Virginia. Mais cela était artificiel et, malheureusement, cela se sentait. Mrs Bodoin était toujours charmante à l'égard des hommes, même si elle les méprisait. Mais les hommes n'étaient pas à leur aise avec elle, car elle leur faisait peur. Ce que ressentaient ces invités, c'est que l'on ne faisait véri¬ tablement rien pour eux. Les réceptions étaient entièrement une affaire entre mère et fille. Elles étaient le centre de gra¬ vité. Une sorte de magnétisme semblait les envelopper, et les
1. Le mot de passe qui permettait d'ouvrir la porte de la caverne des quarante voleurs dans la légende d'Ali Baba (Les Mille et Une Nuits).
760NOUVELLES COMPLÈTES II
hommes ne réussissaient pas à rompre l'isolement, le senti¬ ment d'exclusion qu'ils éprouvaient devant ce couple féminin. Sous l'effet d'un certain éblouissement, plus d'un jeune homme avait éprouvé pour Virginia un début de passion. Mais il n'y avait pas eu de lendemain. A chaque fois, ce sentiment d'exclusion, de dépossession, avait vite flétri la pas¬ sion naissante. Les deux femmes brillaient de tous leurs feux aux deux bouts de la table ; leur magnétisme en circuit fermé transformait les hommes — non en pourceaux, comme l'eût fait un couple de Circé auxquelles ils se fussent volontiers abandonnés, mais en statues de pierre. C'était navrant, car Mrs Bodoin souhaitait voir Virginia tomber amoureuse et se marier. C'est ce qu'elle désirait sincè¬ rement et elle rendait Henry responsable du manque d'em¬ pressement de Virginia. Elle ne se rendait absolument pas compte de l'influence qu'elle-même exerçait, et Virginia égale¬ ment, influence qui paralysait littéralement les hommes que toutes deux, mère et fille, recevaient chez elles. Mrs Bodoin avait mis son humour en veilleuse. Elle possé¬ dait en effet un talent extraordinaire d'animatrice. Elle savait imiter l'accent irlandais des domestiques qu'elle avait eus quand elle habitait en Irlande, ou bien les Américaines qui lui rendaient visite, ou encore les jeunes gens efféminés d'aujour¬ d'hui, les asphodèles, comme elle les surnommait — < Vous savez bien, l'asphodèle, cette variété d'oignon trop bien élevé ! > —, et qui, avec leur petites mines distinguées, cher¬ chaient à lui faire sentir à quel point elle était ridicule et bourgeoise. Elle savait les imiter avec un humour qui confinait au génie, un humour dévastateur, aussi efficace pour détruire ceux qu'elle prenait pour cible que l'eût été un marteau-pilon. On le redoutait, les hommes surtout, et ils évitaient Mrs Bodoin. Aussi s'abstenait-elle de le montrer. Mais on en connaissait l'existence, on savait qu'il était toujours là, cet humour mar¬ teau-pilon, prêt à tout moment à vous fracasser la cervelle ! Elle feignit de s'en être débarrassée, de l'avoir perdu et même auprès de Virginia. Mais il n'y avait rien à faire. Le marteau- pilon avait beau être caché, tout le monde savait qu'il était là, tout le monde avait envie de regarder au-dessus de sa tête et Virginia était dans ses petits souliers, tout en essayant de donner le change avec un sourire idiot, comme si le marteau- pilon était en train de s'abattre sur une nouvelle victime de sexe masculin. C'était une sorte de sport macabre.
761779
En fin de compte le plan allait échouer, ce plan qui consis¬ tait à faire faire un mariage d'amour à Virginia. Pas éton¬ nant ; les hommes n'étaient que des lourdauds, des œufs farcis. Il y en avait un, néanmoins, sur lequel Mrs Bodoin fondait quelques espoirs. C'était un garçon de bonne famille, sain, normal, au physique agréable. Il était sans fortune, hélas, mais il avait un poste de secrétaire à la Chambre des Lords et un certain avenir disait-on. Il n'était pas d'une intelligence extraordinaire, mais il était tombé amoureux de celle de Vir¬ ginia. C'était le genre de jeune homme que Mrs Bodoin, s'il se fut agi d'elle, eût aimé épouser. Sans doute n'avait-il que vingt-six ans, alors que Virginia en avait trente et un. Mais il avait ramé pour Oxford, il adorait les chevaux et il en parlait de façon passionnante. Il était épris de l'intelligence de Vir¬ ginia qui, à ses yeux, était la personne la plus intelligente du monde. Elle était aussi éblouissante que Platon, mais bien plus séduisante dans la mesure où elle était femme. Imaginez un Platon en jupons, avec d'adorables boucles un peu rebelles, des yeux marron avec un soupçon de myopie et un brin de faiblesse, attendrissante pour tout protecteur en puissance, et vous pourrez vous représenter les sentiments qu'Adrian éprou¬ vait pour Virginia. Il était à ses genoux mais il sentait en même temps qu'il pouvait la protéger. — C'est certainement un garçon délicieux, disait Mrs Bodoin. Mais c'est un enfant et il n'y a pas à sortir de là. Ce sera toujours un enfant. Mais c'est précisément ce genre d'homme qui est le plus agréable, le seul type d'homme avec lequel on puisse vivre, l'étemel enfant. Virginia, est-ce qu'il n'est pas à ton goût ί —Mais si. Maman. Comme tu le dis, c'est un garçon déli¬ cieux, répondit Virginia de sa voix basse et mélodieuse. Mais il y avait dans son ton une petite boucle intonatoire qui scel¬ lait le sort d'Adrian. Virginia n'allait pas épouser un garçon délicieux. Elle aussi savait parfois se moquer des goûts de sa mère. Et, sur ce, Mrs Bodoin se laissait aller à un vague mouvement d'impatience. Elle avait formé des projets pour sa retraite. Si Virginia avait été disposée à épouser Adrian, elle-même envisageait de lui laisser immédiatement l'appartement et la moitié de ses propres revenus. Oui, cette mère songeait déjà à la manière de vivre dignement avec trois cents livres de rente, une fois que Virginia serait devenue l'heureuse épouse de ce garçon un peu étourdi, mais si charmant.
762NOUVELLES COMPLÈTES II
Un an plus tard, Virginia, maintenant âgée de trente-deux ans, reçut la visite d'Adrian. Il avait épousé une riche Améri¬ caine et avait été nommé à la légation britannique à Washington. De passage à Londres il s'était fait un devoir de rendre visite à Virginia, de se prosterner devant elle, de se confirmer dans l'idée qu'elle était l'être le plus intelligent qu'il eût jamais rencontré et qu'elle eût été capable d'accom¬ plir des prodiges si seulement elle ne l'avait pas laissé épouser une autre femme ! Virginia paraissait vieillie et fatiguée. Le projet de ménage à deux avec sa mère n'avait pas réussi. Et les responsabilités professionnelles commençaient à devenir pesantes pour Vir¬ ginia. Sans doute était-elle extraordinairement douée, m. il ne lui suffisait pas d'avoir des dons. Il lui fallait travailler dur pour gagner le traitement qu'elle touchait. Il lui fallait se donner de la peine, et se donner à son travail. Aussi long¬ temps qu'il ne s'agissait pour elle que de faire preuve d'intui¬ tion, aussi longtemps que ses responsabilités demeuraient légères, son travail lui plaisait énormément. Mais à partir du moment où il lui fallait accomplir un gros effort, où elle devait se concentrer pour de bon et assumer une véritable responsabilité, Virginia était à l'épreuve. Elle ne vivait plus que sur les nerfs. Elle n'avait pas le genre d'énergie combative que l'on trouve chez un homme. Alors que ce dernier peut mobiliser sa résistance physique, une femme ne peut compter que sur ses nerfs. Les filles d'Eve ne sont pas faites pour se livrer aux travaux qui impliquent une trop lourde responsabi¬ lité ou qui exigent une trop grande concentration mentale. Or, Virginia était chef d'un service important et n'avait personne directement au-dessus d'elle. La pauvre était donc surmenée. Elle était mince comme un fd et sa résistance nerveuse était très entamée. Pas un instant elle n'était capable d'oublier son maudit métier. Il lui arrivait de rentrer pour le thé dans un tel état d'épuisement qu'elle était presque incapable de parler. Sa mère se tourmentait de la voir ainsi et elle mourait d'envie de lui dire : < Qu'est-ce donc qui ne va pas, Virginia ? Ta journée au bureau a-t-elle été spécialement éprouvante ? > Mais elle avait appris à se taire et elle ne posait pas de questions. Elle savait qu'une question eût mis la pauvre Virginia dans tous ses états et, en dépit de tout son calme et de toute son indulgence, Mrs Bodoin ne pouvait pas supporter la moindre scène. Un certain nombre d'épisodes lui avaient enseigné qu'il valait mieux laisser sa fille tranquille
763781
tout comme il vaut mieux ne pas toucher à un tube de vitriol susceptible de se briser. Mais elle n'en était pas rassurée pour autant sur le sort de Virginia. Comment eût-elle pu l'être ? Et celle-ci, sous la double pression de ses soucis professionnels et de la sollicitude contrariée de sa mère, était à bout de forces et à bout de nerfs. Mrs Bodoin n'avait jamais apprécié le fait que Virginia tra¬ vaillait, mais désormais elle se mit à prendre ce travail en grippe. Elle se déchaînait en paroles contre tout ce qui était gouvernemental et administratif. A l'entendre Virginia était au-dessus d'une activité aussi méprisable et, par surcroît, voici que cette activité faisait de la fille de Mrs Bodoin une vieille fille efflanquée, aigrie et apeurée. Que pouvait-il y avoir de plus anglais et de plus humiliant pour une Irlandaise de condirion ? Mrs Bodoin passait volontiers la journée en commençant par s'occuper de l'appartement ; elle reprisait avec soin le tissu d'un fauteuil, puis elle faisait briller les glaces vénitiennes, elle arrangeait des fleurs et allait faire des emplettes. Puis elle s'occupait des comptes, des préparatifs pour les invitations et recevait des visites dans l'après-midi sans que son énergie en fût le moins du monde entamée. Après quoi, elle allait dans sa chambre écrire quelques lettres, se faisait couler un bain et s'habillait avec le plus grand soin. Enfin elle descendait dîner, fraîche comme une rose, mais avec une énergie dont cette fleur est dépourvue. Elle était maintenant prête pour une longue soirée. Sachant que Virginia était rentrée, elle était vaguement inquiète, mais les deux femmes ne se voyaient pas avant l'heure du dîner. Virginia rentrait toujours directement dans sa chambre, discrète et invisible. Jamais elle n'allait prendre le thé au salon. Si jamais Mrs Bodoin entendait sa fille mettre la clé dans la serrure de la porte d'entrée, elle se hâtait de rega¬ gner sa chambre jusqu'à ce que Virginia eût gagné la sienne. Cette dernière était toujours trop fatiguée pour souffrir de voir qui que ce fût à l'heure où elle rentrait du bureau. C'est à peine si elle pouvait supporter d'entendre le murmure des visiteurs à travers la porte du salon. Pendant ce temps Mrs Bodoin se demandait : Comment est-elle ? A-t-elle passé une bonne journée ? Et, par la pensée, elle ne cessait de rejoindre la chambre où Virginia, allongée sur son lit, essayait de se détendre. L'inquiétude de sa mère se prolongeait jusqu'au dîner. Virginia faisait alors son entrée, les
764NOUVELLES COMPLÈTES II
yeux cernés, maigre, tendue, portant sur toute sa personne les stigmates d'une journée passée au bureau. Vêtue de façon négligée, d'humeur aigre, souffrant de maux d'estomac, indif¬ férente à ce dont on l'entretenait, bref, anéantie par son tra¬ vail, Le spectacle de cette jeune femme était une véritable épreuve pour Mrs Bodoin, mais elle n'en laissait rien paraître. Elle se bornait à parler de choses et d'autres et, imperturba¬ blement, faisait les honneurs d'un dîner préparé avec le plus grand soin pour flatter l'appétit de Virginia, laquelle ne faisait même pas attention à ce qu'on lui servait. Mrs Bodoin eût souhaité passer des soirées un peu animées. Mais Virginia s'allongeait sur le divan et faisait marcher la radio. Ou bien elle mettait sur le phono un disque humoris¬ tique qu'elle trouvait amusant. Elle le réécoutait, le trouvait toujours amusant, et le réécoutait ainsi une demi-douzaine de fois sans se lasser. Mrs Bodoin finissait par le connaître par cœur. < Virginia, disait-elle, ne te donne pas la peine de remonter le phono, je peux te répéter le disque à volonté. > Et Virginia, qui semblait ne pas avoir entendu ce qu'on lui disait, répondait quand même au bout de quelques instants : < Je n'en doute pas. Maman. > Ces quelques mots et le ton que Virginia prenait pour les prononcer étaient pleins d'un tel mépris pour l'existence passée, présente ou future de Mrs Bodoin, pour son énergie, pour sa vitalité, pour son intel¬ ligence, pour sa personne et pour toute son existence, que Rachel en était toute retournée. Elle avait l'impression que c'était le spectre de Robert Bodoin qui lui parlait à travers sa fille pour lui empoisonner la vie. Et Virginia, pour la sep¬ tième fois, remettait le disque sur le phono. Leur deuxième année de vie commune fut épouvantable et Mrs Bodoin se rendit compte que cela ne pouvait plus durer. Elle se sentit vaincue. Elle n'avait plus de raison de vivre. Son humour dévastateur, ce marteau-pilon qui avait fait de si nombreuses victimes — pratiquement tous ceux qui l'avaient connue —, s'était maintenant retourné contre elle, et c'est elle qui était à son tour effondrée. Car elle considérait sa fille comme une autre version d'elle-même. Le secret de l'existence de Mrs Bodoin, sa raison d'être et son pouvoir tenaient entiè¬ rement dans cette arme, le marteau de cet humour dévastateur auquel personne ne pouvait résister. La passion de sa vie, le seul plaisir qu'elle eût connu, avait consisté à démolir tout un chacun par son humour et son ironie. C'est là que résidait le plus clair de son talent. Ç'avait été pour elle comme une
765783
vocation. Et elle avait espéré pouvoir un jour transmettre ce marteau-pilon à Virginia, cette fille si intelligente et frêle, qui était l'extension de Rachel. Virginia était pour Rachel comme une autre version d'elle-même. Mais cette vision n'était pas entièrement vraie, car Virginia avait eu un père. Ce fait, que sa mère avait jusqu'alors totale¬ ment négligé, s'imposait maintenant à elle par cette singulière réticence du marteau-pilon. Virginia était la fille de son père. Que pouvait-il y avoir de plus indécent, de plus horrible, de plus contre nature, dans l'ordonnancement de l'univers ? Car Robert Bodoin avait été proprement assommé par le marteau- pilon de Rachel. Que pouvait-il y avoir de plus répugnant que de le voir ressuscité dans la personne de Virginia, la fille de Mrs Bodoin, son autre elle-même, pour se mettre à riposter avec son petit marteau, semblable à la fronde de David contre la masse d'armes de Goliath ' ? Mais la petite fronde pouvait porter des coups mortels, Mrs Bodoin en ressentait les effets sous son front et sous ses tempes. Elle était vaincue, et elle n'avait plus la force de se battre. Les deux femmes furent désormais de plus en plus seules. Virginia n'avait pas la force d'être en société dans la soirée. Si elle n'écoutait pas la radio ou le phono, c'était le silence. Pour toutes deux l'appartement était maintenant un objet d'exécra¬ tion. Aux yeux de Virginia il était le témoignage ultime de l'autoritarisme de sa mère, er la présence du tapageur tapis d'Aubusson, celle des glaces vénitiennes ou des grandes fleurs cultivées à l'excès lui étaient insupportables. La qualité supé¬ rieure de la cuisine était aussi la preuve de cet autoritarisme, er Virginia n'avait qu'une hâte : retrouver son petit restaurant de Soho et les deux petites pièces minables qu'elle occupait naguère à son hôtel. Elle haïssait l'appartement, elle haïssait tout. Mais elle n'avait pas la force de s'en aller, ni la force d'entreprendre quoi que ce fût. Elle avait tout juste celle d'aller travailler, mais ensuite elle était complètement inerte. Cet état de prostration avait porté le coup de grâce à Mrs Bodoin, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. < Faudra-t-il que j'assiste aux obsèques de ma fille pour recevoir les condoléances de ses collègues de bureau ? Non ! Je ne courrai pas le risque d'une pareille humiliarion. Si Virginia
1. Cf. Samuel, l, XVII.
766NOUVELLES COMPLÈTES II
a décidé de finir rond-de-cuir, c'est désormais son affaire et je l'abandonne à son sort. > Mrs Bodoin avait fait tout son possible pour convaincre Virginia d'abandonner son travail et de partager son existence. Elle lui avait offert la moitié de ses rentes. Mais il n'y avait rien eu à faire, Virginia ne voulait pas quitter son bureau. Il fallait donc s'y résigner : l'appartement était un fiasco et Mrs Bodoin n'avait qu'une envie ; le mettre en pièces et en finir une fois pour toutes d'un bon coup de marteau-pilon ! — Virginia, ne crois-tu pas que nous ferions mieux de nous débarrasser de cet appartement pour vivre comme avant, cha¬ cune de notre côté ? Qu'en penses-tu ? — Mais... et toutes les dépenses que nous avons faites? Et le bail ne nous lie-t-il pas pour dix ans ? — Qu'importe ! Nous avons été très contentes de l'installer et il nous a procuré toutes les satisfactions que nous pouvions en tirer. Maintenant je crois le moment venu de nous en débarrasser. Et au plus vite ! Qu'en penses-tu ? Mrs Bodoin se retenait à quatre pour ne pas décrocher sur- le-champ les tableaux, rouler le tapis d'Aubusson, et vider la petite vitrine incrustée d'ivoire de toute sa porcelaine. — Attendons jusqu'à dimanche avant de nous décider, fit Virginia. — Jusqu'à dimanche ? Encore quatre jours ? Pourquoi attendre si longtemps puisque c'est décidé ? — Attendons tout de même jusqu'à dimanche. Ce soir-là, l'Arménien devait venir dîner. Virginia pronon¬ çait son nom, Arnault, à la française. Mrs Bodoin ne l'aimait guère et ne se rappelait jamais son nom, qu'elle associait à une idée de bouillie. Aussi le surnommait-elle l'Arménien ou le loukoum. — Arnault vient dîner ce soir. Maman. — C'est vrai ? Le loukoum vient dîner ? Faut-il préparer quelque chose de spécial ? Elle donnait l'impression de vouloir lui faire servir un aspic d'escargots. — Non, je ne pense pas. Cet Arménien était quelqu'un avec qui Virginia avait été fréquemment en rapport au cours d'une négociation pour le compte du ministère du Commerce. C'était un ancien négo¬ ciant d'une soixantaine d'années. Il avait été riche à millions avant d'être ruiné par la guerre. Il recommençait à travailler et il avait fait des propositions d'échanges commerciaux avec la
767785
Bulgarie. Comme il désirait négocier avec le gouvernement britannique et que celui-ci avait eu le bon sens d'accepter, Virginia était entrée en scène. Les pourparlers étaient en bonne voie et les relations d'affaires s'étaient transformées en relations amicales. Le loukoum était un sexagénaire corpulent et grisonnant. Il avait de nombreux petits-enfants en Bulgarie, mais lui-même était veuf. Il avait une moustache grise coupée à l'américaine et des yeux bruns abrités par des paupières aux cils tout blancs. Il y avait dans son comportement un mélange d'humi¬ lité et de vanité inébranlable que l'on rencontre parfois chez les Juifs. Il avait connu la richesse et la flatterie des flagor¬ neurs. Il avait aussi connu la misère et la déchéance, à un terrible degré. Il était maintenant en train de remonter la pente, avec l'aide de ses fds en Bulgarie. On sentait bien qu'il n'était pas seul. Là-bas, au Proche-Orient, il y avait ses fils, sa famille, toute sa tribu. Son anglais était détestable, mais il parlait français à peu près couramment, avec un accent guttural. Il n'était pas bavard mais il avait de la présence, une présence d'aspect courtaude et appelée à se prolonger. Il y avait quelque chose d'impressionnant dans sa personne lorsque, assis sur son siège, son postérieur avait l'air d'être vissé au centre de la terre. Il avait l'esprit extraordinairement rapide dès qu'il s'agissait d'affaires. On sentait qu'il s'y passionnait, sans pour autant paraître personnellement concerné. Il avait une perspective plus générale, comme si la famille et la tribu étaient, elles aussi, convoquées aux pourparlers. Il avait une attitude humble vis-à-vis des Anglais, car les Anglais attendent de l'humilité de la part d'étrangers comme lui. Mais il avait été à la bonne école, celle des Turcs. Il était de ceux qui ne se sentent jamais de plain-pied. En société, nul ne lui prêtait attention. Il restait une présence étrangère. — J'espère, Virginia, que tu n'as pas l'intention d'inviter ce gentleman vendeur de tapis turcs quand nous avons d'autres invités. Ce serait insupportable. Il y a des personnes que cela pourrait gêner. — Tu ne trouves pas que l'on pourrait avoir le droit de choisir qui l'on désire inviter sous son propre toit ? — Mais si, après tout ! Qu'est-ce que cela peut bien me faire, d'ailleurs ? Et pour ce qui est de vendre des tapis turcs, cette personne doit sûrement s'y connaître. Mais je présume tout de même que tu ne le considères pas comme un ami.
768NOUVELLES COMPLÈTES II
— Mais si, il me plaît beaucoup ! — En ce cas !... A ta guise, mais songe à tes autres amis. Cette fois, Mrs Bodoin était vraiment outrée. Pour elle, un Arménien n'était qu'un de ces gros Levantins coiffés d'un fez, qui vous proposent leurs horribles tentures à Port-Saïd ou encore sur la Promenade des Anglais. Il appartenait au genre des insectes et non au genre humain. Le fait qu'il ait été millionnaire et qu'il puisse redevenir millionnaire accroissait, si possible, son sentiment de dégoût, dans la mesure où il la contraignait à côtoyer pareille engeance. On ne pouvait même pas détruire ni écraser pareil détritus ! Car il n'y a rien à écraser dans un détritus, lequel n'est après tout que ce qui reste d'un débris déjà écrasé. Mais elle était de parti pris. C'est vrai qu'il était obèse, et vrai aussi que, avec ses courtes cuisses, quand il était assis, on l'eût pris pour un crapaud assis là pour l'éternité. 11 avait un sale teint brouillé, la paupière lourde et le regard vitreux. Et il ne prenait jamais la parole le premier, mais il attendait qu'on la lui adresse, comme un crapaud obséquieux. Pourtant, dans sa chevelure blanche et soyeuse, taillée en brosse, il y avait comme une virilité inattendue. Et ses petites mains grassouillettes, couleur de pâté, avaient une certaine allure masculine. Ses yeux bruns, généralement inexpressifs, brillaient parfois d'un éclat fugitif sous leur fourreau de cils blancs, pareils à ceux d'un serpent. 11 avait passé la force de l'âge, mais il était encore vigoureux. Lutteur, il avait connu des victoires et des défaites, mais il n'avait pas désarmé, en dépit de ses handicaps. C'était un dynaste, un patriarche, l'une des têtes d'une tribu invulnérable malgré ses défaites. 11 était le représentant d'une race de vaincus, d'une race qui accepte ses défaites mais que sa ruse sait finalement restaurer. Comme ce n'était pas un homme seul, il était impossible de l'isoler. Il tenait par toutes ses fibres à une dynastie et à une tribu ; humble sans doute, mais invulnérable. A table, il garda cette attitude d'humilité, mais qui est inséparable d'une certaine vanité. Ses manières étaient impec¬ cables, plutôt françaises. "Virginia conservait avec lui en fran¬ çais et il lui répondait avec cette nonchalance boulevardière qu'il savait imiter lorsqu'il s'exprimait en français. Mrs Bodoin pouvait comprendre la conversation, mais elle n'était pas précisément douée pour les langues, et s'il lui arri¬ vait de placer un mot, c'était dans un anglais particulièrement ostentatoire. Le loukoum bredouillait rapidement quelque
769787
chose en anglais, mais était-ce de sa faute si l'on pariait fran¬ çais ? C'était Virginia qui l'avait voulu ainsi. Il était très aimable et prévenant avec Mrs Bodoin. Mais, de temps à autre, il lui jetait un coup d'oeil rapide, reptilien, et très significatif ; < Je vous vois venir, semblait-il dire, vous êtes vraiment très belle. Vous êtes un oijet de vertu presque parfait. Mais —et ici, les épais sourcils blancs cessaient de dissimuler un regard d'antiquaire professionnel —, quel genre de femme êtes-vous en réalité ? Vous n'êtes pas une épouse, ni une mère, ni une maîtresse. Votre sexe est indétectable et vous êtes plus redoutable qu'un soldat turc ou qu'un fonctionnaire anglais. Aucun homme au monde n'aurait l'idée de vous enlacer. Vous êtes sûrement un vampire, quelque génie échappé des enfers ! > Et en son for intérieur il invoquait la protection de ses saints. Mais il était amoureux de Virginia. Ce qu'il voyait surtout en elle, c'était l'enfant, l'enfant égarée dans le ruisseau, l'en¬ fant délaissée, au regard attachant, attendant que l'on veuille bien la recueillir. Une orpheline abandonnée ! Or, lui-même était par vocation un patriarche, l'incarnation même de l'es¬ sence paternelle. Et puis, il connaissait également son habileté en affaires, une habileté si curieusement désintéressée. Il était fasciné par le talent presque surnaturel, par l'instinct dont Virginia faisait preuve en affaires. Elle pourrait lui être d'une immense utilité, lui qui ne comprenait pas l'anglais ni les Anglais. Grâce à elle, ce milieu lui serait accessible, d'autant plus qu'elle était quelqu'un auprès de ces Anglais, auprès de ces fonctionnaires anglais. Il avait soixante ans. Sa famille était fixée en Orient, ses petits-enfants grandissaient. Or, il allait dévoir vivre à Londres pendant quelques années. Cette jeune femme serait utile. Elle n'avait pas d'argent, mis à part ce dont elle hériterait un jour de sa mère. Mais c'était un risque à prendre. Sur le plan professionnel Virginia serait un bon investissement. Et puis, il y avait l'appartement. Il lui plaisait beaucoup. Il en appréciait le cachet. Les lis et les cygnes du tapis d'Aubusson faisaient vibrer son imagination. Virginia lui avait confié que Maman lui avait donné l'appartement, et il considérait que la chose était acquise. Enfin, Virginia était presque ou totalement vierge — totalement, sans doute, pour un Oriental comme lui. La sexualité de jeunes chiots qui caractérise les Anglais était complètement étrangère à cet Oriental aux goûts lascifs. Et,
770NOUVELLES COMPLÈTES II
par-dessus tout, la solitude devenait physiquement insuppor¬ table pour cet homme vieillissant. Vitginia, pour sa part, ne comprenait pas pourquoi elle se plaisait dans la compagnie d'Arnault. Son intelligence ne lui servirait de rien lorsqu'il s'agissait de sa vie intime. Elle disait qu'il était < curieux >, que son français boulevardier était < amusant >, que son astuce en affaires était < surprenante > et que son regard sombre, sous la broussaille blanche de ses cils, était celui d'un < sultan >. Elle le rencontrait souvent, elle allait prendre le thé à son hôtel et un jour ils avaient fait une promenade en voiture jusqu'au bord de la mer. Quand il prenait la main de Virginia dans ses mains gras¬ souillettes, elle éprouvait une telle sensation de caresse et de réconfort, d'intimité et de chaleur que, frémissante d'inquié¬ tude, elle se sentait pourtant sans défense. — Ma pauvre enfant, murmurait-il en français, comme vous êtes fragile. Il faut prendre bien soin de vous, bien vous reposer, pour vous épanouir et engraisser un petit peu. Elle frissonnait, mais elle se sentait sans défense. Curieuse impression, en vérité ! Il était si surprenant, si sûr de lui, si convaincant, surtout ! Quand il se rendit compte qu'il pourrait arriver à ses fins, il prit la situation en main sans la moindre hésitation et cessa de montrer la moindre humilité. Il ne dési¬ rait pas se contenter de lui faire la cour. 11 voulait l'épouser pour une multitude de raisons et il lui fallait donc s'imposer. Il portait la main de Virginia à ses lèvres, et l'on eût dit qu'il aspitait le sang qui coulait dans ses veines. Puis il mur¬ murait en français tout en se rapprochant d'elle : — La pauvre enfant est fatiguée. Elle a besoin de repos, besoin d'être entourée, besoin d'être choyée. Virginia le regardait. Les yeux sombres sous les cils blancs lui faisaienr un peu peur, mais Arnault appliquait toute sa volonté à son entreprise, comptant bien sur la reddition finale de Virginia. Puis il s'approchait d'elle encore un petit peu, posait la main sur son visage, l'obligeait à poser sa joue contre sa poitrine tandis que, de sa main libre, il lui caressait le bras : — Chère petite fille, chère petite fille ! Arnault l'aime telle¬ ment, Arnault est amoureux. Si elle épousait Arnault ? Chère petite fille : son Arnault ferait de sa vie un chemin tout fleuri, il lui ferait une vie toute pleine de parfums, de douceur et de bonheur. Et Virginia restait appuyée contre lui, et se laissait caresser.
771789
Elle adressait à sa mère une pensée fugitive pleine de détresse et de défi. Il lui semblait que l'heure était venue pour elle de s'abandonner au destin. Qu'il serait bon, enfin ! de ne plus avoir à lutter, de pouvoir se laisser aller à la destinée. Et la voix caressante et persuasive reprenait : — Et si elle épousait son vieil Arnault ? Pourquoi pas ? ■Virginia leva la tête et le regarda : ces sourcils blancs brous¬ sailleux, ces yeux sombres, vitreux, au regard las. Comme c'était drôle et inattendu d'être ainsi, en cet instant, tombée au pouvoir de cet homme ! — Et pourquoi pas ? lança-t-elle avec un petit sourire mutin. — M.aïs ouï ! répliqua-t-il en la regardant de sang-froid. Niais ouï ! Je te contenterai, tu le verras, — Tu me contenteras ! fit-elle en souriant de l'assurance de son séducteur. Tu me contenteras vraiment ? — Mais certainement ! Je t'assure. Alors, veux-tu m'épouser ? — Il faut que tu parles à Maman, lui dit-elle. Et elle se pelotonna tout contre son gilet tandis qu'il se rengorgeait de fierté masculine. Mrs Bodoin ignorait complètement que Virginia connaissait intimement le loukoum. Elle observait toujours la plus par¬ faite discrétion vis-à-vis de sa fille. Au cours de ce fameux dîner elle était demeurée impassible et un peu distante, mais parfaitement à son aise. Après le café, Virginia la laissa en tête à tête avec le loukoum. Elle ne chercha pas à entrer en conversation avec lui, et se contenta d'observer le personnage court sur pattes assis devant elle en habit de soirée. Elle essayait de l'imaginer avec un fez et les culottes bouffantes d'un marchand de soukh, comme dans Le Voleur de Bagdad Κ Elle lui demanda en détachant ses mots : — Peut-être préféreriez-vous fumer un hookah ? — Qu'est-ce qu'un hookah, je vous prie ? — Mais c'est une espèce de pipe d'eau : je croyais que tout le monde en fumait en Orient. Il se borna à garder le silence d'un air humble et vague¬ ment surpris. Mrs Bodoin était loin de se douter de ce qu'il mijotait dans sa tête. — Madame, je désirerais vous demander quelque chose.
1. Autre allusion aux Mille et Une Nuits.
772NOUVELLES COMPLÈTES II
— Si vous désirez me le demander, pourquoi ne pas le faire ? — Précisément. Voici. Je désire avoir l'honneur d'épouser votre fille. Elle y consent. Il y eut un silence monumental. Puis, d'un ton curieuse¬ ment emphatique, et s'inclinant lentement vers lui du fond de son fauteuil, Mrs Bodoin demanda : — Qu'avez-vous dit ? Répétez. — Je désire avoir l'honneur d'épouser votre fille. Elle consent à m'épouser. Ils s'observaient mutuellement, lui de son regard sombre un peu furtif, elle fixement, comme pétrifiée, complètement médusée. Elle portait des ornements de topazes roses et Arnault était en train de les évaluer : ils étaient d'une qualité médiocre. — Vous avez bien dit qu'elle consentait à vous épouser ? Mrs Bodoin avait gardé le même ton, calme, distant, mélancolique. — C'est ce que je crois. Madame, fit Arnault en esquissant un salut de la tête. — Je pense que nous allons l'attendre, dit-elle en se calant dans son fauteuil. Ils demeurèrent de nouveau silencieux. Elle regardait le pla¬ fond, et lui les meubles et la porcelaine dans la vitrine incrustée d'ivoire. Il reprit ; — Je peux doter Mademoiselle Virginia d'une somme de cinq mille livres. Est-il exact que le contrat de mariage doit préciser qu'elle apporterait cet appartement et les meubles qu'il contient ? Aucune réponse ne lui parvint. C'était comme s'il avait disparu, comme s'il était sur la lune. Mais il avait des trésors de patience. Virginia finirait par revenir. Mrs Bodoin avait toujours le regard rivé au plafond. Cette fois elle avait pour de bon reçu le coup de grâce. En entrant, Virginia lui jeta un coup d'oeil, mais c'est à Arnault qu'elle s'adressa : — Sers-toi donc un whisky soda, Arnault ! Il se leva, se dirigea vers les carafes et resta debout près de Virginia, penchant vers les boissons sa silhouette trapue et son front couvert de cheveux blancs. Il se demandait ce qui allait suivre. Il actionna le siphon de soda et regagna son fauteuil. — Arnault t'a-t-il parlé. Maman ? demanda Virginia. Mrs Bodoin se redressa dans son fauteuil et regarda Vir-
773791
ginia avec des yeux tout ronds de chouette apeurée. Virginia en fut toute saisie, mais en même temps vaguement satisfaite ; sa mère avait perdu la partie. — Est-il exact, Virginia, que tu consens à épouser ce Mon¬ sieur qui vient d'Orient ? demanda Mrs Bodoin en détachant ses paroles. — Oui, Maman, c'est tout à fait exact, répondit Virginia d'une voix suave. Mrs Bodoin avait l'air d'une chouette apeurée. — Me sera-t-il permis de m'abstenir et d'éviter d'avoir quoi que ce soit à faire avec ton futur mari. Je veux dire d'avoir à être mêlée à quelque transaction que ce soit ? Elle s'exprimait comme eût pu le faire une somnambule. — Mais, bien entendu, Maman. Virginia gardait le sourire, mais elle était effrayée. Après un instant de silence, Mrs Bodoin fit un effort pour se remettre du choc qu'elle venait de subir. — Dois-je comprendre que ton futur mari souhaite devenir propriétaire de cet appartement ? Virginia eut un petit sourire hypocrite. Arnault restait assis sans rien dire, mais il avait bien entendu et elle comptait sur lui pour régler la question. — Mais, peut-être, dit-elle. Peut-être aimerait-il être sûr qu'il m'appartient. Et elle l'interrogea du regard. Arnault acquiesça de la tête avec gravité. — Et toi, tu voudrais qu'il t'appartienne ? demanda Mrs Bodoin. As-tu l'intention de t'y installer avec ton mari ? Elle détachait ses paroles avec une telle insistance que le temps paraissait suspendu. — Oui, probablement. Tu m'avais bien affirmé que l'ap¬ partement était à moi, n'est-ce pas ? — Alors, ainsi soit-il ! Je dirai à mon notaire de prendre contact avec ce Monsieur qui vient d'Orient, si tu veux bien me laisser tes instructions par écrit sur mon secrétaire. Puis-je savoir quand vous avez l'intention de vous marier ? — Qu'en penses-tu, Arnault ? demanda Virginia. — Dans deux semaines, peut-être ? Il restait assis, tout raide, les poings sur les genoux. — Dans une quinzaine. Maman, fit Virginia. — Tu as bien dit quinze jours ? C'est parfait. Dans quinze jours, tout sera à votre disposition. Et maintenant, veuillez m'excuser.
774NOUVELLES COMPLÈTES II
Elle se leva, fit une petite révérence et quitta la pièce sans se hâter mais discrètement. Elle s'en voulait à mort de ne pas pouvoir hurler, de ne pas avoir la force de chasser ce Levantin de chez elle. Mais c'était impossible. Elle s'était cuirassée d'impassibilité. Arnault jetait autour de lui des regards de convoitise. Tout cela serait à lui. Quand ses fils viendraient en Angleterre, c'est là qu'il les recevrait. Regardant Virginia il s'aperçut qu'elle avait, elle aussi, la mine pâle et défaite. Elle avait obéi à un réflexe de haine, comme si elle lui en voulait d'avoir anéanti sa mère. Elle était encore fort capable de l'envoyer promener pour se remettre avec sa mère. Mais le vieux renard sut trouver les gestes et les paroles qui convenaient : — Votre mère est une grande dame, dit-il à Virginia en lui prenant la main. Mais elle n'a pas de mari pour prendre soin d'elle et pour la protéger. Elle est à plaindre. Je suis triste de penser qu'elle va se trouver seule, et je serais heureux qu'elle accepte de vivre avec nous. Virginia sentit remonter en elle une bouffée d'ironie. — J'ai bien peur, répondit-elle, qu'il ne faille guère compter là-dessus. Elle était assise sur le canapé et il la caressait avec douceur, paternellement. Virginia trouvait piquante cette situation, dans le salon de sa mère. Quant à lui, les yeux fixés sur les objets rares et précieux qui l'entouraient, il s'enflammait à l'idée d'en être désormais l'heureux propriétaire. La passion avec laquelle il caressait la jeune femme maigrichonne assise près de lui allait, à travers celle-ci, à ces objets de valeur dont elle l'avait rendu possesseur. Et il lui répétait : — Tu verras comme je te rendrai heureuse, comme je te comblerai. Je te comblerai autrement que ne l'a fait Madame ta maman. Tu vas grossir, tu vas t'épanouir comme une rose. Je te ferai épanouir comme une rose. Et si nous nous mariions la semaine prochaine, qu'en dirais-tu ? Si nous disions, par exemple, mercredi prochain ? Le mercredi est un bon jour. Es-tu d'accord ? — Soit ! répondit Virginia, s'abandonnant de nouveau avec mollesse à son destin, à la fatalité, à la satisfaction de penser qu'elle n'aurait plus désormais qu'à se laisser vivre. Le lendemain Mrs Bodoin alla s'installer à l'hôtel. Elle ne pénétra plus dans l'appartement, pour faire ses valises et emporter ce dont elle avait absolument besoin, qu'aux heures
775793
OÙ Virginia était obligatoirement absente. Les deux femmes ne communiquaient plus que par écrit et dans les limites de l'in¬ dispensable. Cinq jours plus tard Mrs Bodoin avait emmené toutes ses affaires. Tout ce qu'il avait été possible de régler était réglé et ses malles furent emportées. Elle n'en avait que cinq en tout et pour tout. Dépossédée et exilée, elle avait décidé d'aller finir ses jours à Paris. Le dernier jour elle attendit au salon le retour de Virginia. Elle avait gardé son chapeau et son sac, comme si elle était en visite. — Je voulais te dire au revoir. Je pars pour Paris demain matin. Voici mon adresse. Je pense que tout est réglé. Sinon, fais-le-moi savoir et je m'en occuperai. Adieu, donc. Je te souhaite d'être très heureuse. Si elle s'était abstenue d'insister d'un air sinistre sur ces derniers mots, Virginia eût peut-être perdu la tête. Mais elle se ravisa et répliqua avec son petit sourire : — Je le serai très certainement. — Je le crois volontiers, reprit Mrs Bodoin d'un air lugubre. Ton grand-papa arménien sait très bien ce qu'il fait. Finalement tu étais faite pour vivre au harem. Elle avait égrené ces dernières paroles avec soin, et chaque syllabe vibrait du plus profond mépris. — Tu dois avoir raison. Comme c'est drôle ! fit Virginia. Mais je me demande de qui je tiens. Sûrement pas de toi. Maman. Et elle avait prononcé ces derniers mots avec emphase. — Non, sûrement pas, fit Mrs Bodoin. Virginia feignit de prendre un air songeur : — Les filles sont sans doute comme les rêves : elles compensent. Puisque tu ne possédais absolument aucun atout pour vivre dans un harem, il fallait bien que je compense. Mrs Bodoin lui lança un regard furieux ; — Je te plains de tout mon cœur ! s'écria-t-elle. — Merci, ma chère. Et moi je te plains juste un petit peu.