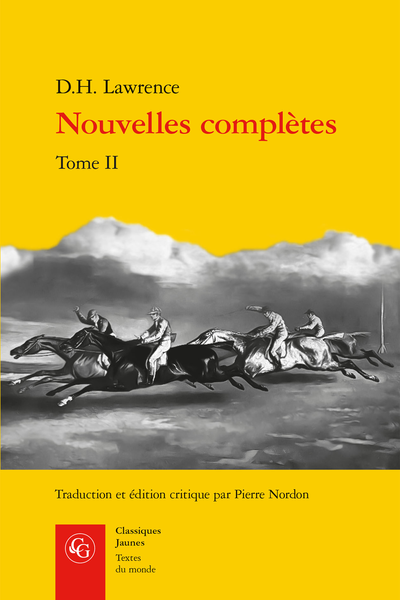
Index des personnages
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Nouvelles complètes. Tome II
- Pages : 797 à 804
- Réimpression de l’édition de : 1987
- Collection : Classiques Jaunes, n° 571
- Série : Textes du monde
- Thème CLIL : 4033 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Langues étrangères
- EAN : 9782812415333
- ISBN : 978-2-8124-1533-3
- ISSN : 2417-6400
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-1533-3.p.0779
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 08/04/2014
- Langue : Français
Soleil*
Kappelow qu'il existe de Soleil deux versions distinctes : l'une, plus brève, dite « expurgée », publiée à Londres en 1926, l'autre, plus longue, dite « non expurgée î, publiée en 1928 à Paris par Black Sun Press. La correspondance de Lawrence indique que la première version de la nouvelle fut écrite en 1925, vers la fin de l'année. Il est vraisemblable que la version longue, dont nous donnons la traduction, est en réalité une réécriture, et non le texte non expurgé dont aurait été tiré la première version. Nous renvoyons le lecteur à la « Note » qui fait suite au texte de la nouvelle pour l'examen de ces deux textes. P. N.
<. T^MMENEZ-LA au soleil >, avait dit le médecin. Elle-même Cl ne croyait guère au soleil, mais elle se laissa faire et, accompagnée de son fils, d'une bonne d'enfant et de sa mère, elle accepta d'embarquer pour l'Europe. Le bateau partait à minuit. Son mari demeura avec elle pendant deux heures tandis que l'on couchait l'enfant et que les autres passagers montaient à bord. C'était une nuit obscure et la lourde noirceur des flots de l'Hudson reflétait de trem¬ blotants fragments de lumière. Penchée au-dessus de la lisse elle songeait : < Que la met est profonde et que de souvenirs insoupçonnés elle recèle ! > En cet instant la mer semblait se
* Titre original : Sun.
704NOUVELLES COMPLÈTES II
soulever comme le serpent de l'apocalypse ' venu du plus loin¬ tain des âges. — Tu sais, disait son mari, je ne puis me faire à ces sépara¬ tions, je les déteste. On sentait sa voix emplie d'appréhensions, de pressenti¬ ments, et l'on eût dit qu'il se raccrochait à un ultime espoir. — Moi non plus, fit-elle d'une voix blanche. Elle se rappelait avec quelle amertume ils avaient tous deux désiré s'éloigner l'un de l'autre. L'instant du départ réactivait ses émotions passées, mais seulement pour remuer plus pro¬ fondément le fer dans la plaie de son âme. Tous deux regardèrent leur fils endormi et les yeux du père s'embuèrent de larmes. Mais que sont les larmes qui vous montent aux yeux auprès des rythmes profonds des habitudes immuables, de ces habitudes forgées au fil des ans, de cet invincible élan vital ί Et leurs élans vitaux les avaient dirigés l'un contre l'autre. Tels deux machines désaccouplées, leurs mouvements ne pro¬ duisaient que frictions. — Tout le monde à terre ! Tout le monde à terre ! — Maurice, tu dois descendre. Et elle pensait : < C'est à lui qu'on s'adresse ; mais pour moi c'est < en route > ! > De la jetée noire et hostile il agitait son mouchoir vers le navire qui s'éloignait tout doucement ; un homme dans la foule ; c est ça un homme dans la foule ! Tels des plateaux chargés de mille lumières, les bacs traver¬ saient encore le Hudson et là-bas cette énorme gueule noire, c'était sans doute la gare de Lackawanna '. Le navire poursuivait lentement sa route interminable le long du fleuve. Elle finit par atteindre le cap. La Battery* était chétivement éclairée et la statue de la Liberté brandissait
1. On sait que Lawrence (Apocalypse, 1931) s'est inscrit dans la littéra¬ ture apocalyptique. Ce passage fait allusion à Saint-Jean, XII, 15 : < Et, de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve >. L'écrivain nous suggère ainsi de voir dans l'héro'îne de ce récit une sorte de réincarnation de la femme évoquée par le texte biblique. 2. En français dans le texte. 3. Trois lignes de chemin de fer, dont la ligne de Lackawanna avaient cette gare pour terminus. Elle était située à Hoboken, New Jersey, en face de Manhattan, sur la rive opposée de l'Hudson. 4. Secteur sud de Manhattan, à l'extrême pointe de l'île.
705723
sa torche dans un geste de colère. On commença à percevoir la houle. Bien que l'Atlantique eût une couleur aussi grise que la lave on finit pat découvrir le soleil. La voyageuse s'installa même dans une demeure qui dominait la plus bleue de toutes les mers. Le vaste jardin planté entièrement de vignes et d'oli¬ viers descendait en terrasses escarpées jusqu'à une petite plage. Il était parsemé de retraites secrètes, de bosquets de citronniers enfoncés dans les fissures de la terre, de verts bassins pleins d'une eau toujours fraîche. Une source jaillissait des profon¬ deurs d'une petite grotte, à laquelle, avant le temps des Grecs, s'étaient abreuvés les Sicules '. On entendait bêler une chèvre grise dans les ruines d'un tombeau antique aux niches mainte¬ nant vides. Les mimosas parfumaient l'air et la neige du volcan brillait au loin. La voyageuse contemplait tout cela. Certes, c'était un spec¬ tacle apaisant, mais il ne constituait qu'un décor ; elle ne s'en imprégnait pas vraiment. Elle ne se sentait pas différente, por¬ tant toujours en elle son mécontentement et son insatisfaction, son impuissance à ressentir la réalité des choses. L'enfant ne cessait de l'irriter et troublait sa tranquillité d'esprit. Il lui inspirait un insupportable sentiment de culpabilité, comme si elle eût été responsable de chacun de ses battements de cœur. Et le malaise qu'elle en éprouvait déteignait sur l'enfant et sur tout son entourage. — Juliet, souviens-toi, le docteur t'avait dit de t'étendre au soleil sans tes vêtements : pourquoi ne le fais-tu pas ? lui demanda sa mère. — Quand cela me sera supportable ! Juliet s'emporta ; Tu ne veux tout de même pas me tuer ? — Sûrement pas. Je parle pour ton bien. — Je t'en prie, arrête un peu de vouloit me faire du bien ! Cédant au chagrin et à la colère, sa mère finit par s'en aller. La mer se fit blanche, puis invisible. Des torrents de pluie s'abattirent et dans la maison consttuite pour le soleil il se mit à faire froid. Puis un matin, dans toute son ardeur et dans tout son éclat.
1. Peuple primitif de l'est de la Sicile d'où l'île a tiré son nom. Law¬ rence vécut en Sicile, à Taormine, en 1921 et en 1922. C'est là qu'il composa Sea and Sardinia, impressions de voyage et de séjour. La lecture de ce livre convainquit Mabel Dodge Luhan que seul Lawrence serait capable de décrire convenablement la région de Tacs.
706NOUVELLES COMPLÈTES II
le soleil surgit, nu au-dessus de l'horizon marin. La maison était tournée vers le sud-est et, de son lit, Juliet l'observa se lever. Ce fut comme si elle n'avait jamais vu le soleil se lever. Jamais elle n'avait vu sa chaste nudité se dresser à l'horizon, se dépouillant de la nuit comme d'un vêtement. Fier et nu, il éveillait en elle le désir de le rejoindre. Ainsi surgit en elle la secrète envie d'aller nue au soleil. Elle caressait jalousement cette secrète envie. Elle voulait rejoindre le soleil. Mais il lui faudrait quitter la maison et s'éloigner des gens. Et comment faire dans un pays où chaque olivier dissimule un regard indiscret, où chaque pente se laisse voir de très loin ? Comment faire pour s'unir au soleil à l'abri des importuns ? Finalement elle découvrit un endroit. C'était un petit pro¬ montoire rocheux en avant de la plage, exposé au soleil et couvert de ces grands cactus que l'on appelle figuiers de Bar¬ barie. Au milieu des figuiers se dressait un cyprès au tronc pâle et massif, et dont la cime flexible se balançait dans l'azur. Il paraissait veiller sur la mer ou bien faisait songer à un cierge dont l'immense flamme ténébreuse se fût détachée sur la lumière : une langue ténébreuse venue lécher le ciel. Juliet s'assit près du cyprès et se déshabilla. Les cactus dif¬ formes formaient autour d'elle un cercle sylvestre à la fois hideux et fascinant. Assise, elle offrait au soleil la nudité de sa poitrine, douloureusement résignée, en cette minute, à se livrer à sa cruelle étreinte. Du moins n'était-ce pas celle d'un homme ! Mais le soleil poursuivait sa marche dans l'azur en répan¬ dant ses rayons. La douceur de l'air marin lui caressait les seins qui, tels des fruits refusant de mûrir, demeuraient presque insensibles au soleil, des fruits qui flétriraient sans avoir connu la maturité. Pourtant elle se mit bientôt à les sentir s'animer à la pré¬ sence du soleil. Sa chaleur était plus délicieuse que l'amour, plus délicieuse que le lait ou les doigts dé son bébé. Enfin voici qu'elle sentait ses seins pareils à de massives grappes de raisin blanc baignées de soleil. Elle se dévêtit entièrement, s'étendit et se mit à contempler le soleil à travers ses doigts à demi écartés. Elle discernait la palpitation de son cœur et l'aveuglant jaillissement de son pourtour. Il était merveilleusement bleu, merveilleusement vivant et ruisselant de feu. Ο Soleil ! Ton corps de flammes bleutées se penchait sur elle et tu enveloppais tout ensemble
707725
ses seins et son visage, sa gorge, son ventre fatigué, ses genoux, ses cuisses et ses pieds ! Elle avait fermé les yeux et une flamme rose lui transperçait les paupières. C'en était trop. Arrachant quelques feuilles elle s'en protégea les yeux, puis elle s'étendit de nouveau, pareille à une longue gourde verte se dorant lentement au soleil. Les rayons lui pénétraient les os ; mieux, il pénétrait ses émotions et ses pensées. La tension dont elle souffrait se relâcha et, tels des caillots glacés, ses idées noires se dissipè¬ rent. C'est toute sa personne qui maintenant était baignée de chaleur. Elle se retourna, présentant au soleil ses épaules et ses reins, sa croupe, le creux de ses genoux et même ses talons. Elle était comme éblouie par la nouveauté de ses sensations. Son cœur las et glacé se fondait et s'évaporait au soleil. Seule sa matrice résistait, de cette opiniâtre et indestructible résis¬ tance que même le soleil ne saurait vaincre. Une fois rhabillée elle s'étendit encore une fois et porta ses regards sur le cyprès dont la cime pareille à une oriflamme flottait dans la brise. Mais en même temps elle sentait la présence majestueuse du soleil quelque part dans l'azur et la résistance qu'elle lui opposait. Elle rebroussa chemin, dans un état semi-conscient, ivre de soleil, aveuglée de lumière. Et cette cécité était un don, cette torpeur de ses sens une richesse nouvelle. Son fils courut à sa rencontre : < Maman, maman ! > Son appel, tel celui d'un oisillon, dans sa monotonie angoissée et avide ne trouva nul écho chez la mère. Pour la première fois l'affectueuse tension causée par son absence tournait court. Elle se borna à prendre l'enfant dans ses bras, tout en pensant : < Comme il est lourd ! Un peu de soleil en lui le rendrait plus vivace. > Et de nouveau à l'égard de l'enfant et à l'égard de toutes choses elle sentit sa matrice envahie d'une réticence invincible. Ces petites mains qui s'accrochaient à elle, surtout à son cou, l'irritaient. Elle retira sa gorge, elle ne voulait pas qu'il la touchât et reposa l'enfant à terre. — Sauve-toi, dit-elle. "Va courir au soleil ! Et sur-le-champ elle le déshabilla, le laissa tout nu sur la terrasse et lui dit : — Va jouer au soleil ! Effrayé, l'enfant fit mine de pleurer, mais sa mère encore tout irradiée d'indolence, le cœur pétri d'indifférence, fit rouler sur le carrelage rouge une orange après laquelle ce petit
708NOUVELLES COMPLÈTES H
bonhomme malléable se mit à courir d'une démarche encore mal assurée. Dans le même temps il se retournait vers sa mère, la mine effarouchée, au bord des larmes, car il n'avait pas l'habitude de se sentir tout nu. — Allons ! dit-elle, surprise de se sentir si insensible aux réactions du bébé, allons ! Apporte l'orange, apporte l'orange à maman ! Et à elle-même, elle se promit : < Il ne grandira pas comme l'a fait son père ; il ne poussera pas comme un petit ver tou¬ jours à l'abri du soleil. >
II
L'enfant avait toujours été sa grande préoccupation. Sa nais¬ sance avait développé en elle un sens tout à fait excessif de sa responsabilité. Au moindre rhume, aiguillonnée au plus pro¬ fond d'elle-même, elle se faisait des reproches, au point même de se dire ; < Regarde un peu ce que tu as mis au monde ! > Mais un changement était en train de se produire. Le bébé cessait d'être un souci permanent. Elle se sentait moins angoissée et en même temps moins préoccupée de son sort. Et le petit n'en allait pas plus mal, bien au contraire ! Elle aspirait secrètement à se sentir pénétrée par la triom¬ phante virilité du soleil. Sa vie se déroulait maintenant sous le signe d'une initiation secrète. Elle ne manquait jamais de s'éveiller avant l'aurore pour observer le passage des couleurs, guettant la présence éventuelle des nuages aux touches de gris susceptibles de se mêler à la pâleur de l'or. Mais jamais elle n'était si joyeuse qu'aux aurores où, dans sa nudité ardente, il répandait dans le ciel candide ses fulgurations bleutées. Il lui arrivait de faire une apparition timide et rougeaude ou, d'autres jours, de se lever avec lenteur, écarlate comme sous l'effet de la colère, ou, enfin, de se cacher derrière un nuage, révélant sa présence par un simple reflet vermillon et doré. La chance la favorisait. Au fil des semaines il arrivait bien que l'aurore fût entourée de nuages et que l'après-midi ne fût pas dégagé, mais pas un jour ne s'écoulait sans que le soleil se montrât. Même l'hiver il paraissait toujours radieux. Les petits
709111
crocus sauvages montraient leurs livrées mauves et les narcisses arboraient leurs étoiles hivernales. Chaciue jour elle se rendait jusqu'au cyprès dans le bosquet de figuiers de Barbarie surplombant les falaises jaunâtres. Elle avait maintenant acquis plus d'expérience et de sagacité et, chaussée de sandales, elle ne portait qu'un léger peignoir gris tourterelle. N'importe quel recoin lui suffisait pour se mettre nue au soleil et en un instant, remettant son peignoir, elle pouvait redevenir grise et invisible. Chaque jour aux environs de midi elle allait s'étendre au pied du cyprès chaussé d'argent, à l'heure où le soleil arpen¬ tait gaillardement le ciel. Elle le connaissait maintenant par chaque fibre de son corps. L'inquiétude, cette inquiétude lan¬ cinante avait disparu de son coeur anxieux, telle la fleur aux rayons du soleil, pour faire place à un petit fruit mûrissant. Et sa matrice encore crispée se détendait insensiblement, tout doucement, comme le bouton d'une nymphée émergeant petit à petit pour s'épanouir au souffle du soleil. Son corps tout entier connaissait le soleil, son ardeur bleue aux franges de feu, faisant jaillir le feu. Et, bien qu'il éclairât l'univers rout entier, c'est sur elle qu'il semblait se pencher tandis qu'elle était étendue toute nue. C'était une chose miracideuse : il éclairait des millions de créatures tout en se penchant sur elle seule, radieux, magnifique, irrempla¬ çable. Cette intimité solaire, la certitude que le soleil l'avait élue pour la connaître, au sens charnel et cosmique du mot, s'ac¬ compagnaient d'un sentiment de détachement et d'une tolé¬ rance un peu hautaine à l'égard d'autrui. L'humanité tout entière lui semblait si éloignée des éléments, si éloignée du soleil, pareille, en somme aux vers des cimetières. Même les paysans qu'elle voyait cheminer le long de l'an¬ tique chemin, montés sur leurs bourricots, avaient beau avoir la peau tannée par le soleil : ils n'étaient pas pénétrés de soleil. Un petit noyau de crainte était logé dans leur âme, tel l'escargot dans sa coquille, au point mystérieux ou l'homme s'effarouche devant la brûlante vitalité de la nature. Une peur ancestrale lui fait redouter le spectacle du soleil ; ainsi en allait-il de tous les hommes ! Alors, à quoi bon leur accorder une place ? Cette indifférence envers les gens, envers les hommes, la rendait moins soucieuse de ne point se montrer. A Marinina, qui l'accompagnait faire des courses au village, elle avait
710NOUVELLES COMPLÈTES II
déclaré que le médecin lui avait prescrit des bains de soleil. Point besoin d'en dire plus. Marinina avait une soixantaine d'années, peut-être plus. Elle était grande et mince, se tenait bien droite ; elle avait des cheveux grisonnants et dans ses yeux gris foncé se lisaient tout à la fois une expérience millénaire et la dérision sou¬ riante que confère une longue existence. Le tragique se repaît d'innocence. < Ce doit être merveilleux de se mettre nue au soleil >, avait dit Marinina tout en observant l'autre femme avec un sourire scrutateur. Les blonds cheveux de Juliet lui encadraient les tempes de petites bouches ombreuses. Femme de la Grande Grèce ', Marinina possédait une mémoire qui plon¬ geait dans le fond des âges. Elle se tourna de nouveau vers Juliet. — Mais, n'est-ce pas, quand une femme est belle, elle peut bien se montrer au soleil Et Marinina riait de ce petit rire essoufflé des femmes du passé. — Qui jseut dire si je suis belle ? fit Juliet. Mais, belle ou non, elle se sentait admirée par le soleil. Ce qui revenait au même. Il arrivait parfois que vers midi, pendant son bain de soleil, Juliet descendît vers le bas des rochers. Contournant la falaise, elle gagnait le ravin profond où les citronniers se pen¬ chaient dans l'ombre d'une éternelle fraîcheur. Et dans le silence de cette retraite elle ôtait son peignoir pour s'asperger à gestes rapides de l'eau des vertes cuvettes. Elle observait alors dans l'ombre verdoyante des citronniers la carnation nacrée de son corps qui peu à peu devenait plus doré. Elle se sentait une autre femme. Elle était réellement devenue une autre femme. Elle se rappela que pour les Grecs le corps qui ne connais¬ sait pas le soleil était tenu pour impur et suspect. Elle se frictionnait avec un peu d'huile d'olive, s'aventurait dans l'univers ombreux des citronniers, s'amusant à faire tenir une fleur de citronnier sur son nombril. Un paysan risquait peut-être de l'apercevoir, mais c'est sans doute lui qui serait le premier effrayé. Sous leurs vêtements les hommes dissimu-
1. Expression désignant l'ensemble des colonies grecques établies dans l'Antiquité du golfe de Tarente à la Sicile, sur les rives occidentales de la mer Ionienne.
711729
laient un pâle noyau de crainte qu'elle savait bien recon¬ naître. Elle pouvait le reconnaître même chez son petit garçon. C'est avec défiance qu'il accueillait le sourire maternel tout inondé de soleil. Elle exigeait maintenant qu'il aille chaque jour trottiner en plein soleil. Son petit corps commençait à prendre des couleurs, son épaisse chevelure blonde rejetée en arrière soulignait les tons délicatement dorés de son visage. Il respirait la santé et les domestiques qui admiraient ses couleurs rouge, or et bleu, l'appelaient un ange venu du ciel. Mais il se méfiait de sa mère : elle riait de lui. Dans les grands yeux bleus de l'enfant elle pouvait lire cette peur, cette appréhension qui, pour elle, caractérisait l'œil du mâle. Elle l'appelait la peur du soleil et son ventre demeurait interdit à tous les hommes, ces poltrons du soleil. < Il a peur du soleil >, pensait-elle en regardant l'enfant droit dans les yeux. Elle observait sa démarche incertaine, ses hésitations, ses culbutes dans le soleil, elle écoutait son gazouillis et elle constatait que, instinctivement, il s'efforçait d'éviter le soleil, que son équilibre était maladroit et ses gestes plutôt gauches. Son ardeur était aussi peu éveillée qu'un escargot à l'intérieur de sa coquille, elle-même logée au fond de quelque crevasse froide et humide, au fond de lui-même. Il lui rappelait son père. Si seulement elle parvenait à l'en déloger, à déclencher en lui un réflexe d'audace, un hommage au soleil. Elle résolut de l'emmener jusqu'au cyprès au milieu des cactus. Il faudrait faire attention aux piquants. Mais une fois là il s'aventurerait sûrement hors de la petite coquille logée dans les profondeurs de son être. Le petit ressort de la civilisa¬ tion qui lui tendait le visage finirait par céder. Elle le fit asseoir sur une couverture et s'installa près de lui. Puis après s'être débarrassée de son peignoir, elle s'allongea, observant le vol d'un faucon dans les hauteurs et la cime inclinée du cyprès. L'enfant s'amusait avec des cailloux. Puis il se leva, faisant mine de s'éloigner. Elle se leva également. Il se retourna pour la regarder et cette fois son regard avait presque la chaleur et l'expression de défi d'un vrai mâle. Et comme il était beau, tout rouge, et tout doré ! Il n'était pas blanc ! Sa peau avait maintenant une teinte d'or bruni. — Attention aux piquants, mon chéri.
712NOUVELLES COMPLÈTES II
— Piquants, répéta l'enfant de son ton d'oisillon, et sans la quitter du regard, avec l'expression hésitante d'un putto ' tout nu dans un tableau. — 'Vilains piquants ! — Ilains piquants ! Dans ses petites sandales il vacillait sur les pierres, se rete¬ nant à des tiges de menthe sauvage desséchée. Elle ne fît qu'un bond, à l'instant précis où il allait tomber contre les piquants. Étonnée de sa propre vivacité elle songea : < Quel chat sauvage je suis ! > Chaque jour où le soleil brillait elle l'emmenait à l'endroit du cyprès ; — Allons nous promener jusqu'au cyprès ! Et les jours de tramontana ^ quand il faisait trop froid pour y descendre, l'enfant ne cessait de réclamer : — Mener cyprès, mener cyprès. Il en avait maintenant autant besoin qu'elle. Ce n'était pas seulement un bain de soleil. Il s'agissait de bien autre chose. Quelque chose se produisait au-dedans d'elle-même, quelque chose se détendait, qui la faisait accéder à une réalité cosmique. Au-dedans d'elle-même une mystérieuse volonté incontrô¬ lable l'unissait au soleil. Le flux de ses rayons l'envahissait, pénétrait dans son ventre. Son moi conscient était relégué au second plan, il se faisait en quelque sorte spectateur. La véri¬ table Juliet existait désormais dans les profondeurs de son propre corps, sous l'influence du soleil noir, dont les flots noirs et violets, abondants et tumultueux enlaçaient tendre¬ ment la fleur toujours fermée de ses entrailles. Elle avait toujours exercé sur elle-même le plus strict contrôle et s'était toujours jugée sans indulgence. Mais dans les profondeurs de son être une nouvelle puissance avait surgi, une puissance qui la dominait, l'aveuglait, la galvanisait, élé¬ mentaire, irrésistible. Elle s'y abandonnait, comme à un charme invincible.
1, Terme italien désignant la représentation d'un enfant en peinture ou en sculpture. 2. Un vent froid venu des Alpes (cf. le français tramontane désignant le vent des Cévennes ou des Pyrénées).
713731
m
A la fin de février il fit soudain très chaud. La moindre brise faisait choir les fleurs d'amandier comme de la neige rose. Les petites anémones mauves aux pétales soyeux étaient en fleur, les asphodèles étaient en bouton et la mer avait la couleur du bleuet. Juliet était devenue totalement insouciance. Elle se conten¬ tait de passer le plus clair de la journée toute nue au soleil avec son fils. Il lui arrivait de se baigner dans les criques ensoleillées mais à l'abri des regards indiscrets. Il lui arrivait d'apercevoir un paysan sur son bourricot. Il pouvait la voir, mais elle et l'enfant étaient si naturels et si tranquilles qu'on ne s'occupait pas d'elle. De plus, les habitants connaissaient la réputation curative de leur soleil, pour l'âme autant que pour le corps et cela leur semblait naturel. Tous deux étaient maintenant complètement bronzés. «Je suis une autre personne > se disait-elle en contemplant sa poi¬ trine et ses cuisses dorées. L'enfant aussi s'était métamorphosé. Il avait absorbé le soleil noir de façon insensible et singulière. Il savait s'amuser silencieusement, sans que sa mère eût besoin de le surveiller. Il ne semblait plus s'apercevoir qu'il était seul lorsqu'elle s'éloignait de lui. Il n'y avait pas un souffle d'air et la mer était bleu foncé. Assise près de la grande griffe d'argent du cyprès, Juliet som¬ nolait en plein soleil, mais ses seins gonflés de sève étaient vigilants. Une sourde activité la travaillait, une activité qui ne tarderait pas à éveiller en elle une nouvelle personnalité. Mais elle ne daignait pas y prendre garde. La nouvelle personnalité aurait avec les autres des rapports nouveaux et cela était une perspective dont elle ne voulait pas. Le froid complexe de la civilisation, elle ne l'avait que trop connu et elle ne savait que trop les difficultés que l'on éprouve à s'en arracher. L'enfant avait disparu quelques mètres plus bas dans le sen¬ tier rocailleux derrière un grand cactus aux feuilles étalées. Elle l'avait aperçu, véritable enfant des vents aux cheveux d'or bruni et aux joues rouges, cueillant les fleurs bigarrées des népenthès et les disposant en rangées. Il possédait maintenant un bon équilibre, il était prompt à se tirer d'un mauvais pas et faisait songer à un jeune animal absorbé dans ses jeux.
714NOUVELLES COMPLÈTES II
— Regarde, maman, regarde ! Quelque chose de singulier dans le timbre de sa voix alerta immédiatement Juliet. Son sang ne fit qu'un tour. Le visage dirigé vers elle il lui montrait d'un doigt hésitant un seφent qui s'était dressé à un mètre devant lui et dardait sa flexible langue fourchue, noire comme une ombre, avec un bref sifflement. — Regarde, maman ! — Oui, chéri, c'est un serpent. Sa voix était grave et lente. L'enfant la regardait attentive¬ ment de ses grands yeux bleus, ne sachant s'il devait avoir peur ou non. Pleine de la sérénité solaire, son calme rassura l'enfant. — Serpent ? — Oui, mon chéri, ne le touche pas car il pourrait te mordre. Le serpent s'était laissé retomber et, défaisant les anneaux dans le tepli desquels il avait dormi au soleil, il laissa glisser lentement son long corps d'un brun doré dans le creux des rochers. L'enfant le suivait du regard, silencieusement, puis il murmura : — Serpent parti. — Oui, tu le laisses, il veut être seul. Immobile, l'enfant suivit des yeux la disparition de l'animal dans son déroulement souple et indifférent. — Serpent rentré. — Oui, c'est cela, Viens voir maman une minute. Il obéit et s'assit, petit corps potelé et nu, sur les genoux nus de sa mère, et elle caressa ses cheveux brunis et brillants. Elle se taisait car tout danger était passé. Le singulier pouvoir apaisant du soleil l'irradiait. Comme un sortilège il irradiait tout le paysage et le serpent, tout comme elle-même et son enfant, faisait partie du paysage. Une autre fois, sur le mur en pierres sèches de l'une des terrasses d'oliviers, elle aperçut un serpent noir qui rampait horizontalement. — Marinina ! J'ai vu un serpent noir : sont-ils dangereux ? — Non, pas les serpents noirs, mais les jaunes, oui ! Quand les jaunes mordent, on meurt. Mais ils me font tous peur, même les noirs si j'en vois un. Juliet retourna sous le cyprès avec son fils. Mais elle prenait soin de regarder autour d'elle avant de s'asseoir et d'inspecter les endroits où il pourrait aller. Puis elle s'allongeait sur le
715733
dos, dardant vers le soleil ses seins bronzés en forme de poire. Elle ne songeait jamais au lendemain. Ses pensées ne franchis¬ saient pas le mur du jardin et elle ne pouvait pas écrire de lettres. Elle chargeait la gouvernante de le faire. Elle restait au soleil, mais sans trop s'y attarder car il devenait plus fort et plus ardent. Et insensiblement le bouton qui au plus profond des rénèbres de son ventre était demeuré clos si longtemps commençait maintenant à redresser et durcir sa tige recourbée, à entrouvrir ses sombres pistils et à découvrir une ombre de rose. Telle une fleur de lotus, sa matrice s'épanouissait enfin dans une extase nacrée '.
IV
L'été approchait, vers le sud du soleil, dont les rayons s'étaient faits très ardents. Au plus chaud de la journée elle s'étendait à l'ombre des arbres ou s'aventurait au cœur du bosquet de citronniers. Il lui arrivait de descendre vers la fraî¬ cheur des gorges profondes au bas du petit ravin, du côté de la maison. Tel un jeune animal absorbé par les choses de la vie, l'enfant gambadait silencieusement près d'elle. Un jour qu'elle rentrait en traversant, nue, les buissons du sombre ravin, elle aperçut au détour d'un rocher, à côté de son âne, le paysan de la petite propriété voisine. Il portait un pantalon de toile, lui tournait le dos et était en train de ficeler un tas de branchages qu'il avait coupés. Dans le lit sombre de ce petit ravin tout respirait le calme et l'intimité. Une sorte de faiblesse la saisit et elle demeura un instant immobile, comme pétrifiée. D'un geste puissant l'homme hissa le tas de bois sur son épaule et se dirigea vers son âne. A la vue de Juliet il sursauta et s'immobilisa comme si quelque mirage lui était apparu. Leurs regards se croisèrent et comme une flamme bleue, un frémissement parcourut les membres de Juliet et vint irradier son ventre dont elle perçut l'irrésistible éclosion. Ils ne se quittaient plus des yeux et cette flamme, issue du cœur solaire, les enveloppait. Sous le vêtement de l'homme
1. Dans l'univers bouddhiste auquel fait allusion Lawrence, la fleur de lotus est la représentation allégorique du nirvana, ultime stade de la mi¬ gration de l'âme.
716NOUVELLES COMPLÈTES II
elle aperçut l'érection du phallus et elle comprit qu'il allait venir à elle. L'enfant avait posé la main sur la cuisse de sa mère : — Maman, un homme, maman, un homme ! Elle perçut son inquiétude et se pencha vers lui : — N'aie pas peur, mon petit. Puis, le prenant par la main, elle lui fit faire le tour du rocher cependant que le paysan suivait du regard le balance¬ ment de sa croupe. Elle enfila son peignoir, prit le petit dans ses bras et se mit à gravir le sentier pentu qui zigzaguait dans un enchevêtre¬ ment de buissons aux fleurs jaunes. Une fois sortie de l'ombte et parvenue en vue des oliviers juste au bas de la maison, elle s'assit pour reprendre ses esprits. La mer était bleue, très bleue, douce et tranquille. Juliet pouvait sentir sa matrice toute grande ouverte, épanouie comme une fleur de lotus ou de figuier, dans une sorte de radieuse attente. Cette sensation l'obnubilait et un amer res¬ sentiment à l'égard de son fils lui brûlait la poitrine. Elle connaissait de vue le paysan. Il devait avoir la tren¬ taine ; c'était un gaillard robuste, aux épaules larges. Elle l'avait souvent observé depuis la terrasse de la maison. Il arri¬ vait avec son âne, taillait les oliviers, toujours seul et donnant toujours une impression de force physique. Il avait un large visage rougeaud et semblait peser tranquillement ses gestes. Une ou deux fois il lui était arrivé de lui parler et elle avait remarqué ses grands yeux bleu sombre, tout emplis de chaleur méridionale. Parfois il se mettait à gesticuler, avec une véhé¬ mence généreuse. Mais elle ne lui avait jamais accordé beau¬ coup d'attention. Tout juste avait-elle remarqué qu'il était très propre et très soigné. Une fois elle avait aperçu sa femme qui était venue lui apporter son repas. Ils s'étaient installés à l'ombre d'un caroubier, vis-à-vis, de chaque côté d'une nappe blanche. Juliet avait pu constater que le paysan était plus jeune que sa femme, laquelle avait la peau brune et un air ombrageux. Une jeune femme les avait rejoints en compagnie d'un enfant et l'homme avait fait danser l'enfant dans ses btas, dans un mouvement d'allégresse spontané. Mais ce n'était pas son enfant : il n'avait pas d'enfants. Et c'est à cet instant, devant cet accès d'allégresse si révélateur d'un désir refoulé, que, pour la première fois, Juliet avait vraiment fait attention à lui. Mais elle l'avait ensuite quelque peu oublié. Avec son gros visage rougeaud, son immense poitrail et ses
717735
petites jambes, ce n'était après tout qu'un paysan, un homme de condition inférieure. Mais maintenant elle avait enregistré le défi singulier de son regard, aussi bleu et aussi dominateur que le cœur du soleil bleu. Elle avait vu le frémissement farouche de son phallus sous le mince tissu de son pantalon : elle en était la destina¬ taire. Avec son visage rougeaud, son corps massif, il était le soleil de Juliet, son soleil en pleine chaleur. Elle éprouvait son existence avec une telle intensité qu'elle ne pouvait plus se détacher de lui. Elle demeurait assise sous l'arbre. La gouvernante agita la cloche du déjeuner et appela l'enfant. Celui-ci répondit et Juliet dut se lever pour regagner la maison. L'après-midi elle était assise sut la terrasse qui donnait sur les oliviers et dominait la mer. L'homme circulait autour de la petite cabane qui se dressait sut son terrain à proximité de la haie de figuiers de Barbarie. Il jetait des regards en direction de la maison, en direction de Juliet assise sur la terrasse. Et celle-ci sentait son ventre s'offrir à lui. Mais elle n'eut pas le courage d'aller le rejoindre. Elle était paralysée. Elle se fit servir le thé sut la terrasse. Et l'homme ne cessait pas ses allées et venues, regardant chaque fois dans sa direction. Enfin la cloche de la petite église sonna les vêpres et le soir se mit à tomber. Juliet n'avait pas quitté la terrasse. La lune était déjà levée quand elle le vit charger son âne et le mener d'un pas mélancolique sur le sentier qui conduisait à la petite route. Elle entendit les sabots de la bête résonner sur les pavés de la route derrière la maison. Il avait disparu, il avait regagné sa maison au village pour se coucher, se coucher auprès de sa femme qui lui demanderait pourquoi il rentrait si tard. Il était rentré tout abattu. Juliet resta ainsi jusqu'à une heure avancée de la nuit. Elle contemplait la lune au-dessus de la mer. Le soleil lui avait ouvert la matrice et elle n'était plus libre. Elle connaissait maintenant le tourment de la fleur de lotus épanouie et c'est elle qui désormais n'osait plus s'aventurer vers le bas de la gorge. Mais elle finit par aller dormir et au réveil elle se sentit mieux. Sa matrice semblait s'être refermée, la fleur de lotus avait replié ses pétales. C'est du moins ce qu'elle eût sou¬ haité : que la fleur restât en bouton et qu'elle puisse jouir du soleil ! Il ne fallait plus songer à cet homme. Elle alla se baigner dans l'une des grandes citernes au bas
718NOUVELLES COMPLÈTES II
du bosquet de citronniers tout au bas du ravin à l'endroit le plus éloigné de l'autre gorge, en pleine fraîcheur. Au-dessous d'elle, sous les citrons, son fils jouait à l'ombre au milieu des oxalides aux fleurs jaunes. Il ramassait des citrons par terre et dans les embrasures de lumière on pouvait voir bouger son petit corps bronzé. Assise au soleil sur la berge inclinée, elle se sentait redevenir libre et au-dedans d'elle la fleur se refermait sagement. Tout à coup, au point le plus élevé du terrain, la silhouette de Marinina se détacha sur le bleu du ciel. Elle avait un fichu noir noué autour de la tête et appelait doucement : — S'ignora ! S'ignora Giul'ietta ! Juliet se leva et, à la vue de cette femme nue qui se dressait ainsi brusquement, les cheveux tout auréolés de soleil, Marinina hésita un instant. Puis d'un pas rapide la vieille descendit le long du sentier abrupt tout brûlant de soleil. Parvenue à quelques pas de la femme ensoleillée elle s'arrêta et, se redressant de toute sa taille, la regarda avec circonspection. Puis d'une voix bien posée, presque iro¬ nique : — On peut dire que vous êtes belle !... Votre mari est là. — Quel mari ? La vieille eut un rire bref, pareil à un jappement, le rire d'une femme du passé ; — Vous avez bien un mari, non ? — Comment ? Où ça ? En Amérique ? La vieille se retourna et se mit de nouveau à rire douce¬ ment : — Pas d'Amérique du tout. Il était juste derrière moi. Il a dû rater le sentier. — Et elle se remit à rire doucement comme font les femmes. Les sentiers recouverts d'herbes et de fleurs de népenthès n'étaient pas plus grands que la trace laissée par le passage d'un oiseau dans un lieu éternellement désert. Quelle solitude étrange est celle des lieux où fleurit la civilisation antique, si accoutumée à la présence de l'homme ! Juliet regarda la Sicilienne d'un air songeur : — C'est bien, fit-elle, qu'il vienne ! Et une petite flamme s'alluma au-dedans d'elle. La fleur s'ouvrait. C'était toujours un homme. — Qu'il vienne ici ? Maintenant ? Les yeux gris de Marinina fixaient avec amusement ceux de Juliet. Elle eut un léger haussement d'épaules :
719737
— C'est d'accord, comme il vous plaira. Mais il aura une sacrée surprise ! Sa bouche s'ouvrit pour laisser passer un rire silencieux et, montrant du doigt l'enfant qui ramassait des citrons contre sa poitrine, elle ajouta : — Comme il est beau ! Un vrai ange du ciel ! Il va être content, le pauvret ! Alors je le fais venir ? — Fais-le venir. La vieille rebroussa rapidement chemin et découvrit Mau¬ rice errant dans les vignes, tout costumé de gris avec son feutre et son complet de ville. Dans ce soleil resplendissant et dans l'harmonie du vieux monde grec il détonnait pitoyable¬ ment : une véritable tache d'encre. — Venez, lui dit Marinina. Elle est plus bas. Et à grandes enjambées elle le mena à travers les herbes selon son propre itinéraire. Parvenue au sommet de la pente que surplombait les citronniers tout en bas, elle précisa : — Vous n'avez qu'à descendre par là. Il la remercia et après avoir jeté un bref coup d'oeil à Mari¬ nina, il se mit à descendre. Il avait une quarantaine d'années. Il avait un visage sans grand relief, rasé de près. Il était très discret et profondément timide. Il menait ses affaires avec doigté, sans accomplir de miracles, mais avec succès. Il n'avait confiance en personne. La vieille femme de la Grande Grèce l'avait jugé au premier coup d'oeil. < Il est bon, songeait-elle, mais, le pauvre, ce n'est pas un vrai homme. > — La Signora est en bas, dit Marinina, désignant la direc¬ tion d'un geste de coryphée. — Merci, merci ! répéta-t-il précipitamment. Puis il s'engagea précautionneusement sur le sentier. Marinina le suivit du regard, releva le menton avec une certaine malice et retourna à grands pas vers la maison. Tout préoccupé à regarder devant lui pour éviter les faux pas que la végétation méditerranéenne risquait de lui faire accomplir, Maurice n'aperçut sa femme qu'une fois parvenu tout près d'elle. Elle était debout toure nue près des aspérités du roc, scintillante de soleil et de vitalité. Ses seins semblaient se soulever comme pour écouter indiscrètement. Ses cuisses brunes frémissaient d'agilité. Son lotus matriciel était grand ouvert, aspirant littéralement les rayons violets du soleil, comme une immense fleur. Un invincible frisson la parcou¬ rait : un homme venait vers elle. Tandis qu'il cheminait vers
720NOUVELLES COMPLÈTES II
elle comme un filet d'encre sur du buvard, elle le couvait d'un œil impatient. Le pauvre Maurice hésita, détourna les yeux et, d'une voix toussotante, bredouilla : — Hello, Julie ! Parfait, parfait ! Il continuait à se diriger vers elle sans la regarder, d'une manière furtive, tandis qu'elle faisait admirer le reflet satiné du soleil sur son épiderme bronzé. Sa nudité n'avait rien de redoutable, toute vêtue qu'elle était des iridescences solaires. Une ombre sembla voiler de froideur la fleur épanouie qu'elle portait en elle. Elle esquissa un mouvement de recul : — Hello, Maurice ! Je ne t'attendais pas si vite ! — Non ! J'ai réussi à m'évader un peu plus tôt que prévu. Et de nouveau il ne put réprimer un toussotement. Furtive¬ ment il avait résolu de la surprendre ainsi. Ils se tenaient à quelques mètres l'un de l'autre et ils gardèrent le silence. Cette femme était une nouvelle Julie : bronzée, les cuisses caressées par la brise, elle ne ressemblait guère à la New Yor- kaise nerveuse qu'il avait connue. — Eh bien... c'est parfait, parfait... tu es parfaite ! Où est le petit ? Au plus profond de son corps il sentait monter en lui le désir de posséder ces membres, cette femme à la chair enve¬ loppée de soleil, cette femme charnelle. C'était une sensation nouvelle, douloureuse, qu'il souhaitait esquiver. — Le voilà ! Et du doigt elle montrait un petit bonhomme tout nu à l'ombre du bosquet, occupé à entasser des citrons. Le père eut un rire bref pareil à un hennissement. — Mais oui ! Le voilà ! Mais c'est un vrai petit homme ! Magnifique ! Une émotion violente parcourait son âme refoulée et il s'ac¬ crochait aux branches fragiles de son intellect ' : — Hello, Johnny ! Hello, Johnny, dit-il d'une voix fluette. L'enfant leva les yeux, laissa tomber ses citrons, mais il resta sans réaction. — Allons le retrouver, dit Juliet. Et elle descendit le sentier. En dépit d'elle-même l'ombre froide avait saisi la fleur éclose de sa matrice et chaque pétale frissonnait. Son mari la suivit, observant la danse nacrée de ses
1. Ajoutée dans la version < définitive >, cette phrase {âme refoulée... intellect) manifeste clairement comment Lawrence entend guider son lec¬ teur vers une mise en perspective psychanalytique.
721739
hanches rapides et l'ondulation de sa taille. Il était à la fois médusé et embarrassé au plus haut point. La personne qu'il avait connue n'était plus là ; c'était une nymphe séduisante, indifférente, au corps pétri de soleil et dont les hanches étince- laient. Quelle conduite adopter ? Avec son costume gris foncé, son feutre gris clair, son visage gris et monacal d'homme d'af¬ faires timide, sa grise mentalité mercantile, il se sentait complètement déplacé. Ses reins, ses membres éprouvaient des sensations inconnues. Terrorisé, il se sentait capable de lancer brusquement un sauvage hurlement de triomphe, capable de bondir sur cette femme de chair bronzée. Ils émergèrent du jaune océan d'oxalides sous les citron¬ niers. — Il a plutôt bonne mine, n'est-ce pas ? dit Juliet. — Oui ! Oui ! Parfait, parfait ! Hello, Johnny ! Tu reconnais papa ? Oubliant le pli de son pantalon, il s'accroupit et ouvrit les bras. — Citrons, dit l'enfant de sa voix aiguë, deux citrons ! — Deux citrons ! Des tas de citrons ! L'enfant alla placer un citron dans chacune des mains de son père et se recula pour juger de l'effet. — Deux citrons, répéta le père. Viens, Johnny, viens dire bonjour à papa ! — Papa s'en va ? — S'en va r· Non... pas maintenant! Il prit l'enfant dans ses bras. — Ore la veste, papa, ôté la veste, s'écria l'enfant joyeuse¬ ment, mais gêné par le contact de l'étoffe. — D'accord, fiston ! Papa ôte la veste. Il retira la vesre et la plia soigneusement à côté de lui, examina le pli de ses pantalons, les défroissa un peu, s'assit avec précaution et prit son fils dans ses bras. Le conract de la peau nue de l'enfant lui donnait comme le vertige. La femme nue regardait l'enfant nacré dans les bras de l'homme en man¬ ches de chemise. L'enfant avait enlevé le chapeau de son père. Juliet contempla les soyeuses tempes argentées de son mari, impeccablement peigné. Mais pas la moindre trace de soleil. De nouveau l'ombre froide s'étendit sur la fleur de sa matrice. Elle demeura longtemps silencieuse, écoutant le père parler à l'enfant qui avait tellement aimé son papa. — Alors, Maurice, qu'as-tu décidé ? demanda-t-elle tout à trac.
722NOUVELLES COMPLÈTES II
Il lui jeta un regard furtif, frappé par son accent américain. Il ne se souvenait plus d'elle. — Décidé quoi, Julie ? — En général, tout cela ! Je ne peux plus revenir vivre dans la 47' rue. 11 marqua un temps d'hésitation : — Non, bien sûr. En tout cas, pas pour le moment. — Jamais plus ! Le silence retomba. — Alors, dans ce cas-là, je ne sais pas. — Crois-tu que tu pourrais vivre ici ? demanda Juliet d'un ton impitoyable. — Oui, pour un mois, je suis sûr qu'un mois cela irait. 11 avait hésité. Puis, s'étant hasardé à la regarder timide¬ ment, comme de façon détournée, il baissa les yeux. Elle l'observait implacablement. Un soupir lui souleva les seins, comme si elle tentait de se débarrasser une fois pour toutes de l'ombre froide et désensoleillée. Elle détacha ses mots : — Je ne ppux pas retourner. Je ne peux pas m'éloigner de ce soleil. Si tu ne peux pas venir ici... Elle ne finit pas sa phrase. Mais la voix de l'Américaine intransigeante et catégorique avait fait place à celle d'une femme charnelle, au corps tout pétri de soleil. Il se mit de nouveau à l'épier à la dérobée, cédant de plus en plus à son désir, de moins en moins craintif... — Non. Tu as ce qui te convient. Tu es parfaite. Non, je ne pense pas que tu puisses retourner. Sa voix s'était faite caressante et elle sentit que, de nouveau, sa fleur matricielle s'ouvrait et frémissait dans chacun de ses pétales. 11 songeait à ce qu'elle avait été dans leur appartement de New York, effacée, pâle, silencieuse, tendue. 11 était la gentillesse et la discrétion mêmes ; après la naissance du bébé, la sourde et atroce hostilité de Juliet l'avait littérale¬ ment épouvanté. 11 sentait bien qu'elle n'y pouvait rien. Les femmes sont ainsi. Leurs sentiments sont sujets à des renver¬ sements subits, même si elles en font les frais. C'était affreux, c'était insupportable. Absolument insupportable de vivre sous le même toit qu'une femme dont l'agressivité s'exerçait contre elle-même. 11 avait constaté que le courant d'hostilité farouche qui émanait de sa femme allait l'en¬ gloutir. Elle en était parvenue au point où l'enfant lui-
723741
même souffrait de ce laminage. Il avait été absolument nécessaire d'en finir. Dieu merci, le soleil avait pulvérisé cette femme spectrale et dangereuse. — Mais, et toi ? demanda-t-elle. — Moi ? Je peux continuer de m'occuper de l'affaire et te rejoindre pour de longues vacances, aussi longtemps que tu désires rester ici. Restes-y aussi longtemps que tu voudras. Il avait les yeux fixés au sol. Il craignait par-dessus tout de réveiller le démon qui avait possédé sa femme, il souhaitait tant la voir demeurer dans l'état où il venait de la retrouver, telle une fraise mûrissante, une véritable femme-fruit. Il jeta un coup d'oeil vers elle et dans son regard incertain il y avait comme une prière. — Même pour toujours ? — Oui, si c'est ce que tu veux. Toujours est un grand mot. On ne peut pas fixer de date. — Et je pourrais faire tout ce qui me plaît ? Elle le regardait droit dans les yeux, avec une expression de défi. Mais en face de cette nudité nacrée et aguerrie, il se sentait désarmé : surtout ne pas réveiller l'autre femmme qui l'avait habitée, l'Américaine autoritaire, spectrale et vindica¬ tive ! — Oui, sans doute, aussi longtemps que tu ne te rends pas malheureuse et que tu ne rends pas le petit malheureux. Il la regarda de nouveau de cet air confus, inquiet pour l'enfant, mais gardant pour lui-même quelque espoir. — Ce ne sera pas le cas, répondit-elle avec vivacité. — Non. Je ne le pense pas non plus. Ils se turent. Les cloches du village carillonnaient midi, c'est-à-dire l'heure du déjeuner. Juliet enfila son kimono de crêpe gris et noua une large ceinture verte autour de sa taille. Puis elle glissa une petite chemise bleue par-dessus la tête du petit garçon et tous trois se dirigèrent vers la maison. A table Juliet examinait le visage de son mari, son teint gris de citadin, ses cheveux grisonnants et gominés, ses manières pointilleuses et l'extrême modération avec laquelle il mangeait et buvait. Il lui lançait parfois un regard furtif entre ses cils noirs. Ses yeux étaient d'un gris doré comme ceux d'un animal attrapé jeune qui a été complètement élevé en captivité, des yeux d'une singulière froideur, dépourvus de chaleur et d'espérance. Mais il avait des cils et des sourcils noirs bien dessinés. Elle ne parvenait pas à le comprendre, à
724NOUVELLES COMPLÈTES II
saisir quel homme c'était vraiment. Elle-même était tellement ivre de soleil qu'elle ne pouvait pas le voir, lui que l'absence de toute trace solaire réduisait pour elle à néant. Ils allèrent prendre le café sur le balcon, sous la masse violacée du bougainvillée. En bas, plus loin, dans le champ voisin, le paysan et sa femme assis sous le caroubier près du blé vert terminaient leur repas sur une petite nappe blanche étalée par terre. Il avaient devant eux un énorme morceau de pain et des verres remplis d'un vin sombre. Le paysan leva les yeux dès qu'il vit l'Américian paraître sur la terrasse. Juliet installa son mari le dos à la scène. Puis, une fois assise, elle regarda à son tour le paysan. Jus¬ qu'à ce que sa noiraude épouse se mît elle aussi à la regarder.
V
L'homme était follement amoureux d'elle. Son large visage rougeaud était immuablement tourné vers elle. Mais lorsque sa femme se mit aussi à regarder, il saisit son verre et le vida d'un seul trait. La femme examina longuement les silhouettes assises sur le balcon. C'était une femme bien bâtie, d'allure plutôt morose et certainement plus âgée que lui. L'énorme différence qui s'établit entre une femme de caractère et de condition plus élevée ayant dépassé la quarantaine et un mari insouciant n'ayant qu'une petite trentaine équivaut à une dif¬ férence entre deux générations. < Il fait partie de ma généra¬ tion, se disait Juliet, et elle appartient à la génération de Mau¬ rice. > Juliet n'avait pas encore trente ans. Vêtu de ses pantalons de toile blanche, de sa chemise rose pâle et de son vieux chapeau de paille, le paysan avait quelque chose d'attachant. Et puis il était si propre, il respi¬ rait tant la santé. De carrure extrêmement athlétique, il avait l'air plutôt petit, mais ses muscles possédaient une telle toni¬ cité ! Tous ces gestes donnaient une impression d'élasticité, et même dans son travail il semblait, comme avec l'enfant qu'il avait fait sauter, se livrer à un jeu. C'était un vrai paysan italien, de ceux qui ont à coeur de se donner et de donner avec une générosité totale, de toute la force de leur chair et jusqu'à la dernière pulsation de leurs veines. Mais, paysan jus-
725743
qu'au bout des ongles, il attendrait de la femme qu'elle fît les premières avances. Son désir se consumerait dans une longue attente entièrement passive, espérant inlassablement que la femme vienne à lui. Jamais, non, jamais il ne ferait le premier pas. C'était à elle de le faire et lui se contenterait de demeurer à sa portée. Conscient du regard de Juliet il se débarrassa de son cha¬ peau de paille, découvrant ainsi une tignasse brune coupée court. De sa main rouge brique il saisit le gros quignon de pain, en arracha un morceau et, l'ayant enfourné dans sa bouche, se mit à le mâchonner. Il savait qu'on le regardait et ce regard l'envoûtait à la manière dont peut être envoûtée une bête, par toutes les artères de son corps, par toute la chaleur de son sang. D'innombrables soleils l'avaient travaillé de leur chaleur, et sa timidité violente et insurmontable se contenterait d'une éternelle attente, d'un éternel désir, mais jamais, au grand jamais, n'accomplirait un seul pas dans la direction de Juliet. Le connaître serait comme un autre bain de soleil, pesant, épuisant, plein de sueur. Et l'oubli lui succéderait. Il ne pou¬ vait pas avoir d'existence personnelle. Il serait tout simplement un bain de chaleur et de jouvence, auquel succéderaient la séparation et l'oubli. Puis, de nouveau, comme le soleil, le bain procréateur. Mais quelle source de bien-être ! Juliet était si lasse des contacts personnels, si lasse de devoir adresser la parole à l'homme une fois l'acte sexuel accompli. Avec cet être plein de santé, la satisfaction se suffirait à elle-même et n'exige¬ rait ensuite aucune contrainte. Assise à cet instant elle sen¬ tait un flux vital circuler invisiblement entre elle et lui. Les simples gestes de l'homme lui indiquaient qu'il éprouvait encore plus intensément qu'elle cette commune intuition. Leurs corps semblaient alors doués d'une conscience auto¬ nome et douloureuse. Et dans une sorte d'hypnose chacun restait assis, immobile, sous le regard vigilant d'un conjoint, d'un propriétaire. < Pourquoi, songeait Juliet, pourquoi n'irais-je pas à lui ? Pourquoi ne porterais-je pas un enfant de lui ? Ce serait comme un enfant apporté en offrande au soleil inconscient, à la terre inconsciente, un enfant semblable à un fruit. > Et la fleur de sa matrice rayonnait. Aucune notion de propriété ne l'effleurait. Cette fleur ne désirait que la rosée virile, à l'exclu¬ sion de tout autre souci temporel. Mais la crainte assombrissait
726NOUVELLES COMPLÈTES Π
son cœur. Jamais elle n'oserait ! Que l'homme ne pouvait-il inventer quelque subterfuge ? Mais non ! C'était impossible : il ne saurait qu'attendre, irrésolu, que désirer dans l'irrésolution, dans une expectative sans fin, jusqu'à ce qu'elle accomplisse le premier pas. Jamais elle n'oserait et l'expectative de l'homme s'éterniserait. Son mari se retourna et aperçut les paysans : — Ne crains-tu pas d'être vue quand tu prends tes bains de soleil ? De l'autre côté de la gorge la femme triste s'était aussi mise à regarder du côté de la villa. C'était une sorte de conflit. — Mais non, on peut très bien éviter d'être vu. Voudrais-tu essayer ■' Voudrais-tu prendre des bains de soleil ? — Euh,,, Oui, je crois que je vais essayer pendant que je suis ici. Son regard brillait faiblement comme sous l'emprise d'une ferveur apeurée, devant la tentation de goûter à ce fruit nou¬ veau qu'incarnait cette femme dont les sein nacrés et mûris au soleil oscillaient sous le peignoir. Juliet songeait à sa petite silhouette de citadin hâve et étiolé, s'agitant au soleil pour reconquérir ses droits conjugaux. Un étourdissement la saisit. Ce singulier petit bonhomme, ce citoyen modèle, était, au regard lucide du soleil, marqué comme un malfaiteur ; et quelle honte il éprouverait à se dévoiler ! La fleur de sa matrice était tout étourdie. Sans doute, elle le savait bien, c'est lui qu'elle choisirait, c'est son enfant qu'elle porterait. C'était pour lui, pour le périt citadin marqué d'une flétrissure que s'épanouissait son ventre, radieux comme le lotus, épanoui comme l'anémone violacée au cœur téné¬ breux. Non ! Elle ne se rendrait pas au paysan ; elle n'avait pas assez de courage pour s'affranchir. Elle n'ignorait pas qu'avec sa passivité terrienne, jamais il ne viendrait la cher¬ cher. Il vivrait dans une attente interminable, se contentant de se manifester à sa vue par intermirtence, avec l'assiduité d'un animal dans sa parade amoureuse. Elle avait observé la montée du sang sur le visage bronzé du paysan, elle avait senti la chaleur bleue qui jaillissait de son regard, observé l'érection de son membre viril, rendant ainsi hommage à sa féminité. Mais elle ne se rendrait pas à lui. Jamais elle n'oserait. C'est le chétif corps étiolé de son mari, de ce citadin marqué, c'est son petit membre viril éperdu qui la posséderair, qui engendrerait son deuxième enfant. Elle n'y pouvait rien. Enchaînée à l'immense roue de
727745
la nécessité, elle était une Andromède que nul Persée ne vien¬ drait délivrer '.
Note sur les deux versions de Soleil La version de » Soleil » (Sun) traduite dans la présente édi¬ tion diffère de la version plus courte, publiée en mai 1928 dans le recueil de nouvelles intitulé The Woman Who Rode Away. Il est intéressant de comparer les deux textes. Publié à Paris en 1928 par Black Sun Press, le texte long a été désigné par Lawrence, tantôt comme le texte κ non expurgé » {auquel cas sa composition serait antérieure à la version courte) et tantôt comme le texte r définitif » (ce qui signifie une repHse de la version courte). Avant de prendre parti, examinons donc les deux textes, que l'on appellera respectivement [7] (version longue, traduite ci- dessus) et [2] (version courte, dont le texte anglais a été repro¬ duit notamment dans les éditions Heinemann). On peut dire que [2] représente les deux tiers de la longueur de [7] (ou, si l'on préfère, que [7] est une fois et demie plus long que [2] ). Cette différence est essentiellement due au fait que les deux dernières sections de [7] sont beaucoup plus longues, en particulier la section IV, qui est presque deux fois plus longue en [7] qu'en Des allongements moins spectaculaires deyÎ\ par rapport à [2] sont visibles à certains endroits des trois pre¬ mières sections. Lorsque l'on saisit l'ensemble des deux versions on peut constater que ces allongements sont subordonnés au déve¬ loppement des deux dernières sections. Le contenu narratif est identique dans les deux versions mais, alors que [2] évoque seulement la présence du Sicilien lorsque Juliet, le voit déjeuner sur l'herbe avec sa femme, [7] lui attribue un rôle déterminant. Dans [7] la rencontre de Juliet et du paysan sicilien, à la section IV, commande les principales différences que l'on peut observer entre les deux ver¬ sions. Le personnage de Juliet est plus fermement campé dans [7]
1. Personnages de la mythologie grecque. Enchaînée à un rocher par Méduse, Andromède fut délivrée par Persée, fils de Zeus et de Danaé. Elle l'épousa et ils régnèrent ensuite sur la ville de Mycènes.
728NOUVELLES COMPLÈTES II
que dans [2]. Son attitude à l'égard de l'enfant est moins conventionnellemenl maternelle. Par exemple, dans la section II de [2] Lawrence écrit qu'elle repose son fils « doucement ν à terre. Dans [i] l'adverbe est supprimé. Les différences touchant aux gestes et aux attitudes visent, dans [l] à donner plus de relief à la réalité des corps. Ainsi, dans la section II, alors que 2 parle du corps de Juliet « dévêtu » (en anglais : unclothed), 7] nous dit que ce corps est «nu» (naked). La différence est significative : dans un cas nous avons une référence implicite au vêtement et à la notion de pudeur ; dans l'autre à la vulnéra¬ bilité du corps exposé au soleil. Dans [2] le corps est perçu « au-dessus de la ceinture », conformément à la représentation verticale opposant la zone supérieure, dite « noble », à la zone inférieure, dite « ignoble ». [i] abolit cette frontière et montre « la totalité » du corps humain. Cette différence est amorcée dès la section II. Dans [2] Lawrence écrit que Juliet « connaissait le soleil dans le ciel (in heaven) », alors que dans [7] elle connaît le soleil « dans tout son corps de femme (in ail her body) [7] décrit Juliet comme « une nymphe séduisante, indifférente, au corps pétri de soleil et dont les hanches étincelaient ». Notons aussi que l'évocation de la «matrice» (womb) apparaît dans [7] dès la fin de la section I. Lawrence joue sur le fait que, dans la langue anglaise, la proxim'ité étymologique des mots « womb » (la matrice) et « woman » (la femme) permet au récit, plus particulièrement dans [7], de marquer l'éveil de Juliet à la réalité physique (« womb ») de sa féminité (« woman »). [7] oppose plus nettement que [2] les notations d'ombre et de lumière, en exploitant la description du relief mouvementé de l'île avec le ravin et les bouquets d'arbres. Surtout cette même version présente une organisation des couleurs qui accentue le symbolisme caractéristique de Lawrence. Le bleu foncé tirant sur le violet est à la fois la couleur de l'énergie solaire et des yeux du paysan sicilien. Ce bleu foncé, absorbé par la Méditerranée, souligne la banalité de Maurice « tout costumé de gris avec son feutre et son complet de ville », [7] associe le paysan sicilien à la force du sang, aux pulsations de la vie. Le texte souligne le teint rouge de son visage, son goût des couleurs vives : chemise rose et pantalon blanc. Autour du couple « le paysan sicilien »-Juliet, [7] polarise d'autres aspects de lorganisation symbolique. Deux stéréotypes animaux sont associés aux personnages, respectivement lâne et le serpent. Traditionnellement lâne signifie le sexe, la libido, lélément instinctif de Ihomme, une vie qui se déroule toute au
729747
plan terrestre et sensuel. Cette représentation très ancienne trouve déjà son expression dans les « métamorphoses » de la lit¬ térature latine et notamment chez Apulée, avec la légende de l'âne d'or. Dans cette légende, le héros Lucius est 'initié au culte d'Osiris — culte solaire — lorsqu'il reprend sa forme humaine. Dans le texte long de « Soleil », le paysan sicilien est aussi une métaphore du soleil et, telle Isis, Juliet est sa compagne dans l'ordre naturel. Dans la section I de [2] Lawrence ne marque pas la personnification du soleil : le mot if sun » (soleil) est écrit avec une minuscule. Au contraire, dans [i] nous avons une majuscule (« Sun ») à l'endroit où il est question de son « corps de flammes bleutées ». Dans [7] la section II se termine par un passage, absent dans [2], où l'irradiation solaire est comparée au flux d'une rivière en crue fertilisant les entrailles de Juliet. Celle-ci est associée au serpent et au lotus. Le ser¬ pent, dont Gaston Bachelard a écrit qu'il était « un des plus importants archétypes de l'âme humaine », est volontiers évoqué chez Lawrence. Ici, jailli d'une crevasse dans la section III, il nous est donné comme une métaphore du désir : porteur de mort pour qui tente de le refouler, mais inoffensif pour celui ou celle qui entreprend de vivre son désir. Quant à la fleur du lotus, métaphore de vulve archétypale, elle nous renvoie également aux croyances de l'Egypte antique où le lotus bleu — encore le bleu... — était considéré comme le plus sacré. Dans [7] les der¬ nières lignes de la section III, absentes en [2], nous disent «· l'extase nacrée » dans laquelle, « telle une fleur de lotus » s'épanouit la matrice de Juliet. Le travail d'écriture, non seulement plus long, mais aussi plus élaboré et plus lucide de [7] par rapport à [2] donne à penser que nous avons affaire effect'ivement, non à une soi-disant version « originale * non expurgée, mais à une réécriture. Cette version plus mûrie de » Soleil » est à rapprocher chronologique¬ ment des rédactions successives que Lawrence donne de L'amant de Lady Chatterley, à rapprocher aussi du roman parce que, promu dans [7] à un rôle de premier plan, le paysan sicilien tient dans la nouvelle une place analogue à celle que Mellors occupe dans le roman. Enfin pour ce qui est de la description, la mise en perspective provocatrice des nus, les notations chroma¬ tiques et le décor ont un air de parenté évident avec les tableaux peints par Lawrence de début mars à fin juin 1928 à la Villa M 'irenda près de Florence.