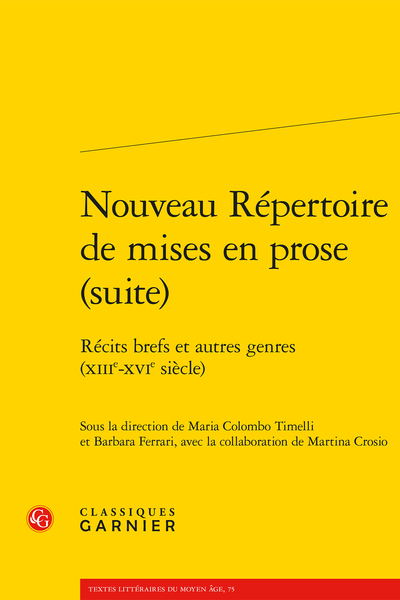
L’erberie
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Nouveau Répertoire de mises en prose (suite). Récits brefs et autres genres (xiiie-xvie siècle)
- Auteur : Crosio (Martina)
- Pages : 91 à 95
- Collection : Textes littéraires du Moyen Âge, n° 75
- Série : Mises en prose, n° 11
- Thème CLIL : 3438 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moyen Age
- EAN : 9782406157960
- ISBN : 978-2-406-15796-0
- ISSN : 2261-0804
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15796-0.p.0091
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 30/04/2024
- Langue : Français
l ’ erberie
(Martina Crosio)
(A) la prose
– auteur : anonyme
– dédicataire : non mentionné
– datation : première moitié du xive siècle. Se basant sur un passage énigmatique, Cifarelli 2017a (p. 11) propose de dater le texte après 1339 ou après 1358. Bendinelli Predelli 1984 est la seule à considérer l’Erberie anonyme antérieure à l’œuvre de Rutebeuf (voir infra).
– manuscrit unique :
Paris, BnF, fr. 19152, f. 89ra-90vc (Gallica). Milieu du xive siècle. Confectionné dans une région du nord de la France impossible à préciser, ce codex en parchemin comporte II + 205 f., numérotés en chiffres arabes, écrits sur trois colonnes (44 lignes) ; 338 x 220 mm. Initiales filigranées alternativement rouges et bleues. Il s’agit d’un grand recueil de textes divers : fabliaux, contes, lais, proverbes et romans. Description détaillée dans Faral 1934.
incipit :« Ci comence l’Erberie. Audafrida fabuli fabula, quant il la bacula sua sor le fossé. “Entre .II. verz, la tierce meüre” dist li vilains, qui ne savoit deviner .XIIII. et .XIIII., ce son .XVII. et puis .III., .XXX., .I. : qui ne set conter, si perde… » (f. 89ra).
explicit : « …Ainsint ven ge mes herbes et mes oignemenz. Ge ne sui pas de çax qui se maudient por lor denrees vendre. Qui vorra si en praigne, qui vorra si le lait. Ne autre foi ne autre soirement que nos vos en avon fait ne vos en ferons nos. Explicit » (f. 90vc).
92E. Faral 1934, Le manuscrit 19152 du fonds français de la Bibliothèque Nationale. Reproduction phototypique, Paris, Droz
Notices en ligne : Archives et manuscrits ; Jonas
– organisation du texte
Titre : L’Erberie (f. 89ra) ; le texte est réparti en 13 paragraphes introduits par des lettrines bleues ou rouges irrégulièrement alternées.
La prose est la transposition libre de l’œuvre de Rutebeuf ; les deux textes offrent la parodie, sur un registre comique, des discours que les bonimenteurs débitent sur les places publiques afin de vendre des remèdes miraculeux. L’Erberie en prose emprunte plusieurs traits à sa source : mêmes motifs narratifs, éventuellement dans un ordre différent ou d’une longueur inégale ; la structure syntaxique et le lexique sont parfois proches. Dans la mise en prose, pourtant, la matière s’enrichit d’éléments comiques étrangers au modèle : une tirade contre les femmes et deux passages construits sur des calembours.
L’Erberie contient des résidus rimiques et métriques tant dans les séquences originairement versifiées que dans les morceaux déjà en prose dans le texte du xiiie siècle. Ces traces de versification ne sont pas un indice de la maladresse du remanieur, mais plutôt le résultat d’un choix délibéré, de l’essai d’un mode d’écriture qui fond les vers dans la prose, dans une écriture qui diffère sensiblement de la prose élégante de Rutebeuf.
Tout comme les sermons religieux, l’introduction s’ouvre par une phrase latinisante, suivie d’un proverbe, d’un calcul mathématique compliqué et d’une plaisanterie misogyne. Viennent ensuite la présentation que le bonimenteur fait de lui-même et l’éloge des vertus curatives de ses remèdes ; cette dernière partie se répète peu après sous une forme plus développée, en devenant le véritable noyau du monologue dramatique. Contrairement à l’opinion de tous les autres spécialistes, Bendinelli Predelli 1984 juge le Dit anonyme antérieur à l’œuvre de Rutebeuf et le considère un véritable boniment auquel le poète champenois se serait inspiré pour sa propre parodie en vers.
Prologue :
Ci comence l’Erberie.Audafrida fabuli fabula, quant il la bacula sua sor le fossé. “Entre .II. verz, la tierce meüre” dist li vilains, qui ne savoit deviner .XIIII. et .XIIII., ce son .XVII. et puis .III., .XXX., .I. : qui ne set 93conter, si perde. Ge vos di, beau seignor, qu’il sont en cest siecle terrien .V. mannieres de choses dont li preudom doit bien croire sa preude feme, s’ele li dit. La premiere chose si est tele que, s’i la met en .I. for tot chaut comme por pain cuire, et il li vegne au devant et li demant : “Bele suer, coment vos est il ?”, s’ele li dit : “Sire, ge n’ai pas froit”, certes il l’en doit bien croire. L’autre enprés si est tele que, s’il la met en .I. sac et il loie bien la bouche, et il la gite desor le pont en l’aive, et il li viegne au devant, et il li demande : “Bele suer, coment vos est il ?”, s’ele li dit : “Certes, sire, ge n’ai pas soif”, il l’en doit bien croire. La tierce aprés si est tele que, se ele travaille d’enfant et il li viegne au devant et li demant : “Bele suer, coment vos est il ?”, se ele li dit : “Certes, sire, ge sui malades”, il l’en doit bien croire que si est ele. La quarte aprés si est tele que, se li preudons vient devant sa preude feme et il li demande : “Dame, que feroiz vos ?” et se ele li respont : “Sire, ge vos corrocerai”, il l’en doit bien croire que si fera ele, se ele puet. La quinte aprés si est tele que, se la preude fame se gist delez son seignor et ele s’est endormie, et ele lait aler ou pet ou vesse, et li preudons la sente et il li dit : “Bele suer, vos vos conchiez toute”, “Par mon chief, sire, fait ele, mais vos”, il l’en doit bien croire, quar si fait ele : el ne se conchie pas, ainz conchie son vilain, si se nestoie, quar ele se delivre de la merde, si l’en aboivre (f. 89ra-b).
Épilogue :
Ge vos di, beau seignor, que s’il n’avoit plus dedenz ceste boiste que les bones paroles et l’erbe qui i est, si devriez vos avoir ferme creance qu’il vos devroit bien faire, et ge la vos monsterrai de par Dieu. Or dites aprés moi : “Benoite soit l’eure que Diex fu nez, et ceste si soit !”, et ge vos monsterrai la dame des herbes. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ceste dame d’erbe, il ne la trest ne griex ne païens ne sarrazins ne crestiens, ainz la traist une beste mue : et tantost come ele est traite, si covient morir cele beste. Cuidiez vos que ge vos giffle ? Ele muert par angoisse de mort. Vos ne savez pas por quoi la dame des herbes est bone, se ge nel vos di ; mais ge le vos dirai. Prenez moi sempres de ceste dame d’erbe, si vos en desgeünez par .VII. jors et par .VII. nuiz, .III. foiz le jor, à geün, et au soir, quant vos irez couchier. Ge di que por tertre avaler ne por tertre monter, ne por fooïr ne por hoer, ne por corre ne por troter, piez ne braz ne vos dieudront, oeil ne vos ploreront, chief ne vos dieura. Por parler à jornee ausint come ge faz, goute feste ne vos pranra, goute migraigne ne vos tenra, ne fis, ne clox, ne clopaire, ne ru d’oreille, ne encombrement de piz, ne avertin de chief, ne dolour de braz, que Diex vos envoit. Ainsint ven ge mes herbes et mes oignemenz. Ge ne sui pas de çax qui se maudient por lor denrees vendre. Qui vorra si en praigne, qui vorra si le lait. Ne autre foi ne autre soirement que nos vos en avon fait ne vos en ferons nos. Explicit (f. 90vb-c).
94(B) la source
Probablement composée en 1271 (mais Zink 1989-1990 propose ca 1265), à l’occasion de la publication, par la Faculté de Médecine de Paris, de dispositions contre ceux qui vendaient au peuple des panacées miraculeuses, l’Herberie de Rutebeuf est une pièce comique qui juxtapose une partie en vers (114 v.) et une en prose. Sa forme métrique est assez particulière : il s’agit de tercets coués, à savoir des groupes de trois vers monorimes, le premier de quatre syllabes, les deux autres de huit.
deux manuscrits (sigles de Zink 1989-1990) : (1) Paris, BnF, fr. 1635, f. 80rb-82ra (selon Arlima, dernier tiers du xiiie siècle ; selon Jonas, xiiie siècle ; sans nom d’auteur) (C) ; (2) Paris, BnF, fr. 24432, f. 33vb-35va (Arlima : 23/04/1345-11/09/1349 ; Jonas : après 1345 ; le nom de Rutebeuf est fourni dans l’incipit et dans l’explicit) (D)
éditions et traductions
M. Méon 1823, Nouveau recueil de fabliaux et contes, des poètes français des xiie, xiiie, xive et xve siècles, Paris, Chasseriau, I, p. 185-191
A. Franklin 1874, Les rues et les cris de Paris au xiiie siècle. Pièces historiques publiées d’après les manuscrits de la Bibliothèque nationale, Paris, Willem et Daffis, p. 165-174
A. Jubinal 1874-1875, Œuvres complètes de Rutebeuf, trouvère du xiiie siècle, nouvelle édition, revue et corrigée, Paris, Daffis, II, p. 51-62
A. Kresser 1885, Rustebuef’s Gedichte. Nach den Handschriften der Pariser National-Bibliothek, Wolfenbüttel, Zwissler, p. 115-120
L. Constans 1906, Chrestomathie de l’ancien français (ixe-xve siècles), précédée d’un tableau sommaire de la littérature française au Moyen Âge et suivie d’un glossaire étymologique détaillé. Troisième édition soigneusement revue, Paris – Leipzig, Welter, p. 119-120 [édition partielle]
E. Faral 1910, Mimes français du xiiie siècle (textes, notices et glossaire), Paris, Honoré Champion, p. 55-59 et 61-68 [texte d’après C]
G. Gassies(des Brulies) 1927, Anthologie du théâtre français du Moyen Âge. Théâtre sérieux : mystères, miracles, moralités des xiie, xiiie, xive et xve siècles, Paris, Delagrave, p. 86-90 [traduction en français moderne uniquement]
A. Pauphilet 1951, Jeux et sapience du Moyen Âge, Paris, Gallimard, p. 202-207
M. Zink 1989-1990, Rutebeuf, Œuvres complètes, Paris, Bordas, II, p. 239-251 [texte avec variantes et traduction en français moderne]
95(C) histoire de la prose
Exception faite d’une adaptation du texte par Legrand d’Aussy au xviiie siècle, l’Erberie en prose n’a connu aucune diffusion ultérieure.
– Bibliothèques du xviii e siècle
P. J.-B. Legrand d ’ Aussy, Fabliaux ou contes, fables et romans du xiie et du xiiie siècle traduits ou extraits d’après divers Manuscrits du tems, Paris, Onfroy, III, 1779, p. 349-355 [l’auteur déclare d’avoir réuni et fondu ensemble deux textes : le Dit anonyme et l’œuvre de Rutebeuf]
(D) bibliographie
(1) éditions
A.-A. Renouard 1829, Fabliaux ou contes, fables et romans du xiieet du xiiie siècle, traduits ou extraits par Legrand d’Aussy. Troisième édition, considérablement augmentée, Paris, Renouard, IV, p. 239-245 ; C.R. : F. Raynouard, Journal des savants, 1830, p. 195-204
A. Jubinal 1874-1875, Œuvres complètes de Rutebeuf, trouvère du xiiie siècle, nouvelle édition, revue et corrigée, Paris, Daffis, III, p. 182-192 ; C.R. : P. Meyer, Romania, 3, 1874, p. 401
E. Faral 1910, Mimes français du xiiie siècle (textes, notices et glossaire), Paris, Honoré Champion, p. 55-59 et 69-76 ; C.R. : A. Jeanroy, Romania, 40, 1911, p. 127-129
E. Faral – J. Bastin 1959-1960, Œuvres complètes de Rutebeuf, II, Paris, Picard, p. 268-271
M. Bendinelli Predelli 1984, « L’Erberie del ms BN fr. 19152 », in Vox Romanica, 43, p. 85-112
(2) bibliographie critique
P. Cifarelli 2017a, « Formes brèves et mise en prose. Le cas des Herberies », in Reinardus, 29, p. 1-15
P. Cifarelli 2017b, « Récits brefs et mise en prose », in Raconter en prose, xive-xvie siècle, Paris, Classiques Garnier, p. 303-324