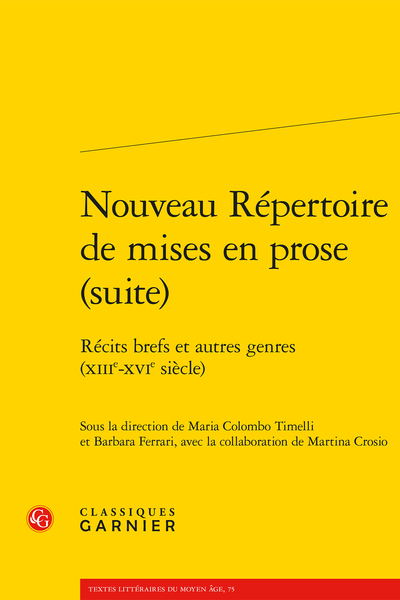
Gérard du Frattre de Jacques Le Gros
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Nouveau Répertoire de mises en prose (suite). Récits brefs et autres genres (xiiie-xvie siècle)
- Auteurs : Suard (François), Lambert (Adélaïde)
- Pages : 495 à 505
- Collection : Textes littéraires du Moyen Âge, n° 75
- Série : Mises en prose, n° 11
- Thème CLIL : 3438 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moyen Age
- EAN : 9782406157960
- ISBN : 978-2-406-15796-0
- ISSN : 2261-0804
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15796-0.p.0495
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 30/04/2024
- Langue : Français
GÉrard du Frattre
de Jacques Le Gros
(François Suard et Adélaïde Lambert)
(A) la prose
– auteur : Jacques Le Gros
– datation : entre 1525 et 1533
– Doutrepont1939, p. 276
– manuscrit unique :
Paris, BnF, fr. 12791 (Gallica). De 1525 à 1548. Papier, 14 f. numérotés en chiffres romains + 236 f. numérotés en chiffres arabes en haut à droite (sans doute par la même main qui a copié le texte de 1 à 228, puis par une main moderne) ; 283 x 200 mm ; 26/37 lignes par page. Deux f. collés au xixe s. font l’inventaire des dix-huit pièces contenues dans le manuscrit proprement dit ; ils se terminent par l’indication : « mss sur papier, volume in folio, mauvaise écriture du 16e siècle ».
Le textede Gérard du Frattre occupe les f. 1 à 228. Les initiales commençant les chapitres et les paragraphes n’ont pas été exécutées. Rubriques en tête de chaque chapitre ; nombreux essais de plume. La figure de Jacques Le Gros est présente tout au long du texte, grâce à diverses marques : sa devise, « Espoir Loyal » (f. 1r, 30r, 81r, 156r, 175v, 228r), son monogramme accompagné par la devise (encadré par les deux mots : f. Xr, 175r, 214v, 228v ; ou non : XIVr, 228v), ou encore son monogramme isolé (f. 214v). Le f. 81r est occupé dans le quart supérieur par la rubrique du chapitre qui raconte le passage du chapeau de Charlemagne relevé par Gérard ; on trouve au-dessous la devise « Espoir Loyal » et un dessin à la plume montrant un cavalier tombant de sa monture, le crâne fendu, son épée brisée gisant à terre.
496Gérard du Frattre est l’œuvre autographe de Jacques Le Gros, un marchand de soie parisien, dont les affaires permettent progressivement de grimper dans l’échelle sociale : devenu un bourgeois influent à la moitié de sa vie, il est en contact avec des notables du Parlement de Paris mais également avec des éditeurs-libraires et des auteurs en vue comme Herberay des Essarts et Jean Maugin. Il pourrait également être l’auteur du Gérard d’Euphrate imprimé en 1549 →, qui constituerait un prequel du Gérard du Frattre manuscrit. L’imprimé est en effet centré sur l’enfance de Gérard et composé dans le style des Amadis.
Outre Gérard du Frattre, le manuscrit contient une collection de pièces plus courtes de genres divers, transcrites par Jacques Le Gros entre 1525 et 1548 d’après les datations qu’il précise pour la copie de quelques-unes. Parmi ces documents se trouve l’inventaire des livres de l’auteur (f. Ir-IIv), dressé par lui-même en 1533 (articles 1 à 66) et qu’il a complété après 1542 (articles 67 à 103). Cette liste mentionne un livre intitulé Gérard du Frattre (f. IIr, col. 1), dont on ne sait s’il était manuscrit ou imprimé. Le manuscrit présente également la table (Vv-Xr) reprenant les rubriques de 80 chapitres de Gérard du Frattre, une permission (f. IIIv), quatre prophéties (IVr-Vr ; XIr ; XIIv-XIIIv ; 236r), deux pasquinades (Xv ; 230v-233v), un placard (229v-230r), une lettre (234r-235v), deux poèmes d’escorte (228v ; 229r) et, enfin, deux douzains de Robert Cusson, fatiste du roi, adressés à Jacques Le Gros, fils de notre auteur, à l’occasion de son mariage (f. XIv).
Le f. XIVr, qui précède le texte de la prose, présente le monogramme de J. Le Gros, qui reprend sa devise, « Espoir Loyal » (un « e » se terminant par une haste cruciforme, auquel est accolé un « R »), puis la devise elle-même, avec au-dessous la date de 1525, puis la formule « omnia principia dificilia, Jhesus Maria Joseph », « Audiens sapiens erit », et « proverbiorum primus ». Au f. XIIr, on trouve les armes de Jacques Le Gros et de Katherine Du Hamel, qu’il a épousée en 1525 ; au f. XIVv, un arbre aux branches duquel sont suspendues les armes de France, au-dessous celles de J. Le Gros à gauche et son monogramme à droite. Sa devise entoure le tronc de l’arbre, au pied duquel figurent à gauche un cygne lové autour d’une croix, allusion à l’enseigne de sa résidence parisienne, rue Neuve-Notre-Dame, « Au cygne de la croix », avec la formule « in hoc signo vinces », à gauche les armes de Katherine Du Hamel.
Notices en ligne : Archives et Manuscrits ; Jonas
497– organisation du texte
Pas de titre précédant le texte de la prose ; à partir du f. 2r, titre courant au recto de chaque feuillet : « De Gerard du Frattre » ; des mots jugés trop abrégés ou trop peu lisibles sont régulièrement réécrits ; le manuscrit semble ainsi préparé pour l’impression.
Nombreuses insertions lyriques aux f. 4v, 6r, 15r, 30r-31r (4 insertions formant une petite ballade), 52v, 56v-57v, 58r, 88v, 93v-94r, 104v (2 insertions), 117v, 118r-118v (4 insertions formant une petite ballade), 130v, 135r, 140v, 156r-v (2 insertions), 167r-v, 167v-168r, 175r-v, 185v, 191v (5 insertions), 214r-v, 215r-v. Les poésies offrent une grande variété formelle et s’inscrivent dans la tradition de la Grande Rhétorique et des poètes du xve siècle. Jacques Le Gros en a « signé » cinq à l’aide d’un acrostiche.
Malgré son caractère composite, Gérard du Frattre se caractérise par une grande cohésion d’ensemble : les insertions poétiques et les légendes compilées s’enchaînent harmonieusement dans le continuum de la narration.
Prologue :
Jhesus, restaurateur de l’humain genre, environ l’an sept cens quarante deux aprés sa tresdouloureuse mort et Passion, pour obvier aux futurs inconveniens et subvenir a la saincte religion crestienne, par sa pitié et misericorde preeslut les trois gestes galicanes, c’est assavoir trois lignees en la nacion de France, lesquelles il exalta singulierement entre aultres generacions et corobora de la grace du Sainct Paraclit, leur exibant pouoir et privilege especial sur tout l’universel. Car d’icelles sont issus les tresrenommés et ilustres triomphateurs, princes, magnattes et militateurs, chevaliers de l’Eglise chatolicque soubz la protection desquelz la saincte foy de Nostre Redempteur Jhesus a flory et pululé, et jusques aujourd’huy florit, croist et mul[ti]plie en habondance de glorieuse renommee et vertu. Car par leurs proesses et forces chevalleureuses et triumphantes victoires par iceulx obtenues sur les anciens ennemis de nostre foy, ilz ont non seullement dechassés les infidelles Juifz du regne d’Israel, mais d’habondant les idolattres payens, sarazins et mecreans mahommistes expulsés des païs de Frise, Hespaigne, Jherusalem, Esclavonnie, des Allemaignes et une partie d’Affricque et Saixonne ; ont reduit a la vraie lumiere de salut iceux regnes dessus mencionnés avec plusieurs aultres terres, provinces, païs et regions dont, et pour plus facillement entendre que furent icelles gestes et les princes chevaliers de leur posterité qui tant surhaulcerent nostre foy crestienne, moyennent l’ayde du Redempteur Jhesus Crist, je en descripray partie en brief.
498A la louenge tressaincte, gloire infinie et infailible exaltacion de l’individue et inseparable Trinité, le tressacré, tressainct et tres benist non de la quelle, au commencement de parvulle et trespetit opusculle, est par moy indigne humblement invocqué, sans oublier la tressacree et immaculee Vierge et Genitrice de la seconde personne d’icelle trine Divinité, Marie, Souveraine, grande Tresoriere et Regente de l’empire celestielle et terrienne, et generallement de tous les benoistz sainctz et sainctes de Paradis.
Il est a notter, selon ce que dit le treseloquent historiographe Turpin, chancellier imperial, legat apostolicque et archevesque de Rains, per de France, que trois princes ilustres furent en l’an .vii..c. sept ou environ, nez en une nuit, une heure et mesme instance, a la nativité desquelz furent veuz plusieurs signes et prodiges de grant signiffiance, entre lesquelz trois beaux abres verdoyans, d’estrange et incongnue nature, portans fueilles et fruit furent procreés en l’instance de leur nativité aux trois pallais de leurs geniteurs, qui fut chose de haulte et ardue admiracion. Lesquelz peres d’iceux enfans, advertis par leurs messaiges et explorateurs d’icelluy cas de tant nouvelle admiracion, assemblerent en ung certain lieu gens doctes, saiges et de saincte vie, qui aprés longue et mure deliberacion, par revelacion du Sainct Esprit, predirent iceulx enffans aporter gros fruit en la Crestienté, dont les bons princes furent grandement esjouis et consollés, et rendirent louenges au Createur de la grace qu’il leur avoit faict et a leurs trois beaux enffans quant il les avoit sanctiffiés dés le ventre de leurs meres (f. 1r-v).
Épilogue :
Icy laisse le treschatolicque archevesque de Rains Turpin, grant chancellier imperial, les gestes du duc Gerard du Frattre et de ses enffans, et insculpe en sa cronicque l’oultrecuydance de Barthelot, nepveu de l’empereur, et comme Regnault le occit, les grant [sic] debatz et guerres qui en sourdirent et finablement l’histoire d’icelluy noble chevalier Regnault, surnommé de Montauban, qui moult est belle et plaisante. La quelle, combien que aulchuns saiges acteurs ayent mise en avant, je redigeray selon le vray, en plus ample maniere, car, l’honneur saulve a tous, cil qui l’a escripte n’a faict que passer par dessus, sy Dieu Nostre Seigneur m’en doient la grace, sans le quel on ne peult rien, juste ce que dit sainct Jehan en son premier chappitre ‘et sine ipso factum est nichil’, le quel je deprie humblement nous donner son heritage a nous promise. Espoir Loyal. Telos [en caractères grecs] (f. 228r).
La compilation, placée sous le patronage de l’archevêque Turpin, propose une mise en prose de Fierabras (f. 1r-26r), suivie de celle d’Aspremont (f. 26r-93r), puis d’une version du Pèlerinage de Charlemagne à Saint-Jacques-de-Compostelle (f. 93r-106r) et à Jérusalem (f. 106r-228r). À la fin de son œuvre, le prosateur déclare que son modèle, Turpin, « laisse les gestes du duc Gerard du Frattre et de ses enfans » et traite 499maintenant de l’histoire de « Regnault surnommé de Montauban » (f. 228r), histoire qu’il va rédiger à son tour car « cil qui l’a escripte n’a faict que passer par dessus ».
Gérard du Frattre manifeste en effet une nette perspective cyclique, en mêlant à des récits faisant partie de la geste du Roi (Fierabras, Aspremont, les Pèlerinages) les exploits des descendants de Doon de Mayence. Dans Fierabras et dans Aspremont, Regnault de Dordonne joue un rôle important tandis qu’Ogier devient une figure essentielle du Pèlerinage à Jérusalem. Le remanieur connaît par ailleurs de nombreux épisodes de la légende d’Ogier le Danois, notamment celui de la lâcheté d’Alori. Il n’est donc pas surprenant, après qu’il a conté les exploits d’Ogier, de lui voir annoncer une suite consacrée à Regnault. On notera que le nom donné au héros est proche de Girart d’Eufrate, nom que l’on trouve dans certains manuscrits de la chansond’Aspremont.
L’ouvrage n’a donc pas pour sujet unique l’histoire de Gérard et de ses fils ; le vassal impétueux joue cependant un rôle important dans la partie Aspremont, rôle qui devient plus épisodique dans le Pèlerinage à Jérusalem, puisqu’il refuse de se porter au secours de l’empereur, tandis que ses enfants, et notamment Milon d’Auvergne, son fils bâtard, interviennent dans cette dernière partie. Par ailleurs, le prosateur connaît la fin terrible du rebelle, telle qu’on la trouve dans le Myreur des Histors → (il s’arrache le cœur après avoir été blessé par Ogier).
Ce qui l’intéresse, c’est une sorte de fresque épique dont il fixe le début avec l’histoire de Fierabras – où Gérard n’intervient pas –, cause de l’attaque menée dans Aspremont, du fait de la mort de Ballant, par les Sarrasins Angoullant (Agolant) et Yaumont (Aumont). À la fin de cette séquence Gérard se révolte contre Charlemagne. Le Pèlerinage est lié à cette révolte, dans la mesure où l’empereur, plongé dans la tristesse, décide de partir à Jérusalem. Au cours de cette partie, Gérard poursuit ses néfastes projets, mais Milon d’Auvergne vient au secours de son suzerain. Cependant, et contrairement au Myreur, la prose ne conte ni le secours apporté par Charlemagne à Gérard, assiégé par les Sarrasins dans Orbendas, ni la guerre entre vassal et suzerain, qui se termine par la mort du rebelle.
Le patronage accordé à Turpin s’explique par l’influence sensible de la célèbre chronique, dans la mesure où, par exemple, l’action de la partie Aspremont s’insère dans le cadre d’une conquête complète de l’Espagne ; il est également un gage de l’authenticité du récit.
500Sur le plan stylistique, la caractéristique majeure est la présence fréquente d’une écriture humaniste et l’insertion de nombreux passages lyriques qui interviennent à l’occasion de discours rapportés marqués par une certaine solennité, qu’ils soient individuels ou collectifs. Par ailleurs, Gérard du Frattre se situe à la limite entre les « anciens » et les « nouveaux romans » du xvie siècle : un lexique et des structures syntaxiques anciennes côtoient de nombreux néologismes et latinismes ainsi que des figures mythologiques. Le texte possède d’ailleurs un lexique riche et il incarne par plusieurs aspects le renouveau que connaît le roman chevaleresque dans le courant des années 1530-1540.
(a) partie Fierabras
Les deux premiers tiers de l’intrigue telle qu’elle est rapportée dans la Chanson du xiie siècle sont brièvement résumés « comme il est narré en plusieurs volumes » et la part du roman réservée à Fierabras est par ailleurs très réduite (6 chapitres sur 80). Elle commence sans transition par une cour tenue par Charlemagne à Paris afin de porter secours à Olivier qui, après sa victoire sur Fierabras, est retenu prisonnier avec les pairs de France en Espagne. La prose diffère considérablement des données de la chanson du xiie siècle : le rôle de Fierabras est très effacé, l’importance des diableries sarrasines est développée, ainsi que le rôle de Renier de Gennes, de Regnault de Dordonne – dont on conte ici les enfances – et d’Ogier ; les scènes de délibération prennent le pas sur les scènes d’action. Le passage se termine par la mort de Ballant (tué par Ogier) et le baptême de Florippes, ainsi que par les louanges adressées aux plus vaillants chrétiens, notamment Regnault de Dordonne, louanges que Turpin « mist en son rolle par ordre, comme en plusieurs volumes sont amplement contenues et specifiez » (f. 26r).
(b) partie Aspremont
Plus développée que la précédente (19 chapitres), elle offre avec la chanson du xiie siècle d’importantes différences. La formule initiale peut laisser supposer que le lien avec Fierabras a quelque chose d’arbitraire : « Yl est vraysemblable que pour lors regnoit en la grant cité de Mesques ung geant oultrecuydé, fier et orguilleux oultre mesure nommé Yamont, filz du geant Angoullant d’Affricque » (f. 26r). Du reste, autre lien arbitraire, Yamont est informé de la défaite et de la mort de Ballant par Sinagon, qui a recueilli sur son navire des Sarrasins échappés au carnage. L’action 501se déroule en Espagne, et non en Calabre ; Roland possède déjà l’épée Durendal, et l’importance respective des chefs sarrasins est inversée : Angoullant est tué au début du récit, en préambule à la grande bataille, et c’est Yamont qui, du côté païen, est le grand adversaire des chrétiens. L’ensemble du récit est rapporté à l’histoire de la conquête de l’Espagne, comme dans le Pseudo-Turpin, et se termine par l’instauration du privilège de l’église de Saint-Jacques. Gérard, après la victoire sur les Sarrasins, se révolte bien contre Charlemagne, mais il se comporte au départ comme un personnage pieux (c’est parce qu’il se rend en pèlerinage à Compostelle qu’il est amené à venir en aide à l’empereur) et comme un vassal fidèle. Enfin l’aspect cyclique de la prose est confirmé par le rôle éminent que continue à jouer Renaud : c’est lui, notamment, qui tue Angollant ; en revanche, c’est Roland qui, comme dans la chanson, tue Yamont.
(c) partie Pèlerinage
Elle comporte deux étapes. L’une, très brève (chapitres 26 à 30) raconte le pèlerinage de Charlemagne à Saint-Jacques de Compostelle. Après une transition de trois chapitres (31-33) dans laquelle on voit notamment Gérard refuser l’hommage à Charlemagne, commence la partie la plus développée de la prose (49 chapitres, 34 à 81), qui ne doit rien, si ce n’est le motif du pèlerinage, à la chanson du xiie siècle qui raconte le voyage de Charlemagne à Jérusalem et à Constantinople. Elle est en revanche proche pour une large part du texte présent dans le Myreur des Histors →, ce qui suppose un modèle commun. Après avoir tenu une cour à Laon, au cours de laquelle s’illustre Renaud et où Gérard se révolte contre l’empereur, Charlemagne part pour Jérusalem après avoir laissé la régence du royaume à Renier de Gennes, assisté d’Aymon de Dordonne. Il passe par la Lombardie où sa troupe, et notamment Renaud et Ogier, connaît des aventures merveilleuses : lutte contre le géant Carnios que tue Renaud, combats livrés et remportés par Ogier dans le château du géant. Charlemagne rencontre ensuite le pape Milon, puis reçoit à Jérusalem la relique de Pierre le Mineur. Sur le chemin du retour, les chrétiens sont assaillis en mer et capturés par Sinagon de Palerme : seul Milon d’Auvergne, qui a accompagné son suzerain alors que le rebelle était retourné à Orbendas, peut s’échapper. Il demande en vain de l’aide à son père afin de délivrer Charlemagne et les siens, mais en trouve auprès des régents du royaume, qui lèvent une armée de secours. Une grande bataille voit la victoire des chrétiens et la réalisation 502de plusieurs projets amoureux : la belle sarrasine Gracienne est baptisée et épouse Ogier, dont elle aura une fille, nommée elle aussi Gracienne, mais elle meurt quelques jours après avoir accouché ; Flesglentine de son côté épouse Estou, fils de d’Eudon de Langres.
Cette partie propose, autour du thème du pèlerinage, des aventures nombreuses, de nature très diverse : tournois, aventures fantastiques, aventures amoureuses, dont les héros sont Ogier et à un moindre degré Renaud et Milon. Ce dernier est présenté comme un chevalier loyal, vigoureusement opposé à son père Gérard.
(B) les sources
On connaît trois proses françaises rapportant l’histoire de Gérard, vassal rebelle de Charlemagne : celle du Myreur des Histors de Jean d’Outremeuse →, où le héros porte le nom de Gerart del Fraite ; celle de notre ms Paris, BnF, fr. 12791, où il s’agit de Gérard du Frattre ; celle de l’Histoire et ancienne chronique de Gérard d’Euphrate (Gérard d’Euphrate →).
La partie Fierabras et l’épisode du Pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle se rapprochent de l’Histoire de Charlemagne ou Conqueste du grant roy Charlemaigne des Espagnes de Jean Bagnyon, avec laquelle Gérard du Frattre peut avoir un modèle en commun, à moins de suivre un modèle issu de l’œuvre de Bagnyon.
Pour ce qui concerne Aspremont,aucune prose autonome ne dérime la chanson de geste de la fin du xiie siècle. Ce récit d’une victoire remportée par Charlemagne en Calabre sur les Sarrasins Aumont et son père Agolant, et qui rapporte les circonstances dans lesquelles Roland sauve la vie de son oncle et conquiert ses propres emblèmes (son épée Durendal, son olifant et son cheval Veillantif), a toutefois suffisamment marqué les esprits pour que deux compilations intègrent cette histoire, avec des modifications plus ou moins importantes : les Chroniques et Conquêtes de Charlemagne → et le Gérard du Frattre →. Cette version, très différente de la prose fidèle de David Aubert, abrège nettement les données du modèle en vers et ne laisse pas apercevoir sous quelle forme il a pu en avoir connaissance.
Pour la partie Pèlerinageà Jérusalem, la proximité entre Gérard du Frattre et le Myreur des Histors → est évidente et permet de postuler un modèle commun. Toute la trame du Myreur se retrouve en effet dans Gérard ; 503le texte de Jacques Le Gros est toutefois considérablement développé par rapport à la chronique liégeoise, soit que celle-ci ait abrégé son modèle, soit que l’auteur de Gérard l’ait augmenté d’aventures multiples, conformément à la perspective cyclique déjà présente dans la chronique liégeoise où se mêlent les aventures d’Ogier et de Renaud à celles de Charlemagne et de Gérard.
La source de la prose est attribuée au « treschatolicque archevesque Turpin » que Jacques Le Gros prétend mettre au net et spécifier. En effet, les chansons de geste qui nous sont parvenues (Fierabras, Aspremont, Le Voyage de Charlemagne à Jérusalem) et dont l’action ne correspond que très partiellement aux trois grandes séquences de la prose, ne sauraient être sa source directe, tant les différences sont importantes. Le seul élément sur lequel nous pouvons nous appuyer est l’utilisation par le prosateur et par Jean d’Outremeuse d’un modèle commun pour la partie Pèlerinage, modèle antérieur par conséquent à la fin du xive siècle, qui pouvait être attribué à Turpin dans le ms fr. 12791 (ce que ne confirme pas la version du prosateur liégeois), en raison de la célébrité de la Chronique. Ce modèle pouvait lui-même remonter à une version remaniée de la Chanson d’Aspremont.
La partie Pèlerinage faisait-elle suite à la partie Aspremont ? La chose est vraisemblable puisque la rébellion de Gérard est présente dans la compilation de Jacques Le Gros comme dans le Myreur. La « récupération » de Fierabras pourrait être due en revanche à l’invention du prosateur. En tout cas, celui-ci reconnaît au début de son ouvrage la pluralité des matières traitées par son modèle à propos de « Gerard du Frattre […] duquel ce present volume porte le non. Et combien que de plusieurs aultes belles et plaisantes matieres soit aorné, toutesfois s’adonne nostre aucteur Turpin plus sur luy que sur aultres. Car pour ses faictz merveilleux a voullu et luy a reservé ceste presente cronicque, laquelle a l’aide du speculateur des actes humains je specifirai et metteray au net selon mon simple et rude ente[n]dement pour estre exibé a tous nobles lecteurs » (f. 2r).
On peut considérer Gérard du Frattre comme « un cycle dans un cycle ». La cohérence cyclique de l’ensemble repose en effet sur la création de liens de parenté entre les héros chrétiens des quatre fictions et entre leurs ennemis païens. Mais, au-delà de l’intrigue elle-même, des anticipations et des épisodes orphelins, dont Gérard du Frattre rapporte le début sans 504raconter la fin, trouvent des prolongements dans le Myreur des Histors →. Le roman de Jacques Le Gros passe ainsi pour le premier élément d’une saga familiale focalisée sur les descendants de Doon de Mayence.
Se pose également la question du Gérard du Frattre figurant dans la Bibliothèque de Jacques Le Gros dans l’inventaire daté de 1533. L. Delisle avait déjà reconnu qu’un certain nombre de titres font partie d’un ajout postérieur : les Angoisses douloureuses d’Elisenne de Crenne par exemple n’ont été éditées qu’en 1538. Par ailleurs la plupart des ouvrages figurant dans l’inventaire sont des livres imprimés ; il n’en va pas ainsi de notre Gérard, puisque la première édition correspondant à un tel titre, sinon à son contenu, est de 1549. Le titre figurant dans l’inventaire correspond donc très vraisemblablement au Gérard figurant plus loin dans le ms fr. 12791, manuscrit qui, comme l’inventaire, a été copié par Jacques Le Gros lui-même ou sur ses indications (Cooper 2012a, p. 28-29).
(C) histoire de la prose
La presque totalité du premier chapitre de l’Ancienne Chronique de Gérard d’Euphrate imprimée en 1549 est très proche de celui de la prose manuscrite. L’intrigue de Gérard d’Euphrate elle-même se présente comme une continuation analeptique ou un prequel de l’histoire narrée dans Gérard du Frattre et l’imprimé contient de nombreuses références à des épisodes évoqués dans le manuscrit de Jacques Le Gros.
(D) bibliographie
(1) édition
A. Lambert 2021, Gerard du Frattre de Jacques Le Gros (ms. Paris, BnF fr. 12791). Édition et étude d’une compilation épique du xvie siècle, Thèse sous la dir. de N. Henrard, Université de Liège
(2) bibliographie critique
L. Delisle 1896, « Documents parisiens de la Bibliothèque de Berne. I Livre de raison de Jacques Le Gros ; Note additionnelle. Manuscrit de Jacques Le Gros », in Mémoires de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île de France, XXIII, p. 225-247 et 291-296
505R. Louis 1947, « La chanson de geste de Girart de Fraite », in Girart, comte de Vienne, dans les chansons de geste : Girart de Vienne, Girart de Fraite, Girart de Roussillon, Première partie, Auxerre, Imprimerie moderne, p. 115-176
F. Suard 1991, « La légende de Gérart de Fraite en français du xive au xvie siècle », in Rhétorique et mise en prose au xve siècle, Milano, Vita e Pensiero, p. 139-172 [repris in Chanson de geste et tradition épique en France au Moyen Âge, Caen, Paradigme, 1994, p. 416-448]
G. A. Runnals 2000, « Le Livre de raison de Jacques le Gros et le Mystère de la Passion joué à Paris en 1539 », in Romania, 118, p. 138-193
F. Suard 2003, « Fierabras dans trois proses françaises », in Le rayonnement de Fierabras dans la littérature européenne, Lyon, CEDIC, p. 157-176 (p. 170-176)
F. Suard 2004, « Aspremont aux xve et xvie siècles », in L’Analisi Linguistica e Letteraria, 12, p. 425-453 (p. 435-453)
R. Cooper 2012a, Le premier livre de l’histoire et ancienne chronique de Gerard d’Euphrate, Duc de Bourgogne, Paris, Classiques Garnier, p. 28-30
R. Cooper 2012b, « Roman, histoire, nationalisme : le cas antihéroïque de Gérard d’Euphrate », in Le Roman à la Renaissance, Lyon, RHR (en ligne)
A. Lambert 2018a, « Pratiques d’écriture d’un bourgeois de Paris au xvie siècle. Deux livres de Jacques Le Gros (Paris, BnF, fr. 12791 ; Berne, BU, MUE Bong VI 221) », in Le moyen français, 83, p. 121-138
A. Lambert 2018b, « Des vieux romans aux Amadis. Rhétorique de l’exploit guerrier dans le manuscrit Gerard du Frattre et l’imprimé Gerard d’Euphrate », in Bien dire et bien aprandre, 33, p. 23-36
A. Lambert 2020, « Les insertions versifiées dans les mises en prose épiques et romanesques », in Le moyen français, 86, p. 27-49