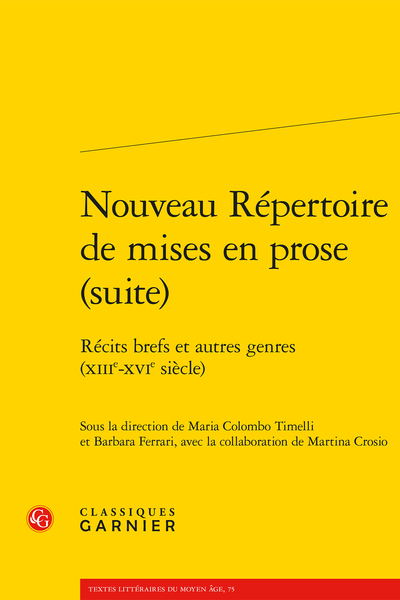
Conception nostre Dame
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Nouveau Répertoire de mises en prose (suite). Récits brefs et autres genres (xiiie-xvie siècle)
- Auteur : Ferrari (Barbara)
- Pages : 59 à 65
- Collection : Textes littéraires du Moyen Âge, n° 75
- Série : Mises en prose, n° 11
- Thème CLIL : 3438 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moyen Age
- EAN : 9782406157960
- ISBN : 978-2-406-15796-0
- ISSN : 2261-0804
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15796-0.p.0059
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 30/04/2024
- Langue : Français
Conception nostre Dame
(Barbara Ferrari)
(A) la prose
– auteur : anonyme
– dédicataire : non mentionné
– datation : ante début du xive s. (date du ms le plus ancien)
– trois manuscrits (sigles de B. Ferrari) :
(1) Paris, BnF, fr. 413 (P1, Gallica) ; f. 365rb-365va. Fin du xive ou début du xve s. Parchemin ; 453 f. (456 f. selon la foliotation ancienne ; trois f. ont été perdus) ; 333 x 250 mm ; deux colonnes de 42/44 lignes. Chaque texte est introduit par un titre rubriqué, une miniature ou une initiale historiée ; à partir du f. 157r, celles-ci ont été remplacées par des initiales ornées.
Sur le verso du dernier feuillet de garde, parmi de nombreux essais de plume d’une main du xve s., on lit : « A mon treschier et tresamé frere Jehan de Loraine » ; selon Ingallinella 2017-2018 (p. 60), il s’agirait du début d’une lettre adressée à Jean II d’Anjou, duc de Lorraine (Nancy 1425 – Barcelone 1470), par l’un de ses frères ou de ses sœurs, propriétaires du manuscrit (sans doute Yolande d’Anjou qui vivait à Nancy au milieu du xve siècle).
Légendier méthodique de 121 articles, formant avec le ms 2 ci-dessous le groupe F de Meyer 1906. 16 pièces sont tirées de la traduction de Jean de Vignay de la Legenda aurea. La Conception Nostre Dame est le premier d’une série de chapitres correspondant aux fêtes mariales (Annonciation, Purification Nostre Dame, Assomption Nostre Dame), suivis de la section des vies des saintes. En réalité, sous le titre De la Concepcion de la Vierge Marie (f. 364ra), deux textes sont réunis : la Nativité Nostre 60Dame (f. 364ra-365rb), tirée de la traduction française de l’Abbreviatio in gestis et miraculis sanctorum de Jean de Mailly (Meyer 1899, p. 54), et notre mise en prose, dont le début n’est signalé que par une lettrine filigranée de 3 UR ; l’explicit aussi (cf. infra)fait mention de la seule Conception. Trois autres mises en prose font partie du recueil : la Vie de saint Jean-Baptiste →, la Vie desaint Julien l’Hospitalier → et la Vie de sainte Geneviève→.
titre : « De la Concepcion de la Vierge Marie » (f. 364ra)
incipit : « Le roy Heraus d’Angleterre mut jadis grans guerres en Normandie contre le duc Guillaume et contre l’autre peuple » (f. 365rb).
explicit : « Et anonça l’angre a l’abbé que quiconques la Concepcion celebroit en l’onneur de Nostre Dame Saincte Marie auroit remission de ses pechiez et ne mourroit ja desconfés. Explicit une hystoire de la Concepcion Nostre Dame saincte Marie » (f. 365va).
P. Meyer 1899, « Notice sur un légendier français du xiiie siècle classé selon l’ordre de l’année liturgique », in Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres Bibliothèques,36/1, p. 1-69 (p. 54)
P. Meyer 1906, « Légendes hagiographiques en français. II. Légendes en prose », in Histoire Littéraire de la France, 33, p. 378-458 (p. 424-425)
Collet – Messerli 2008, p. 207-209
L. Ingallinella 2017-2018, La Storia aurea volgarizzata da Giovanni Chierici (Firenze, Bibl. Ricc. 1390) e la tradizione del Légendier français en prose, Tesi di perfezionamento della Scuola Normale Superiore di Pisa, dir. C. Ciociola, p. 59-60
Notices en ligne : Archives et Manuscrits ; Jonas
(2) Paris, BnF, fr. 23117 (P2, Gallica) ; f. 402rb-vb. Fin du xiiie s., f. 1-35, 42-227 ; commencement du xive s., f. 36-41 (Vie de saint Jean-Baptiste)et228-481 ; selon Collet – Messerli 2008 (p. 207-208), il s’agirait quand même d’un recueil organique, réalisé au début du xive s. dans un atelier disposant de plusieurs scribes et décorateurs. Parchemin ; 485 f. ; 325 x 220 mm ; deux colonnes de 40 lignes (une colonne pour la Vie de saint Quintin en vers, cf. infra). Table du xve s. en tête du volume ; vers la fin du manuscrit (f. 481v-482r), se trouve une autre table, rédigée en latin par le bibliothécaire Claude de Grandrue au début du xvie s. (Ouy 1999), qui signale la table initiale. Les œuvres sont introduites le 61plus souvent par une miniature et une initiale ornée jusqu’au f. 227, par une initiale filigranée à partir du f. 228.
Légendier méthodique de 102 articles, formant avec le ms 1 ci-dessus le groupe F de Meyer 1906 ; à la différence de celui-ci, il ne contient pas les chapitres de la Légende dorée. Deux séries de légendes en prose sont séparées par la Vie de saint Quintin en quatrains d’alexandrins (f. 228r-237r). Les Vies desaint Jean-Baptiste, de saint Sebastien et le Traité de l’Antéchrist ont été copiés deux fois, ce qui prouverait que le compilateur avait à sa disposition deux modèles différents. Dans ce manuscrit la Conception Nostre Dame est précédée de l’Assomption Nostre Dame (traduction du Transitus du Pseudo-Méliton, même version que dans le ms 1 ; cf. Ruini 2011, p. 345) et suivie des Vies de Marie-Madeleine, deMarie l’Égyptienne et des saintes vierges. Trois autres mises en prose font partie du recueil : la Vie de saint Jean-Baptiste →, la Vie de saint Julien l’Hospitalier → et la Vie de sainte Geneviève →.
Le manuscrit provient de la bibliothèque de Saint-Victor, où il était conservé depuis le xive s. au moins, comme le prouvent les deux mentions copiées dans la marge inférieure des f. 1r et 42r dans une écriture livresque soignée : « Iste liber est Sancti Victoris Parisiensis quicumque eum furatus fuerit vel celaverit vel titulum istum deleverit anathema sit. Amen ». Anciennes signatures à la fin des formules citées et sur le deuxième f. de garde. Au f. 1v, à l’encre rouge, la devise « Jhesus, Maria, sanctus Victor, sanctus Augustinus » accompagnée du blason de l’Abbaye.
titre : « Ci commence l’ystoire de la Concepcion Nostre Dame » (f. 402rb)
incipit : « Le roy Heraus d’Angleterre mut jadis granz guerres en Normandie contre le duc Guillaume et contre l’autre peuple » (f. 402rb).
explicit : « Et anonça l’angre a l’abbé que quiconques la Concepcion celebreroit en l’onur de la Vierge Marie aroit remission de ses pechez et ne mourroit ja desconfés » (f. 402vb).
P. Meyer 1906, « Légendes hagiographiques en français. II. Légendes en prose », in Histoire Littéraire de la France, 33, p. 378-458 (p. 424-425)
G. Ouy 1999, Les manuscrits de l’Abbaye de Saint-Victor. Catalogue établi sur la base du répertoire de Claude de Grandrue (1514), Turnhout, Brepols, II, p. 423-424
Collet – Messerli 2008, p. 207-209
Notices en ligne : Archives et Manuscrits ; Jonas
62(3) Paris, BnF, fr. 24433 (P3, Gallica) ; f. 95r-v. Ce volume est composé de cinq unités codicologiques, copiées entre la fin du xive et le premier quart du xve s., réunies sans doute vers la fin du xve s. (Ouy 1999, p. 419). Parchemin et papier ; 192 f. ; 295 x 210 mm ; plusieurs mains ; textes copiés à longues lignes et sur deux colonnes (52 lignes). Chaque section est séparée de la suivante par un feuillet blanc ; sur le premier (f. 50r), table en latin de Claude de Grandrue (Ouy 1999). Anciennes gardes en parchemin contenant un fragment des Grandes Chroniques de France relatif au règne de saint Louis (f. i-ii, 191r-192v). Au f. 1r, miniature en grisaille (songe de Daniel).
Ce recueil contient surtout des textes de piété : le Decacornon, traité sur les Dix commandements, est suivi d’une section comprenant divers morceaux consacrés à Jésus et Marie, tirés pour la plupart de la Légende dorée de Jean de Vignay. La Conception est copiée entre la Pentecôte et la Nativité de la Vierge (traduite de la Legenda aurea). Ce manuscrit contient aussi la seule copie de la Vie et miracles de saint Pierre Célestin et une Chronique universelle composée à Valenciennes sous le règne de Philippe le Bel (texte incomplet, s’arrêtant à 1290).
Le volume provient de la bibliothèque de Saint-Victor où il figure dans l’inventaire de 1513 ; mention d’une main du xve s. dans la marge inférieure du f. 1r : « Iste liber est Sancti Victoris Parisiensis. Sainct Victor ». Au f. 191v, note de l’ancien possesseur, Perrin Hausselet, frère d’André Hausselet, prieur de Saint-Victor en 1474 et prédécesseur du bibliothécaire Claude de Grandrue (Ouy 1999).
titre : « Cy aprés s’ensuit ung tres notable miracle : comment la Concepcion de la glorieuse Vierge Marie fut ordonnee a solempniser » (f. 95r)
incipit : « Le roy Heraus d’Angleterre mut jadis grant guerres en Normandie contre le duc Guillaume et contre l’autre peuple » (f. 95r).
explicit : « Et anonça l’angre a l’abbé que quiconques la Concepcion celebreroit en l’onneur de la Viarge [sic]Marie aroit remission de ses pechiés et ne mouroit ja desconfés. Amen » (f. 95v).
G. Ouy 1999, Les manuscrits de l’Abbaye de Saint-Victor. Catalogue établi sur la base du répertoire de Claude de Grandrue (1514), Turnhout, Brepols, II, p. 418-419
Notices en ligne : Archives et Manuscrits ; Jonas
63– organisation du texte
En décrivant les manuscrits du légendier F, Paul Meyer avait reconnu dans le court texte intitulé La Concepcion Nostre Dame (ms 2 ci-dessus)la mise en prose du poème de Wace, sans préciser toutefois que la réécriture ne concerne que la première section de l’œuvre (Meyer 1906, p. 425). C’est le titre du ms 3 qui introduit le mieux le contenu de la mise en prose : Cy aprés s’ensuit ung tres notable miracle : comment la Concepcion de la glorieuse Vierge Marie fut ordonnee a solempniser ; les 180 premiers vers du poème, en effet, narrent l’institution de la fête de l’Immaculée Conception par le moine anglais Hersin, sauvé miraculeusement d’un naufrage, alors que la suite concerne la vie de la Vierge, de sa conception à son assomption. Selon Ruini, cette structure est fonctionnelle à la promotion du culte immaculiste de la part de Wace, puisque le récit de la vie de Marie, « en soulignant sa pureté et sa dignité exceptionnelles, devient la preuve de l’absence du péché en elle, et donc du fait qu’elle est digne d’être honorée par la fête de l’Immaculée Conception » (Ruini 2011, p. IV). Parmi nos trois manuscrits, cependant, seul le n. 3 garde cette disposition, en faisant suivre à la mise en prose le chapitre de la Nativité de la Vierge tiré de la Légende dorée ; le ms 1 adopte l’ordre inverse et le n. 2 situe le miracle après l’Assomption.
L’analyse de Ruini, le seul à s’être intéressé à cette mise en prose après Meyer, montre bien la proximité entre le poème source et sa réécriture : le prosateur conserve souvent des vers entiers (v. 16-17 : « Li rois Herauz i fu ocis/ Dont fu Guillaume dus et rois », l. 6-7 : « et y fu li roys Herauz ocis : donc fu Guillaume dux et roys » ; v. 93 : « Tuit ierent a noier torné », l. 18 : « Toz furent a noier tornez », etc.), ou se limite à des retouches de surface (v. 67-68 : « En haute mer ja loing estoient,/ Fors mer et ciel riens ne veoient », l. 15 « En haute mer ja loing estoient et ne veoient fors ciel et mer » ; v. 157-158 : « Et cil lor nef apereillierent,/ En Engleterre repererent », l. 29-30 : « et li mariner lor nef appareillierent et reperierent sauvement en Engleterre ») (Ruini 2011, p. 347-348).
(B) la source
Wace, Conception Nostre Dame (1130-1155), poème de 1836 octosyllabes à rimes plates (dans l’éd. Ruini) ; la mise en prose concerne les v. 1-180.
6425 manuscrits (liste et sigles de Ruini 2011), dont seuls les n. 1-3, 6, 9, 12-13, 17, 19-22, 25 contiennent le miracle initial. La collation entre ces manuscrits et la mise en prose n’a pas permis à Ruini d’identifier le modèle utilisé par le prosateur.
(1) Paris, BnF, fr. 19166(A) ; (2) London, BL, Add. 15606 (B) ; (3) Carpentras, BM, 473 (C) ; (4) London, BL, Cotton Vitellius A-X (D) ; (5) Vaticano, BAV, Ottob. lat. 1473 (E) ; (6) Vaticano, BAV, Patetta 74 (F) ; (7) Torino, BNU, L-II-19 (G) ; (8) London, BL, Roy. 2-A-IX (I) ; (9) Cambridge, St John’s Coll., B-9 (31) (J) ; (10) Paris, BnF, fr. 25439 (K) ; (11) Lyon, BM, 739 (645) (L) ; (12) Paris, BnF, fr. 25532 (M) ; (13) Paris, BnF, n.a.fr. 13521 (N) ; (14) Paris, BnF, Moreau 1715-1719 (N1) ; (15) Oxford, U. Coll., 100 (O) ; (16) Paris, BnF, fr. 1526 (P) ; (17) Paris, BnF, Duchesne 79 (Q) ; (18) Paris, BnF, fr. 1504 (Q1) ; (19) Paris, BnF, fr. 818 (R) ; (20) Paris, BnF, fr. 24429 (S) ; (21) Tours, BM, 927 (T) ; (22) Vaticano, BAV, Reg. lat. 1682 (V) ; (23) Paris, BnF, lat. 5002 (W) ; (24) Paris, B. Arsenal, 3516 (X) ; (25) Paris, BnF, fr. 1527 (Z)
éditions
G. Mancel, G.-S. Trébutien1842, L’Établissement de la fête de la Conception Notre-Dame, dite la fête aux Normands, par Wace, trouvère anglo-normand du xiie siècle, publiée pour la première fois d’après les manuscrits de la Bibliothèque du Roi, Caen, Mancel
V. Luzarche 1859, La vie de la Vierge Marie de maître Wace, publiée d’après un manuscrit inconnu aux premiers éditeurs, suivie de la Vie de saint George, poème inédit du même trouvère, Tours, Bouserez
W. R. Ashford 1933, The Conception of Nostre Dame of Wace, Chicago, The University of Chicago
D. Ruini 2011, La Conception Nostre Dame di Wace. Edizione critica, Tesi della Scuola di Dottorato europea in Filologia Romanza dell’Università di Siena, dir. R. Crespo
J. Blaker, G. S. Burgess, A. V. Ogden 2013, Wace, the Hagiographical Works : the Conception Nostre Dame and the Lives of st. Margaret and st. Nicholas, Leiden, Brill [avec traduction anglaise en regard]
F. Laurent, F. LeSaux, N. Bragantini-Maillard 2019, Wace, Vie de sainte Marguerite, Conception Nostre Dame, Vie de saint Nicolas, Paris, Honoré Champion [avec traduction en français moderne en regard]
65(C) histoire de la prose
La mise en prose de la Conception Nostre Dame n’a connu aucune diffusion ultérieure.
(D) bibliographie
(1) édition
D. Ruini 2011, La Conception Nostre Dame di Wace. Edizione critica, Tesi della Scuola di Dottorato europea in Filologia Romanza dell’Università di Siena, dir. R. Crespo, p. 344-349 [texte du ms 2, avec les variantes de 1 ; Ruini ne cite pas notre ms 3]
(2) bibliographie critique
P. Meyer 1906, « Légendes hagiographiques en français. II. Légendes en prose », in Histoire Littéraire de la France, 33, p. 378-458 (p. 425)